La date/heure actuelle est Ven 19 Avr - 7:02
323 résultats trouvés pour historique
John Barth
Le Courtier en tabac
J'ai enfin lu ces 770 pages, mais en sors un peu déçu.
Dans l’Angleterre de la fin du XVIIe, Burlingame, le précepteur des jumeaux Ebenezer et Anna Cooke, fut très jeune marin au long cours et ambulant avec les bohémiens, puis fréquenta Henry More et Newton. Il donne une éducation hétéroclite à Ebenezer, qui est surtout indécis et indolent (et idéaliste et vaniteux), et se présente comme « vierge et poète ». Ebenezer, nommé lauréat par Lord Baltimore et amoureux de la putain Joan Toast, retourne au Maryland où il est né, à Malden, terre de son père pionnier. Il devait être accompagné par Burlingame, qui s’entremet dans les intrigues et rivalités de cette possession anglaise, à la recherche de ses origines dans cette contrée où il fut abandonné très jeune. C’est en fait Bertrand, le valet d’Ebenezer, qui accompagne ce dernier dans la traversée, se faisant passer pour lui dans une cascade de quiproquos et rebondissements. C’est fort rocambolesque, et l’écart est grand entre la réalité prosaïque et les aspirations d’Ebenezer, entre le vieux monde et la nouvelle terre, mais moins entre innocence et ignorance.
John Barth se réclame de la littérature du XVIIIe et tout particulièrement de Fielding dans cette « fantaisie », et celle-ci renvoie surtout à Butler (l’hudibrastique »).
La longueur du récit elle-même, ses « circuits » (détours), « écarts » (déviations, digressions, tels les commentaires) et ramifications embrouillées (tout particulièrement juridiques), la restitution détaillée de l’Histoire (notamment l’affrontement catholiques et protestants) et de l’époque jusque dans le langage et même la vêture (apparemment très bien rendus par le traducteur, Claro, quoiqu’il employât « ramenteva » pour « ramentut »), caractérisent les intérêts de cet « à la manière de », roman à tiroirs, picaresque, d'aventures et d'apprentissage XVIIIe, qui autrement s’avère assez vain. Outre ses fastidieuses circonlocutions de pensum, l’humour scabreux et scatologique m’a semblé sordide et complaisant, malgré la référence à Rabelais, qui ne me l’a jamais paru. Et le pastiche n’atteint pas au Nom de la rose d’Eco, entr'autres réactualisations de ces beau style et tour de pensée.
« Mais dans son cœur, la mort et toutes ses semblables anticipations étaient pour Ebenezer comme la vie, l’histoire et la géographie, lesquelles, de par son éducation et ses dispositions naturelles, il regardait toujours du point de vue du narrateur ; il en connaissait abstraitement la finalité ; il en goûtait indirectement l’horreur ; mais il ne pouvait jamais en éprouver les deux ensemble. Ces vies sont des histoires, admettait-il ; ces histoires ont une fin, reconnaissait-il – comment sinon en pourrait-on débuter une autre ? Mais que le conteur lui-même puisse vivre un conte propre et mourir… Inconcevable ! Inconcevable ! »
Je pense qu'il y a un rapprochement possible avec le Pynchon de Mason & Dixon, mais assez distant.
\Mots-clés : #aventure #colonisation #esclavage #historique #initiatique #prostitution #relationenfantparent #religion #voyage
- le Jeu 3 Aoû - 13:17
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: John Barth
- Réponses: 15
- Vues: 892
Philip Kerr
Une douce flamme
« Le navire était le SS Giovanni, ce qui semblait tout à fait approprié puisque trois au moins de ses passagers, moi y compris, avaient appartenu à la SS. »
Avec cet incipit, Bernhard (Bernie) Gunther, alias Doktor Carlos Hausner, nous apprend qu’il rejoint l’Argentine avec Herbert Kuhlmann et… Adolf Eichmann…
Nous sommes à Buenos Aires en 1950, et le roman s’y passe (ainsi qu’à Tucumán), mais aussi à Berlin en 1932, quand Gunther y vivait la chute de la République de Weimar avec son sergent Heinrich Grund. Ce dernier est alors un fervent partisan du parti national-socialiste, qui s’oppose au SPD, « Front de fer », le parti social-démocrate, et prend le pouvoir.
L’Argentine est le salut de nombre de « vieux camarades » dans l’après-guerre, quoique…
« À Buenos Aires, il vaut mieux tout savoir qu’en savoir trop »
Le Troisième Reich s’est effondré, mais ses rescapés survivent en exil et s’organisent sous le régime de Juan (et Evita) Perón, continuant à perpétrer leurs crimes, même s’ils ne sont plus de guerre.
« — Tous les journaux sont fascistes par nature, Bernie. Quel que soit le pays. Tous les rédacteurs en chef sont des dictateurs. Tout journalisme est autoritaire. Voilà pourquoi les gens s’en servent pour tapisser les cages à oiseaux. »
« Qu’est-ce que prétend Hitler ? demandai-je. Que la force réside non dans la défense mais dans l’attaque ? »
Gunther est recruté par le SIDE, les services de renseignement péronistes, et enquête sur la mort de jeunes adolescentes auxquelles on a enlevé l’appareil génital. Il rapproche ces crimes d’une affaire similaire non élucidée en 1932 ; il apparaît qu’ils furent perpétrés pour dissimuler des avortements ratés par des psychopathes ayant profité de l’aubaine constituée par le nazisme ; Bernie retrouvera notamment le Dr Hans Kammler (ingénieur responsable « de tous les grands projets de construction SS pendant la guerre », et Herr Doktor Mengele…
« Pour être un grand détective, il faut être aussi un protagoniste. Un personnage dynamique qui provoque les événements rien qu’en étant lui-même. Et je pense que vous appartenez à cette catégorie, Gunther. »
Il se confie aussi, bourrelé par sa mauvaise conscience, à Anna, son amante juive.
« Tous les Allemands portent en eux l’image d’Adolf Hitler, dis-je. Même ceux qui, comme moi, le haïssaient, lui et tout ce qu’il représentait. Ce visage, avec ses cheveux ébouriffés et sa moustache en timbre-poste, continue de nous hanter, aujourd’hui encore et à jamais, et, telle une douce flamme impossible à éteindre, brûle dans nos âmes. Les nazis parlaient d’un Reich de mille ans. Mais, parfois, je me dis qu’à cause de ce que nous avons fait, le nom de l’Allemagne et les Allemands sont couverts d’infamie pour mille ans. Qu’il faudra au reste du monde mille ans pour oublier. Vivrais-je un millier d’années que jamais je n’oublierais certaines des choses que j’ai vues. Et certaines de celles que j’ai commises. »
« J’en veux aux communistes d’avoir appelé en novembre 1932 à la grève générale qui a précipité la tenue d’élections. J’en veux à Hindenburg d’avoir été trop vieux pour se débarrasser de Hitler. J’en veux aux six millions de chômeurs – un tiers de la population active – d’avoir désiré un emploi à n’importe quel prix, même au prix d’Adolf Hitler. J’en veux à l’armée de ne pas avoir mis fin aux violences dans les rues pendant la République de Weimar et d’avoir soutenu Hitler en 1933. J’en veux aux Français. J’en veux à Schleicher. J’en veux aux Britanniques. J’en veux à Gœbbels et à tous ces hommes d’affaires bourrés de fric qui ont financé les nazis. J’en veux à Papen et à Rathenau, à Ebert et à Scheidemann, à Liebknecht et à Rosa Luxemburg. J’en veux aux spartakistes et aux Freikorps. J’en veux à la Grande Guerre d’avoir ôté toute valeur à la vie humaine. J’en veux à l’inflation, au Bauhaus, à Dada et à Max Reinhardt. J’en veux à Himmler, à Gœring, à Hitler et à la SS, à Weimar, aux putains et aux maquereaux. Mais, par-dessus tout, je m’en veux à moi-même. Je m’en veux de n’avoir rien fait. Ce qui est moins que ce que j’aurais dû faire. Ce qui est tout ce dont le nazisme avait besoin pour l’emporter. Je suis coupable, moi aussi. J’ai mis ma survie au-dessus de toute autre considération. C’est une évidence. Si j’étais vraiment innocent, je serais mort, Anna. Ce qui n’est pas le cas. »
« — Mon ange, s’il y a bien une chose qu’a montrée la dernière guerre, c’est que n’importe qui peut tuer n’importe qui. Tout ce qu’il faut, c’est un motif. Et une arme.
— Je n’y crois pas.
— Il n’y a pas de tueurs. Seulement des plombiers, des commerçants, et aussi des avocats. Chacun est parfaitement normal jusqu’à ce qu’il appuie sur la détente. Il n’en faut pas plus pour livrer une guerre. Des tas de gens ordinaires pour tuer des tas d’autres gens ordinaires. Rien de plus facile. »
Entr’autres lieux communs, on fera une petite virée au-dessus du Rio de la Plata avec des opposants de Perón, et on retrouvera même les ruines d’un camp d’extermination de Juifs dans la pampa, mais cette approche d’une Histoire si difficile à comprendre ne m’a pas paru vaine, même si elle peut sembler oiseuse, ou simpliste. Kerr donne quelques éclaircissements sur ses sources en fin d’ouvrage.
\Mots-clés : #antisémitisme #communautejuive #criminalite #culpabilité #deuxiemeguerre #exil #guerre #historique #politique #xxesiecle
- le Lun 31 Juil - 15:06
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Philip Kerr
- Réponses: 12
- Vues: 1240
Gerald Basil Edwards
Le livre d'Ebenezer Le Page
Le narrateur, le vieil Ebenezer Le Page, présente d’abord ses antécédents.
« Il est dit dans la Bible : « Regarde la pierre dans laquelle tu as été sculpté et le puits dont tu fus extrait. » Eh bien, ces gens sont la pierre dans laquelle j’ai été sculpté et le puits dont j’ai été extrait. Je n’ai pas parlé de mes cousins, ou des cousins de mes cousins, mais il faut dire que la moitié des gens de l’île sont mes cousins, ou les cousins de mes cousins. »
« C’est ça l’ennui, dans le fait d’écrire la vraie histoire de ma famille, ou la mienne, d’ailleurs. Je n’en connais ni le commencement ni la fin. »
Et c’est, plus qu’un roman et/ou autobiographie (ou plutôt une autofiction ?), une histoire de famille autant qu’une chronique de Guernesey (Sarnia en latin) de la fin du XIXe siècle au début des années 1960, tant la parentèle est importante dans ce milieu insulaire. De même, c’est toute l’époque qui est revisitée.
Souvenirs précis rapportés en détail par un vieillard évidemment nostalgique, manifestement doué d’un caractère entier. Simple pêcheur et producteur de légumes en serre, Ebenezer est observateur, et n’aime pas le changement dans l’île qu’il n’a guère quittée pendant près d’un siècle :
« Dieu a doté cette île d’un bon sol et d’un bon climat, particulièrement propres à faire pousser des fruits, des légumes et des fleurs, et à engendrer deux sortes de créatures : les vaches de Guernesey et les gens de Guernesey. J’aurais cru que les États tiendraient à protéger ces espèces, mais il n’y a visiblement plus de place pour elles. »
Sa mère avec qui il vit jusqu’à sa mort (puis avec Tabitha sa sœur), Jim son ami qui mourra à la Première Guerre, et Liza, une de ses petites amies mais son seul amour et jamais accompli, se distinguent dans la foule de personnages qui sont décrits, sans plus nuire à la compréhension que les personnes inconnues évoquées dans une conversation agréable. Remarquables sont également ses deux tantes, la Hetty et la Prissy, mariées à Harold et Percy Martel (des constructeurs dans le bâtiment), et leurs fils Raymond (qui prendra une grande place dans ses affections) et Horace, dans les maisons voisines de Wallaballoo et Tombouctou : elles sont souvent aux prises l’une avec l’autre, entre chicanes et brouilles.
L’opinion d’Ebenezer (et d’autres Guernesiais) sur les femmes et le mariage explique au moins en partie qu’il soit demeuré célibataire.
« J’ai commis une grave erreur dans ma jeunesse. Je pensais à ce moment-là que les filles étaient des êtres humains comme nous, mais c’est faux. Elles sont toujours en quête de quelque chose, de votre corps, de votre argent, ou d’un père pour leurs enfants, et si ce n’est pas le cas, elles veulent quand même que vous deveniez quelqu’un ou que vous fassiez quelque chose qui leur apportera la gloire. Ça ne leur suffit jamais de vous laisser vivre et de vivre avec vous.
– Tu sais, j’ai répliqué, les hommes aussi en ont toujours après quelque chose. »
L’île est protestante, de diverses obédiences (surtout méthodistes et anglicans, mais aussi quelques catholiques ou « papistes »).
« Je dois reconnaître que dans la famille de ma mère, ils ne passaient pas leur temps à essayer de convertir tout le monde. Ils savaient qu’ils étaient dans le vrai et si les autres ne l’étaient pas, c’était leur problème. »
« Je ne sais pas ce que c’est qu’un païen, j’ai répondu, je ne peux donc pas dire si je le suis ou pas, mais je ne sais pas non plus ce qu’est un chrétien. Il y en a des milliers de toutes sortes sur cette île. Ce ne sont peut-être pas tous des dévergondés, du moins pas ouvertement, mais ils partent à la guerre et tuent d’autres gens, et en temps de paix, ils gagnent autant d’argent qu’ils le peuvent sur le dos les uns des autres et ils n’aiment pas plus leur prochain que moi. »
« La religion de ma mère est de loin la plus terrifiante dont j’ai jamais entendu parler. […] Le plus effroyable, c’est que l’endroit où l’on finirait était décidé avant même notre naissance, et qu’il n’y avait rien à y faire. »
Raymond s’est toujours senti la vocation de pasteur, mais sa conception de l’amour divin l’écarte du sacerdoce ; son destin assez dramatique en fait un personnage central, juste après Ebenezer.
« Comme je l’ai déjà dit, je n’aime pas les prêcheurs. Ils se hissent sur un piédestal et prétendent être le porte-parole de la volonté divine en vous assurant que toute autre opinion est le fruit du Diable. J’aime quand les gens disent carrément ce qu’ils pensent sur le moment et se fichent pas mal d’avoir tort ou raison. »
« « Après tout, disais-je, il y a quand même eu des progrès, tu sais. Le monde s’améliore lentement, du moins on peut l’espérer. » C’était le genre d’idée qui le mettait en rage. « Le monde s’est-il amélioré de ton temps ? demandait-il [Raymond]. – Eh bien, je ne sais pas, peut-être pas au point qu’on le remarque, je répondais. – Non, pas plus que du temps de n’importe qui d’autre ! Ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre. Le progrès, c’est la carotte pendue devant l’âne pour le faire tourner en rond. »
Relativement nombreux sont les insulaires tentés par l’émigration. La Première Guerre mondiale ne touche pas directement l’île, mais décime sa jeunesse envoyée au combat. Pendant la Seconde, c’est l’Occupation allemande, famine, et collaboration de certains.
« C’est la seule fois où il [Raymond] ait un peu parlé de la guerre. « Hitler, c’est l’Ancien Testament qui recommence, a-t-il dit. Pas étonnant qu’il déteste les Juifs. » Je ne l’ai pas compris alors, et un tas d’autres réflexions qu’il lâchait brusquement de temps à autre m’échappaient. Cette fois-là, je lui ai demandé ce qu’il entendait par là.
« Méfie-toi de ceux qui se prétendent désignés par l’Histoire ou par Dieu. Ils se sont désignés eux-mêmes. Il n’y a pas de Peuple Élu, a-t-il déclaré. – Ce n’était pas l’avis de ma mère. Elle y croyait, elle, aux Élus de Dieu. – Les communistes aussi, a-t-il rétorqué. C’est ce qu’ils appellent le Prolétariat. Les nazis les appellent les Aryens. Ça revient au même. L’État totalitaire. Rien n’est plus faux. La véritable totalité est inaccessible au cœur et à l’esprit des hommes. Au mieux, nous ne faisons que l’entrevoir. – Ça, je l’ignore, ai-je dit. Je n’en ai même jamais eu le moindre aperçu. – Ça vaut mieux que de s’imaginer qu’on sait tout, a-t-il répliqué. Dieu merci, je suis un îlien, et je ne serai jamais rien de plus. » Je me demande ce qu’il penserait s’il était encore en vie aujourd’hui. Guernesey devient chaque jour de plus en plus un État totalitaire. J’ai l’impression que c’est Hitler qui a gagné la guerre. »
« Quant à moi, je ne me sortirai pas de la tête qu’après la Libération, nous avons eu une chance unique de repartir à zéro. Mais pour je ne sais quelle raison, Guernesey a pris un mauvais tournant, même si elle n’a pas dégringolé la pente aussi vite et aussi volontiers que Jersey. La routine reprenait ses droits, mais en pire. Le chien retournait à son vomi et la truie se vautrait dans la fange. [Pierre] Il y avait sûrement autre chose à faire. Je ne sais pas quoi exactement. Je n’ai aucun droit de critiquer. Je me souviens trop bien comment, dans les pires moments, je me fichais pas mal de tout et de tout le monde, à part moi. Et je n’étais pas le seul. Si c’est bien là la vérité, alors mieux vaut encore ne pas la connaître. C’est peut-être la seule leçon qu’on ait tirée de l’Occupation, sauf que ça n’était pas la bonne. »
C’est aussi l’occasion de quelques scènes cocasses, comme les fouilles archéologiques de vestiges proches des Moulins, où Ebenezer demeure. Malgré ses nombreuses préventions de casanier misanthrope, Ebenezer noue étonnamment des liens d’amitié avec des « ennemis », un Jersiais catholique, un occupant allemand : c’est apparemment la personne qui compte pour lui, pas son appartenance.
« Se battre, forniquer et gagner de l’argent sont les choses les plus faciles au monde. Ayant moi-même pratiqué les trois, je sais de quoi je parle. Je continue à gagner de l’argent comme je peux. Quand on a commencé, on ne peut plus s’arrêter. Cet argent m’en rapporterait lui-même encore plus si je l’avais mis à la banque et touchais les intérêts tous les ans. « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l’abondance mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. » [Matthieu] L’ennui, maintenant que je l’ai, c’est que je ne sais pas quoi en faire. Je ne vivrai pas éternellement et il faut bien que je le lègue à quelqu’un. J’ai dû parcourir plusieurs centaines de kilomètres ces dernières années pour rendre visite à des parents plus ou moins éloignés à la recherche d’un héritier valable. »
Ebenezer parvient finalement à se trouver un digne héritier, Neville Falla, qui plus jeune avait cassé des vitres de sa serre, a gardé une réputation de voyou et est devenu un peintre enthousiaste.
« Je me suis dit que c’était lui l’ancêtre et moi le jeune, car de nos jours les enfants naissent déjà vieux et c’est à nous, les anciens, de leur apprendre à retrouver leur jeunesse. »
« De nos jours, quand on discute avec les gens, rien n’existe à moins que la télé en ait parlé. Elle donne aux gens l’impression d’avoir tout vu et de tout savoir, alors qu’ils n’ont jamais rien vu et ne savent rien. C’est la drogue la plus nocive au monde. Les gens poussent de grands cris indignés quand les jeunes fument de l’herbe. Mais la télévision est l’herbe de millions de drogués qui, les yeux ronds, la regardent tous les soirs. »
J’ai lu sans ennui ces quelques 600 pages, et sans doute leur charme tient aux grandes justesse et humanité dans le rendu, à tel point que le lecteur peine à croire à une fiction. Style conventionnel, jusqu’au relatif happy end en passant par un respect global de la chronologie. Mention spéciale pour les trop rares expressions en guernesiais, proche du normand.
\Mots-clés : #historique #identite #insularite #lieu #religion #ruralité #temoignage #vieillesse #xxesiecle
- le Mer 31 Mai - 13:32
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Gerald Basil Edwards
- Réponses: 3
- Vues: 282
Leonardo Sciascia
Les Paroisses de Regalpetra
Dans son Avertissement, Sciascia donne la chronique de cette petite ville fictive qui ressemble à celle de ses origines, Racalmuto, comme à nombre d’autres en Sicile : pressurisation des paysans et les mineurs (soufre, sel), les braccianti, depuis les comtes du XVIIe jusqu’au fascisme, excluant uniquement les fonctionnaires des Bourbons.
Dans Brève chronique d’un régime, c’est l’enfance du narrateur (Sciascia) sous le fascisme.
« À l’exception de quelques petites invectives, je n’entendais dire que du bien de Mussolini et du fascisme. »
En grandissant, s’épuise l’évidence du fascisme et de son embrigadement, de ses guerres en Éthiopie et en Espagne.
« C’est ça, la dictature : un soupçon venimeux, un réseau de trahisons et de tromperies humaines. »
Compte rendu édifiant instructif du Cercle de la Concorde, celui des galantuomini (mais malheureusement il faudrait bien connaître l’histoire et la politique italiennes pour le savourer en détail). Puis Sciascia est instituteur au bourg, avec des élèves affamés, sans autre perspective que la faim ou l’émigration, dont il désigne chaque jour les heureux bénéficiaires de la cantine.
« Si je m’habitue à cette anatomie quotidienne de misère, d’instincts, à ce cruel rapport humain, si je commence à la voir dans sa nécessité et sa fatalité, comme d’un corps qui est ainsi fait et qui ne peut pas être différent, j’aurai perdu ce sentiment, d’espoir et d’autre chose, qui est, je crois, ce que j’ai de meilleur en moi. »
Les ouvriers sauniers : passage qui vaut document sur leur misérable condition.
Journal d’une campagne électorale : celle de 1955, avec une multitude de partis dans une curieuse démocratie, très « pirandellienne ».
La neige, Noël : le froid ajoute à la pauvreté.
« Moi, le jour de Noël, j’ai joué avec mes cousins et mes camarades. J’avais gagné deux cents lires et quand je suis rentré, mon père me les a prises et c’est lui qui s’en est allé s’amuser. »
Sont marquants les ascendants des prêtres et de la mafia ; j'ai été surpris du renoncement impuissant de Sciascia instituteur.
\Mots-clés : #biographie #corruption #historique #misere #politique #ruralité #xxesiecle
- le Mer 17 Mai - 12:40
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Leonardo Sciascia
- Réponses: 14
- Vues: 2234
Taylor Brown
Le fleuve des rois
Un an après le décès de leur père, vétéran du Vietnam et pêcheur de crevettes qui aurait été tué par le saut d’un esturgeon, ses deux fils Lawton et Hunter descendent en cinq jours de kayak l’Altamaha River pour disperser ses cendres dans l’estuaire, où se situe la ville de Darien, fondée au XVIIIe par les Écossais. Lawton, l’aîné, un commando de marine, décide d’enquêter sur la mort de leur père.
En parallèle de ce périple est rapporté ceux de Jacques Le Moyne de Morgues, illustrateur et cartographe luthérien du XVIe (des gravures tirées de son œuvre sont insérées dans le livre) et de l’interprète La Caille dans les expéditions de Laudonnière, qui fonde Fort Caroline en Nouvelle-France. Les Français sont « en porte-à-faux avec deux tribus en guerre », commandées par les chefs Saturiwa et Utina ; ils sont aussi en conflit avec les Espagnols (catholiques), et souffrent de la faim en attendant le ravitaillement devant venir d’Europe ; des désertions et une mutinerie les affaiblissent encore : ils rêvent de l’or des Appalaches, et de celui obtenu par les pirates dans les îles Caraïbes.
« Fais attention, Le Moyne. Un jour, tes dessins seront peut-être la seule chose qui restera de nous. Après tout, le Christ Lui-même continue à vivre dans un livre. »
Hiram Loggins, dont les tatouages le brûlent en cas de danger, récupère avec son chalutier les « mérous carrés », colis de marijuana colombienne, jusqu’à ce que son bateau soit saisi. Il se réfugie sur le fleuve, et a une liaison charnelle avec Annabelle Mackintosh, descendante des premiers immigrants écossais. Il s’avère que c’est le père de Lawton et Hunter ; et on le suit, perdant son nouveau chalutier dans un ouragan, et pensant trouver enfin un retour de fortune.
Le fleuve géorgien, resté sauvage, constitue le thème central des trois récits entrecroisés, d’autant qu’il serait le refuge d’un cryptide, l’Altamaha-ha, une sorte de dragon, grand serpent d’eau ou dinosaure déjà aperçu par les Indiens et Le Moyne. Un vieil homme illuminé, le révérend Uncle King, guette ce monstre avec un harpon. Il s’avèrera qu’il était ami d’enfance et frère de sang de Hiram.
Ce qui m’a retenu, c’est l’étonnante nature marécageuse, avec ses tupélos, gommiers et surtout les cyprès chauves, parfois multicentenaires, dont les pneumatophores émergent autour de la base du tronc comme des genoux ou des stalagmites, mais aussi ses poissons-chats, têtes-plates, brochets-crocodiles ou alligators et ses esturgeons, encore les bûcherons, radeliers et maisons flottantes du passé récent.
Mais je n’ai pas trop apprécié le ton du récit, un peu maladroit, didactique et compassé (aussi sensationnel thriller), à moins que ce ne soit dû à la traduction (qui n’évite pas mains « caleuses » pour calleuses et « chevrotine » pour grenaille).
\Mots-clés : #amérindiens #historique #merlacriviere #nature #violence
- le Mer 3 Mai - 11:19
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Taylor Brown
- Réponses: 2
- Vues: 202
Jean-Paul Kauffmann
Remonter la Marne
Voyage pédestre solitaire, d’abord dans la région parisienne au départ de Charenton, puis en suivant le chemin de halage.
Outre celles à l’Histoire (et tout particulièrement les guerres), les évocations littéraires sont fréquentes, notamment de Francis Ponge, et Bachelard.
« Bossuet fait preuve d’une efficacité sans égale, mais il aimait aussi bousculer les mots. Le bousculé, c’est peut-être cela, l’idéal. Une certaine imperfection, en tout cas de négligé – pas de négligence – que Jacques Rivière a parfaitement défini : « Je ne sais quoi de dédaigneux de ses aises, d’à moitié campé, de précaire et de profond, l’incommodité des situations extrêmes. Un esprit toujours en avant et au danger. » Un modèle comme Saint-Simon commet lui aussi nombre d’incorrections et n’hésite pas à malmener la langue. Ce côté risqué, inconfortable, est ce qui convient le mieux au français. Quelque chose d’expéditif, de dégagé dans la tenue. Une forme de desserrement, venu sans peine. Pour moi, le comble de l’élégance. La grâce. Cependant, il ne faut pas que cela se voie. »
« Dans cette progression, l’imprévu se voit de loin. Une barque, un promeneur, une chapelle, on a le temps de s’y habituer. La marche annonce longtemps à l’avance le moindre changement. La vie du promeneur fluvial ne connaît pas de hauts ni de bas, elle suit la platitude moelleuse et l’uniformité du cours d’eau, sa pondération un peu ennuyeuse. Ce dispositif assure le pilotage automatique du marcheur. Le long de la berge, pas besoin de réfléchir, il suffit d’accompagner le flux. Pas de carte à consulter, pas d’inscriptions à déchiffrer, casse-tête de la randonnée. Cette déambulation quasi somnambulique est reposante, elle permet de s’absorber spacieusement dans ses pensées sans perdre de vue la rivière.
L’eau exhale un parfum de feuilles mortes, d’infusion à froid, cette empreinte entêtante d’eau verte et terreuse, bouffées mouillées que ramène inlassablement le vent dans mes narines. Cette haleine de liquide bourbeux rappelle la canalisation d’eau suintante, une sensation de rouillé, de renfermé, paradoxalement rafraîchissante. Si c’était un son, ce serait une basse continue. Sentiment de bien-être légèrement litanique, perception de déjà-senti. Dans ce déroulé monotone, l’olfaction est le sens le plus sollicité. »
Les impressions olfactives sont effectivement prépondérantes dans tout le récit.
Un temps, Kauffmann chemine avec son ami Milan (en qui il faut vraisemblablement reconnaître le photographe Gérard Rondeau, auteur de La Grande Rivière Marne), en Champagne (champagne et jansénisme).
« La voiture, qui permet d’accéder promptement au cœur d’un village, ne met en mouvement que le cerveau ; manqueront toujours le toucher, le contact physique, cette friction de la plante des pieds et du talon avec le sol, sans lesquels l’expérience de la vie immédiate est incomplète. Les orteils palpant la surface de la croûte terrestre nous renseignent mieux que la tête sur la consistance des choses.
Le sac à dos modifie le regard d’autrui. Autrefois, le chemineau était perçu comme un vagabond. Aujourd’hui, le randonneur est considéré comme appartenant à une espèce à part, impossible à classer. Il cache une autre vie. Que fait-il quand il ne marche pas ? Il n’est pas socialement identifiable. L’anorak, le bâton, l’équipement, qui tiennent lieu d’uniforme, font l’effet d’un camouflage. »
Kauffmann tourne autour de la notion de décadence, qu’il réfute ; il préfère celle de changement d’époque dans « l’angoisse générale » de la mondialisation et de déclin rural, tout en étant accablé de cette désolation, à laquelle résistent quelques « conjurateurs ».
« Chaque époque a la vanité de croire que ses interrogations sont absolument inédites et capitales. Ainsi, nous pensons actuellement que nous avons atteint un point de non-retour. Rien ne sera plus comme avant, nous assistons à des bouleversements comparables, paraît-il, à l’imprimerie, à la révolution copernicienne, alors que tout est conforme, rétréci, joué. Cette fin est consommée depuis longtemps. Il n’y a pas de quoi en faire un drame. Ce n’est ni un dépérissement ni une décadence, encore moins une agonie ou un épuisement. Simplement un accomplissement. Une saison se termine, une autre commence. »
« Plus que les signes de déliquescence dont on nous rebat les oreilles – Braudel, en 1981, s’élevait déjà contre le concept de décadence –, c’est l’état de vacance, un abandon mal camouflé, un renoncement qui se manifestent ce soir dans ce restaurant. »
Kauffmann s’intéresse d’ailleurs beaucoup au vocabulaire, usant de « patapharesque » et s’attardant sur un terme comme « rambleur » (lueur nocturne reflétant dans le ciel un incendie ou l'éclairage d'une ville ; Kauffmann semble en avoir une définition légèrement différente)…
Et bien sûr la rivière, ses méandres, ses noues, surtout observée lors d’une descente, embarqué avec le Maître des Eaux, de la Compagnie des rivières et des surfaces fluviatiles.
« Avant Cloyes, arrêt près de l’entrée d’une noue, monde mystérieux aux eaux calmes contrastant avec le bras vif sur lequel nous descendons à toute allure. Fraîcheur, troncs tordus, végétation luxuriante, vol d’insectes. Royaume du silence, mais cette intimité grouille d’une vie qui rumine, nichée dans les souches et les arbres morts, enfouie dans la vase et l’eau dormante. Des plantes rares comme l’utriculaire, fleur carnivore, se sont acclimatées à ce milieu.
Percées du soleil dans la caverne végétale, jeux de lumière sur l’eau immobile et épaisse, projection crue, acérée comme une perforation. Les taches étincelantes au contour net deviennent blanches par opposition au noir de la galerie et de l’eau. Odeur intense de champignonnière, règne du spongieux et du croupi. La décomposition embaume violemment. Un parfum sombre de souterrain, d’humus trempé. »
\Mots-clés : #historique #merlacriviere #mondialisation #nature #ruralité #voyage
- le Ven 28 Avr - 12:55
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean-Paul Kauffmann
- Réponses: 8
- Vues: 952
Philippe Descola
La Composition des mondes
Philippe Descola est pour le moins un digne continuateur de l’œuvre de Lévi-Strauss, et même si je connais peu son travail à ce jour, j’ai apprécié notamment Les lances du crépuscule (je peux vous baller un monceau de citations sur simple demande). Ces entretiens avec Pierre Charbonnier permettent d’aborder l’œuvre et l’homme de biais, aussi introduire à l’ethnographie (cet intérêt pour l’autre) contemporaine. (Dans le même esprit, on peut écouter actuellement https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/a-voix-nue/le-gout-des-autres-4725026, 5 x 28').
Étudiant engagé, Descola se tourne vers la philosophie, puis l’ethnologie.
« Au contraire du mythe populiste qui fait de la « génération 68 » des jouisseurs épris de facilité, beaucoup d’entre nous étions stimulés par la nécessité un peu grandiloquente de manifester une intelligence à la hauteur des circonstances. »
Choix de l’Amazonie comme terrain d’étude, avec Claude Lévi-Strauss comme directeur de thèse.
« C’est bien là que résidait le mystère à percer : ces tribus en apparence totalement anomiques, sans cesse traversées par des conflits sanglants, continuaient pourtant à manifester une très grande résilience malgré quatre siècles de massacres, de spoliations territoriales et d’effondrement démographique provoqué par les maladies infectieuses. Où était leur ressort ? Comment définir ce qui, chez elles, faisait société ? »
Aussi une conscience écologique, c'est-à-dire du rapport à la nature, qui n’était pas courante dans les années 70. Évidemment marqué par le creuset de l’ethnologie américaniste,
« …] prendre les sociétés indigènes d’Amérique du Sud comme une totalité à multiples facettes et non comme réparties entre des blocs géographiques et culturels intrinsèquement différents. »
… et le structuralisme anthropologique,
« …] l’idée d’une combinatoire rendant compte de tous les états d’un ensemble par les différences systématiques qui opposent ses éléments. »
Rôle majeur du Laboratoire d’anthropologie sociale,
« Le choix même du terme « laboratoire », inusité à l’époque dans les sciences sociales, signalait déjà la volonté de placer la recherche en anthropologie sur un pied d’égalité avec les sciences expérimentales, en mettant l’accent autant sur l’enquête de terrain que sur ce qui vaut expérimentation dans notre discipline, à savoir l’élaboration de modèles susceptibles être comparés. Si l’ethnographie est une démarche nécessairement individuelle, l’ethnologie et l’anthropologie supposent en revanche non pas tant un travail collectif que l’existence d’un collectif de chercheurs, réunis avec leurs diverses compétences ethnographiques dans un lieu où ils peuvent échanger jour après jour informations, hypothèses et appréciations critiques, et disposant en outre de l’ample documentation et des systèmes modernes de traitement des données indispensables à leur entreprise. »
… création de Lévi-Strauss.
« Il a toujours encouragé l’originalité chez ceux qui le côtoyaient et découragé les tentatives de faire la même chose que lui. De ce point de vue, la seule exigence qui comptait était celle que l’on s’imposait à soi-même afin d’être digne de celle qu’il s’imposait à lui-même. Pour ma part, et cela depuis ce premier exposé dans son séminaire qui a été publié par la suite dans L’Homme, j’ai toujours écrit pour Lévi-Strauss. On écrit souvent en ayant un lecteur à l’esprit, et le lecteur que je me suis choisi dès l’origine, c’est lui. En effet, outre ses compétences et son savoir d’anthropologue, outre son imagination théorique et son jugement acéré, outre sa familiarité avec les problèmes philosophiques et son talent d’écrivain, Lévi-Strauss avait une grande connaissance de la nature – de la botanique, de la zoologie, de l’écologie – et il avait prêté une attention toute particulière à la façon dont l’esprit exploite les qualités qu’il perçoit dans les objets naturels pour en faire la matière de constructions symboliques complexes et parfois très poétiques. J’éprouvais ainsi une affinité profonde avec sa pensée, et c’est l’une des raisons qui expliquent ce choix de le considérer comme un lecteur idéal de mon travail. »
Rôle important également de Françoise Héritier qui lui fait briguer le Collège de France.
« Au fond, je poursuis l’entreprise que j’avais amorcée à l’École des hautes études, qui est d’explorer des domaines nouveaux, et donc de ne jamais enseigner les choses que je sais déjà, mais plutôt des choses que je suis en train de découvrir ou d’apprendre à connaître. »
À propos de son approche dans sa monographie sur les Achuars :
« Pourtant, en proscrivant toute référence ouverte à sa subjectivité, l’ethnologue se condamne à laisser dans l’ombre ce qui fait la particularité de sa démarche au sein des sciences humaines, un savoir fondé sur la relation personnelle et continue d’un individu singulier avec d’autres individus singuliers, savoir issu d’un concours de circonstances à chaque fois différent, et qui n’est donc strictement comparable à aucun autre, pas même à celui forgé par ses prédécesseurs au contact de la même population. »
Un résumé de son ouvrage anthropologique, Par-delà nature et culture :
« Peut-être faut-il rappeler le point de départ de cet exercice d’ontologie structurale. C’est l’expérience de pensée d’un sujet : je ne peux détecter des qualités dans un autre indéterminé, humain ou non humain, qu’à la condition de pouvoir y reconnaître celles au moyen desquelles je m’appréhende moi-même. Or, celles-ci relèvent à la fois du plan de l’intériorité – états mentaux, intentionnalité, réflexivité… – et du plan de la physicalité – états et processus physiques, schèmes sensori-moteurs, sentiment interne du corps… Le noyau originaire est donc un invariant hypothétique, le rapport entre intériorité et physicalité, dont j’étudie les combinaisons possibles. Elles sont au nombre de quatre : ou bien les non-humains ont une intériorité de même type que la mienne, mais se distinguent de moi, et entre eux, par leurs capacités physiques, c’est ce que j’appelle l’animisme ; ou bien au contraire ils subissent le même genre de déterminations physiques que celles dont je fais l’expérience, mais ils n’ont pas d’intériorité, et c’est le naturalisme ; ou bien encore des humains et des non-humains partagent le même groupe de qualités physiques et morales, tout en se différenciant ainsi par paquets d’autres ensembles d’humains et de non-humains qui ont d’autres qualités physiques et morales en commun, et cela correspond au totémisme ; ou bien enfin chaque existant se démarque du reste par la combinaison propre de ses qualités physiques et morales qu’il faut alors pouvoir relier à celles des autres par des rapports de correspondance, et j’ai baptisé cela du nom d’analogisme. »
Du terrain à la théorie :
« Si l’on n’est pas soi-même passé par l’expérience ethnographique, si l’on ne sait pas de quoi sont faites les briques constitutives que l’on va chercher dans la littérature ethnographique afin de bricoler des modèles anthropologiques, l’on aura toute chance de ne pas prendre les bonnes briques ou de ne pas prendre ces premiers éléments pour ce qu’ils sont. Et c’est aussi en ce sens que le terrain est fondamental, parce qu’il nous donne une appréhension plus juste des conditions sous lesquelles est produit le savoir ethnographique que nous utilisons pour construire nos théories anthropologiques. »
Les plantes cultivées sont considérées comme de même filiation que les Achuars, et le gibier comme des parents par alliance. Dans La Nature domestique, l’ambition de Descola « était de mettre sur le même plan les systèmes techniques de construction et d’usage du milieu et les systèmes d’idées qui informaient ces pratiques. » C’est « l’étude d’un système d’interaction localisé dans lequel dimensions matérielles et dimensions idéelles sont étroitement mêlées » qui constate « l’usage de catégories sociales – en l’occurrence, la consanguinité et l’affinité – pour penser le rapport aux objets naturels. » Descola reprend le terme d’animisme pour désigner ce schème.
Le retour du terrain :
« Ainsi, lorsque l’on a passé plusieurs années avec très peu de biens matériels et que l’on s’est aperçu que, au fond, on n’en avait pas réellement besoin, on se trouve tout à fait décalé vis-à-vis de la surabondance d’artefacts et la valeur centrale accordée à la richesse. Manger au moins une fois par jour, dormir à l’abri de la pluie, une rivière à l’eau claire pour se laver deviennent le maximum auquel on aspire, de sorte que l’on se trouve sans repères lorsque l’on revient au sein d’un monde englué dans les objets. […] Et l’on ne peut manquer, dans ce genre de situations, d’être frappé par la pertinence des analyses que Marx consacre à ce qu’il appelle le « fétichisme de la marchandise » : pour lui, le capitalisme se caractérise par le fait que les relations entre les êtres sont médiatisées par des marchandises, et que l’on finit par leur accorder plus de réalité qu’au monde social et moral. »
Puis Descola explique comment il a pu généraliser ses découvertes sur l’animisme sur la base des données recueillies avant et ailleurs, et les opposer au totémisme tel que vu par Lévi-Strauss tout en le modifiant en intégrant les données australiennes :
« …] dans le totémisme, la nature permet de penser la société, dans l’animisme c’est la société qui permet de penser la nature. »
Puis il articule le naturalisme (notre propre culture occidentale) avec ces deux concepts « ontologiques » « dans le jeu de continuité et de discontinuité des physicalités et des intériorités » entre humains et non-humains, tout en s’inspirant de nombreux travaux de ses pairs et relevant des inversions dans les schèmes différents qu’il contraste en dialectique des pôles du continu et du discret. Alors il discerne logiquement (en combinatoire selon la psychologie cognitive) la quatrième formule ou mode d’identification au(x) monde(s), l’analogisme qui existe en Mésoamérique, système de correspondances qu’il retrouve dans la Renaissance vue par Foucault, la Chine vue par Grenet… parachevant ainsi la matrice analytique qu’il propose.
Évidemment basé sur le structuralisme :
« Mais, comme je l’ai déjà dit, pour nous, l’objet de l’anthropologie [française] ce n’est pas ces agrégats de cultures dont on cherche à tirer des leçons généralisables, ce sont les modèles que l’on construit pour rendre compte d’une totalité constituée de l’ensemble des variantes observables d’un même type de phénomène et afin d’élucider les principes de leurs transformations. »
En dépassant la théorie du déterminisme technique et environnemental, et celle de l’évolutionnisme historique qui nous considère comme un modèle à atteindre en partant du "sauvage" (et l’impérialisme, voire le néocolonialisme) :
« La question principale que pose l’exercice critique de refocalisation auquel je me suis livré est la suivante : comment élaborer des instruments d’analyse qui ne soient ni fondés sur un universalisme issu du développement de la pensée occidentale, ni complètement segmentés selon les types d’ontologie auxquels on a affaire ? »
« L’exigence d’universalisme passe par la recherche d’une articulation entre l’ensemble des modes d’être-au-monde, par l’interopérabilité des concepts, c’est-à-dire par le fait de pouvoir nous voir nous-mêmes comme nous voyons les autres sociétés, de façon à ce que la singularité de notre point de vue ne soit plus un biais dans l’analyse, mais un objet parmi d’autres de cette analyse.
Plutôt qu’à un universalisme militant, ce à quoi j’aspire c’est à une forme de symétrisation qui mette sur un plan d’égalité conceptuelle les anthropologues et ceux dont ils s’occupent. »
« Lévi-Strauss avait employé l’analogie de la table de Mendeleïev, qui illustre bien ce qu’est à mon sens le travail de l’anthropologie : mettre en évidence les composants élémentaires de la syntaxe des mondes et les règles de leur combinaison. »
Exemple pratique : « le passage de l’analogisme au naturalisme entre le XVe et le XVIIe siècle en Europe », en considérant que « les deux pivots d’un mode d’identification naturaliste sont l’intériorité distinctive de chaque humain et la continuité physique des êtres et des choses dans un espace homogène ».
La quatrième et dernière partie confronte le monde contemporain à cette nouvelle grille de lecture. Sont présentés les divergences et échanges avec Bruno Latour, les implications en écologie, et les conséquences de l’économie humaine sur l’environnement.
« La difficulté principale de cette hypothèse est que les raisons du sous-développement volontaire des Achuar sont multiples. Il est vrai que traiter les animaux chassés comme des partenaires sociaux n’incite pas à faire des massacres inutiles, d’autant que les esprits maîtres du gibier sont toujours prompts à punir les excès, en envoyant des maladies, par exemple, ou en causant des « accidents ». Mais il y a aussi et surtout que les Achuar se sont maintenus dans un état d’équilibre environnemental pour des raisons qui sont en grande partie démographiques. Ils ont très longtemps souffert d’une forte mortalité infantile, laquelle, conjuguée aux effets de la guerre, maintenait la population à un taux de densité extrêmement faible sur un territoire assez grand. Cette « capacité de charge » confortable explique aussi pourquoi ils pouvaient se donner le « luxe » d’avoir des excédents potentiels de production considérables. Par ailleurs, comme je l’ai déjà évoqué, le temps qu’ils consacrent à la production de subsistance est très faible et inélastique ; ou plus exactement, ils ne sont pas prêts à renoncer aux mille choses qu’ils font quand ils ne travaillent pas, c’est-à-dire le plus clair du temps. »
« Il me semble, plus généralement, qu’il y a un abîme entre l’importance des questions écologiques dans le destin actuel de l’humanité et le faible développement de l’écologie comme science, en particulier en France. »
De même pour l’anthropologie, qui pourrait être plus politique.
« Je ne crois pas que l’on puisse s’inspirer directement des pensées non modernes, animistes ou autres, car il n’y a pas d’expérience historique qui soit transposable telle quelle dans des circonstances différentes de celles où elle a eu lieu. Quelle que soit l’admiration que l’on éprouve pour ce que l’on considère un peu confusément comme la sagesse des modes de vie ancestraux, et même si les Achuar, les aborigènes d’Australie ou les Inuit peuvent nous en apprendre beaucoup sur l’usage de la nature, notre situation présente est très différente de celles auxquelles ils ont fait face. La fascination pour ces peuples donne lieu à un commerce assez lucratif, en particulier dans le domaine éditorial, mais il faut se garder d’une recherche de modèles. Et la raison principale est que toutes ces sociétés ont résolu des problèmes à une échelle locale, alors que les enjeux qui sont ceux des sociétés urbaines modernes sont globaux. »
« Les milliers de façons de vivre la condition humaine sont en effet autant de preuves vivantes de ce que notre expérience présente n’est pas la seule envisageable. L’anthropologie ne nous fournit pas des idéaux de vie alternatifs, elle nous apporte la preuve que d’autres voies sont possibles puisque certaines d’entre elles, aussi improbables qu’elles puissent paraître, ont été explorées ailleurs ou jadis. Elle nous montre que l’avenir n’est pas un simple prolongement linéaire du présent, qu’il est gros de potentialités inouïes dont nous devons imaginer la réalisation afin de réaliser au plus tôt, sinon peut-être une véritable maison commune, à tout le moins des mondes compatibles, plus accueillants et plus fraternels. »
« La représentation que les Modernes se sont donnée de leur forme d’agrégation politique a ainsi été longtemps transposée à l’analyse des sociétés non modernes, en même temps qu’une kyrielle de spécificités, comme le partage entre nature et culture ou notre propre régime d’historicité ; et c’est avec cela que je voudrais rompre. »
« Notre acception traditionnelle de ce qui est politique, ainsi que notre prise intellectuelle sur ce genre de phénomènes, me paraît ainsi dépassée. Le politique, ici, consiste à maintenir des conditions d’interaction qui peuvent prendre la forme de l’échange, mais aussi de la prédation ou du partage, avec des voisins conçus comme étant autonomes. Et les conséquences que cela peut avoir en retour sur notre conceptualisation du politique sont aussi importantes, puisque nous sommes incités à moduler l’anthropologie politique, non plus, comme jadis, sous la forme d’une typologie des formes d’organisation marquée par un évolutionnisme larvé – horde, tribu, chefferie, État –, mais selon les modalités réelles que prend l’exercice du vivre-ensemble dans des collectifs dont les formes ne sont plus prédéterminées par celles auxquelles nous sommes habitués. C’est un nouveau domaine sur lequel l’exigence de décolonisation de la pensée s’exerce, et qui nous permet de nous défaire des modèles au moyen desquels nous avons été accoutumés à penser sous l’influence d’une riche tradition qui remonte à la philosophie grecque, à la réflexion médiévale sur la cité, au jus gentium, aux théories contractualistes, etc. Ce qui est en jeu, au fond, c’est notre capacité à prendre au sérieux ce que ces modèles politiques nous imposent, en termes de catégories d’analyse, et nous proposent, en termes d’imagination politique. »
« La défense de ces dispositifs de protection des hommes et de la nature m’a conduit à militer contre un certain fondamentalisme écologiste porté par de nombreuses organisations internationales. Pour beaucoup, les populations humaines, et notamment les populations tribales, sont nécessairement des perturbateurs environnementaux, et pour protéger un écosystème, il faut les en expulser. L’idée fondamentale de cette écologie est que les milieux et les paysages naturels doivent être le plus possible déconnectés de l’influence humaine, et maintenus dans un fonctionnement hermétiquement clos. J’ai beaucoup protesté contre cela, car l’exemple de l’Amazonie montre à l’évidence qu’il est absurde d’expulser de zones de forêt que l’on cherche à protéger des populations qui ont contribué à ce que la forêt présente la physionomie qu’elle a actuellement. Cela revient à déplacer les agriculteurs normands pour protéger le bocage ! »
Autre chose, l’avis de Descola sur la muséographie (et le quai Branly, où il a dirigé l’exposition « La fabrique des images ») sont aussi fort intéressantes, comme la question des restitutions.
Conclusion sur l’éloge de la diversité.
« Un monde monotone et monochrome, sans imprévu ni rencontres improbables, sans rien de nouveau pour accrocher l’œil, l’oreille ou la curiosité, un monde sans diversité est un cauchemar. Je ne peux m’empêcher de penser que la diminution de la diversité dans les manières de produire dont la standardisation industrielle du début du XXe siècle est responsable a constitué l’un des ferments des régimes totalitaires, modèles par excellence du rejet de la diversité et de l’uniformisation des consciences et des modes d’être. Chaplin l’avait compris lorsqu’il enchaîna Le Dictateur après Les Temps modernes ! »
Le mot de la fin :
« Car exister, pour un humain, c’est différer. »
J’ai retrouvé à cette lecture une large part de l’éblouissement ressenti à celle de Lévi-Strauss (y compris au sens de perception troublée).
\Mots-clés : #amérindiens #autobiographie #contemythe #ecologie #entretiens #historique #politique #science #social #traditions #voyage
- le Mer 26 Avr - 16:09
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Philippe Descola
- Réponses: 9
- Vues: 360
Julian Barnes
L'Homme en rouge
En juin 1885, trois Français font du « shopping intellectuel et décoratif » à Londres, capitale des préraphaélites et de la décadence en cette Belle Époque : le comte Robert de Montesquiou, qui inspira le Des Esseintes de Huysmans (À rebours est fréquemment mentionné dans ce récit) et le baron de Charlus à Proust, le prince Edmond de Polignac, musicien lui aussi « dandy-esthète » pour qui tout est affaire de goût, et Samuel Pozzi, célèbre médecin qui lui n’est pas homosexuel, ni aristocrate (c’est L'Homme en rouge). Oscar Wilde est tôt évoqué, et Le Portrait de Dorian Gray revient aussi maintes fois. Quant à lui, Pozzi fut (entr’autres) l’amant, puis l’ami de Sarah Bernhardt.
D’autres personnalités apparaîtront (tous les personnages sont historiques), souvent littéraires tels Baudelaire, Flaubert, Barbey d’Aurevilly, Mallarmé, Maupassant, Henry James, Edmond de Goncourt, Jean Lorrain (un excessif et fielleux potinier), les Daudet, mais aussi des peintres (Degas, Whistler) et photographes (Nadar) ; l’ouvrage est illustré de certaines de leurs œuvres parmi d’autres, comme les vignettes de célébrités Félix Potin.
Très beau tableau de la société française au tournant des XIX et XXe siècles, entremêlant histoire petite et grande dans un style éblouissant :
« Et puis il y eut un incident insolite, mineur et amusant, à des milliers de kilomètres de là, qui illustre bien la loi historique des conséquences non voulues. En 1896, pendant la ruée coloniale sur l’Afrique, l’expédition militaire Marchand, comprenant une dizaine de Français et plus de cent vingt tirailleurs sénégalais, entreprit de traverser le continent d’ouest en est ; leur objectif était un fort en ruine sur le Nil supérieur. D’une manière bien française, ils partirent avec treize cents litres de bordeaux, cinquante bouteilles de Pernod, et un piano mécanique. La rude traversée dura deux ans ; ils arrivèrent en juillet 1898, deux mois après le J’accuse ! de Zola. Ils hissèrent le drapeau tricolore sur le fort de Fachoda, sans paraître avoir d’autre but géopolitique que d’embêter les Britanniques. Ce qu’ils firent, un peu, jusqu’au moment où Kitchener, qui commandait alors l’armée d’Égypte (et qui était, contrairement à sa réputation, un francophile parlant couramment français), arriva à son tour et leur conseilla de décamper. Il leur donna aussi des journaux français récents, où ils lurent des articles sur l’affaire Dreyfus, et pleurèrent. Les deux camps fraternisèrent, et la fanfare britannique joua La Marseillaise quand les Français se retirèrent. Personne ne fut blessé ou violenté ; encore moins tué. »
« Tous les cent ans environ, une nouvelle vague d’exilés arrivait dans les ports du côté anglais de la Manche : huguenots, fugitifs après la Révolution, communards, anarchistes… Quatre souverains successifs (Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et Napoléon III) trouvèrent refuge en Grande-Bretagne ; ainsi que Voltaire, l’abbé Prévost, Chateaubriand, Guizot et Victor Hugo. Monet, Pissarro, Rimbaud, Verlaine, Zola, tous prirent la direction de l’Angleterre quand des soupçons (de différentes sortes) les visèrent de manière trop inquiétante. […]
La raison principale d’un exil en France, pour un Britannique, était le désir d’échapper au scandale (et de pouvoir continuer dans la même voie scandaleuse) : c’était l’endroit où aller pour l’aristocrate ruiné, le bigame, le tricheur professionnel, l’homosexuel. « Ils » nous envoyaient leurs souverains déchus et leurs dangereux révolutionnaires, nous leur envoyions nos mauvais sujets plus ou moins huppés. Une autre raison d’un exil continental fut exprimée par le peintre Walter Sickert dans une lettre postée de Dieppe en 1900 : « C’est bougrement sain ici & foutrement bon marché » (sans allusion sexuelle cryptée). »
Britannique, Barnes a un regard plein d’humour sur les deux pays, France et Angleterre :
« Les Britanniques sont censés être pragmatiques, les Français plus sentimentaux. En réalité, dans les affaires du cœur, c’était souvent le contraire. Les Britanniques croyaient à l’amour et au mariage – croyaient que l’amour menait et survivait au mariage, que la sentimentalité était une expression d’amour vrai, et que la tendre union et le fidèle veuvage de leur reine Victoria étaient un exemple national. C’étaient les Français qui avaient l’approche la plus pragmatique : on se mariait pour la position sociale, pour l’argent ou pour les biens, pour la perpétuation de la famille, mais non pour l’amour. L’amour survivait rarement au mariage, et il était sottement hypocrite de faire comme s’il le pouvait. Le mariage n’était qu’un camp de base d’où le cœur aventureux s’élançait vers telle ou telle cime.
Ces règles, bien entendu, étaient fixées par les hommes, et ne figuraient nulle part dans le contrat de mariage. »
Le portrait des principaux concernés est étonnant, tel le snob et vaniteux Montesquiou qui s’entremet dans le mariage du prince de Polignac, ruiné, avec la richissime Winnaretta Singer (des machines à coudre), lesbienne.
« La Belle Époque fut une période de grande richesse pour les plus fortunés, de pouvoir social pour l’aristocratie, de snobisme débridé et complexe, d’impétueuse ambition coloniale, de patronage artistique, et de duels dont le degré de violence reflétait souvent une irascibilité personnelle plus qu’un honneur bafoué. Il n’y a pas grand-chose à dire en faveur de la Grande Guerre, mais au moins elle balaya une bonne partie de tout cela. »
Nombreuses observations sur la survivance de la coutume du duel pour l’honneur en France (et la facilité à détenir une arme), qui m’a aussi toujours étonné.
Pozzi est particulièrement rendu, éminent représentant de la chirurgie française, titulaire de la première chaire de gynécologie en France, assisté de Robert Proust, le frère de Marcel. On découvre aussi Catherine, sa fille. On le suit aux États-Unis, comme Wilde et Bernhardt, qui créent Salomé.
La mort de Pozzi est difficilement perçue comme « non-fiction », et je me garde de la divulgâcher. Reste au moins de lui cette phrase :
« Le chauvinisme est une des formes de l’ignorance. »
Ce récit, très documenté, est assez décousu, et le fil directeur, la vie de Pozzi, lâchement bâti, mais l’ensemble magistralement agencé, car la lecture reste éveillée d’une anecdote à un autre témoignage tandis que se compose le tableau de la société de l’époque. Le narrateur (en fait l’auteur apparemment) commente directement :
« L’art survit au caprice individuel, à l’orgueil familial, aux conventions sociales ; l’art a toujours le temps de son côté. »
« Les livres changent avec le temps ; ou du moins, la façon dont nous les lisons change. »
« Rien ne date autant que l’excès.
Daté : comme le passé doit haïr parfois autant le présent que le présent peut haïr l’avenir – cet avenir inconnaissable, insouciant, cruel, offensant, dédaigneux et qui ne sait l’apprécier –, un avenir indigne d’être l’avenir du présent. Ce que j’ai dit au début – que l’art a toujours le temps de son côté – n’était que de l’optimisme, une illusion sentimentale. L’art peut avoir le temps de son côté ; mais lequel ? Le temps impose un tri brutal. Moreau, Redon, Puvis de Chavannes : chacun d’eux parut être autrefois l’avenir de la peinture française. Puvis semble maintenant – pour la période en cours en tout cas – bien seul et pâle loin derrière. Redon et Moreau parlèrent à leur époque avec des métaphores très différentes, et le siècle suivant a préféré Redon. »
« « On ne peut savoir. » Modérément employée, c’est une des plus fortes phrases dans le langage du biographe : elle nous rappelle que la suave histoire-d’une-vie qu’on lit, malgré tous ses détails, sa longueur et ses notes en bas de page, malgré toutes ses certitudes factuelles et ses solides hypothèses, ne peut être qu’une version publique d’une vie publique, et une version subjective d’une vie privée. La biographie est une série de lacunes reliées par de la ficelle, et cela nulle part autant que dans la vie sexuelle et amoureuse. »
« « On ne peut savoir », mais « c’est ce qu’on dit, en tout cas ». La rumeur est « vraie » dans le sens qu’elle répète ce que croit quelqu’un, ou ce que croit quelqu’un qu’il ou elle connaît ; ou, si cette personne l’a inventée elle-même, ce qu’elle aimerait croire. Donc la rumeur est au moins vraie dans son mensonge, et révélatrice du caractère et de la mentalité de ceux qui la répandent. »
« Qu’y a-t-il dans le présent qui le rende si impatient de juger le passé ? Il y a toujours une tendance à la névrose dans le présent, qui se croit supérieur au passé mais ne peut tout à fait surmonter une anxiété persistante à l’idée qu’il pourrait ne pas l’être. Et derrière cela il y a une autre question : qu’est-ce qui nous permet de juger ? Nous sommes le présent, c’est le passé : cela suffit généralement pour la plupart d’entre nous. Et plus le passé s’éloigne, plus il devient tentant de le simplifier. Si grossière que soit notre accusation, il ne répond jamais, il reste silencieux. »
\Mots-clés : #biographie #historique #peinture
- le Dim 23 Avr - 13:15
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Julian Barnes
- Réponses: 60
- Vues: 4103
Tommy Orange
Ici n'est plus ici
Prologue :
« Nous sommes nombreux à être urbains, désormais. Moins parce que nous vivons en ville que parce que nous vivons sur Internet. Dans le gratte-ciel des multiples fenêtres de navigation. On nous traitait d’Indiens des rues. On nous traitait de réfugiés urbanisés, superficiels, inauthentiques, acculturés, on nous traitait de pommes. Une pomme est rouge à l’extérieur et blanche à l’intérieur. Mais nous sommes le résultat de ce qu’ont fait nos ancêtres. De leur survie. »
Dans la première partie, Reste, sont présentés quatre protagonistes :
Tony Loneman, Cheyenne de 21 ans, porte sur le visage le « Drome », syndrome d’alcoolisation fœtale. Avec sa grand-mère, Maxine, il vit à Oakland, et c’est sa terre. Et il projette le braquage d’un pow-wow…
Dene Oxendene, d’ascendance cheyenne et arapaho, projette quant à lui de recueillir les témoignages filmés d'Indiens urbains.
« Cette citation est importante pour Dene. Ce « là, là ». Il n’avait pas lu Gertrude Stein en dehors de cette citation. Mais pour les Autochtones de ce pays, partout aux Amériques, se sont développés sur une terre ancestrale enfouie le verre, le béton, le fer et l’acier, une mémoire ensevelie et irrécupérable. Il n’y a pas de là, là : ici n’est plus ici. »
(« There is no there there. » Le titre original du livre est There There).
Opale Viola Victoria Bear Shield, douze ans, son Teddy Bear Two Shoes, sa sœur aînée Jacquie et sa mère à Alcatraz, pendant l’occupation de l’île par des militants des Premières Nations en 1969-1971. La mère, qui semble faire référence à Storytelling, de Christian Salmon :
« Elle m’a dit que le monde était fait d’histoires et de rien d’autre, juste des histoires, et des histoires qui ont pour sujet d’autres histoires. »
Edwin Black est également un Indien-Américain, titulaire d’un master de littérature comparée dans le domaine de la littérature des Indiens d’Amérique. « Bébé trentenaire » obèse, il feuillette Internet à la recherche de son père, et lui aussi incarne le mal-être amérindien. Octavio lui montre son flingue imprimé en 3D, indétectable par les détecteurs de métaux.
Dans la seconde partie, Réclamation, voici d’autres personnes impliquées :
Bill Davis, beau-père d’Edwin, balaie le stade Coliseum, quand il avise un drone et tente de l’abattre.
« Il adorait Vol au-dessus d’un nid de coucou. Ça l’avait mis en rogne quand on en avait fait un film et que l’Autochtone, qui était le narrateur tout au long du livre, n’y tenait plus que le rôle de l’Indien taiseux, cinglé et stoïque qui balance le lavabo contre la baie vitrée à la fin. »
Calvin Johnson, pris dans une affaire de drogue et d’argent, est contraint de participer au braquage, avec notamment Octavio.
Jacquie Red Feather, sœur d’Opale, conseillère diplômée en toxicomanie et alcoolique en sevrage (l’alcool est omniprésent chez les Amérindiens, et la drogue est aussi fort présente chez ces "mal assimilés", généralement miséreux), participe à une conférence sur la prévention du suicide, fréquent chez les jeunes Indiens. Elle rencontre Harvey, qui l’a violée à Alcatraz, et dont elle a eu une fille qu’elle a placée. Son autre fille, héroïnomane, s’est suicidée, et elle a laissé les trois fils de celle-ci à sa sœur.
Orvil Red Feather est l’aîné des trois enfants. Il recherche son identité, car on ne lui a rien transmis, et témoigne devant Dene. Des pattes d’araignée sont sorties d’une grosseur qu’il a sur la jambe, et il va au pow-wow avec ses frères.
Dans Entracte, comme dans le prologue, Orange donne des précisions sur l’histoire des Premières Nations. Suivent deux autres actes de ce drame annoncé.
Puis la narration se resserre sur la préparation du « Grand Pow-Wow d’Oakland », qui réunit la plupart des protagonistes tandis que Tony introduit sur site les balles du pistolet en plastique – des pistolets, car il y en a cinq.
Opale s’est aussi sorti des pattes d’araignée de la jambe, lorsqu’elle était enfant (il y a de nombreuses références aux « médecines »).
« Un mot cheyenne : Veho. Il signifie « araignée », « escroc », et « homme blanc ». »
Le pow-wow, avec le tambour central dans le récit et la culture amérindienne, lieu de retrouvailles notamment familiales, culmine dans un massacre, en écho de l’Histoire de la conquête de l’Ouest.
Il y a quelque chose de viscéral (peut-être le sang) dans ce roman à la fois très dense et éclaté (comme les familles) qui parcourt les aspects particuliers aux Premières Nations, et où s’unissent des voix du présent comme du passé.
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #historique #minoriteethnique #romanchoral #social #traditions #violence #xxesiecle
- le Ven 21 Avr - 13:06
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Tommy Orange
- Réponses: 7
- Vues: 550
Christian Salmon
Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits
Dès l’introduction, le livre est rattrapé par l’actualité, voire dépassé par le phénomène dont il constate la naissance dans les années 90 :
« La clé du leadership américain et le secret du succès présidentiel résident, dans une grande mesure, dans le storytelling », écrivait en 2004 Evan Cornog, professeur de journalisme à l'université de Columbia, dans The Power and the Story, un essai qui réexamine l'histoire des présidences américaines de George Washington à George W. Bush à travers le prisme du storytelling : « Depuis les origines de la république américaine jusqu'à nos jours, écrit-il, ceux qui ont cherché à conquérir la plus haute charge ont dû raconter à ceux qui avaient le pouvoir de les élire des histoires convaincantes, sur la nation, ses problèmes et, avant tout, sur eux-mêmes. Une fois élu, la capacité du nouveau président à raconter la bonne histoire et à en changer chaque fois que c'est nécessaire est une qualité déterminante pour le succès de son administration. Et quand il a quitté le pouvoir, après une défaite ou à la fin de son mandat, il occupe souvent les années suivantes à s'assurer que sa version de sa présidence est bien celle qui sera retenue par l'Histoire. Sans une bonne histoire, il n'y a ni pouvoir ni gloire. »
Notre perception de l'histoire des États-Unis n'a-t-elle d'ailleurs pas le plus grand mal à démêler le vrai du faux, le réel de la fiction ? Qu'on se souvienne du président Ronald Reagan, qui évoquait parfois un épisode d'un vieux film de guerre comme s'il appartenait à l'histoire réelle des États-Unis… N'est-elle pas encombrée de fictions et de légendes, comme en atteste la réplique souvent citée du film de John Ford, Qui a tué Liberty Valance ? : « Lorsque la légende devient un fait établi, on imprime la légende. »
Dans Des logos à la story, Salmon nous montre comme le « marketing viral » des entreprises prospères les fait passer de la production des marchandises à celle des marques, puis des histoires.
« La publicité telle que nous la connaissons est morte, déclarait enfin en 2002 Sergio Zyman, ex-directeur marketing de Coca-Cola, dans son livre Les Derniers Jours de la publicité : Cela ne marche plus. C'est un colossal gaspillage d'argent, et, si vous n'y prenez garde, cela finira par détruire votre société… et votre marque. »
« Le paradoxe du marketing moderne est en effet qu'il doit fidéliser des comportements d'achat devenus changeants, labiles, imprévisibles. Ramener le consommateur volage au bercail de la marque et l'inciter à s'engager dans une relation durable et émotionnelle. »
« La consommation comme seul rapport au monde. On attribue aux marques les pouvoirs qu'on cherchait jadis dans les mythes ou la drogue : passer la limite, faire l'expérience d'un soi sans pesanteur, voler, planer ; c'était hier Icare ou le LSD, c'est aujourd'hui Nike ou Adidas. […] Les marques sont les vecteurs d'un « univers » : elles ouvrent la voie à un récit fictif, un monde scénarisé et développé par les agences de « marketing expérientiel », dont l'ambition n'est plus de répondre à des besoins ni même de les créer, mais de faire converger des « visions du monde ». »
Dans L’invention du storytelling management, c’est l’histoire des gourous qui ont révolutionné l’entreprise. L’idée est de motiver par l’émotion, et la rhétorique.
« Les gourous sont des pourvoyeurs de modes managériales. La popularité de leurs idées va et vient selon des cycles d'invention (quand l'idée est créée), de dissémination (quand l'idée est portée à l'attention d'un public ciblé), d'adhésion (quand l'idée est acceptée), de désenchantement (quand les évaluations négatives et les frustrations liées à cette idée commencent à émerger), puis de déclin ou d'abandon de l'idée… »
« De nombreux auteurs décrivent les gourous du management comme des experts en persuasion, qui cherchent à formater leur public par le biais de discours efficaces, à tel point que certains ont comparé leur puissance oratoire à celle des prédicateurs évangéliques. »
« « Les gens ne veulent plus d'informations, écrit Annette Simmons, auteure d'un des best-sellers du storytelling. Ils veulent croire – en vous, en vos buts, en votre succès, dans l'histoire que vous racontez. C'est la foi qui fait bouger les montagnes et non les faits. Les faits ne donnent pas naissance à la foi. La foi a besoin d'une histoire pour la soutenir – une histoire signifiante qui soit crédible et qui donne foi en vous. » D'où l'importance des pratiques d'autolégitimation et d'autovalidation, puisque la source unique de la performance d'un gourou, c'est sa personne même : c'est lui la source des récits utiles et de leurs effets mystérieux, c'est en lui que se concentrent les compétences narratives. Il est l'agent et le médiateur, le passeur et le message. Il doit vous convaincre que tout est en ordre, conforme au bon sens, au droit naturel. Il ne vous enseigne pas un savoir technique, il transmet une sagesse proverbiale, qui cultive le bon sens populaire, fait appel aux lois de la nature et convoque un ordre mythique. »
Dans La nouvelle « économie fiction » sont évoqués les (nombreux) employés des call centers du « nouveau rêve indien », à Bombay, qui se font passer pour des États-Uniens et sont déshumanisés et acculturés dans le formatage identitaire de la globalisation au travers de cette délocalisation virtuelle.
« Depuis le début des années 1980, la figure du cadre a ainsi cédé la place à celle du manager, puis au leader et au coach, et finalement au storyteller, dont les récits parlent au cœur des hommes et non seulement à leur raison, en leur proposant des visions de l'entreprise et des fictions qui les aident à fonctionner [… »
Le néomanagement impose une fiction de processus de groupe ou équipe dans l’entreprise (ce qui m’a ramentu mes doutes lors d’un MOOC sur le digital).
« L'autorité d'un récit – celui du « changement » – a pris sa place [à l’autorité]. Un récit écrit par le marché sous ses nombreux pseudonymes, aussi nombreux que les hétéronymes de Pessoa : la mondialisation, la globalisation, le progrès technique, la concurrence… »
Renvois à la créativité, à l’authenticité…
« Les techniques du management s'apparentent de plus en plus à celles de la mise en scène, les partenaires doivent s'ajuster le mieux possible à leurs rôles, de façon à rendre le récit crédible aux yeux d'un public de consommateurs et d'investisseurs. »
Dans Joueurs de Don DeLillo, une entreprise préfigure les sociétés de services à la personne.
« L'ironie de DeLillo, qui prenait pour cible la tendance des sociétés capitalistes à transformer toute émotion en marchandise, y compris les sentiments les plus intimes, comme le deuil, le remords ou la dépression, pouvait paraître excessive en 1977. »
« La nouvelle idéologie du capitalisme privilégie le changement à la continuité, la mobilité à la stabilité, la tension à l'équilibre et propose un nouveau paradigme organisationnel : l'entreprise sans frontières, décentralisée et nomade, libérée des lois et des emplois, légère, agile, furtive, qui ne se reconnaît d'autre loi que le récit qu'elle se donne, d'autre réalité que les fictions qu'elle répand dans le monde. »
« « Légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité et consistance » : cela pourrait constituer un bon résumé des valeurs du nouveau management. Il n'en est rien. Ce sont les titres de six conférences que devait prononcer l'écrivain italien Italo Calvino en 1985-1986 aux États-Unis. Il avait choisi six valeurs essentielles à ses yeux, qui devaient constituer l'épistémè du XXIe siècle. Il rédigea les cinq premières, qui furent publiées à titre posthume sous le titre Leçons américaines. »
Les entreprises mutantes du nouvel âge du capitalisme : ou « créer un mythe collectif contraignant » et enfumer tout le monde, en interne comme à l’extérieur de l’entreprise.
« Les applications du storytelling en entreprise accompagnent le mouvement par lequel chacun est mis en demeure de raconter sa vie et son travail, de transmettre son savoir-faire, de mobiliser ses énergies et d'accepter un changement. »
« Le récit y [dans les storytelling organisations] est en effet considéré tout à la fois comme un facteur d'innovation et de changement, un vecteur d'apprentissage et un outil de communication. Il constitue une réponse à la crise du sens dans les organisations et une méthode pour construire une identité d'entreprise. Il structure et formate la communication, à l'intention des consommateurs comme des actionnaires. »
Cas d’école de dérégulation :
« Enron était devenu un véritable mirage financier, producteur d'illusions non seulement pour ses salariés intéressés à la croyance, mais aussi pour les plus grandes banques du monde, les analystes financiers, les experts comptables et les actionnaires de Wall Street. »
« Plus le monde de la finance s'éloignait des estimations rationnelles et des performances économiques, plus la cosmétique d'entreprise consistant à rendre une entreprise belle et désirable pour les investisseurs a pris de l'importance dans la gestion des nouvelles organisations. […] Dans un monde rationnel, ce fiasco exemplaire aurait signé la mort du storytelling et de ses vertus hypnotiques. Et pourtant, près de dix ans plus tard, il reste plus que jamais la bible des « gourous du management ». »
La « mise en histoires » de la politique :
L’exploitation émotionnelle de l’histoire « évangélique » d’une fille d'une victime du 11 septembre réconfortée par le président dans la campagne de George W. Bush en 2004 : le rôle du « conseiller en communication », ou spin doctor (depuis Reagan), le récit du héros contre des méchants (simple et reprenant la forme narrative des mythes anciens).
« Si l'exercice du pouvoir présidentiel tend à s'identifier à une sorte de campagne électorale ininterrompue, les critères d'une bonne communication politique obéissent de plus en plus à une rhétorique performative (les discours fabriquent des faits ou des situations) qui n'a plus pour objectif de transmettre des informations ni d'éclairer des décisions, mais d'agir sur les émotions et les états d'âme des électeurs, considérés de plus en plus comme le public d'un spectacle. Et pour cela de proposer non plus un argumentaire et des programmes, mais des personnages et des récits, la mise en scène de la démocratie plutôt que son exercice.
La capacité à structurer une vision politique non pas avec des arguments rationnels, mais en racontant des histoires, est devenue la clé de la conquête du pouvoir et de son exercice dans des sociétés hypermédiatisées, parcourues par des flux continuels de rumeurs, de fausses nouvelles, de manipulations. »
Storytelling de guerre
Les centres de simulation du Pentagone deviennent, avec l’aide d’Hollywood, des théâtres de réalité virtuelle privilégiant des situations expérientielles plutôt que cognitives. Le recrutement militaire se fait via la vidéo, comme le traitement psychologique des états de stress posttraumatique.
« L'invention d'un modèle de société dans lequel les agents fédéraux, réels ou fictifs, doivent disposer d'une autonomie d'action suffisante pour protéger efficacement la population n'est rien d'autre que l'instauration d'un état d'exception permanent qui, ne trouvant plus sa légitimité dans le droit et la Constitution, la cherche et la trouve dans la fiction. »
« …] la puissance de l'entreprise américaine de mise en fiction du réel permet le triomphe des préjugés sur la morale la plus élémentaire, la négation du réel par la toute-puissance des représentations qui prétendent le transformer. »
L'empire de la propagande
Le gouvernement George W. Bush, juste avant la guerre en Irak :
« Nous sommes un empire maintenant, poursuivit-il, et, lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. »
« …] les dirigeants de la première puissance mondiale se détournent non seulement de la realpolitik, mais du simple réalisme, pour devenir créateurs de leur propre réalité, maîtres des apparences, revendiquant ce qu'on pourrait appeler une realpolitik de la fiction. »
Ron Susking, journaliste d’investigation (2004) :
« Il ne nous restera plus ainsi qu'une culture et un débat public fondés sur l'affirmation plutôt que sur la vérité, sur les opinions et non sur les faits. Parce que, lorsque vous en êtes là, vous êtes contraint de vous fier à la perception du pouvoir. »
Renouvellement de la propagande en infotainment type Fox News, aux contenus dictés par le gouvernement républicain, les fake news, dès 2004, manipulation de l'information marquée d’un obscurantisme émanant de la droite fondamentaliste chrétienne et opposé aux réalistes. C’est la droite chrétienne conservatrice contre la connaissance objective, la foi contre la raison.
Conclusion – Le nouvel ordre narratif : en France aussi, depuis le rôle de Henri Guaino dans la campagne de 2007.
« Don Quichotte lui aussi voulait changer le monde en racontant une histoire… Comme l'écrivait Michel Foucault : « À lui de refaire l'épopée, mais en sens inverse : celle-ci racontait […] des exploits réels, promis à la mémoire ; Don Quichotte, lui, doit combler de réalité les signes sans contenus du récit. » »
« Les « campagnes marketing » de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal signent donc une profonde évolution — et peut-être une vraie rupture — dans la culture politique française. Formatés par leurs conseillers experts en storytelling, réduits à leurs talents respectifs pour appliquer les consignes de « mise en scène » - et Sarkozy l'a nettement emporté sur ce terrain -, les deux candidats ont de concert contribué à délégitimer la politique : s'adressant aux individus comme à une « audience », évitant l'adversaire, contournant les partis, ils ont substitué au débat public la captation des émotions et des désirs. Ce faisant, ils ont inauguré une ère nouvelle de la démocratie, que l'on pourrait qualifier de « postpolitique ». »
Postface à l'édition de 2008 : en prolongement de l’analyse précédente du storytelling sarkozien, Salmon évoque la réaction au contrôle gouvernemental de l'agenda médiatique du décryptage par la presse. Puis pointe le « nouvel ordre narratif » :
« Ce qui est en jeu aujourd'hui, à tous ces niveaux à la fois, c'est l'apparition d'une même raison régulatrice qui consiste à réduire et à contrôler, par le storytelling et les machines de fiction, les conduites individuelles. »
Cet essai est proprement époustouflant lorsqu’on le lit en ayant connu l’ère Trump ; même autrement, il explique nombre de curieuses constatations qu’on a pu faire en observant notre société.
\Mots-clés : #actualité #contemporain #essai #guerre #historique #medias #politique #psychologique #social #xxesiecle
- le Sam 15 Avr - 17:09
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Christian Salmon
- Réponses: 3
- Vues: 320
Jacques Le Goff
L’Imaginaire médiéval
Butiné dans la préface, où Le Goff précise son regard d’historien sur l’imaginaire, et surtout les images :
« Les images qui intéressent l'historien sont des images collectives brassées par les vicissitudes de l'histoire, elles se forment, changent, se transforment. Elles s'expriment par des mots, des thèmes. Elles sont léguées par les traditions, s'empruntent d'une civilisation à une autre, circulent dans le monde diachronique des classes et des sociétés humaines. »
« J'ai toujours été fasciné par les naissances et les genèses, accordant en revanche peu d'intérêt aux origines qui ne sont souvent que des illusions et sont menées par le préjugé d'un déterminisme sous-jacent (dis-moi d'où tu viens, et je te dirai qui tu seras) et aux déclins et décadences, fortement imbibés d'une idéologie pessimiste et moralisante que je ne partage pas, persuadé que la mort est rare en histoire, car l'histoire est transformation et mémoire, mémoire d'un passé qui ne cesse de vivre et de changer sous le regard des sociétés successives. Ce qui m'émeut, c'est l'accouchement d'une société et d'une civilisation, selon une logique traversée et même faite de hasards. Rien de moins « événementiel » que les événements. »
« Pas d'idée qui ne trouve à s'exprimer par des mots, pas de mots qui ne renvoient à des réalités ! L'histoire des mots est de l'histoire tout court. Disparition et apparition de termes, évolution et changements sémantiques du vocabulaire, c'est le mouvement même de l'histoire. »
« Il n'y a pas d'espace-temps plus riche en imaginaire que le voyage. »
S’ensuit un recueil d’essais regroupés par thèmes eux-mêmes subdivisés : le merveilleux, l’espace et le temps, le corps, littérature imaginaire, les rêves et « vers l'anthropologie politique ».
Le Goff développe d’abord le concept de « long Moyen Âge », période qui s’étend de l’Antiquité à la révolution industrielle, englobant la Renaissance, datation peu significative dans cette évolution constante.
Il distingue ensuite un merveilleux préchrétien qui perdure (populaire, oral, folklorique), un magique satanique et un surnaturel miraculeux proprement chrétien, l’hagiographie tendant à remplacer le premier, à la fois imprévisible et quotidien, naturel, grâce à des tendances au symbolisme et à la moralisation, à la rationalisation scientifique et historique. Dans les fonctions du merveilleux, il identifie le monde à l'envers (le pays de Cocagne), et le monde à rebours (Paradis terrestre, Âge d'or).
Intéressante remarque sur la citation (et quelque part l’intertextualité) :
« …] la compilation médiévale est une des principales voies de la recherche et de la création originale. »
Les considérations sur l’espace et le temps m’ont paru un peu hors de propos, mais seront utiles plus tard dans l’ouvrage. La haine chrétienne du corps me semble expliquer le contrecoup de la récente révolution sexuelle et féministe (de même, la gesticulation honnie, considérée comme païenne et/ou diabolique, correspond au rejet du théâtre, qui a perduré).
« L'incarnation est humiliation de Dieu. Le corps est la prison (ergastulum – prison pour esclaves) de l'âme, c'est, plus que son image habituelle, sa définition. L'horreur du corps culmine dans ses aspects sexuels. Le péché originel, péché d'orgueil intellectuel, de défi intellectuel à Dieu est changé par le christianisme médiéval en péché sexuel. L'abomination du corps et du sexe est à son comble dans le corps féminin. D'Ève à la sorcière de la fin du Moyen Âge, le corps de la femme est le lieu d'élection du Diable. À l'égal des temps liturgiques qui entraînent un interdit sexuel (carême, vigiles et fêtes), le temps du flux menstruel est frappé de tabou : les lépreux sont les enfants d'époux qui ont eu des relations sexuelles pendant la menstruation de la femme. L'inévitable rencontre du physiologique et du sacré conduit à un effort de négation de l'homme biologique : vigile et jeûne qui défient le sommeil et l'alimentation. Le péché s'exprime par la tare physique ou la maladie. La maladie symbolique et idéologique par excellence du Moyen Âge, la lèpre (qui remplit les mêmes fonctions que le cancer dans notre société), est avant tout la lèpre de l'âme. Le chemin de la perfection spirituelle passe par la persécution du corps : le pauvre est identifié à l'infirme et au malade, le type social éminent, le moine, s'affirme en tourmentant son corps par l'ascétisme, le type spirituel suprême, le saint, ne l'est jamais aussi indiscutablement que lorsqu'il fait le sacrifice de son corps dans le martyre. Quant aux clivages sociaux laïcs essentiels ils ne s'expriment jamais mieux qu'en oppositions corporelles : le noble est beau et bien fait, le vilain est laid et difforme (Aucassin et Nicolette, Yvain, etc.). Plus encore que poussière, le corps de l'homme est pourriture. La voie de toute chair c'est la décrépitude et la putréfaction. Dans la mesure où le corps (Marie-Christine Pouchelle en parlera plus pertinemment) est une des métaphores privilégiées de la société et du monde, ils sont entraînés dans cette inéluctable décadence. Le monde du christianisme médiéval, selon la théorie des six âges, est entré dans la vieillesse. Mundus senescit. »
Analyse structurale (inspirée de Lévi-Strauss, portant sur Yvain ou le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes) du monde sauvage, la forêt (Brocéliande).
« Et tornai mon chemin à destre
Parmi une forest espesse
Molt i ot voie felenesse
De ronces et d'espinnes plainne. »
Cet extrait (et la suite du texte) renvoie me semble-t-il à ceux cités ici https://deschosesalire.forumactif.com/t2233p20-louise-erdrich#134944
Intéressante association médiévale (au moins) de la fonction guerrière et du viol – d’une ville, d’une femme.
À propos de l’urbanité, et je pense généralisable :
« Aussi loin que le regard de l'historien peut se porter, toute culture se nourrit d'héritages. Le poids de ces héritages dans une culture est un des éléments les plus importants pour définir la nature de cette culture. La plupart des médiévistes seront, je pense, d'accord pour estimer que ce poids est particulièrement lourd dans la culture de l'Occident médiéval. […] Cela ne signifie pas à mes yeux que la société de l'Occident médiéval n'ait pas été créatrice, au contraire, mais que sa créativité a, pendant longtemps, surtout consisté en des choix, des déplacements d'accent, des assemblages inédits parmi les éléments légués par les cultures dont elle avait hérité. »
À propos de généralisation :
« Quand et comment s'est constitué le stock primitif d'images et d'idées des sociétés humaines très anciennes, nous l'ignorons, mais ce que nous observons le plus souvent, c'est l'antériorité de l'idéologie par rapport à l'histoire. L'histoire rejoint plus souvent l'idéologie que l'inverse. Ce qui ne veut pas dire que l'idéologie soit le moteur de l'histoire, mais elle n'en est pas non plus le produit. »
Longue analyse de l’évolution de l’attitude vis-à-vis des rêves, vrais ou faux, de Dieu ou du Diable (ou des morts), réservés ou non à des spécialistes (« des oniromanciens savants et des "devins de place publique" »), puis aux martyrs, saints et rois, visions ou songes dans le sommeil, jusqu’à leur refoulement indifférencié.
« Le refoulement et la manipulation des rêves.
Ils ont été imposés, comme pour la sexualité, par la grande censure ecclésiastique dont nous ne sommes pas encore complètement libérés et qui, pour le meilleur et pour le pire, a conduit à la psychanalyse. »
« Dans ce monde devenu celui du cauchemar dans une certaine vision de christianisme névrosé, même pas la nuit n'apporte le repos et l'homme a été réduit à la situation de Job aux pires moments de ses épreuves. »
\Mots-clés : #essai #historique #moyenage
- le Mar 4 Avr - 12:54
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Jacques Le Goff
- Réponses: 1
- Vues: 620
Jean-Marie Blas de Roblès
Dans l'épaisseur de la chair
Le roman commence par un passage qui développe heureusement la superstition des marins, ici des pêcheurs à la palangrotte sur un pointu méditerranéen, Manuel Cortès, plus de quatre-vingt-dix ans, et son fils, le narrateur. Ce dernier veut recueillir les souvenirs paternels pour en faire un livre. Et c’est accroché au plat-bord de l’embarcation dont il est tombé, seul en mer, qu’il commence le récit de la famille, des Espagnols ayant immigré au XIXe en Algérie pour fuir sécheresse et misère : des pieds-noirs :
« Le problème est d’autant plus complexe que pas un seul des Européens qui ont peuplé l’Algérie ne s’est jamais nommé ainsi. Il faut attendre les derniers mois de la guerre d’indépendance pour que le terme apparaisse, d’abord en France pour stigmatiser l’attitude des colons face aux indigènes, puis comme étendard de détresse pour les rapatriés. Il en va des pieds-noirs comme des Byzantins, ils n’ont existé en tant que tels qu’une fois leur monde disparu. »
À Bel-Abbès, ou « Biscuit-ville », Juan est le père de Manuel, antisémite comme en Espagne après la Reconquista, et « n’ayant que des amis juifs »… Ce sont bientôt les premiers pogroms, et la montée du fascisme à l’époque de Franco, Mussolini et Hitler.
« En Algérie, comme ailleurs, le fascisme avait réussi à scinder la population en deux camps farouchement opposés. »
« Le Petit Oranais, journal destiné "à tous les aryens de l’Europe et de l’univers", venait d’être condamné par les tribunaux à retirer sa manchette permanente depuis 1930, un appel au meurtre inspiré de Martin Luther : "Il faut mettre le soufre, la poix, et s’il se peut le feu de l’enfer aux synagogues et aux écoles juives, détruire les maisons des Juifs, s’emparer de leurs capitaux et les chasser en pleine campagne comme des chiens enragés." On remplaça sans problème cette diatribe par une simple croix gammée, et le journal augmenta ses ventes. »
Est évoquée toute l’Histoire depuis la conquête française, qui suit le modèle romain.
« Bugeaud l’a clamé sur tous les tons sans être entendu : "Il n’est pas dans la nature d’un peuple guerrier, fanatique et constitué comme le sont les Arabes, de se résigner en peu de temps à la domination chrétienne. Les indigènes chercheront souvent à secouer le joug, comme ils l’ont fait sous tous les conquérants qui nous ont précédés. Leur antipathie pour nous et notre religion durera des siècles." »
« Cela peut sembler incroyable aujourd’hui, et pourtant c’est ainsi que les choses sont advenues : les militaires français ont conquis l’Algérie dans une nébulosité romaine, oubliant que le songe où ils se coulaient finirait, comme toujours, et comme c’était écrit noir sur blanc dans les livres qui les guidaient, par se transformer en épouvante. D’emblée, et par admiration pour ceux-là mêmes qui avaient conquis la Gaule et gommé si âprement la singularité de ses innombrables tribus, les Français ont effacé celle de leurs adversaires : ils n’ont pas combattu des Ouled Brahim, des Ouled N’har, des Beni Ameur, des Beni Menasser, des Beni Raten, des Beni Snassen, des Bou’aïch, des Flissa, des Gharaba, des Hachem, des Hadjoutes, des El Ouffia, des Ouled Nail, des Ouled Riah, des Zaouaoua, des Ouled Kosseir, des Awrigh, mais des fantômes de Numides, de Gétules, de Maures et de Carthaginois. Des indigènes, des autochtones, des sauvages. »
« Impossible d’en sortir, tant que ne seront pas détruites les machines infernales qui entretiennent ces répétitions. »
Dans l’Histoire plus récente, le régime de Vichy « réserva les emplois de la fonction publique aux seuls Français "nés de père français" », et fit « réexaminer toutes les naturalisations d’étrangers, avec menace d’invalider celles qui ne seraient pas conformes aux intérêts de la France. Ces dispositions, qui visaient surtout les Juifs sans les nommer, impliquaient l’interdiction de poursuivre des études universitaires. »
« Exclu du lycée Lamoricière, André Bénichou, le professeur de philo de Manuel, en fut réduit à créer un cours privé dans son appartement. C’est à cette occasion qu’il recruta Albert Camus, lui-même écarté de l’enseignement public à cause de sa tuberculose. Et je comprends mieux, tout à coup, pourquoi l’enfant de Mondovi, coincé à Oran, s’y était mis à écrire La Peste. »
Manuel se tourne vers la pharmacie, puis la médecine, s’engage pendant la Seconde Guerre, et devient chirurgien dans un tabor de goumiers du corps expéditionnaire français en Campanie.
« Sur le moment, j’aurais préféré l’entendre dire qu’il avait choisi la guerre « pour délivrer la France » ou « combattre le nazisme ». Mais non. Il s’était presque fâché de mon insistance : Je n’ai jamais songé à délivrer qui que ce soit, ni ressenti d’animosité particulière contre les Allemands ou les Italiens. Pour moi, c’était l’aventure et la haine des pétainistes, point final. »
« Quand le tabor se déplaçait d’un lieu de bataille à un autre, les goumiers transportaient en convoi ce qu’ils avaient volé dans les fermes environnantes, moutons et chèvres surtout, et à dos de mulet la quincaillerie de chandeliers et de ciboires qu’ils pensaient pouvoir ramener chez eux. Ils n’avançaient que chargés de leurs trophées, dans un désordre brinquebalant et coloré d’armée antique. […]
Les autorités militaires offrant cinq cents francs par prisonnier capturé, les goumiers s’en firent une spécialité. Et comme certains GI ne rechignaient pas à les leur racheter au prix fort pour s’attribuer l’honneur d’un fait d’armes, il y eut même une bourse clandestine avec valeurs et cotations selon le grade des captifs : un capitaine ou un Oberstleutnant rapportait près de deux mille francs à son heureux tuteur ! »
« Officiellement, la circulaire d’avril 1943 du général Bradley était très explicite sur ce point : pour maintenir le moral de l’armée il ne fallait plus parler de troubles psychologiques, ni même de shell shock, la mystérieuse « obusite » des tranchées, mais d’« épuisement ». Dans l’armée française, c’était beaucoup plus simple : faute de service psychiatrique – le premier n’apparaîtrait que durant la bataille des Vosges – il n’y avait aucun cas recensé de traumatisme neurologique. Des suicidés, des mutilations volontaires, oui, bien sûr, des désertions, des simulateurs, des bons à rien de tirailleurs ou de goumiers paralysés par les djnouns, incapables de courage physique et moral, ça arrivait régulièrement, des couards qu’il fallait bien passer par les armes lorsqu’ils refusaient de retourner au combat, mais des cinglés, jamais. Pas chez nous. Pas chez des Français qui avaient à reconquérir l’honneur perdu lors de la débâcle.
Mon père m’a raconté l’histoire d’un sous-officier qu’il avait vu se mettre à courir vers l’arrière au début d’une attaque et ne s’était plus arrêté durant des kilomètres, jusqu’à se réfugier à Naples où on l’avait retrouvé deux semaines plus tard. Et de ceux-là, aussi, faisant les morts comme des cafards au premier coup d’obus. J’ai pour ces derniers une grande compassion, tant je retrouve l’attitude qui m’est la plus naturelle dans mes cauchemars de fin du monde. Faire le mort, quitte à se barbouiller le visage du sang d’un autre, et attendre, attendre que ça passe et ce moment où l’on se relèvera vivant, quels que soient les comptes à rendre par la suite.
Sommes-nous si peu à détester la guerre, au lieu de secrètement la désirer ? »
S’accrochant toujours à sa barque, le narrateur médite.
« Dès qu’on se mêle de raconter, le réel se plie aux exigences de la langue : il n’est qu’une pure fiction que l’écriture invente et recompose. »
Heidegger, le perroquet que le narrateur a laissé au Brésil et devenu « une sorte de conscience extérieure qui me dirait des choses tout en dedans », renvoie à Là où les tigres sont chez eux.
« Heidegger a beau dire qu’il s’agit d’une coïncidence dénuée d’intérêt, je ne peux m’empêcher d’en éprouver un vertige désagréable, celui d’un temps circulaire, itératif, où reviendraient à intervalles fixes les mêmes fulgurances, les mêmes conjonctures énigmatiques. »
Ayant suivi des cours de philosophie (tout comme Manuel qui « s’inscrivit en philosophie à la fac d’Alger »), Blas de Roblès cite Wole Soyinka (sans le nommer) :
« Le tigre ne proclame pas sa tigritude, soupire Heidegger, il fonce sur sa proie et la dévore. »
En contrepartie de leur courage de combattants, les troupes coloniales commettent de nombreuses exactions, du pillage aux violences sur les civils.
« Plus qu’une sordide décompensation de soldats épargnés par la mort, le viol a toujours été une véritable arme de guerre. »
Le roman est fort digressif (d’ailleurs la citation liminaire est de Sterne). Le narrateur qui marine et s’épuise évoque des jeux d’échecs, fait de curieux projets, met en cause Vasarely…
Après la bataille du monastère de Monte Cassino, la troupe suit le « bellâtre de Marigny » (Jean de Lattre de Tassigny) dans le débarquement en Provence, puis c’est la bataille des Vosges, et l’Ardenne.
À propos du film Indigènes, différent sur l’interprétation des faits.
À peine l’Allemagne a-t-elle capitulé, Manuel est envoyé avec la Légion et les spahis qui répriment une insurrection à Sétif, « un vrai massacre » qui tourne vite à l’expédition punitive (une centaine de morts chez les Européens, plusieurs milliers chez les indigènes). Blessé, il part suivre ses études de médecine à Paris, puis se marie par amour avec une Espagnole pauvre, mésalliance à l’encontre de l’entre-soi de mise dans les différentes communautés.
« Les « indigènes », au vrai, c’était comme les oiseaux dans le film d’Alfred Hitchcock, ils faisaient partie du paysage. »
« Après Sétif, la tragédie n’a plus qu’à débiter les strophes et antistrophes du malheur. Une mécanique fatale, avec ses assassinats, ses trahisons, ses dilemmes insensés, sa longue chaîne de souffrances et de ressentiment. »
Les attentats du FLN commencent comme naît Thomas, le narrateur, qui aborde ses souvenirs d’enfance.
« …] le portrait que je trace de mon père en me fiant au seul recours de ma mémoire est moins fidèle, je m’en aperçois, moins réel que les fictions inventées ou reconstruites pour rendre compte de sa vie avant ma naissance. »
OAS et fellaghas divisent irréconciliablement Arabes et colons. De Gaulle parvient au pouvoir, et tout le monde croit encore que la situation va s’arranger, jusqu’à l’évacuation, l’exode, l’exil. Mauvais accueil en métropole, et reconstruction d’une vie brisée, Manuel devant renoncer à la chirurgie pour être médecin généraliste.
Histoire étonnante des cartes d’Opicino de Canistris :
« À la question « qui suis-je ? », qui sum ego, il répond tu es egoceros, la bête à corne, le bouc libidineux, le rhinocéros de toi-même.
Il n’est pas fou, il me ressemble comme deux gouttes d’eau ; il nous ressemble à tous, encombrés que nous sommes de nos frayeurs intimes et du combat que nous menons contre l’absurdité de vivre. »
Regret d’une colonisation ratée…
« Ce qu’il veut dire, je crois, c’est qu’il y aurait eu là-bas une chance de réussir quelque chose comme la romanisation de la Gaule, ou l’européanisation de l’Amérique du Nord, et que les gouvernements français l’avaient ratée. Par manque d’humanisme, de démocratie, de vision égalitaire, par manque d’intelligence, surtout, et parce qu’ils étaient l’émanation constante des « vrais colons » – douze mille en 1957, parmi lesquels trois cents riches et une dizaine plus riches à eux dix que tous les autres ensemble – dont la rapacité n’avait d’égal que le mépris absolu des indigènes et des petits Blancs qu’ils utilisaient comme main-d’œuvre pour leurs profits. »
… mais :
« Si les indigènes musulmans ont été les Indiens de la France, ce sont des Indiens qui auraient finalement, heureusement, et contre toute attente, repoussé à la mer leurs agresseurs.
Un western inversé, en somme, bien difficile à regarder jusqu’à la fin pour des Européens habitués à contempler en Technicolor la mythologie de leur seule domination. »
« La France s’est dédouanée de l’Algérie française en fustigeant ceux-là mêmes qui ont essayé tant bien que mal de faire exister cette chimère. Les pieds-noirs sont les boucs émissaires du forfait colonialiste.
Manuel ne voit pas, si profonde est la blessure, que ce poison terrasse à la fois ceux qui l’absorbent et ceux qui l’administrent. La meule a tourné d’un cran, l’écrasant au passage, sans même s’apercevoir de sa présence.
Il y aura un dernier pied-noir, comme il y a eu un dernier des Mohicans. »
Clairement narré, et regroupé en petits chapitres, ce qui rend la lecture fort agréable. Par exemple, le 240ème in extenso :
« Rejoindre le front des Vosges dans un camion de bauxite, sauter sur une mine à Mulhouse, et se retrouver médecin des gueules rouges à Brignoles, en compagnie d’un confrère alsacien ! Qu’est-ce qui est à l’œuvre dans ce genre de conjonction ? Quels sont les dieux fourbes qui manipulent ainsi nos destinées ? Projet : S’occuper de ce que Charles Fort appelait des « coïncidences exagérées ». Montrer ce qu’elles révèlent de terreur archaïque devant l’inintelligibilité du monde, de poésie latente aussi, et quasi biologique, dans notre obstination à préférer n’importe quel déterminisme au sentiment d’avoir été jetés à l’existence comme on jette, dit-on, un prisonnier aux chiens. »
Les parties du roman sont titrées d’après les cartes italiennes de la crapette, « bâtons, épées, coupes et deniers ».
Il y a une grande part d’autobiographie dans ce roman dense, qui aborde nombre de sujets.
Beaucoup d’aspects sont abordés, comme le savoureux parler nord-africain en voie de disparition (ainsi que son humour), et pendant qu’on y est la cuisine, soubressade, longanisse, morcilla…
Et le dénouement est inattendu !
\Mots-clés : #antisémitisme #biographie #colonisation #deuxiemeguerre #enfance #exil #guerredalgérie #historique #identite #immigration #insurrection #politique #racisme #relationenfantparent #segregation #social #terrorisme #traditions #xxesiecle
- le Ven 31 Mar - 12:56
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean-Marie Blas de Roblès
- Réponses: 25
- Vues: 1899
Hubert Haddad
La Cène
Marquès, reporter alcoolique et athée, accompagne une équipe de rugbymen brésiliens, étudiants catholiques de bonne famille, comme leur Fokker s’écrase à quatre mille mètres sur les Andes, entre Lima et Buenos Aires, où Marquès espérait retrouver Isabel.
« Chrétiens aux larges épaules, construits à l’échelle de Dieu, ils représentaient l’élite catholique du jeune Brésil formée dans un respect martial du credo. »
Les survivants souffrent du froid, de la faim ; ils piétinent vainement une grande croix de signalisation. Lui plaide pour descendre dans la vallée, tandis que les autres prient, attendant le salut du ciel. Il se confronte aussi à eux qui, par opposition au suicide, se refusent à euthanasier le pilote agonisant, incarcéré dans son cockpit.
« La plupart portaient des sortes de casques transparents bricolés à l’aide des plaques de mica qui protègent les hublots des radiations. Ils se découvrirent pour boire l’eau bouillante de la cuvette et leurs visages éclairés par les flammes semblaient figés sous les fards. Chacun s’était enduit la peau avec les cosmétiques et autres produits trouvés dans les sacs de voyage. »
Au bout d’une semaine, l’équipe décide de manger les morts, à grand renfort d’autojustifications. Marquès s’abstient, se sustentant d’excréments.
« Jésus a rompu le pain et tendu le calice aux apôtres. Il leur a dit de sa bouche mortelle : « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance. » Voilà ce qu’a dit notre Seigneur à la veille du supplice. Écoutez sa parole : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. » Le Christ est mort pour que nous vivions ! Les apôtres ont bu et ont mangé à la très sainte table pour accéder à la vie éternelle…
Ne pas manger serait un suicide et le suicide est le péché des péchés ! »
« Une cordée retourna en chasse : on remonta d’un précipice le corps pétrifié du séminariste. Sur la dépouille dénudée, le rasoir frôla les chairs meurtries. L’ongle d’acier découvrit les arêtes brisées des os. De la poitrine, jaillirent les organes sirupeux et luisants comme des crânes de nouveau-nés. Les athlètes s’accroupirent et Rodriguez distribua les parts. Ils se passèrent le foie dégelé à l’eau tiède, fruit précieux qui jutait dans les mains. Chacun y mordit à son tour comme l’aigle de la légende. Sébastien tombé de la croix, le séminariste gisait en chien de fusil sur la neige, les os en flèches, clavicules et condyles tranchant les lambeaux de chair. Son visage remodelé au gouffre souriait, extatique et sans âge. »
Après sept semaines, deux hommes se lancent dans la descente, et douze autres rescapés seront ainsi sauvés.
L’Église cautionne la « communion des vivants et des morts » qui permit de survivre à ceux qui sont alors considérés comme des héros.
L’histoire est bien sûr tirée du drame de la cordillère des Andes du 13 octobre 1972, dont on a beaucoup parlé à l’époque (quarante-cinq personnes à bord, trente-trois survivants le premier jour et seize à la fin).
Dans sa postface, La Cène ou le dernier festin des cannibales, Haddad interroge sur les limites de l’humanité.
« En exhumant le seul vrai héros de l’aventure, vite oublié par les survivants mais dont les premiers témoignages tiennent compte, sous la figure à demi fictive d’un reporter, lequel refusa jusqu’au bout de manger la chair humaine, j’ai tenté d’élever le fait divers à la parabole : cette poignée d’hommes en détresse caricature le destin d’une certaine forme cannibale et suicidaire des civilisations livrées au capitalisme sauvage, à l’ostracisme calculé des plus faibles, à la mise en coupe des ressources vitales, et pour finir à l’usage hypnotique des médias. »
Malhabilement emphatique par moments, et trop évidemment à charge sur le fond, malgré de superbes (et parfois horribles) descriptions.
\Mots-clés : #historique #mort #religion
- le Mer 8 Mar - 12:28
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 20
- Vues: 917
Panait Istrati
Les Chardons du Baragan
Incipit :
« Quand arrive septembre les vastes plaines incultes de la Valachie danubienne se mettent à vivre, pendant un mois, leur existence millénaire. »
C’est le baragan, plaine continentale roumaine, « ogre amoureux d’immensité inhabitable » et « assoiffé de solitude », désert où ne poussait que les chardons, qui secs étaient emmenés par le Crivatz (vent froid), comme les virevoltants ou tumbleweeds des westerns.
À neuf ans, le narrateur y part avec son père, dans l’objectif de vendre le poisson qui abonde chez eux, et manque ailleurs.
« Bon pays, mauvaise organisation :
Sacré nom d’un règlement !
C’était cela : un pays riche, mal organisé et mal gouverné ; ma mère le savait comme tout paysan roumain. »
Mais l’expédition est un échec, la mère décède, et à quatorze ans Mataké se sépare de son père pour partir à l’aventure derrière les « petites meules de broussaille » avec son ami Brèche-Dent : il réalise le rêve de tous les enfants, s’évader « à la découverte du monde », « quitter la maison et s’en aller par le monde ».
Ils sont recueillis comme argats [« Valets de ferme »] dans une famille paysanne miséreuse (peut-être les cojans, terme récurrent mais non explicité, comme trop d’autres).
« Sous un ciel si terreux qu’on eût dit la fin du monde, on voyait les chars avancer comme des tortues, sur des champs, sur des routes, sur une terre que Dieu maudissait de toute sa haine. Chars informes ; bêtes rabougries ; hommes méconnaissables ; fourrage boueux ; et aucune pitié nulle part, ni au ciel ni sur la terre ! Nous avions pourtant besoin de pitié divine autant que de pitié humaine, car les chars s’embourbaient ou se renversaient ; car les bêtes tombaient à genoux et nous demandaient grâce ; car les hommes battaient les bêtes et se battaient entre eux ; car les ciocani [« Tiges de maïs, dont les feuilles servent de fourrage et le déchet de combustible »] pourrissaient dans les mares et il fallait en transporter les gerbes à dos d’homme, à dos de femme, à dos d’enfant, et ces hommes, ces femmes, ces enfants n’étaient plus que des tas de hardes imbibées de boue, de grosses mottes de terre pantelante sous l’action de cœurs inutiles.
Tels étaient les paysans roumains, à l’automne de 1906. »
Mataké est tombé amoureux de Toudoritza, ma belle demoiselle éconduite par son amoureux à cause du boyard. Grand nettoyage (deux fois par an, pour Pâques et Noël) :
« Nous vidâmes deux pièces, en entassant les meubles dans une troisième. Au milieu de la tinda, trois brouettes de glaise jaune comme le safran et une brouette de crottin de cheval furent versées avec de l’eau chaude par-dessus, et je fus chargé de piétiner le lut sur le sol des chambres dont Toudoritza badigeonnait les murs en chantant à tue-tête. Elle s’était affublée de vieux vêtements de sa mère ; complètement enfouie, chevelure et visage, sous une grande basma qui ne laissait voir que ses beaux yeux, et armée d’une brosse à long manche, elle couvrait murs et plafond de cette couche de chaux bleuâtre qui fait la joie et la santé du paysan roumain et que connaissent seuls les villages balkaniques. Le badigeonnage fini, ce fut le tour du sol. Le temps de fumer une pipe, il se fit aussi lisse qu’une table, sous les mains adroites de Toudoritza qui le nivelait en marchant à reculons.
Une semaine durant, nous vécûmes une vie de rescapés, couchant un soir ici, le lendemain là, comme ça se trouvait, et mangeant sur le pouce, dans une atmosphère de salle de bain turc dont la vapeur, sentant la chaux et la bouse, nous piquait le nez. »
Mais une mauvaise récolte suscite une famine qui désespère les paysans.
« Soudain, une nouvelle tomba dans le village, comme l’éclair d’une explosion. En Moldavie, les paysans avaient brûlé le konak du grand fermier juif Ficher ! C’est M. Cristea qui nous lut cette nouvelle, dans un journal. Et ce journal concluait : « Cela apprendra aux Juifs à exploiter les paysans jusqu’au sang. À bas, à bas les Juifs ! »
Les cojans qui écoutaient se regardèrent les uns les autres :
– Quels Juifs ? Dans notre département il n’y en a pas ! Et même ailleurs, ils n’ont pas le droit d’être propriétaires ruraux. Or, les fautifs, ce sont les propriétaires, non les fermiers.
À ces paroles, toutes les faces se tournèrent du côté du konak. »
Et les villageois révoltés brûlent le konak. (Un konak est un palais, une grande résidence en Turquie ottomane ; il doit en être de même ici, à propos de la demeure du boyard.) La bourgade est bombardée par l’armée, c’est un massacre.
Outre le témoignage sur une Roumanie rurale misérable et l’insurrection de 1907, ainsi que ses charmes de conte, ce roman offre un éclairage original sur le goût du départ et l’émigration.
\Mots-clés : #historique #lieu #misere #ruralité #temoignage
- le Ven 17 Fév - 12:24
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Panait Istrati
- Réponses: 20
- Vues: 1360
Jules Romains
Les Hommes de bonne volonté« Les Hommes de bonne volonté », c’est 27 livres, 779 chapitres, des milliers de pages mettant en scène des dizaines de personnages pendant une génération, précisément du 6 octobre 1908 au 6 octobre 1923.
Par cette vaste fresque romanesque qui se place dans la continuité des entreprises de Balzac et de Zola, Jules Romains a tenté de dresser un panorama de la France de la Belle Epoque à l’entre-deux-guerres. Son entreprise est toutefois différente de celle de ses illustres prédécesseurs par un plan d’ensemble rigoureusement construit avec interaction entre eux des personnages dans les différents ouvrages.
A la différence de Proust, il ne faut pas chercher chez Romains une analyse psychologique poussée des personnages qui illustrent plutôt des types sociaux. Plus que la psychologie, c’est l’histoire qui intéresse l’auteur. De même, l’individu n’est plus au centre de la narration qui est constituée d’un conglomérat de différents points de vue en un temps donné, ceci afin de rendre compte au mieux de la diversité du monde réel. Tout ceci se résume dans une théorie à caractère spiritualiste, l’unanimisme, la croyance en une entité supérieure collective dans laquelle viendrait se fondre les différentes individualités. Ainsi, les hommes de bonne volonté pourraient infléchir le cours de l’Histoire.
Ces conceptions ont aujourd’hui un peu vieilli. N’empêche, « Les Hommes de bonne volonté » constitue un passionnant tableau de la société pendant le premier quart du XXe siècle.
Il s’agit pour moi d’une relecture.
Les Hommes de bonne volonté
1 - Le 6 octobre

Ce premier volume se passe à Paris dans la seule journée du 6 octobre 1908. Du matin au soir, nous faisons connaissance avec quelques personnages qui vont occuper le devant de la scène : les Saint-Papoul, noblesse traditionnelle dans leur hôtel particulier du faubourg Saint-Germain, le député Gruau prévoyant d’interpeller la Chambre sur les concussions des pétroliers, ignorant que sa compagne spécule sur le sucre. Nous croisons l’instituteur Clanricart, soucieux des risques de guerre, l’inquiétant relieur Quinette chez qui vient se refugier un homme maculé de sang. Dans un très beau chapitre, nous suivons le petit Léon Bastide courant avec son cerceau dans les rues de Montmartre.
Le véritable héros du livre c’est Paris. Il y a un vrai amour de la capitale que Jules Romains décrit avec lyrisme.
Quelques extraits pour mieux en rendre compte :
« Les gens s’en vont, marchent droit devant eux avec une assurance merveilleuse. Ils ne semblent pas douter un instant de ce qu’ils ont à faire. L’autobus qui passe est plein de visages non pas joyeux, sans doute, ni même paisibles, mais, comment dire ? justifiés. Oui, qui ont une justification toute prête. Pourquoi êtes-vous ici, à cette heure-ci ? Ils sauront répondre. »
« L’enduit de la muraille est très ancien. Il a pris la couleur qui est celle des vieilles maisons de la Butte, et que les yeux d’un enfant de Montmartre ne peuvent regarder sans être assaillis de toutes les poésies qui ont formé son cœur. Un couleur qui contient un peu de soleil champêtre, un peu d’humidité provinciale, d’ombre de basilique, de vent qui a traversé la grande plaine du Nord, de fumées de Paris, de reflets de jardin, d’émanation de gazon, de lilas et de rosiers."
« Puis la trêve de l’Exposition Universelle, avec des bruits de danses, et des coudoiements de nations, curieuses les unes des autres, mais sans amitié, comme des estivants qui se rencontrent sur une plage. L’aurore du siècle, trop attendue, fatiguée d’avance, trop brillante, traversée de lueurs fausses, et que les formidables stries de la guerre, dans les premières heures d’après, étaient venues charger. »
« Alors, les lycéens, dans les salles d’étude, mordillant leur porte-plume ou fourrageant leurs cheveux, suivaient les derniers reflets du jour chassés par la lumière du gaz sur la courbure miroitante des grandes cartes de géographie. Ils voyaient la France toute entière ; Paris posé comme une grosse goutte visqueuse sur la quarante-huitième parallèle, et le faisant fléchir sous son poids : ils voyaient Paris bizarrement accroché à son fleuve, arrêté par une boucle, coincé comme une perle sur un fil tordu. On avait envie de détordre le fil, de faire glisser Paris en amont jusqu’au confluent de la Marne, ou en aval, aussi loin que possible vers la mer. »
« Il y avait la ligne de la richesse qui courait comme une frontière mouvante et douteuse, souvent avancée ou reculée, sans cesse longée ou traversée par un va-et-vient de neutres et de transfuges, entre les deux moitiés de Paris dont chacune s’oriente vers son pôle propre ; le pôle de la richesse qui depuis un siècle remonte lentement de la Madeleine vers l’Etoile ; le pôle de la pauvreté, dont les pâles effluves, les aurores vertes et glacées oscillaient alors de la rue Rébaval à la rue Julien-Lacroix. Il y avait la ligne des affaires qui ressemblait à une poche contournée, à un estomac de ruminant accroché à l’enceinte du Nord-Est, et pendant jusqu’au contact du fleuve. C’est dans cette poche que les forces de trafic et de la spéculation venaient se tasser, se chauffer, fermenter l’une contre l’autre. Il y avait la ligne de l’amour charnel, qui ne séparait pas, comme la ligne de la richesse, deux moitiés de Paris de signe contraire ; qui ne dessinait pas, non plus, comme la ligne des affaires, les contours et les renflements d’un sac. Elle formait plutôt une sorte de traînée ; elle marquait le chemin phosphorescent de l’amour charnel à travers Paris, avec des ramifications, ça et là, des aigrettes ou de larges épanchements stagnants. Elle ressemblait à une voie lactée.
Il y avait la ligne du travail la ligne de la pensée, la ligne du plaisir… »
\Mots-clés : #historique #lieu #social
- le Jeu 29 Déc - 18:13
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jules Romains
- Réponses: 2
- Vues: 141
James Fenimore Cooper
Le Dernier des Mohicans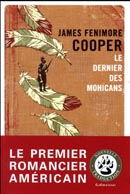
Dans son Introduction de la nouvelle édition du Dernier des Mohicans, Cooper énonce aussi laconiquement que légitimement ce que nous avons perdu avec la disparition des cultures amérindiennes d’Amérique du Nord :
« Peu de caractères d’hommes présentent plus de diversité, ou, si nous osons nous exprimer ainsi, de plus grandes antithèses que ceux des premiers habitants du nord de l’Amérique. »
Dans sa Préface de la première édition, il présente son roman historique comme un « récit », une « relation ».
En juillet 1757, dans l'actuel État de New York à la frontière des États-Unis et du Canada, le marquis de Montcalm et son armée s’approchent du fort William Henry, tenu par le colonel britannique Munro sur le lac Horican (George de nos jours). Cora et Alice, ses filles, partent pour le rejoindre du fort Edward tenu par le Général Webb, accompagnées par le major Duncan Heyward, le guide huron Magua (Renard Subtil), et La Gamme, maître en psalmodie. Ils rencontrent Œil-de-Faucon (« le chasseur », Bumppo ou la Longue Carabine à cause de son « tueur de daims » ; c’est Leatherstocking ou Bas-de-Cuir, au centre du cycle des cinq romans de Cooper auquel appartient celui-ci), coureur des bois (chasseur) et « batteur d’estrade » (éclaireur) des Anglais, Chingachgook ou Grand Serpent, sagamore (sachem) des Mohicans et son fils Uncas, ou Cerf Agile (c’est « le dernier des Mohicans »). Ils campent sur une petite île avec deux cavernes dans les chutes du Glen sur l’Hudson, et y sont assaillis par les Hurons. Après des affrontements épiques, à court de poudre, Œil-de-Faucon et les deux Indiens s’enfuient à la nage pour chercher du secours, tandis que les autres sont capturés. Ayant été humilié par Munro, Magua propose à Cora de l’épouser. Au moment où les captifs vont être exécutés, Œil-de-Faucon et les deux Mohicans les délivrent. Après d’autres péripéties, ils rejoignent le fort William Henry assiégé par les Français en nombre nettement supérieur. Sur ordre de Webb, commandant de la région qui n’enverra pas ses renforts, la garnison se rend et quitte le fort. Des Hurons, alliés de Montcalm, massacrent l’arrière-garde ; de nouveau, Alice, Cora et David sont enlevés par Magua, et Œil-de-Faucon, Chingachgook et Uncas se lancent à leurs trousses avec Munro et Heyward, d’abord en canoë sur le lac Horican puis sur terre, où les trois premiers font de nouveau preuve de leurs talents de pisteurs, qui lisent les traces comme les Blancs un livre. En approchant du Canada, ils retrouvent David, laissé en semi-liberté car pris pour un fou. Alice a été placée dans une tribu de Hurons et Cora chez les Delawares, traditionnels ennemis, mais alliés enrôlés dans la lutte contre les Anglais. Duncan se rend chez lez Hurons (déguisé), où Uncas est amené prisonnier. Œil-de-Faucon (travesti en ours) délivre Alice avec son aide, puis Uncas. Magua, orateur adroit et politique astucieux, intrigue toujours, chez les Hurons, puis chez les Delawares, où il ne parvient cependant qu’à arracher Cora au grand conseil présidé par le patriarche, Tamenund. Uncas, dont l’ascendance est reconnue, entraîne les Delawares contre les Hurons : avec la plupart de ces derniers, Cora, Uncas puis Magua trouvent la mort.
La distinction raciale est souvent évoquée, que ce soit la pureté d’un sang « sans mélange » qu’Œil-de-Faucon revendique fréquemment, ou la couleur de la peau (le teint tanné de ce dernier se distinguerait de celui des Indiens) : si on montre de la sympathie pour les Peaux-Rouges, c’est "malgré" leur couleur, au moins autant que leur aspect farouche ou leurs mœurs de sauvages, non-civilisés.
« Il y a de la raison dans un Indien, quoique la nature lui ait donné une peau rouge, dit le Blanc en secouant la tête en homme qui sentait la justesse de cette observation. »
Si la rigueur historique manque, cette fiction vaut pour l’attention portée aux peuples amérindiens en voie de disparition, « ces peuples à la fois si impétueux et si impassibles », et bien sûr pour l’action aux multiples rebondissements de ces aventures dans la nature "sauvage", si captivantes, du moins pour les jeunes lecteurs. Mais c’est mal écrit-traduit, d’un romantisme ronflant, et rempli d’invraisemblances. Style :
« Cependant l’air d’assurance et d’intrépidité du major, aidé peut-être par la nature du danger, leur donna du courage, et les mit en état, du moins à ce qu’elles crurent, de supporter les épreuves inattendues auxquelles il était possible qu’elles fussent bientôt soumises. »
\Mots-clés : #amérindiens #aventure #historique #nature
- le Sam 3 Déc - 11:03
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: James Fenimore Cooper
- Réponses: 2
- Vues: 200
W.G. Sebald
Austerlitz
Sebald rencontre à Anvers Austerlitz, architecte qui l’entretient de la démesure atteinte au XIXe dans la surenchère entre fortification et poliorcétique (art de mener un siège), la forteresse devenant de plus en plus rapidement obsolète face aux progrès de l’artillerie.
« …] nos meilleurs projets, au cours de leur réalisation, n’ont de cesse qu’ils ne se muent en leur exact contraire. »
« …] étudiant, l’architecture de l’ère capitaliste, et en particulier l’impératif d’ordonnance et la tendance au monumental à l’œuvre dans les cours de justice et les établissements pénitentiaires, les bourses et les gares, mais aussi les cités ouvrières construites sur plan orthogonal. »
Ils se revoient plusieurs fois, par hasard ; ici, à propos du palais de justice de Bruxelles :
« La construction de cette singulière monstruosité architecturale, à laquelle il songeait à cette époque consacrer une étude, avait été entreprise vers les années quatre-vingt du siècle dernier, dans la précipitation, sous la pression de la bourgeoisie bruxelloise, me raconta Austerlitz, avant que les plans grandioses présentés par un certain Joseph Poelaert aient été élaborés en détail, et la conséquence en était, dit Austerlitz, que dans ce bâtiment d’une capacité de plus de sept cent mille mètres cubes il existait des corridors et des escaliers qui ne menaient nulle part, des pièces et des halls sans porte où jamais personne n’avait pénétré et dont le vide conservait emmuré le secret ultime de tout pouvoir sanctionné. »
Ils se rencontrent encore deux décennies plus tard à Londres, et Sebald s’aperçoit qu’il ressemble à Wittgenstein, avec « son sac à dos ne le quittait jamais ».
« …] voilà qui était contraire à toute vraisemblance statistique mais d’une logique interne étonnante, pour ne pas dire inéluctable. »
Austerlitz lui raconte son histoire : dès le début de la Seconde Guerre mondiale et ses quatre ans et demi, il a été élevé par d’austères parents nourriciers, et son enfance fut froide, sinon lugubre.
« J’ai grandi, dit-il, à Bala, petite bourgade du pays de Galles, dans la maison d’un prédicateur calviniste, un ancien missionnaire nommé Emyr Elias et marié à une femme timorée issue d’une famille anglaise. »
« Durant toutes les années que j’ai passées au presbytère de Bala, le sentiment ne m’a de fait jamais quitté que restait dérobé à ma vue quelque chose de très proche et de très évident. Parfois, c’était comme si j’essayais à partir d’un rêve de saisir la réalité ; puis j’avais l’impression que marchait à mes côtés un frère jumeau invisible, le contraire d’une ombre en quelque sorte. »
Ce n’est qu’au lycée, une fois sa mère adoptive morte et Elias devenu fou de chagrin dans sa sombre croyance qui ne le soutient plus, qu’on lui apprend que son vrai nom est Austerlitz. André Hilary, son professeur d’histoire, féru de l’époque napoléonienne, lui apprend l’histoire de la bataille.
Il s’initie à la photographie (comme Sebald, dont les photos illustrent le texte) ; il protège son factotum en pension, le petit Gerald Fitzpatrick, début d’une amitié ; il se trouve invité par la mère de ce dernier à Barmouth, où Alphonso, le grand-oncle naturaliste, leur fait notamment découvrir les mites et papillons.
Les souvenirs d’Austerlitz sont riches d’énumérations minutieuses (insectes, mais aussi plantes, minéraux, maladies, etc.), et tout ce qui est rapporté l’est dans un style élaboré, précis, à la fois fluide et pesant, car sans pause (la traduction semble excellente).
« Admirées surtout par Gerald, les diverses stries lumineuses qu’ils semblaient laisser derrière eux, traits, boucles et spirales, n’avaient en réalité aucune existence, avait expliqué Alphonso, elles n’étaient que traces fantômes dues à la paresse de notre œil, qui croit encore voir un reflet rémanent à l’endroit d’où l’insecte, pris une fraction de seconde sous l’éclat de la lampe, a déjà disparu. C’était à ces genres de phénomènes factices, à ces irruptions de l’irréel dans le monde réel, à certains effets de lumière dans un paysage étalé devant nous, au miroitement dans l’œil d’une personne aimée, que s’embrasaient nos sentiments les plus profonds, ou du moins ce que nous tenions pour tels. »
Suivent des considérations sur le temps (ce récit lui-même est quasiment un flux ininterrompu).
« Si Newton a pensé, dit Austerlitz en montrant par la fenêtre, brillant dans le reste de jour, le méandre qui enserre l’île des Chiens, si Newton a réellement pensé que le temps s’écoule comme le courant de la Tamise, où est alors son origine et dans quelle mer finit-il par se jeter ? Tout cours d’eau, nous le savons, est nécessairement bordé des deux côtés. Mais quelles seraient, à ce compte, les rives du temps ? Quelles seraient ses propriétés spécifiques correspondant approximativement à celles de l’eau, laquelle est liquide, assez lourde et transparente ? En quoi des choses plongées dans le temps se distinguent-elles de celles qui n’ont jamais été en contact avec lui ? Que signifie que nous représentions les heures diurnes et les heures nocturnes sur un même cercle ? Pourquoi, en un lieu, le temps reste-t-il éternellement immobile tandis qu’en un autre il se précipite en une fuite éperdue ? Ne pourrait-on point dire que le temps lui-même, au fil des siècles, au fil des millénaires, n’a pas été synchrone ? Finalement, il n’y a pas si longtemps que cela qu’il se trouve en expansion et se répand en tous sens. Et jusqu’aujourd’hui, la vie des hommes, dans maintes contrées de la terre, n’est-elle pas moins régie par le temps que par les conditions atmosphériques, autrement dit par une grandeur inquantifiable qui ignore la régularité linéaire, n’avance pas de manière constante mais au rythme de remous et de tourbillons, est déterminée par les engorgements et les dégorgements, revient sous une forme sans cesse autre et évolue vers qui sait où ? L’être-hors-du-temps qui naguère encore était le mode d’existence dans les contrées reculées et oubliées de notre propre pays, comme sur les continents non encore explorés d’outre-mer, se retrouvait aussi, dit Austerlitz, dans les métropoles régies par le temps, Londres par exemple. Les morts n’étaient-ils pas hors du temps ? Les mourants ? Les malades alités chez eux ou dans les hôpitaux ? Et non seulement eux, car il suffisait d’avoir son content de malheur personnel pour déjà être coupé de tout passé et de tout avenir. »
Austerlitz poursuit ses études à Oxford puis Paris, tandis que Gerald, passionné par les pigeons, devient aviateur et astronome.
Lors d’excursions nocturnes Austerlitz explore le milieu urbain, et on se sait parfois plus s’il s’agit de Sebald ou de lui, sorte d’alter ego. Lorsque l’auteur mentionne ses propres allées et venues en marge des confidences d’Austerlitz, l’inquiétante étrangeté et son angoisse semblent déteindre des zones lugubres traversées.
Après une évocation des morts à propos des cimetières reconquis par la ville en extension, Austerlitz rapporte sa révélation sur ses origines dans la salle d’attente abandonnée de Liverpool Street Station. Ces architectures absurdes, à la Piranèse, reviennent plusieurs fois, comme une pénétration onirique de la réalité.
« Il faut bien dire que les pas décisifs de notre vie, nous les accomplissons presque tous sous la pression d’une confuse nécessité interne. »
Il poursuit ses investigations aux Archives de Prague, et retrouve Věra, sa bonne d’enfant, avec les souvenirs de sa petite enfance, il poursuit ses remémorations dans une profusion de détails. Sa mère, Agáta, était actrice, et « chanteuse d’opéra et d’opérette », juive dans l’avant-guerre…
« Ta mère Agáta, ainsi commença-t-elle, je crois, dit Austerlitz, en dépit de sa manière taciturne et quelque peu mélancolique, était une femme qui avait tout à fait confiance en la vie et se montrait parfois insoucieuse. […]
Néanmoins, dit Věra, poursuivit Austerlitz, Maximilian ne croyait en aucune façon que le peuple allemand avait été mené à sa perte ; bien plus, selon lui, partant des aspirations individuelles et de l’état d’esprit régnant dans les familles, il s’était lui-même radicalement refondé en se coulant dans ce moule pervers ; et il avait ensuite engendré ces dignitaires nazis que Maximilian tenait tous pour des bons à rien et des têtes brûlées, pour servir de porte-parole symboliques aux instincts profonds qui l’agitait. […]
Maximilian lui avait expliqué, dit Věra, que dans cette foule qui ne faisait plus qu’un seul être agité d’étranges convulsions et soubresauts, il s’était senti comme un corps étranger qui allait incessamment être broyé et expulsé. »
Quels bels emboîtements en cascade pour un cataclysme en marche avec tout un peuple ! Litanie scandée par l’indication des deux narrateurs, et passage superbe à propos de l’écho dans « le matériau de ces innombrables corps immobiles » du message « messianique » nazi.
Sur les traces de sa mère déportée, Austerlitz visite Terezín avec son bazar, sa forteresse et son musée du ghetto.
« Il ne me semble pas que nous connaissions les règles qui président au retour du passé, mais j’ai de plus en plus l’impression que le temps n’existe absolument pas, qu’au contraire il n’y a que des espaces imbriqués les uns dans les autres selon les lois d’une stéréométrie supérieure, que les vivants et les morts au gré de leur humeur peuvent passer de l’un à l’autre, et plus j’y réfléchis, plus il me semble que nous qui sommes encore en vie, nous sommes aux yeux des morts des êtres irréels, qui parfois seulement deviennent visibles, sous un éclairage particulier et à la faveur de conditions atmosphériques bien précises. »
Dans la foulée, il relate son séjour à Marienbad avec Marie de Verneuil (une Française dont il est proche), dans un étrange ressenti de désarroi et de discordance dû à sa résistance au retour de sa mémoire. Il reconnaît sourdement la gare Wilson d’où il partit pour Londres, envoyé par ses parents avec son petit sac à dos. La pérégrination dans l’espace et le temps continue avec Nuremberg, puis le camp de Theresienstadt. Dans ce dernier, les Allemands ont reconstitué une fallacieuse vitrine bienséante du ghetto afin de leurrer une commission d’inspection, aussi sinistre que cynique mascarade filmée « soit à des fins de propagande, soit pour légitimer à leurs yeux toute cette entreprise » : Le Führer offre une ville aux Juifs.
Ensuite Austerlitz cherche trace de son père, Maximilian, disparu à Paris.
« Ce genre d’intuitions me viennent immanquablement en des lieux qui appartiennent davantage au passé qu’au présent. Par exemple, lors de mes pérégrinations en ville, je jette quelque part un coup d’œil dans l’une de ces cours intérieures où rien n’a changé depuis des décennies, et je sens, physiquement presque, le cours du temps se ralentir dès qu’il entre dans le champ de gravitation des choses oubliées. Tous les moments de notre vie me semblent alors réunis en un seul espace, comme si les événements à venir existaient déjà et attendaient seulement que nous nous y retrouvions enfin, de même que, une fois que nous répondons à une invitation, nous nous retrouvons à l’heure dite dans la maison où nous devions nous rendre. Et ne serait-il pas pensable, poursuivit Austerlitz, que nous ayons aussi des rendez-vous dans le passé, dans ce qui a été et qui est déjà en grande part effacé, et que nous allions retrouver des lieux et des personnes qui, au-delà du temps d’une certaine manière, gardent un lien avec nous ? »
Pertes de connaissance ; lectures à la Bibliothèque nationale (l’ancienne puis la nouvelle).
« …] et j’en suis arrivé à la conclusion que dans chacun des projets élaborés et développés par nous, la taille et le degré de complexité des systèmes d’information et de contrôle qu’on y adjoint sont les facteurs décisifs, et qu’en conséquence la perfection exhaustive et absolue du concept peut tout à fait aller, et même, pour finir, va nécessairement de pair avec un dysfonctionnement chronique et une fragilité inhérente. »
Enfin, la gare d’Austerlitz…
Je suis heureux d’avoir reporté jusqu'ici la lecture de cet admirable roman (quoique l’on ait peu l’impression qu’il s’agisse d’un roman), m’y préparant avec la lecture d’autres œuvres de Sebald. Le parti pris des descriptions, digressions, énumérations, signale suffisamment que l’essentiel dans ce livre n’est pas l’histoire d’Austerlitz, ni l’Histoire, mais plutôt les impressions et coïncidences spatiotemporelles de l'existence.
\Mots-clés : #devoirdememoire #historique #identite
- le Lun 28 Nov - 12:10
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: W.G. Sebald
- Réponses: 74
- Vues: 8384
Georges Duby
Le Dimanche de Bouvines (27 juillet 1214)
Un livre d’histoire (« grand public ») qui… fit date !
« Les événements sont comme l'écume de l'histoire, des bulles, grosses ou menues, qui crèvent en surface, et dont l'éclatement suscite des remous qui plus ou moins loin se propagent. Celui-ci a laissé des traces très durables : elles ne sont pas aujourd'hui tout à fait effacées. Ces traces seules lui confèrent existence. En dehors d'elles, l'événement n'est rien. Donc c'est d'elles, essentiellement, que ce livre entend parler. »
« C'est la raison qui me conduit à regarder cette bataille et la mémoire qu'elle a laissée en anthropologue, autrement dit à tenter de les bien voir, toutes deux, comme enveloppées dans un ensemble culturel différent de celui qui gouverne aujourd'hui notre rapport au monde. »
Duby nous dit que vers l’an mil, la guerre ne fut plus considérée comme bonne par l’Église, et que la paix lui fut préférée, avec un rôle d’échange dorénavant dévolu au négoce ; c’est ainsi qu’elle en vint « à tolérer le lucre, à l'absoudre ». Ensuite l’Église travaille à instaurer la paix (armée) de Dieu, que le roi (consacré) va diriger personnellement. Le dimanche est chômé à la guerre, qui est toujours affaire de la chevalerie, comme la prière celle du clergé, et le labeur celle des roturiers, selon les trois ordres hiérarchisés de la société. L’essor de la monnaie va permettre celui des mercenaires, et aussi des tournois, joute équestre, jeu d'argent, « combats de plaisance » où la jeunesse exalte prouesse et largesse.
Et justement la bataille de Bouvines ressort à ce type d’exploit (quasiment "sportif", avec ses champions, son rituel, etc.). J’ai naturellement pensé au Désastre de Pavie de Giono – d’autant que Duby le cite comme source d’inspiration de son livre, de ton plus libre qu’un texte érudit !
Le code d’honneur reste prégnant, et tuer n’est pas le but.
« Parce que la guerre est une chasse, menée par des gens expérimentés, maîtres d'eux-mêmes, solidement protégés, qui ne rêvent pas d'exterminer leur ennemi, s'il est bon chrétien, mais de le saisir. Pour le rançonner. Encore une fois : pour gagner. »
« Quand, au début de l'engagement, Eustache de Malenghin se met à crier : « À mort les Français », tous ceux qui l'entendent sont écœurés, révoltés d'une telle inconvenance. Aussitôt les chevaliers de Picardie empoignent l'impertinent, ils le saignent. C'est le seul chevalier dont il est dit qu'il trouva la mort sur le champ de Bouvines. Avec Etienne de Longchamp, atteint lui, accidentellement, d'un couteau, par l'œillère du heaume. Tous les autres cadavres, ce fut le bas peuple qui les fournit. »
La conséquence légendaire de cette bataille est la naissance d’une nation, dans la lignée de Charlemagne et opposée à l’Allemagne, « mythe de la nation et de la royauté réunies ».
Déconstruit finement toute la complexité des ressorts de l’événement (y compris économiques). Captivant !
\Mots-clés : #contemythe #guerre #historique #moyenage #politique #religion #social #traditions
- le Mar 15 Nov - 11:36
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Georges Duby
- Réponses: 3
- Vues: 492
Paolo Rumiz
Appia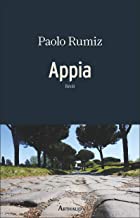
ArenSor nous a déjà présenté ce récit dans un commentaire approfondi, s’y reporter pour une description générale de l’ouvrage. Heureusement, il y a tant dans ce livre si dense que je vais pouvoir y glisser mon petit grain de sel…
C’est donc la redécouverte, presque une découverte, de la Via Appia, « la reine de toutes les routes », « la première route d’Europe », en grande partie oubliée, voire disparue. Périple à quatre randonneurs, pas pèlerins mais routards, « entre la rage et l’émerveillement », de l’antique en mafias en passant par les cuisines régionales (et sans éviter l’incontournable Padre Pio), de Rome la Dominante à Capoue puis Brindisi, du Nord au Sud et l’Est.
D’entrée le ton est vif, stigmatisant l’incurie, la « dilapidation » et bien d’autres maux actuels comme la paysannerie bradée – de ruines en ruines, plus ou moins récentes – et prônant les « paroles "narrabondes" » :
« …] le nomade préfère les paroles prononcées, capables de voler, plutôt que les paroles écrites, condamnées à « rester ». Il sait que la lecture silencieuse détache du monde et porte à la solitude. Les caractères de l’écriture phonétique ont été inventés pour être écoutés et partagés, et aujourd’hui le livre, pour ne pas mourir, a un besoin urgent de redevenir au plus vite le lieu de la voix. Chant, métrique, allure. Tendez l’oreille : dans l’antre des trésors, la Parole résonne que c’en est une merveille. »
Quelques autres extraits au fil de la lecture :
« Suivre notre route de bout en bout équivaut à se réapproprier le pays. »
« Rome, c’était avant toute autre chose le génie civil, la logistique, l’architecture. Routes, ponts, aqueducs, relais de poste. »
« "Vous êtes d’où ?" nous demande le jeune berger qui les suit, avachi dans sa voiture, la casquette à l’envers, visière sur la nuque, le bras gauche pendant le long de la portière. Il n’a jamais vu personne passer à pied sur ce chemin. Les Italiens ne marchent pas dans le ventre du pays.
[…]
Il rit, il se démanche le bras pour nous saluer et passe son chemin, klaxonnant derrière son troupeau lancé à l’assaut de l’abreuvoir, dans un sillage de crottes. Le berger en voiture et les bourgeois à pied : la situation est d’un comique évident. »
« Nous cherchions à faire renaître une route de l’Antiquité, au lieu de quoi nous assistons, lézarde après lézarde, éboulement après éboulement, à la mort en direct d’une route de l’ère moderne. »
« Les Pouilles étaient bien vertes, alors. Aujourd’hui est venu le temps du bitume et des désherbants. »
« Je me rends compte qu’il faudrait un minimum d’efforts pour maintenir cette route en état. »
« Rome était un empire fondé sur les choses. "Res" : entends la force lapidaire de ce mot qui ne laisse aucune place à de verbeuses échappatoires. »
« La lenteur complique les choses, répète toujours Riccardo, et moi, je veux une vie compliquée. »
J’ai pu mesurer combien peu je connais l’Italie (histoire, géographie, cuisine) – mais après tout, les Italiens eux-mêmes…
Une idée de randonnée pour Avadoro ?!
\Mots-clés : #Antiquité #historique #temoignage #voyage
- le Dim 30 Oct - 11:11
- Rechercher dans: Nature et voyages
- Sujet: Paolo Rumiz
- Réponses: 22
- Vues: 4010
Claudio Magris
Une autre mer
Enrico est un jeune étudiant en philologie de Gorizia en Autriche-Hongrie qui s’embarque à Trieste pour l’Argentine fin 1909, renonçant au bonheur avec son frère Nino et son ami Carlo, avec qui il pratiquait les philosophes grecs (notamment Platon), Schopenhauer, Ibsen, Tolstoï, Bouddha, Beethoven.
« Ce mélange de peuples et son agonie sont une grande leçon de civilisation et de mort ; une grande leçon de linguistique générale aussi, car la mort est spécialiste en matière de plus-que-parfait et de futur antérieur. »
« Sur ce bateau qui à présent file à travers l’Atlantique, Enrico est-il en train de courir pour courir ou bien pour arriver, pour avoir déjà couru et vécu ? À vrai dire, il reste immobile ; déjà les quelques pas qu’il fait entre sa cabine, le pont et la salle à manger lui semblent inconvenants dans la grande immobilité de la mer, égale et toujours à sa place autour du bateau qui prétend la labourer, alors que l’eau se retire un instant et se referme aussitôt. La terre supporte, maternelle, le soc de charrue qui la fend, mais la mer est un grand rire inaccessible ; rien n’y laisse de trace, les bras qui y nagent ne l’étreignent pas, ils l’éloignent et la perdent, elle ne se donne pas. »
Enrico devient éleveur en Patagonie, toujours en selle ; il est patient, détaché, libre, éprouvant dans l’instant la vie à laquelle il ne demande rien, refusant tout engagement professionnel, politique, sentimental ou familial.
« Une fois il se trouve face à un puma, son cheval s’emballe, il le fouette rageusement et même le mord, l’animal le désarçonne et le piétine ; pendant des mois il pisse du sang, jusqu’à ce que des Indiens lui fassent boire certaines décoctions d’écorces et que ça lui passe. »
« Il y a toujours du vent mais au bout d’un certain temps on apprend à distinguer ses tonalités diverses selon les heures et les saisons, un sifflement qui s’effiloche ou un coup sec comme une toux. Parfois il semble que le vent a des couleurs, il y a le vent jaune d’or entre les haies, le vent noir sur le plateau nu. »
« Enrico tire, le canard sauvage s’abat sur le sol, en un instant le vol héraldique est un déchet jeté par la fenêtre. La loi de la pesanteur est décidément un facteur de gaucherie dans la nature ; il n’y a que les mots qui en soient préservés, entre autres ceux imprimés dans les classiques grecs et latins de la collection Teubner de Leipzig. »
Venu de la mansarde de Nino dans Gorizia à une cabane de l’altiplano, fuyant le vacarme des villes (et la guerre), il correspond avec Carlo (qui est le philosophe Carlo Michelstaedter), jusqu’à ce que celui-ci se suicide après avoir rédigé La persuasion et la rhétorique. Cet essai théorise la persuasion comme « plénitude de l’être en accord avec la vie et l’instant », la rhétorique en tant que « tout ce qui nous fait désirer d’être ailleurs, plus tard, plus fort, tandis qu’irrévocablement s’écoule et s’enfuit notre vie véritable » (Gallimard). Enrico est l’incarnation du « persuadé ».
« Carlo est la conscience sensible du siècle et la mort n’a aucun pouvoir sur la conjugaison du verbe être, seulement sur l’avoir. Enrico a ses troupeaux, son cheval, quelques livres. »
« Carlo parlait de toi, il regardait ta vie comme la seule chose qui mérite de l’estime… ce que Carlo nous a donné tu le fais et le démontres dans chacun des actes de ta vie actuelle et tu ne le sais même pas… »
« Dans ces pages ultimes Carlo le représente comme l’homme libre à qui les choses disent « tu es » et qui jouit uniquement parce que sans rien demander ni craindre, ni la vie ni la mort, il est pleinement vivant toujours et à chaque instant, même au dernier. »
« Les hommes ne sont pas tristes parce qu’ils meurent, a dit Carlo, ils meurent parce qu’ils sont tristes. »
« Dans ces pages il y a la parole définitive, le diagnostic de la maladie qui ronge la civilisation. La persuasion, dit Carlo, c’est la possession au présent de sa propre vie et de sa propre personne, la capacité de vivre pleinement l’instant, sans le sacrifier à quelque chose qui est à venir ou dont on espère la venue prochaine, détruisant ainsi sa vie dans l’attente qu’elle passe le plus vite possible. Mais la civilisation est l’histoire des hommes incapables de vivre dans la persuasion, qui édifient l’énorme muraille de la rhétorique, l’organisation sociale du savoir et de l’agir, pour se cacher à eux-mêmes la vue et la conscience de leur propre vacuité. »
Enrico revient à Gorizia après la Grande Guerre ; l’empire austro-hongrois a éclaté. Il vit à Punta Salvore en Istrie, alors italienne, se marie, est quitté, demeure avec une autre femme. L’Istrie passe du régime fasciste au communisme (puis au titisme) en devenant part de la Yougoslavie après la Seconde Guerre mondiale. Il contemple toujours la mer, songeant à Carlo, de plus en plus hors du temps, à l’écart de la vie ; il montre peu à peu des signes de mesquinerie égoïste, puis meurt.
« Mais il ne peut en être autrement, les mots ne peuvent faire écho qu’à d’autres mots, pas à la vie. »
« …] le plaisir c’est de ne pas dépendre des choses qui ne sont pas absolument nécessaires, et même celles qui le sont doivent être accueillies avec indifférence. »
« Ce sont les esclaves qui ont toujours le mot droit à la bouche, ceux qui sont libres ont des devoirs. »
Magris a mis beaucoup de choses dans ce beau livre, qui m’a ramentu… Yourcenar !
\Mots-clés : #biographie #historique #philosophique #portrait #xxesiecle
- le Ven 7 Oct - 12:33
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Claudio Magris
- Réponses: 17
- Vues: 2309
Page 2 sur 17 •  1, 2, 3 ... 9 ... 17
1, 2, 3 ... 9 ... 17 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages
