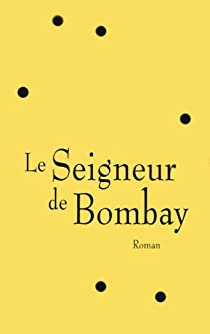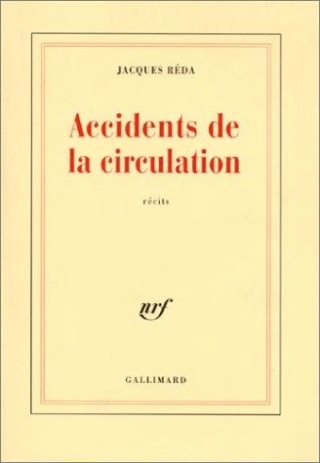La date/heure actuelle est Ven 19 Avr - 6:55
18 résultats trouvés pour urbanité
Pierre Bergounioux
Carnet de notes 1980-1990
Journal commencé à la trentaine, où Bergounioux note pour s’en souvenir les faits saillants de sa vie quotidienne (y compris la météo, à laquelle il est très sensible, étant plus rural qu’urbain) entre la Corrèze et la région parisienne, minéralogie, entomologie, pêche (à la truite), peinture, modelage, travail du bois puis de la ferraille, piano, archéologie préhistorique, descriptions (paysages, oiseaux), rêves nocturnes, ennuis de santé (lui et ses proches), famille et amis, son travail d’enseignant, et surtout ses copieuses lectures (et sa bibliophilie !), ses études qu’il prolonge ainsi, et ses souvenirs d’enfance (sa « vie antérieure », jusque dix-sept ans).
« Sur les zinnias voletaient Flambés et Machaons, ainsi que l’insaisissable Morosphinx. Jamais il ne se posait. Il oscillait dans l’air au-dessus du calice des fleurs, dans lequel il plongeait sa longue et fine trompe noire. Je n’ai jamais réussi, alors, à m’en emparer. J’en étais venu à le regarder comme une créature des rêves. Je percevais avec perplexité, avec dépit, l’existence de deux ordres, l’un que nos désirs édifient spontanément, l’autre, décevant, des choses effectivement accessibles, et l’impossibilité de franchir sans dommage ni perte la frontière. Est-ce que je m’en suis ouvert à quelqu’un ? Ai-je demandé des éclaircissements à ce sujet ? Peut-être. Papa aime à répéter, sardoniquement, que je fatiguais déjà tout le monde de questions. Mais je ne garde pas souvenir d’avoir obtenu la réponse. »
« Laver, nourrir, habiller les petits nous prend un temps infini. Comme la génération qui se forme pèse sur l’âge intermédiaire où nous sommes entrés, entre la dépendance à laquelle on est réduit, quand on commence, et celle où l’on va retomber avant de finir. »
« Ensuite, je peins – approches de la ville, avec, au premier plan, un canal, puis, sans l’avoir voulu, la façade de quelque château, flanqué de masures. À l’origine, c’était un pont sur l’eau à quoi j’ai fait faire un quart de tour. Quelque chose est apparu. Je ne parviens jamais de façon concertée à un résultat. Ce qui résulte d’un dessein arrêté est d’une banalité sans remède. C’est dans un angle mort, une dimension négligée, d’abord, d’un geste involontaire, que naissent la demeure des songes, la rive inconnue, la fête mystérieuse. »
« Toujours des soulèvements d’inquiétude, des éclairs d’angoisse, la crainte soudaine, panique, que le sursis qui me tient lieu de vie va prendre fin, que l’heure a sonné. Et ma réaction immédiate, indignée : qu’il est bien tôt, que j’ai beaucoup à faire, encore, qu’il me reste à connaître, à expérimenter, à aimer. »
« Tenté, au retour, de faire des essais de drapé avec du plâtre coulé dans un sac poubelle. J’avais été frappé, en avril, lors de la construction de la terrasse, des plis et volutes du ciment tombé, frais, dans la toile plastique froissée. Le résultat est décevant. Comment pourrait-il en aller autrement, au premier essai ? Et puis il faut que je revienne à ma lecture. Si j’excepte cette occupation dévorante, infinie, j’aurais bâclé ma vie, désireux que j’étais de répondre à l’appel de mille choses et conscient, tragiquement, qu’elle est trop brève pour pouvoir m’attarder plus qu’un court instant auprès de chacune d’elles. Comment étudier, pêcher, traquer les bêtes, chercher les pierres, les fossiles, peindre, modeler, menuiser, fondre, forger, rêver, respirer, regarder de tous ses yeux, être époux et père, professeur, fils et camarade, apprendre, avancer, ne pas oublier, ne jamais céder quand je suis sous la menace chronique d’être pris à la gorge sans rémission ? »
Début 1983, Bergounioux commence à écrire de la littérature.
« Malgré la fatigue, je reprends mon récit au commencement. J’essaie de le purger des approximations, des gaucheries. Je fais des phrases trop longues. C’est un de mes vices. Je me crois tenu, par mimétisme, d’envelopper une chose dans une seule et unique coulée syntaxique alors que, justement, le registre symbolique est autonome, relativement. »
Sa vie est partagée entre deux pôles, le travail dans l’Île-de-France, la nature pendant les vacances scolaires dans le Midi – et aussi le travail professionnel versus son « bureau » où il s’échine.
Ses phares sont Flaubert, Faulkner, Beckett, mais pas les seuls auteurs appréciés.
« Je lis les Chroniques italiennes de Stendhal avec un grand bonheur. Mais il a un âcre revers. Tout ce que je pourrais écrire s’en trouve terni. »
« Ensuite, j’extrais mes dernières lectures. Mais j’ai peu de preuves à présenter au tribunal qui siège en moi et me somme, le soir, d’expliquer, si je peux, ce que j’ai fait de ma journée. »
« Dans la même nuit, nous avons brisé le sortilège qui nous condamne à l’exil aux portes de Paris, traversé quatre cents kilomètres de ténèbres et de pluie, atteint le seuil de la seule existence que je sache, du seul monde qui lui fasse écho. »
« Je ne saurais lire puisque je suis parmi les choses. »
« Je regarde une émission de la série Histoires naturelles consacrée à la pêche au sandre. Les images du bord de l’eau, la lente marche du fleuve m’exaltent et m’accablent. J’aurais pu, moi aussi, passer des jours sur la rivière, dans l’oubli miséricordieux de tout. J’ai connu ce bonheur sans soupçonner qu’il me serait retiré bientôt. J’ai eu de ces heures, sur la Dordogne, et puis j’ai découvert, à dix-sept ans, qu’il semblait permis de comprendre ce qui nous arrivait, que cela se pouvait, et j’ai cessé de vivre. »
« J’esquisse un plan, jette, dirait-on, des grains de sable dans le vide, autour desquels pourraient se former des concrétions. Il me manque toujours l’arête. Je m’en remets sur l’avancée d’apporter ses propres rails, d’engendrer sa substance. Les mots, en revanche, tombent d’eux-mêmes, épousent la vision. »
« Je n’ai toujours pas pris mon parti de ne plus m’appartenir. »
« Paris excède la mesure de l’homme, la mienne, du moins. »
« La question est de savoir s’il est préférable de vivre ou de se retirer de la vie pour tenter d’y comprendre quelque chose, qui est encore une façon de vivre, mais combien désolée, amère, celle-ci. »
« Et comme je travaille de mes mains, et que je suis ici [les Bordes, en Corrèze], mes vieux compagnons, le noir souci, la contrariété, le désespoir chronique m’ont oublié. »
« Je songe aux profonds échos que la disparition de Mamie a soulevés, aux grandes profondeurs cachées sous la chatoyante et fragile surface des jours. J’y pensais, hier matin, dans la nuit noire, quand tout dormait, et j’y pense encore. Et c’est cela, peut-être, qu’il faudrait essayer de porter au jour. C’est le moment. Les figures tutélaires de mon enfance s’en vont, sans avoir seulement soupçonné, je suppose, ce qui s’est passé et les concernait, pourtant, au suprême degré. J’ai atteint l’âge où l’on peut tenter de comprendre, de porter dans l’ordre second, distinct, de l’écrit ce qu’on a confusément senti : la vie saisie à des moments successifs qui s’éclairent l’un l’autre, à l’occasion de ces subites et brutales retrouvailles que les naissances, les décès, surtout les décès, provoquent de loin en loin, les grandes permanences et le changement, l’œuvre fatidique, effrayante du temps. »
« Je reste un très long moment à me demander si j’ai bien de quoi remplir six autres chapitres, songe à croiser les voix, donc à modifier le poids, l’importance, le sens des choses qui commandent, à leur insu, parfois, mais parfois en conscience, les agissements des générations successives, la destinée unique, reprise par trois fois, de l’individu générique, supra-individuel auquel, sous le rapport de la longue durée, s’apparente celui, périssable, en qui nous consistons. »
« C’est à la faveur de ces instants limitrophes que m’apparaissent la hâte folle, la fureur concentrée qui m’emportent depuis ma dix-septième année et m’arrachent aux instants, aux lieux, aux êtres parmi lesquels nous aurons vécu, respiré. Toujours hors de moi, la tête ailleurs, l’esprit occupé de choses qui ne sont que dans les livres, ou alors du passé ou encore des éventualités redoutables, sans doute insurmontables, qui peuplent l’avenir. Et le seul bien véritable, le présent, ses authentiques et charmants habitants, je n’en aurai pas connu le goût, la douceur, la simple réalité. »
Bergounioux s’acharne, se force à écrire chaque jour – quand il en a le loisir.
« Je lance lessive sur lessive, range tout ce qui traîne partout, descends faire quelques achats, conduis Jean à sa dernière leçon de piano de l’année. Comment travailler ? Il ne me semble pas tant faire ce qu’il paraît, les courses, de la cuisine, prendre soin des petits, enseigner, etc. que combattre l’envahissement chronique de la vie, du métier, du chagrin, de tout, afin d’avoir un peu de temps pour la table de travail, méditer, endurer les affres sans nom de la réflexion, de l’explicitation. C’est un souci de chaque instant, une hantise vieille de vingt-deux ans et qui me ronge comme au premier jour. »
« Enfoncé dans la tâche d’écrire dont j’ai retrouvé, reconnu la rudesse, l’âpreté, le tempo – la facilité toute relative du matin, les lenteurs et les pesanteurs de l’après-midi, l’hébétude où je finis. C’est d’entrée de jeu qu’il faut emporter le morceau, arracher au vide rebelle, à l’opposition de la vie au retour réflexif, le sens de ce qui a eu lieu, le chiffre des heures passées. La violence du geste inaugural, et en vérité de cette occupation contre nature, dépasse de beaucoup celle que je mobilise, à l’atelier, contre les bois durs, l’acier. Que je relâche si peu que ce soit la pression à laquelle il faut soumettre la vapeur du souvenir, l’impalpable matière de la pensée, et la plume cesse de courir, le fil rompt. Je réussis à couvrir la deuxième page vers trois heures de l’après-midi après avoir douté, à chaque mot, d’extorquer le suivant, et un autre, encore, à l’inexpiable ennemi. C’est pur hasard, me semble-t-il, s’il a cédé. L’espoir s’est évanoui. On recommence, pourtant, puisque là est le chemin, et c’est ainsi qu’un autre terme vient, qu’on s’empresse, incrédule, d’ajouter au précédent. Et c’est à ce régime que je vais me trouver réduit pour des mois. »
« Je ne suis pas encore sorti de la voiture qu’un type à l’air malheureux, misérable, vient me demander une pièce. Il se passe des choses graves, que les rues soient pleines de gens qui mendient, qu’on soit partout et continuellement sollicité. »
« Les petits qui tournicotent sans rien faire m’irritent beaucoup. Mais c’est – j’essaie de me le rappeler – le privilège de l’âge où ils sont encore de n’avoir pas à compter, de dilapider les heures, les jours en petit nombre qui nous sont alloués. J’en ai usé, moi aussi, à leur âge, en très grand seigneur avant de me faire épicier. »
« Je me lève à six heures. Il s’agit de mordre sur le nouveau chapitre. Les premières lignes me coûtent mille maux. Je passe par toutes les couleurs de la désespérance. Partout, la muraille ou le puits, comme dans le conte d’Edgar Poe. Il doit être neuf heures lorsque les premiers mots apparaissent sur la page. Les mots d’Helvétius sur le malheur d’être et la fatigue de penser me reviennent. Dans l’intervalle, un jour clair et tiède s’est levé. C’est l’été de la Saint-Martin. Je m’acharne, gagne deux mots, trois autres un peu plus tard. À midi, j’aurai progressé d’une page. »
« La difficulté d’écrire se dresse, intacte, malgré les années. Je devine le grouillement obscur des possibles, l’enchevêtrement des thèmes, la confusion première, foncière, peut-être définitive de l’esprit aussi longtemps qu’il n’a pas fait retour sur lui-même, passé outre à l’interdit qui lui défend de se connaître, de porter en lui-même ordre et clarté. »
« Je lis La Psychologie des sentiments de Th. Ribot. Ce qu’il dit du sentiment esthétique est étrangement conforme à ce que j’ai toujours éprouvé, sous ce chef : un besoin aussi impérieux que la soif et la faim, plus impérieux, en vérité, plus violent, ab origine. »
« Je reprendrai plus tard la fin, qui est très insatisfaisante. Je reviens au début pour la première passe de rabotage. Il est deux heures et demie de l’après-midi lorsque j’ai grossièrement élagué le premier chapitre. La dialectique abstruse du deuxième m’arrête net et j’ai un accès de détresse. Jamais je ne serai content. Toujours mon esprit revient buter sur son insuffisance essentielle, son incurable infirmité. »
C’est une figure opiniâtre qui se dégage de ce journal, avec en filigrane un grand élan vers l’authenticité.
J’ai lu avec plaisir ces carnets, comme une histoire, tant le propos est bien énoncé, l’écriture agréable, la syntaxe soignée et riche le vocabulaire. Bien sûr cette lecture est laborieuse, puisqu’il s’agit d’un journal, donc non structuré, où abondent les récurrences des évocations de peines diverses ; mais les préoccupations de Bergounioux, les soucis qu’il consigne plus volontiers que les satisfactions, recoupent souvent les nôtres.
\Mots-clés : #autobiographie #creationartistique #ecriture #education #enfance #famille #journal #mort #nature #relationenfantparent #ruralité #urbanité #viequotidienne #xxesiecle
- le Jeu 14 Mar - 11:20
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Pierre Bergounioux
- Réponses: 40
- Vues: 4303
Eugène Dabit
L'Hôtel du Nord
Juste après-guerre, les Lecouvreur, Émile et Louise, un couple d’ouvriers avec un fils, Maurice, reprennent L'Hôtel du Nord, près du quai de Jemmapes sur le canal Saint-Martin.
« Au fil du canal, des péniches glissaient, lentes et gonflées comme du bétail. »
C’est un hôtel populaire, assez pauvre, où les « locataires » vivent presque en famille. La bonne, c’est Renée, qui vit là avec son amant, plutôt brutal.
« Elle l’avait rendu exigeant et difficile. La vie à deux use le cœur d’un homme. Pierre ne lui parlait plus jamais d’amour. »
Enceinte, Pierre la quitte ; les Lecouvreur la gardent, son fils en nourrice à la campagne meurt, des hommes la fréquentent, elle doit s’en aller.
Beaucoup d’histoires de couples, parfois drôles souvent tristes, ou sordides, comme autant d’épisodes en courts chapitres sur la clientèle : les anciens, les familles, les jeunes ouvriers, les gens de passage, et la « boutique » avec les joueurs de manille, les ivrognes, les « camionneurs » des écuries voisines, les pêcheurs…
Une autre évocation douce-amère de ce Paris populaire disparu.
\Mots-clés : #enfance #nostalgie #urbanité #viequotidienne #xxesiecle
- le Dim 28 Jan - 11:09
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Eugène Dabit
- Réponses: 11
- Vues: 276
Albert Cossery
Les Couleurs de l'infamie
Ossama est un adroit voleur professionnel du Caire, à l’éthique de dérision professant que « le seul moteur de l’humanité était le vol et l’escroquerie » ; à ce titre, il vole les riches (voleurs) pour faire circuler l’argent.
« La multitude humaine qui déambulait au rythme nonchalant d’une flânerie estivale sur les trottoirs défoncés de la cité millénaire d’Al Qahira, semblait s’accommoder avec sérénité, et même un certain cynisme, de la dégradation incessante et irréversible de l’environnement. »
Il a trouvé dans le portefeuille volé d’un certain Suleyman, promoteur immobilier véreux, la lettre d’Abdelrazak, frère du ministre des Travaux publics, qui l’implique dans une malversation à propos d’une habitation neuve qui s’est effondrée en tuant cinquante personnes.
Pour faire éclater le scandale, il approche Karamallah, un lettré subversif qui vit dans la Cité des morts, un vaste cimetière urbain squatté par une multitude de démunis.
« Pour Karamallah le choix de cette austère résidence avait pour origine le despotisme d’un gouvernement imperméable à l’humour et férocement hostile à toute information ayant quelque rapport avec la vérité. »
« C’était un principe de sa philosophie que les problèmes se résolvent d’eux-mêmes si on n’y prête pas attention. »
« Il n’y a aucun avenir dans la vérité, tandis que le mensonge est porteur de vastes espérances. »
« Sache que l’honneur est une notion abstraite, inventée comme toujours par la caste des dominateurs pour que le plus pauvre des pauvres puisse s’enorgueillir d’un avoir fantomatique qui ne coûte rien à personne. »
« Atef Suleyman, le promoteur d’anodins génocides urbains, ne portait pas le signe de l’infamie inscrit sur son front, mais cette négligence de la nature n’empêchait pas les innombrables locataires des immeubles construits par sa société immobilière de le maudire à toute heure du jour et de la nuit, sans compter certains extrémistes qui réclamaient sa mort immédiate. Malheureusement ces invectives d’une populace acrimonieuse, dépourvue de toute culture économique pour apprécier les beautés du capitalisme, n’atteignaient jamais leur destinataire. Celui-ci vivait majestueusement dans le quartier résidentiel de Zamalek, distant de plusieurs kilomètres des nouvelles cités conquises sur le désert où il exerçait sa lucrative industrie. Désabusé par la pérennité des monuments pharaoniques, Suleyman se voulait le promoteur de l’ère des constructions éphémères – emblème de la modernité – qui ne léguaient à la postérité que gravats et poussières. En langage clair, des maisons jetables. »
Karamallah décide de faire se rencontrer Ossama et « cet homme [qui] représente toute l’infamie universelle »…
Ce roman est moins abouti que de précédents, mais rend sensiblement Le Caire contemporain et sa population (ainsi que quelques réalités socio-économiques), avec même quelques personnages féminins moins contrefaits, comme Safira la prostituée et Nahed l’étudiante. Ici, j’entends Oum Kalsoum :
« Soudain il s’arrêta pour écouter une voix venue de nulle part, mais qu’il connaissait depuis son enfance. Une radio diffusait les airs adulés de la chanteuse mythique dont la voix accompagnera encore longtemps les hommes dans leurs dérives et leurs amours inassouvis. »
\Mots-clés : #corruption #misere #politique #social #urbanité #xxesiecle
- le Mer 19 Avr - 12:03
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Albert Cossery
- Réponses: 59
- Vues: 5933
Lawrence Block
Huit millions de façons de mourir
Une enquête de Matt Scudder, détective privé sans licence qui rend service contre émolument ; naguère inspecteur de police, une de ses balles perdues a tué une fillette, et il ne cesse de s’interroger sur les aléas de l’existence ; quoique non-croyant, il met dix pour cent de ce qu’il touche dans le tronc des pauvres d’une église quelconque. Il est en sevrage alcoolique (excellent rendu des affres de l’addiction, Alcooliques Anonymes, trous de mémoire – traduits par « passages à vide » –, rechute, etc.)
Kim Dakkinen, une jeune et belle call-girl venue de son Midwest, lui demande d’annoncer à son souteneur, Chance, qu’elle a décidé d’arrêter : le lendemain de son départ, elle est massacrée, et Chance le recrute pour trouver le meurtrier.
Beaucoup de faits divers évoqués illustrent la violence à New York.
« — La peine de mort, nous l’avons. Mais pas pour les assassins, non. Pour les gens normaux. L’homme de la rue a plus de chances de se faire tuer que le tueur de passer à la chaise électrique. La peine de mort, on la trouve cinq, six, sept fois par jour. […]
— Il y a huit millions d’histoires dans la ville, me dit-il. Vous vous rappelez cette émission ? C’était à la télévision, il y a quelques années.
— Je me rappelle.
— Ils disaient un truc comme ça, à la fin de chaque émission. Il y a huit millions d’histoires dans la ville nue. Celle-ci en était une.
— Je me rappelle.
— Huit millions d’histoires. Vous savez ce qu’il y a, ici, dans cette putain de ville de merde ? Vous savez ce qu’il y a ? Il y a huit millions de façons de mourir. »
Matt enquête donc (il soupçonne que le meurtrier de Kim pourrait être un « petit ami »), et interroge les autres filles de Chance, ce qui est l’occasion de détailler leurs profils, de la poétesse éprise d’indépendance à la journaliste féministe qui voudrait écrire un roman sur la prostitution, « une fin en soi ». L’une d’elles se suicide. Le réceptionniste de l’hôtel où Kim a été tuée disparaît. Une prostituée transgenre est massacrée de la même façon que celle-ci.
Matt, têtu mais déboussolé et se sentant coupable dans sa lutte pour tenir sans alcool vingt-quatre heures par vingt-quatre heures, prend conscience de l’importance de l’indice de l’émeraude verte que portait Kim au doigt, alors que Block avait déjà soigneusement attiré notre attention dessus.
« — Je me demande, dit-elle, si elle était une émi-ou une immi-grante.
— Que voulez-vous dire ?
— Partait-elle de ou pour ? C’est une question de point de vue. Quand je suis arrivée à New York, j’étais partie pour, j’étais également partie de chez mes parents et de la ville où j’avais été élevée, mais c’était secondaire. Par la suite, quand je me suis séparée de mon mari, je fuyais quelque chose. Le fait de partir était une chose en soi, qui comptait plus que la destination. »
« L’argent trop vite gagné ne dure pas. Autrement, Wall Street appartiendrait aux dealers. »
« Au cours des réunions, on entend les gens dire : « Le pire de mes jours de sobriété vaut mieux que le meilleur de mes jours d’ivresse ». Et tout le monde hoche la tête comme le petit chien en plastique sur le tableau de bord d’un Portoricain. Je songeai à cette soirée avec Jan, puis je regardai la petite cellule qui me sert de chambre et j’essayai de comprendre en quoi cette soirée-ci était meilleure que cette soirée-là. »
« On glane un truc par-ci, un truc par-là et on ne sait jamais s’ils vont se recouper. »
« J’essaie de ne pas penser au fait qu’on l’a tuée, et pourquoi et comment elle est morte. Vous avez lu un livre qui s’appelle Watership Down ? (Je ne l’avais pas lu.) Eh bien, ça parle d’une colonie de lapins, des lapins semi-domestiques. Ils ont toute la nourriture qu’il leur faut parce que les humains leur en apportent. C’est une sorte de paradis pour lapins, sauf que les hommes qui leur donnent à manger le font pour pouvoir tendre des pièges et avoir de temps en temps un lapin pour le dîner. Les lapins survivants ne parlent jamais des pièges, ni de leurs compagnons que les pièges ont tués. Ils ont une sorte d’accord tacite en fonction duquel ils font comme si les pièges n’existaient pas et comme si leurs copains morts n’avaient jamais existé. (Jusque-là, en parlant, elle ne m’avait pas regardé. Mais ses yeux se fixèrent sur les miens quand elle poursuivit : ) Vous savez, je crois que les New-Yorkais sont comme ces lapins. Nous vivons ici pour profiter de ce que la ville peut nous procurer sous forme de culture, de possibilités d’emploi ou ce que vous voudrez. Et nous détournons les yeux quand la ville tue nos voisins et nos amis. Oh, bien sûr, nous lisons ça dans les journaux, nous en parlons pendant un jour ou deux, mais après, nous nous empressons d’oublier. Parce qu’autrement, nous serions obligés de faire quelque chose contre ça et nous en sommes incapables. Ou bien il nous faudrait aller vivre ailleurs et nous n’avons pas envie de bouger. Nous sommes comme ces lapins, vous ne croyez pas ? »
« Le proxénétisme n’est pas difficile à apprendre. Tout ce qui compte, c’est le pouvoir. On fait comme si on l’avait déjà, et les femmes viennent vous le donner d’elles-mêmes. C’est pas plus compliqué que ça. »
\Mots-clés : #addiction #criminalite #polar #social #solitude #urbanité #xxesiecle
- le Ven 17 Mar - 11:29
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Lawrence Block
- Réponses: 18
- Vues: 746
Junichiro TANIZAKI
Le Tatouage et autres récits
Le Tatouage
Seikichi, un jeune tatoueur réputé et cruel qui cherchait une jeune beauté selon son désir pour lui « instiller toute son âme », suborne une future geisha et lui montre deux peintures anciennes, une princesse contemplant un homme qui va être immolé, et une femme regardant un monceau de cadavres, lui disant que c’est sa propre image. D’abord terrifiée, elle se soumet, puis est révélée à elle-même par le tatouage.
Les Jeunes Garçons
Ei-chan, le narrateur, est invité par son condisciple, le timoré Shin.ichi, à jouer chez lui, où il se révèle dominateur, notamment avec Senkichi, pourtant chef de bande à l’école. Mitsuko, sa sœur, se mêle bientôt à eux, et c’est alors une succession de fantasmatiques jeux sadomasochistes.
Le Secret
Le narrateur décide de faire une retraite secrète à l’écart des turbulences de Tôkyô.
« Il ne peut pas ne pas y avoir, me disais-je, coincée au milieu de la cohue des rues populaires, quelque oasis de paix où ne passent qu’exceptionnellement des gens bien déterminés dans des circonstances bien déterminées ; exactement comme dans un torrent impétueux se forment ici et là des trous d’eau dormante. »
Il mène dès lors une existence clandestine, lisant romans policiers et histoires criminelles, se déguisant pour sortir, puis se travestissant en femme.
« Environ une semaine plus tard, un soir, un incident imprévu, un curieux concours de circonstances, furent le point de départ d’une aventure passant toutes les autres en étrangeté, en fantaisie, en mystère. »
Il croise une femme avec qui il eut une aventure, dont la beauté l’éclipse et qui le débusque.
« Vous trouvez sans doute singulière ma toilette de ce soir ; mais c’est qu’il n’est pas d’autre moyen que de changer ainsi de mise tous les jours si l’on veut dissimuler aux gens ce que l’on est réellement. »
Il fréquente de nouveau « la femme d’un songe, qui habite le pays des chimères » sans même connaître son adresse, emmené là en pousse-pousse les yeux bandés ; parvenu à découvrir le chemin de son domicile, il sera dégrisé au terme de ses déambulations dans les rues, dont il se demande depuis le commencement combien il ne connaît pas dans la ville (et ce texte constitue un beau morceau d'urbex)…
Tanizaki, écrivain de la sensualité hors-norme dans un style magnifique, dès ses premières œuvres.
\Mots-clés : #nouvelle #psychologique #sexualité #urbanité
- le Sam 30 Avr - 14:49
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: Junichiro TANIZAKI
- Réponses: 77
- Vues: 9366
Jean-Paul Clébert
Paris insolite
À propos de ces flâneries urbaines, impossible de ne pas évoquer les deux Robert, Giraud et Doisneau (qui apparaissent d’ailleurs dans ce livre qui leur est dédié), et inutile de préciser que la connaissance géographique de Paris est conseillée. Ce texte est plus encore peut-être un témoignage sur les lieux et l’époque, tant sont nombreux les portraits et tableaux précis, comme les Halles, la Villette, ou l’ancienne ligne des fortifications où erre ce « rôdeur de barrières ».
« Mais en haut, face au Canon de Bicêtre et le long des fortifs, c’est pas beau. Envie de s’asseoir et d’en finir, à condition que ça puisse finir un jour. Une brocanteuse en rade ayant piqué la place d’un ancien, et rangeaillé ses mignardises en stuc et toc sur un coin d’herbe, il s’ensuit une bagarre lamentable. L’autre balance tout. Volent au vent, tas de détritus, morceaux de porcelaine qui trouvent encore moyen de casser. Et ça gueule. Argot hétérogène, yiddish, polak, bas allemand, berbère, kabyle, gitan et même slang, comme celui de ce grand vieil Américain là-bas, couvert d’une peau de bique à trois étages comme un berger des Pyrénées et que personne ne comprend, si ce n’est peut-être l’Isaac du coin qui cligne de l’œil… »
Clébert se signale également par son intense curiosité, surtout pour les gens, mais aussi esthétique, historique, sociale.
« Et Martin, surtout, peut-être le seul type qui à Paris puisse se vanter d’exercer la profession de porteur d’eau, allant chaque matin chercher à la fontaine la flotte à tout faire de dix ou quinze habitants, muni de brocs en faïence bleue et d’arrosoirs en tôle bosselée, faisant les corvées, les courses, au tabac, chez le boulanger, à l’épicerie, là-bas en ville, de l’autre côté de la caserne, se faisant payer la plupart du temps en nature, cigarettes, verres de vin ou de café, bols de soupe qu’il réclame d’un ton péremptoire, n’ayant pas la langue dans sa poche et lorgnant instinctivement le comptoir, n’acceptant d’aller quérir les ingrédients que si son godet est plein à ras bord, d’avance et posé bien en évidence ; menant une vie de château, couchant dans une cahute plus ou moins abritée dont il est le légal propriétaire, se couchant tôt et se levant tard, n’arrivant chez Francis que vers dix heures, au désespoir de Mme Jeanne qui n’a rien pour tremper la soupe, et saluant la compagnie, se collant les mitaines aux flancs du poêle, s’approchant du patron qui petit-déjeune en rentier d’un saladier de café au lait et de tranches de pain beurré, et lui déclarant l’œil égrillard et la voix théâtrale : Ah ! Comme votre café me fait plaisir ! »
Il n’omet pas de courir les filles − affichant une certaine misogynie peut-être ?
« La Catherine fait dans les cent quatre-vingts livres et baise à croupetons. Grasses et boudinées, elles ne sont plus de toute première fraîcheur, mais les clients ne manquent pas : bouchers et tripiers du coin habitués à malaxer la viande mollasse et la bidoche violette. »
La misère pendant la guerre et le long après-guerre de reconstruction passent peu à peu, avec les petits métiers depuis disparus.
« …] les biffins qui (tôt arrivés, à trois-quatre-cinq heures de la nuit d’hiver, pour avoir la meilleure place qu’ils marquent de ficelles, de pavés, de journaux, tandis qu’ils vont boire un jus mauvais) viennent vendre leur camelote, ces objets hétéroclites dont échappe à première vue la valeur marchande, morceaux de tissus et de vêtements, godasses dépareillées, soucoupes ébréchées, réveille-matin sans aiguilles et vides probablement, jeux de clés, poignées de clous, cartes postales, journaux maculés, jusqu’à des morceaux de planches coupées et assemblées en margotins. »
Les bistrots évidemment, tous aussi singuliers que chaque individu, dans un livre cependant moins aviné que Le Vin des rues ; pourtant les mêmes rues et quartiers de Paris… Et surtout la vadrouille heureuse :
« Itinéraires parisiens, dédales, détours, raccourcis, volteface, retours, montées, descentes, calme plat des rues abandonnées, dont le charme est si grand que fatigué déjà d’un long piétinement dans la zone sud, aux confins de Montrouge, je n’hésitais pas à regagner ma tanière des Halles par le chemin des écoliers, quittant le boulevard Kellermann pour remonter sur la place des Peupliers et longer la rue Charles-Fourier (où dès cinq heures des dizaines de copains cloches stationnent devant la porte de cave du sordide bâtiment de la Mie de Pain, faisant la queue de façon organisée, ne voulant pas perdre une place, car les tickets, rouges pour une soupe et un lit, blancs pour une soupe seule et le droit de dormir sur les bancs, et sans couleur distincte pour celui de s’allonger sur le ciment, sont distribués par ordre d’arrivée). »
« Mais un cul-de-sac dans la ville est une chose rare, presque un miracle. Car Paris-la-nuit est un dédale, les rues y sont interminables, n’en finissent jamais, se multiplient, se poursuivent, se prolongent, s’emboîtent les unes aux autres comme des canalisations, se rétrécissent ou s’élargissent comme des bouts de lorgnettes, ou en équerre, ou à angles droits, vaste treillage, échafaudage enchevêtré de tubulures de fer posé à même le sol. Paris-la-nuit est un labyrinthe où chaque rue débouche dans une autre, ou dans un boulevard qu’ils appellent justement une artère, où je progresse lentement par soubresauts comme un caillot de sang, hoquetant, suivant la plus grande pente, poussé derrière moi par les étranglements, aspiré devant par le vide. Et j’avance, je marche, je coule, je fleuve, j’espère me jeter dans la mer, havre de paix et d’insouciance. Mais c’est impossible, il n’y a jamais autre chose que des embranchements, des carrefours, des bifurcations, partout des affluents à droite à gauche en amont en aval, partout des rives identiques encaissées indifférentes, insensibles à l’égratignement du cours des rues. »
« Vagabondage. Mon plus long voyage, un bon mois, fut le parcours du quatrième arrondissement, le centre vital de Paris, le plexus, d’une diversité stupéfiante, propre à l’évocation d’un exotisme de pas-de-porte. »
« Mains au creux des fentes pantalonnières, le mégot basculant, l’œil plissé sous la fumée, un pied chassant l’autre, on se tape un gueuleton visuel, gratuit, pour soi seul. »
Les différentes « chroniques », manifestement écrites à différentes dates, sont vaguement regroupées par thèmes ou lieux. L’expression est originale, et vigoureuse. Savoureuse, même si ce n’est pas toujours drôle.
« C’est en son honneur et sur sa demande que j’avais fait le sacrifice d’un paquet de bougies, dont il aimait comme moi la lumière vacillante tellement plus vivante que celle d’une lampe électrique dont la source est anonyme et canalisée, vivante dans ses mouvements de hanches, dans la variation de sa vivacité, une cosmie d’éclats et d’éclipses, vivante parce qu’éphémère, dont la lueur apaisante ne choquait pas les paupières des endormis, les veillait, s’animant à leur souffle. J’en avais enculé trois bouteilles. »
« Rien n’est plus épouvantable que le repêchage en Seine de cadavres qui s’en vont à vau-l’eau couler des jours meilleurs dans un autre univers, gosses maltraités et incompris, filles engrossées et abandonnées, chômeurs inadaptables, follingues obsédés, tous ces types de roman-feuilleton qui ont la vogue des lectures populaires et dont le spectacle cramponne les badauds comme des insectes scatophiles sur des merdes neuves. »
La crasse et la faim, les Arabes et les juifs, les cloches et les mendigots, les chiffonniers et les chômeurs, les vieillards et les putains, les repris de justice et un avaleur de grenouilles, Clébert est avide de s’initier à tous les milieux et corporations, de connaître de façon approfondie tout un réseau de repaires, terriers, planques et caches secrètes, ficelles, tuyaux et combines partagées entre copains.
Le vrai de cette vie, c’est le goût de la liberté, un choix assumé de cette indépendance que lui envient les inconnus qui lui prêtent leur logement pour une matinée :
« Nombre relativement étonnant (qui suffit à remplir la longueur d’un calendrier) des types ayant encore le sens de l’hospitalité et du dépannage gratuit. »
Sans paraître politisé, Clébert n’aime pas les personnes aisées qui méprisent les nécessiteux, guère les religieux (mais son point de vue sur eux est intéressant) et nettement moins encore les touristes et la fausse bohème ; il fait preuve de passéisme (regret des vieilles rues et du bon temps qui disparaissent) :
« La lumière bouffe tout. La nuit dans la ville se réduit à une poignée d’heures. »
Saisissante évocation également, celle des indigents qui meurent seuls : tout le passage mériterait d’être cité.
« On imagine assez peu le nombre de ces êtres humains, à bout de ressources et de souffle, qui s’éteignent en cachette, se terrent dans leur trou pour se voir mourir. »
Le « Paris Vécu », les marches nocturnes, le peuple quand ce terme n’était pas encore trop entaché de connotations – une page devenue légendaire.
Une belle découverte que celle de ce livre, due à maître ArenSor, que j'en remercie !
\Mots-clés : #lieu #misere #social #temoignage #urbanité #xxesiecle
- le Mer 19 Mai - 0:27
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean-Paul Clébert
- Réponses: 6
- Vues: 598
Flâneries urbaines
De Léon-Paul Fargue, recueil Sous la lampe, 1929.Juste magnifique et saisissant, langueur du rythme, traces de rimes, cicatrices d'assonances...
Allez fuse, poème, fuse...
La gareÀ Arthur Fontaine
Gare de la douleur j’ai fait toutes tes routes.
Je ne peux plus aller, je ne peux plus partir.
J’ai traîné sous tes ciels, j’ai crié sous tes voûtes.
Je me tends vers le jour où j’en verrai sortir
Le masque sans regard qui roule à ma rencontre
Sur le crassier livide où je rampe vers lui,
Quand le convoi des jours qui brûle ses décombres
Crachera son repas d’ombres pour d’autres ombres
Dans l’étable de fer où rumine la nuit.
Ville de fiel, orgues brumeuses sous l’abside
Où les jouets divins s’entrouvrent pour nous voir,
Je n’entends plus gronder dans ton gouffre l’espoir
Que me soufflaient tes chœurs, que me traçaient tes signes,
À l’heure où les maisons s’allument pour le soir.
Ruche du miel amer où les hommes essaiment,
Port crevé de strideurs, noir de remorqueurs,
Dont la huée enfonce sa clef dans le cœur
Haïssable et hagard des ludions qui s’aiment,
Torpilleur de la chair contre les vieux mirages
Dont la salve défait et refait les visages,
Sombre école du soir où la classe rapporte
L’erreur de s’embrasser, l’erreur de se quitter,
Il y a bien longtemps que je sais écouter
Ton écluse qui souffre à deux pas de ma porte.
Je suis venu chez toi du temps de ma jeunesse.
Je me souviens du cœur, je me souviens du jour
Où j'ai quitté sans bruit pour surprendre l'amour
Mes parents qui lisaient, la lampe, la tendresse
Et ce vieux logement que je verrai toujours.
Sur l'atlas enfumé, sur la courbe vitreuse,
J'ai guidé mon fanal au milieu de mes frères.
Les ombres commençaient le halage nocturne.
Le mètre, le ruban filaient dans leur poterne
Les hommes s'enroulaient autour d'un dévidoir
La boutique, l’enclume à l’oreille cassée,
La forge qui respire une dernière prise,
La terrasse qui sent le sable et la liqueur
Rougissaient par degré sur le livre d’images
Et gagnaient lentement leur place dans l’église.
Un tramway secouait en frôlant les feuillages
Son harnais de sommeil dans les flaques des rues.
L’hippocampe roulait sa barque et sa lanterne
Sur les pièges du fer et sur les clefs perdues.
Il y avait un mur assommé de traverses
Avec un bec de gaz tout taché de rousseur
Où fusait tristement les insectes des arbres
Sous le regard absent des éclairs de chaleur.
L’odeur d’un quartier sombre où se fondent les graisses
Envoyait gauchement ses corbeaux sur le ciel.
Une lampe filait dans l’étude du soir.
Une cour bruissait dans son gâteau de miel.
Une vitre battait comme un petit cahier
Contre le tableau noir où la main du vieux maître
Posait et retirait doucement les étoiles.
Les femmes s’élançaient comme des araignées
Quand un passant marchait sur le bord de leur toile.
Les grands fonds soucieux bourbillaient de plongeurs
Que le masque futur cherchait comme il me cherche
Le présage secret qui chasse sur les hommes
Nageait d’un peu plus près sur ma tête baissée.
Je me suis retrouvé sous la terrasse des vitres
Dans les plants ruisselants, les massifs des visages
Scellés du nom, de l’âge et du secret du coffre,
Du nécessaire d’os et du compas de chair,
En face du tunnel où se cache la fée
De l’aube, qui demain vendra ses madeleines
Sur un quai somnolent tout mouillé de rosée
Dans le bruit du tambour, dans le bruit de la mer.
J’ai longé tout un soir tes grands trains méditants,
Triangles vigilants, braises, bielles couplées,
Sifflets doux, percement lointain des courtilières
Cagoules qui clignez bassement par vos fentes,
Avec deux passants noirs penchés sur la rambarde
Au–dessus du fournil du pont de la Chapelle
Où le guerrier déchu qui mène les hommes
Encrasse son panache avec un bruit de chaînes,
Et le grand disque vert de la rue de Jessaint,
Gare de ma jeunesse et de ma solitude
Que l’orage parfois saluait longuement,
J’aurai longtemps connu tes regards et tes rampes,
Tes bâillements trempés, tes cris froids, tes attentes,
J’ai suivi tes passants, j’ai doublé tes départs,
Debout contre un pilier j’en aurai pris ma part
Au moment de buter au heurtoir de l’impasse,
À l’heure qu’il faudra renverser la vapeur
Et que j’embrasserai sur sa bouche carrée
Le masque ardent et dur qui prendra mon empreinte
Dans le long cri d’adieu de tes portes fermées
\Mots-clés : #poésie #urbanité #xxesiecle
- le Dim 18 Avr - 6:52
- Rechercher dans: Balades en...
- Sujet: Flâneries urbaines
- Réponses: 89
- Vues: 8406
Léon-Paul Fargue
Merci Tristram !
!Poète sensible ce Léon-Paul, amateur de jeux de mots, buveur, oiseau de nuit parisien et épris de sa ville...
Colette a, paraît-il, prétendu: Je ne l'aurais peut-être pas reconnu, si je l'avais rencontré au clair de jour.
Il signe une poésie à l'âcre légèreté, ou à l'insouciance pesante, comme dans ce magnifique extrait (qui ouvre le recueil Espaces Vulturnes - Épaisseurs, 1928) en pleine hype surréaliste et pourtant complètement engagé sur une voie différente.
C'est un poème sonore et imagé, avec son premier vers introductif de l'espace (la ville), poème énonçant la condition existentielle du poète Fargue, lequel doit certainement être l'homme à l'encre sympathique, poème qui donne la mission assignée: être l'œil quêteur de ces va-et-vient urbains.
La ville ouvre ses compas
Ses couleurs, ses tire-lignes.
Sur les grèves étagères
L'homme à l'encre sympathique
Contemple avec méfiance
Les signes de son bonheur.
Hachures de chair qui dansent
Aux confins de la rumeur,
Cette allure verticale,
Ce saut interrogateur
Dans les rues qui se démaillent
Piétinées par les troupeaux
Que faisande le menteur
\Mots-clés : #poésie #urbanité #xxesiecle
- le Dim 18 Avr - 6:31
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Léon-Paul Fargue
- Réponses: 13
- Vues: 719
Léon-Paul Fargue
Le Piéton de Paris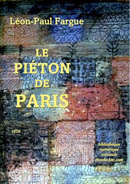
Petit complément à la présentation d’ArenSor.
Paru en 1939, ce livre évoque pour partie un Paris qui appartenait déjà au passé, et des quartiers qu’on regrette de ne pas mieux connaître afin de suivre leur parcours ; cette mémoration reste cependant pleine de charme.
Une sorte d’avant-propos, Par ailleurs, forme un beau texte présentant ce compte-rendu d’innombrables promenades dans les rues parisiennes, où Léon-Paul Fargue expose sa (non-)méthode, si ce n’est une attitude d’écoute sensible :
« Qu’on veuille bien m’excuser de risquer ici quelques semble-paradoxes auxquels je tiens comme à la racine de mes yeux. Je ne me fie pas trop à l’inspiration. Je ne me vois pas, tâtonnant parmi les armoires et les chauves-souris de ma chambre, à la recherche de cette vapeur tiède qui, paraît-il, fait soudain sourdre en vous des sources cachées d’où jaillit le vin nouveau. L’inspiration, dans le royaume obscur de la pensée, c’est peut-être quelque chose comme un jour de grand marché dans le canton. Il y a réjouissance en quelque endroit de la matière grise ; des velléités s’ébranlent, pareilles à des carrioles de maraîchers ; on entend galoper les lourdes carnes des idées ; les archers et les hussards de l’imagination chargent le papier net. Et voici que ce papier se couvrirait, comme par opération magique, et comme si, à de certaines heures, nous sentions, sur cette plage qui va d’une tempe à l’autre, le crépitement d’une mitrailleuse à écrire ? L’inspiration, en art, me fait l’effet d’un paroxysme de facilité. Et je lui préférerais encore l’intention, autre microbe, mais plus curieux. »
« Sans doute, il y a une première prise de contact. Des matières, des images sûres, des odeurs irréfutables, des clartés péremptoires viennent à ma rencontre. J’en écris, soit. C’est un premier jet. J’installe ces couleurs de préface sur un large écran. Je tisse une toile. Le stade second consiste à percevoir plus loin, à m’arrêter devant le même spectacle, à me taire plus avant, à respirer plus profond devant la même émotion. »
Le « ghetto parisien » :
« Des détritus croupissent dans les ruisseaux, mêlés aux enfants chétifs, aux chats eczémateux. Une odeur de beignets, de cuisses chaudes, de poireaux traîne à la hauteur des rez-de-chaussée. Des silhouettes ornées de tresses traversent les rues étroites et vont s’approvisionner en sirops ou en chaussons de moujik dans les librairies-restaurants. »
Les bistrots et cafés tiennent une large place, notamment les établissements recevant les noctambules.
« La chromo, en allemand le kitch, existe dans le domaine des cabarets de nuit. Restaurants bizarres, généralement slaves, qui sont à la fête nocturne ce que la quincaillerie catholico-lugubre de la place Saint-Sulpice est à l’art. Nous n’aimons pas beaucoup ça. Entr’ouvrons pourtant ensemble ce velours décoré, ces tonnes de soie parfumée qui tiennent lieu de portes dans deux de ces bars : Shéhérazade et Casanova, aux noms qui troublent l’éternel calicot. »
Fargue fait référence à nombre de personnes dont le nom, lorsqu’il le donne, a été oublié depuis.
« Je le trouvais généralement nu, déambulant dans sa chambre et s’arrêtant soudain pour crayonner les murs, comme faisait Scribe quand il avait besoin de répliques vraies. Mais le Portugais n’improvisait aucune scène : il était à la recherche d’un art nouveau qui devait, dans son esprit, réunir les avantages de la peinture, de la littérature et du papier peint. »
Il n’y a pas que la bohème et les artistes de Montmartre :
« Montparnasse est un des endroits du monde où il est le plus facile de vivre sans rien faire, et parfois même de gagner de l’argent. Il y suffit, la plupart du temps, de porter un pull-over voyant, de fumer une pipe un peu compliquée, et de danser en croquenots à clous. En revanche, le moindre talent se trouve plutôt gênant : il est même le seul moyen de crever carrément de faim. »
« Le véritable état-major de Montparnasse se composait de Moréas, de Whistler, de Jarry, de Cremnitz, de Derain, de Picasso, de Salmon, de Max Jacob, haut patronage de morts et de vivants qui donne encore le ton aux débutants dans l’art d’avoir du génie. »
Des quais de Seine aux grands hôtels, on visite l’Histoire et des histoires que souvent j'ignorais.
L’expression de la langue est heureuse, vraisemblablement fort travaillée, avec recours à des expressions et mots rares ou qui ne s’entendent plus.
À rapprocher bien sûr de Le Vin des rues, de Robert Giraud, voir ICI, et d’Antoine Blondin, voir LÀ.
Facile de regretter de ne pas avoir connu les lieux à l’époque, ainsi que les contemporains qui figurent dans ce livre…
\Mots-clés : #lieu #urbanité #xxesiecle
- le Dim 18 Avr - 0:23
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Léon-Paul Fargue
- Réponses: 13
- Vues: 719
Roberto Arlt
Eaux-Fortes de Buenos Aires
Bienvenue chez les flâneurs, flemmards et autres fainéants portègnes ! « le joyeux parasite avec le squenun [une variété locale de vaurien particulièrement mou] ou l’homme qui fait le mort » ! le chômeur professionnel (ou pas) en marcel qui lanterne assis sur le seuil, « marié à une repasseuse » qui l’entretient…
« L’homme bouchon, qui jamais ne s’enfonce, quels que soient les événements troubles auxquels il est mêlé, est le type le plus intéressant de la faune des enflures. »
« C’est le propre des crapules, des malandrins, des arnaqueurs, des roublards, des médiocres, des imbéciles brevetés, des voleurs, des futés, des lèche-bottes, des feignasses et des flambeurs ; c’est le propre des misérables prétentieux, des hommes ruinés avec un nom aristocratique, des sous-fifres aux velléités de patron, des patrons ayant une âme de sous-fifre, que de proclamer après un quart d’heure de conversation et avec l’air pincé d’une demoiselle dont on douterait du pucelage : "Moi, j’suis né avec une cuillère en argent dans la bouche…" »
« Ils en ont ras-le-bol. La flemme les a bouffés jusqu’à la moelle. Ils s’ennuient tellement que, pour parler, il leur faut prendre des minutes de vacances et des arrêts maladies d’un quart d’heure. Ils en ont ras-le-bol. […]
En Inde, ces indolents seraient de parfaits disciples de Bouddha, puisqu’ils sont les seuls à connaître les mystères et les délices de la vie contemplative. »
« Il ne fait aucun doute que nous vivons dans un pays de vagabonds, de fainéants, de bons à rien, d’aspirants fonctionnaires et de fanatiques du hamac paraguayen. »
Presque aussi fielleux qu’Ambrose Bierce et acerbe qu’Ian McEwan (c’est le mordant des eaux-fortes), cette humanité est aussi « fourbe » qu’ailleurs, mais on devine chez l’auteur de ces chroniques journalistiques une misanthropie (il est vrai concernant plus les notables que les malfrats ou miséreux) et une acrimonie singulières.
Misogynie également :
« Une femme doute du mari, du fiancé, du frère et du père, mais il suffit qu’elle croise sur son chemin un dévergondé loquace, pure pyrotechnie, gestes mélodramatiques, prestance étudiée, théâtralité comme on en trouve dans les romans de cette idiote appelée Delly, et frère, fiancé ou mari se trouvent annihilés par le charlatan. »
Goût (amer) de la vie urbaine :
« Tout au long des saussaies, il y a des rues plus mystérieuses que des repaires de brigands, des maisons à deux étages en tôle de zinc et, sur le fond ondulé de ces maisons, un tramway ocre jette une ombre mouvante de progrès. » (Les Grues abandonnées sur l’île Maciel)
« Les extraordinaires rencontres de la rue. Les choses qu’on y voit. Les mots qu’on y entend. Les tragédies qui vous sautent au visage. Et soudain, la rue, la rue lisse et qui semblait destinée à n’être qu’une artère de trafic avec les trottoirs pour les hommes et la chaussée pour les bestiaux et les chariots, devient une vitrine, ou plutôt une scène grotesque et épouvantable où, comme dans les cartons de Goya, les possédés, les pendus, les ensorcelés, les fous, dansent leur sarabande infernale. » (Le Plaisir de vagabonder)
Il m’a semblé que, bien qu’ils ne furent pas du même milieu social, Arlt concrétisait la fascination de son contemporain Borges pour les bas-fonds et le tango. Il fait souvent référence aux auteurs russes, mais use surtout de la langue populaire de l’argot (le lunfardo de Buenos Aires et le cálo gitan), souvent d’origine italienne ; un petit lexique arltien en fin de volume s’adresse plus aux hispanophones.
M’a donné le goût de retourner aux Livres de Chroniques d’António Lobo Antunes, qui dans mes souvenirs, certes incertains, sont peut-être plus substantiels.
\Mots-clés : #criminalite #urbanité #viequotidienne #xxesiecle
- le Ven 1 Jan - 20:45
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Roberto Arlt
- Réponses: 22
- Vues: 2012
Roberto Arlt

Eaux-Fortes de Buenos Aires
Écrites entre 1928 et 1933, les Eaux-fortes de Buenos Aires sont autant d’instantanés de la capitale argentine, de ses habitants, de ses coutumes et de son art de vivre : ses jeunes oisifs plantés devant leur seuil, ses chantiers de construction pillés de leurs briques, ses maisons de tôle ondulée aux couleurs passées… Un tableau vivant et mouvant de la ville, une œuvre urbaine et moderne.
asphalte-editions.com
Moins dingue que Les Sept fous, sans doute parce qu'il s'agit de textes destinés à un journal, sans doute aussi parce que l'objectif est différent. Quoique croquer sa ville et son moment n'empêche Roberto Arlt d'avoir la dent dure et le mot acéré... A côté de ça on a aussi des similitudes : l'intérêt pour les petits, l'envie de dévoiler l'envers du décor, l'attachement peut-être pour certaines manies et travers. ... Un goût du pittoresque ? Pourquoi pas.
De l'autre côté de la page en tout cas il y a du plaisir, de la curiosité. C'est très vivant entre les considérations linguistiques (c'est un bouquin pour Tristram), l'incroyable matière à citations (c'est un bouquin pour Tristram), le tout venant du quotidien, et la manière par petites touches d'élaborer un portrait d'une ville entière et vivante, "qui passe" avec une pincée de regrets.
Et le ton libre, direct, mouvant.
Très bon moment, qui ne paye pas tant de mine derrière ses provocations mais qui devrait laisser une impression durable. Je recommande chaudement.
Mots-clés : #lieu #urbanité #viequotidienne
- le Lun 16 Nov - 19:29
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Roberto Arlt
- Réponses: 22
- Vues: 2012
Albert Cossery
Les Hommes oubliés de Dieu
Recueil de cinq nouvelles, ou plutôt suite de portraits cairotes, dans les années quarante :
I – Le facteur se venge
Un repasseur drogué qui ne sort de sa paresse que pour insulter le facteur, souffre-douleur du quartier, et pour baiser sa femme ou la battre. Or le facteur rêve d’une revanche de tyran… C’est un sommet d’abjection, et on est loin d’une ode à la paresse…
« Il se sentait trop fatigué pour aller jusqu’à chez lui et battre sa femme. Il aurait voulu plutôt dormir. »
II – La jeune fille et le haschache
(Le haschache est le consommateur de haschich). Une jeune fille en proie au désir se livre à un drogué qui peine à sortir de son sommeil.
« Tous les gens qui habitent ce quartier sont des imbéciles. Quant aux femmes, ce sont toutes des putains. Elles ne savent faire que des commérages lorsqu’il n’y a pas un homme pour les baiser. Comme je voudrais leur pisser à tous sur la tête. La drogue qui me rendra fou, il y a cinq jours que je n’en ai pas senti l’odeur. Le monde va bientôt finir. Si ça continue encore quelques jours, il n’y aura plus de monde. »
III – Le coiffeur a tué sa femme
Chaktour, le misérable ferblantier de la ruelle Noire, n’a plus d’espoir. Son fils arrive avec une botte de trèfle, pour le « mouton de la fête », que son père n’a pas les moyens d’acheter. (Traditionnellement, chaque famille sacrifie un mouton pour le repas de l'Aïd el-Kebir, la "grande fête" musulmane qui commémore le sacrifice d'Abraham.)
« L’homme tout en travaillant pensait à la mort comme à la seule délivrance possible, et il la désirait ardemment pour lui, sa femme, son enfant et toute la ruelle. »
« Il n’était pas gêné pas sa misère. Elle était grande et large et il s’y promenait librement. Elle était comme une prison spacieuse ; il était libre d’aller d’un mur à l’autre de sa misère sans demander la permission à personne. Il était seulement gêné de la sentir si abondante. C’était une misère riche. Il ne savait comment la dépenser. Il regarda l’enfant, l’héritier d’une telle richesse. »
Le gendarme, autre despote de quartier, évoque la « révolte des balayeurs » qu’il a maté la veille. Chaktour est déconcerté par cet évènement, ainsi que par le crime du coiffeur ambulant ; mais lui vient la conviction que la misère arrive à sa fin.
Sarcastique, Cossery personnifie la ville qui broie les pauvres au profit des puissants (il distingue « ville européenne » et ville indigène) ; ce texte fut considéré comme subversif par les autorités…
IV – Danger de la fantaisie
« L’école des mendiants se trouve au bout du sentier de l’Enfant-qui-Pisse, dans un endroit appelé la place du Palmier. C’est une vieille masure à l’état de ruine, effroyablement noyée dans les immondices. Elle sert en même temps de demeure à Abou Chawali. »
Abou Chawali est le maître de cette « école des mendiants », et le scandalise la théorie du lettré Tewfik Gad, « intellectuel raté », qui est d’user de psychologie, et de substituer la sympathie à la pitié pour toucher les « clients » :
« La sympathie était un sentiment encore inexploité par la classe mendiante. Jusqu’alors la valeur d’un mendiant résidait dans sa misère crapuleuse, ses plaies suppurantes et son indicible saleté. Aussi cette race de pleurnicheurs incurables, aux douleurs criardes et à l’aspect mortel, devait disparaître et faire place à une foule de petites créatures habillées comme des poupées en sucre, et aux attitudes naïves et charmantes. Par leur maintien et leurs gestes pleins d’une grâce exotique, elles sauront établir chez le client un courant de sympathie, vite récompensé, car rien ne plaît à l’homme satisfait comme le spectacle qui l’émeut d’une manière agréable, sans le salir ni l’effaroucher. Il était certain que tous les idiots sentimentaux de la ville européenne seraient séduits par l’attrait irrésistible de ce pittoresque nouveau. »
Une fantaisie qu’Abou Chawali rejette au nom du réalisme ‒ et de la dignité des mendiants :
« Abou Chawali, lui, répugnait à la fantaisie ; il était partisan du réalisme le plus cru, le plus dénué de complaisance, celui qui prend les clients à la gorge, les étouffe et les rend inaptes à tout genre d’optimisme. Il lui fallait des créatures rassemblant en elles les pires mutilations corporelles, souillées par mille maladies contagieuses et inguérissables. En somme, une matière humaine qui fût en mesure d’apitoyer les cœurs pourris et les consciences tarées de l’humanité repue. Et non seulement les apitoyer, mais aussi leur faire peur. Car Abou Chawali portait en lui, profondément enracinée, une idée sociale, pleine de sombres révoltes. »
« Il faut que nos enfants apparaissent tels qu’ils sont en réalité, c’est-à-dire immondes et crasseux et qu’ils traînent dans les rues comme de vivants reproches. Il faut que le monde nous craigne et qu’il sente monter autour de lui l’odeur nauséabonde de notre énorme misère. […]
‒ La mendicité ne subira pas de modifications. Elle devra rester telle qu’elle est ou bien disparaître complètement de la surface de la terre. »
On atteint dans ce texte goguenard un sommet de sordidité…
Qui a vécu au Caire se ramentera :
« Les ordures incalculables de plusieurs générations mortes et oubliées fleurissent le long de ce sentier maudit. C’est la fin du monde ; on ne peut pas aller plus loin. La misère humaine a trouvé ici son tombeau. »
Excellente observation sur le mécanisme de l’émeute :
« Alors les gens du terrain comprennent qu’un délire a éclaté quelque part et ils se précipitent tous vers le lieu du tumulte. Sans rien demander, sans s’inquiéter du motif, ils prennent l’affaire en mains, se lancent des injures et créent d’inutiles et irrémédiables confusions. »
V – Les affamés ne rêvent que de pain
Tristes amours de misère, la nuit, dans l’attente d’une aube d’espoir.
« Passèrent d’abord un vieillard aveugle traîné par un enfant nu, mais complètement nu et qui n’avait rien fait pour l’être. Mendiant et fils de mendiant. La rue les avala peu à peu, lentement, avec dégoût.
Puis passa une femme mariée qui était très pressée, mais personne ne savait pourquoi.
Puis une charrette avec deux hommes dedans, deux hommes maigres et silencieux.
Puis quelques vagues échantillons de l’humanité crasseuse, sans couleur ni relief, et qu’on ne peut pas décrire.
Puis la rue redevint ce qu’elle était. »
Cossery préfigure Naguib Mahfouz et ses harafîch (gueux des ruelles), avec une dimension plus critique ; on trouve déjà dans ce livre le petit peuple des terrasses qu’Alaa al-Aswany dépeindra.
Mots-clés : #nouvelle #social #urbanité
- le Jeu 10 Sep - 16:22
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Albert Cossery
- Réponses: 59
- Vues: 5933
Vikram CHANDRA
Ce livre est à l’image de Bombay, à l’image de son sujet : un monstre. Plus de 1000 pages, 1,2 kg sur la balance, écrit pas bien gros. Une aberration d’édition. Ce livre, je le regarde en chien de faïence depuis des années. Très tentée de le lire, incapable d’en arriver à la seule solution envisageable pour en venir à bout, à savoir le tronçonner. Et abîmer un livre, ça, je déteste. Mais je me suis dit que cette période si particulière était l’occasion de vaincre mes réticences. Et donc, j’ai tronçonné gaiement.Le Seigneur de Bombay est un livre monstre sur un homme monstrueux vivant dans une ville monstre. Nous voilà bien partis. Comme il va de soi dans une ville monstre, à Bombay, la corruption est partout. Même la police est concernée, très concernée même. Il y a ceux qui usent de la corruption « raisonnablement », et ceux qui mangent à tout les rateliers, y compris celui de la pègre, dans une relation amis-ennemis dont l’ambiguïté est savamment entretenue. A ce petit jeu-là certains sont rois, mais Sartaj Singh n’en est pas. Il n’est qu’un policier de quartier qui penche du côté plutôt honnête de la force. Le voilà donc bien étonné lorsqu’un appel anonyme lui livre Ganesh Gaitonde, l’un des plus gros parrains de Bombay. Mais Gaitonde se suicide avant son arrestation, entraînant avec lui dans la mort une femme inconnue. C'est une grosse affaire, même les services secrets s'en mêlent. Sartaj est chargé d'enquêter. On ne lui dit qu’une chose : la sécurité de la nation est en jeu, pas moins.
Donc, Sartaj enquête tout en menant sa vie de flic de quartier, ses affaires routinières, ses visites à sa mère, et ses éventuelles amours. Sartaj est un type plutôt bien, fatigué de la vie mais pas encore tout à fait désabusé. La flamme ne demande, peut-être, qu’à être réanimée. Le récit alterne entre le quotidien de Sartaj et le récit d’outre-tombe de Gaitonde. Car même mort, le parrain tient à sa légende. Alors, quand Sartaj se repose, il se raconte, dans une logorhhée méticuleuse qui ne nous épargne rien de ses faits d’arme ; son premier crime, sa première trahison, puis la gloire, l’or et les femmes, les boys fidèles à la vie à la mort, et la lutte acharnée contre son concurrent, Suleman Isa. Le tout matiné d’un chouilla de patriotisme hindou, puisqu’il y avait une place à prendre de ce côté là…
Ganesh use des hommes comme on écosse des petits pois. A chaque cosse ouverte, ce sont 4 ou 5 grains bien ronds et charnus que l’on s’attend à voir rouler dans l’assiette. Mais il arrive qu’il y en ait d’autres, des grains menus et mal fichus qui se cachaient dans les coins. On les accepte quand même dans la pitance, on n’est pas chien. Ganesh Gaitonde les accepte aussi. Sauf que lui n’a que faire des petits pois, ce sont les têtes qu’il fait rouler. S’il y en a plus que prévu, eh bien c’est qu’il devait y avoir des dommages collatéraux. Et bas.
Cela dit, Ganesh a aussi des états d’âme. C’est un homme qui réfléchit, qui a une vision, une pensée, une spiritualité. Il voit loin, il n’est pas fait du même bois que le commun des mortels, et il met tout en oeuvre pour nous en persuader dans ces pages où il expose en détail ses succès et aussi, parfois, quelques faiblesses moins avouables… Fascinante plongée dans la psychée d’un parrain...
Bien qu’essentiellement centré sur Gaitonde et Sartaj, le récit ne néglige pas pour autant les autres protagonistes. Vikram Chandra se délecte à nous raconter par me menu la vie de chacun des personnages rencontrés : policiers, femmes au foyer ou femmes d’affaire, politiciens, délinquants, et même Miss Monde… Un luxe de détails qui pourrait être fastidieux et se révèle au contraire fascinant. Au travers des multiples aspects de ces vies minuscules imbriquées, c’est le portrait de Bombay, l’énigmatique ville monstre, qui se dessine en creux. Avec ses contradictions, ses rêves enfouis, ses amours ravis ou déçus, ses meurtres et sa crasse.
Les nombreux termes hindi, gujarati, marathi, bengali, etc. qui parsèment le récit, et que le formidable travail de traduction nous rend instinctivement compréhensibles, participent de la sensation d'immersion. (Le recours au (très bon) glossaire s'avère évidemment utile, par exemple pour établir la subtile distinction entre maderchood et bhenchood, dont Gaitonde et ses sbires ponctuent la moindre hrase...)
J’y étais, à Bombay, aux côté de Ganesh Gaitonde et de ses boys, de Sartaj et de son adjoint, et même de Miss monde. Un regard, un éclat de rire, et puis une tête qui roule…
1000 pages. Il y a forcément des longueurs, dans un tel pavé, me direz-vous. Je n’en ai pas vu une seule. Ces 1000 pages ont passé comme un éclair. Même tronçonné et désormais moche comme tout, ce livre, je l’aime. J'ai pour lui les yeux de Chimène. Trois jours que je l'ai terminé, et il me manque. Tout me paraît fade, en comparaison. Il fera date, c'est certain.
Vous aurez compris, je crois, que je le recommande vivement, ce Seigneur de Bombay, si vous êtes prêts à découvrir les entrailles de la ville monstre, ses recoins obscurs et ses magouilles, son charme inexplicable et son bouillonnement. Un roman fascinant, palpitant. Même si au final, de ce tourbillon de vies humaines, ne reste que la vacuité et l’impermanence. Un petit tour sur terre, et bas.
Mots-clés : #famille #urbanité #violence
- le Sam 11 Avr - 16:59
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: Vikram CHANDRA
- Réponses: 8
- Vues: 800
Alain Damasio
Les furtifs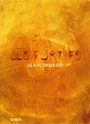
Tu te sens prêt, Lorca?
– Absolument pas…
– C'est précisément ce que j'appelle être prêt. Cet état d'incertitude fragile, ouverte, qui rend disponible à l'inconnu. Crois-moi Lorca, quoi qu'il arrive, tu vas vivre l'un des moments les plus intenses de ton existence. Reste ouvert.
On est en 2041. Les villes sont privatisées. La Gouvernance, grâce aux technologies numériques, a mis en place une société basée sur le contrôle , Jouant sur la peur et le désir, elle a habilement su la faire accepter au commun des mortels.
Une nouvelle espèce arrive peu à peu à la connaissance humaine : les furtifs, qui semble à l’origine de tout le vivant. Elle a pu survivre grâce à sa capacité à se cacher , ne pas laisser de trace, échapper au contrôle, justement. Elle intéresse l’armée de par cette capacité, et le pouvoir de la rébellion qu’elle est susceptible de nourrir. Les furtifs sont des êtres étranges, en métamorphose permanente - empruntant en quelques minutes à différentes espèces animales ou végétales, mais pouvant aussi transmettre à un humain une part d’eux-même. Ils se déplacent avec une vélocité extrême, échappant au regard humain, car ce seul regard peut les tuer. Ils ont à voir avec la fuite, la liberté. Ils s’expriment par sons, mélodies, phrases mi-infantiles mi-sybillines. Et laissent d’obscures glyphe comme seul signe de leur passage.
Tishka, l’enfant mystérieusement disparue de Lorca et Sahar, n’a t ’elle pas rejoint le camp des furtifs ?. Ses parents la recherchent dans une logue enquête, riche en péripéties, en rencontres parfois ésotériques, en épreuves.
Plus leur enquête avance, plus se lève dans le pays une prise de conscience, d’où émerge un mouvement pro-furtif, réunissant les libertaires, les marginaux, les exclus et ceux qui se sont exclus par choix, grapheurs, musiciens, scientifiques, rebelles en tout genre..., qui va nous mener dans une ZAD à Porquerolles et vers un combat politique et une insurrection finale grandiose.
C’est un formidable roman d’aventure, où le réel infiltre un imaginaire prolifique. Les six personnages-phares, identifiées par leur symboles, sont des figures mythologiques, héros portés par leur grandeur et leurs petitesses, leur singularité, leur folie, leur charisme. Les rebondissements s’enchaînent , mêlant scènes intimes, épisodes guerriers ou quasi magiques, poursuites, amples scènes de foule.
C’est un magnifique roman d’amour autour du trio Varèse, au centre duquel Trishka est l’enfant troublante, qui a pris son envol, mais n’en aime pas moins ses parents. Ceux-ci l’ont fait naître pour elle-même, respectent son choix, mais voudraient quand même bien la voir grandir, la caresser, l’aimer. C’est d’un pathétique grandiose et sans pathos.
C’est un roman philosophique, sociétal, politique, une grande réflexion sur les outils numériques et les risques qu’ils nous font encourir, si réels, si proches. Une exhortation à s’intéresser à l’autre et le respecter, à s’ouvrir à l’étrange, à s’ancrer dans le vivant. Un hommage aux sens, à la musique et aux sonorités, au beau, aux valeurs et émotions perdues.
C’est enfin un objet littéraire pharaonique, unique, où on retrouve tout le travail sur la langue, la ponctuation et la typographie qu’on a déjà connu dans La horde du Contrevent, mais magnifié, mûri, amplifié. Damasio est un inventeur de mots fantasque et érudit, un joueur de son assez incroyable, un surdoué du jeu de mots, de lettres, de l’Oulipo. Il multiplie les néologismes, les inversions de sens et de syllabes, les allitérations et les assonances, cela s’accélère dans les temps forts, monte en puissance tout au fil du livre pour créer dans les derniers chapitre, s’insinuant peu à peu, comme une langue nouvelle, le damasien, issue du français, parfaitement compréhensible mais parfaitement différente, d’une poésie, d’un rythme, d’une tension, d’une mélodie incroyables.
C’est livre géant, titanesque, décapant, totalement enthousiasmant. Il ne faut pas hésiter à s’obstiner à y entrer, c’est une lecture exigeante, qui demande un temps d’habituation (il m’a fallu 200 pages) mais qui devient enchanteresse.
Mots-clés : #amour #aventure #fantastique #insurrection #relationenfantparent #romanchoral #sciencefiction #urbanité #xxesiecle
- le Mar 30 Juil - 13:54
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Alain Damasio
- Réponses: 55
- Vues: 4813
Cyril Dion
DemainUn nouveau monde en marche
(il a dû rager un peu de se faire piquer son « monde en marche, Cyril Dion)

Mais nous avons oublié un détail : est-ce que l'être humain a besoin de la nature ? Oui. Est-ce que la nature a besoin de l'être humain ? Non.
Pierre Rabhi.
En 2012, Cyril Dion « découvre », par une étude de Nature , que nous allons tous dans le mur.
"Que faire ? Mais pourquoi personne ne fait rien ? , se dit-il, c’est incroyable !"
Bien conscient qu’il ne faut pas compter sur les multinationales, ni sur les gouvernements que celles-ci tiennent pieds et poings liés, il décide, avec Mélanie Laurent, de partir à la rencontre d’initiatives individuelles ou collectives, souvent implantées dans le local, qui non seulement créent une ambiance de pépinière, mais aussi prouvent que cela est possible, efficace, et aussi rentable. Et réussissent. Et diffusent leurs pratiques.
Et il les raconte, persuadé que ce qui fait bouger les hommes, ce sont les récits. Il y met une sympathique naïveté feinte, qui permet de revenir aux fondamentaux dans une volonté pédagogique, un enthousiasme déterminé qui permettent d’échapper à un côté trop catalogue, fait ressentir une réelle proximité au lecteur, traité d’égal à égal, totalement impliqué, pris en considération tant dans les carences de ses connaissances que dans ses motivations personnelles.
Thierry Salomon : « le mot "transition" est intéressant. Ce n'est pas un modèle, c'est une démarche. On part d'un certain nombre de petites expérimentations locales, qui arrivent à se bâtir dans les interstices de ce que permet l'institution, qui se reproduisent lorsqu'elles fonctionnent et, si elles ont fait leurs preuves, on crée une norme pour aller dans ce sens. Ce mouvement est intéressant car il part du bas, puis le haut raccroche les wagons pour généraliser. »
Cyril Dion mêle avec fluidité les données objectives, informations scientifiques, interviews d’experts et d’acteurs de terrain, observations personnelles. Il y met aussi une réelle empathie, qui est l’une de ses forces, je crois, pour un réel ouvrage d’investigation populaire. Il s’introduit dans le récit, aussi humble que le lecteur, réfléchissant à l’hôtel d’étape, cédant un temps au pessimisme pour mieux rebondir, se culpabilisant des km parcourus pour la cause en avion.
Cela donne, à côté de la rigueur de l’exercice, une grande proximité à ce nouveau récitpour l’homme moderne qu’il nous propose, qui décide d’un optimisme (il dit bien quelque part qu'il a volontairement décidé de ne pas s'étendre sur les difficultés et les échecs).
Il finit en apothéose par la description de « son » monde idéal pour demain, écologique, citoyen, partagé, récit très utopique, il doit bien le savoir, mais porteur d’espoirs et ferment d’actions positives.
- Spoiler:
- Au niveau agroalimentaire, il rapporte les expériences de Detroit, ville économiquement ravagée reconvertie dans l' agriculture urbaine , de Topmordem en Angleterre dont les habitants ont développé Les Incroyables Comestibles, culture de fruits et légumes partagés , ou la ferme de permaculture du Bec-Helloin qui prouve sa compétitivité face à la culture intensive.
Au niveau énergétique il rapporte le scénario de transition énergétique Negawatt, qui montre que celle-ci est possible, entre décroissance du gaspillage énergétique, création d’énergies renouvelables, recherche d'autonomie, réduction d'émission de CO2 . Un pays (Islande), des îles (La réunion), des villes ( Copenhague classée n°1 des villes les plus résilientes au changement climatique, Malmö et son écoquartier prometteur, San Francisco avec l'objectif zéro déchet) se lancent à fond dans l’aventure de la transition énergétique.
Au niveau économique, en réponse à l’aberration de la croissance économique indéfinie, génératrice du pillage de la planète et des pire disparités, il évoque l’expérience d’Emmanuel Druon (dont j’ai lu Le syndrome du poisson lune) avec Pochéco, une entreprise qui prouve au quotidien que la performance économique est compatible avec une croissance raisonnée et une gestion écologique et humaine. Il parle des monnaies complémentaires comme celle de la Wir Bank en Suisse ou la Bristol Pound, d’initiatives privilégiant le local., ou encore des makers et de la culture des Fab-labs, qui remplacent la consommation par la fabrication et la réparation.
Au niveau politique, il parle de la démocratie délibérative, du tirage au sort en alternative aux élections, des ateliers constituants http://ateliersconstituants.org/ et s’appuie sur la rédaction de la Constitution Islandaise, ou les panchayat (conseils municipaux) et gram sabha (assemblées populaires) en Inde notamment à Kuttambakkam, où le maire, par ce biais, a réussi à annihiler le système des castes et l’exclusion des Intouchables.
Tout cela ne tiendra pas sans l’éducation, bien sûr, une éducation à la coopération et non plus à la compétition, comme en Finlande où nous visitons une école.
Alors, nous, qu’est-ce que nous faisons aujourd’hui plus qu’hier pour entrer dans Demain ?
Mots-clés : #contemporain #documentaire #ecologie #economie #education #nature #politique #urbanité
- le Jeu 16 Mai - 11:50
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Cyril Dion
- Réponses: 24
- Vues: 1559
Jacques Réda
Accidents de la circulation
180 pages environ. Nouvelles, bien que l'auteur préfère récits. Paru en 2001.
L'arpenteur du quotidien urbain sublimé nous entraîne cette fois-ci (et pour ne pas trop changer) dans son Paris maintes fois encré dans sa prose, entre narquois, préciosité, poésie et agapes quasi de l'ordre cingriesque.
Avec incursions, à moins qu'excursions ne soit un terme préférable, en France profonde, à Lisbonne, à Madrid, à Bologne (pour "les cravates", qu'on peut trouver ailleurs chez cet auteur - il doit aimer donc ce récit-là, à moins que l'amateur ne soit son éditeur).
Homme aux semelles d'évent, il met en évidence tout ce que la confrérie de la voirie et du fil à linge cèle, de façon géo-poétiquement correcte (cher Jack-Hubert, si tu passes par ce fil d'auteur, qui n'est pas qu'à linge...).
Nul besoin d'aller s'immerger dans des tessons de civilisations rares, dans des paysages sublimes, des rencontres hors du commun: le simple franchissement géographique de votre boîte aux lettres suffit à entrer dans un monde exceptionnel, à condition bien entendu de subodorer sa présence, ce qui est une autre paire de manches.
Mais-bonheur et tutoriel-, voilà Réda à la rescousse, puis à la manœuvre et à la barre, on lève le doigt pour se laisser désigner passager attentif et silencieux.
Ces Accidents de la circulation, dans lesquels il n'y a jamais crash ! au sens ballardien du terme, et plutôt collusion que collision, ont leur charme (usuel chez l'auteur) un peu bric-et-broc.
Narquois disais-je, flegmatique, bonhomme et gentiment humoristique, le gentilhomme Réda.
Un mot sur le découpage du livre:
25 récits (ou nouvelles), charpentés en 4 titres de chapitre, qui valent qu'on les cite parce qu'ils se répondent et composent une phrase:
Quand on sent que le temps va tourner à l'orage,
(11 récits)
il vaut mieux s'aviser de prendre un peu de champ,
(5 récits)
puis reprendre la route, en roulant, en marchant,
(5 récits)
en se laissant porter au loin comme un nuage.
(4 récits).
Récit Roman de l'escabeau a écrit:
Peut-on attendre davantage d'une rue ? Raisonnablement: non, ou pour mieux dire: en bonne justice. Au-delà, les rues, si on leur tourne la tête, on ne sait pas de quoi elles seront capables ensuite pour leur malheur. Elles ressembleront à celles de la banlieue pavillonnaire qui ont complètement perdu le nord, auxquelles il faudrait sans arrêt rappeler le parcours qu'elles ont à suivre ou simplement leur nom qui se répète dans les communes avoisinantes. Si je renais au mot la rue du Retrait dans les intentions qu'elle manifeste, ce serait abuser de l'innocence, parce qu'elle propose quelque chose qu'elle ne comprend pas bien.
Mots-clés : #nouvelle #urbanité
- le Ven 10 Mai - 14:51
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jacques Réda
- Réponses: 38
- Vues: 4754
Simon et Capucine Johannin
Nino dans la nuit
Nino est un tout jeune homme qui hante les rues et les nuits de Paris, poches vides, cœur battant, à la recherche d’éclats qui s’apparenteraient au bonheur. La rage au cœur il hait cette société qui ne vit que par l’argent, il va de petits boulots humiliants en petits vols rapides. Il aime la douce Lale d’un curieux amour-toujours revitalisant, trésor de tendresse dans ce monde sans pitié. Avec ses potes, à la vie à la mort, ils déchirent les nuits de leurs cris, de elurs danses, de leurs défonces.
Si le roman n’avait pas cette fin, ce serait une romance contemporaine âpre, sauvage, magnétique, où la noirceur du quotidien n’empêche pas la douceur de l’âme de ces jeunes antihéros en galère, refusés de la vie « normal ». Il y a une beauté fébrile dans cette colère désespérée, dans cette langue crue, résolument contemporaine, à la poésie urbaine, qui claque et frappe, on prend ça en pleine figure.
J’ai douté sur la fin, cette allégeance brutale à un univers clinquant, cette démission face au fric. Qu’y a t’il donc de pire, la galère sociale en elle-même , ou les mirages et les compromissions qu’elle impose ?
On parlait naguère des romans que seule la fin « justifiait ». J’ai trouvé ici un roman insolite, innovant, prenant, auquel je dois au contraire pardonner la fin.
Mots-clés : #amitié #amour #contemporain #jeunesse #social #urbanité
- le Jeu 25 Avr - 9:26
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Simon et Capucine Johannin
- Réponses: 1
- Vues: 861
Iain Sinclair

Quitter Londres
1975-2016, ainsi se termine le livre. A travers ses marches, souvent accompagnées, l'auteur nous fait le récit dans différents quartiers de l'effacement de la ville. Dans le brouhaha des conversations des communications sur portables, les images de réhabilitations se succèdent, réécritures automatiques d'un mieux obligatoire polarisées sur des projets commerciaux et des investissements espérés juteux.
L'emballage censé rendre le tout séduisant est très balisé, promenades prédéfinies, religion du vélo, espaces de co-working, barbiers, ... on n'est pas très dépaysés.
De même que par l'envers du décor qui toujours chez Sinclair accompagne son regard, lui sert de moteur. Sans abris immigrés sans papiers, artistes, bâtiments et lieux qui sont un lien, l'histoire et l'âme du vécu de la ville sont sa trame à lui. Une trame réactualisée physiquement par la marche et le partage du récit... ou sa construction quand il s'agit d'une exploration commune.
Le kaléidoscope nostalgique donne le tournis mais l'épopée fait aussi bien. Malgré The Shard, la couleur des vélos et quelques couleurs locales c'est la reconnaissance d'un même mouvement destructeur qui rassure. Pas parce que le mouvement d'effacement et d'anonymisation est réjouissant mais pour le parcours humain qui laisse aussi imaginer que d'une façon ou d'une autre il peut persister une trace, une mémoire commune.
Pas mal de pistes à explorer, Sebald, Ballard et Moore pour les plus connus mais ça va bien plus loin !
Farfelu, énigmatique, nocturne, usé, vivifiant et chaleureux ? Au moins tout ça et bien plus encore ce judicieux portrait d'une ville emblématique (mais de quoi ?).
Phénoménal bric-brac plein de surprises.
Mots-clés : #lieu #urbanité
- le Dim 21 Avr - 13:27
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Iain Sinclair
- Réponses: 26
- Vues: 1479


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages