La date/heure actuelle est Ven 19 Avr - 9:30
90 résultats trouvés pour identite
Natasha Brown
Après des études de mathématiques à Cambridge University, Natasha Brown a travaillé pendant une dizaine d’années dans le secteur bancaire.
Son premier roman, "Assemblage", est encensé dès sa sortie par la critique et les libraires du Royaume-Uni, puis traduit dans le monde entier. Natasha Brown est aujourd’hui considérée comme le grand espoir des lettres britanniques.
Source : Grasset
2023 : Assemblage
=============================================

Bonjour à tous !
Nouveau fil, nouvelle auteure :
Découvrir l’âge adulte en pleine crise économique. Rester serviable dans un monde brutal et hostile. Sortir, étudier à "Oxbridge", débuter une carrière. Faire tout ce qu’il faut, comme il faut. Acheter un appartement. Acheter des œuvres d’art. Acheter du bonheur. Et surtout, baisser les yeux. Rester discrète. Continuer comme si de rien n’était.
La narratrice d’Assemblage est une femme britannique noire. Elle se prépare à assister à une somptueuse garden-party dans la propriété familiale de son petit ami, située au cœur de la campagne anglaise. C’est l’occasion pour elle d’examiner toutes les facettes de sa personnalité qu’elle a soigneusement assemblées pour passer inaperçue. Mais alors que les minutes défilent et que son avenir semble se dessiner malgré elle, une question la saisit : est-il encore temps de tout recommencer ?
Le premier roman de Natasha Brown a été une véritable déflagration dans le paysage littéraire britannique. « Virtuose » (the Guardian), « tranchant comme un diamant » (The Observer), Assemblage raconte le destin d’une jeune femme et son combat intime pour la liberté.
Pamphlet du concept tant fantasmé d'un système structurel et omnipotent bien implanté en Angleterre , intellection des chimères des luttes pour une ascension sociale, diatribe de l'exclusion sexiste des élites obsédées par la domination, blâme pour ce racisme distingué des classes racées anglo-saxonnes, mise en lumière des illusions perdues se débattant de la noyade dans un tourbillon de clairvoyance, Assemblage, c'est la version façon puzzle d'une vie préfabriquée pièce après pièce qu'on ampute de chacune d'elle afin de mieux déconstruire la perversité du dogmatisme tronqué, de notre constitution docile à endosser l'uniforme pour un rôle modelé à l'avance par un pouvoir financier, de la perte d'identité accueillie les bras ouverts tant que la promotion sociale nous déballe toutes ses faveurs aux dépends des filiations qui nous relient aux notres, à fortiori, à soi-même.
Assemblage, c'est aussi l'analyse d'une destruction mentale et physique délivrée par les phrases assassines et concises de la narratrice anglaise, noire , proche portrait de l'auteure Natasha Brown, une incursion dans le dépassement de soi pour simplement exister dans une angleterre où les parvenus politicards de la bonne société qui ne se sont jamais mouillés pointent les noirs comme des problèmes à résoudre, une expédition sous haute tension dans les arcanes de la finance au sein desquelles l'humain reste un profit net exploité en toute transparence , dénigré si noir.
Assemblage, plus que tout, est un flot de pensée lourd de sens, une clameur de la censure et du silence, un contre rendu éloquent des restes du colonialisme, une admonition sévère à la société britannique, le tout desservi par une plume trempée dans du vitriol.
Abrupt et corrosif, ce premier roman est un pavé dans la Tamise qu'il faut apprivoiser, déroutant dès les premières pages par la complexité de la narration décousue et des digressions, la trame se remet sur les rails, defilent alors à toute allure les explosions simultanées des mots percutants, la déflagration émise par les constats carbonise alors les corps et les âmes, à l'image de la narratrice engloutie et ravagée par ce flot devastateur emprisonnant la moindre de ses émotions dans les méandres de son identité contestée.
Des arrangements avec l'Histoire, c'est en accepter la centralité, l'individualité de ceux qui n'existent véritablement que dans la délimitation de leur condition face à une silhouette noire, se débarrasser de ses revendications pour gagner une legitimité et faire perdurer la valse lente et orchestique du déni en bonne société.
Se désincarner. Feindre d'être assimilée. Laisser monter la vague de la bienveillance feinte. Trimer pour n'être jamais ancrée, sans appartenance.
Peut-on en terminer ?
En terminer. Une fois pour toute.
Un roman à l'architecture monumentale, imposant et brillant.
Extraits :
"Pas de temps, en octobre, pour autre chose que le beurre de cacahuète, les feux de signalisation et les esclaves libérés. Ça vous fait perdre le nord, ça vous empêche de vous forger une identité. La vie dans un endroit où l'on vous dit sans cesse de partir, sans savoir, sans rien connaître à rien. Sans histoire.
Après la guerre, l'Empire qui s'émiettait est retourné chercher ses sujets coloniaux. Pas de soldats ce coup-ci : des infirmières, des infirmiers pour porter à bout de bras un service de santé chancelant. Enoch Powell en personne est allé à la Barbade pour nous implorer: venez. Et nous sommes venus et nous avons édifié, nous avons réparé, nous avons soigné, cuisiné, nettoyé. Nous avons payé des impôts, payé des loyers exorbitants aux rares propriétaires qui voulaient bien de nous. On nous haïssait. Le National Front poursuivait, incendiait, poignardait éradiquait. Churchill mettait sur pied les détachements spéciaux pour nous sortir du pays. Pour une Angleterre blanche. Enoch, autrefois recruteur intrépide, mettait à présent en garde, des rivières ensanglantées si nous restions. Promulgation de nouvelles lois, révocations de nos droits.
Pourtant certains ont survécu. On réussi, qui c'est comment, à mettre un peu de côté sur leur maigres salaires. Assez, en fin de compte, pour permettre à femme, mari et enfant de passer d'une pièce unique louée dans une maison que se partageaient 5 familles à un petit pavillon bien à eux. Vraiment à eux. Et une éthique, une mentalité, une détermination a vu le jour à cette époque et persiste encore. Une quête acharnée, sans compromis. "
" Sois la meilleure. Travaille plus, travaille mieux. Dépasse toutes les attentes. Mais aussi, sois invisible, imperceptible. Ne mets personne mal à l'aise. Ne gêne personne. N'existe qu'au négatif, dans l'espace alentour. ne t'insère pas dans le courant de l'Histoire. Ne te fais pas remarquer.
deviens de l'air.
Ouvre les yeux. "
\Mots-clés : #identite #racisme #social
- le Lun 18 Mar - 9:45
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Natasha Brown
- Réponses: 4
- Vues: 267
Nathan Wachtel
Paradis du Nouveau Monde
Essais répartis entre Fables d’Occident (deux chapitres) et Messianismes indiens (trois chapitres).
I : Le Paradis terrestre est situé en Amérique méridionale par l’érudit vieux-chrétien espagnol Antonio de León Pinelo dans son encyclopédique El Paraíso en el Nuevo Mundo, rédigé entre 1640 et 1650, et le jésuite portugais Simão de Vasconcelos dans ses Noticias Curiosas e Necessarias das Cousas do Brasil, parues en 1663.
II : La « théorie de l’Indien juif », soit celle des Dix Tribus perdues d’Israël exilées en Amérique, est développée dans les synthèses de deux Espagnols, le dominicain Gregorio García dans L’origine des Indiens du Nouveau Monde, publié en 1607, et Diego Andrés Rocha dans Tratado Unico y Singular del Origen de los Indios, publié en 1681, et réfutée par le Hollandais d’origine portugaise Menasseh ben Israël dans Espérance d’Israël, publié en 1650.
« N’oublions pas cependant que des auteurs tels que Gregorio García, Diego Andrés Rocha ou Menasseh ben Israël développaient une argumentation extrêmement rigoureuse, que leurs démonstrations s’enchaînaient de manière très rationnelle ; et si elles ne peuvent plus convaincre, c’est parce qu’elles sont faussées au départ par leurs prémisses bibliques. »
III : La « Terre sans Mal » des Tupi-Guarani est le premier aspect du point de vue des Amérindiens. L’ethnologue autodidacte Curt Unkel Nimuendajú estime au début du XXe que « le moteur des migrations tupis-guaranis n’a pas été leur force d’expansion guerrière, et que leur motivation était d’un autre ordre, probablement religieux », outre la pression des colons, les guerres entre tribus indiennes, les conflits internes à certains villages, les épidémies et la politique gouvernementale de sédentarisation et de « réduction » des Indiens. Ces derniers vont vers l’est, en direction du soleil et de la mer à la recherche d’une sorte de paradis, dans un mouvement messianique dirigé par les « hommes-dieux » (Alfred Métraux) qui inclut bientôt la révolte contre la domination coloniale tout en intégrant des éléments de la catéchèse chrétienne.
IV : Le retour de l’Inca, « "messianisme" ou "millénarisme" » « obstinément réinventé » dans les Andes.
« …] la représentation indigène de la fin d’un monde est régie tant par les catégories de l’organisation dualiste que par la conception cyclique du temps. »
« L’on estime que, pendant le premier demi-siècle de la domination coloniale, la chute démographique dans le monde andin atteint en moyenne quelque 80 % de la population : d’où l’ampleur de la désintégration sociale, et du traumatisme. »
Les huacas (divinités) reviennent, possèdent des fidèles dans la « maladie de la danse », reprennent et retournent des éléments de l’institution coloniale contre elle dans un « mouvement de revitalisation religieuse ».
« Soit le renversement cataclysmique de l’ordre du monde, dès lors remis à l’endroit. »
« Ce n’est donc pas nécessairement par rejet du christianisme que les Indiens rebelles exterminent les Espagnols et pourchassent les prêtres. Bien au contraire ! On peut soutenir en effet, sans paradoxe, que si les rebelles massacrent les oppresseurs espagnols, c’est parce que ces derniers, cupides et corrompus, sont de mauvais chrétiens, instruments du diable, et qu’eux-mêmes, Indiens, incarnent les véritables et authentiques chrétiens. »
V : La Danse des Esprits dans le prophétisme nord-amérindien, issu des « catastrophe démographique » due aux épidémies (disparition de plus de 80% de la population la aussi), guerres, spoliations notamment territoriales et déportations forcées de la colonisation anglo-américaine (ainsi que de la disparition du gibier).
« Pendant quelque trois cents ans, les Indiens d’Amérique du Nord ont ainsi éprouvé des traumatismes de tous ordres, indéfiniment répétés, accumulés, toujours recommencés : ils ont vécu de multiples et tragiques fins du monde, en abyme. »
La région des Grands Lacs est le siège d’une « revitalisation religieuse et guerrière » chez les rescapés regroupés dans une pan-indianité intertribale, d’abord « nativiste » et tournée contre les influences européennes.
Lorsque les Indiens ont tous été « transformés en clients, puis en assistés » dans des « réserves », les visions du Paiute Wodziwob annoncent « le retour des morts » au cours de Ghost Dances (d’origine ancestrale). Puis Wovoka, un autre Paiute, donne une inflexion pacifiste à son message de « Messie » : la transe traditionnelle doit dorénavant coexister avec les usages importés (travail salarié, école, église, etc.).
« Il s’agit en fait de combiner et concilier la fidèle perpétuation des rituels anciens (danses, prières, chants, transes) avec l’inévitable intégration dans le monde moderne : soit un processus double, où se consolide et s’affirme une identité de plus en plus manifeste, par-delà les particularités tribales : l’identité indienne. »
Les Sioux font ensuite face à l’extermination des bisons et à une très importante réduction de leurs réserves ; les traités avec cette « nation » sont régulièrement violés. Puis vient le massacre de Wounded Knee, basé sur un malentendu à propos de la Ghost Dance (qui perdurera). Wachtel relate le meurtre de Sitting Bull, le rôle ambivalent de Buffalo Bill et de son Wild West Show – le contexte de la fin d’un monde.
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #contemythe #essai #historique #identite #minoriteethnique #religion #segregation #spiritualité #traditions
- le Dim 11 Fév - 11:29
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Nathan Wachtel
- Réponses: 2
- Vues: 396
Pete Fromm
Lucy in the Sky
Chuck, le père de Lucy, est bûcheron et repart de nouveau.
« S’il existait un État plus pauvre que le Montana, j’imagine qu’on y habiterait. Il suit les arbres, c’est tout. »
Lucy, "garçon manqué" de quatorze ans, découvre peu à peu l’amour avec son ami Kenny, et s’aperçoit que le couple fusionnel et plein d’humour de ses parents n’est pas si heureux et stable : sa mère, Mame, travaille à l’insu de son mari, et découche. Lorsque ce dernier est là, c’est un jaloux, qui devient vite violent ; lorsqu’il s’en va, une certaine entente s’établit entre mère et fille (surtout lorsque Tim vient s’ajouter à Kenny, rapprochant le scénario de leurs vies). L’éveil de Lucy à l’amour commence par l’ambivalence du dégoût et de l’irrésistible, d’ailleurs caractéristique de son ressenti tout au long des deux années où on la suivra : contradictions dans son passage de l’enfance à l’âge adulte, alors que ses parents n’y sont pas vraiment parvenus.
« — Waouh. Toi, tu sais parler aux filles. L’amour, c’est comme une envie de pisser, on n’y peut rien. Ça t’a empêché de dormir de formuler ça ? Tu t’es arrêté de penser et après t’as oublié de recommencer ? »
« — Tu sais, à ton âge, je pensais que je traverserais cette période difficile (elle prit une voix grave, digne d’un film d’horreur), l’adolescence, et qu’après je serais de l’autre côté, à la lumière, et qu’à partir de là tout irait comme sur des roulettes. Jusqu’à ce que je sois vieille, en tout cas. Croulante. Jusqu’à ce que le cancer ou autre chose vienne gâcher une journée assez correcte par ailleurs.
— Le cancer, dis-je. Quelle saleté.
— Mais tu sais quoi, Luce ? Ça ne devient pas plus facile après. On avance d’une étape à une autre, et chaque fois ça complique encore ce qu’il y avait avant, ce qui vient après. »
« — Merde, Luce. Ils nous plaquent tous. Je pensais que tu aurais au moins appris ça. Mais là tout de suite, c’est lui qui attend. Il m’attend, Luce. C’est moi qu’il attend. »
Attachante histoire d’une adolescence assez paumée, excellemment dépeinte par Pete Fromm, notamment par les dialogues.
\Mots-clés : #identite #initiatique #jeunesse #relationdecouple #relationenfantparent #ruralité
- le Jeu 8 Fév - 11:08
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Pete Fromm
- Réponses: 59
- Vues: 4335
Louise Erdrich
Love Medicine
Comme dans tout roman choral, il est difficile au lecteur de mémoriser les nombreux personnages (et ce malgré la présence d’une sorte d’arbre généalogique assez peu clair) – et encore plus difficile d’en rendre compte. De plus, il y a deux Nector, deux King, deux Henry… Mais ce mixte chaotique et profus d’enfants et de liaisons de parenté (avec ou sans mariage, catholique ou pas) est certainement volontaire chez Louise Erdrich.
À travers les interactions des membres de deux (ou trois) familles ayant des racines remontant jusqu’à six générations, c’est l’existence des Indiens de nos jours dans une réserve du Dakota du Nord qui est exposée, avec les drames de l’alcoolisme, du chômage, de la misère, de la prison, de la guerre du Vietnam, du désarroi entre Dieu, le Très-bas et les Manitous (Marie Lazarre Kashpaw) et la pure superstition (Lipsha Morrissey). C’est également une grande diversité d’attitudes individuelles, épisodes marquants de la vie des personnages présentés par eux-mêmes (tout en restant profondément rattachés à leurs histoires familiales et tribales). "Galerie de portraits hauts en couleur", ce poncif caractérise pourtant excellemment cette "fresque pittoresque"…
Ainsi, Moses Pillager, qui était nourrisson lors d’une épidémie :
« Ne voulant pas perdre son fils, elle décida de tromper les esprits en prétendant que Moses était déjà mort, un fantôme. Elle chanta son chant funèbre, bâtit sa tombe, déposa sur le sol la nourriture destinée aux esprits, lui enfila ses habits à l’envers. Sa famille parlait par-dessus sa tête. Personne ne prononçait jamais son vrai nom. Personne ne le voyait. Il était invisible, et il survécut. »
Moses devint windigo, se retira seul sur une île avec des chats, portant toujours ses habits à l’envers et marchant à reculons…
La joyeuse et vorace Lulu Nanapush Lamartine, qu’on pourrait désigner comme une femme facile, qui fait entrer « la beauté du monde » en elle avec constance et élève une ribambelle d’enfants, forme comme un pendant de Marie, opposition en miroir, et ces deux fortes personnalités font une image des femmes globalement plus puissante que celle des hommes.
« Elle déplia une courtepointe coupée et cousue dans des vêtements de laine trop déchirés pour être raccommodés. Chaque carré était maintenu en place avec un bout de fil noué. La courtepointe était marron, jaune moutarde, de tous les tons de vert. En la regardant, Marie reconnut le premier manteau qu’elle avait acheté à Gordie, une tache pâle, gris dur, et la couverture qu’il avait rapportée de l’armée. Il y avait l’écossais de la veste de son mari. Une grosse chemise. Une couverture de bébé à demi réduite en dentelle par les mites. Deux vieilles jambes de pantalon bleues. »
La situation tragique d’un peuple vaincu et en voie de déculturation reste bien sûr le thème nodal de ces destins croisés.
« Pour commencer, ils vous donnaient des terres qui ne valaient rien et puis ils vous les retiraient de sous les pieds. Ils vous prenaient vos gosses et leur fourraient la langue anglaise dans la bouche. Ils envoyaient votre frère en enfer, et vous le réexpédiaient totalement frit. Ils vous vendaient de la gnôle en échange de fourrures, et puis vous disaient de ne pas picoler. »
Dès ce premier roman, Louise Erdrich maîtrise l’art de la narration, tant en composition que dans le style, riche d’aperçus métaphoriques comme descriptifs. La traduction m’a paru bancale par endroits.
\Mots-clés : #amérindiens #discrimination #famille #identite #minoriteethnique #relationenfantparent #romanchoral #ruralité #social #temoignage #traditions #xxesiecle
- le Mer 20 Sep - 12:12
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Louise Erdrich
- Réponses: 37
- Vues: 2870
Jean Baret
Bonheur
Toshiba et Walmart (nommés d’après leurs sponsors) sont « chasseurs d’idées » dans la police au XXIIIe siècle. La consommation est obligatoire, et la publicité omniprésente, comme les IA, algorithmes et hologrammes.
« Toshiba entre dans sa Pontiac et roule vers la Zone Urbaine 1, traversant une forêt d’hologrammes publicitaires d’une densité qui l’étouffe. Il n’a jamais réalisé à quel point il est entouré d’hologrammes. Il y en a des grands, des petits, des bruyants, des silencieux, des colorés, des noir et blanc, des grotesques, des sérieux, des interactifs, des agressifs, il y en a au niveau du sol, sur les murs des tours, dans le ciel, en haut, en bas, sur les côtés, des mobiles qui suivent son véhicule, des fixes qu’il traverse comme des fantômes, des effrayants, des émouvants, des intriguants, et tous tentent d’attirer son attention, de capter son temps de cerveau disponible. »
« Les panneaux surplombant les façades des magasins ouverts jour et nuit clignotent agressivement pour attirer le chaland. Il y a des panneaux rédigés dans sa langue, mais aussi en mandarin, en arabe, en russe, en latin, en grec, en uzbek, en runes nordiques, en farsi, en hébreu, en sumérien, en puxian, et il se dit que la tour de Babel s’est effondrée et qu’ils vivent dans ses ruines. »
« – Ben, le fait que travailler est nécessaire pour qu’on ait un pouvoir d’achat suffisant, mais que travailler ne nous laisse pas assez de temps pour consommer !
– Ah… Ouais en effet… Tout est une question d’équilibre. Consommer, c’est aussi donner du travail aux autres. Te faire plaisir en t’achetant tout ce que tu veux, c’est la garantie d’un taux de chômage faible. »
« Tous s’accordent à dire que la pauvreté n’est pas une fatalité, ni un bug du système, mais, au contraire, fait partie dudit système, et que l’ingéniosité sans limite de l’économie permet d’envisager une infinité de moyens de monétiser cette couche de la population. »
La société est fort diversifiée (et à la limite monstrueuse).
« Il y en a des grands, des petits, des jeunes, des vieux, des transhumains, des furry [humains transformés en animaux], des punks, des goths, des grunges, des zazous, des dandys, des homosexuels, des bisexuels, des transexuels, des cyborgs, des hommes d’affaires, des directeurs d’entreprise, des employés, des putes, des gigolos [… »
Il y aussi les surhumains, les bioroïdes [« clones de génies des siècles passés ou de ceux qui sont modifiés génétiquement dès la naissance »], les mutants, les Moreau [« formes de vie animales ayant été élevées à un niveau de conscience humaine par des modifications génétiques et des prothèses cybernétiques », en référence au roman de H. G. Wells], etc. L’emploi fréquent de listes accumulatives rend habilement compte de la pluralité des modes d’identités, mais aussi de la saturation émotive due à la pub et aux informations incessantes qui captent tout le temps de cerveau disponible. Cette société est encore noyée dans la routine (rendue par les répétitions dans l’emploi du temps quotidien des personnages) du travail productif et des loisirs (surtout des achats aussi pulsionnels qu’obligatoires), se conformant sans cesse aux injonctions au bonheur individuel, qui est considéré comme un droit.
Toshiba a un robot pour épouse (ou plutôt esclave, surtout sexuel).
« Il finit le questionnaire en se couchant. Il prend ses antidépresseurs, mais se sent déjà soulagé à l’idée que, dès demain, Silvia [son nouvel algorithme de gestion de vie] prendra le relais et répondra à tous les messages en souffrance [sur FaceHub]. Hal-Bert [son assistant personnel] est chargé de surveiller les messages entrants pour le prévenir directement en cas d’urgence extrême.
Il fait brutalement l’amour à sa femme, achète quelques produits, et se dit que Silvia pourrait aussi être programmée pour faire des achats à sa place, ce qui lui éviterait cette corvée. Il a envie de pleurer sans savoir pourquoi. Ses amis — ou peut-être les assistants personnels de ses amis — ne sauront jamais que ce n’est pas lui qui répond. Sa vie sociale va s’enrichir, elle va même, pour ainsi dire, se poursuivre sans lui, il pourrait bien ne plus jamais revoir personne sans que cela n’ait de conséquences pour les gens qui l’aiment. Alors, pourquoi pleurer ?
Son épouse tente de le réconforter, mais il préfère la gifler pour se soulager. Il la frappe sans retenue. Elle crie, mais ce soir il n’est pas d’humeur, alors il s’interrompt, la reprogramme rapidement pour qu’elle se taise, et reprend son tabassage en règle jusqu’à l’épuisement. Il s’endort dans ses bras, tandis que le visage en plastique de son épouse reprend lentement sa forme d’origine. »
Tout est monétisé : par exemple, Toshiba parie sur les résultats des conflits armés ; mais le spree killing (tuerie à la chaîne) est difficile à rentabiliser :
« Tandis que Minute Girl [présentatrice du talk show permanent dans les ascenseurs, où s’expriment des experts aux avis contradictoires] recueille les propos tout aussi décousus d’un copain de lycée du tueur, un spécialiste reconnaît que ces tueries adolescentes posent un vrai problème social, dans la mesure où personne n’a réussi à trouver comment monétiser ce mouvement. Il se félicite de ce que, heureusement, les paris, qui sont depuis longtemps libéralisés, permettent au moins aux citoyens de faire circuler quelques crédits en misant sur le nombre de victimes de la prochaine tuerie, le lieu où elle se déroulera, le profil du tueur, etc… Mais ça n’est pas suffisant. »
La violence est prégnante dans ce que l’"information" en continu présente, mais aussi dans la vie courante.
« Avec son bol d’insectes Weetabix, il [Toshiba] avale des antidépresseurs, des nooleptiques, des thymoleptiques, des régulateurs de l’humeur, des sédatifs, des antiépileptiques, des psychoanaleptiques, des nooanaleptiques, des thymoanaleptiques, de la dopamine, de la sérotonine, de l’endorphine, de l’ocytocine, de l’œstrogène et de la progestérone. »
Toshiba décède discrètement d’une surdose médicamenteuse, et est remplacé par un autre Toshiba.
Walmart est un surhumain bodybuilder qui s’administre quantité de pilules et d’injections pour doper son organisme (et aussi beaucoup d’alcool). Son enquête sur un Netrunner aboutit à un hub révolutionnaire où circulent des réflexions du philosophe Dany-Robert Dufour (ou plutôt sa pensée synthétisée par un émulateur), qui dénonce la nouvelle religion du Marché néolibéral.
« Les Netrunners vivent dans une surcouche sociétale dénommée Noosphère. Cette dernière est un agglomérat gigantesque d’open worlds persistants thématiques dans lesquels les Netrunners se retrouvent. […]
Ils se prétendent l’avenir de la société et considèrent les flatscans [terme péjoratif qui désigne chez les Netrunners tous ceux qui n’en sont pas] comme des reliques archaïques de l’ancien monde, celui des néotènes [ceux « à qui il manque quelque chose à la naissance »], celui où le corps, même sublimé par la technologie, est toujours une insupportable limitation à la toute-puissance de la volonté humaine. »
« Aujourd’hui, nous ne pensons plus, nous dépensons. Or, l’accroissement infini des services et des biens permis par les sciences a fini par rencontrer la finitude du monde, ce qui pose la question de la fin du monde. »
Dany-Robert Dufour vante dans une postface la « transposition visuelle » de ses thèses par Jean Baret (qui se revendique du « courant de l’anticipation sociale dont les deux maîtres étaient les Américains Brett Easton Ellis et Chuck Palahniuk, auteurs de dystopies contemporaines ou futures marquantes »). Il explicite aussi la notion de pléonexie, « (du grec pleon « plus » et de echein « avoir »), qui signifie le fait d’avoir plus, de vouloir-avoir-toujours-plus, et qui est victime dans notre civilisation d’húbris, c’est-à-dire de démesure.
« Puisque Bonheurnous fait passer à l’autre bout de l’histoire occidentale, à la flèche du temps, comme dit Jean Baret, où l’on s’est affranchis de cette prohibition, on y sent une lourde menace peser partout. Celle du châtiment, à la fois imminent et constamment différé, qui attend ces êtres post-beckettiens, libres et abandonnés de Dieu, en somme laissés à eux-mêmes et sans limite — nous —, essayant sans cesse, grâce aux technologies d’« augmentation » promises par les prothèses numériques, génétiques et chimiques, de sortir de leur condition d’homme, de femme, de mortel, d’assigné à résidence dans le temps et l’espace… »
J’ai aussi pensé à Aldous Huxley, George Orwell, Ray Bradbury, Margaret Atwood et Philip K. Dick à la lecture de ce roman d'anticipation dystopique, à l’inventivité singulière et à l’écriture congrue, qui pousse à son extrême le libéralisme de notre modèle socio-économique actuel.
\Mots-clés : #identite #romananticipation #satirique #social
- le Mar 12 Sep - 11:19
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean Baret
- Réponses: 3
- Vues: 160
Kent Nerburn
Ni loup ni chien
Grâce à ses précédents ouvrages sur les Indiens, Kent Nerburn est pressenti par Dan, un vieux Lakota, pour devenir son porte-parole.
« …] Indiens. Je n’avais jamais autant apprécié un peuple ni trouvé ailleurs un tel sens de l’humour et une telle modestie. En outre, j’avais ressenti chez eux une paix et une simplicité qui dépassaient les stéréotypes de sagesse et d’alcoolisme. Ils étaient tout simplement les personnes les plus terre à terre que j’avais rencontrées, dans le bon et le mauvais sens de la chose. Ils étaient différents des Blancs, des Noirs, différents de l’image qu’on m’en avait inculquée, différents de tout ce que j’avais croisé. Je me sentais heureux en leur compagnie, et honoré d’être à leur côté. »
Il le rejoint dans sa réserve des Grandes Plaines. Ils feront une « virée » en Buick avec Grover, l’ami de Dan, tandis qu’il enregistre les « petits discours » de ce dernier.
« Voilà ce qu’il y avait derrière cette idée d’Amérique comme nouveau pays de l’autre côté de l’océan : devenir propriétaire. […] Nous ne savions pas cela. Nous ne savions même pas ce que cela signifiait. Nous appartenions à la terre. Eux voulaient la posséder. »
« Un point important selon moi : votre religion ne venait pas de la terre, elle pouvait être transportée avec vous. Vous ne pouviez pas comprendre ce que ça signifiait pour nous que d’avoir notre religion ancrée dans la terre. Votre religion existait dans une coupelle et un morceau de pain, et elle pouvait être trimballée dans une boîte. Vos prêtres pouvaient sacraliser n’importe où. Vous ne pouviez pas comprendre que, pour nous, ce qui était sacré se trouvait là où nous vivions, parce que c’est là que les choses saintes s’étaient produites et que les esprits nous parlaient. »
« Pendant de nombreuses années, l’Amérique voulait simplement nous détruire. Aujourd’hui, tout d’un coup, on est le seul groupe que les gens essaient d’intégrer. Et pourquoi d’après toi ? […]
– Je pense, reprit-il, que c’est parce que les Blancs savent qu’on avait quelque chose de véritable, qu’on vivait de la manière dont le Créateur voulait que les humains vivent sur cette terre. Ils désirent ça. Ils savent que les Blancs font n’importe quoi. S’ils disent qu’ils sont en partie indiens, c’est pour faire partie de ce que nous avons. »
« Nos aînés nous ont appris que c’était la meilleure façon de faire avec les Blancs : sois silencieux jusqu’à ce qu’ils deviennent nerveux, et ils commenceront à parler. Ils continueront de parler, et si tu restes silencieux, ils en diront trop. Alors tu seras capable de voir dans leur cœur et de savoir ce qu’ils veulent vraiment. Et tu sauras quoi faire. »
« Si tu commences à parler, je ne t’interromps pas. Je t’écoute. Peut-être que j’arrête d’écouter si je n’aime pas ce que tu dis. Mais je ne t’interromps pas. Quand t’as fini, je prends ma décision sur ce que tu as dit, mais je ne t’expose pas mon désaccord, à moins que ça soit important. Autrement, je me tais et je m’en vais simplement. Tu m’as dit ce que j’avais besoin de savoir. Il n’y a rien de plus à ajouter. »
Des épaves de voiture jonchent la réserve :
« J’avais toujours été interloqué par l’acceptation des gens à vivre dans la saleté, quand un simple petit effort aurait suffi à rendre les choses propres. À la longue, j’en étais venu à accepter le vieux bobard sociologique qui racontait que cela reflétait un manque d’estime de soi et un certain accablement.
Mais, au fond de moi, je savais que c’était trop facile, une supposition trop médiocre. C’était cependant certainement préférable aux explications précédentes, selon lesquelles les gens qui vivaient comme cela étaient simplement paresseux ou apathiques. »
« Pour nous, chaque chose avait son utilité, puis retournait à la terre. On avait des bols et des coupelles en bois, ou des objets fabriqués en argile. On montait à cheval ou on marchait. On fabriquait des choses à partir de choses de la terre. Puis quand on n’en avait plus besoin, on les laissait y retourner.
Aujourd’hui, les choses ne retournent pas à la terre. Nos enfants jettent des canettes. On abandonne des vieilles voitures. Avant, ça aurait été des cuillères en os ou des tasses en corne, et les vieilles voitures auraient été des squelettes de chevaux ou de bisons. On aurait pu les brûler ou les laisser là, et elles seraient retournées à la terre. Maintenant, on ne peut plus.
On vit de la même manière, mais avec des choses différentes. On apprend vos manières, mais, tu vois, vous n’apprenez rien. Tout ce dont vous vous souciez vraiment, c’est de garder les choses propres. Vous ne vous souciez pas de ce qu’elles sont réellement, tant qu’elles sont propres. Quand vous voyez une canette au bord d’un chemin, vous trouvez ça pire qu’une énorme autoroute goudronnée qui est maintenue propre. Vous vous énervez davantage devant un sac-poubelle dans une forêt que devant un gros centre commercial tout impeccable et balayé. »
Une autre vision sociale :
« On n’évaluait pas les gens par la richesse ou la pauvreté. On ne savait pas faire cela. Quand les temps étaient bons, tout le monde était riche. Quand les temps étaient durs, tout le monde était pauvre. On évaluait les gens sur leur capacité à partager. »
Les wannabes, qui croient avoir une grand-mère cherokee, portent queue de cheval et bijoux indiens en turquoise et argent, sont particulièrement insupportables ; au cinéma :
« Peuvent plus mettre de sauvages, maintenant. Aujourd’hui, c’est l’Indien sage – tu sais, celui qui ne fait qu’un avec la terre et tout, et qui rend le Blanc meilleur en lui apprenant à vivre à l’indienne, pour qu’il ajoute des valeurs indiennes à sa blanchitude. »
« Nous savons que les Blancs ont une faim infinie. Ils veulent tout consommer et tout englober. Quand ils ne possèdent pas physiquement, ils veulent posséder spirituellement. C’est ce qui est en train de se passer avec les Indiens, aujourd’hui. Les Blancs veulent nous posséder spirituellement. Vous voulez nous avaler pour pouvoir dire que vous êtes nous. C’est quelque chose de nouveau. Avant, vous vouliez qu’on soit comme vous. Mais aujourd’hui, vous êtes malheureux avec vous-mêmes, donc vous voulez vous transformer en nous. Vous voulez nos cérémonies et nos façons de faire pour pouvoir dire que vous êtes spirituels. Vous essayez de devenir des Indiens blancs. »
La leçon tirée des traités non honorés :
« Écoute-moi. Nous, les Indiens, parlons peu au peuple blanc. Il en a toujours été ainsi. Il y a une raison. Les Blancs ne nous ont jamais écoutés quand nous avons pris la parole. Ils ont seulement entendu ce qu’ils voulaient entendre. Parfois ils prétendaient avoir entendu et faisaient des promesses. Puis ils les brisaient. Il n’y avait plus pour nous de raison de parler. Donc nous avons arrêté. Même aujourd’hui, nous disons à nos enfants : “Fais gaffe quand tu parles aux wasichus [hommes blancs en lakota]. Ils utiliseront tes mots contre toi.” »
Le regard de Dan est particulièrement aigu en ce qui concerne la société occidentale.
« Le monde blanc met tout le pouvoir au sommet, Nerburn. Lorsqu’une personne arrive au sommet, elle a le pouvoir de prendre ta liberté. Au début, quand les Blancs sont arrivés ici, c’était pour fuir ces personnes au sommet. Mais ils ont continué de raisonner de cette façon et très vite, il y a eu de nouvelles personnes au sommet dans ce nouveau pays. Parce que c’est comme ça qu’on vous a appris à penser.
Dans vos églises, il y a quelqu’un au sommet. Dans vos écoles aussi. Dans votre gouvernement. Dans vos métiers. Il y a toujours quelqu’un au sommet, et cette personne a le droit de dire si tu es bon ou mauvais.
Elle te possède.
Pas étonnant que les Américains se soucient autant de la liberté. Vous en avez quasiment aucune. Si vous la protégez pas, quelqu’un vous la prendra. Vous devez la surveiller à chaque seconde, comme un chien garde un os. »
« Quand vous êtes arrivés parmi nous, vous ne pouviez pas comprendre notre façon d’être. Vous vouliez trouver la personne au sommet. Vous vouliez trouver les barrières qui nous entouraient – jusqu’où notre terre allait, jusqu’où notre gouvernement allait. Votre monde était fait de cages et vous pensiez que le nôtre aussi. Quand bien même vous détestiez vos cages, vous croyiez en elles. Elles définissaient votre monde et vous aviez besoin d’elles pour définir le nôtre.
Nos anciens ont remarqué ça dès le début. Ils disaient que l’homme blanc vivait dans un monde de cages et que si nous ne nous méfiions pas, ils nous feraient aussi vivre dans un monde de cages.
Donc nous avons commencé à y prêter attention. Tout chez vous ressemblait à des cages. Vos habits se portaient comme des cages. Vos maisons ressemblaient à des cages. Vous mettiez des clôtures autour de vos jardins pour qu’ils ressemblent à des cages. Tout était une cage. Vous avez transformé la terre en cages. En petits carrés.
Puis, une fois que vous avez eu toutes ces cages, vous avez fait un gouvernement pour les protéger. Et ce gouvernement n’était que cages. Uniquement des lois sur ce qu’on ne pouvait pas faire. La seule liberté que vous aviez se trouvait dans votre cage. Puis vous vous êtes demandé pourquoi vous n’étiez pas heureux et pourquoi vous ne vous sentiez pas libres. Vous aviez créé toutes ces cages, puis vous vous êtes demandé pourquoi vous ne vous sentiez pas libres.
Nous les Indiens n’avons jamais pensé de cette façon. Tout le monde était libre. Nous ne faisions pas de cages, de lois, ni de pays. Nous croyions en l’honneur. Pour nous, l’homme blanc ressemblait à un homme aveugle en train de marcher, qui ne comprenait qu’il était sur le mauvais chemin que quand il butait contre les barreaux d’une des cages. Notre guide à nous était à l’intérieur, pas à l’extérieur. C’était l’honneur. Il était plus important pour nous de savoir ce qui était bien que de savoir ce qui était mauvais.
Nous regardions les animaux et voyions ce qui était bien. Nous voyions comment le cerf trompait les animaux les plus puissants et comment l’ours rendait ses enfants forts en les élevant sans pitié. Nous voyions comment le bison se tenait et observait jusqu’à ce qu’il comprenne. Nous voyions comment chaque animal était sage et nous essayions d’apprendre cette sagesse. Nous les regardions pour comprendre comment ils cohabitaient et comment ils élevaient leurs petits. Puis nous faisions comme eux. Nous ne cherchions pas ce qui était mauvais. Non, nous tendions toujours vers ce qui était bien. »
Dan livre ses convictions sur les meneurs « à l’indienne », comment Jésus fut imposé aux Indiens, puis comme l’espoir du messie leur fut refusé ; il développe les différences d’appréciation de l’histoire entre eux et les Blancs…
« Avant, je pensais que vous agissiez comme ça parce que vous étiez avides. Plus maintenant. Maintenant, je pense que ça fait juste partie de qui vous êtes et de ce que vous faites, tout comme écouter la terre fait partie de qui nous sommes et de ce que nous faisons. »
Les femmes, au travers de Dannie, petite-fille de Dan :
« C’est ce que je veux dire quand je dis que c’est notre tour à nous, les femmes indiennes. On a toujours été au centre. La famille indienne était comme un cercle, et la femme était au centre. […] On n’a pas besoin de se libérer. On a besoin de libérer nos hommes. »
Les métis :
« Tout ce qui comptait pour nous, c’était la façon dont ils étaient élevés et les personnes qu’ils devenaient. Vous, vous examiniez la couleur de leur peau et la couleur de leurs cheveux, et essayiez de calculer le pourcentage de blancheur qu’ils avaient à l’intérieur d’eux. Vous les appeliez des métis. Vous ne les laissiez être ni blancs ni indiens. »
Puis ils arrivent à Wounded Knee, là où, comme dans nombre d’autres lieux, enfants et vieillards furent massacrés – tout un peuple.
Outre des faits connus des familiers de lectures sur les Amérindiens, ce livre-témoignage développe une pensée originale (il s’agit de réflexions de Dan, plus que de révélations), qui permet aussi d’approfondir l’appréhension de la conception du monde chez les « Américains natifs ». Et c’est encore (et surtout ?) un récit profondément sensible, plein de colère et de douleur, également d’humour malicieux – humain.
J'ai beaucoup cité, mais il y a bien d'autres choses à retenir de ce livre qui sort de l'ordinaire sur le sujet.
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #culpabilité #discrimination #documentaire #identite #initiatique #racisme #segregation #spiritualité #temoignage #traditions
- le Lun 28 Aoû - 14:39
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Kent Nerburn
- Réponses: 2
- Vues: 253
William Faulkner
Descends, Moïse
Sept récits paraissant indépendants de prime abord, qui mettent en scène des personnages du Sud des USA, blancs, nègres (et Indiens ; je respecte, comme j’ai coutume de le faire, l’orthographe de mon édition, exactitude encore permise je pense). Plus précisément, c’est la lignée des Mac Caslin, qui mêle blancs et noirs sur la terre qu’elle a conquise (les premiers émancipant les seconds). Oppositions raciale, mais aussi genrée sur un siècle, plus de quatre générations dans le Mississipi.
Le titre fait référence à des injonctions du Seigneur à Moïse sur le Sinaï, notamment dans l’Exode. Ce roman est dédicacé à la mammy de Faulkner enfant, née esclave.
Autre temps : apparition de Isaac Mac Caslin, « oncle Ike », et la poursuite burlesque d’un nègre enfui.
Le Feu et le Foyer : affrontement de Lucas Beauchamp et Edmonds, fils de Mac Caslin, qui a pris la femme du premier :
« – Ramasse ton rasoir, dit Edmonds.
– Quel rasoir ? » fit Lucas. Il leva la main, regarda le rasoir comme s’il ne savait pas qu’il l’avait, comme s’il ne l’avait encore jamais vu, et, d’un seul geste, il le jeta vers la fenêtre ouverte, la lame nue tournoyant avant de disparaître, presque couleur de sang dans le premier rayon cuivré du soleil. « J’ai point besoin de rasoir. Mes mains toutes seules suffiront. Maintenant, prenez le revolver sous votre oreiller. » »
« Alors Lucas fut près du lit. Il ne se rappela pas s’être déplacé. II était à genoux, leurs mains enlacées, se regardant face à face par-dessus le lit et le revolver : l’homme qu’il connaissait depuis sa petite enfance, avec lequel il avait vécu jusqu’à ce qu’ils fussent devenus grands, presque comme vivent deux frères. Ils avaient péché et chassé ensemble, appris à nager dans la même eau, mangé à la même table dans la cuisine du petit blanc et dans la case de la mère du petit nègre ; ils avaient dormi sous la même couverture devant le feu dans les bois. »
Péripéties autour d’alambics de whisky de contrebande, et de la recherche d’un trésor. Lucas, bien que noir, a plus de sang de la famille que Roth Edmonds, le blanc, que sa mère a élevé avec lui dès sa naissance. Le même schéma se reproduit de père en fils, si bien qu’on s’y perd, et qu’un arbre généalogique de la famille avec tous les protagonistes serait utile au lecteur (quoique ce flou entre générations soit vraisemblablement prémédité par Faulkner, de même que le doute sur la "couleur" de certains personnages, sans parler des phrases contorsionnées).
« Lucas n’était pas seulement le plus ancien des habitants du domaine, plus âgé même que ne l’aurait été le père d’Edmonds, il y avait ce quart de parenté, non seulement de sang blanc ni même du sang d’Edmonds, mais du vieux Carothers Mac Caslin lui-même de qui Lucas descendait non seulement en ligne masculine, mais aussi à la seconde génération, tandis qu’Edmonds descendait en ligne féminine et remontait à cinq générations ; même tout gamin, il remarquait que Lucas appelait toujours son père M. Edmonds, jamais Mister Zack comme le faisaient les autres nègres, et qu’il évitait avec une froide et délibérée préméditation de donner à un blanc quelque titre que ce fût en s’adressant à lui. »
« Ce n’était pas toutefois que Lucas tirât parti de son sang blanc ou même de son sang Mac Caslin, tout au contraire. On l’eût dit non seulement imperméable à ce sang, mais indifférent. Il n’avait pas même besoin de lutter contre lui. Il ne lui fallait pas même se donner le mal de le braver. Il lui résistait par le simple fait d’être le mélange des deux races qui l’avaient engendré, par le seul fait qu’il possédait ce sang. Au lieu d’être à la fois le champ de bataille et la victime de deux lignées, il était l’éprouvette permanente, anonyme, aseptique, dans laquelle toxines et antitoxines s’annulaient mutuellement, à froid et sans bruit, à l’air libre. Ils avaient été trois autrefois : James, puis une sœur nommée Fonsiba, puis Lucas, enfants de Tomey’ Turl, fils du vieux Carothers Mac Caslin et de Tennie Beauchamp, que le grand-oncle d’Edmonds, Amédée Mac Caslin, avait gagnée au poker à un voisin en 1859. »
« Il ressemble plus au vieux Carothers que nous tous réunis, y compris le vieux Carothers. Il est à la fois l’héritier et le prototype de toute la géographie, le climat, la biologie, qui ont engendré le vieux Carothers, nous tous et notre race, infinie, innombrable, sans visage, sans nom même, sauf lui qui s’est engendré lui-même, entier, parfait, dédaigneux, comme le vieux Carothers a dû l’être, de toute race, noire, blanche, jaune ou rouge, y compris la sienne propre. »
Bouffonnerie noire : Rider, un colosse noir, enterre sa femme et tue un blanc.
Gens de jadis : Sam Fathers, fils d’un chef indien et d’une esclave quarteronne, vendu avec sa mère par son père à Carothers Mac Caslin ; septuagénaire, il enseigne d’année en année la chasse à un jeune garçon, Isaac (Ike).
« L’enfant ne le questionnait jamais ; Sam ne répondait pas aux questions. Il se contentait d’attendre et d’écouter, et Sam se mettait à parler. Il parlait des anciens jours et de la famille qu’il n’avait jamais eu le temps de connaître et dont, par conséquent, il ne pouvait se souvenir (il ne se rappelait pas avoir jamais aperçu le visage de son père), et à la place de qui l’autre race à laquelle s’était heurtée la sienne pourvoyait à ses besoins sans se faire remplacer.
Et, lorsqu’il lui parlait de cet ancien temps et de ces gens, morts et disparus, d’une race différente des deux seules que connaissait l’enfant, peu à peu, pour celui-ci, cet autrefois cessait d’être l’autrefois et faisait partie de son présent à lui, non seulement comme si c’était arrivé hier, mais comme si cela n’avait jamais cessé d’arriver, les hommes qui l’avaient traversé continuaient, en vérité, de marcher, de respirer dans l’air, de projeter une ombre réelle sur la terre qu’ils n’avaient pas quittée. Et, qui plus est, comme si certains de ces événements ne s’étaient pas encore produits mais devaient se produire demain, au point que l’enfant finissait par avoir lui-même l’impression qu’il n’avait pas encore commencé d’exister, que personne de sa race ni de l’autre race sujette, qu’avaient introduite avec eux sur ces terres les gens de sa famille, n’y était encore arrivé, que, bien qu’elles eussent appartenu à son grand-père, puis à son père et à son oncle, qu’elles appartinssent à présent à son cousin et qu’elles dussent être un jour ses terres à lui, sur lesquelles ils chasseraient, Sam et lui, leur possession actuelle était pour ainsi dire anonyme et sans réalité, comme l’inscription ancienne et décolorée, dans le registre du cadastre de Jefferson, qui les leur avaient concédées, et que c’était lui, l’enfant, qui était en ces lieux l’invité, et la voix de Sam Fathers l’interprète de l’hôte qui l’y accueillait.
Jusqu’à il y avait trois ans de cela, ils avaient été deux, l’autre, un Chickasaw pur sang, encore plus incroyablement isolé dans un sens que Sam Fathers. Il se nommait Jobaker, comme si c’eût été un seul mot. Personne ne connaissait son histoire. C’était un ermite, il vivait dans une sordide petite cabane au tournant de la rivière, à cinq milles de la plantation et presque aussi loin de toute autre habitation. C’était un chasseur et un pêcheur consommé ; il ne fréquentait personne, blanc ou noir ; aucun nègre ne traversait même le sentier qui menait à sa demeure, et personne, excepté Sam, n’osait approcher de sa hutte. »
Jobaker décédé, Sam se retire au Grand Fond, et prépare l’enfant à son premier cerf :
« …] l’inoubliable impression qu’avaient faite sur lui les grands bois – non point le sentiment d’un danger, d’une hostilité particulière, mais de quelque chose de profond, de sensible, de gigantesque et de rêveur, au milieu de quoi il lui avait été permis de circuler en tous sens à son gré, impunément, sans qu’il sache pourquoi, mais comme un nain, et, jusqu’à ce qu’il eût versé honorablement un sang qui fût digne d’être versé, un étranger. »
« …] la brousse […] semblait se pencher, se baisser légèrement, les regarder, les écouter, non pas véritablement hostile, parce qu’ils étaient trop petits, même ceux comme Walter, le major de Spain et le vieux général Compson, qui avaient tué beaucoup de daims et d’ours, leur séjour trop bref et trop inoffensif pour l’y inciter, mais simplement pensive, secrète, énorme, presque indifférente. »
L’ours :
« Cette fois, il y avait un homme et aussi un chien. Deux bêtes, en comptant le vieux Ben, l’ours, et deux hommes, en comptant Boon Hogganbeck, dans les veines de qui coulait un peu du même sang que dans celles de Sam Fathers, bien que celui de Boon en fût une déviation plébéienne et que seul celui du vieux Ben et de Lion, le chien bâtard, fût sans tache et sans souillure. »
Cet incipit railleur de Faulkner dénote les conceptions de l’époque sur les races et la pureté du sang.
Ce récit et le précédent, dont il constitue une variante, une reprise et/ou une extension, sont un peu dans la même veine que London. Ils m’ont impressionné par la façon fort juste dont sont évoqués le wild, la wilderness, la forêt sauvage (la « brousse »), « la masse compacte quoique fluide qui les entourait, somnolente, sourde, presque obscure ». Ben, le vieil ours qui « s’était fait un nom » et qui est traqué, Sam et « le grand chien bleu » laisseront la vie dans l’ultime scène dramatique.
Puis Ike, devenu un chasseur et un homme, refuse la terre héritée de ses ancêtres, achetée comme les esclaves (depuis affranchis) ; se basant sur les registres familiaux, il discourt sur la malédiction divine marquant le pays.
Automne dans le Delta : Ike participe une fois encore à la traditionnelle partie de chasse de novembre dans la « brousse », qui a reculé avec le progrès états-unien, et il se confirme que Faulkner est, aussi, un grand auteur de nature writing.
« …] rivières Tallahatchie ou Sunflower, dont la réunion formait le Yazoo, la Rivière du Mort des anciens Choctaws – les eaux épaisses, lentes, noires, sans soleil, presque sans courant, qui, une fois l’an, cessaient complètement de couler, remontaient alors leur cours, s’étalant, noyant la terre fertile, puis se retiraient la laissant plus fertile encore. »
« Car c’était sa terre, bien qu’il n’en eût jamais possédé un pied carré. Il ne l’avait jamais désiré, pas même après avoir vu clairement son suprême destin, la regardant reculer d’année en année devant l’attaque de la hache, de la scie, des chemins de fer forestiers, de la dynamite et des charrues à tracteur, car elle n’appartenait à personne. Elle appartenait à tous : on devait seulement en user avec sagesse, humblement, fièrement. »
La chasse est centrale, avec son ancrage ancestral, son initiation, son folklore, son narratif, et son éthique (c’est le vieil Ike qui parle) :
« Le seul combat, en quelque lieu que ce soit, qui ait jamais eu quelque bénédiction divine, ça a été quand les hommes ont combattu pour protéger les biches et les faons. »
Descends, Moïse : mort d’un des derniers Beauchamp.
Les personnages fort typés mis en scène dans ce recueil se rattachent à la formidable galerie des figures faulknériennes ; ainsi apparaissent des Sartoris, des Compson, et même Sutpen d’Absalon ! Absalon !.
Ces épisodes d’apparence indépendants me semblent former, plus qu’un puzzle, un archipel des évènements émergents d’un sang dans la durée.
\Mots-clés : #colonisation #discrimination #esclavage #famille #identite #initiatique #lieu #nature #portrait #racisme #religion #ruralité #social #violence
- le Mer 2 Aoû - 13:36
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William Faulkner
- Réponses: 103
- Vues: 12087
Gerald Basil Edwards
Le livre d'Ebenezer Le Page
Le narrateur, le vieil Ebenezer Le Page, présente d’abord ses antécédents.
« Il est dit dans la Bible : « Regarde la pierre dans laquelle tu as été sculpté et le puits dont tu fus extrait. » Eh bien, ces gens sont la pierre dans laquelle j’ai été sculpté et le puits dont j’ai été extrait. Je n’ai pas parlé de mes cousins, ou des cousins de mes cousins, mais il faut dire que la moitié des gens de l’île sont mes cousins, ou les cousins de mes cousins. »
« C’est ça l’ennui, dans le fait d’écrire la vraie histoire de ma famille, ou la mienne, d’ailleurs. Je n’en connais ni le commencement ni la fin. »
Et c’est, plus qu’un roman et/ou autobiographie (ou plutôt une autofiction ?), une histoire de famille autant qu’une chronique de Guernesey (Sarnia en latin) de la fin du XIXe siècle au début des années 1960, tant la parentèle est importante dans ce milieu insulaire. De même, c’est toute l’époque qui est revisitée.
Souvenirs précis rapportés en détail par un vieillard évidemment nostalgique, manifestement doué d’un caractère entier. Simple pêcheur et producteur de légumes en serre, Ebenezer est observateur, et n’aime pas le changement dans l’île qu’il n’a guère quittée pendant près d’un siècle :
« Dieu a doté cette île d’un bon sol et d’un bon climat, particulièrement propres à faire pousser des fruits, des légumes et des fleurs, et à engendrer deux sortes de créatures : les vaches de Guernesey et les gens de Guernesey. J’aurais cru que les États tiendraient à protéger ces espèces, mais il n’y a visiblement plus de place pour elles. »
Sa mère avec qui il vit jusqu’à sa mort (puis avec Tabitha sa sœur), Jim son ami qui mourra à la Première Guerre, et Liza, une de ses petites amies mais son seul amour et jamais accompli, se distinguent dans la foule de personnages qui sont décrits, sans plus nuire à la compréhension que les personnes inconnues évoquées dans une conversation agréable. Remarquables sont également ses deux tantes, la Hetty et la Prissy, mariées à Harold et Percy Martel (des constructeurs dans le bâtiment), et leurs fils Raymond (qui prendra une grande place dans ses affections) et Horace, dans les maisons voisines de Wallaballoo et Tombouctou : elles sont souvent aux prises l’une avec l’autre, entre chicanes et brouilles.
L’opinion d’Ebenezer (et d’autres Guernesiais) sur les femmes et le mariage explique au moins en partie qu’il soit demeuré célibataire.
« J’ai commis une grave erreur dans ma jeunesse. Je pensais à ce moment-là que les filles étaient des êtres humains comme nous, mais c’est faux. Elles sont toujours en quête de quelque chose, de votre corps, de votre argent, ou d’un père pour leurs enfants, et si ce n’est pas le cas, elles veulent quand même que vous deveniez quelqu’un ou que vous fassiez quelque chose qui leur apportera la gloire. Ça ne leur suffit jamais de vous laisser vivre et de vivre avec vous.
– Tu sais, j’ai répliqué, les hommes aussi en ont toujours après quelque chose. »
L’île est protestante, de diverses obédiences (surtout méthodistes et anglicans, mais aussi quelques catholiques ou « papistes »).
« Je dois reconnaître que dans la famille de ma mère, ils ne passaient pas leur temps à essayer de convertir tout le monde. Ils savaient qu’ils étaient dans le vrai et si les autres ne l’étaient pas, c’était leur problème. »
« Je ne sais pas ce que c’est qu’un païen, j’ai répondu, je ne peux donc pas dire si je le suis ou pas, mais je ne sais pas non plus ce qu’est un chrétien. Il y en a des milliers de toutes sortes sur cette île. Ce ne sont peut-être pas tous des dévergondés, du moins pas ouvertement, mais ils partent à la guerre et tuent d’autres gens, et en temps de paix, ils gagnent autant d’argent qu’ils le peuvent sur le dos les uns des autres et ils n’aiment pas plus leur prochain que moi. »
« La religion de ma mère est de loin la plus terrifiante dont j’ai jamais entendu parler. […] Le plus effroyable, c’est que l’endroit où l’on finirait était décidé avant même notre naissance, et qu’il n’y avait rien à y faire. »
Raymond s’est toujours senti la vocation de pasteur, mais sa conception de l’amour divin l’écarte du sacerdoce ; son destin assez dramatique en fait un personnage central, juste après Ebenezer.
« Comme je l’ai déjà dit, je n’aime pas les prêcheurs. Ils se hissent sur un piédestal et prétendent être le porte-parole de la volonté divine en vous assurant que toute autre opinion est le fruit du Diable. J’aime quand les gens disent carrément ce qu’ils pensent sur le moment et se fichent pas mal d’avoir tort ou raison. »
« « Après tout, disais-je, il y a quand même eu des progrès, tu sais. Le monde s’améliore lentement, du moins on peut l’espérer. » C’était le genre d’idée qui le mettait en rage. « Le monde s’est-il amélioré de ton temps ? demandait-il [Raymond]. – Eh bien, je ne sais pas, peut-être pas au point qu’on le remarque, je répondais. – Non, pas plus que du temps de n’importe qui d’autre ! Ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre. Le progrès, c’est la carotte pendue devant l’âne pour le faire tourner en rond. »
Relativement nombreux sont les insulaires tentés par l’émigration. La Première Guerre mondiale ne touche pas directement l’île, mais décime sa jeunesse envoyée au combat. Pendant la Seconde, c’est l’Occupation allemande, famine, et collaboration de certains.
« C’est la seule fois où il [Raymond] ait un peu parlé de la guerre. « Hitler, c’est l’Ancien Testament qui recommence, a-t-il dit. Pas étonnant qu’il déteste les Juifs. » Je ne l’ai pas compris alors, et un tas d’autres réflexions qu’il lâchait brusquement de temps à autre m’échappaient. Cette fois-là, je lui ai demandé ce qu’il entendait par là.
« Méfie-toi de ceux qui se prétendent désignés par l’Histoire ou par Dieu. Ils se sont désignés eux-mêmes. Il n’y a pas de Peuple Élu, a-t-il déclaré. – Ce n’était pas l’avis de ma mère. Elle y croyait, elle, aux Élus de Dieu. – Les communistes aussi, a-t-il rétorqué. C’est ce qu’ils appellent le Prolétariat. Les nazis les appellent les Aryens. Ça revient au même. L’État totalitaire. Rien n’est plus faux. La véritable totalité est inaccessible au cœur et à l’esprit des hommes. Au mieux, nous ne faisons que l’entrevoir. – Ça, je l’ignore, ai-je dit. Je n’en ai même jamais eu le moindre aperçu. – Ça vaut mieux que de s’imaginer qu’on sait tout, a-t-il répliqué. Dieu merci, je suis un îlien, et je ne serai jamais rien de plus. » Je me demande ce qu’il penserait s’il était encore en vie aujourd’hui. Guernesey devient chaque jour de plus en plus un État totalitaire. J’ai l’impression que c’est Hitler qui a gagné la guerre. »
« Quant à moi, je ne me sortirai pas de la tête qu’après la Libération, nous avons eu une chance unique de repartir à zéro. Mais pour je ne sais quelle raison, Guernesey a pris un mauvais tournant, même si elle n’a pas dégringolé la pente aussi vite et aussi volontiers que Jersey. La routine reprenait ses droits, mais en pire. Le chien retournait à son vomi et la truie se vautrait dans la fange. [Pierre] Il y avait sûrement autre chose à faire. Je ne sais pas quoi exactement. Je n’ai aucun droit de critiquer. Je me souviens trop bien comment, dans les pires moments, je me fichais pas mal de tout et de tout le monde, à part moi. Et je n’étais pas le seul. Si c’est bien là la vérité, alors mieux vaut encore ne pas la connaître. C’est peut-être la seule leçon qu’on ait tirée de l’Occupation, sauf que ça n’était pas la bonne. »
C’est aussi l’occasion de quelques scènes cocasses, comme les fouilles archéologiques de vestiges proches des Moulins, où Ebenezer demeure. Malgré ses nombreuses préventions de casanier misanthrope, Ebenezer noue étonnamment des liens d’amitié avec des « ennemis », un Jersiais catholique, un occupant allemand : c’est apparemment la personne qui compte pour lui, pas son appartenance.
« Se battre, forniquer et gagner de l’argent sont les choses les plus faciles au monde. Ayant moi-même pratiqué les trois, je sais de quoi je parle. Je continue à gagner de l’argent comme je peux. Quand on a commencé, on ne peut plus s’arrêter. Cet argent m’en rapporterait lui-même encore plus si je l’avais mis à la banque et touchais les intérêts tous les ans. « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l’abondance mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. » [Matthieu] L’ennui, maintenant que je l’ai, c’est que je ne sais pas quoi en faire. Je ne vivrai pas éternellement et il faut bien que je le lègue à quelqu’un. J’ai dû parcourir plusieurs centaines de kilomètres ces dernières années pour rendre visite à des parents plus ou moins éloignés à la recherche d’un héritier valable. »
Ebenezer parvient finalement à se trouver un digne héritier, Neville Falla, qui plus jeune avait cassé des vitres de sa serre, a gardé une réputation de voyou et est devenu un peintre enthousiaste.
« Je me suis dit que c’était lui l’ancêtre et moi le jeune, car de nos jours les enfants naissent déjà vieux et c’est à nous, les anciens, de leur apprendre à retrouver leur jeunesse. »
« De nos jours, quand on discute avec les gens, rien n’existe à moins que la télé en ait parlé. Elle donne aux gens l’impression d’avoir tout vu et de tout savoir, alors qu’ils n’ont jamais rien vu et ne savent rien. C’est la drogue la plus nocive au monde. Les gens poussent de grands cris indignés quand les jeunes fument de l’herbe. Mais la télévision est l’herbe de millions de drogués qui, les yeux ronds, la regardent tous les soirs. »
J’ai lu sans ennui ces quelques 600 pages, et sans doute leur charme tient aux grandes justesse et humanité dans le rendu, à tel point que le lecteur peine à croire à une fiction. Style conventionnel, jusqu’au relatif happy end en passant par un respect global de la chronologie. Mention spéciale pour les trop rares expressions en guernesiais, proche du normand.
\Mots-clés : #historique #identite #insularite #lieu #religion #ruralité #temoignage #vieillesse #xxesiecle
- le Mer 31 Mai - 13:32
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Gerald Basil Edwards
- Réponses: 3
- Vues: 282
Jean-Marie Blas de Roblès
Dans l'épaisseur de la chair
Le roman commence par un passage qui développe heureusement la superstition des marins, ici des pêcheurs à la palangrotte sur un pointu méditerranéen, Manuel Cortès, plus de quatre-vingt-dix ans, et son fils, le narrateur. Ce dernier veut recueillir les souvenirs paternels pour en faire un livre. Et c’est accroché au plat-bord de l’embarcation dont il est tombé, seul en mer, qu’il commence le récit de la famille, des Espagnols ayant immigré au XIXe en Algérie pour fuir sécheresse et misère : des pieds-noirs :
« Le problème est d’autant plus complexe que pas un seul des Européens qui ont peuplé l’Algérie ne s’est jamais nommé ainsi. Il faut attendre les derniers mois de la guerre d’indépendance pour que le terme apparaisse, d’abord en France pour stigmatiser l’attitude des colons face aux indigènes, puis comme étendard de détresse pour les rapatriés. Il en va des pieds-noirs comme des Byzantins, ils n’ont existé en tant que tels qu’une fois leur monde disparu. »
À Bel-Abbès, ou « Biscuit-ville », Juan est le père de Manuel, antisémite comme en Espagne après la Reconquista, et « n’ayant que des amis juifs »… Ce sont bientôt les premiers pogroms, et la montée du fascisme à l’époque de Franco, Mussolini et Hitler.
« En Algérie, comme ailleurs, le fascisme avait réussi à scinder la population en deux camps farouchement opposés. »
« Le Petit Oranais, journal destiné "à tous les aryens de l’Europe et de l’univers", venait d’être condamné par les tribunaux à retirer sa manchette permanente depuis 1930, un appel au meurtre inspiré de Martin Luther : "Il faut mettre le soufre, la poix, et s’il se peut le feu de l’enfer aux synagogues et aux écoles juives, détruire les maisons des Juifs, s’emparer de leurs capitaux et les chasser en pleine campagne comme des chiens enragés." On remplaça sans problème cette diatribe par une simple croix gammée, et le journal augmenta ses ventes. »
Est évoquée toute l’Histoire depuis la conquête française, qui suit le modèle romain.
« Bugeaud l’a clamé sur tous les tons sans être entendu : "Il n’est pas dans la nature d’un peuple guerrier, fanatique et constitué comme le sont les Arabes, de se résigner en peu de temps à la domination chrétienne. Les indigènes chercheront souvent à secouer le joug, comme ils l’ont fait sous tous les conquérants qui nous ont précédés. Leur antipathie pour nous et notre religion durera des siècles." »
« Cela peut sembler incroyable aujourd’hui, et pourtant c’est ainsi que les choses sont advenues : les militaires français ont conquis l’Algérie dans une nébulosité romaine, oubliant que le songe où ils se coulaient finirait, comme toujours, et comme c’était écrit noir sur blanc dans les livres qui les guidaient, par se transformer en épouvante. D’emblée, et par admiration pour ceux-là mêmes qui avaient conquis la Gaule et gommé si âprement la singularité de ses innombrables tribus, les Français ont effacé celle de leurs adversaires : ils n’ont pas combattu des Ouled Brahim, des Ouled N’har, des Beni Ameur, des Beni Menasser, des Beni Raten, des Beni Snassen, des Bou’aïch, des Flissa, des Gharaba, des Hachem, des Hadjoutes, des El Ouffia, des Ouled Nail, des Ouled Riah, des Zaouaoua, des Ouled Kosseir, des Awrigh, mais des fantômes de Numides, de Gétules, de Maures et de Carthaginois. Des indigènes, des autochtones, des sauvages. »
« Impossible d’en sortir, tant que ne seront pas détruites les machines infernales qui entretiennent ces répétitions. »
Dans l’Histoire plus récente, le régime de Vichy « réserva les emplois de la fonction publique aux seuls Français "nés de père français" », et fit « réexaminer toutes les naturalisations d’étrangers, avec menace d’invalider celles qui ne seraient pas conformes aux intérêts de la France. Ces dispositions, qui visaient surtout les Juifs sans les nommer, impliquaient l’interdiction de poursuivre des études universitaires. »
« Exclu du lycée Lamoricière, André Bénichou, le professeur de philo de Manuel, en fut réduit à créer un cours privé dans son appartement. C’est à cette occasion qu’il recruta Albert Camus, lui-même écarté de l’enseignement public à cause de sa tuberculose. Et je comprends mieux, tout à coup, pourquoi l’enfant de Mondovi, coincé à Oran, s’y était mis à écrire La Peste. »
Manuel se tourne vers la pharmacie, puis la médecine, s’engage pendant la Seconde Guerre, et devient chirurgien dans un tabor de goumiers du corps expéditionnaire français en Campanie.
« Sur le moment, j’aurais préféré l’entendre dire qu’il avait choisi la guerre « pour délivrer la France » ou « combattre le nazisme ». Mais non. Il s’était presque fâché de mon insistance : Je n’ai jamais songé à délivrer qui que ce soit, ni ressenti d’animosité particulière contre les Allemands ou les Italiens. Pour moi, c’était l’aventure et la haine des pétainistes, point final. »
« Quand le tabor se déplaçait d’un lieu de bataille à un autre, les goumiers transportaient en convoi ce qu’ils avaient volé dans les fermes environnantes, moutons et chèvres surtout, et à dos de mulet la quincaillerie de chandeliers et de ciboires qu’ils pensaient pouvoir ramener chez eux. Ils n’avançaient que chargés de leurs trophées, dans un désordre brinquebalant et coloré d’armée antique. […]
Les autorités militaires offrant cinq cents francs par prisonnier capturé, les goumiers s’en firent une spécialité. Et comme certains GI ne rechignaient pas à les leur racheter au prix fort pour s’attribuer l’honneur d’un fait d’armes, il y eut même une bourse clandestine avec valeurs et cotations selon le grade des captifs : un capitaine ou un Oberstleutnant rapportait près de deux mille francs à son heureux tuteur ! »
« Officiellement, la circulaire d’avril 1943 du général Bradley était très explicite sur ce point : pour maintenir le moral de l’armée il ne fallait plus parler de troubles psychologiques, ni même de shell shock, la mystérieuse « obusite » des tranchées, mais d’« épuisement ». Dans l’armée française, c’était beaucoup plus simple : faute de service psychiatrique – le premier n’apparaîtrait que durant la bataille des Vosges – il n’y avait aucun cas recensé de traumatisme neurologique. Des suicidés, des mutilations volontaires, oui, bien sûr, des désertions, des simulateurs, des bons à rien de tirailleurs ou de goumiers paralysés par les djnouns, incapables de courage physique et moral, ça arrivait régulièrement, des couards qu’il fallait bien passer par les armes lorsqu’ils refusaient de retourner au combat, mais des cinglés, jamais. Pas chez nous. Pas chez des Français qui avaient à reconquérir l’honneur perdu lors de la débâcle.
Mon père m’a raconté l’histoire d’un sous-officier qu’il avait vu se mettre à courir vers l’arrière au début d’une attaque et ne s’était plus arrêté durant des kilomètres, jusqu’à se réfugier à Naples où on l’avait retrouvé deux semaines plus tard. Et de ceux-là, aussi, faisant les morts comme des cafards au premier coup d’obus. J’ai pour ces derniers une grande compassion, tant je retrouve l’attitude qui m’est la plus naturelle dans mes cauchemars de fin du monde. Faire le mort, quitte à se barbouiller le visage du sang d’un autre, et attendre, attendre que ça passe et ce moment où l’on se relèvera vivant, quels que soient les comptes à rendre par la suite.
Sommes-nous si peu à détester la guerre, au lieu de secrètement la désirer ? »
S’accrochant toujours à sa barque, le narrateur médite.
« Dès qu’on se mêle de raconter, le réel se plie aux exigences de la langue : il n’est qu’une pure fiction que l’écriture invente et recompose. »
Heidegger, le perroquet que le narrateur a laissé au Brésil et devenu « une sorte de conscience extérieure qui me dirait des choses tout en dedans », renvoie à Là où les tigres sont chez eux.
« Heidegger a beau dire qu’il s’agit d’une coïncidence dénuée d’intérêt, je ne peux m’empêcher d’en éprouver un vertige désagréable, celui d’un temps circulaire, itératif, où reviendraient à intervalles fixes les mêmes fulgurances, les mêmes conjonctures énigmatiques. »
Ayant suivi des cours de philosophie (tout comme Manuel qui « s’inscrivit en philosophie à la fac d’Alger »), Blas de Roblès cite Wole Soyinka (sans le nommer) :
« Le tigre ne proclame pas sa tigritude, soupire Heidegger, il fonce sur sa proie et la dévore. »
En contrepartie de leur courage de combattants, les troupes coloniales commettent de nombreuses exactions, du pillage aux violences sur les civils.
« Plus qu’une sordide décompensation de soldats épargnés par la mort, le viol a toujours été une véritable arme de guerre. »
Le roman est fort digressif (d’ailleurs la citation liminaire est de Sterne). Le narrateur qui marine et s’épuise évoque des jeux d’échecs, fait de curieux projets, met en cause Vasarely…
Après la bataille du monastère de Monte Cassino, la troupe suit le « bellâtre de Marigny » (Jean de Lattre de Tassigny) dans le débarquement en Provence, puis c’est la bataille des Vosges, et l’Ardenne.
À propos du film Indigènes, différent sur l’interprétation des faits.
À peine l’Allemagne a-t-elle capitulé, Manuel est envoyé avec la Légion et les spahis qui répriment une insurrection à Sétif, « un vrai massacre » qui tourne vite à l’expédition punitive (une centaine de morts chez les Européens, plusieurs milliers chez les indigènes). Blessé, il part suivre ses études de médecine à Paris, puis se marie par amour avec une Espagnole pauvre, mésalliance à l’encontre de l’entre-soi de mise dans les différentes communautés.
« Les « indigènes », au vrai, c’était comme les oiseaux dans le film d’Alfred Hitchcock, ils faisaient partie du paysage. »
« Après Sétif, la tragédie n’a plus qu’à débiter les strophes et antistrophes du malheur. Une mécanique fatale, avec ses assassinats, ses trahisons, ses dilemmes insensés, sa longue chaîne de souffrances et de ressentiment. »
Les attentats du FLN commencent comme naît Thomas, le narrateur, qui aborde ses souvenirs d’enfance.
« …] le portrait que je trace de mon père en me fiant au seul recours de ma mémoire est moins fidèle, je m’en aperçois, moins réel que les fictions inventées ou reconstruites pour rendre compte de sa vie avant ma naissance. »
OAS et fellaghas divisent irréconciliablement Arabes et colons. De Gaulle parvient au pouvoir, et tout le monde croit encore que la situation va s’arranger, jusqu’à l’évacuation, l’exode, l’exil. Mauvais accueil en métropole, et reconstruction d’une vie brisée, Manuel devant renoncer à la chirurgie pour être médecin généraliste.
Histoire étonnante des cartes d’Opicino de Canistris :
« À la question « qui suis-je ? », qui sum ego, il répond tu es egoceros, la bête à corne, le bouc libidineux, le rhinocéros de toi-même.
Il n’est pas fou, il me ressemble comme deux gouttes d’eau ; il nous ressemble à tous, encombrés que nous sommes de nos frayeurs intimes et du combat que nous menons contre l’absurdité de vivre. »
Regret d’une colonisation ratée…
« Ce qu’il veut dire, je crois, c’est qu’il y aurait eu là-bas une chance de réussir quelque chose comme la romanisation de la Gaule, ou l’européanisation de l’Amérique du Nord, et que les gouvernements français l’avaient ratée. Par manque d’humanisme, de démocratie, de vision égalitaire, par manque d’intelligence, surtout, et parce qu’ils étaient l’émanation constante des « vrais colons » – douze mille en 1957, parmi lesquels trois cents riches et une dizaine plus riches à eux dix que tous les autres ensemble – dont la rapacité n’avait d’égal que le mépris absolu des indigènes et des petits Blancs qu’ils utilisaient comme main-d’œuvre pour leurs profits. »
… mais :
« Si les indigènes musulmans ont été les Indiens de la France, ce sont des Indiens qui auraient finalement, heureusement, et contre toute attente, repoussé à la mer leurs agresseurs.
Un western inversé, en somme, bien difficile à regarder jusqu’à la fin pour des Européens habitués à contempler en Technicolor la mythologie de leur seule domination. »
« La France s’est dédouanée de l’Algérie française en fustigeant ceux-là mêmes qui ont essayé tant bien que mal de faire exister cette chimère. Les pieds-noirs sont les boucs émissaires du forfait colonialiste.
Manuel ne voit pas, si profonde est la blessure, que ce poison terrasse à la fois ceux qui l’absorbent et ceux qui l’administrent. La meule a tourné d’un cran, l’écrasant au passage, sans même s’apercevoir de sa présence.
Il y aura un dernier pied-noir, comme il y a eu un dernier des Mohicans. »
Clairement narré, et regroupé en petits chapitres, ce qui rend la lecture fort agréable. Par exemple, le 240ème in extenso :
« Rejoindre le front des Vosges dans un camion de bauxite, sauter sur une mine à Mulhouse, et se retrouver médecin des gueules rouges à Brignoles, en compagnie d’un confrère alsacien ! Qu’est-ce qui est à l’œuvre dans ce genre de conjonction ? Quels sont les dieux fourbes qui manipulent ainsi nos destinées ? Projet : S’occuper de ce que Charles Fort appelait des « coïncidences exagérées ». Montrer ce qu’elles révèlent de terreur archaïque devant l’inintelligibilité du monde, de poésie latente aussi, et quasi biologique, dans notre obstination à préférer n’importe quel déterminisme au sentiment d’avoir été jetés à l’existence comme on jette, dit-on, un prisonnier aux chiens. »
Les parties du roman sont titrées d’après les cartes italiennes de la crapette, « bâtons, épées, coupes et deniers ».
Il y a une grande part d’autobiographie dans ce roman dense, qui aborde nombre de sujets.
Beaucoup d’aspects sont abordés, comme le savoureux parler nord-africain en voie de disparition (ainsi que son humour), et pendant qu’on y est la cuisine, soubressade, longanisse, morcilla…
Et le dénouement est inattendu !
\Mots-clés : #antisémitisme #biographie #colonisation #deuxiemeguerre #enfance #exil #guerredalgérie #historique #identite #immigration #insurrection #politique #racisme #relationenfantparent #segregation #social #terrorisme #traditions #xxesiecle
- le Ven 31 Mar - 12:56
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean-Marie Blas de Roblès
- Réponses: 25
- Vues: 1899
William H. Gass
Le Musée de l'inhumanité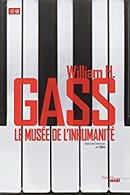
Les Skizzen, famille autrichienne de Graz apparemment de culture juive, fuient la montée du nazisme pour l’Angleterre, où ils subissent le Blitz. Le mari, Rudi, devient Yankel Fixel, puis Raymond Scofield, tandis que son épouse Nita est renommée Miriam, sa fille Dvorah, Deborah, et le jeune Yussel, né à Londres, Joseph.
« Être autrichien aujourd’hui est une calamité, et deviendra une malédiction. »
Le père disparaît, apparemment parti pour l’Amérique du Nord ; sa famille part s’installer à New York, puis Woodbine, Ohio. Joseph, parfois appelé Joey, joue du piano, improvisant beaucoup sous la direction de son professeur, le vieux Hirk. Il deviendra lui-même professeur de musique, avec son « musée de l’inhumanité » où il collectionne les atrocités et les crimes d’écocide découpés dans les journaux – où il module des variations sur une phrase (en caractères gras) qui évoque le passage de la crainte de ce que l’humanité ne pas perdure pas à celle qu’elle puisse survivre. État final :
« Skizzen s’attendait à voir l’humanité périr, mais finit par redouter qu’elle survive. »
« Avec un stylo et de l’encre, avant d’écrire, on pense, parce qu’on ne supporte pas la vue des corrections. Avec l’ordinateur, on écrit d’abord et on pense après, les corrections sont si faciles à apporter. Ce que je préfère, c’est la touche EFFACER ; elle a belle allure, dit Skizzen, en tapant furieusement. "Nous avons mangé notre portée et cru que c’était là une façon splendidement saine, voire succulente, de dîner." Joseph décida de laisser quelque chose derrière comme le ferait un animal pour signaler sa présence, aussi tapa-t-il : "Nous avons attendu avec impatience notre propre massacre, comme si nous recevions une récompense." »
Alternativement est évoquée la période où il travailla dans une boutique de disques, se spécialisant dans la musique classique, puis sa scolarité à Augsburg Community College, où il est organiste et lit, notamment Thomas Hardy, s’efforçant d’être « monsieur Passe-Partout », et se sentant toujours illégitime, « frauduleux », coupable – un « Im-pos-teur ».
« Bref, tout ce qui concernait Skizzen était schizo. »
« Augsburg, décida Joey, était soit une école bohème très progressive, soit un pénitencier éclairé.
Aussi n’avait-il jamais d’argent et menait-il, par conséquent, une bonne vie luthérienne. Sa naïveté l’empêchait de remarquer que c’étaient les élèves les plus pauvres qui gonflaient (eux seuls disaient « augsburgeaient ») leurs revenus en rendant des services aux mieux lotis, une autre façon qu’avait Augsburg de préparer ses étudiants au monde. »
Puis il devint bibliothécaire à Urichstown, chez miss Marjorie Bruss, dite « le Major » (encline aux hurlements), et miss Moss, qui répare les livres. Il y a aussi Portho le clodo qui se réfugie dans la bibliothèque, et miss Hérisson, Hazel Hawkins, « la Sorcière », contralto dans le gospel. Lui lit des biographies de musiciens.
« Les criminels sont trop intelligents pour vivre à Urichstown. On les y élève, mais ils ne restent pas. »
Joseph vit avec sa mère, qu’il a converti au jardinage des fleurs grâce à quelques graines subtilisées.
« Joseph Skizzen voyait la vie de sa mère s’épanouir à la semblance de ses plantes, tandis que la sienne – qui avait tracé si longtemps un trait lui aussi ascendant – s’enroulait autour de sa phrase obsessionnelle tel un lierre prédateur – les deux quêtes étant si évidemment reliées –, ajoutant quotidiennement à sa collection d’inhumanités. Mais son traitement des exactions n’engendrait rien d’admirable : s’il avait écrit à l’encre, il aurait fait un pâté ; s’il avait modelé de l’argile, cela aurait ressemblé à un étron ; s’il avait joué des notes, on aurait entendu une cacophonie ; s’il avait utilisé des ficelles, il aurait fait un nœud. Seule au sein de sa satanée collection, sa fierté finissait par sortir tel un rot. »
Autodidacte devenu professeur de musique moderne, il est confronté chez ses étudiants à la même atonie que la sienne à leur place.
« Joseph comprit que la religion s’attaquait à l’éducation libérale comme un assassin à la jugulaire. »
« Les rockers voudraient naturellement savoir ce qui se passait dans leur monde, mais ni leurs esprits ni leur monde n’étaient musicaux, un fait qu’ils ne comprenaient pas, et qui les agaçait. »
« Il boudait les exposés postulant que l’art neuf et le son nouveau étaient nés spontanément et ne savaient ni n’avaient besoin de désigner leurs parents. »
« Dans l’esprit de Joseph, la musique, à l’instar d’Orphée, se retournait, puis se retournait encore, de même que tous les compositeurs composaient avec d’antiques harmonies en tête [… »
À propos de la musique atonale (je n’ai pas été capable de suivre tous les développements musicaux) :
« C’est une musique qui doit passer par l’esprit avant de parvenir à l’oreille. Mais vous ne pouvez pas être un Américain pur jus et priser autant l’esprit. Les Américains n’ont pas de traditions dans lesquelles infuser comme le thé. Ils sont nés dans le Los Angeles de la Californie du Sud, ou à Cody dans le Wyoming, pas à Berlin ou à Vienne. Ils apprennent le piano avec de vieux décatis qui composent des chants pour oiseaux. Les Américains adorent la grosse caisse. La caisse est un instrument intentionnellement stupide. Les Américains jouent de tout de façon percussive sur des instruments intentionnellement stupides et jouent de la guitare comme s’ils tiraient avec un flingue. Mais je me suis laissé emporter par ma digression. Les digressions sont aussi agréables que les vacances, mais gare aux coups de soleil. »
« Seule sa folie progressait, ainsi que le musée qui était sa manifestation la plus convaincante. C’était un progrès qui naissait de l’accumulation, pas de la sélection, de la répétition et non de l’interconnexion ni – il le craignait – d’une plus profonde compréhension. »
Long et intéressant développement du thème du jardinage, catalogues compris.
« La musique, surtout, était ce qui attirait Joseph Skizzen dans le jardin, en particulier à cette époque de l’année, aussi croquante qu’un radis, quand les oiseaux établissaient leurs territoires. L’air semblait pressentir les graines et les graines pousser vers les chants des oiseaux. Joseph croyait connaître les plantes qui débusquaient les gazouilleurs, et celles qui se relevaient pour le roitelet, ou la fougère qui se tournait, non vers le soleil, mais vers le jacassement de la mésange, si vifs étaient les pétales de son chant, si nets si abondants si clairs, si ostentatoires dans leur symétrie, si soudains dans l’ombre. »
« Le professeur Skizzen détestait le mystère encore plus que Joey, surtout les mystères dont l’éclaircissement ne pouvait être agréable, comme des nuages se dissipant pour révéler la pluie. »
Myriam, outre le jardinage, cultive une cuisine nostalgique de l’Autriche.
« On ne peut pas avoir de courants d’air dans la cuisine quand on prépare les Krapfen. Ou des ustensiles froids – tu sais –, les bols doivent être aussi chauds que tes mains, des mains que tu as brûlées rapidement, et le plan de pâtisserie devrait être dans le même état, et non gris de la poussière des vieilles miches. Tu auras besoin de phalanges pour pétrir et aplatir ces plis d’air sournois, et tu devras donner à la pâte quelques gifles avec tes mains frottées. Chlac ! Comme tu giflerais un pinceur de fesses. La peau de la pâte se contractera. Et avoir du lard bien pâle à portée pour frire ton beignet, comme un saint – j’oublie – il exigeait – tu sais – il choisit l’huile qui fera de lui un martyr. »
La vieille voiture achetée à miss Hérisson, « la Balourde », occasionne un développement sur « le rêve américain – l’automobile ».
« Joey n’osait pas expliquer au président de la fac ou à ses collègues ou au doyen qu’il avait un but dans la vie qu’ils ne pouvaient sans doute pas comprendre mais que leurs soupçons ruinaient : c’était de traverser la vie en étant le moins complice possible des affaires humaines, des affaires où prédominent toujours… l’envie, la méchanceté, le meurtre, la jalousie, l’avidité, la trahison, la misère, l’égoïsme, la vengeance, la cruauté, la stupidité, et en général la gratuité. Mon père a fui les nazis avant qu’ils soient des nazis, parce qu’il connaissait notre nature. Il a essayé de se retirer du reproche, de la complicité. S’il ne l’avait pas fait, n’aurait-il pas été, à sa modeste façon, responsable de l’attitude de l’État autrichien, et accueilli leur petit et piètre Führer à son arrivée ? Je n’appartiens pas non plus à l’Amérique. Je suis sans nombre. Mon argent, le peu que j’en ai, ne peut être dépensé vilement. Je n’ai pas contribué aux entourloupes de la haute finance. Je vis simplement, à l’écart de l’ambition ou de la conspiration. Et donc, le professeur Skizzen, ce n’est pas moi. Je lui ai demandé de me représenter, pourrait-on dire, et d’être celui qui doit pactiser avec le diable. »
« Les croyances sont agitées par d’âpres exigences, mais les croyances, bien que stupides, absurdes ou bizarres, n’ont pas plus de corps matériel que Dieu lui-même. Elles ne peuvent être aisément détruites, et survivent toujours à leurs portefaix, ne serait-ce que dans les ouvrages désuets et les vieux volumes. Elles y végètent jusqu’à ce qu’un nigaud les ranime. »
C’est excellemment écrit, avec une vaste gamme de tons et un léger humour, même si le ton grince souvent. Dans ce portrait d'un homme qui veut s'effacer devant l'Histoire terrible, j'ai notamment pensé à l’Ulysse de Joyce.
\Mots-clés : #culpabilité #deuxiemeguerre #identite #initiatique #musique #xxesiecle
- le Jeu 23 Mar - 12:12
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William H. Gass
- Réponses: 4
- Vues: 400
Salman Rushdie
Quichotte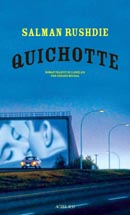
M. Ismail Smile, vieil États-unien originaire de Bombay et voyageur de commerce, est si addict aux « programmes télévisés ineptes » qu’il a glissé dans cette « réalité irréelle », suite à un mystérieux « Événement Intérieur ».
« Des acteurs qui jouaient des rôles de président pouvaient devenir présidents. L’eau pouvait venir à manquer. Une femme pouvait être enceinte d’un enfant qui se révélait être un dieu revenant sur terre. Des mots pouvaient perdre leur sens et en acquérir de nouveaux. »
« À l’ère du Tout-Peut-Arriver », sous le pseudonyme de Quichotte il se lance dans la quête amoureuse d’une vedette de télé, Miss Salma R., elle aussi d'origine indienne.
Quichotte se crée un « petit Sancho », un fils né de Salma dans le futur, inspiré du garçon rondouillard qu’il fut avant de devenir un adulte grand et mince
Ce premier chapitre a été écrit par l’écrivain Sam DuChamp, dit Brother, auteur de romans d’espionnage aux tendances paranoïaques, qui trouve en Quichotte une grande similitude avec sa propre situation.
« Ils étaient à peu près du même âge, l’âge auquel pratiquement tout un chacun est orphelin et leur génération qui avait fait de la planète un formidable chaos était sur le point de tirer sa révérence. »
Situation des immigrants indiens :
« Puis, en 1965, un nouvel Immigration and Nationality Act ouvrit les frontières. Après quoi, retournement inattendu, il s’avéra que les Indiens n’allaient pas, après tout, devenir une cible majeure du racisme américain. Cet honneur continua à être réservé à la communauté afro-américaine et les immigrants indiens, dont beaucoup étaient habitués au racisme des Blancs britanniques en Afrique du Sud et en Afrique de l’Est tout comme en Inde et en Grande-Bretagne, se sentaient presque embarrassés de se retrouver exonérés de la violence et des attaques raciales, et embarqués dans un devenir de citoyens modèles. »
Dans ce roman, Rushdie met en scène (de nouveau) l’état du monde, politique, culturel, en faisant des allers-retours des sociétés d’Asie du Sud à celles d’Occident.
« Une remarque, au passage, cher lecteur, si vous le permettez : on pourrait défendre l’idée que les récits ne devraient pas s’étaler de la sorte, qu’ils devraient s’enraciner dans un endroit ou dans un autre, y enfoncer leurs racines et fleurir sur ce terreau particulier, mais beaucoup de récits contemporains sont, et doivent être, pluriels, à la manière des plantes vivaces rampantes, en raison d’une espèce de fission nucléaire qui s’est produite dans la vie et les relations humaines et qui a séparé les familles, fait voyager des millions et des millions d’entre nous aux quatre coins du globe (dont tout le monde admet qu’il est sphérique et n’a donc pas de coins), soit par nécessité soit par choix. De telles familles brisées pourraient bien être les meilleures lunettes pour observer notre monde brisé. Et, au sein de ces familles brisées, il y a des êtres brisés, par la défaite, la pauvreté, les mauvais traitements, les échecs, l’âge, la maladie, la souffrance et la haine, et qui s’efforcent pourtant, envers et contre tout, de se raccrocher à l’espoir et à l’amour, et il se pourrait bien que ces gens brisés – nous, le peuple brisé ! – soient les plus fidèles miroirs de notre époque, brillants éclats reflétant la vérité, quel que soit l’endroit où nous voyageons, échouons, vivons. Car nous autres, les immigrants, nous sommes devenus telles les spores emportées dans les airs et regardez, la brise nous entraîne où elle veut jusqu’à ce que nous nous installions sur un sol étranger où, très souvent, comme c’est le cas par exemple à présent en Angleterre avec sa violente nostalgie d’un âge d’or imaginaire où toutes les attitudes étaient anglo-saxonnes et où tous les Anglais avaient la peau blanche, on nous fait sentir que nous ne sommes pas les bienvenus, quelle que soit la beauté des fruits que portent les branches des vergers de fruitiers que nous sommes devenus. »
À Londres, Sister (sœur de… Brother avec qui elle est brouillée), est une coléreuse « avocate réputée, s’intéressant tout particulièrement aux questions des droits civiques et aux droits de l’homme ».
« Sister était idéaliste. Elle pensait que l’État de droit était l’un des deux fondements d’une société libre, au même titre que la liberté d’expression. »
Le Dr R. K. Smile, riche industriel pharmaceutique cousin et employeur d’Ismail, se révèle être un escroc, distribuant fort largement ses produits opiacés.
Sancho Smile est une créature au second degré (imaginé par Quichotte imaginé par Brother) qui s’interroge sur son identité.
« Il y a un nom pour cela. Pour la personne qui est derrière l’histoire. Le vieux bonhomme, papa, dispose de plein d’éléments sur cette question. Il n’a pas l’air de croire en une telle entité, n’a pas l’air de sentir sa présence comme moi mais sa tête est tout de même remplie de pensées sur cette entité. Sa tête et par conséquent la mienne aussi. Il faut que je réfléchisse à cela dès maintenant. Je vais le dire ouvertement : Dieu. Peut-être lui et moi, Dieu et moi, pouvons-nous nous comprendre ? Peut-être pourrions-nous avoir une bonne discussion ensemble, puisque, vous savez, nous sommes tous deux imaginaires. »
« C’est simplement lui, papa, qui se dédouble en un écho de lui-même. C’est tout. Je vais me contenter de cela. Au-delà, on ne peut que sombrer dans la folie, autrement dit devenir croyant. »
« Il y a trois crimes que l’on peut commettre dans un pensionnat anglais. Être étranger, c’est le premier. Être intelligent, c’est le deuxième. Être mauvais en sports, c’est le troisième coup, vous êtes éliminé. On peut s’en sortir avec deux des trois défauts mais pas avec les trois à la fois. »
« Il y a des gens qui ont besoin de donner par la force une forme au caractère informe de la vie. Pour eux, l’histoire d’une quête est toujours très attirante. Elle les empêche de souffrir les affres de la sensation, comment dit-on, d’incohérence. »
Sancho est aussi un personnage (fictif) qui rêve d’émancipation, ombre de Quichotte et qui ne veut plus en être esclave. Tout ce chapitre 6 où il parle forme un morceau d’anthologie sur le sens de l’existence et de la littérature, via l’intertextualité. Ainsi, en référence à Pinocchio :
« “Grillo Parlante, à ton service, dit le criquet. C’est vrai, je suis d’origine italienne. Mais tu peux m’appeler Jiminy si tu veux. […]
Je suis une projection de ton esprit, exactement comme tu as commencé toi-même par être une projection du sien. Il semble que tu devrais bientôt avoir une insula. »
Salma, bipolaire issue d’une lignée féminine de belles vedettes devenues folles, est dorénavant superstar dans son talk-show (en référence assumée à Oprah Winfrey) ; elle s’adonne à « l’automédication » avec des « opiacés récréatifs ».
« Elle était une femme privilégiée qui se plaignait de soucis mineurs. Une femme dont la vie se déroulait à la surface des choses et qui, ayant choisi le superficiel, n’avait pas le droit de se plaindre de l’absence de profondeur. »
Road-trip où le confiant, souriant et bavard Quichotte emmène Sancho, qui découvre la réalité, les USA, la télé :
« Nous sommes sous-éduqués et suralimentés. Nous sommes très fiers de qui vous savez. Nous fonçons aux urgences et nous envoyons Grand-Mère nous chercher des armes et des cigarettes. Nous n’avons besoin d’aucun allié pourri parce que nous sommes stupides et vous pouvez bien nous sucer la bite. Nous sommes Beavis et Butt-Head sous stéroïdes. Nous buvons le Roundup directement à la canette. Notre président a l’air d’un jambon de Noël et il parle comme Chucky. C’est nous l’Amérique, bordel. Zap. Les immigrants violent nos femmes tous les jours. Nous avons besoin d’une force spatiale à cause de Daech. Zap. […]
“Le normal ne me paraît pas très normal, lui dis-je.
– C’est normal de penser cela”, répond-il. […]
Chaque émission sur chaque chaîne dit la même chose : d’après une histoire vraie. Mais cela non plus ce n’est pas vrai. La vérité, c’est qu’il n’y a plus d’histoires vraies. Il n’existe plus de vérité sur laquelle tout le monde peut s’accorder. »
… et la vie en motels, qui nous vaut cette belle énumération d’images :
« Ce qu’il y a, surtout, ce sont des ronflements. La musique des narines américaines a de quoi vous impressionner. La mitrailleuse, le pivert, le lion de la MGM, le solo de batterie, l’aboiement du chien, le jappement du chien, le sifflet, le moteur de voiture au ralenti, le turbo d’une voiture de course, le hoquet, les grognements en forme de SOS, trois courts, trois longs, trois courts, le long grondement de la vague, le fracas plus menaçant des roulements de tonnerre, la brève explosion d’un éternuement en plein sommeil, le grognement sur deux tons du joueur de tennis, la simple inspiration/expiration ordinaire ou ronflement classique, le ronflement irrégulier, toujours surprenant, avec, de temps en temps, des pauses imprévisibles, la moto, la tondeuse à gazon, le marteau-piqueur, la poêle grésillante, le feu de bois, le stand de tir, la zone de guerre, le coq matinal, le rossignol, le feu d’artifice, le tunnel à l’heure de pointe, l’embouteillage, Alban Berg, Schoenberg, Webern, Philip Glass, Steve Reich, le retour en boucle de l’écho, le bruit d’une radio mal réglée, le serpent à sonnette, le râle d’agonie, les castagnettes, la planche à laver musicale, le bourdonnement. »
« En fait, voilà : quand je m’éveille le matin et que j’ouvre la porte de la chambre, je ne sais pas quelle ville je vais découvrir dehors, ni quel jour de la semaine, du mois ou de l’année on sera. Je ne sais même pas dans quel État nous allons nous trouver, même si cela me met dans tous mes états, merci bien. C’est comme si nous demeurions immobiles et que le monde nous dépassait. À moins que le monde ne soit une sorte de télévision, mais je ne sais pas qui détient la télécommande. Et s’il y avait un Dieu ? Serait-ce la troisième personne présente ? Un Dieu qui, au demeurant, nous baise, moi, les autres, en changeant arbitrairement les règles ? Et moi qui croyais qu’il y avait des règles pour changer les règles. Je pensais, même si j’accepte l’idée que quelqu’un virgule quelque chose a créé tout ceci, ce quelque chose virgule ce quelqu’un n’est-il, virgule ou n’est-elle, pas lié.e par les lois de la création une fois qu’il, ou elle, l’a achevée ? Ou peut-il virgule, peut-elle hausser les épaules et déclarer finie la gravité, et adieu, et nous voici flottant tous dans le vide ? Et si cette entité, appelons-la Dieu, pourquoi pas, c’est la tradition, peut réellement changer les règles tout simplement parce qu’elle est d’humeur à le faire, essayons de comprendre précisément quelle est la règle qui est changée en l’occurrence. »
Ils arrivent à New-York.
« Il y a deux villes, dit Quichotte. Celle que tu vois, les trottoirs défoncés de la ville ancienne et les squelettes d’acier de la nouvelle, des lumières dans le ciel, des ordures dans les caniveaux, la musique des sirènes et des marteaux-piqueurs, un vieil homme qui fait la manche en dansant des claquettes, dont les pieds disent, j’ai été quelqu’un, dans le temps, mais dont les yeux disent, c’est fini, mon gars, bien fini. La circulation sur les avenues et les rues embouteillées. Une souris qui fait de la voile sur une mare dans le parc. Un type avec une crête d’Iroquois qui hurle en direction d’un taxi jaune. Des mafieux affranchis avec une serviette coincée sous le menton dans une gargote italienne de Harlem. Des gars de Wall Street qui ont tombé la veste et se commandent des bouteilles d’alcool dans des night-clubs ou se prennent des shots de tequila et se jettent sur les femmes comme sur des billets de banque. De grandes femmes et de petits gars chauves, des restaurants à steaks et des boîtes de strip-tease. Des vitrines vides, des soldes définitifs, tout-doit-disparaître, un sourire auquel manquent quelques-unes de ses meilleures dents. Des travaux partout mais les conduites de vapeur continuent à exploser. Des hommes qui portent des anglaises avec un million de dollars en diamants dans la poche de leur long manteau noir. Ferronnerie. Grès rouge. Musique. Nourriture. Drogues. Sans-abris. Chasse-neige, baseball, véhicules de police labellisés CPR – courtoisie, professionnalisme, respect –, que-voulez-vous-que-je-vous-dise, ils-ne-manquent-pas-d’humour. Toutes les langues de la Terre, le russe, le panjabi, le taishanais, le créole, le yiddish, le kru. Et sans oublier le cœur battant de l’industrie de la télévision, Colbert au Ed Sullivan Theater, Noah dans Hell’s Kitchen, The View, The Chew, Seth Meyers, Fallon, tout le monde. Des avocats souriants sur les chaînes du câble qui promettent de vous faire gagner une fortune s’il vous arrive un accident. Rock Center, CNN, Fox. L’entrepôt du centre-ville où est tourné le show Salma. Les rues où elle marche, la voiture qu’elle prend pour rentrer chez elle, l’ascenseur vers son appartement en terrasse, les restaurants d’où elle fait venir ses repas, les endroits qu’elle connaît, ceux qu’elle fréquente, les gens qui ont son numéro de téléphone, les choses qu’elle aime. La ville tout entière belle et laide, belle dans sa laideur, jolie-laide, c’est français, comme la statue dans le port. Tout ce qu’on peut voir ici.
– Et l’autre ville ? demanda Sancho, sourcils froncés. Parce que ça fait déjà pas mal, tout ça.
– L’autre ville est invisible, répondit Quichotte, c’est la cité interdite, avec ses hauts murs menaçants bâtis de richesse et de pouvoir, et c’est là que se trouve la réalité. Ils sont très peu à détenir la clef qui permet d’accéder à cet espace sacré. »
Après avoir « renoncé à la croyance, à l’incroyance, à la raison et à la connaissance », ils doivent parvenir dans la « quatrième vallée » au détachement, là où « ce qu’on appelle communément « la réalité », qui est en réalité l’irréel, comme nous le montre la télévision, cessera d’exister. »
Quichotte envoie des lettres à Salma, puis sa photo, qui rappelle à celle-ci Babajan, son « grand-père pédophile ».
« Ma chère Miss Salma,
Dans une histoire que j’ai lue, enfant, et que, par une chance inespérée, vous pouvez voir aujourd’hui portée à l’écran sur Amazon Prime, un monastère tibétain fait l’acquisition du super-ordinateur le plus puissant du monde parce que les moines sont convaincus que la mission de leur ordre est de dresser la liste des neuf milliards de noms de Dieu et que l’ordinateur pourrait les aider à y parvenir rapidement et avec précision. Mais apparemment, il ne relevait pas de la seule mission de leur ordre d’accomplir cet acte héroïque d’énumération. La mission relevait également de l’univers lui-même, si bien que, lorsque l’ordinateur eut accompli sa tâche, les étoiles, tout doucement et sans tapage aucun, se mirent à disparaître. Mes sentiments à votre égard sont tels que je suis persuadé que tout l’objectif de l’univers jusqu’à présent a été de faire advenir cet instant où nous serons, vous et moi, réunis dans les délices éternelles et que, quand nous y serons parvenus, le cosmos, ayant atteint son but, cessera paisiblement d’exister et que, ensemble, nous entamerons alors notre ascension au-delà de l’annihilation pour pénétrer dans la sphère de l’Intemporel. »
« Autrefois, les gens croyaient vivre dans de petites boîtes, des boîtes qui contenaient la totalité de leur histoire et ils jugeaient inutile de se préoccuper de ce que faisaient les autres dans leurs autres petites boîtes, qu’elles soient proches ou lointaines. Les histoires des autres n’avaient rien à voir avec les leurs. Mais le monde a rétréci et toutes les boîtes se sont trouvées bousculées les unes contre les autres et elles se sont ouvertes et à présent que toutes les boîtes sont reliées les unes aux autres il nous faut admettre que nous devons comprendre ce qui se passe dans les boîtes où nous ne sommes pas, faute de quoi nous ne comprenons plus la raison de ce qui se passe dans nos propres boîtes. Tout est connecté. »
Quichotte a (comme Brother) une demi-sœur, « Trampoline », avec qui il s’est brouillé en l’accusant de détournement de leur héritage, devenue une défenderesse des démunis, et dont il voudrait maintenant se faire pardonner.
« Il n’accordait guère de temps aux chaînes d’actualités et d’informations, mais quand il les regardait distraitement il voyait bien qu’elles aussi imposaient un sens au tourbillon des événements et cela le réconfortait. »
Son, le fils de Brother, s’est aussi éloigné de ce dernier depuis des années, « passant tout son temps, jour et nuit, perdu quelque part dans son ordinateur, à s’immerger dans des vidéos musicales, jouer aux échecs en ligne ou mater du porno, ou Dieu sait quoi. »
Un agent secret (nippo-américain) apprend à Brother que son fils serait le mystérieux Marcel DuChamp, cyberterroriste qui porte le masque de L’Homme de la Manche, et l’engage à le convertir à servir les USA dans cette « Troisième Guerre mondiale ».
« Je ne suis pas critique littéraire mais je pense que vous expliquez au lecteur que le surréel, voire l’absurde, sont potentiellement devenus la meilleure façon de décrire la vraie vie. Le message est intéressant même s’il exige parfois, pour y adhérer, un considérable renoncement à l’incrédulité. »
Le destin d’Ignatius Sancho, esclave devenu abolitionniste, écrivain et compositeur en Grande-Bretagne, est évoqué à propos.
« Les réseaux sociaux n’ont pas de mémoire. Aujourd’hui, le scandale se suffisait à lui-même. L’engagement de Sister, toute une vie durant, contre le racisme, c’était comme s’il n’avait jamais existé. Différentes personnes qui se posaient en chefs de la communauté étaient prêtes à la dénoncer, comme si faire de la musique à fond tard le soir était une caractéristique indéniable de la culture afro-caribéenne et que toute critique à son égard ne pouvait relever que du préjugé, comme si personne n’avait pris la peine de remarquer que la grande majorité des jeunes buveurs nocturnes, ceux qui faisaient du scandale ou déclenchaient des bagarres, étaient blancs et aisés. »
« Mais aujourd’hui c’était le règne de la discontinuité. Hier ne signifiait plus rien et ne pouvait pas nous aider à comprendre demain. La vie était devenue une suite de clichés disparaissant les uns après les autres, un nouveau posté chaque jour et remplaçant le précédent. On n’avait plus d’histoire. Les personnages, le récit, l’histoire, tout cela avait disparu. Seule demeurait la plate caricature de l’instant et c’est là-dessus qu’on était jugé. Avoir vécu assez longtemps pour assister au remplacement, par sa simple surface, de la profonde culture du monde qu’elle s’était choisi était une bien triste chose. »
Trampoline est passée par un cancer qui lui a valu une double mastectomie, et elle recouvrit confiance en elle grâce à Evel Cent (Evil Scent, « mauvaise odeur » – Elon Musk !), un techno-milliardaire qui prétend sauver l’humanité en lui faisant quitter notre planète dans un monde en voie de désintégration ; Quichotte la brouilla avec lui, actuellement invité de Salma dans son talk-show. Trampoline révèle à Sancho que son « Événement Intérieur » fut une attaque cérébrale, et Quichotte obtient le pardon de ses offenses envers elle, rétablissant ainsi l’harmonie, prêt pour la sixième vallée, celle de l’Émerveillement.
« La mort de Don Quichotte ressemblait à l’extinction, en chacun d’entre nous, d’une forme particulière de folie magnifique, une grandeur innocente, une chose qui n’a plus sa place ici-bas, mais qu’on pourrait appeler l’humanité. Le marginal, l’homme dont on ridiculise la déconnexion d’avec la réalité, le décalage radical et l’incontestable démence, se révèle, au moment de sa mort, être l’homme le plus précieux d’entre tous et celui dont il faut déplorer la perte le plus profondément. Retenez bien cela. Gardez-le à l’esprit plus que tout. »
Brother retrouve Sister à Londres, qui se meurt d’un cancer (elle aussi), pour présenter ses excuses alors qu’il n’a pas souvenir de ses torts. Elle lui apprend que leur père avait abusé d’elle.
« C’était déconcertant à un âge aussi avancé de découvrir que votre récit familial, celui que vous aviez porté en vous, celui dans lequel, dans un sens, vous aviez vécu, était faux, ou, à tout le moins, que vous en aviez ignoré la vérité la plus essentielle, qu’elle vous avait été cachée. Si l’on ne vous dit pas toute la vérité, et Sister avec son expérience de la justice le savait parfaitement bien, c’est comme si on vous racontait un mensonge. Ce mensonge avait constitué sa vérité à lui. C’était peut-être cela la condition humaine : vivre dans des fictions créées par des contre-vérités ou par la dissimulation des vérités réelles. Peut-être la vie humaine était-elle dans ce sens véritablement fictive, car ceux qui la vivaient ne savaient pas qu’elle était irréelle.
Et puis il avait écrit sur une gamine imaginaire dans une famille imaginaire et il l’avait dotée d’un destin très proche de celui de sa sœur, sans même savoir à quel point il s’était approché de la vérité. Avait-il, quand il était enfant, soupçonné quelque chose, puis, effrayé de ce qu’il avait deviné, avait-il enfoui cette intuition si profondément qu’il n’en gardait aucun souvenir ? Et est-ce que les livres, certains livres, pouvaient accéder à ces chambres secrètes et faire usage de ce qu’ils y trouvaient ? Il était assis au chevet de Sister rendu sourd par l’écho entre la fiction qu’il avait inventée et celle dans laquelle on l’avait fait vivre. »
Sister et son mari (un juge qui aime s’habiller en robe de soirée) se suicident ensemble avec le « spray InSmileTM » qu’il a apporté à sa demande. Le Dr R. K. Smile charge Quichotte d’une livraison du même produit pour… Salma !
« …] elle passait à la télévision, sur le mode agressif, son monologue introductif portant le titre de “Errorisme en Amérique” ce qui lui permettait à elle et à son équipe de scénaristes de s’en prendre à tous les ennemis de la réalité contemporaine : les adversaires de la vaccination, les fondus du changement climatique, les nouveaux paranoïaques, les spécialistes des soucoupes volantes, le président, les fanatiques religieux, ceux qui affirment que Barack Obama n’est pas né en Amérique, ceux qui soutiennent que la Terre est plate, les jeunes prêts à tout censurer, les vieux cupides, les trolls, les clochards bouddhistes, les négationnistes, les fumeurs d’herbe, les amoureux des chiens (elle détestait qu’on domestique les animaux) et la chaîne Fox. “La vérité, déclamait-elle, est toujours là, elle respire encore, ensevelie sous les gravats des bombes de la bêtise. »
Des troubles visuels et d’autres signes rappellent la théorie de l’effilochement de la réalité dans un cosmos en amorce de désagrégation.
Le nouveau Galaad rencontre Salma pour lui remettre cette « potion » qui devait la rendre amoureuse de lui ; son message d’amour ne passe pas, et Salma fait une overdose avec le produit du Dr R. K. Smile, qui est arrêté pour trafic de stupéfiants (bizarrement, se greffe un chef d’inculpation portant sur son comportement incorrect avec les femmes…).
Maintenant, la télévision s’adresse directement à Quichotte, et son pistolet lui conseille de tuer Salma, sortie de l’hôpital mais dorénavant inatteignable. Sancho, qui lui aussi s’est trouvé une dulcinée et s’émancipe de plus en plus, agresse sa tante pour la voler ; il a changé depuis qu’il a été victime d’une agression raciste.
« Depuis qu’il avait été passé à tabac dans le parc, Sancho avait eu l’impression que quelque chose n’allait pas en lui, rien de physique, plutôt un trouble d’ordre existentiel. Quand vous avez été sévèrement battu, la part essentielle de vous-même, celle qui fait de vous un être humain, peut se détacher du monde comme si le moi était un petit bateau et que l’amarre le rattachant au quai avait glissé de son taquet laissant le canot dériver inéluctablement vers le milieu du plan d’eau, ou comme si un grand bateau, un navire marchand, par exemple, se mettait, sous l’effet d’un courant puissant, à chasser sur son ancre et courait le risque d’entrer en collision avec d’autres navires ou de s’échouer de manière désastreuse. Il comprenait à présent que ce relâchement n’était peut-être pas seulement d’ordre physique mais aussi éthique, que, lorsqu’on soumettait quelqu’un à la violence, la violence entrait dans la catégorie de ce que cette personne, jusque-là pacifique et respectueuse des lois, allait inclure ensuite dans l’éventail des possibilités. La violence devenait une option. »
Des « ruptures dans le réel » et autres « trous dans l’espace-temps » signalent de plus en plus l’imminente fin du monde.
Dans des propos tenus à son fils Son, « l’Auteur » met en abyme dans la fiction le projet de l’auteur.
« “Tant de grands écrivains m’ont guidé dans cette voie”, dit-il ; et il cita aussi Cervantès et Arthur C. Clarke. “C’est normal de faire ça ? demanda Son, ce genre d’emprunt ?” Il avait répondu en citant Newton, lequel avait déclaré que s’il avait été capable de voir plus loin c’était parce qu’il s’était tenu sur les épaules de géants. »
« Il essaya de lui expliquer la tradition picaresque, son fonctionnement par épisodes, et comment les épisodes d’une œuvre de ce genre pouvaient adopter des styles divers, relevé ou ordinaire, imaginatif ou banal, comment elle pouvait être à la fois parodique et originale et ainsi, au moyen de ses métamorphoses impertinentes, mettre en évidence et englober la diversité de la vie humaine. »
« Je pense qu’il est légitime pour une œuvre d’art contemporaine de dire que nous sommes paralysés par la culture que nous avons produite, surtout par ses éléments les plus populaires, répondit-il. Et par la stupidité, l’ignorance et le sectarisme, oui. »
Dans la septième vallée, celle de l’annihilation d’un monde apocalyptique livré aux vides, Quichotte (et son pistolet) convainc Salma d’aller avec lui au portail d’Evel Cent en Californie pour fuir dans la Terre voisine : celle de l’Auteur.
C’est excellemment conté, plutôt foutraque et avec humour, mais en jouant de tous les registres de la poésie au polar en passant par le picaresque ; relativement facile à suivre, quoique les références, notamment au show business, soient parfois difficiles à saisir pour un lecteur français. Beaucoup de personnages et d’imbroglios dans cette illustration de la complexité du monde. De nombreuses mises en abîme farfelues, comme l’histoire des mastodontes (dont certains se tenant sur les pattes arrière et portant un costume vert), perturbent chacun des deux fils parallèles en miroir (celui de Quichotte et celui de Brother), tout en les enrichissant. Récurrences (jeu d’échec, etc.), intertextualité (le « flétan », qui rappelle Günter Grass, etc.). J’ai aussi pensé à Umberto Eco, Philip K. Dick.
\Mots-clés : #Contemporain #ecriture #famille #Identite #immigration #initiatique #Mondialisation #racisme #sciencefiction #XXeSiecle
- le Sam 4 Mar - 12:51
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Salman Rushdie
- Réponses: 18
- Vues: 1481
Antonio Tabucchi
Pour Isabel - Un mandala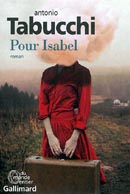
Mónica rapporte des souvenirs de jeunesse, au Portugal sous Salazar, avec Isabel, à Waclaw Slowacki (et/ou Tadeus), le narrateur, un étranger qui a connu cette dernière il y a longtemps. Puis ce sont Bi, Brígida Teixeira, sa nourrice, Tecs, une saxophoniste américaine qui l’a fréquentée à l’université, Oncle Tom, Almeida le gardien de prison capverdien qui la fit s’enfuir, ensuite Tiago le photographe, qui évoquent l’amie disparue dans des versions (ou péripéties) différentes de son destin.
« …] les photographies d’une vie sont-elles un temps segmenté en plusieurs personnes ou la même personne segmentée en différents temps ? »
« …] la mort est le tournant de la route, et mourir c’est seulement ne pas être vu. Et alors pourquoi, demanda-t-il d’un air encore plus perplexe, dans quel but ? Dans le but de faire des cercles concentriques, dis-je, pour arriver finalement au centre. »
Sixième cercle de l’enquête : Magda, de l’organisation clandestine où œuvrait Isabel (une chauve-souris à Macao).
Slowacki semble reconnaître ou être reconnu par les serveurs de rencontre.
« Le restaurant s’appelait Lisboa antiga-Macau moderno. C’était un endroit très modeste, avec une petite vitrine où reposaient en paix les restes de tripes blanchâtres dans un plat. Au milieu de la vitrine trônait une gigantesque racine de ginseng et un petit carton écrit en portugais affirmait : Nos pensamos na sua virilidade, nous veillons à votre virilité. »
Le Fantôme qui Marche, un poète opiomane, lui indique les Alpes Suisses, où il rencontre, dans un château-lieu de méditation dédié à Hermann Hesse, Lise, une astrophysicienne, et Xavier, le Lama, qui le dirige énigmatiquement vers une petite station de la Riviera italienne où il trouve le Violoneux Fou, puis finalement Isabel, telle que lorsqu’il lui a dit adieu – dans leur autrefois, et le « néant sapientiel ».
Tabucchi précisa dans un entretien paru en juin 1994, concernant ce roman volontairement posthume qui constitue une manière de clef de voûte de son œuvre :
« Depuis quelques années j’écris un roman que j’espère pouvoir bientôt conclure. Le personnage principal sera justement Isabel, la même femme qui dans Requiem n’apparaît pas, ou plutôt qui est seulement esquissée et qui à un certain moment apparaît, mais comme une sorte de Convive de pierre. Dans ce roman, ce n’est pas Isabel qui parlera d’elle, ce sont les autres qui le feront. Beaucoup des personnages de mes livres précédents seront appelés à témoigner sur Isabel, il y aura Tadeus, Magda, et même le Xavier de Nocturne indien, le personnage recherché mais jamais trouvé, qui fournira un important témoignage. Ce sera un tour, ou plusieurs tours, autour de la figure de cette femme qui a eu une vie difficile et obscure, une vie sur laquelle existent des versions différentes et en même temps toutes étonnamment dignes de foi. Ce sera un roman qui tentera de faire la lumière sur l’existence d’une femme fuyante et très mystérieuse. »
Se souvenir des précédents personnages de Tabucchi serait évidemment un plus, mais pas un must, tant l'histoire a du charme.
\Mots-clés : #amour #creationartistique #identite #romanchoral #universdulivre
- le Mer 21 Déc - 12:35
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Antonio Tabucchi
- Réponses: 38
- Vues: 4347
W.G. Sebald
Austerlitz
Sebald rencontre à Anvers Austerlitz, architecte qui l’entretient de la démesure atteinte au XIXe dans la surenchère entre fortification et poliorcétique (art de mener un siège), la forteresse devenant de plus en plus rapidement obsolète face aux progrès de l’artillerie.
« …] nos meilleurs projets, au cours de leur réalisation, n’ont de cesse qu’ils ne se muent en leur exact contraire. »
« …] étudiant, l’architecture de l’ère capitaliste, et en particulier l’impératif d’ordonnance et la tendance au monumental à l’œuvre dans les cours de justice et les établissements pénitentiaires, les bourses et les gares, mais aussi les cités ouvrières construites sur plan orthogonal. »
Ils se revoient plusieurs fois, par hasard ; ici, à propos du palais de justice de Bruxelles :
« La construction de cette singulière monstruosité architecturale, à laquelle il songeait à cette époque consacrer une étude, avait été entreprise vers les années quatre-vingt du siècle dernier, dans la précipitation, sous la pression de la bourgeoisie bruxelloise, me raconta Austerlitz, avant que les plans grandioses présentés par un certain Joseph Poelaert aient été élaborés en détail, et la conséquence en était, dit Austerlitz, que dans ce bâtiment d’une capacité de plus de sept cent mille mètres cubes il existait des corridors et des escaliers qui ne menaient nulle part, des pièces et des halls sans porte où jamais personne n’avait pénétré et dont le vide conservait emmuré le secret ultime de tout pouvoir sanctionné. »
Ils se rencontrent encore deux décennies plus tard à Londres, et Sebald s’aperçoit qu’il ressemble à Wittgenstein, avec « son sac à dos ne le quittait jamais ».
« …] voilà qui était contraire à toute vraisemblance statistique mais d’une logique interne étonnante, pour ne pas dire inéluctable. »
Austerlitz lui raconte son histoire : dès le début de la Seconde Guerre mondiale et ses quatre ans et demi, il a été élevé par d’austères parents nourriciers, et son enfance fut froide, sinon lugubre.
« J’ai grandi, dit-il, à Bala, petite bourgade du pays de Galles, dans la maison d’un prédicateur calviniste, un ancien missionnaire nommé Emyr Elias et marié à une femme timorée issue d’une famille anglaise. »
« Durant toutes les années que j’ai passées au presbytère de Bala, le sentiment ne m’a de fait jamais quitté que restait dérobé à ma vue quelque chose de très proche et de très évident. Parfois, c’était comme si j’essayais à partir d’un rêve de saisir la réalité ; puis j’avais l’impression que marchait à mes côtés un frère jumeau invisible, le contraire d’une ombre en quelque sorte. »
Ce n’est qu’au lycée, une fois sa mère adoptive morte et Elias devenu fou de chagrin dans sa sombre croyance qui ne le soutient plus, qu’on lui apprend que son vrai nom est Austerlitz. André Hilary, son professeur d’histoire, féru de l’époque napoléonienne, lui apprend l’histoire de la bataille.
Il s’initie à la photographie (comme Sebald, dont les photos illustrent le texte) ; il protège son factotum en pension, le petit Gerald Fitzpatrick, début d’une amitié ; il se trouve invité par la mère de ce dernier à Barmouth, où Alphonso, le grand-oncle naturaliste, leur fait notamment découvrir les mites et papillons.
Les souvenirs d’Austerlitz sont riches d’énumérations minutieuses (insectes, mais aussi plantes, minéraux, maladies, etc.), et tout ce qui est rapporté l’est dans un style élaboré, précis, à la fois fluide et pesant, car sans pause (la traduction semble excellente).
« Admirées surtout par Gerald, les diverses stries lumineuses qu’ils semblaient laisser derrière eux, traits, boucles et spirales, n’avaient en réalité aucune existence, avait expliqué Alphonso, elles n’étaient que traces fantômes dues à la paresse de notre œil, qui croit encore voir un reflet rémanent à l’endroit d’où l’insecte, pris une fraction de seconde sous l’éclat de la lampe, a déjà disparu. C’était à ces genres de phénomènes factices, à ces irruptions de l’irréel dans le monde réel, à certains effets de lumière dans un paysage étalé devant nous, au miroitement dans l’œil d’une personne aimée, que s’embrasaient nos sentiments les plus profonds, ou du moins ce que nous tenions pour tels. »
Suivent des considérations sur le temps (ce récit lui-même est quasiment un flux ininterrompu).
« Si Newton a pensé, dit Austerlitz en montrant par la fenêtre, brillant dans le reste de jour, le méandre qui enserre l’île des Chiens, si Newton a réellement pensé que le temps s’écoule comme le courant de la Tamise, où est alors son origine et dans quelle mer finit-il par se jeter ? Tout cours d’eau, nous le savons, est nécessairement bordé des deux côtés. Mais quelles seraient, à ce compte, les rives du temps ? Quelles seraient ses propriétés spécifiques correspondant approximativement à celles de l’eau, laquelle est liquide, assez lourde et transparente ? En quoi des choses plongées dans le temps se distinguent-elles de celles qui n’ont jamais été en contact avec lui ? Que signifie que nous représentions les heures diurnes et les heures nocturnes sur un même cercle ? Pourquoi, en un lieu, le temps reste-t-il éternellement immobile tandis qu’en un autre il se précipite en une fuite éperdue ? Ne pourrait-on point dire que le temps lui-même, au fil des siècles, au fil des millénaires, n’a pas été synchrone ? Finalement, il n’y a pas si longtemps que cela qu’il se trouve en expansion et se répand en tous sens. Et jusqu’aujourd’hui, la vie des hommes, dans maintes contrées de la terre, n’est-elle pas moins régie par le temps que par les conditions atmosphériques, autrement dit par une grandeur inquantifiable qui ignore la régularité linéaire, n’avance pas de manière constante mais au rythme de remous et de tourbillons, est déterminée par les engorgements et les dégorgements, revient sous une forme sans cesse autre et évolue vers qui sait où ? L’être-hors-du-temps qui naguère encore était le mode d’existence dans les contrées reculées et oubliées de notre propre pays, comme sur les continents non encore explorés d’outre-mer, se retrouvait aussi, dit Austerlitz, dans les métropoles régies par le temps, Londres par exemple. Les morts n’étaient-ils pas hors du temps ? Les mourants ? Les malades alités chez eux ou dans les hôpitaux ? Et non seulement eux, car il suffisait d’avoir son content de malheur personnel pour déjà être coupé de tout passé et de tout avenir. »
Austerlitz poursuit ses études à Oxford puis Paris, tandis que Gerald, passionné par les pigeons, devient aviateur et astronome.
Lors d’excursions nocturnes Austerlitz explore le milieu urbain, et on se sait parfois plus s’il s’agit de Sebald ou de lui, sorte d’alter ego. Lorsque l’auteur mentionne ses propres allées et venues en marge des confidences d’Austerlitz, l’inquiétante étrangeté et son angoisse semblent déteindre des zones lugubres traversées.
Après une évocation des morts à propos des cimetières reconquis par la ville en extension, Austerlitz rapporte sa révélation sur ses origines dans la salle d’attente abandonnée de Liverpool Street Station. Ces architectures absurdes, à la Piranèse, reviennent plusieurs fois, comme une pénétration onirique de la réalité.
« Il faut bien dire que les pas décisifs de notre vie, nous les accomplissons presque tous sous la pression d’une confuse nécessité interne. »
Il poursuit ses investigations aux Archives de Prague, et retrouve Věra, sa bonne d’enfant, avec les souvenirs de sa petite enfance, il poursuit ses remémorations dans une profusion de détails. Sa mère, Agáta, était actrice, et « chanteuse d’opéra et d’opérette », juive dans l’avant-guerre…
« Ta mère Agáta, ainsi commença-t-elle, je crois, dit Austerlitz, en dépit de sa manière taciturne et quelque peu mélancolique, était une femme qui avait tout à fait confiance en la vie et se montrait parfois insoucieuse. […]
Néanmoins, dit Věra, poursuivit Austerlitz, Maximilian ne croyait en aucune façon que le peuple allemand avait été mené à sa perte ; bien plus, selon lui, partant des aspirations individuelles et de l’état d’esprit régnant dans les familles, il s’était lui-même radicalement refondé en se coulant dans ce moule pervers ; et il avait ensuite engendré ces dignitaires nazis que Maximilian tenait tous pour des bons à rien et des têtes brûlées, pour servir de porte-parole symboliques aux instincts profonds qui l’agitait. […]
Maximilian lui avait expliqué, dit Věra, que dans cette foule qui ne faisait plus qu’un seul être agité d’étranges convulsions et soubresauts, il s’était senti comme un corps étranger qui allait incessamment être broyé et expulsé. »
Quels bels emboîtements en cascade pour un cataclysme en marche avec tout un peuple ! Litanie scandée par l’indication des deux narrateurs, et passage superbe à propos de l’écho dans « le matériau de ces innombrables corps immobiles » du message « messianique » nazi.
Sur les traces de sa mère déportée, Austerlitz visite Terezín avec son bazar, sa forteresse et son musée du ghetto.
« Il ne me semble pas que nous connaissions les règles qui président au retour du passé, mais j’ai de plus en plus l’impression que le temps n’existe absolument pas, qu’au contraire il n’y a que des espaces imbriqués les uns dans les autres selon les lois d’une stéréométrie supérieure, que les vivants et les morts au gré de leur humeur peuvent passer de l’un à l’autre, et plus j’y réfléchis, plus il me semble que nous qui sommes encore en vie, nous sommes aux yeux des morts des êtres irréels, qui parfois seulement deviennent visibles, sous un éclairage particulier et à la faveur de conditions atmosphériques bien précises. »
Dans la foulée, il relate son séjour à Marienbad avec Marie de Verneuil (une Française dont il est proche), dans un étrange ressenti de désarroi et de discordance dû à sa résistance au retour de sa mémoire. Il reconnaît sourdement la gare Wilson d’où il partit pour Londres, envoyé par ses parents avec son petit sac à dos. La pérégrination dans l’espace et le temps continue avec Nuremberg, puis le camp de Theresienstadt. Dans ce dernier, les Allemands ont reconstitué une fallacieuse vitrine bienséante du ghetto afin de leurrer une commission d’inspection, aussi sinistre que cynique mascarade filmée « soit à des fins de propagande, soit pour légitimer à leurs yeux toute cette entreprise » : Le Führer offre une ville aux Juifs.
Ensuite Austerlitz cherche trace de son père, Maximilian, disparu à Paris.
« Ce genre d’intuitions me viennent immanquablement en des lieux qui appartiennent davantage au passé qu’au présent. Par exemple, lors de mes pérégrinations en ville, je jette quelque part un coup d’œil dans l’une de ces cours intérieures où rien n’a changé depuis des décennies, et je sens, physiquement presque, le cours du temps se ralentir dès qu’il entre dans le champ de gravitation des choses oubliées. Tous les moments de notre vie me semblent alors réunis en un seul espace, comme si les événements à venir existaient déjà et attendaient seulement que nous nous y retrouvions enfin, de même que, une fois que nous répondons à une invitation, nous nous retrouvons à l’heure dite dans la maison où nous devions nous rendre. Et ne serait-il pas pensable, poursuivit Austerlitz, que nous ayons aussi des rendez-vous dans le passé, dans ce qui a été et qui est déjà en grande part effacé, et que nous allions retrouver des lieux et des personnes qui, au-delà du temps d’une certaine manière, gardent un lien avec nous ? »
Pertes de connaissance ; lectures à la Bibliothèque nationale (l’ancienne puis la nouvelle).
« …] et j’en suis arrivé à la conclusion que dans chacun des projets élaborés et développés par nous, la taille et le degré de complexité des systèmes d’information et de contrôle qu’on y adjoint sont les facteurs décisifs, et qu’en conséquence la perfection exhaustive et absolue du concept peut tout à fait aller, et même, pour finir, va nécessairement de pair avec un dysfonctionnement chronique et une fragilité inhérente. »
Enfin, la gare d’Austerlitz…
Je suis heureux d’avoir reporté jusqu'ici la lecture de cet admirable roman (quoique l’on ait peu l’impression qu’il s’agisse d’un roman), m’y préparant avec la lecture d’autres œuvres de Sebald. Le parti pris des descriptions, digressions, énumérations, signale suffisamment que l’essentiel dans ce livre n’est pas l’histoire d’Austerlitz, ni l’Histoire, mais plutôt les impressions et coïncidences spatiotemporelles de l'existence.
\Mots-clés : #devoirdememoire #historique #identite
- le Lun 28 Nov - 12:10
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: W.G. Sebald
- Réponses: 74
- Vues: 8384
Hubert Haddad
L'Univers
Ce roman-dictionnaire est agencé en une suite d’entrées :
« ALPHABET ¶ Mon avenir dépend de l’agencement de vingt-six lettres. Ce dictionnaire mélancolique ne sera peut-être qu’un lexique du néant, un petit glossaire des gouffres, mais j’aurai tenté les retrouvailles d’un monde perdu de la seule façon concevable pour moi qui n’ai plus ni centre ni parties. Ce que j’appréhende : un mélange obtus de concepts et d’images. Se repérer là-dedans. Un mot me renverra à un autre ; les choses se lieront objectivement, selon l’ordre alphabétique qui me permettra, malgré les lésions ou l’égarement, de revenir à ce savoir. Ce cahier sera donc une sorte de conquête du dedans par le dehors. J’arracherai de cette confusion une figure peu à peu, les contours d’une figure ; et j’accoucherai enfin de moi-même. Oui, je serai mon propre Pygmalion. »
On découvre progressivement un narrateur, marin venu d’un archipel du Pacifique qui essaie de « mettre de la cohérence dans ses souvenirs », dans une « réalité multiple, éclatée », foisonnante de mythologie et de symbolique, d’astrophysique et de cosmogonie ; la quête de son identité, « tentative désespérée d’autobiographie », prend la forme de notes reprises lors de chacune de ses périodes de « cohérence mnésique d’un quart d’heure à vingt minutes ». Cette clause préliminaire d’une mémoire intermittente par phases de durée si réduite met à rude épreuve la crédulité consentie du lecteur, car il serait difficile de parcourir un tel texte dans ce laps de temps… mais admettons le processus du recueil de réminiscences associé aux termes listés dans un répertoire d’articles.
« La plus profonde blessure est celle qui touche à la mémoire. »
À noter aussi que la mise en ordre de ces fractions de temps et d’espace ne respecte évidemment pas l’ordre chronologique, puisqu’il s’agit de retrouver le fil des causalités : la lecture fera donc des allers-retours aléatoires dans le temps – a priori...
Dans ce « travail » émergent tour à tour et dans le désordre l’Altmühl et le château ruiné de Banhiul en Bavière, Esther, qui se révèle être sa mère, israélite d’origine polonaise échappée aux camps de concentration grâce à un officier allemand, le baron von Dunguen, qui la confie à son cousin Balthus, un vieux prêtre (beau personnage que celui qui l’initie à l’astronomie avant de devenir aveugle, respectant sa religion en doutant peut-être de la sienne après l’Holocauste, au sortir de l’hypnose collective) et Lockie Dor sa belle gouvernante sourde. Réapparaissent fréquemment d’autres lieux et personnes, comme la tour de l’îlot d’Aigremore, ancien phare aménagé en observatoire météorologique, sa liaison avec la contorsionniste Anémone Duprez (« la femme-caméléon »), ses condisciples Haseinklein (« L’ange au bec-de-lièvre », « fils de héros nazi » métaphysicien, qui massacre Virginie Coulpe), et De Harciny lors d’études à Nuremberg et Bruxelles (ainsi que le mélomane Flotille, « l’exobiologiste aux bretelles d’or »), son service sur l’aviso allemand désarmé Nichtberg (avec son aspirant, Ulghanf, adepte de « suggestologie »), le vieux cargo mixte Roll-Tanger et la goélette Aglaé – aussi une prostituée aimée, qui lui donne la photo de l’archipel ; ce dernier, avec l’Abora son menaçant volcan, les requins bleus du lagon, « les Blancs de l’île-mère et les indigènes des îles boisées », son compagnon Lami le radioastronome et son chien Hubble, « un nègre-pie » sculpteur d’arbres dans sa forêt totémique, le contrebandier Jacob, petit-fils bossu d’un bagnard chevauchant Maître Aliboran l’âne, Angor, pirate capitaine de l’Argus, Mahalia la sauvageonne qu’il a recueilli et devenue son amante, Requiem, Asiate borgne devin et conseiller du gouverneur, l’arbitraire paranoïaque Rubi O.Sessé, un despote caricatural – on n’en est qu’au cinquième du livre, et toujours s’étoffera et se précisera l’univers du narrateur.
« Le bossu était en somme un camelot des mers, vague regrattier des songes, plus pourvoyeur que messager, Mercure aux ailerons ossifiés sur l’épaule. »
Autres récurrences significatives, l’oubli, le somnambulisme, la recherche d’un contact extraterrestre, l’Allemagne vaincue près la Seconde Guerre mondiale, des statues (notamment tombées du ciel), la vodka verte, la relation entre expansion/inflation/dispersion et gravitation/attraction/accrétion dans le cosmos, assujétissements et liberté, dualité et unité, la Vénus d’Arcturus (une mystérieuse constellation intime), le professeur Rubio Zwitter, qui traite son « amnaphasmie », syndrome rare d’"amnésie fantôme", « hypermnésie spasmodique », « de type écliptique ».
La structure fragmentaire ne permet qu’une lecture discontinue, mais une certaine continuité est souvent perceptible d’une bribe à l’autre, traçant un récit narratif qui reconstitue peu à peu la mémoire éparpillée du sujet, à la recherche de son identité et du nom de celle qu’il aime.
Le séquençage en courts paragraphes à la fois déroute le lecteur et facilite sa lecture.
Cahier de notes éparses qui sont parfois des épisodes d’aventure vécues (quelquefois reprises plus loin), de brefs contes, des esquisses narratives laissées ouvertes, des notations scientifiques (principalement de mécaniques céleste et quantique), des anecdotes historiques, des réflexions philosophico-métaphysiques, des hypothèses métaphoriques qui interrogent la réalité, elles émaillent le développement de l’histoire, elle-même confondue à sa conception, à la fois genèse cosmique et littéraire, création totalisante de l’univers et du livre.
« Le philtre de Tristan et Yseult dure-t-il par-delà la vie ? Une idée absurde me vient : écrire un livre pour ramener au monde l’être perdu, pour le ramener réellement. Un livre, en somme, pour inventer la réalité. Tout en lui devrait avoir l’étoffe inimitable des sensations. À vrai dire, il serait cette étoffe même à force d’intensité et de style. »
« Quelqu’un m’a soutenu une théorie affolante, équations à l’appui, qui tendrait à prouver que l’observation est créatrice de son objet, que l’atome n’existait pas avant qu’on l’imaginât. Et donc que l’univers ne serait que la mesure approximative des facultés humaines les plus abouties. Il se disait persuadé qu’on trouvera inévitablement ce qui est recherché avec assez de pugnacité intellectuelle. La particule inversant d’une nanoseconde la flèche du temps, par exemple. »
(Dans l’article ATOME ¶, cette « théorie » semble inspirée du principe d’incertitude de Heisenberg.)
« ATTENTE ¶ Il n’y a pas d’autre nom à notre perception du temps ; c’est la durée qui prend conscience d’elle-même. »
« AUTOSCOPIE ¶ Les psychiatres parlent d’hallucination spéculaire. En grec, scopias n’est que l’action d’observer, de s’auto-observer. Il est normal qu’on finisse par se dédoubler, par se considérer soi-même du point de vue du spectateur sur la scène simplifiée du regard. […] C’est notre condition que de tout dédoubler ; la culture, le langage humain, ne sont que l’exercice varié du double. »
« COPIE ¶ Comment s’expliquer la simultanéité non causale à distance dans la physique quantique ? Et dans la vie amoureuse ? Nous vivons peut-être dans la duplication en tout lieu, entourés d’une procession inépuisable de doubles. Dans ma solitude existe ici et là une copie intempestive de moi-même qui poursuivrait ma chimère, l’entretien d’un amour absolu que j’ignore ou qui échappe aujourd’hui à ma conscience, à ma vigilance trahie. »
« DEUX ¶ L’unité perdue, adverbe qui veut dire deux. Perdre serait se dédoubler. »
(La notion d’alter ego parcoure tout le livre ; le narrateur aurait-il eu un frère jumeau ? Lami serait-il lui-même ?)
« Le temps ne serait que la pensée des distances, la vitesse de la lumière. »
« Mon idée, peut-être indéfendable aujourd’hui, avance la simultanéité foudroyante de tous les moments et de tous les lieux d’une vie en regard d’un point tangentiel absolu situé à l’origine comme à la fin de toutes choses. Cette disparité, ce côté hoquetant et hasardeux des événements et des états de conscience dans le ressac de la mémoire, ne prouvent que notre infirmité de créature. »
« ÉVÉNEMENT ¶ Tout arrive, tout se produit, tout est événement, l’univers lui-même dans sa totalité. Mais tout, sur un autre plan, est aussi répétition. La femme que j’embrasse pour la première fois, même si je la perds aussitôt, m’enchaîne éternellement à elle. »
« HABITUDE ¶ La plupart des gens vivent cette aliénation quasi hypnotique des habitudes, à la fin système végétatif coextensif à la vie même, pathologie de la mémoire qui se sclérose en manies inconscientes. L’étymologie parle de manière d’être, d’habitus. Hormis mon goût pour la vodka, aujourd’hui brimé, je n’ai cessé de rompre avec l’automate, de rejeter l’espèce de mithridatisation de la nouveauté et du désir qui endort chacun dans la fadeur, sous les mauvais plis du quotidien. »
« HUMEUR ¶ On s’est tous dit un jour que l’univers n’était peut-être qu’une goutte de salive aux babines d’un chat, une dernière goutte de sang tombant de la tempe d’un suicidé, l’infinitésimale sécrétion d’une glande endocrine à l’origine des seins naissants d’une femelle sapajou, le tourbillon de plasma dans le conduit de l’urètre à la seconde précédant l’éjaculat d’un puceron. La géométrie n’est qu’une migraine d’insecte dans son espace mécanique. »
« HYPNOSE ¶ L’inhibition partielle du cortex qui conduit à l’hypnose – quand l’esprit se fixe sur un seul point, dans la méditation instrumentale par exemple, ou par les manœuvres d’un inhibiteur bien ou mal intentionné –, nous admettons sans mal qu’elle participe de la psychologie ordinaire. Quiconque veut persuader use de techniques d’hypnose, jeux des mains et du regard, focalisations de l’attention, usage sédatif de la répétition. Tous les hommes politiques, a fortiori les dictateurs, associent les artifices de la démagogie à la séduction hypnotique. Nous avons tous été plus ou moins victimes d’un lavage de cerveau organisé à travers les trois phases de toute éducation : un long isolement psychologique conduisant à la perte de personnalité, l’interrogatoire intensif provoquant la confusion et l’angoisse en même temps qu’un état de suggestibilité aigu, puis enfin la conversion aux valeurs de l’ennemi par le moyen d’une confession tous azimuts qui pousse le sujet à se soumettre corps et âme à ses tourmenteurs pour obtenir le pardon et accéder à la rédemption communautaire. En Allemagne, préparé par l’hygiénisme scout, l’esprit de revanche et le naturisme wagnérien, c’est tout un peuple qui aura subi la double contrainte de l’hypnose et du contrôle de la pensée. À la fin de la guerre, des millions d’Allemands en état de choc, abandonnés à leur inhibition, auront régressé dans l’angélisme ou la névrose obsessionnelle. »
« On sait que les champs électromagnétique et gravitationnel ne sont que deux états transitoires de l’univers, lesquels permettent la perception humaine. Si l’atome (la matière donc) n’existe qu’au moment où il change, tout le réel se profile sur les instants de changement, le monde sensible n’est qu’un froissement de l’éphémère sur fond de néant. »
« PHÉNIX ¶ L’univers parvenu à un seuil d’expansion tel que la désintégration de la matière devient désintégration de l’espace-temps : le champ euclidien existe-t-il encore sans ces repères gravitationnels que sont le point et le centre ? Mais l’univers crée sa forme. L’annihilation de la masse équivaut à la disparition hors l’espace-temps. Disparu hors de lui-même, tout recommence. Tout recommence à l’instant de désintégration car l’absence d’espace recrée à tout instant le point zéro. Pourquoi, alors qu’on admet le concept magique d’inflation, voudrait-on que le Big Bang, pour se répéter, ait besoin de récupérer l’univers comme masse ? Toute matière naît d’un déséquilibre quantique et non d’une quantité au sens classique. L’éternel retour ne se négocie avec aucun dieu, ni aucune causalité. Tout renaîtra, tout ne cesse de renaître. Et l’instant n’est autre que les mille recommencements surimposés de l’univers à cet instant de ma conscience : une statue éternelle et instantanée à laquelle une infinité d’autres succéderont dans toutes les poses imaginables. »
« TECHNIQUE ¶ L’intelligence automatisée de la technique, vraie pensée d’esclave, a depuis longtemps perdu l’innocence de l’instrument. Un moyen n’est jamais gratuit puisqu’il résulte d’une intention. Il m’a toujours semblé que la science aurait pu emprunter d’autres directions, dissemblables, si notre morphologie, nos sens et nos désirs eussent été autres, qu’elle obéit à des tropismes inconscients afin de rejoindre et de magnifier, en comblant la distance entre rêve et réalité, l’imaginaire humain spécifique. Il m’arrive de penser que la téléphonie sans fil est venue dédouaner un phénomène occulte comme la télépathie par une sorte de fatalité. La technique nous sauve in extremis de l’irrationnel. À la fin, on pourrait créer Dieu, le bricoler plutôt, aboutir aux preuves objectives de son existence. Au fur et à mesure de sa progression, la technique invente le monde. Elle devient l’invention du monde (qu’elle remplacera sans doute un jour dans l’exil virtuel définitif). L’au-delà du quark et la valeur du spin, moment angulaire interne de la particule, voire de l’incertain graviton, surgissent comme par miracle à la croisée de la théorie et de la sophistication de l’instrument. Avec une conviction entière et des moyens adéquats, l’homme pourrait créer l’objet de son désir. Le rêve n’est qu’une étape. »
« THÉORIE ¶ Complice avec l’étymologie, voici un spectacle qu’on se donne. Plus les sciences exactes perdent pied, plus la théorie prospère. On pourrait même imaginer un nouveau genre qui concernerait scientifiques, philosophes, romanciers et schizophrènes : la théorie-fiction. »
« TRIBUNAL ¶ Je n’eus pas droit à un vrai jugement. Le Coroner après son enquête me livra à une sorte de greffier d’assises d’une corpulence éléphantesque qui semblait avoir dévoré jurés et magistrats avec tous les dossiers d’instruction. Deux gardes civils me poussèrent jusqu’à la prison. Aux pires heures de l’Inquisition, même les rats et les insectes avaient droit à un procès avec écritures, avocats et comparution de témoins. Pour convaincre les animaux nuisibles de collusion avec Satan, les tribunaux civils ou sacerdotaux multipliaient les audiences. Le juge Barthélemy de Chasseneuz, en Bourgogne, rédigea l’ordre d’accusation contre les hurebers, sauterelles venues de l’Inde qui dévastaient les vignes, et leur intima l’ordre de comparaître. Le vin étant un don de Dieu, les sauterelles péchaient contre lui. Et preuve que la loi primait l’arbitraire, une contestation de l’application du droit canon par le tribunal séculier entraîna des échanges d’arguties pendant des semaines. Un verdict de bannissement à l’encontre des sauterelles sera pour finir lu dans les vignobles par les juges en grande tenue. On connaît aussi maints procès de chenilles, sangsues, escargots, porcs, hannetons, lapins de garenne avec assignation officielle et protection de corps pendant le difficile trajet des campagnes à la ville où se tiennent les tribunaux. À Mayence, la défense parvint à faire relaxer les mouches comme mineures au moment des faits incriminés. On leur accorda un droit de séjour limité. Au Brésil, les fourmis d’un couvent franciscain furent accusées de vol caractérisé et jugées selon l’esprit de saint François : nos sœurs les fourmis furent convaincues de quitter le couvent. »
« Pour moi l’univers est fermé comme une bétonnière qui tournerait à vide. »
« Sigmund Freud avait tout motif de remplacer impitoyablement le mot amour par celui de transfert et de considérer la pensée comme un substitut hallucinatoire du désir. »
« VAGUE ¶ Dans quelle trappe suis-je tombé ? Rien ne m’occupe aujourd’hui que le mouvement des vagues. Cet ondoiement léger porte un liseré d’écume sur la grève. J’y vois comme une écriture renouvelée, ligne après ligne, d’un gris tremblé le long des côtes. »
À la moitié du livre, la belle Azralone répond trente-huit ans plus tard à son souhait d’enfant (un appel intersidéral à partir d’un poste à galène), foudroyante prise de contact avec Arcturus à trente-huit ans années-lumière ; au cours de ses observations astrales, il découvre la planète Katléïa, et prend place le personnage d’Adolf Manthauneim l’idiot du village fasciné par le nazisme, homme à tout faire et prodige de calcul mental. Au trois-quarts du livre, le narrateur est emprisonné à la maison d’arrêt d’Orlon (sur l’île Savante, où le bagne initial devint léproserie avant d’être la prison de l’archipel), accusé par le Coroner du meurtre de Lami dans la nuit de la Sainte-Ambroisie ; il va être pendu par le bourreau, M. Pantoire.
Ce texte est certes long – mais qui pourrait certifier que telle partie éventuellement "retranchable" n’y a pas sa place ? Et l’énigme n’en est que plus intrigante… J’ai tenté sans succès de faire un rapprochement (parmi beaucoup d’autres possibilités) entre le monde stellaire et le microcosme de l’archipel… un absorbant casse-tête !
Une pertinente mise en abyme : le narrateur enfant qui recompose le grand miroir brisé peu après la mort de sa mère…
« Tout devint puzzle bousculé pour moi, images d’images, mondes débâtis. Et c’est mon esprit qui s’étale aujourd’hui en morceaux. Saurai-je jamais en rapprocher l’unité et la forme ? »
J’ai particulièrement apprécié l’exploitation imaginative des récentes découvertes scientifiques, sources d’émerveillements dont il est trop rarement tiré parti en littérature ; c’est particulièrement vrai de la physique quantique, si difficile à se figurer.
Dictionnaire (ou encyclopédie) d’une vie, mémoire recomposée, constituée comme un puzzle par Haddad, qui ne perd jamais le fil conducteur dans les digressions qui n’en sont guère, jouant de registres allant du poétique à l’épique en passant par l’érotique, c’est une véritable « vision totale du monde » (Weltanschauung).
D’une lecture passionnante, ce fabuleux roman m’a ramentu (par moments et pour des motifs différents) certaines structures issues de l’OULIPO, Là où les tigres sont chez eux de Blas de Roblès ou même L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, aussi Marelle de Cortázar, Locus Solus de Raymond Roussel ainsi que les œuvres de Novalis et de Tournier, également les errances et naufrages d’Ulysse.
J’ai déjà lu Haddad dans Perdus dans un profond sommeil, lorsqu’en son temps je me suis intéressé au courant de la Nouvelle Fiction, découvrant ainsi Frédérick Tristan avec Les Égarés, La Cendre et la Foudre, Le fils de Babel, Le singe égal du ciel, Un monde comme ça, L’Énigme du Vatican), le sinologue Jean Levi avec Le coup du Hibou (sur les aspects du pouvoir), Georges-Olivier Châteaureynaud (Newton go home! et Au fond du paradis) et François Coupry (Le Rire du pharaon) ; il y a de nombreuses pépites dans ce courant (méconnu ?) qui fait la part belle à l’imaginaire en interrogeant son rapport au réel : il me faut l’exploiter davantage !
\Mots-clés : #aventure #contemythe #fantastique #identite
- le Sam 12 Nov - 12:33
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 20
- Vues: 917
Annie Ernaux
Les armoires vides
Denise, « Ninise » Lesur, jeune étudiante, subit un avortement clandestin, et évoque son enfance. Une enfance dans un milieu méprisé (a posteriori), en fait assez heureux (parents faisant « tout » pour elle, chère abondante – c’est l’après-guerre), modeste mais relativement privilégié (commerçants) : la misère est en réalité autour (avec notamment l’alcoolisme), même si on baigne dedans (d’autant plus avec la promiscuité).
« Malheurs lointains qui ne m'arriveront jamais parce qu'il y a des gens qui sont faits pour, à qui il vient des maladies, qui achètent pour cinquante francs de pâté seulement, et ma mère en retire, elle a forcé, des vieux qui ont, a, b, c, d, la chandelle au bout du nez en hiver et des croquenots mal fermés. Ce n'est pas leur faute. La nôtre non plus. C'est comme ça, j'étais heureuse. »
Puis l’autre monde, celui de l’école (libre) ; humiliation sociale, et culpabilité (le péché) insinuée par l’aumônier à la « vicieuse » avec son « quat'sous » (son sexe, avec connotation de peu de valeur) ; puis revanche de première de la classe. Et la lecture.
« Ces mots me fascinent, je veux les attraper, les mettre sur moi, dans mon écriture. Je me les appropriais et en même temps, c'était comme si je m'appropriais toutes les choses dont parlaient les livres. Mes rédactions inventaient une Denise Lesur qui voyageait dans toute la France – je n'avais pas été plus loin que Rouen et Le Havre –, qui portait des robes d'organdi, des gants de filoselle, des écharpes mousseuses, parce que j'avais lu tous ces mots. Ce n'était plus pour fermer la gueule des filles que je racontais ces histoires, c'était pour vivre dans un monde plus beau, plus pur, plus riche que le mien. Tout entier en mots. Je les aime les mots des livres, je les apprends tous. »
« Pour moi, l'auteur n'existait pas, il ne faisait que transcrire la vie de personnages réels. J'avais la tête remplie d'une foule de gens libres, riches et heureux ou bien d'une misère noire, superbe, pas de parents, des haillons, des croûtes de pain, pas de milieu. Le rêve, être une autre fille. »
Rejet du moche, du sale, du café-épicerie de la rue Clopart, honte haineuse d’une inculture (pourtant compréhensible), envie aussi de la vie des autres jeunes, de la liberté : l’adolescente veut "s’en sortir".
Premières menstrues, « chasse aux garçons », découverte du plaisir ; avec quand même la crainte confuse de mal tourner, comme redoutent les parents (qui triment pour lui permettre de poursuivre ses études).
« Dans l'ordre, si tout y avait été, une maison accueillante, de la propreté, si je m'étais plu avec eux, chez eux, oui, ce serait peut-être rentré dans l'ordre. »
Dix-sept ans, l’Algérie et mai 68 en toile de fond, et ce besoin (à la fois légitime et choquant) d’être supérieur à sa condition d’origine.
« J'inscris des passages sur un petit carnet réservé, secret. Découvrir que je pense comme ces écrivains, que je sens comme eux, et voir en même temps que les propos de mes parents, c'est de la moralité de vendeuse à l'ardoise, des vieilles conneries séchées. »
« Mais la fête de l'esprit, pour moi, ce n'est pas de découvrir, c'est de sentir que je grimpe encore, que je suis supérieure aux autres, aux paumés, aux connasses des villas sur les hauteurs qui apprennent le cours et ne savent que le dégueuler. »
Étudiante enfin, puis c’est la « dé-fête », elle est enceinte, et avorte clandestinement.
« J'ai été coupée en deux, c'est ça, mes parents, ma famille d'ouvriers agricoles, de manœuvres, et l'école, les bouquins, les Bornin. Le cul entre deux chaises, ça pousse à la haine, il fallait bien choisir. »
Contrairement à ce qui est parfois prétendu, Ernaux a "un style".
« Ça me fait un peu peur, ça saignera, un petit fût de sang, lie bleue, c'est mon père qui purge les barriques et en sort de grandes peaux molles au bout de l'immense rince-bouteilles chevelu. Que je sois récurée de fond en comble, décrochée de tout ce qui m'empêche d'avancer, l'écrabouillage enfin. Malheureuse tout de même, qui est-il, qui est-il... Mou, infiniment mou et lisse. Pas de sang, une très fine brûlure, une saccade qui s'enfonce, ce cercle, ce cerceau d'enfant, ronds de plaisir, tout au fond... Traversée pour la première fois, écartelée entre les sièges de la bagnole. Le cerceau roule, s'élargit, trop tendu, trop sec. La mouillure enfin, à hurler de délivrance, et macérer doucement, crevée, du sang, de l'eau. »
« Le goût de viande crue m'imbibe, les têtes autour de moi se décomposent, tout ce que je vois se transforme en mangeaille, le palais de dame Tartine à l'envers, tout faisande, et moi je suis une poche d'eau de vaisselle, ça sort, ça brouille tout. Le restau en pleine canicule, les filles sont vertes, je mange des choses immondes et molles, mon triomphe est en train de tourner. Et je croyais qu'il s'agissait d'une crise de foie. Couchée sur mon lit, à la Cité, je m'enfilais de grands verres d'hépatoum tout miroitants, une mare sous des ombrages, à peine au bord des lèvres, ça se changeait en égout saumâtre. La bière se dénature, je rêve de saucisson moelleux, de fraises écarlates. Quand j'ai fini d'engloutir le cervelas à l'ail dont j'avais une envie douloureuse, l'eau sale remonte aussitôt, même pas trois secondes de plaisir. J'ai fini par faire un rapprochement avec les serviettes blanches. Une sorte d'empoisonnement. »
Et pour une écriture "blanche" (certes peu métaphorique), j’ai découvert plusieurs mots nouveaux pour moi : décarpillage, cocoler, polard, pouque et mucre (il est vrai cauchois), etc. ; curieusement (pourtant dans l’œuvre d’une écrivaine nobelisée !), je n’ai pas trouvé en ligne la définition de "creback", apparemment une pâtisserie, ni « troume » (peur vraisemblablement).
Dès ce premier roman, Ernaux parvient, avec l'originalité de son écriture, à nous transmettre une expérience commune. C'est peut-être ça qui explique l'oppression ressentie à cette lecture, comme signalée par Chrysta : Ernaux n'est pas une auteure d'évasion, c'est tout le contraire, on est sans cesse durement ramené à la triste réalité.
\Mots-clés : #autobiographie #conditionfeminine #contemporain #enfance #identite #intimiste #Jeunesse #Misère #relationenfantparent #sexualité #social #temoignage #xxesiecle
- le Ven 28 Oct - 11:23
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Annie Ernaux
- Réponses: 136
- Vues: 12206
Kateb Yacine
Nedjma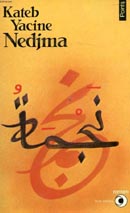
À Bône dans l’Est algérien, vers 1945, quatre journaliers, Mustapha, Mourad, Rachid et Lakhdar ; deux colons, Ernest le contremaître, blessé par Lakhdar qu’il molestait, et Ricard l’entrepreneur qui épouse Suzy, la fille du premier, avant d’être tué par Mourad. Puis le roman retourne dans le récent passé des quatre amis, ainsi que dans celui de l’auteur, destins tous reliés à Nedjma par un amour plus ou moins caché, puisqu’elle est mariée à Kamel.
Notations généralement brèves, « par bribes », roman polyphonique éclaté, violence, misère, injustice ; puis c’est l’exposé de l’épopée de Si Mokhtar et Rachid le déserteur, d’une voix plus intelligible.
« Mais la mère de Kamel ne m'avait pas tout dit ; elle ne m'avait pas dit que Si Mokhtar était aussi le rival de son défunt époux, rival à deux titres : pour lui avoir successivement ravi sa femme et sa maîtresse, et cela n'était pas le plus terrible pour Rachid, car qui avait pu tuer l'autre rival, le mort de la grotte, sinon le vieux bandit et séducteur, le vieux Si Mokhtar qui est à la fois le père de Kamel, celui de Nedjma, et aussi vraisemblablement l'assassin que le fils de la victime poursuit sans le savoir, car Rachid ne peut pas savoir ce que je sais, n'ayant pas connu la mère de Kamel qui me révéla d'autres choses encore... »
« Trois fois enlevée, la femme du notaire, séductrice de Sidi Ahmed, du puritain et de Si Mokhtar, devait disparaître une quatrième fois de la grotte où mon père fut retrouvé, raide et froid près du fusil, son propre fusil de chasse qui l'avait trahi comme avait dû le faire la Française enfuie avec Si Mokhtar... Trois fois enlevée, la proie facile de Si Mokhtar, père à peu près reconnu de Kamel et peut-être aussi de Nedjma, Nedjma la réplique de l'insatiable Française, trois fois enlevée, maintenant morte ou folle ou repentie, trois fois enlevée, la fugitive n'a d'autre châtiment que sa fille, car Nedjma n'est pas la fille de Lella Fatma... »
S’insère l’évocation de « l'ombre des pères, des juges, des guides », la tribu d’origine de l’ancêtre légendaire Keblout, massacrée par le conquérant français. Ce livre est aussi l’histoire, en filigrane, de la marche vers l’indépendance de l’Algérie sous le joug étranger.
« …] mais la conquête était un mal nécessaire, une greffe douloureuse apportant une promesse de progrès à l'arbre de la nation entamé par la hache ; comme les Turcs, les Romains et les Arabes, les Français ne pouvaient que s'enraciner, otages de la patrie en gestation dont ils se disputaient les faveurs [… »
« …] tu penses peut-être à l'Algérie toujours envahie, à son inextricable passé, car nous ne sommes pas une nation, pas encore, sache-le : nous ne sommes que des tribus décimées. Ce n'est pas revenir en arrière que d'honorer notre tribu, le seul lien qui nous reste pour nous réunir et nous retrouver, même si nous espérons mieux que cela… »
Lorsqu’apparaît Nedjma, le ton cède à un lyrisme poétique et enchanteur.
« Je contemplais les deux aisselles qui sont pour tout l'été noirceur perlée, vain secret de femme dangereusement découvert : et les seins de Nedjma, en leur ardente poussée, révolution de corps qui s'aiguise sous le soleil masculin, ses seins que rien ne dissimulait, devaient tout leur prestige aux pudiques mouvements des bras, découvrant sous l'épaule cet inextricable, ce rare espace d'herbe en feu dont la vue suffît à troubler, dont l'odeur toujours sublimée contient tout le philtre, tout le secret, toute Nedjma pour qui l'a respirée, pour qui ses bras se sont ouverts. »
Le récit se recentre sur Rachid à Constantine.
« Rachid n'avait pas voyagé durant son enfance ; il avait le voyage dans le sang, fils de nomade né en plein vertige, avec le sens de la liberté, de la hauteur contemplative [… »
« Non seulement Rachid n'avait jamais recherché l'assassin – « son père avait été tué d'un coup de fusil dans une grotte » – mais devenu l'ami d'un autre meurtrier, sombrant dans la débauche, ravalé au rang de manœuvre, puis de chômeur ne vivant plus que de chanvre, il était maintenant le maître du fondouk, le paria triomphant sur les lieux de sa déchéance. »
Évocation de Carthage, Hippone, Cirta (et de Nedjma, femme fatale, en Salammbô). Puis de la famille tribale, avec encore un changement de registre.
« …] nous nous sommes toujours mariés entre nous ; l'inceste est notre lien, notre principe de cohésion depuis l'exil du premier ancêtre [… »
Souvenirs d’enfances, puis de la manifestation réprimée dans le sang le 8 mai 1945 à Sétif.
Les quatre chômeurs sont réunis autour de Nedjma, puis rejoignent la situation du début du roman, lorsqu’ils se séparent.
Un livre complexe, qui réclame sans doute plusieurs lectures.
\Mots-clés : #criminalite #famille #identite #romanchoral #xxesiecle
- le Mar 25 Oct - 10:39
- Rechercher dans: Écrivains du Maghreb
- Sujet: Kateb Yacine
- Réponses: 6
- Vues: 3538
Alberto Manguel
Un retour
Néstor Andrés Fabris est un Argentin antiquaire à Rome qui, convié par son filleul (qu’il n’a jamais rencontré) à son mariage, retourne à Buenos Aires après trente années d’exil, ville qu’il a quittée suite à une manifestation estudiantine rudement réprimée, abandonnant ainsi Marta, la mère de son filleul. Il erre dans la ville, évoquant le passé, rencontrant des amis d’alors, dans une atmosphère déroutante, de plus en plus étrange, comme il retrouve de moins en moins son chemin. De nombreuses allusions à l’antiquité sont présentes dans le texte, comme avec le livre Le Passé, de Norberto Grossman, son ancien professeur qui, devenu conducteur d’un bus vide, le mène dans une visite du genre de celle d’Énée ou Dante aux enfers.
« C'est la raison pour laquelle, à mon sens, le passé n'est qu'une construction de la mémoire en quête de permanence, construction que nous prenons pour quelque chose d'immuable. »
Cette novella, ou même nouvelle, allie culture classique et fantastique aux thèmes de l’exil et de la culpabilité.
\Mots-clés : #culpabilité #exil #fantastique #identite #jeunesse #regimeautoritaire
- le Lun 3 Oct - 13:23
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Alberto Manguel
- Réponses: 53
- Vues: 4921
Eve Ensler
Le titre m’a fait peur, je me demandais pourquoi le vagin précisément, vu que ce qui est caché est notre sexe en sa totalité, voire plus spécifiquement le clitoris…
Mais elle explique dès le début pourquoi choisir ce mot : elle n’a pas trouvé mieux, « chatte » implique trop de choses, « vulve » est encore plus spécifique … Donc par « vagin », il faut entendre le sexe de la femme dans son ensemble.
Ces monologues m’ont énormément fait penser à Au de-là de la pénétration de Martin Page, où l’on retrouve de nombreux témoignages de femmes concernant leurs sexualités. Peut être s’en est-il inspiré ?
On y retrouve des témoignages poignants :
A 72 ans, elle avait commencé une thérapie, et sur les conseils de son psy, un jour, elle était rentrée chez elle, avait allumé des bougies, s’était fait couler un bain, avait mis une musique d’ambiance et était partie à la découverte de son vagin. Elle m’a dit que ça lui avait pris plus d’une heure, parce qu’elle avait de l’arthrose, mais que quand enfin elle avait trouvé son clitoris, elle s’était mise à pleurer.
Se dire qu’une femme, qui a eu des rapports sexuels, des enfants, n’a jamais connu l’orgasme alors qu’elle possède un organe prévu juste pour ça.. Ca me révolte et me bouleverse, le manque d’information, d’études, d’éducation sur ce sujet est tellement énorme…
Il y a également des témoignages remplis de poésie, de beauté, de liberté, de femmes qui s’émancipent, sortent de la norme et des doctrines, qui s’envolent loin au dessus de tout ça, j’aime beaucoup ceux ci :
Il = mon vagin a écrit:Il veut voyager. Il n’a pas envie de voir trop de monde. Il veut lire, connaître des choses, sortir davantage. Il veut faire l’amour. Il adore faire l’amour. Il veut aller au bout des choses. Il a soif de profondeur. Il veut faire des fouilles archéologiques, remonter aux sources. Il veut de la tendresse. Il veut du changement. Du silence et de la liberté et des baisers doux et des humidités chaudes et des caresses voluptueuses. Il veut du chocolat, être en confiance et de la beauté. Il veut hurler. Mais il ne veut plus être en colère. Il veut jouir. Il veut vouloir. Il veut … Mon vagin… Mon vagin … C’est bien simple… il veut tout.
Réponse d'une enfant de six ans :
« Ton vagin il sent quoi ?
_Les flocons de neige »
Des faits surprenants également (apparemment c’est toujours d’actualité ! )
Le vente des vibromasseurs est interdite par la loi dans les Etats suivants : Texas, Géorgie, Ohio et Arkansas. Si vous vous faites prendre, vous risquez une amende de 10 000 dollars et un an de travaux forcés. En revanche, dans ces mêmes Etats, la vente des armes est parfaitement légale. Et pourtant, on n’a jamais vu un massacre collectif causé par un vibromasseur.
Avec ces témoignages, on découvre ce que les femmes subissent encore, actuellement, au niveau de leurs corps, de leurs sexualités, de leurs libertés… Même si ce livre date de 1996, il est malheureusement toujours d’actualité.
\Mots-clés : #identite #identitesexuelle #sexualité
- le Dim 29 Mai - 19:51
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Eve Ensler
- Réponses: 6
- Vues: 295
John Maxwell Coetzee
Vers l'âge d'homme
Second (2003) des trois récits révisés et réunis dans Une vie de province, entre Scènes de la vie d’un jeune garçon (1999) et L’Été de la vie (2010) ; j’ai déjà lu dans sa première version le premier volume de ce qui considéré comme une autobiographie écrite à la troisième personne.
Citation liminaire de Goethe, qu’on peut je pense traduire par « « Celui qui veut comprendre le poète doit aller dans le pays du poète » :
« Wer den Dichter will verstehen,
muß in Dichters Lande gehen. »
Le personnage principal, John, est étudiant (en mathématiques) en Afrique du Sud, et a la conviction d’être un poète en devenir, un élu du « feu sacré », sur la voie du « travail de transmutation de l’expérience vécue en art ».
« Car il sera un artiste, c’est chose arrêtée de longue date. »
Émigré à Londres (il est programmeur, d’abord chez IBM), il y subit l’Angst (angoisse existentielle).
« En fait, pour rien au monde il n’entreprendrait une psychothérapie. L’objectif de la psychothérapie est de rendre heureux. À quoi bon ? Les gens heureux ne sont pas intéressants. Mieux vaut porter le fardeau du malheur et essayer d’en faire quelque chose de valable, de la poésie, de la musique ou de la peinture : c’est là sa conviction. »
« Le malheur est son élément. Il est dans le malheur comme un poisson dans l’eau. Si le malheur venait à être aboli, il ne saurait pas quoi faire de lui-même. »
Il a des relations peu satisfaisantes avec les femmes, et le regrette.
« L’art ne vit pas seulement de privation, de désir insatisfait, de solitude. Il lui faut de l’intimité, de la passion, de l’amour. »
« Le sexe et la créativité vont de pair, tout le monde le dit, et il ne met pas cela en doute. »
« Est-ce que c’est ça que veulent les femmes : être prises en charge, être menées ? Est-ce pour cela que les danseurs observent le code selon lequel l’homme conduit et la femme se laisse conduire ? »
« Comment aurait-elle pu croire que ce qu’elle lisait dans son journal n’était pas la vérité, l’ignoble vérité sur ce qui passait par la tête de son compagnon lors de ces soirées de silence pesant et de soupirs, mais que c’était de la fiction, une fiction possible parmi bien d’autres, qui n’est vraie qu’au sens où une œuvre d’art est vraie – vraie en soi, vraie et fidèle au but qu’elle poursuit par elle-même –, alors que ce qu’elle lisait d’ignoble était si conforme à ce qu’elle soupçonnait : son compagnon ne l’aimait pas, il n’avait pas même pour elle de l’affection ? »
Il rêve de passion, mais…
« Il dort mieux tout seul. »
Curiosité exotique :
« À son avis, ceux qui conduisent en état d’ébriété devraient être doublement pénalisés au lieu de bénéficier de circonstances atténuantes. Mais en Afrique du Sud tous les excès commis sous l’influence de l’alcool sont considérés avec indulgence. »
C’est écrit dans un style plat, détaché, où affleure à peine l’autodérision d’un idéaliste assez effacé et maladroit, aux idées préconçues (mais qui a cependant directement travaillé dans la course informatique américano-anglo-russe sur l’ordinateur prototype de Cambridge).
Vaut surtout pour les amateurs de Coetzee − et d’éventuels rapprochements avec son propre vécu !
\Mots-clés : #ecriture #identite #jeunesse
- le Dim 15 Mai - 14:54
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: John Maxwell Coetzee
- Réponses: 42
- Vues: 6303
Daniel Mendelsohn
L’Étreinte fugitive
En complément au commentaire de Topocl, qui présente bien le livre.
Un long développement sur l’identité gay, et notamment Narcisse à son miroir, le désir des corps de garçons et statues grecques, la répétition ludique à l’identique, vanité, multiplicité et plaisir sexuel.
« …] à chercher le visage qui hante votre imagination, flottant au loin, au bord des choses, le visage de la beauté et de l’impossibilité, celui dont vous savez que vous ne pouvez pas tout à fait l’avoir, à l’instant même où vous cherchez à l’atteindre, traversant les corps qui vont avec les visages, retombant sur vous-même encore et encore. »
Puis une famille « étrange et compliquée », un père et une mère fort différents et hauts en couleur, de même les grands-parents et la grand-tante Rachel, « la jeune épouse de la mort », décédée une semaine avant son mariage forcé et décisif pour la lignée (récit rapproché d’Antigone, la pièce de Sophocle) – et bien sûr la judaïté, et la tragédie, l’Histoire et le mythe, la beauté et la perte.
Encore l’étonnant parrainage d’un bébé fasciné par la lune (mis en parallèle avec Ion, la pièce d’Euripide « où il est question d’un garçon qui a deux pères »).
« C’est précisément au cours de la difficile rédaction de L’Étreinte fugitive que m’est venue l’idée de cette technique, qui fait depuis lors la marque de fabrique de mon style d’autofiction : l’entrelacement de la narration personnelle et du commentaire de textes anciens. »
C’est captivant, bien écrit, et bien construit ; ça ne m’a pas paru confus, car on distingue clairement l’un de l’autre les fils entrelacés pour entrer en résonnance entr’eux.
\Mots-clés : #autofiction #contemythe #identite
- le Lun 9 Mai - 13:23
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Daniel Mendelsohn
- Réponses: 56
- Vues: 5211
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages

