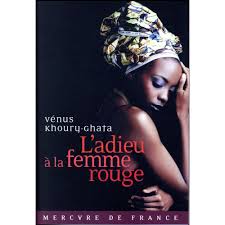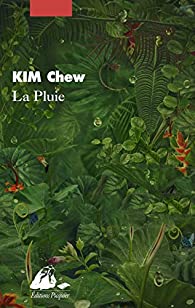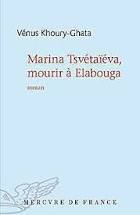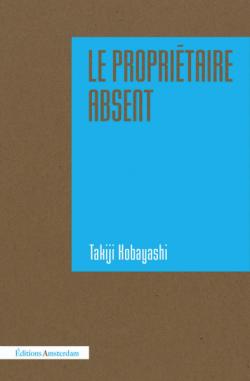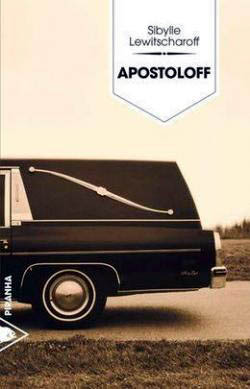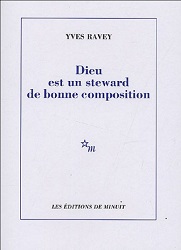La date/heure actuelle est Ven 19 Avr - 17:24
96 résultats trouvés pour immigration
Nicolas Mathieu
Leurs enfants après eux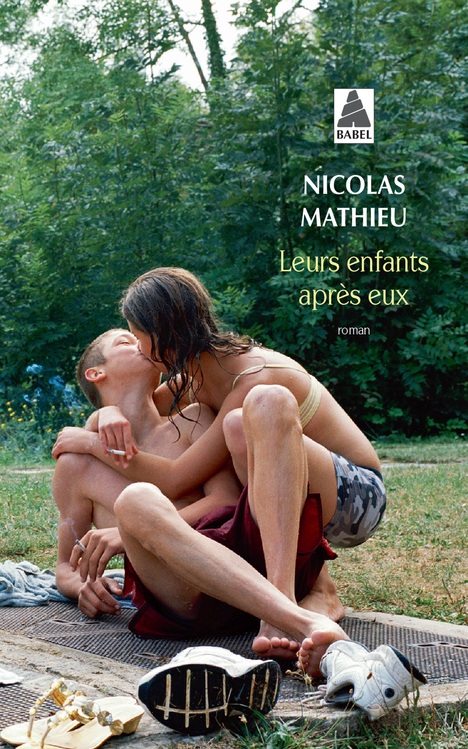
Lecture d'abord assez ennuyeuse, congrue à son sujet (donc c’est plutôt positif comme constat). C’est minable, les gens, les choses, l’époque : industrialisation puis désindustrialisation, et ce que ça donne socialement ; l’enfance, l’adolescence : c’est pas Bosco, pas celle dont curieusement les adultes disent se souvenir, mais la vraie, ce vaste ennui des jeunes tordus par les hormones de croissance, et leurs parents avant eux. « Le plus beau cul d’Heillange », qui mène Hélène à son fils Anthony, le personnage principal (suivi de quatorze à vingt ans). Et c’est finalement un panorama français (daté d’un quart de siècle), qui ne peut être réjouissant.
« Il sentit s’abattre sur lui ce malaise flou, encore une fois, l’envie de rien, le sentiment que ça ne finirait jamais, la sujétion, l’enfance, les comptes à rendre. Par moments, il se sentait tellement mal qu’il lui venait des idées expéditives. Dans les films, les gens avaient des têtes symétriques, des fringues à leur taille, des moyens de locomotion bien souvent. Lui se contentait de vivre par défaut, nul au bahut, piéton, infoutu de se sortir une meuf, même pas capable d’aller bien. »
(J’ai conservé des extraits qu’ArenSor avait déjà cités.)
« Il n’y a pas si longtemps, il lui suffisait de se taper des popcorn devant un bon film pour être content. La vie se justifiait toute seule alors, dans son recommencement même. Il se levait le matin, allait au bahut, il y avait le rythme des cours, les copains, tout s’enchaînait avec une déconcertante facilité, la détresse maximale advenant quand tombait une interro surprise. Et puis maintenant, ça, ce sentiment de boue, cette prison des jours. »
Patrick est le père d’Anthony, et ici occasion d’analyse sociétale du changement des valeurs :
« Depuis, Patrick entretenait avec ce couvre-chef des relations d’opérette. Il le portait, se croyait observé, le piétinait, l’oubliait dans son C15, le perdait régulièrement. Au volant, sur un site, au bistrot, au bureau, au garage, il se posait cette question : devait-il porter sa casquette ? Autrefois, les mecs n’avaient pas besoin de se déguiser. Ou alors les liftiers, les portiers, les domestiques. Voilà que tout le monde se retrouvait plus ou moins larbin, à présent. La silicose et le coup de grisou ne faisaient plus partie des risques du métier. On mourait maintenant à feu doux, d’humiliation, de servitudes minuscules, d’être mesquinement surveillé à chaque stade de sa journée ; et de l’amiante aussi. Depuis que les usines avaient mis la clef sous la porte, les travailleurs n’étaient plus que du confetti. Foin des masses et des collectifs. L’heure, désormais, était à l’individu, à l’intérimaire, à l’isolat. Et toutes ces miettes d’emplois satellitaient sans fin dans le grand vide du travail où se multipliaient une ribambelle d’espaces divisés, plastiques et transparents : bulles, box, cloisons, vitrophanies.
Là-dedans, la climatisation tempérait les humeurs. Bippers et téléphones éloignaient les comparses, réfrigéraient les liens. Des solidarités centenaires se dissolvaient dans le grand bain des forces concurrentielles. Partout, de nouveaux petits jobs ingrats, mal payés, de courbettes et d’acquiescement, se substituaient aux éreintements partagés d’autrefois. Les productions ne faisaient plus sens. On parlait de relationnel, de qualité de service, de stratégie de com, de satisfaction client. Tout était devenu petit, isolé, nébuleux, pédé dans l’âme. Patrick ne comprenait pas ce monde sans copain, ni cette discipline qui s’était étendue des gestes aux mots, des corps aux âmes. On n’attendait plus seulement de vous une disponibilité ponctuelle, une force de travail monnayable. Il fallait désormais y croire, répercuter partout un esprit, employer un vocabulaire estampillé, venu d’en haut, tournant à vide, et qui avait cet effet stupéfiant de rendre les résistances illégales et vos intérêts indéfendables. Il fallait porter une casquette. »
Les personnages féminins sont de même approfondis :
« Depuis le temps qu’elle trompait son attente, se préparait. Ainsi, ces derniers jours, elle avait pris soin d’ingurgiter ses deux bouteilles de Contrex quotidiennes. Elle s’était mise au soleil, mais pas trop, une heure maxi, se nappant avec patience, couche après couche, jusqu’à obtenir le rendu parfait, un hâle savant, onctueux, une peau en or et de jolies marques claires qui dessinaient sur sa nudité le souvenir de son maillot deux pièces. Au saut du lit, elle montait sur la balance avec une inquiétude sourde. Elle était gourmande, fêtarde. Elle aimait se coucher tard et avait tendance à picoler pas mal. Alors elle s’était surveillée au gramme près, mesurant son sommeil, ce qu’elle mangeait, faisant mais alors extrêmement gaffe à ce corps qui selon les moments, la lumière, les fatigues et les rations de nourriture connaissait d’extraordinaires mues. Elle avait poli ses ongles, maquillé ses yeux, prodigué à ses cheveux un shampoing aux algues, un autre aux œufs. Elle avait fait un peeling et s’était frottée sous la douche avec du marc de café. Elle avait confié ses jambes et son sexe à l’esthéticienne. Elle était ravie, appétissante, millimétrée. Elle portait un débardeur tout neuf, un truc Petit Bateau à rayures. »
Les clés de la réussite sociale n’ont finalement guère changé de mains…
« Les décideurs authentiques passaient par des classes préparatoires et des écoles réservées. La société tamisait ainsi ses enfants dès l’école primaire pour choisir ses meilleurs sujets, les mieux capables de faire renfort à l’état des choses. De cet orpaillage systématique, il résultait un prodigieux étayage des puissances en place. Chaque génération apportait son lot de bonnes têtes, vite convaincues, dûment récompensées, qui venaient conforter les héritages, vivifier les dynasties, consolider l’architecture monstre de la pyramide hexagonale. Le “mérite” ne s’opposait finalement pas aux lois de la naissance et du sang, comme l’avaient rêvé des juristes, des penseurs, les diables de 89, ou les hussards noirs de la République. Il recouvrait en fait une immense opération de tri, une extraordinaire puissance d’agglomération, un projet de replâtrage continuel des hiérarchies en place. C’était bien fichu. »
… même si certains parviennent à prendre l’ascenseur social.
« Car ces pères restaient suspendus, entre deux langues, deux rives, mal payés, peu considérés, déracinés, sans héritage à transmettre. Leurs fils en concevaient un incurable dépit. Dès lors, pour eux, bien bosser à l’école, réussir, faire carrière, jouer le jeu, devenait presque impossible. Dans ce pays qui traitait leur famille comme un fait de société, le moindre mouvement de bonne volonté ressemblait à un fait de collaboration.
Cela dit, Hacine avait aussi plein d’anciens copains de classe qui se trouvaient en BTS, faisaient une fac de socio, de la mécanique, Tech de co ou même médecine. Finalement, il était difficile de faire la part des circonstances, des paresses personnelles et de l’oppression générale. Pour sa part, il était tenté de privilégier les explications qui le dédouanaient et justifiaient les libertés qu’il prenait avec la loi. »
Les classes moyennes, pourtant financièrement précaires, alimentent allègrement la société de consommation :
« Avec Coralie, ils s’étaient d’ailleurs rendus chez Mr Bricolage et Leroy Merlin, mais ils étaient chaque fois rentrés bredouilles. Hacine n’y connaissait rien en bricolage, et il avait peur de se faire arnaquer, ça le rendait méfiant, il refusait de parler aux vendeurs. Heureusement, il y avait juste à côté d’autres enseignes pour acheter de la déco, des vêtements, des jeux vidéo, du matos hi-fi, du mobilier exotique et puis manger un morceau. C’était la beauté de ces zones commerciales du pourtour, qui permettaient de dériver des journées entières, sans se poser de question, en claquant du blé qu’on n’avait pas, pour s’égayer la vie. À la fin, ils étaient même allés chez King Jouet et avaient parcouru les allées, un sourire aux lèvres, en pensant à tout le plaisir qu’ils auraient eu étant gosses, s’ils avaient pu s’offrir tout ça. Résultat, l’appart était rempli de bougies, de loupiotes en plastique, de plaids en laine polaire, de bibelots d’inspiration bouddhique. Coralie avait également craqué pour deux fauteuils en rotin garnis de coussins blancs. Avec le yucca et les plantes vertes dans les coins, c’est vrai que l’ensemble avait pris un certain cachet. Ce serait encore mieux quand Hacine se serait décidé à planter un clou pour accrocher la photo du Brooklyn Bridge qui attendait au pied du mur. »
Culmination avec la fresque du 14 juillet :
« Ils étaient donc là, peut-être pas tous, mais nombreux, les Français.
Des vieux, des chômeurs, des huiles, des jeunes en mob, et les Arabes de la ZUP, les électeurs déçus et les familles monoparentales, les poussettes et les propriétaires de Renault Espace, les commerçants et les cadres en Lacoste, les derniers ouvriers, les vendeurs de frites, les bombasses en short, les gominés, et venus de plus loin, les rustiques, les grosses têtes, et bien sûr quelques bidasses pour faire bonne mesure. »
C’est la ruralité, alors il faut deux ou quatre roues pour se déplacer, pas seulement pour la frime.
Il y a plusieurs incohérences ou erreurs, qu’une relecture sérieuse aurait corrigé.
Le suspense est habilement entretenu dans le déroulement de ces quelques vies caractéristiques, avec pour ressort les rapports tendus d’Anthony et Hacine.
Après une première partie plutôt rebutante, je me félicite d’avoir poursuivi l’effort de lecture de ce roman en fait très consistant, qui traite de la jeunesse, de la désindustrialisation, de l’immigration, des « cassos », des drogues et de la délinquance en notre pays (principalement les années 1990). Plus proche de l’observation sociologique (avec effectivement les pertinentes « analyses récapitulatives » évoquées par Topocl ; j’ai aussi pensé à Daewoo, de François Bon) que de l’"ouvrage d'imagination", il a quand même obtenu le prix Goncourt. Ce dernier peut se révéler décevant, mais a permis cette fois de faire valoir un romancier contemporain qui mérite d’être lu.
\Mots-clés : #immigration #lieu #mondedutravail #relationdecouple #relationenfantparent #ruralité #sexualité #xxesiecle
- le Jeu 4 Avr - 12:23
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Nicolas Mathieu
- Réponses: 35
- Vues: 1570
Hubert Haddad
Opium Poppy
Camir, Centre d’accueil des mineurs isolés et réfugiés : Alam l’Afghan de onze-douze ans est parmi les autres (dont Diwani, rescapée tutsie), et doit apprendre une nouvelle langue, une société autre.
« Grands et petits, ceux du Mali et du Congo, ceux du Pakistan, les Kurdes d’Anatolie, les réfugiés blêmes du Caucase, tous les élèves se dressent d’un seul bond, comme affranchis d’une chape d’indignité, et recouvrent dans les couloirs les allures flottantes du désarroi. »
Kandahar :
« Mais elles voulaient apprendre à lire et à calculer. Chaque jour, elles repartaient gaiement au lycée. Un matin, des garçons en moto leur ont coupé le chemin. Ils ont soulevé leurs voiles. Avec des pistolets à eau, comme pour jouer, ils ont arrosé leurs visages. Alam griffe la purée de sa fourchette. Il soupçonne avec effroi un vague lien entre son assiette et les dérives de son esprit. Les belles jeunes filles, il les imagine tête nue, les cheveux brûlés, la face sanguinolente et déformée comme un derrière de singe. Le vitriol efface d’un coup la rosée miraculeuse des visages. Il n’y a plus personne dans la maison du souvenir… »
Alam est en fait l’Évanoui (Alam le Borgne est son frère aîné) ; il a vécu au village de montagne, puis en ville.
« Sa vie jusque-là s’était partagée entre les maigres pâtures, les champs de pavots et son village à l’aspect de ruines exhumées ; tant que les insurgés se terraient dans leurs repaires, l’appel du muezzin et la traite des brebis suffisaient à rythmer les jours. »
Parvenu en France, il s’évade du Camir dans Paris, et côtoie les divers sans-abris et migrants.
« On part découragé, en lâche ou en héros, dans l’illusion d’une autre vie, mais il n’y a pas d’issue. L’exil est une prison. »
Une belle description des ruines urbaines de la zone des Vignes où se réfugient les marginaux, souvent délinquants.
« Une glaciale impression de déshérence s’étend sur cette zone où le piéton ne s’aventure qu’une fois fourvoyé, croyant couper les distances entre le canal de l’Ourcq, les gares à jamais hantées de Drancy et de Bobigny, et l’immense champ de morts de Pantin où les allées ont des noms d’arbre. Nulle part, serait-ce dans les pires îlots de La Courneuve ou de Clichy, la solitude n’arbore un tel aspect de coupe-gorge sans issue. »
Retour sur son enfance (récit alterné entre l’Afghanistan et la France, ses passé et présent), qui a lieu après la première prise de pouvoir des talibans.
Son frère ainé a rejoint le Djihad ; l’Évanoui le retrouvera par hasard, deviendra enfant-soldat, et le tuera comme on l’en enjoint car il aurait trahi, et parce qu’il lui apprend être de ceux qui ont vitriolé Malalaï, sa voisine qui fréquentait l’école et son seul rayon de bonheur.
« On égorgeait et massacrait sans haine, comme les moutons de l’Aïd el-Kebir, par sacrifice de soumission à la loi. Dieu se chargeait de remplacer les fils des hommes morts à la guerre par des béliers et des chèvres couchés sur le flanc gauche aux portes du paradis, dans la gloire de l’au-delà. »
Les talibans ont entraîné l’Évanoui au combat et au martyre.
« Ce dernier était plutôt disposé au sacrifice. Lorsque les balles remplacent les mots, l’instinct de vie s’étiole avec l’espérance. Le spectacle continu des corps en souffrance, des amputés, des exécutés pour l’exemple tourne vite à la farce. »
« Rien n’échappe à la violence ; le monde n’existe plus. On égorge l’agneau et l’enfant d’un même geste. Dès qu’une femme rit trop fort ou danse avec un autre, on l’attache et l’assomme de pierres aiguës. Chaque homme est trahi par son ombre. Une hallucination guide des somnambules aux mains sanglantes d’un cœur arraché à l’autre. »
Gravement blessé, l’Évanoui a été pris en charge par la coalition occidentale et le Croissant rouge dans un camp de réfugiés dont il s’enfuit. Au terme d’un périple via l’Iran, la Turquie puis la Bulgarie ou la Macédoine et l’Italie, il atteint Paris où il est plus ou moins recueilli par Yuko le Kosovar, caïd des trafics de drogue et d’armes du squat, qui le protège plus ou moins, ainsi que Poppy la junkie.
Rendu saisissant de l’existence de réfugiés en France, et dans leur pays d’origine, ainsi que d’une jeunesse "perdue".
\Mots-clés : #contemporain #enfance #exil #guerre #immigration #jeunesse #social #terrorisme #traditions #xxesiecle
- le Lun 5 Fév - 10:19
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 20
- Vues: 917
Jean-Marie Blas de Roblès
Dans l'épaisseur de la chair
Le roman commence par un passage qui développe heureusement la superstition des marins, ici des pêcheurs à la palangrotte sur un pointu méditerranéen, Manuel Cortès, plus de quatre-vingt-dix ans, et son fils, le narrateur. Ce dernier veut recueillir les souvenirs paternels pour en faire un livre. Et c’est accroché au plat-bord de l’embarcation dont il est tombé, seul en mer, qu’il commence le récit de la famille, des Espagnols ayant immigré au XIXe en Algérie pour fuir sécheresse et misère : des pieds-noirs :
« Le problème est d’autant plus complexe que pas un seul des Européens qui ont peuplé l’Algérie ne s’est jamais nommé ainsi. Il faut attendre les derniers mois de la guerre d’indépendance pour que le terme apparaisse, d’abord en France pour stigmatiser l’attitude des colons face aux indigènes, puis comme étendard de détresse pour les rapatriés. Il en va des pieds-noirs comme des Byzantins, ils n’ont existé en tant que tels qu’une fois leur monde disparu. »
À Bel-Abbès, ou « Biscuit-ville », Juan est le père de Manuel, antisémite comme en Espagne après la Reconquista, et « n’ayant que des amis juifs »… Ce sont bientôt les premiers pogroms, et la montée du fascisme à l’époque de Franco, Mussolini et Hitler.
« En Algérie, comme ailleurs, le fascisme avait réussi à scinder la population en deux camps farouchement opposés. »
« Le Petit Oranais, journal destiné "à tous les aryens de l’Europe et de l’univers", venait d’être condamné par les tribunaux à retirer sa manchette permanente depuis 1930, un appel au meurtre inspiré de Martin Luther : "Il faut mettre le soufre, la poix, et s’il se peut le feu de l’enfer aux synagogues et aux écoles juives, détruire les maisons des Juifs, s’emparer de leurs capitaux et les chasser en pleine campagne comme des chiens enragés." On remplaça sans problème cette diatribe par une simple croix gammée, et le journal augmenta ses ventes. »
Est évoquée toute l’Histoire depuis la conquête française, qui suit le modèle romain.
« Bugeaud l’a clamé sur tous les tons sans être entendu : "Il n’est pas dans la nature d’un peuple guerrier, fanatique et constitué comme le sont les Arabes, de se résigner en peu de temps à la domination chrétienne. Les indigènes chercheront souvent à secouer le joug, comme ils l’ont fait sous tous les conquérants qui nous ont précédés. Leur antipathie pour nous et notre religion durera des siècles." »
« Cela peut sembler incroyable aujourd’hui, et pourtant c’est ainsi que les choses sont advenues : les militaires français ont conquis l’Algérie dans une nébulosité romaine, oubliant que le songe où ils se coulaient finirait, comme toujours, et comme c’était écrit noir sur blanc dans les livres qui les guidaient, par se transformer en épouvante. D’emblée, et par admiration pour ceux-là mêmes qui avaient conquis la Gaule et gommé si âprement la singularité de ses innombrables tribus, les Français ont effacé celle de leurs adversaires : ils n’ont pas combattu des Ouled Brahim, des Ouled N’har, des Beni Ameur, des Beni Menasser, des Beni Raten, des Beni Snassen, des Bou’aïch, des Flissa, des Gharaba, des Hachem, des Hadjoutes, des El Ouffia, des Ouled Nail, des Ouled Riah, des Zaouaoua, des Ouled Kosseir, des Awrigh, mais des fantômes de Numides, de Gétules, de Maures et de Carthaginois. Des indigènes, des autochtones, des sauvages. »
« Impossible d’en sortir, tant que ne seront pas détruites les machines infernales qui entretiennent ces répétitions. »
Dans l’Histoire plus récente, le régime de Vichy « réserva les emplois de la fonction publique aux seuls Français "nés de père français" », et fit « réexaminer toutes les naturalisations d’étrangers, avec menace d’invalider celles qui ne seraient pas conformes aux intérêts de la France. Ces dispositions, qui visaient surtout les Juifs sans les nommer, impliquaient l’interdiction de poursuivre des études universitaires. »
« Exclu du lycée Lamoricière, André Bénichou, le professeur de philo de Manuel, en fut réduit à créer un cours privé dans son appartement. C’est à cette occasion qu’il recruta Albert Camus, lui-même écarté de l’enseignement public à cause de sa tuberculose. Et je comprends mieux, tout à coup, pourquoi l’enfant de Mondovi, coincé à Oran, s’y était mis à écrire La Peste. »
Manuel se tourne vers la pharmacie, puis la médecine, s’engage pendant la Seconde Guerre, et devient chirurgien dans un tabor de goumiers du corps expéditionnaire français en Campanie.
« Sur le moment, j’aurais préféré l’entendre dire qu’il avait choisi la guerre « pour délivrer la France » ou « combattre le nazisme ». Mais non. Il s’était presque fâché de mon insistance : Je n’ai jamais songé à délivrer qui que ce soit, ni ressenti d’animosité particulière contre les Allemands ou les Italiens. Pour moi, c’était l’aventure et la haine des pétainistes, point final. »
« Quand le tabor se déplaçait d’un lieu de bataille à un autre, les goumiers transportaient en convoi ce qu’ils avaient volé dans les fermes environnantes, moutons et chèvres surtout, et à dos de mulet la quincaillerie de chandeliers et de ciboires qu’ils pensaient pouvoir ramener chez eux. Ils n’avançaient que chargés de leurs trophées, dans un désordre brinquebalant et coloré d’armée antique. […]
Les autorités militaires offrant cinq cents francs par prisonnier capturé, les goumiers s’en firent une spécialité. Et comme certains GI ne rechignaient pas à les leur racheter au prix fort pour s’attribuer l’honneur d’un fait d’armes, il y eut même une bourse clandestine avec valeurs et cotations selon le grade des captifs : un capitaine ou un Oberstleutnant rapportait près de deux mille francs à son heureux tuteur ! »
« Officiellement, la circulaire d’avril 1943 du général Bradley était très explicite sur ce point : pour maintenir le moral de l’armée il ne fallait plus parler de troubles psychologiques, ni même de shell shock, la mystérieuse « obusite » des tranchées, mais d’« épuisement ». Dans l’armée française, c’était beaucoup plus simple : faute de service psychiatrique – le premier n’apparaîtrait que durant la bataille des Vosges – il n’y avait aucun cas recensé de traumatisme neurologique. Des suicidés, des mutilations volontaires, oui, bien sûr, des désertions, des simulateurs, des bons à rien de tirailleurs ou de goumiers paralysés par les djnouns, incapables de courage physique et moral, ça arrivait régulièrement, des couards qu’il fallait bien passer par les armes lorsqu’ils refusaient de retourner au combat, mais des cinglés, jamais. Pas chez nous. Pas chez des Français qui avaient à reconquérir l’honneur perdu lors de la débâcle.
Mon père m’a raconté l’histoire d’un sous-officier qu’il avait vu se mettre à courir vers l’arrière au début d’une attaque et ne s’était plus arrêté durant des kilomètres, jusqu’à se réfugier à Naples où on l’avait retrouvé deux semaines plus tard. Et de ceux-là, aussi, faisant les morts comme des cafards au premier coup d’obus. J’ai pour ces derniers une grande compassion, tant je retrouve l’attitude qui m’est la plus naturelle dans mes cauchemars de fin du monde. Faire le mort, quitte à se barbouiller le visage du sang d’un autre, et attendre, attendre que ça passe et ce moment où l’on se relèvera vivant, quels que soient les comptes à rendre par la suite.
Sommes-nous si peu à détester la guerre, au lieu de secrètement la désirer ? »
S’accrochant toujours à sa barque, le narrateur médite.
« Dès qu’on se mêle de raconter, le réel se plie aux exigences de la langue : il n’est qu’une pure fiction que l’écriture invente et recompose. »
Heidegger, le perroquet que le narrateur a laissé au Brésil et devenu « une sorte de conscience extérieure qui me dirait des choses tout en dedans », renvoie à Là où les tigres sont chez eux.
« Heidegger a beau dire qu’il s’agit d’une coïncidence dénuée d’intérêt, je ne peux m’empêcher d’en éprouver un vertige désagréable, celui d’un temps circulaire, itératif, où reviendraient à intervalles fixes les mêmes fulgurances, les mêmes conjonctures énigmatiques. »
Ayant suivi des cours de philosophie (tout comme Manuel qui « s’inscrivit en philosophie à la fac d’Alger »), Blas de Roblès cite Wole Soyinka (sans le nommer) :
« Le tigre ne proclame pas sa tigritude, soupire Heidegger, il fonce sur sa proie et la dévore. »
En contrepartie de leur courage de combattants, les troupes coloniales commettent de nombreuses exactions, du pillage aux violences sur les civils.
« Plus qu’une sordide décompensation de soldats épargnés par la mort, le viol a toujours été une véritable arme de guerre. »
Le roman est fort digressif (d’ailleurs la citation liminaire est de Sterne). Le narrateur qui marine et s’épuise évoque des jeux d’échecs, fait de curieux projets, met en cause Vasarely…
Après la bataille du monastère de Monte Cassino, la troupe suit le « bellâtre de Marigny » (Jean de Lattre de Tassigny) dans le débarquement en Provence, puis c’est la bataille des Vosges, et l’Ardenne.
À propos du film Indigènes, différent sur l’interprétation des faits.
À peine l’Allemagne a-t-elle capitulé, Manuel est envoyé avec la Légion et les spahis qui répriment une insurrection à Sétif, « un vrai massacre » qui tourne vite à l’expédition punitive (une centaine de morts chez les Européens, plusieurs milliers chez les indigènes). Blessé, il part suivre ses études de médecine à Paris, puis se marie par amour avec une Espagnole pauvre, mésalliance à l’encontre de l’entre-soi de mise dans les différentes communautés.
« Les « indigènes », au vrai, c’était comme les oiseaux dans le film d’Alfred Hitchcock, ils faisaient partie du paysage. »
« Après Sétif, la tragédie n’a plus qu’à débiter les strophes et antistrophes du malheur. Une mécanique fatale, avec ses assassinats, ses trahisons, ses dilemmes insensés, sa longue chaîne de souffrances et de ressentiment. »
Les attentats du FLN commencent comme naît Thomas, le narrateur, qui aborde ses souvenirs d’enfance.
« …] le portrait que je trace de mon père en me fiant au seul recours de ma mémoire est moins fidèle, je m’en aperçois, moins réel que les fictions inventées ou reconstruites pour rendre compte de sa vie avant ma naissance. »
OAS et fellaghas divisent irréconciliablement Arabes et colons. De Gaulle parvient au pouvoir, et tout le monde croit encore que la situation va s’arranger, jusqu’à l’évacuation, l’exode, l’exil. Mauvais accueil en métropole, et reconstruction d’une vie brisée, Manuel devant renoncer à la chirurgie pour être médecin généraliste.
Histoire étonnante des cartes d’Opicino de Canistris :
« À la question « qui suis-je ? », qui sum ego, il répond tu es egoceros, la bête à corne, le bouc libidineux, le rhinocéros de toi-même.
Il n’est pas fou, il me ressemble comme deux gouttes d’eau ; il nous ressemble à tous, encombrés que nous sommes de nos frayeurs intimes et du combat que nous menons contre l’absurdité de vivre. »
Regret d’une colonisation ratée…
« Ce qu’il veut dire, je crois, c’est qu’il y aurait eu là-bas une chance de réussir quelque chose comme la romanisation de la Gaule, ou l’européanisation de l’Amérique du Nord, et que les gouvernements français l’avaient ratée. Par manque d’humanisme, de démocratie, de vision égalitaire, par manque d’intelligence, surtout, et parce qu’ils étaient l’émanation constante des « vrais colons » – douze mille en 1957, parmi lesquels trois cents riches et une dizaine plus riches à eux dix que tous les autres ensemble – dont la rapacité n’avait d’égal que le mépris absolu des indigènes et des petits Blancs qu’ils utilisaient comme main-d’œuvre pour leurs profits. »
… mais :
« Si les indigènes musulmans ont été les Indiens de la France, ce sont des Indiens qui auraient finalement, heureusement, et contre toute attente, repoussé à la mer leurs agresseurs.
Un western inversé, en somme, bien difficile à regarder jusqu’à la fin pour des Européens habitués à contempler en Technicolor la mythologie de leur seule domination. »
« La France s’est dédouanée de l’Algérie française en fustigeant ceux-là mêmes qui ont essayé tant bien que mal de faire exister cette chimère. Les pieds-noirs sont les boucs émissaires du forfait colonialiste.
Manuel ne voit pas, si profonde est la blessure, que ce poison terrasse à la fois ceux qui l’absorbent et ceux qui l’administrent. La meule a tourné d’un cran, l’écrasant au passage, sans même s’apercevoir de sa présence.
Il y aura un dernier pied-noir, comme il y a eu un dernier des Mohicans. »
Clairement narré, et regroupé en petits chapitres, ce qui rend la lecture fort agréable. Par exemple, le 240ème in extenso :
« Rejoindre le front des Vosges dans un camion de bauxite, sauter sur une mine à Mulhouse, et se retrouver médecin des gueules rouges à Brignoles, en compagnie d’un confrère alsacien ! Qu’est-ce qui est à l’œuvre dans ce genre de conjonction ? Quels sont les dieux fourbes qui manipulent ainsi nos destinées ? Projet : S’occuper de ce que Charles Fort appelait des « coïncidences exagérées ». Montrer ce qu’elles révèlent de terreur archaïque devant l’inintelligibilité du monde, de poésie latente aussi, et quasi biologique, dans notre obstination à préférer n’importe quel déterminisme au sentiment d’avoir été jetés à l’existence comme on jette, dit-on, un prisonnier aux chiens. »
Les parties du roman sont titrées d’après les cartes italiennes de la crapette, « bâtons, épées, coupes et deniers ».
Il y a une grande part d’autobiographie dans ce roman dense, qui aborde nombre de sujets.
Beaucoup d’aspects sont abordés, comme le savoureux parler nord-africain en voie de disparition (ainsi que son humour), et pendant qu’on y est la cuisine, soubressade, longanisse, morcilla…
Et le dénouement est inattendu !
\Mots-clés : #antisémitisme #biographie #colonisation #deuxiemeguerre #enfance #exil #guerredalgérie #historique #identite #immigration #insurrection #politique #racisme #relationenfantparent #segregation #social #terrorisme #traditions #xxesiecle
- le Ven 31 Mar - 12:56
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean-Marie Blas de Roblès
- Réponses: 25
- Vues: 1899
Salman Rushdie
Quichotte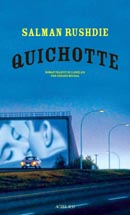
M. Ismail Smile, vieil États-unien originaire de Bombay et voyageur de commerce, est si addict aux « programmes télévisés ineptes » qu’il a glissé dans cette « réalité irréelle », suite à un mystérieux « Événement Intérieur ».
« Des acteurs qui jouaient des rôles de président pouvaient devenir présidents. L’eau pouvait venir à manquer. Une femme pouvait être enceinte d’un enfant qui se révélait être un dieu revenant sur terre. Des mots pouvaient perdre leur sens et en acquérir de nouveaux. »
« À l’ère du Tout-Peut-Arriver », sous le pseudonyme de Quichotte il se lance dans la quête amoureuse d’une vedette de télé, Miss Salma R., elle aussi d'origine indienne.
Quichotte se crée un « petit Sancho », un fils né de Salma dans le futur, inspiré du garçon rondouillard qu’il fut avant de devenir un adulte grand et mince
Ce premier chapitre a été écrit par l’écrivain Sam DuChamp, dit Brother, auteur de romans d’espionnage aux tendances paranoïaques, qui trouve en Quichotte une grande similitude avec sa propre situation.
« Ils étaient à peu près du même âge, l’âge auquel pratiquement tout un chacun est orphelin et leur génération qui avait fait de la planète un formidable chaos était sur le point de tirer sa révérence. »
Situation des immigrants indiens :
« Puis, en 1965, un nouvel Immigration and Nationality Act ouvrit les frontières. Après quoi, retournement inattendu, il s’avéra que les Indiens n’allaient pas, après tout, devenir une cible majeure du racisme américain. Cet honneur continua à être réservé à la communauté afro-américaine et les immigrants indiens, dont beaucoup étaient habitués au racisme des Blancs britanniques en Afrique du Sud et en Afrique de l’Est tout comme en Inde et en Grande-Bretagne, se sentaient presque embarrassés de se retrouver exonérés de la violence et des attaques raciales, et embarqués dans un devenir de citoyens modèles. »
Dans ce roman, Rushdie met en scène (de nouveau) l’état du monde, politique, culturel, en faisant des allers-retours des sociétés d’Asie du Sud à celles d’Occident.
« Une remarque, au passage, cher lecteur, si vous le permettez : on pourrait défendre l’idée que les récits ne devraient pas s’étaler de la sorte, qu’ils devraient s’enraciner dans un endroit ou dans un autre, y enfoncer leurs racines et fleurir sur ce terreau particulier, mais beaucoup de récits contemporains sont, et doivent être, pluriels, à la manière des plantes vivaces rampantes, en raison d’une espèce de fission nucléaire qui s’est produite dans la vie et les relations humaines et qui a séparé les familles, fait voyager des millions et des millions d’entre nous aux quatre coins du globe (dont tout le monde admet qu’il est sphérique et n’a donc pas de coins), soit par nécessité soit par choix. De telles familles brisées pourraient bien être les meilleures lunettes pour observer notre monde brisé. Et, au sein de ces familles brisées, il y a des êtres brisés, par la défaite, la pauvreté, les mauvais traitements, les échecs, l’âge, la maladie, la souffrance et la haine, et qui s’efforcent pourtant, envers et contre tout, de se raccrocher à l’espoir et à l’amour, et il se pourrait bien que ces gens brisés – nous, le peuple brisé ! – soient les plus fidèles miroirs de notre époque, brillants éclats reflétant la vérité, quel que soit l’endroit où nous voyageons, échouons, vivons. Car nous autres, les immigrants, nous sommes devenus telles les spores emportées dans les airs et regardez, la brise nous entraîne où elle veut jusqu’à ce que nous nous installions sur un sol étranger où, très souvent, comme c’est le cas par exemple à présent en Angleterre avec sa violente nostalgie d’un âge d’or imaginaire où toutes les attitudes étaient anglo-saxonnes et où tous les Anglais avaient la peau blanche, on nous fait sentir que nous ne sommes pas les bienvenus, quelle que soit la beauté des fruits que portent les branches des vergers de fruitiers que nous sommes devenus. »
À Londres, Sister (sœur de… Brother avec qui elle est brouillée), est une coléreuse « avocate réputée, s’intéressant tout particulièrement aux questions des droits civiques et aux droits de l’homme ».
« Sister était idéaliste. Elle pensait que l’État de droit était l’un des deux fondements d’une société libre, au même titre que la liberté d’expression. »
Le Dr R. K. Smile, riche industriel pharmaceutique cousin et employeur d’Ismail, se révèle être un escroc, distribuant fort largement ses produits opiacés.
Sancho Smile est une créature au second degré (imaginé par Quichotte imaginé par Brother) qui s’interroge sur son identité.
« Il y a un nom pour cela. Pour la personne qui est derrière l’histoire. Le vieux bonhomme, papa, dispose de plein d’éléments sur cette question. Il n’a pas l’air de croire en une telle entité, n’a pas l’air de sentir sa présence comme moi mais sa tête est tout de même remplie de pensées sur cette entité. Sa tête et par conséquent la mienne aussi. Il faut que je réfléchisse à cela dès maintenant. Je vais le dire ouvertement : Dieu. Peut-être lui et moi, Dieu et moi, pouvons-nous nous comprendre ? Peut-être pourrions-nous avoir une bonne discussion ensemble, puisque, vous savez, nous sommes tous deux imaginaires. »
« C’est simplement lui, papa, qui se dédouble en un écho de lui-même. C’est tout. Je vais me contenter de cela. Au-delà, on ne peut que sombrer dans la folie, autrement dit devenir croyant. »
« Il y a trois crimes que l’on peut commettre dans un pensionnat anglais. Être étranger, c’est le premier. Être intelligent, c’est le deuxième. Être mauvais en sports, c’est le troisième coup, vous êtes éliminé. On peut s’en sortir avec deux des trois défauts mais pas avec les trois à la fois. »
« Il y a des gens qui ont besoin de donner par la force une forme au caractère informe de la vie. Pour eux, l’histoire d’une quête est toujours très attirante. Elle les empêche de souffrir les affres de la sensation, comment dit-on, d’incohérence. »
Sancho est aussi un personnage (fictif) qui rêve d’émancipation, ombre de Quichotte et qui ne veut plus en être esclave. Tout ce chapitre 6 où il parle forme un morceau d’anthologie sur le sens de l’existence et de la littérature, via l’intertextualité. Ainsi, en référence à Pinocchio :
« “Grillo Parlante, à ton service, dit le criquet. C’est vrai, je suis d’origine italienne. Mais tu peux m’appeler Jiminy si tu veux. […]
Je suis une projection de ton esprit, exactement comme tu as commencé toi-même par être une projection du sien. Il semble que tu devrais bientôt avoir une insula. »
Salma, bipolaire issue d’une lignée féminine de belles vedettes devenues folles, est dorénavant superstar dans son talk-show (en référence assumée à Oprah Winfrey) ; elle s’adonne à « l’automédication » avec des « opiacés récréatifs ».
« Elle était une femme privilégiée qui se plaignait de soucis mineurs. Une femme dont la vie se déroulait à la surface des choses et qui, ayant choisi le superficiel, n’avait pas le droit de se plaindre de l’absence de profondeur. »
Road-trip où le confiant, souriant et bavard Quichotte emmène Sancho, qui découvre la réalité, les USA, la télé :
« Nous sommes sous-éduqués et suralimentés. Nous sommes très fiers de qui vous savez. Nous fonçons aux urgences et nous envoyons Grand-Mère nous chercher des armes et des cigarettes. Nous n’avons besoin d’aucun allié pourri parce que nous sommes stupides et vous pouvez bien nous sucer la bite. Nous sommes Beavis et Butt-Head sous stéroïdes. Nous buvons le Roundup directement à la canette. Notre président a l’air d’un jambon de Noël et il parle comme Chucky. C’est nous l’Amérique, bordel. Zap. Les immigrants violent nos femmes tous les jours. Nous avons besoin d’une force spatiale à cause de Daech. Zap. […]
“Le normal ne me paraît pas très normal, lui dis-je.
– C’est normal de penser cela”, répond-il. […]
Chaque émission sur chaque chaîne dit la même chose : d’après une histoire vraie. Mais cela non plus ce n’est pas vrai. La vérité, c’est qu’il n’y a plus d’histoires vraies. Il n’existe plus de vérité sur laquelle tout le monde peut s’accorder. »
… et la vie en motels, qui nous vaut cette belle énumération d’images :
« Ce qu’il y a, surtout, ce sont des ronflements. La musique des narines américaines a de quoi vous impressionner. La mitrailleuse, le pivert, le lion de la MGM, le solo de batterie, l’aboiement du chien, le jappement du chien, le sifflet, le moteur de voiture au ralenti, le turbo d’une voiture de course, le hoquet, les grognements en forme de SOS, trois courts, trois longs, trois courts, le long grondement de la vague, le fracas plus menaçant des roulements de tonnerre, la brève explosion d’un éternuement en plein sommeil, le grognement sur deux tons du joueur de tennis, la simple inspiration/expiration ordinaire ou ronflement classique, le ronflement irrégulier, toujours surprenant, avec, de temps en temps, des pauses imprévisibles, la moto, la tondeuse à gazon, le marteau-piqueur, la poêle grésillante, le feu de bois, le stand de tir, la zone de guerre, le coq matinal, le rossignol, le feu d’artifice, le tunnel à l’heure de pointe, l’embouteillage, Alban Berg, Schoenberg, Webern, Philip Glass, Steve Reich, le retour en boucle de l’écho, le bruit d’une radio mal réglée, le serpent à sonnette, le râle d’agonie, les castagnettes, la planche à laver musicale, le bourdonnement. »
« En fait, voilà : quand je m’éveille le matin et que j’ouvre la porte de la chambre, je ne sais pas quelle ville je vais découvrir dehors, ni quel jour de la semaine, du mois ou de l’année on sera. Je ne sais même pas dans quel État nous allons nous trouver, même si cela me met dans tous mes états, merci bien. C’est comme si nous demeurions immobiles et que le monde nous dépassait. À moins que le monde ne soit une sorte de télévision, mais je ne sais pas qui détient la télécommande. Et s’il y avait un Dieu ? Serait-ce la troisième personne présente ? Un Dieu qui, au demeurant, nous baise, moi, les autres, en changeant arbitrairement les règles ? Et moi qui croyais qu’il y avait des règles pour changer les règles. Je pensais, même si j’accepte l’idée que quelqu’un virgule quelque chose a créé tout ceci, ce quelque chose virgule ce quelqu’un n’est-il, virgule ou n’est-elle, pas lié.e par les lois de la création une fois qu’il, ou elle, l’a achevée ? Ou peut-il virgule, peut-elle hausser les épaules et déclarer finie la gravité, et adieu, et nous voici flottant tous dans le vide ? Et si cette entité, appelons-la Dieu, pourquoi pas, c’est la tradition, peut réellement changer les règles tout simplement parce qu’elle est d’humeur à le faire, essayons de comprendre précisément quelle est la règle qui est changée en l’occurrence. »
Ils arrivent à New-York.
« Il y a deux villes, dit Quichotte. Celle que tu vois, les trottoirs défoncés de la ville ancienne et les squelettes d’acier de la nouvelle, des lumières dans le ciel, des ordures dans les caniveaux, la musique des sirènes et des marteaux-piqueurs, un vieil homme qui fait la manche en dansant des claquettes, dont les pieds disent, j’ai été quelqu’un, dans le temps, mais dont les yeux disent, c’est fini, mon gars, bien fini. La circulation sur les avenues et les rues embouteillées. Une souris qui fait de la voile sur une mare dans le parc. Un type avec une crête d’Iroquois qui hurle en direction d’un taxi jaune. Des mafieux affranchis avec une serviette coincée sous le menton dans une gargote italienne de Harlem. Des gars de Wall Street qui ont tombé la veste et se commandent des bouteilles d’alcool dans des night-clubs ou se prennent des shots de tequila et se jettent sur les femmes comme sur des billets de banque. De grandes femmes et de petits gars chauves, des restaurants à steaks et des boîtes de strip-tease. Des vitrines vides, des soldes définitifs, tout-doit-disparaître, un sourire auquel manquent quelques-unes de ses meilleures dents. Des travaux partout mais les conduites de vapeur continuent à exploser. Des hommes qui portent des anglaises avec un million de dollars en diamants dans la poche de leur long manteau noir. Ferronnerie. Grès rouge. Musique. Nourriture. Drogues. Sans-abris. Chasse-neige, baseball, véhicules de police labellisés CPR – courtoisie, professionnalisme, respect –, que-voulez-vous-que-je-vous-dise, ils-ne-manquent-pas-d’humour. Toutes les langues de la Terre, le russe, le panjabi, le taishanais, le créole, le yiddish, le kru. Et sans oublier le cœur battant de l’industrie de la télévision, Colbert au Ed Sullivan Theater, Noah dans Hell’s Kitchen, The View, The Chew, Seth Meyers, Fallon, tout le monde. Des avocats souriants sur les chaînes du câble qui promettent de vous faire gagner une fortune s’il vous arrive un accident. Rock Center, CNN, Fox. L’entrepôt du centre-ville où est tourné le show Salma. Les rues où elle marche, la voiture qu’elle prend pour rentrer chez elle, l’ascenseur vers son appartement en terrasse, les restaurants d’où elle fait venir ses repas, les endroits qu’elle connaît, ceux qu’elle fréquente, les gens qui ont son numéro de téléphone, les choses qu’elle aime. La ville tout entière belle et laide, belle dans sa laideur, jolie-laide, c’est français, comme la statue dans le port. Tout ce qu’on peut voir ici.
– Et l’autre ville ? demanda Sancho, sourcils froncés. Parce que ça fait déjà pas mal, tout ça.
– L’autre ville est invisible, répondit Quichotte, c’est la cité interdite, avec ses hauts murs menaçants bâtis de richesse et de pouvoir, et c’est là que se trouve la réalité. Ils sont très peu à détenir la clef qui permet d’accéder à cet espace sacré. »
Après avoir « renoncé à la croyance, à l’incroyance, à la raison et à la connaissance », ils doivent parvenir dans la « quatrième vallée » au détachement, là où « ce qu’on appelle communément « la réalité », qui est en réalité l’irréel, comme nous le montre la télévision, cessera d’exister. »
Quichotte envoie des lettres à Salma, puis sa photo, qui rappelle à celle-ci Babajan, son « grand-père pédophile ».
« Ma chère Miss Salma,
Dans une histoire que j’ai lue, enfant, et que, par une chance inespérée, vous pouvez voir aujourd’hui portée à l’écran sur Amazon Prime, un monastère tibétain fait l’acquisition du super-ordinateur le plus puissant du monde parce que les moines sont convaincus que la mission de leur ordre est de dresser la liste des neuf milliards de noms de Dieu et que l’ordinateur pourrait les aider à y parvenir rapidement et avec précision. Mais apparemment, il ne relevait pas de la seule mission de leur ordre d’accomplir cet acte héroïque d’énumération. La mission relevait également de l’univers lui-même, si bien que, lorsque l’ordinateur eut accompli sa tâche, les étoiles, tout doucement et sans tapage aucun, se mirent à disparaître. Mes sentiments à votre égard sont tels que je suis persuadé que tout l’objectif de l’univers jusqu’à présent a été de faire advenir cet instant où nous serons, vous et moi, réunis dans les délices éternelles et que, quand nous y serons parvenus, le cosmos, ayant atteint son but, cessera paisiblement d’exister et que, ensemble, nous entamerons alors notre ascension au-delà de l’annihilation pour pénétrer dans la sphère de l’Intemporel. »
« Autrefois, les gens croyaient vivre dans de petites boîtes, des boîtes qui contenaient la totalité de leur histoire et ils jugeaient inutile de se préoccuper de ce que faisaient les autres dans leurs autres petites boîtes, qu’elles soient proches ou lointaines. Les histoires des autres n’avaient rien à voir avec les leurs. Mais le monde a rétréci et toutes les boîtes se sont trouvées bousculées les unes contre les autres et elles se sont ouvertes et à présent que toutes les boîtes sont reliées les unes aux autres il nous faut admettre que nous devons comprendre ce qui se passe dans les boîtes où nous ne sommes pas, faute de quoi nous ne comprenons plus la raison de ce qui se passe dans nos propres boîtes. Tout est connecté. »
Quichotte a (comme Brother) une demi-sœur, « Trampoline », avec qui il s’est brouillé en l’accusant de détournement de leur héritage, devenue une défenderesse des démunis, et dont il voudrait maintenant se faire pardonner.
« Il n’accordait guère de temps aux chaînes d’actualités et d’informations, mais quand il les regardait distraitement il voyait bien qu’elles aussi imposaient un sens au tourbillon des événements et cela le réconfortait. »
Son, le fils de Brother, s’est aussi éloigné de ce dernier depuis des années, « passant tout son temps, jour et nuit, perdu quelque part dans son ordinateur, à s’immerger dans des vidéos musicales, jouer aux échecs en ligne ou mater du porno, ou Dieu sait quoi. »
Un agent secret (nippo-américain) apprend à Brother que son fils serait le mystérieux Marcel DuChamp, cyberterroriste qui porte le masque de L’Homme de la Manche, et l’engage à le convertir à servir les USA dans cette « Troisième Guerre mondiale ».
« Je ne suis pas critique littéraire mais je pense que vous expliquez au lecteur que le surréel, voire l’absurde, sont potentiellement devenus la meilleure façon de décrire la vraie vie. Le message est intéressant même s’il exige parfois, pour y adhérer, un considérable renoncement à l’incrédulité. »
Le destin d’Ignatius Sancho, esclave devenu abolitionniste, écrivain et compositeur en Grande-Bretagne, est évoqué à propos.
« Les réseaux sociaux n’ont pas de mémoire. Aujourd’hui, le scandale se suffisait à lui-même. L’engagement de Sister, toute une vie durant, contre le racisme, c’était comme s’il n’avait jamais existé. Différentes personnes qui se posaient en chefs de la communauté étaient prêtes à la dénoncer, comme si faire de la musique à fond tard le soir était une caractéristique indéniable de la culture afro-caribéenne et que toute critique à son égard ne pouvait relever que du préjugé, comme si personne n’avait pris la peine de remarquer que la grande majorité des jeunes buveurs nocturnes, ceux qui faisaient du scandale ou déclenchaient des bagarres, étaient blancs et aisés. »
« Mais aujourd’hui c’était le règne de la discontinuité. Hier ne signifiait plus rien et ne pouvait pas nous aider à comprendre demain. La vie était devenue une suite de clichés disparaissant les uns après les autres, un nouveau posté chaque jour et remplaçant le précédent. On n’avait plus d’histoire. Les personnages, le récit, l’histoire, tout cela avait disparu. Seule demeurait la plate caricature de l’instant et c’est là-dessus qu’on était jugé. Avoir vécu assez longtemps pour assister au remplacement, par sa simple surface, de la profonde culture du monde qu’elle s’était choisi était une bien triste chose. »
Trampoline est passée par un cancer qui lui a valu une double mastectomie, et elle recouvrit confiance en elle grâce à Evel Cent (Evil Scent, « mauvaise odeur » – Elon Musk !), un techno-milliardaire qui prétend sauver l’humanité en lui faisant quitter notre planète dans un monde en voie de désintégration ; Quichotte la brouilla avec lui, actuellement invité de Salma dans son talk-show. Trampoline révèle à Sancho que son « Événement Intérieur » fut une attaque cérébrale, et Quichotte obtient le pardon de ses offenses envers elle, rétablissant ainsi l’harmonie, prêt pour la sixième vallée, celle de l’Émerveillement.
« La mort de Don Quichotte ressemblait à l’extinction, en chacun d’entre nous, d’une forme particulière de folie magnifique, une grandeur innocente, une chose qui n’a plus sa place ici-bas, mais qu’on pourrait appeler l’humanité. Le marginal, l’homme dont on ridiculise la déconnexion d’avec la réalité, le décalage radical et l’incontestable démence, se révèle, au moment de sa mort, être l’homme le plus précieux d’entre tous et celui dont il faut déplorer la perte le plus profondément. Retenez bien cela. Gardez-le à l’esprit plus que tout. »
Brother retrouve Sister à Londres, qui se meurt d’un cancer (elle aussi), pour présenter ses excuses alors qu’il n’a pas souvenir de ses torts. Elle lui apprend que leur père avait abusé d’elle.
« C’était déconcertant à un âge aussi avancé de découvrir que votre récit familial, celui que vous aviez porté en vous, celui dans lequel, dans un sens, vous aviez vécu, était faux, ou, à tout le moins, que vous en aviez ignoré la vérité la plus essentielle, qu’elle vous avait été cachée. Si l’on ne vous dit pas toute la vérité, et Sister avec son expérience de la justice le savait parfaitement bien, c’est comme si on vous racontait un mensonge. Ce mensonge avait constitué sa vérité à lui. C’était peut-être cela la condition humaine : vivre dans des fictions créées par des contre-vérités ou par la dissimulation des vérités réelles. Peut-être la vie humaine était-elle dans ce sens véritablement fictive, car ceux qui la vivaient ne savaient pas qu’elle était irréelle.
Et puis il avait écrit sur une gamine imaginaire dans une famille imaginaire et il l’avait dotée d’un destin très proche de celui de sa sœur, sans même savoir à quel point il s’était approché de la vérité. Avait-il, quand il était enfant, soupçonné quelque chose, puis, effrayé de ce qu’il avait deviné, avait-il enfoui cette intuition si profondément qu’il n’en gardait aucun souvenir ? Et est-ce que les livres, certains livres, pouvaient accéder à ces chambres secrètes et faire usage de ce qu’ils y trouvaient ? Il était assis au chevet de Sister rendu sourd par l’écho entre la fiction qu’il avait inventée et celle dans laquelle on l’avait fait vivre. »
Sister et son mari (un juge qui aime s’habiller en robe de soirée) se suicident ensemble avec le « spray InSmileTM » qu’il a apporté à sa demande. Le Dr R. K. Smile charge Quichotte d’une livraison du même produit pour… Salma !
« …] elle passait à la télévision, sur le mode agressif, son monologue introductif portant le titre de “Errorisme en Amérique” ce qui lui permettait à elle et à son équipe de scénaristes de s’en prendre à tous les ennemis de la réalité contemporaine : les adversaires de la vaccination, les fondus du changement climatique, les nouveaux paranoïaques, les spécialistes des soucoupes volantes, le président, les fanatiques religieux, ceux qui affirment que Barack Obama n’est pas né en Amérique, ceux qui soutiennent que la Terre est plate, les jeunes prêts à tout censurer, les vieux cupides, les trolls, les clochards bouddhistes, les négationnistes, les fumeurs d’herbe, les amoureux des chiens (elle détestait qu’on domestique les animaux) et la chaîne Fox. “La vérité, déclamait-elle, est toujours là, elle respire encore, ensevelie sous les gravats des bombes de la bêtise. »
Des troubles visuels et d’autres signes rappellent la théorie de l’effilochement de la réalité dans un cosmos en amorce de désagrégation.
Le nouveau Galaad rencontre Salma pour lui remettre cette « potion » qui devait la rendre amoureuse de lui ; son message d’amour ne passe pas, et Salma fait une overdose avec le produit du Dr R. K. Smile, qui est arrêté pour trafic de stupéfiants (bizarrement, se greffe un chef d’inculpation portant sur son comportement incorrect avec les femmes…).
Maintenant, la télévision s’adresse directement à Quichotte, et son pistolet lui conseille de tuer Salma, sortie de l’hôpital mais dorénavant inatteignable. Sancho, qui lui aussi s’est trouvé une dulcinée et s’émancipe de plus en plus, agresse sa tante pour la voler ; il a changé depuis qu’il a été victime d’une agression raciste.
« Depuis qu’il avait été passé à tabac dans le parc, Sancho avait eu l’impression que quelque chose n’allait pas en lui, rien de physique, plutôt un trouble d’ordre existentiel. Quand vous avez été sévèrement battu, la part essentielle de vous-même, celle qui fait de vous un être humain, peut se détacher du monde comme si le moi était un petit bateau et que l’amarre le rattachant au quai avait glissé de son taquet laissant le canot dériver inéluctablement vers le milieu du plan d’eau, ou comme si un grand bateau, un navire marchand, par exemple, se mettait, sous l’effet d’un courant puissant, à chasser sur son ancre et courait le risque d’entrer en collision avec d’autres navires ou de s’échouer de manière désastreuse. Il comprenait à présent que ce relâchement n’était peut-être pas seulement d’ordre physique mais aussi éthique, que, lorsqu’on soumettait quelqu’un à la violence, la violence entrait dans la catégorie de ce que cette personne, jusque-là pacifique et respectueuse des lois, allait inclure ensuite dans l’éventail des possibilités. La violence devenait une option. »
Des « ruptures dans le réel » et autres « trous dans l’espace-temps » signalent de plus en plus l’imminente fin du monde.
Dans des propos tenus à son fils Son, « l’Auteur » met en abyme dans la fiction le projet de l’auteur.
« “Tant de grands écrivains m’ont guidé dans cette voie”, dit-il ; et il cita aussi Cervantès et Arthur C. Clarke. “C’est normal de faire ça ? demanda Son, ce genre d’emprunt ?” Il avait répondu en citant Newton, lequel avait déclaré que s’il avait été capable de voir plus loin c’était parce qu’il s’était tenu sur les épaules de géants. »
« Il essaya de lui expliquer la tradition picaresque, son fonctionnement par épisodes, et comment les épisodes d’une œuvre de ce genre pouvaient adopter des styles divers, relevé ou ordinaire, imaginatif ou banal, comment elle pouvait être à la fois parodique et originale et ainsi, au moyen de ses métamorphoses impertinentes, mettre en évidence et englober la diversité de la vie humaine. »
« Je pense qu’il est légitime pour une œuvre d’art contemporaine de dire que nous sommes paralysés par la culture que nous avons produite, surtout par ses éléments les plus populaires, répondit-il. Et par la stupidité, l’ignorance et le sectarisme, oui. »
Dans la septième vallée, celle de l’annihilation d’un monde apocalyptique livré aux vides, Quichotte (et son pistolet) convainc Salma d’aller avec lui au portail d’Evel Cent en Californie pour fuir dans la Terre voisine : celle de l’Auteur.
C’est excellemment conté, plutôt foutraque et avec humour, mais en jouant de tous les registres de la poésie au polar en passant par le picaresque ; relativement facile à suivre, quoique les références, notamment au show business, soient parfois difficiles à saisir pour un lecteur français. Beaucoup de personnages et d’imbroglios dans cette illustration de la complexité du monde. De nombreuses mises en abîme farfelues, comme l’histoire des mastodontes (dont certains se tenant sur les pattes arrière et portant un costume vert), perturbent chacun des deux fils parallèles en miroir (celui de Quichotte et celui de Brother), tout en les enrichissant. Récurrences (jeu d’échec, etc.), intertextualité (le « flétan », qui rappelle Günter Grass, etc.). J’ai aussi pensé à Umberto Eco, Philip K. Dick.
\Mots-clés : #Contemporain #ecriture #famille #Identite #immigration #initiatique #Mondialisation #racisme #sciencefiction #XXeSiecle
- le Sam 4 Mar - 12:51
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Salman Rushdie
- Réponses: 18
- Vues: 1481
John Le Carré
Un homme très recherché
Peu après le 11 septembre, Issa Karpov, le mystérieux fils tchétchène d’un colonel de l’Armée rouge décédé, arrive clandestinement à Hambourg (port cosmopolite qui abrita une cellule islamiste impliquée dans l’attentat) ; il a été torturé en Russie et en Turquie, et prétend étudier la médecine, envoyé par Allah. Annabel Richter, une jeune avocate idéaliste de gauche, le met en rapport avec Tommy Brue, un banquier dont le père a créé un compte d’argent blanchi pour son père, associé à la mafia et au massacre des musulmans russes ; les services secrets s’intéressent à lui.
« En fac de droit, on discutait beaucoup de la primauté de la loi sur la vie. C’est un principe fondamental qui traverse toute l’histoire de l’Allemagne : la loi n’est pas faite pour protéger la vie, mais pour l’étouffer. Nous l’avons appliqué aux Juifs. Adapté à l’Amérique d’aujourd’hui, ce même principe autorise la torture et l’enlèvement politique. »
À son habitude, Le Carré dépeint de beaux portraits de ses personnages (notamment des agents secrets), ainsi qu'un contexte géopolitique international occulte, et crédible.
« S’il existe en ce monde des gens prédestinés à l’espionnage, Bachmann était de ceux-là. Rejeton polyglotte d’une extravagante Germano-Ukrainienne ayant contracté une série de mariages mixtes, unique officier de son service censé n’avoir rien réussi à l’école si ce n’est se faire renvoyer définitivement du lycée, avant l’âge de trente ans Bachmann avait bourlingué sur toutes les mers du globe, fait du trekking dans l’Hindou Kouch et de la prison en Colombie, et écrit un roman impubliable d’un millier de pages.
Pourtant, au fil de ces expériences invraisemblables, il avait découvert son patriotisme et sa vraie vocation, d’abord en tant qu’auxiliaire irrégulier d’un lointain avant-poste allemand, puis en tant qu’agent expatrié sans couverture diplomatique à Varsovie pour sa connaissance du polonais, à Aden, Beyrouth, Bagdad et Mogadiscio pour son arabe, et enfin à Berlin pour ses péchés, condamné à y végéter après avoir engendré un scandale quasi épique dont seuls quelques détails avaient atteint le moulin à ragots : un excès de zèle, dirent les rumeurs, une tentative de chantage malavisée, un suicide, un ambassadeur allemand rappelé en hâte. »
Sont particulièrement intéressants les discours manipulateurs des agents de renseignement et surtout des officiers traitants.
« Pas étonnant qu’elle n’arrive pas à dormir. Il lui suffisait de poser la tête sur l’oreiller pour revivre avec un réalisme criant ses nombreuses et diverses prestations de la journée. Ai-je outré mon intérêt pour le bébé malade de la standardiste du Sanctuaire ? Quelle image ai-je projetée quand Ursula a suggéré qu’il était temps pour moi de prendre des vacances ? Et pourquoi l’a-t-elle suggéré d’ailleurs, alors que je me terre derrière ma porte close pour donner l’impression que je remplis diligemment mes fonctions ? Et pourquoi en suis-je venue à me considérer comme le légendaire papillon d’Australie dont le battement d’ailes peut déclencher un tremblement de terre à l’autre bout de la planète ? »
« …] malgré tous les fabuleux joujoux d’espions high-tech qu’ils avaient en magasin, malgré tous les codes magiques qu’ils décryptaient et toutes les conversations suspectes qu’ils interceptaient et toutes les déductions brillantes qu’ils sortaient d’une pochette-surprise concernant les structures organisationnelles de l’ennemi ou l’absence desdites, malgré toutes les luttes intestines qu’ils se livraient, malgré tous les journalistes soumis qui se disputaient l’honneur d’échanger leurs scoops douteux contre des fuites calculées et un peu d’argent de poche, au bout du compte, ce sont toujours l’imam humilié, le messager secret malheureux en amour, le vénal chercheur travaillant pour la Défense pakistanaise, l’officier subalterne iranien oublié dans la promotion, l’agent dormant solitaire fatigué de dormir seul, qui à eux tous fournissent les renseignements concrets sans lesquels tout le reste n’est que du grain à moudre pour les manipulateurs de vérité, idéologues et politopathes qui mènent le monde à sa perte. »
« Nous ne sommes pas des policiers, nous sommes des espions. Nous n’arrêtons pas nos cibles. Nous les travaillons et nous les redirigeons contre des cibles plus importantes. Quand nous identifions un réseau, nous l’observons, nous l’écoutons, nous le pénétrons et nous en prenons peu à peu le contrôle. Les arrestations ont un impact négatif. Elles détruisent des acquis précieux. Elles nous renvoient à la case départ, elles nous obligent à chercher un autre réseau qui serait même deux fois moins bien que celui qu’on vient de foutre en l’air. »
Le Dr Abdullah est un érudit installé en Allemagne qui « représente beaucoup de grandes organisations caritatives musulmanes », et il est pressenti pour répartir pieusement l’argent « impur » de l’héritage d’Issa, car c’est un homme de bien – mais peut-être y a-t-il chez lui ne serait-ce que 5 % de mal ?
Cette histoire fait intervenir les services secrets allemands, anglais et américains, avec leurs guerres intestines, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique, jusqu'au triomphe final des États-Unis et de leur puissant système de non-droit.
Le suspense m’est paru particulièrement bien mené. Je renvoie aux subtils commentaires de Marie et Shanidar.
\Mots-clés : #contemporain #discrimination #espionnage #immigration #justice #minoriteethnique #politique #psychologique #religion #terrorisme #xxesiecle
- le Ven 21 Oct - 13:04
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: John Le Carré
- Réponses: 33
- Vues: 2605
Philip Roth
Patrimoine, Une histoire vraie
Récit apparemment factuel des rapports de Philip Roth avec son père (86 ans). En chemin pour lui annoncer qu’il a une tumeur au cerveau, Roth fils s’égare et aboutit par hasard au cimetière où est enterrée sa mère (ainsi que bientôt son père) :
« Ma mère et les autres morts avaient été amenés ici par la force impérieuse de ce qui, somme toute, était un hasard encore plus improbable : le fait d’avoir, un temps, vécu. »
Pugnace, à la fois vulnérable et tenace, inflexible et angoissé, son père n’a pas un caractère très facile :
« Au lieu de me traiter comme un membre de ta famille, sois gentil et imagine-toi que tu es toujours directeur d’une compagnie d’assurances. »
« Mais de notre père, comme il était notre père, on n’aurait pu attendre qu’il comprît. Il ne comprenait, comme nous tous d’ailleurs, que ce qu’il comprenait, mais cela, il le comprenait farouchement. »
Dans ce portrait approfondi d’un père (et par ricochet du fils), il me semble qu’est démontrée l’énigmatique complexité d’une personnalité, présentant simultanément des caractéristiques contradictoires tant que son image n’est pas stylisée, stéréotypée par la fiction.
Très bien écrit, et aussi touchant, comme l’a noté Topocl.
C’est aussi beaucoup l’héritage de la culture juive et de l’immigration.
C’est encore le sordide de la maladie, la déchéance de la vieillesse, et la fatalité de la mort.
« Mourir est un travail, et c’était un travailleur. Mourir est quelque chose d’horrible, et mon père était en train de mourir. Je lui pris la main qui, elle au moins, donnait encore l’impression d’être sa main ; je lui caressai le front qui lui, au moins, donnait encore l’impression d’être son front ; et je lui dis toutes sortes de choses qu’il n’était plus en mesure de comprendre. Heureusement, il n’y avait dans ce que je lui dis au cours de cette matinée rien qu’il ne sût déjà. »
\Mots-clés : #immigration
- le Jeu 15 Sep - 13:40
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Philip Roth
- Réponses: 111
- Vues: 11787
Bruno Latour
Où atterrir − Comment s’orienter en politique
Incipit de cet ouvrage de 2017 :
« Cet essai n’a pas d’autre but que de saisir l’occasion de l’élection de Donald Trump, le 11 novembre 2016, pour relier trois phénomènes que les commentateurs ont déjà repérés mais dont ils ne voient pas toujours le lien − et par conséquent dont ils ne voient pas l’immense énergie politique qu’on pourrait tirer de leur rapprochement.
Au début des années 1990, juste après la "victoire contre le communisme" symbolisée par la chute du mur de Berlin, à l’instant même où certains croient que l’histoire a terminé son cours, une autre histoire commence subrepticement.
Elle est d’abord marquée par ce qu’on appelle la "dérégulation" et qui va donner au mot de "globalisation" un sens de plus en plus péjoratif ; mais elle est aussi, dans tous les pays à la fois, le début d’une explosion de plus en plus vertigineuse des inégalités ; enfin, ce qui est moins souvent souligné, débute à cette époque l’entreprise systématique pour nier l’existence de la mutation climatique. ("Climat" est pris ici au sens très général des rapports des humains à leurs conditions matérielles d’existence.)
Cet essai propose de prendre ces trois phénomènes comme les symptômes d’une même situation historique : tout se passe comme si une partie importante des classes dirigeantes (ce qu’on appelle aujourd’hui de façon trop vague les "élites") était arrivée à la conclusion qu’il n’y aurait plus assez de place sur terre pour elles et pour le reste de ses habitants.
Par conséquent, elles ont décidé qu’il était devenu inutile de faire comme si l’histoire allait continuer de mener vers un horizon commun où "tous les hommes" pourraient également prospérer. Depuis les années 1980, les classes dirigeantes ne prétendent plus diriger mais se mettre à l’abri hors du monde. De cette fuite, dont Donald Trump n’est que le symbole parmi d’autres, nous subissons tous les conséquences, rendus fous par l’absence d’un monde commun à partager. »
« Aux migrants venus de l’extérieur qui doivent traverser des frontières au prix d’immenses tragédies pour quitter leur pays, il faut dorénavant ajouter ces migrants de l’intérieur qui subissent, en restant sur place, le drame de se voir quittés par leur pays. Ce qui rend la crise migratoire si difficile à penser, c’est qu’elle est le symptôme, à des degrés plus ou moins déchirants, d’une épreuve commune à tous : l’épreuve de se retrouver privés de terre. »
« Si l’hypothèse est juste, tout cela participe du même phénomène : les élites ont été si bien convaincues qu’il n’y aurait pas de vie future pour tout le monde qu’elles ont décidé de se débarrasser au plus vite de tous les fardeaux de la solidarité − c’est la dérégulation ; qu’il fallait construire une sorte de forteresse dorée pour les quelques pour-cent qui allaient pouvoir s’en tirer − c’est l’explosion des inégalités ; et que pour, dissimuler l’égoïsme crasse d’une telle fuite hors du monde commun, il fallait absolument rejeter la menace à l’origine de cette fuite éperdue − c’est la dénégation de la mutation climatique.
Pour reprendre la métaphore éculée du Titanic : les classes dirigeantes comprennent que le naufrage est assuré ; s’approprient les canots de sauvetage ; demandent à l’orchestre de jouer assez longtemps des berceuses, afin qu’ils profitent de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte excessive alerte les autres classes ! »
La parade des « élites obscurcissantes » est l’expression « réalité alternative ».
Cet essai constitue là une approche salutaire des problèmes actuels d’identité et de migration – dans la société globale : l’illusion des frontières étanches, tant pour les tenants de la mondialisation que pour ceux du local, les progressistes et les réactionnaires.
Le vecteur qui allait de l’ancien au nouveau, du Local au Global, n’est plus le sens de l’histoire (de même la différence Gauche-Droite). Un troisième attracteur se dégage, « Terrestre » (ou écologique, et opposé au Hors-Sol) : c’est le fameux « pas de côté ». À l’aune de la lutte des classes se substituent les conflits géo-sociaux.
L’erreur épistémologique à propos de la notion de nature, confusion entre nature-univers et nature-processus :
« On va se mettre à associer le subjectif avec l’archaïque et le dépassé ; l’objectif avec le moderne et le progressiste. Voir les choses de l’intérieur ne va plus avoir d’autre vertu que de renvoyer à la tradition, à l’intime, à l’archaïque. Voir les choses de l’extérieur, au contraire, va devenir le seul moyen de saisir la réalité qui compte et, surtout, de s’orienter vers le futur. »
L’hypothèse Gaïa :
« Si la composition de l’air que nous respirons dépend des vivants, l’air n’est plus l’environnement dans lequel les vivants se situent et où ils évolueraient, mais, en partie, le résultat de leur action. Autrement dit, il n’y a pas d’un côté des organismes et de l’autre un environnement, mais une superposition d’agencements mutuels. L’action est redistribuée. »
« La simplification introduite par Lovelock dans la compréhension des phénomènes terrestres n’est pas du tout d’avoir ajouté de la "vie" à la Terre, ni d’avoir fait de celle-ci un "organisme vivant", mais, tout au contraire, d’avoir cessé de nier que les vivants soient des participants actifs à l’ensemble des phénomènes bio- et géochimiques. Son argument réductionniste est l’exact contraire d’un vitalisme. »
« Dire : "Nous sommes des terrestres au milieu des terrestres", n’introduit pas du tout à la même politique que : "Nous sommes des humains dans la nature." »
La nécessaire cohabitation sur un territoire renvoie à Vinciane Despret et Baptiste Morizot, comme les notions d’économie à Piketty, la notion de nature à Descola, l’apport des pratiques d’autres cultures à Nastassja Martin… qui ont leur fil sur le forum, prêt à être tissé avec d’autres.
\Mots-clés : #actualité #ecologie #essai #historique #immigration #mondialisation #nature #politique #science #social
- le Sam 12 Mar - 13:02
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Bruno Latour
- Réponses: 13
- Vues: 1135
Vénus Khoury-Ghata
Quelque part en Afrique sub-saharienne (en Érythrée apprendrons-nous au fil du roman), une jeune femme suit, de gré, un photographe aux cheveux jaunes qui la mitraille de son appareil photo.
Son mari et ses enfants la recherchent jusqu'en Andalousie (Séville), où elle trône sur les affiches publicitaires. Puis elle quitte le photographe pour un écrivain, et sa truculente femme de ménage Amalia.
S'ensuit une histoire complètement hallucinante, dans laquelle les enfants, aidés d'un géant noir nommé Baobab, habillent la nuit les affiches dénudées montrant leur mère, tandis que le père se fond dans la masse plus ou moins ingénieuse des clandestins et autres sans-papiers pour gagner sa vie.
Après bien des péripéties, les top-models de couleur noire s'avèrent ne plus être à la mode, laquelle s'est reportée sur les slaves éthéreés...
Livre non dénué de tendresse, ni d'amour, ni d'humour.
Vénus Khoury-Ghata en mode foutraque a décidé de s'amuser, bien que le thème soit de première lourdeur, et, tour de force, sans escamotage, sans galvauder la profondeur du sujet; à titre personnel je lui en sais gré.
Un style imagé, servi par une écriture maîtrisée à la technique éprouvée (l'avantage de ces auteurs qu'on dit avancés en âge, sans doute...?), des touches réellement poétiques, une peinture des âmes dites simples, un rendu d'ensemble très facile et coulé au service d'une cocasserie qui rend léger ce petit ouvrage, lequel avait pourtant tout pour ne pas l'être:
S'il l'on confiait le sujet douloureux et les protagonistes fragiles à toute autre plume, n'obtiendrions-nous pas un mélo dans neuf productions sur dix ?
Marcher sur la pointe des pieds pour ne pas alerter le maître qui n'aime pas les enfants, dormir le plus souvent possible, sortir de la chambre et manger quand il dort.
Zina et Zeit hochent la tête pour dire qu'ils ont compris.
Mais la secouent lorsque la mère leur annonce qu'ils iront dans peu de temps dans un pensionnat.
"C'est quoi un pensionnat ?
- Une école où on dort et mange trois fois par jour.
- Dormir trois fois par jour ?"
Autant leur dire que la lune a mangé toutes les étoiles du ciel et roté leurs arêtes sur le désert.
De sa voix brutale, la mère énumère les exigences d'admission en pensionnat.
Des enfants propres, des habits propres. Des cahiers et des chaussures propres, un crayon à papier taillé et surtout pas de poux dans la tête.
Zina et Zeit sont d'accord pour le spoux, les cahiers, les crayons et les chaussures mais à condition de ne pas s'éloigner de la mère. Ils ont eu tant de mal pour la retrouver.
Et pourquoi le pensionnat ?
Ils sont assez grands pour remplir trois cahiers avec les mots qu'ils ont appris depuis leur arrivée dans le pays.
Conocer, no conocer, bono, no bono. Auxquels il faudra ajouter gracia Señor el filosofo appliqué au maître des lieux.
Dire qu'ils le prenaient pour un escritor.
"Un gran escritor, précise Amalia dans sa cuisine, son crayon est si long qu'il touche le plafond."
\Mots-clés : #enfance #exil #famille #immigration #misere #social
- le Dim 14 Fév - 16:25
- Rechercher dans: Écrivains du Proche et Moyen Orient
- Sujet: Vénus Khoury-Ghata
- Réponses: 27
- Vues: 6859
Louise Erdrich
La Chorale des maîtres bouchers
À la fin de la Première Guerre mondiale, le jeune Fidelis Waldvogel rentre du front et rencontre Eva, la fiancée enceinte de son ami mort au combat, et l’épouse. Puis, quittant l’Allemagne défaite, il part en Amérique, avec une valise de saucisses fumées pour payer le voyage (et ses couteaux de boucherie) jusqu’à Argus, Dakota du Nord, où Eva et Frank le rejoindront. Ils rencontreront ensuite Cyprian Lazarre l’équilibriste et sa partenaire Delphine, Roy le père ivrogne de cette dernière, et son amie d’enfance Clarisse l’embaumeuse. Les protagonistes hauts en couleur sont souvent remarquables, comme Un-Pas-Et-Demi la chiffonnière, mais « Tante » est caricaturale.
Au début, Fidelis paraît être le personnage principal (qui sera plutôt Delphine), et semble trop parfait :
« Avant de le rencontrer, elle sentit sa présence, tel un afflux de courant électrique dans l’air lorsque les nuages sont bas et que la foudre passe en bondissant sur la terre. Puis elle sentit une pesanteur. Un champ de gravité lui traversa le corps. Elle essayait de se lever, de chasser cette sensation, lorsqu’il remplit brusquement tout l’encadrement de la porte. Puis il entra et remplit toute la pièce.
Ce n’était pas sa taille. Il n’était pas extraordinairement grand, ni large. Mais de lui émanait une puissance, comme s’il contenait un homme plus grand tassé à l’intérieur. Ou était-ce, pourquoi pas, qu’il était bourré de hurlements d’animaux ? C’était peut-être ses épaules musclées, ou son silence attentif. »
C’est un roman à la fois classique et original sur le rêve américain, relevé de quelques scènes épouvantables et surtout de bizarreries dont on ne sait si elles sont des maladresses dues à la traduction :
« …] il devait abattre une truie primée appartenant aux Mecklenberg, et la décréer en côtelettes, filet, jambons, jarrets, pieds en saumure, lard maigre, bacon et saucisses. »
« D’un coup de talon, il referma avec soin la porte derrière eux, puis déposa Delphine sur le couvre-lit jaune d’or, froid et glissant. »
Il y a une évidente part d’inspiration puisée par Erdrich dans son vécu (mari allemand, etc.), et la Seconde Guerre mondiale sera un dilemme pour les États-Uniens d’origine allemande ; le livre critique par moments la société états-unienne.
« Une réclame pour du chewing-gum laissant entendre qu’une tablette dans chaque lettre combattrait la solitude, et aviverait même les facultés d’observation des troupes. "Voilà comment nous sommes dans ce pays, cria-t-elle. La destruction est une façon de vendre du chewing-gum !" »
Les odeurs (pas forcément agréables) sont prégnantes.
« Elle sentait les érables, les pins, le suintement de la rivière plutôt que l’odeur crue, primitive et caverneuse des bœufs que l’on ouvre. »
Certaines observations psychologiques me paraissent douteuses :
« Par contraste, Clarisse réservait sa précision à son métier et négligeait sa maison, tenait les lieux dans un état de désordre féminin. »
Erdrich a une sensibilité particulière, qui occasionne de beaux passages.
« En entrant dans la cuisine d’Eva, quelque chose de profond arriva à Delphine. Elle ressentit une fabuleuse expansion de son être. Prise de vertige, elle eut l’impression d’une chute en vrille et puis d’un silence, à la façon d’un oiseau qui se pose. »
On peut s’interroger sur une influence amérindienne de sa perception du monde.
« Si je meurs, ne soyez pas trop tristes, leur recommanda-t-elle, la mort n’est qu’une partie de choses plus vastes que ce que nous pouvons imaginer. Nos cerveaux entament simplement ce qui est grand, pour apprendre comment faire des choses telles que voler. Et après ? Vous verrez, et vous verrez que votre mère fait partie du plan d’ensemble. Et je serai toujours composée de choses, et les choses seront toujours composées de moi. Rien ne peut se débarrasser de moi parce que je suis déjà contenue dans le motif. »
Mais j’ai regretté une certaine outrance, et une sorte de manque de cohérence dans l’ensemble.
Il me semble que l’œuvre de Louise Erdrich s’apparente à celle de Joyce Carol Oates (mais je n’ai pas assez lu celle-ci pour être affirmatif), ou plus largement à Jean-Christophe Grangé et consorts (même remarque).
\Mots-clés : #famille #immigration #viequotidienne #xixesiecle
- le Ven 29 Jan - 13:17
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Louise Erdrich
- Réponses: 37
- Vues: 2870
NG Kim Chew
Le livre se compose de 7 tableaux sous la pluie.
Une famille de migrants Chinois installés en Malaisie, exploitent leur plantation d’hévéas ; dur travail de saigner les arbres pour récupérer le latex dont la vente est le principal revenu.
Cette famille se compose du père, de la mère et de Sin leur fils, du moins dans le premier tableau, car par la suite s’ajoutent des sœurs à la famille mais j’ai cru comprendre que le destin d’une autre famille était aussi relaté, famille où le fils s’appelle aussi Sin. Quelques tableaux plus tard je saisi le fait que le premier enfant Sin était en fait l’oncle du deuxième Sin.
La plantation est située dans la jungle malaisienne qui abrite beaucoup d’animaux dangereux dont le fameux tigre de Malaisie dont l’un des enfants sera la proie, car on meurt souvent brutalement et atrocement dans ces récits. Comment pourraient-il en être autrement quand on vit dans la jungle, dans la pauvreté, loin de la ville, avec pour moyen de défense seulement des bâtons, des couteaux et de nombreux chiens pour alerter.
Les prières, les rites qui s’élèvent vers les divers Dieux, n’éloigneront pas la pluie incessante durant de nombreux jours, les agressions, puis l’arrivée de l’armée japonaise (qui déjà avait conduit la famille à fuir la Chine) qui exerce ses exactions sous l’invite des malaisiens du coin, à l’encontre des Chinois migrants et donc de la famille de Sin.
Les rêves se confondent avec la réalité ou bien c’est la réalité qui se fond dans les rêves. Les esprits aimables ou méchants s’invitent souvent dans la vie de la famille.
Malgré leur culture la mère est assez pragmatique et n’hésite pas à contrevenir aux lois quand cela sert la famille.
***
Ces tableaux de vie sont contés avec tant de poésie que la lecture de ce petit livre est très agréable malgré l’étrangeté.L’arrivée dans la plantation de l’armée japonaise est l’occasion de rappeler, leur invasion de la Chine, les nombreuses tueries dans des villes, puis par la suite, la demande de participation et de soutien auprès des Chinois migrants des révolutionnaires Chinois.
Les relations entre les membres de la famille sont intéressantes, voire étonnantes.
Je vous engage à faire cette lecture.
Extraits
La lecture s’ouvre sur un très beau poème :
« Jours de pluie
Après la longue sécheresse, voici les jours de pluie, continus
comme si les clartés n’allaient plus revenir
Dans l’arrière-cour les vêtements mouillés pendent, pesants
Les grenouilles pondent dans les ourlets des pantalons
Elles bondissent effrayées éclaboussant le mur
Le sol en ciment trempé, glissant,
reflète ton mal du pays
comme un poisson
dans un marais à sec
Les pages des livres, gorgées d’eau, gondolent
Des pousses d’herbes ont germé dans les mots, entre les lignes de caractères
Des cernes du bois des étagères sortent
de chatouilleuses
têtes de champignons
Comme cette année où avaient poussé sur l’arbre
contre lequel le père souvent appuyait son échelle
de nombreux champignons en forme d’oreille
petits et grands, ici et là,
pour écouter le bruit de la pluie
le bruit du vent
Bien des années après sa mort, pendant la mousson,
une sandale en plastique abandonnée dans la boue
se souvenait encore des cals obstinés de sa plante de pied
Alors, dans la forêt d’hévéas
où de grands éclairs poursuivaient de petits éclairs parmi les nuages,
la mère a dit tout doucement :
« Le feu a ri, à cette heure-là,
quelqu’un va-t-il encore venir ? »
« Les frondaisons des arbres sont luxuriantes.
Après tant d’années déjà, le chemin est presque comme dans ses souvenirs, il n’a pas beaucoup changé. Il s’étend toujours tranquillement, les feuilles mortes ne l’ont pas recouvert. Là où l’herbe ne pousse pas, c’est le chemin. Il ne change d’aspect qu’au moment des grandes pluies, quand les précipitations le submergent. Quelques feuilles s’entassent au milieu du petit chemin, retenues par les racines qui le traversent. Mais elles seront bien vite repoussées sur le côté par les marcheurs, tout comme les racines qui font trébucher seront coupées, mises à nu.
La grosse pluie de la veille au soir a trempé les arbres. Les feuilles éparpillées sur le sol ont recueilli l’eau, de la vapeur s’en échappe, elles luisent. Les araignées s’affairent à réparer leurs toiles anéanties par la pluie, elles dévident leur fil de la pointe des herbes au tronc des arbres, font des allers-retours dans les fourrés. Sur les toiles, des gouttelettes scintillantes restent accrochées.
Et le ciel est maintenant d’un azur limpide. «
« Elle s’approche pas à pas et lui tend la bouteille. Il distingue progressivement ce qui est dedans – on dirait une peinture ou des figurines d’argile –, dans le goulot il y a une espèce de chose blanche et ronde qui lui rappelle du coton, le fond est tout noir, d’innombrables gouttelettes tombent sur ce qui ressemble à des cimes d’arbres verts. Au fond de la bouteille, en forme de motte brune, on dirait un tertre sur lequel ont poussé une dizaine de maigres arbres ; entre les arbres, une maison au toit de tôle en zinc, sous l’auvent sont posés deux vélos noirs. En y regardant de plus près, il voit un homme minuscule, d’âge moyen, assis sur une chaise en rotin, une pipe à la bouche, qui regarde le ciel, l’air complètement détendu. A côté de lui, un chien jaune, un chien blanc et un chien noir sont couchés. De l’autre côté, une femme est assise avec deux enfants sur un long banc. Ils la regardent avec une grande attention, ils semblent écouter cette femme qui raconte une histoire en faisant de grands gestes. »
« A-Yeh a brusquement cessé de téter, elle ne boit plus que du lait concentré Milkmaid. Elle est encore petite, il y doit y avoir quelque chose qu’elle ne comprend pas. Est-ce que le goût de son lait ne serait plus bon ? Elle demande à Sin d’en prendre une gorgée, pour voir, mais il secoue la tête, non, il ne veut pas. Elle en tire un peu dans une cuillère pour le goûter, eh bien c’est toujours le même lait, fade et légèrement sucré. Si personne ne lui en prend, ses seins vont enfler et lui faire mal. Cela devient bientôt insupportable, et Sin refuse toujours de la soulager, au moment de se coucher, il lui faut ôter son soutien-gorge. Ses deux seins pendent, pesants, elle souffre plusieurs jours durant. Un matin au chant du coq, elle s’aperçoit, chose incroyable, que la douleur a disparu, quelques boutons de son chemisier sont ouverts, elle sent qu’elle a été tétée avec avidité, sur le bout de son sein il reste un peu de salive. La bouche l’a quitté à l’instant même où elle s’est réveillée. Elle va jeter un coup d’œil aux enfants, ils sont tous les deux profondément endormis. Elle regarde d’un peu plus près, aucune trace de lait au coin de leur bouche ; elle hume, pas d’odeur de lait. Et si c’était… le fantôme de ce sacré A-To ? Mais comment serait-ce donc possible ? »
« Un jour, profitant d’être allée faire les courses, elle se rend au temple prier pour ses enfants et s’enquérir de ses affaires à elle. A sa grande surprise, le vieil aveugle du temple prend un ton mystérieux pour lui déclarer : « Dans ton ventre, il y a une grenouille. » Après cette déclaration, elle trouve encore le temps de courir à la consultation ouverte par le médecin indien. Une fois le diagnostic établi, elle se fait opérer et supplie le médecin aux bras couverts de poils noirs de saisir cette occasion pour la ligaturer. Plus tard, elle se souviendra toujours de ces deux mains avant qu’elles soient gantées, et après, quand les gants ont été jetés. Elle n’a pas osé regarder ce qu’on a extrait de son ventre, pas osé vérifier s’il s’agissait d’une grenouille – qu’elle soit enceinte d’une grenouille ou d’un poisson, les deux choses seraient horribles. Et elle ne voulait pas non plus savoir comme c’était arrivé là. »
« Le prêtre taoïste recommande à Sin de servir pendant cent jours un bol de nourriture à son père lors des repas, comme s’il était encore en vie. Au bout de deux jours à peine, la femme d’A-To n’y tient plus. Donner des bons plats aux chiens et aux fourmis ? Un petit bol de riz suffira, pas la peine de varier les plats.
Sin ne parle presque plus. »
Mots-clés : #famille #immigration #lieu #ruralité
- le Sam 31 Oct - 18:20
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: NG Kim Chew
- Réponses: 3
- Vues: 377
Blaise Cendrars
L'or

Sous-titré: La Merveilleuse Histoire du général Johann August Suter.
Roman, 1925, 160 pages environ.

Sous-titré: La Merveilleuse Histoire du général Johann August Suter.
Roman, 1925, 160 pages environ.
[relecture]
Accueil mitigé à sa sortie pour cet opus, longuement cogité et porté par l'auteur, mais écrit et publié avec célérité. On lui reproche de ne pas avoir fait œuvre de biographe fidèle, d'historien, mais justement c'est ce que Cendrars revendique - comme indiqué en préface il eût pu appeler Alexandre Dumas à la rescousse, selon celui-ci l'Histoire serait "un clou où l'on peut accrocher un beau tableau".
Usant d'effets stylistiques afin d'évoquer, surtout, une trajectoire, le roman prête à une lecture rapide, la course d'un projectile propulsé. Gâcher, çà et là, un peu de peinture afin de soigner davantage les décors et les seconds caractères ne m'eût pas déplu, à titre personnel: de la saveur, certes, dans les ingrédients, petit manque d'épices toutefois.
J-A Suter (Sutter dans la vraie vie), un Suisse de bonne famille, en rupture, passe en fraude en France puis s'embarque pour le Nouveau Monde, et, après moult expédients dont des actes répréhensibles, détours, temporisations, approches, gagne la Californie encore hispanisante et mexicaine, très peu peuplée, y fonde un empire, lequel viendra se fondre dans une Californie annexée pacifiquement à l'Union, avant d'être ruiné par la découverte d'or sur ses terres et la ruée qui s'ensuivit, drainant des flots continus de migrants s'accaparant ses terres, son personnel le quittant pour prospecter, puis, ruine consommée, devient quasi-aliéné (pour ne pas dire complètement fou), avec une phase de récupération par des illuminés mystiques et businessmen, et décéde en tentant de faire valoir ses droits à Washington: un beau sujet.
entame du chapitre 6 a écrit:- Vois-tu, mon vieux, disait Paul Haberposch à Johann August Suter, moi, je t'offre une sinécure et tu seras nourri, logé, blanchi. Même que je t'habillerai. J'ai là un vieux garrick à sept collets qui éblouira les émigrants irlandais. Nulle part tu ne trouveras une situation aussi bonne que chez moi; surtout, entre nous, que tu ne sais pas la langue; et c'est là que le garrick fera merveille, car avec les irlandais qui sont tous de sacrés bons bougres, tous fils du diable tombés tout nus du paradis, tu n'auras qu'à laisser ouvertes tes oreilles pour qu'ils y entrent tous avec leur bon dieu de langue de fils à putain qui ne savent jamais se taire. Je te jure qu'avant huit jours tu en entendras tant que tu me demanderas à entrer dans les ordres.
Un Irlandais ne peut pas se taire, mais pendant qu'il raconte ce qu'il a dans le ventre, mois, je te demande d'aller palper un peu son balluchon, histoire de voir s'il n'a pas un double estomac comme les singes rouges ou s'il n'est pas constipé comme une vieille femme.
Je te donne donc mon garrick, un gallon de Bay-Rhum (car il faut toujours trinquer avec un Irlandais qui débarque, c'est une façon de se souhaiter la bienvenue entre compatriotes), et un petit couteau de mon invention, long comme le coude, à lame flexible comme le membre d'un eunuque. Tu vois ce ressort, presse dessus, na, tu vois, il y a trois petites griffes qui sortent du bout de la lame. C'est bien comme ça, oui. Pendant que tu lui parles d'O'Connor ou de l'acte de l'Union voté par le Parlement, mon petit outil te dira si ton client a le fondement bouché à l'émeri. Tu n'auras qu'à mordre dessus pour savoir si elle est en or ou en plomb, sa rondelle.
Mots-clés : #aventure #colonisation #exil #historique #immigration #independance #justice #mondialisation #voyage #xixesiecle
- le Jeu 10 Sep - 7:12
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Blaise Cendrars
- Réponses: 31
- Vues: 4773
Vénus Khoury-Ghata
Marina Tsvétaïéva, mourir à Elabouga
Boulimique d'écriture et de liaisons, une vie d'une rare dureté, faite d'épreuves dont on ne se relève généralement pas.
Hors ceci, Marina Tsvétaïéva est et restera une poétesse-phare de la langue russe au XXème -si je puis conseiller son recueil Insomnie, lequel s'ouvre sur de très touchants poèmes saphiques-, cet opus de Vénus Khoury-Ghata permet d'apréhender le phénomène:
Marina Tsvétaïéva ce sont plusieurs vies, généralement misérables et déchirées, et un talent multi-facettes boudé de son vivant, du moins après la révolution d'Octobre mais reconnu et pleinement appréhendé de nos jours (autre exemple, ses traductions, surtout celles du russe vers le français, étaient dédaignées à son époque, elles font autorité aujourd'hui).
Le livre s'ouvre sur Marina Tsvétaïéva, revenue en Russie, dans une masure insalubre à Elabouga (Russie), en haillons, qui gratte les sillons de la terre gelée de ses mains pour glaner quelques pommes de terre échappées à la récolte, efin de nourrir son fils Mour, qu'elle se plaît à croire issu de plusieurs pères, avant de se suicider par pendaison au bout de sa trajectoire d'errante misère.
Elle fut de la très haute société moscovite du temps du Tsar, puis épousa un futur Blanc (Serge) contre l'avis paternel (déjà rebelle). Déçue par la France, mais aussi par l'Autriche et l'Allemagne, l'exil de la haute société russe bardée d'argent, par les cercles et coteries littéraires françaises et occidentales, marquée par la mort de faim de sa fille Irina dans un pensionnat et la culpabilité qui va avec, puis par les rapports détestables qu'elle entretient avec sa fille Alia, très douée, qu'elle refuse de mettre en pension et dont elle se sert comme souillon, comme bonne à tout faire. Marina Tsvétaïéva n'a jamais su être mère.
Déçue aussi par Natalie Clifford Barney et Renée Vivien, leur cercle huppé littéraire et saphique, dans lequel, paraissant en haillons (elle, née princesse !) parmi ces belles dames en atours splendides, elle est une curiosité, l'ornithorynque dans le lac aux cygnes.
En dépit de ses engouements, de ses amours, de ses contacts tellement multiples (Rilke avec lequel elle entretint une longue correspondance, Mandelstam, Gorki, Nicolas Granki, André Biely, Anna Akhmatova, Pasternak, Nina Berberova, Ilya Erhenbourg, etc....) elle choisit l'irrémédiable, retourner en Russie prétextant que les littérateurs de l'exil ne valent pas ceux restés au pays, malgré ce que cela signifie: une mort encore plus misérable qu'en occident, la prison ou à tout le moins l'exil (ce sera Elabouga).
Vénus Khoury-Ghata, inspirée, nous narre cela d'une écriture dure, sans concession, aux teintes bleu-froid. Avec son côté cru, son refus d'apitoiement (il eût été si facile de signer une bio qui fût un tantinet mélo, mais la grande dame de Bcharré ne semble pas manger de ce pain-là...).
Volochine a vite compris que tu étais une sauvage incapable de penser comme tout le monde, incapable d'adhérer à un mouvement.
Tu l'amusais alors que tu voulais attirer son attention.
C'est chez lui à Koktebel en Crimée que tu as rencontré le jeune Serge Efron, épousé un an plus tard contre l'avis de ton père incapable de s'opposer à tes désirs. Tu imposais ta volonté, imposais une écriture qui n'avait aucun lien avec celle des poètes qui t'ont précédée.
Tu fascinais, dérangeais. Tu faisais peur.
Mots-clés : #biographie #ecriture #immigration #portrait #violence #xxesiecle
- le Dim 6 Sep - 10:09
- Rechercher dans: Écrivains du Proche et Moyen Orient
- Sujet: Vénus Khoury-Ghata
- Réponses: 27
- Vues: 6859
Russell Banks
Continents à la dérive
Bob Dubois, trente ans, prend conscience qu’il est sans avenir :
« On croit être en vie, mais c’est tout. »
« Leur regard passe comme s’il s’agissait de quelque chose d’invisible, au travers de l’amas informe de McDonald’s et de Burger King, de Kentucky Fried Chicken et de Pizza Hut, long tunnel rectiligne de franchises qu’interrompent par instants des boutiques de prêteurs et des parkings asphaltés où luisent des armadas de Corvette, de Thunderbird, de Camaro et de TransAm et plus loin, derrière les concessionnaires automobiles, entourés de chaînes, des cimetières de voitures, immenses et sens dessus dessous, lugubres, sans couleur, indestructibles. »
Pour changer de vie, il descend avec femme et enfants du New Hampshire en Floride ; mais, dans le Sud, il y a des Noirs, et qui parlent un anglais différent du sien.
Le narrateur omniscient, dans la perspective qu’une vision géopolitique excentrée peut donner (Somalie, Pakistan, Caraïbes), explicite le titre :
« En même temps, le métabolisme de la géologie évolue trop lentement pour qu’il nous soit possible de le percevoir, de sorte que, de la naissance à la mort, il nous semble, prisonniers que nous sommes du battement de nos cœurs humains pris un à un, que tout ce qui se passe sur cette planète est ce qui nous arrive à nous, individuellement, personnellement, secrètement. »
« Systèmes et ensembles, sous-systèmes et sous-ensembles, arrangements et agrégats d’eau, de terre, d’air et de feu – les nommer, les renommer, apprendre l’interdépendance complexe des forces qui les meuvent et les convertissent les uns en les autres, semblable processus nous fournit une vision de la planète comme cellule organique, création sphérique et sans raison dont l’unique dessein est de naître aussi rapidement qu’elle se meurt et dont le principe général, informant ce dessein, comme s’il s’agissait d’un impératif moral, est de se maintenir en mouvement. Révolutions autour d’un certain nombre de points, girations sur des axes, tourbillons et tournoiements, boucles et cercles, ellipses, spirales, courbes longues qui s’élèvent de par l’univers et disparaissent enfin à l’horizon le plus lointain de notre imagination humaine pour réapparaître ici, derrière nous, dans la vie quotidienne de notre corps, dans notre nourriture, notre merde et notre pisse, nos nouveau-nés, ceux qui s’effondrent dans la mort – se mouvoir, toujours, continuer de se reproduire, de pisser et de chier, continuer de manger la planète sur laquelle nous vivons, continuer de s’agiter, seul, par familles, par tribus, par nations, et même par espèces entières : voilà notre seul argument contre l’entropie. Et il ne s’agit pas seulement d’un argument, mais d’une vision. C’est un déni en forme d’assertion, une réfutation en forme d’anecdote, ce qui signifie qu’il s’agit de contes, et non de comptes ; non de représentation, mais de présentation. »
Dans le même temps que la famille Dubois déménage, Vanise Dorsinville, son bébé Charles et son neveu Claude migrent d’Haïti à Miami en passant par Caicos et Nassau, viols et abus divers, sans se départir de la croyance aux loas (esprits vaudou) :
« C’est vrai, voilà maintenant longtemps que nous n’avons pas nourri les loas, alors, aujourd’hui, l’ouragan arrive pour nous rappeler que c’est nous qui vivons pour les morts et non les morts qui vivent pour nous. »
« L’intimité, la connaissance secrète de soi-même sont aux pauvres et aux ignorants, c’est-à-dire à la plupart des gens de ce monde, ce que la notoriété publique est souvent aux personnes riches et éduquées. C’est le meilleur moyen qu’ils possèdent d’empêcher que leur existence ne sombre dans l’absurdité. »
Les croyances et pratiques vaudou (notamment papa Legba, dieu des croisements, et Brav Ghede, esprit de la régénérescence et de la mort) sont présentées par Banks en connaisseur des Grandes Antilles.
La convergence des deux destinées souligne leur contraste, gens du Sud et du Nord, et leur point commun, fuite et rêve (américain) de nouveau départ dans la vie, mais surtout fait partie du scénario lui-même : leur (non-)rencontre requiert la relation préalable de leurs cheminements respectifs.
Les Haïtiens quittent un pays misérable pour souvent trouver la mort. Bob a quitté une situation pour une autre, puis une autre, descendant de plus en plus bas.
« Il a eu de la chance, c’est tout, et c’est la différence essentielle qui existe jusqu’à maintenant entre ma vie et la sienne, conclut Bob. Intelligence, labeur acharné et courage n’ont rien à voir là-dedans. Et la chance ne peut durer toujours, à moins qu’on ne meure jeune. »
« Et ce n’est pas une affaire de chance, Bob sait cela aussi ; la vie n’est pas qu’un simple ensemble de forces aussi irrationnelles que cela ; et bien qu’il ne soit pas un génie, ce n’est pas non plus affaire d’imbécillité pure et simple, il y a trop d’imbéciles qui réussissent dans la vie pour que cela soit. Non, c’est une affaire de rêves. Et tout particulièrement, le rêve d’une vie nouvelle, le rêve de tout recommencer. Plus un homme est prêt à échanger la vie qu’il connaît, celle qu’il a devant lui et qui lui est échue de naissance, modelée par les accidents et les circonstances particulières de sa jeunesse, plus il est disposé à échanger une partie de tout cela contre les rêves d’une vie nouvelle, et moins il a de pouvoir. »
Une phrase qui m’a laissé dubitatif, que ce soit dû à l’auteur ou au traducteur (Marc Chénetier) :
« C’était avant qu’il n’apprît que ce qui clochait chez les riches, ce n’était pas tant qu’ils possédassent ce qu’il désirait, mais qu’ils fussent inconscients, souvent consciemment, du pouvoir qu’ils exerçaient sur la vie des autres. »
Outre l’impression de lire avec plus de trente ans d’avance le compte-rendu de ce qui se passe actuellement en Méditerranée, ce livre engagé (et pessimiste) reste un roman ; je l’ai personnellement trouvé prolixe, surtout dans la narration des états d’âme existentiels et des excursions sexuelles hors mariage de Bob…
Mots-clés : #immigration
- le Sam 29 Aoû - 13:31
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Russell Banks
- Réponses: 42
- Vues: 4170
KOBAYASHI Takiji
Des paysans attiré par « le guide de l’immigrant d’Hokkaidô » rempli de bonnes promesses sur les règles d’obtention de terrains, les revenus et l’espoir de devenir propriétaire de leur parcelle et de la maison, s’installent dans un village du territoire d’Hokkaidô (ce territoire dit extérieur a été acquis pour le rentabiliser par l’Etat).
En fait, les parcelles les mieux situées sont vendues à peu de frais à des nobles ou des propriétaires riches qui ont donc mis les parcelles en fermage pour lesquel les paysans payent un fort loyer.
Alors qu’au bout d’un certain nombre d’années la terre devait appartenir aux fermiers, la promesse, comme sur d’autres territoires d’ailleurs, n’est pas tenue.
Par ailleurs les terres de ce territoire au climat rigoureux ne donnent pas et les fermiers quand une année est encore plus critique à cause du temps, se retrouve sans presque pour se nourrir. C’est donc lors d’une année catastrophique que les fermiers, parmi lesquels deux hommes sont syndicalisés, devant l’intransigeance du propriétaire, décident de demander « l’arbitrage agraire ». Ils s’uniront au syndicat ouvrier d’Otaru pour former une intersyndicale d’ouvriers et de paysans. C’est connu « l’union fait la force ».
Ces paysans incultes pour la plupart s’instruiront auprès des syndicats et avec la sympathie des citoyens de la ville parviendront à faire plier « le propriétaire absent » de l’exploitation Kishino, utilisant tous les « matériaux » syndicaux ; grèves, tracts, réunions publiques…
Le titre du livre montre le fait que les riches propriétaires n’habitent pas dans le village de leur exploitation mais préfèrent les larges possibilités offertes par la ville, les paysans ne sont bons qu’à travailler pour le profit du propriétaire qui négligent ses obligations les plus élémentaires envers les paysans qui pour lui sont « comme des bêtes ».
Tract :
« Les fermiers ont fait la preuve qu’ils n’étaient plus les pauvres paysans du passé, privés du droit à vivre dignement, pour être désormais les véritables « alliés » de la classe ouvrière en lutte.
Pour combattre l’exploitation féodale !
Pour l’établissement d’un droit à cultiver la terre !
Rejoignons le syndicat national agricole !
Ouvriers et paysans, la main dans la main !
Pour cette grande victoire collective, banzaï ! »
**************************
Sur la méthodologie : « À vrai dire, il ne saurait y avoir aucune « manière d’écrire » un roman.
Non seulement personne ne pourrait se lancer immédiatement dans l’écriture d’un roman au prétexte d’avoir lu une « méthodologie », mais chacun, consciemment ou inconsciemment, possède sa propre façon d’écrire.
Et même si je dis ici quoi que ce soit de la manière d’écrire un roman, ce n’est rien de plus qu’un « exposé » des bases sur lesquelles je m’appuie à chaque fois moi-même.
Aussi, pour les nouveaux venus s’étant mis en tête d’écrire quelque chose, cet « exposé » ne peut-il constituer qu’une « référence » en un sens extrêmement limité, ni plus ni moins.
Les nouveaux auteurs doivent posséder une manière d’écrire parfaitement nouvelle. »
« Ceux qui voudraient écrire un roman prolétarien doivent s’absorber dans la lecture de Marx, de Lénine et de tout autre ouvrage de théorie marxiste. Telles sont les « bases » dont aucun écrivain prolétarien ne saurait se passer ! »
Concernant ce livre l’auteur souhaitait qu’il soit supérieur au « Bâteau-usine », au lecteur de décider.
C’est le conflit agraire de l’exploitation Isono Susumu qui a fourni à Kobayashi le sujet de son livre.
L’auteur étant employé à la Banque du défrichement n’a pas hésité à introduire les agissements des banques dans son récit, ce qui suite à la publication du livre vaudra à Kobayashi un licenciement.
L’un des personnages Shichinosuke paysan qui travaille comme ouvrier dans l’usine relie par ses lettres le passé et le présent, les us anciennes et le progrès dans le travail (machines, travail à la chaine). Quand l’usine fabrique des ustensiles qui seront vendus dès le lendemain apportant revenu, il faudra un an avant que les semailles rapportent au paysan, souvent juste de quoi se nourrir. La durée est donc là facteur de progrès.
L’auteur cite aussi le fait que les propriétaires eux-mêmes doivent se diversifier et s’adapter au progrès. Ce progrès qui répandu dans les villages, par les ustensiles d’usage quotidien par exemple, tuent aussi le petit artisanat qui permettait aux paysans quelques subsides de plus.
Dans ce livre on voit l’éveil des paysans, au syndicalisme et leur intérêt pour la politique (l’un des paysans rejoint le Syndicat paysans à Asahikawa.
« En 1928 : Une vaste répression du parti communiste fut déclenchée presque aussitôt après, le 15 mars. Puis une aggravation de la loi sur le maintien de l’ordre (Chian-iji-hô) autorisa des châtiments pouvant aller jusqu’à la peine de mort : la mise à jour de la loi intervint sur une proclamation impériale urgente. […] Les idées libérales aussi bien que communistes devinrent l’objet d’une surveillance politique rigoureuse » (Dictionnaire historique du Japon). »
***
La syndicaliste que je suis ne pouvait qu’être conquise par cet auteur. Oui il était communiste et alors ? Je n’associe pas systématiquement le mot communiste à stalinisme. A. Koestler qui lui aussi a été un certain temps communiste dit très justement dans son livre « la lie de la terre » alors qu’il est dans un camp du sud-ouest ce qu’il pense des communistes « de la base », pour avoir lu aussi Howard Fast, je sais aussi combien d’ honnêtes citoyens, ont été emprisonnés pour le seul fait d’être de ce Parti.
Kobayashi lui en est mort.
et merci à Animal de m'avoir fait connaître cet auteur.
Mots-clés : #immigration #mondedutravail #social
- le Lun 27 Juil - 10:59
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: KOBAYASHI Takiji
- Réponses: 10
- Vues: 1096
Sibylle Lewitscharoff
Originale : Allemand, 2009
description du livre a écrit:
Deux sœurs, installées en Allemagne, acceptent l'offre d'un riche membre de leur communauté d'origine : il leur propose une importante somme d'argent pour l'exhumation de leur père car il veut réunir dans un même tombeau les dépouilles de ses amis bulgares morts en exil.
Un convoi de limousines les conduit donc à Sofia et leur chauffeur, Apostoloff, entreprend de leur faire découvrir les richesses du pays : la céramique... à base de bleu de cobalt toxique, le littoral de la mer Noire… défiguré ou l'architecture locale (un crime contre l'esthétique).
Les péripéties de cette odyssée, racontées avec un humour corrosif, sont l'occasion pour Sibylle Lewitscharoff de mener une réflexion sans concession sur des questions existentielles comme les racines des migrants, le sentiment de nostalgie ou la famille.
REMARQUES :
A vrai dire j’aurais presque jeté le livre dans un coin de ma chambre ! Quel démonstration haineuse des rapports de la narratrice envers son père, puis le pays de celui-ci, d’où il s’est exilé dans les années 40 ! Amer, plein de « préjugés », - semble-t-il. Plus que méchant ! Pour les amateurs du genre par contre probablement un bonheur !
Et puis je me suis dit : avec le Prix reçu comme meilleur livre de l’année, il doit y avoir autre chose ? Continuons à lire !
Et puis rapidemment apparaissait quelque chose, une lecture possible, de cette amertume sous la lumière de la mélancolie de l’exilé , de l’émigrant. Et cela pas juste dans la première génération, mais même, comme transmise mystèrieusement, dans celle de la deuxième, voir troisième. J’y reconnaissais quelque chose de mon vécu.
D’un coup cette vue acerbe, le criticisme envers la Bulgarie, son père, presque tout le monde, deviennent comme par magie et secrètement une expression d’un désir de plus, d’un inaccomplissement. Et une attente d’autre chose : pour les pays de l’ancien bloc de l’Est, mais aussi soi-même ?
CES sujets sont suggérés et en quelque sorte sécrets. Mais évident et incontournable est (j’ai lu le livre en allemand) l’incroyable art de manier la langue de l’auteure ! La langue est riche, inventive, laconique, aussi « mèchante ». Mais toujours originale. Ce serait intéressant ce qu’un lecteur francophone en tire de la traduction française !
C’est avec effroi presque que nous réconnaissons dans cette écriture de poison tellement de parallèles avec la biographie de l’auteure. Aïe ! Mais reconnaissons alors aussi derrière cette amertume le souffle d’une mélancolie. Celle-là resonne d’une façon merveilleuse parfois. Qu’est-ce qu’on attend, qu’est-ce qu’attend un tel pays ? C’est par le négatif que Lewitscharoff dit ce qui manque, ou ce qu’il faudrait : de l’âme. Le pays aurait été déâmisé… Et pas juste la Bulgarie, j’ajoute, peut-être la maladie d’aujourd’hui ?
Mots-clés : #famille #humour #immigration
- le Mer 17 Juin - 7:51
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: Sibylle Lewitscharoff
- Réponses: 6
- Vues: 609
Yves Ravey
Editions de Minuit a écrit:Le dancing Chez Malaga est en émoi. Alfredo, le fils de la patronne est de retour après seize ans passés à l'étranger.
Mais Alfredo ne revient pas dans la seule intention de revoir ses proches. Il doit récupérer un document de la plus haute importance.
J'ai choisi de lire cette pièce en apprenant que Jean-Michel Ribes, que j'estime sans bien le connaître, s'est chargé de la mise en scène, ce qui m'a paru de bon augure. L'intrigue tient à rien, et l'on se moque du document qui motive le retour du fils. La pièce m'a rappelé La visite de la vieille dame de Dürrenmatt, et plus lointainement, Ghelderode. Ce qui doit advenir ne compte pas : tous les regards sont dirigés vers le passé, toutes les conversations le ruminent et le découvrent par pans. L'action de la pièce est terminée avant que celle-ci commence, il n'en manque que le dénouement. C'est une pièce à l'arrêt, une ronde poussive autour d'un personnage dérobé, une tragédie exsangue. Les caractères recréent par le dialogue les tensions de cette intrigue presque achevée qu'ils se révèlent les uns aux autres, et à nous, lecteurs. Il faut reconnaître à Yves Ravey, je n'ose pas affirmer un talent (il faudrait pour cela que je lise un autre de ses livres), mais un certain savoir-faire de dialoguiste. La plupart du temps, peut-être au détriment du sens, le style est naturel (bien qu'artificiel de bien des manières) : les phrases s'enchaînent sans heurts, portent juste, et la semi-oralité est correctement négociée. Artificiel, car certaines répliques sont comme rêvées (elles sonneraient faux prononcées nettement dans le dialogue), il s'y trouve un léger ton d'irréel, comme une sécrétion de la mémoire qui travaille, du passé qui vient au jour. Mais ces réminiscences (peut-être la trace de la logorrhée qui te fait fuir, @Tristram ?) ne sont pas envoûtantes, elles possèdent une dimension romanesque qui en rend la lecture assez agréable. Il y a en outre chez cet auteur une affection pour le vieillot, une nostalgie du passé qu'il place chez l'un de ses personnages mais que je soupçonne être à lui (après la lecture de quelques pages du Cours classique, dans un cadre qui semble emprunté au Petit Nicolas). J'aime croire que cela lui vient de ses origines franc-comtoises. J'ajoute par scrupule, car ça ne m'a guère intéressé, que l'un des sujets principaux de la pièce est celui de l'exil (l'identité de l'exilé).
Une remarque importante pour qui serait intéressé : ne soyez pas influencé (en bien ou en mal) par la couverture, il n'y a que peu de traces du "maniérisme de Minuit".
Je vous parlais des coiffeuses. C’est comme les caissières, il y en a de nouvelles, un lot, chez Billa, deux rues plus loin direction le cimetière, dans le nouveau magasin. Vous ne le connaissez pas ce magasin-là, monsieur Alfredo, il n’empêche, vous en avez de nouvelles. Par cinq elles arrivent. Vous savez que certaines ne savent même pas vous débiter une tranche de jambon...? Le client dit : « Je voudrais du jambon sec. » Elle vous découpe un morceau d’un centimètre d’épaisseur avec la machine à jambon, alors le client lui dit : « Madame, je ne vais pas payer deux cents euros pour une tranche de jambon, je voulais un demi-millimètre d’épaisseur, pas un centimètre, vous avez déjà vu du jambon de Parme épais comme une planche de contreplaqué? C’est du bois, de la sciure solidifiée, ça fait cher le mètre carré, un bois pareil, c’est du sapin, nom de dieu. » Et elle est là, elle vous regarde les yeux en chien de faïence.
Ni tout à fait séduit, ni irrémédiablement rebuté, la prochaine fois je lirai un de ses romans.
Mots-clés : #exil #famille #huisclos #immigration #théâtre
- le Dim 3 Mai - 14:24
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Yves Ravey
- Réponses: 28
- Vues: 1257
Annie Dillard
Les vivants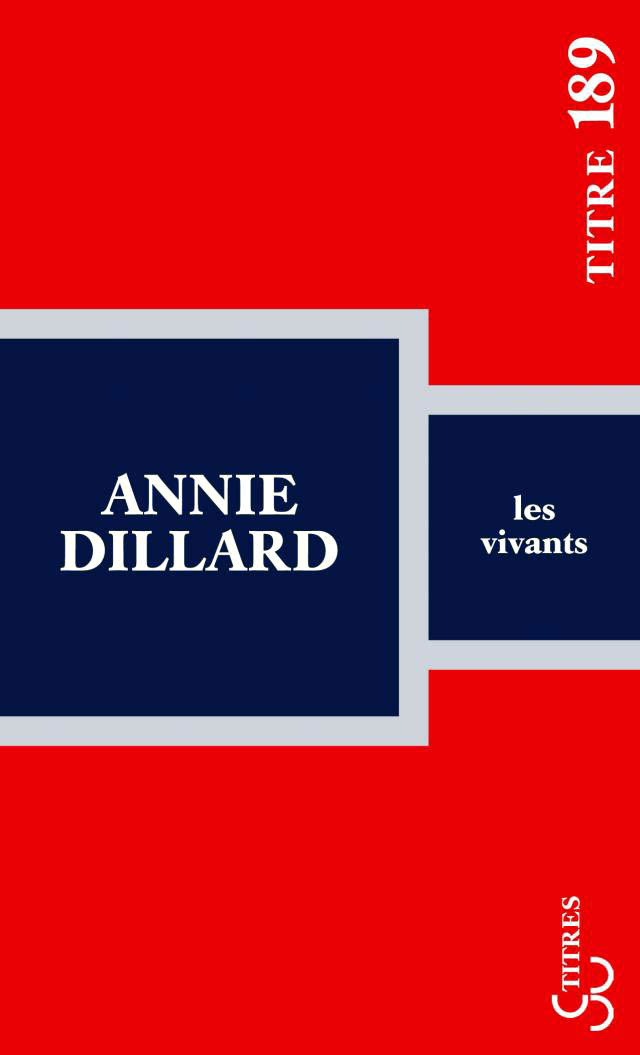
Whatcom, État de Washington, arrivée des premiers pionniers mi-XIXe sur la rive du Pacifique, parmi les énormes sapins Douglas et les accueillants Indiens Lummis.
« C’était l’abrupt rebord du monde, où les arbres poussaient jusqu’aux pierres. »
« Constellés de gouttes, les arbres ruisselaient sans cesse. On aurait dit une condensation, une incarnation de la pluie, une excroissance affreusement pesante et foisonnante contre laquelle l’homme luttait tous les jours de toutes ses forces, et qu’il détestait au plus profond de son cœur douloureux. Ce pays n’avait nul besoin d’ombre fraîche. La tâche de Rooney consistait à briser ce dôme ombreux, à aider le soleil à descendre jusqu’à terre. »
« Cela lui paraissait grandiose. « Je crois que je verrai les bienfaits du Seigneur au pays des vivants », lisait-elle [Ada, dans les Écritures] et Rooney y croyait aussi. »
Les familles survivent courageusement dans la précarité (nombreux accidents mortels, mais aussi épanouissement des enfants), et en bonne intelligence avec les Indiens du cru.
« De leur côté, les Lummis avaient appris à ignorer l’affreuse odeur des Bostons, car les nouveaux venus se lavaient rarement et ne changeaient jamais de sous-vêtements. Ils apprirent aussi à ne pas fouiller partout, car cela plongeait les Bostons dans un état d’énervement inutile, et à ne pas chaparder des objets ou des enfants sans prévenir. Ainsi, les gens s’entendaient. »
« Il disait que les Indiens étaient tous différents, jusqu’au dernier, exactement comme les Blancs, et John Ireland commençait seulement d’imaginer qu’il en était sans doute ainsi. »
« Le matin, le soleil semblait jaillir au hasard de n’importe quel point de l’horizon, comme une hirondelle. Il montait et descendait le long des versants des montagnes, chaîne après chaîne, sur ce rebord oriental du monde. Chaque après-midi, il jetait des ombres et des lumières nouvelles sur le papier peint ; chaque soir, il sombrait derrière une île différente. Le soleil est une créature fantasque, pensait le jeune Clare Fishburn ; le soleil est une abeille. Le jour faisait éclater les ténèbres puis inondait le monde ; toute la plage vacillait, s’enivrait de lumière. »
C’est aussi l’époque du boom économique américain, celle de l’épopée du chemin de fer, de l’expansion de la ville et du capitalisme marquée de crises désastreuses, et celle de la déportation des Chinois (voulue par les socialistes).
« ils créaient purement et simplement de l’argent »
« Aucun enfant n’est jamais voué à une vie ordinaire, on le voit bien en eux et d’ailleurs ils le savent, mais l’époque se met alors à les travailler, ils perdent leur intelligence à force d’apprendre ce que les gens attendent d’eux, ils dépensent toute leur énergie à essayer de s’élever au-dessus de leurs semblables. »
« Si l’utilité et la valeur du papier-monnaie dépendaient d’une superstition comme "la confiance du public", alors il ne savait plus à quel saint se vouer. »
Beal Obenchain le psychopathe malfaisant a décidé de faire sa chose de Clare Fishburn en lui annonçant qu’il allait le tuer d’un moment à l’autre, ce qui déclenche une méditation existentielle de la victime en attente (et met un peu de suspense dans l'histoire).
« S’il mourait maintenant, sa vie n’aurait été qu’un bref épisode, comme une averse passagère. S’il mourait plus tard, en ayant accompli davantage de choses, cela reviendrait au même. »
« Le temps était un hameçon dans sa bouche. Le temps le tirait, mâchoire en avant ; le temps le ramenait, tête la première, hébété, vers un rivage dont il n’avait pas soupçonné l’existence. »
« Il était, depuis le début, une bobine d’empreintes de pas qui commençaient un peu plus au nord, dans la cabane du campement dressée sur la plage où il avait appris à se tenir debout en s’accrochant à la jupe noire de sa mère. Ses traces disparaissaient, puis redevenaient visibles à mesure qu’il égrenait ses jours et ses ans ; il passa douze années à Goshen avant de revenir à Whatcom et il effectua d’innombrables allées et venues entre son domicile et le lycée, puis le bureau. Maintenant, sur cette plage, ses traces se dévidaient derrière lui telle une épluchure : le temps était un couteau qui l’épluchait comme une pomme et il allait continuer de l’entailler jusqu’à la fin. Ses traces, les traces de sa vie se termineraient abruptement, elles aussi – mais à ce moment-là il ne s’envolerait pas, comme un oiseau dans le ciel ; il descendrait sous terre. »
« Ces dernières années, quand il se retrouvait à chercher la compagnie des mouettes et des corneilles, des jeunes enfants et des arbres tolérants, il se savait motivé non seulement par leur indifférence envers sa personne et par leur belle spontanéité en sa présence, mais aussi parce qu’il admirait leur pureté, leur solitude sous le ciel bouleversé : les pattes des oiseaux dans la charogne, l’attention des jolis enfants, l’humilité et la rigueur des arbres. »
La place prépondérante de la religion chez les pionniers, qui doutent cependant :
« Dans le Sinaï, Dieu leur dit de ne pas toucher la montagne, sinon Il se mettrait en colère contre eux. Ils ne touchèrent pas la montagne, mais apparemment Il se mit néanmoins en colère contre eux, tout comme Il se mit en colère contre Ada tout près des montagnes, alors qu’elle non plus n’avait touché à rien. »
Une fresque historique (plus de 700 pages), avec de nombreux personnages hauts en couleur :
« Eddie Mannchen, dont la mère était morte brûlée à Goshen, et qui s’était installé à Whatcom vingt ans plus tôt, était passager sur le vapeur de Seattle en ce mois de mai, quand le courant drossa le bateau sur un rocher près d’Anacortes et qu’il coula. Tout le monde quitta le navire sain et sauf, tout le monde sauf Eddie Mannchen ; il resta à bord. Les gens installés dans les canots de sauvetage l’appelèrent et le supplièrent. L’eau lui arrivait à la taille sur le pont arrière, mais il resta à bord, les bras croisés, son chapeau repoussé sur la nuque. Enfin, le vapeur coula, entraînant la surface de l’eau avec lui, ainsi qu’Eddie Mannchen et son chapeau. Une femme agacée, qui élevait du bétail, le repêcha d’un coup de filet. Quand elle lui demanda pourquoi diable il avait fait cette ânerie, il répondit qu’il voulait seulement savoir, pendant une demi-heure, "à quoi ça ressemblait d’être le propriétaire d’un bateau et fabuleusement riche." »
Mots-clés : #aventure #colonisation #immigration #independance #nature #ruralité #xixesiecle
- le Sam 8 Fév - 12:20
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Annie Dillard
- Réponses: 10
- Vues: 892
Valerio Varesi
Les mains vides
Parme en été, il fait chaud et le commissaire Soneri sue en regrettant le brouillard. Confronté à la pègre calabraise et albanaise qui pourrit dorénavant sa ville, il lutte vainement pour la sauvegarder, idéaliste amer et impuissant.
« C’est de tout accepter sans aucun sens critique et sans jamais protester, même à voix basse. C’est ça, la barbarie. »
« Il trouvait aussi qu’il perdait son temps à enquêter sur la petite délinquance de rue au lieu de le passer sur la délinquance en col blanc. Un vieux défaut des forces de l’ordre. »
« Vous parlez comme un curé ou un communiste. Vous pensez vraiment que les gens la veulent, la liberté ? Foutaises. La plupart ne veulent que le confort, ils n’en ont rien à foutre du reste. »
« Que ça vous plaise ou non, ils le veulent, ils veulent être commandés. Croyez-moi, ajouta Gerlanda en ricanant avec cynisme, la plupart des gens ont la liberté en horreur parce qu’elle les écrase sous le poids de responsabilités qu’ils sont incapables de prendre. C’est beaucoup plus simple de se dire qu’il n’existe qu’une seule route : la contrainte sait souvent être plus douce que la liberté. »
« Personne n’en a plus rien à foutre des idées, nous sommes dans un monde de choses et d’objets. »
« ‒ Oui, on le sait, constata le commissaire, ils édictent leurs propres règles pour faire leurs saloperies, et après une armée de parasites diplômés en droit réfléchissent du matin au soir à comment baiser la justice. »
« Monsieur le commissaire, vous savez pas qu’aujourd’hui les délinquants, ils ont la cravate, et qu’ils ont remplacé les gens bien ? »
Mots-clés : #criminalite #immigration #polar
- le Lun 20 Jan - 20:41
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Valerio Varesi
- Réponses: 55
- Vues: 5774
Juan José Saer
Le Fleuve sans rives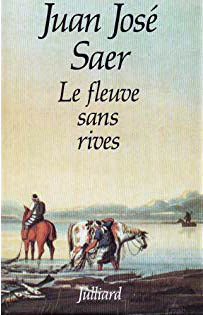
El río sin orillas: tratado imaginario (1991)
"Essai" qui présente le Río de la Plata (et son prolongement chimérique, l’Argentine) de manière géographique, historique, ethnologique, toponymique, littéraire, sociologique, politique :
« Disons qu’ayant été chargé de fabriquer un objet significatif, j'ouvre le tiroir, je le renverse sur la table et me mets à chercher, puis à examiner les souvenirs les plus évocateurs, afin de les organiser ensuite selon un ordre approprié qui ne soit ni celui du reportage, ni celui du traité, ni celui de l'autobiographie, mais celui qui me paraît le plus conforme à mon sentiment et à mes goûts artistiques : un hybride sans genre défini mais dont la tradition ne cesse de se perpétuer, me semble-t-il, dans la littérature argentine, du moins telle que je la vois. […]
Disons par conséquent qu’il n’y a pas dans ce livre un seul fait relevant d’une volonté de fiction. »
La pampa fut d’abord un lieu de passage, un désert premièrement habité par les chevaux (à partir du peu abandonné par les Espagnols), les vaches puis les chiens, ensuite les Indiens qu’ils attirent, puis les gauchos (« créés par le cheval », et arrivés deux siècles après ce dernier), avant le patriarcat des propriétaires fonciers, puis la vague d’immigration européenne, enfin les dictatures, les militaires initiés aux techniques nazies, l’emprise états-unienne.
À la fascination nationale pour l’Europe et sa pensée semble répondre le symptomatique exil de tant de penseurs argentins.
Saer donne des informations éclairantes sur les auteurs argentins (Borges, etc.), mais aussi Caillois et Gombrowicz, retenus à Buenos-Aires par la Seconde Guerre mondiale.
Ce livre évoque les éléments de L’ancêtre (1983), et le fleuve sans rives apparaît aussi dans L’enquête (1994) ; en fait, il constitue un trousseau de clefs pour élucider ces romans (ainsi, Saer dit que si des Indiens ont dévoré des Espagnols, c’est parce qu’ils les auraient pris pour du gibier, n’y reconnaissant pas des humains).
« Il est bien connu que le mythe engendre la répétition, la répétition la coutume, la coutume le rite, le rite le dogme, et le dogme, enfin, l’hérésie. »
Un passage lumineux de nos jours, auquel j’adhère totalement :
« Peut-être le Rio de la Plata (comme d’autres régions de la planète ayant connu également de forts courants d’immigration) a-t-il reçu en partage un privilège très différent de ceux de sa classe patriarcale : celui de préfigurer, en une sorte de mirage paradigmatique, les grands déplacements du XXe, les grandes migrations dont la dimension dorénavant planétaire a bouleversé le monde traditionnel des cinq continents. Cette impossibilité de s’identifier à une tradition unique, ce déchirement entre un passé trop lointain et un présent insaisissable, cette impression d’être perdu au milieu d’une foule sans racines, contraint d’adopter des règles de conduite individuelle et sociale dont personne ne serait capable de justifier la légitimité, ce flou, si révélateur de notre époque, touchant à la nature même de notre être, tout cela est apparu, plus tôt probablement qu’en toute autre partie du monde, dans les environs immédiats de notre fleuve sans rives. Au lieu de vouloir à tout prix être quelque chose ‒ appartenir à un pays, à une tradition, se connaître comme une classe, un nom, une situation sociale ‒, peut-être n’existe-t-il pas aujourd’hui d’autre orgueil légitime que celui de se reconnaître comme rien, moins que rien, fruit mystérieux de la contingence, produit des combinaisons complexes qui mettent tous les vivants sur un même pied d’égalité, celui d’une présence aléatoire et fugitive. Le premier pas de la découverte de notre véritable identité consiste justement à admettre qu’à la lumière de la réflexion, et, pourquoi pas, de la compassion, aucune affirmation d’identité n’est possible. […]
Confrontés les premiers aux signes avant-coureurs de l’obscure irréalité qui allait se généraliser, ils [les habitants du Rio de la Plata] cherchaient obstinément une réponse, sans soupçonner que l’imprévisible réponse était dans la nécessité où ils avaient été de se poser la question. »
Les réflexions de l’écrivain concernent également la création littéraire :
« Créer un objet capable d’embrasser ce que spécialistes et profanes ont en commun : ainsi peut se résumer la fonction de la littérature. […] plus nous [les] mettons en valeur [les détails], plus nous tâchons d’éclairer l’image que nous voulons donner, et plus nous procurons de plaisir à notre destinataire, qui du seul fait de les évoquer, les reconnaît comme siens. Le but de l’art n’est pas de représenter l’Autre, mais le Même. Le terrain le plus favorable à l’Autre, c’est, bien qu’à première vue cela paraisse contradictoire, l’accidentel et le stéréotype : l’accidentel, parce qu’il n’exprime que les contingences extérieures, la résolution purement technique des actions humaines, et le stéréotype, parce qu’il est la cristallisation stylisée, dorénavant indépendante de l’imaginaire, de ces accidents. »
Cette lecture constitue un régal (une excellente conversation érudite et de bon ton, où j’aurais eu celui de me taire), et dans la première partie on pense inévitablement au Danube de Rumiz et Magris…
Mots-clés : #amérindiens #essai #immigration #lieu #voyage
- le Lun 6 Jan - 12:03
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Juan José Saer
- Réponses: 38
- Vues: 2693
John Fante
Les Compagnons de la grappe
The Brotherhood of the Grape aurait peut-être été mieux traduit par « la fraternité de la vigne », comme il est dit dans le roman lui-même ? La traduction de Brice Matthieussent m’a aussi paru douteuse par endroits (comme ces « briques rouges immaculées »)…
Le narrateur, Henry Molise, est un écrivain quinquagénaire qui évoque ses relations familiales, notamment avec son père, Nick, immigré des Abruzzes, ancien maçon et tailleur de pierre de soixante-seize ans, autoritaire ‒ un tyran domestique ‒, buveur, joueur, coureur et violent. Les rapports entre ce dernier, sa femme et les quatre enfants sont toujours conflictuels, dans une alternance passionnée de haine et d’amour, haute en couleur et typiquement ritale. C’est en fait la même saga familiale que Fante raconte dans ses précédents romans, avec l’exubérance, l’infantilité, la sentimentalité, la rage latines.
« Un peu d’ail écrasé sous ses narines lui fit reprendre conscience, et avec le courage d’une sainte Bernadette elle se mit à vaciller dans la cuisine pour poser du vin et des tartes génoises sur la table, où une discussion de ses problèmes avec papa s’ensuivit. »
« De fait, nous formions un clan impulsif, imprévisible, imbattable pour les décisions prises à chaud et les remords lancinants. »
« Le cimetière de Valhalla grouillait d’anges en marbre blanc sculptés par mon père, les ailes déployées, leurs bras et leurs longs doigts tendus, graves et concentrés comme des oiseaux de proie, figés en une posture menaçante, tels des vautours protégeant leur charogne. Perchés un peu partout, on avait l’impression qu’ils avaient déjà profané les tombes. »
« Mon père n’avait jamais désiré d’enfants. Il avait désiré des poseurs de briques et des tailleurs de pierre. Il a eu un écrivain, un comptable dans une banque, une fille mariée, et un serre-freins. En un sens il a essayé de faire de ses fils des maçons comme on façonne la pierre – en cognant dessus. »
C’est la lecture qui permit à Henry de s’évader de l’emprise paternelle, lui révélant sa vocation :
« Alors c’est arrivé. Une nuit que la pluie tambourinait sur le toit indigné de la cuisine, un grand esprit s’est glissé à jamais dans ma vie. Je tenais son livre entre mes mains tremblantes tandis qu’il me parlait de l’homme et du monde, d’amour et de sagesse, de souffrance et de culpabilité, et j’ai compris que je ne serais plus jamais le même. Il s’appelait Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski. Personne n’en savait autant que lui sur les pères et les fils, les frères et les sœurs, les prêtres et les fripons, la culpabilité et l’innocence. Dostoïevski m’a changé. L’Idiot, les Possédés, les Frères Karamazov, le Joueur. Il m’a bouleversé de fond en comble. J’ai découvert que je pouvais respirer, voir des horizons invisibles. La haine que j’éprouvais pour mon père a fondu. Je me suis mis à l’aimer, cette pauvre épave livrée à ses obsessions et à la souffrance. J’ai aussi découvert mon amour pour ma mère, et pour toute la famille. L’heure était venue de devenir un homme, de quitter San Elmo pour m’ouvrit au monde. Je voulais penser et sentir comme Dostoïevski. Je voulais écrire. »
S’ensuivit une période de vagabondage à Los Angeles, narrée avec humour, avant un piteux retour au foyer où il s’initie à l’écriture.
Mais l’emprise paternelle est telle qu’Henry suit aujourd’hui son père pour l’aider à construire un fumoir de granit dans les montagnes…
« Agenouillés près du torrent, nous avons tété le cruchon en tournant nos visages hâves vers le résultat de nos efforts – une petite bâtisse trapue qui ressemblait à un bunker arabe dans le Sinaï. Ce fumoir était mal fichu et tout de guingois. On aurait dit que les pierres avaient été jetées dans le mur plutôt que posées l’une sur l’autre. Les murs ondulaient comme du linge qui claque au vent, tantôt convexes, tantôt concaves, pleins de bosses et de creux, et puis ils étaient très épais, beaucoup plus épais que ce qu’avait promis papa. Le mortier dégoulinait de partout et maculait la pierre. Malgré tous ces défauts esthétiques, ce fumoir semblait indestructible. […]
Ça ne ressemblait pas du tout à un bâtiment, davantage à une charretée de pierres déversées en vrac. Fatigué, ivre, en proie à des hallucinations, je me suis mis à voir une ancienne tombe indienne. Puis un iceberg. J’ai cligné des yeux et regardé encore. Maintenant c’était un ours polaire. Puis le mont Whitney, puis une formation rocheuse sur la lune. Le brouillard envahissait la clairière tandis que je roulais les tuyaux et rassemblais les outils. Quand j’ai regardé de nouveau la chose, c’était un navire qui avançait lentement dans la brume. »
C’est l’occasion de célébrer le fruit de la vigne, le vrai sang italien.
« Nous pénétrions dans les vignobles d’Angelo Musso, la terre sacrée de mon père et de ses amis. Depuis cinquante ans ils éclusaient le Chianti et les crus authentiques produits par ces collines rocheuses. Ils étaient non seulement les clients d’Angelo, mais aussi ses esclaves, éperdus d’inquiétude quand la récolte s’annonçait mauvaise, car ce vin était le lait de leur seconde enfance, livré une fois par mois à la porte du client en cruchons d’un gallon, tandis que les verres vides étaient rapportés à la propriété.
Tous les cinq ans environ le gel détruisait les vignes ou bien le vin nouveau tournait mystérieusement à l’aigre, et les paisani devaient se rabattre sur une autre marque. Pareille catastrophe semait le désespoir parmi eux, ainsi que l’insomnie et les rhumatismes. Jusqu’au dernier, les clients d’Angelo vivaient dans la terreur qu’il ne mourût avant eux. […]
Angelo Musso était incapable de parler, car dix ans plus tôt on lui avait retiré les cordes vocales à cause d’un cancer. La cendre de ses cigarettes laissait un sillage gris sur le devant de sa chemise bleue, et il toussait par intermittence, car il fumait sans discontinuer ; sur la table, devant lui, étaient posés deux paquets de Camel à côté d’une carafe de vin, d’un briquet et d’un cendrier plein à ras bord. Mon père et la plupart des Italiens qui habitaient depuis longtemps le comté de Placer considéraient Angelo Musso comme un être extraordinaire, un oracle antique qui ne dispensait aucune sagesse, un sage qui ne donnait aucun conseil, un prophète sans prédictions, un dieu qui faisait fermenter le vin le plus magique du monde sur un minuscule vignoble de trente âcres généreusement doté de gros cailloux et de ceps sublimes. Cela faisait de lui un être divin. Son mutisme obligé contribuait aussi à cette métamorphose. Parce qu’il ne pouvait parler, tout le monde venait lui soumettre ses problèmes. Et chacun trouvait sa solution dans les yeux jaunâtres d’Angelo. »
« J’étais fait pour être fils. »
Mots-clés : #famille #immigration #relationenfantparent
- le Ven 3 Jan - 23:10
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: John Fante
- Réponses: 42
- Vues: 3544
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages