La date/heure actuelle est Jeu 2 Mai - 8:15
184 résultats trouvés pour xxesiecle
Roberto Arlt
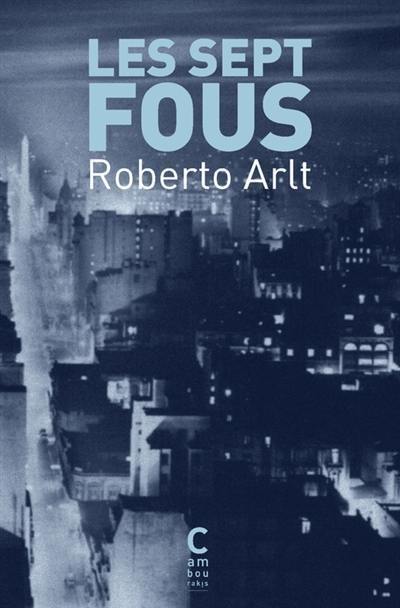
Les Sept fous
Après coup je me demande, y a-t-il des personnages sympathiques dans ce livre ? Pas certain mais alors qu'est qui fait qu'on peut rester avec eux dans une atmosphère pas claire du tout ? Le fait que cette atmosphère pas claire du tout nous rappelle une part de nous-mêmes ? Pas la meilleure certes...
Prenons Erdosain, le personnage principal de cette histoire. Encaisseur mal payé dans une petite boîte et pique dans la caisse. Partant de là ça peut dégénérer...
Rancœur, coups bas dans un sens ou dans un autre, ruminations diverses, c'est à travers ce petit bonhomme à plaindre mais pas très agréable qu'on en découvre d'autres, des hommes surtout mais pas exclusivement, esquintés souvent, tout aussi nébuleux et potentiellement tout aussi mal intentionnés.
Chouette non ? C'est la ligne de flottaison entre la dèche, les mesquineries, les vraies blessures et les vrais espoirs qui peut fasciner. Surtout que c'est sombre et tordu à souhait mais riche en bien belles phrases (soulignons au passage la préface des traducteurs). Qu'en plus derrière les ombres révolutionnaires et totalitaires ne sont vraiment pas loin (Mussolini et Lénine reviennent souvent).
Très tordu cocktail en kaléidoscope et en aller-retours dans la grande ville. Sacrée découverte, avec malaise et pas mal de zones d'ombre mais le roman est envoûtant et efficace à sa manière.
Extraits bientôt.
Mots-clés : #xxesiecle (en fait je sèche grave sur les mots-clés)
- le Mer 26 Juin - 21:45
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Roberto Arlt
- Réponses: 22
- Vues: 2015
Henri Vincenot
La Billebaude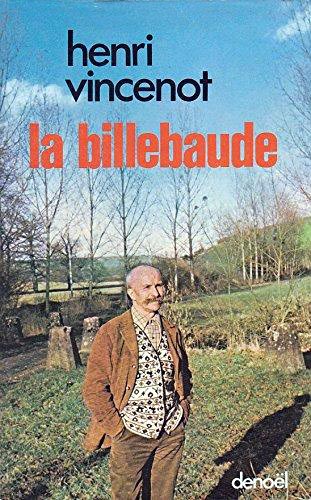
D’abord, le titre :
En note (de l’auteur vraisemblablement) dans le livre :
Billebauder : chasser au hasard des enceintes [zone de remise des animaux en forêt] et des voies [ensemble des traces laissées par un animal, permettant de l’identifier et de le suivre] ; faire les choses au hasard.
Chasser à la billebaude : chasse au hasard des rencontres.
« Et voilà que je me laisse entraîner dans des digressions qui s’emmanchent l’une dans l’autre et qui met là où je n’avais pas prévu d’aller, mais n’est ce pas que ça que billebauder ? C’est notre façon de chasser certes mais la vie toute crue n’est-elle pas une billebaude permanente ? »
Chez Littré :
Billebaude : « Terme familier qui signifie confusion, désordre. »
À la billebaude : « En confusion. »
« Tir à la billebaude, tir irrégulier et à volonté, s'est dit autrefois soit à la guerre, soit à la chasse. »
Pour le TLFi :
À la billebaude : en désordre, dans la confusion,
Chasser, tirer à la billebaude : chacun à sa fantaisie, sans que des places précises aient été assignées.
Wiktionnaire :
Billebaude : sorte de traque du gibier menée au hasard.
Billebauder : chasser au hasard et généralement mal, en parlant de chiens.
À la billebaude : (Bourgogne) (familier) à la fantaisie ; au hasard.
En billebaude : en parlant d'un type de chasse ou d'attaque dans lequel les chasseurs ou les soldats ne sont ni postés, ni alignés.
Œuvre principale, ou la plus connue (vendue) de Vincenot, ce livre (autobiographique dans une large mesure) mérite une précaution liminaire : il n’est plus mainstream. D’entrée le narrateur-auteur enfant découvre l’anus du chevreuil braconné par son grand-père :
« Ce fut une sorte d’ivresse : cette fiente sentait bon ! On peut avoir une idée de son parfum en broyant ensemble des noisettes, des mûres dans du lait aigre avec un je-ne-sais-quoi qui rappelait la terre, le champignon, la mousse, la touffeur des ronciers épais où n’entrent jamais les rayons du soleil. C’était plus qu’il n’en fallait à l’époque pour me saouler. »
C’est qu’on aime la sauvagine et son fumet, dans la famille Tremblot ! Et on y parle vert, et dru !
Texte savoureux : terroir, identité forte, les mots et les mets, le dialecte et celui de la cuisine ; encore cette liberté de randonner dans de vastes terres boisées ‒ d’y chasser !
« À les entendre, la chasse devenait ce qu’elle était vraiment : la plus noble, la plus sûre, la plus haute préoccupation de l’être humain, roi de la terre. »
Il faudra certes bémoliser… De même, Vincenot le bourguignon revendique fièrement l’appartenance à « l’ancienne civilisation », gauloise, celte, voire mégalithique, « le temps des grosses pierres » ‒ ce qui est sans doute erroné… Et dire que les propos issus de ce milieu traditionnel frôlent parfois le conservatisme voire le réactionnaire ne me semble pas excessif ; cet ardent pamphlétaire va même jusqu’à préconiser l’Inquisition pour limiter « la réussite des cuistres ! »… On trouve cependant profit à lire ces réflexions (achevées et parues en 1978) sur le "progrès", le risque technologique, la destruction de l’environnement et du monde rural :
« Ce n’est que plus tard que je compris encore autrement les choses, mon "exceptionnelle intelligence" n’avait pas encore à cette époque la maturité voulue, ni l’expérience, pour se cabrer contre cet écrémage du monde rural de l’artisanat et de l’agriculture qui lui enlevait ses meilleurs éléments dès leur certificat d’études primaires pour les verser à jamais dans le monde de la théorie, pour en faire des administratifs, des bureaucrates ou des hauts théoriciens de tout poil, des ingénieurs, des inutiles coûteux, des nuisibles bien payés, perdus à jamais pour le monde sain et équilibré de l’ouvrage bien fait.
Là commençait cette crise qui dévore comme chancre la société moderne et qui la tuera aussi sûr que furet saigne lapin ! Mais du diable si toutes ces idées contestataires pouvaient me venir. Autour de moi, on s’extasiait au contraire devant ce merveilleux élitisme scolaire et universitaire qui permettait aux enfants des milieux les plus modestes de s’élever vers les plus hautes destinées, et autres fariboles. »
« Mon bel avenir ! Mais je lui tournais le dos ! Mon avenir était dans les pâturages, dans les bois où les derniers de la classe jouaient à la tarbote [jeu d’adresse] en gardant les vaches, en attendant d’aller à la charrue ou d’apprendre à raboter les planches. Leur école avait le ciel pour plafond, et que me restait-il à moi, condamné aux études à perpète ? Une journée de liberté par semaine, celle de la grande promenade, pour reprendre respiration, comme une carpe de dix livres qui vient happer une goulée d’air à la surface d’un plat à barbe, oui, voilà l’impression que je me faisais.
Devant moi, je le pressentais sans bien l’imaginer avec précision, s’étendait une vie où je ne vivrais vraiment qu’un jour sur sept, comme tous les gens des villes et des usines, le jour de la grande promenade des bons petits citadins châtrés. »
« Or, tous les poètes, tous les rêveurs, tous les "littéraires", comme on disait, choisissaient comme moi le groupe qui devait gagner les espaces rupestres, sylvestres, champêtres, les zones imprécises et inutiles, sans clôture, sans chemin, sans ciment et sans bitume. Les forts en mathématiques, au contraire, se trouvaient tous dans le groupe qui se traînait en ville sur le macadam et cherchait à voir passer des automobiles pour les compter, fourrer leur nez dans le capot si par bonheur l’une d’elles venait à tomber en panne.
A tort ou à raison, je vis dans ce clivage naturel, quoique manichéen, le partage spontané de l’humanité en deux, dès l’enfance ; d’un côté, les gens inoffensifs, de bonne compagnie, un tantinet négligents, mais dotés d’imagination, donc capables de savourer les simples beautés et les nobles vicissitudes de la vie de nature, et, de l’autre, les gens dangereux, les futurs savants, ingénieurs, techniciens, bétonneurs, pollueurs et autres déménageurs, défigureurs et empoisonneurs de la planète.
Certes, ce n’est que quelques années plus tard que je devais découvrir ce paradoxe bien celte, énoncé par mon frère celte Bernard Shaw : Les gens intelligents s’adaptent à la nature, les imbéciles cherchent à adapter à eux la nature, c’est pourquoi ce qu’on appelle le progrès est l’œuvre des imbéciles. […]
Et je ne croyais pas si bien dire ! Mais, qui, à l’époque, ne m’eût pas considéré comme un plaisantin ? Aujourd’hui, pourtant, parce que l’on se désagrège dans leur bouillon de fausse culture, que l’on se tape la tête contre les murs de leurs ineffables ensembles-modèles, que l’on se tortille sur leur uranium enrichi comme des vers de terre sur une tartine d’acide sulfurique fumant, que l’on crève de peur en équilibre instable sur le couvercle de leur marmite atomique, dans leur univers planifié, les grands esprits viennent gravement nous expliquer en pleurnichant que la science et sa fille bâtarde, l’industrie, sont en train d’empoisonner la planète, ce qu’un enfant de quinze ans, à peine sorti de ses forêts natales, avait compris un demi-siècle plus tôt. Il n’y avait d’ailleurs pas grand mérite car, déjà à cette époque, ça sautait aux yeux comme le cancer sur les tripes des ilotes climatisés. Et, que l’on me pardonne, il m’arriva de vouloir, déjà à cette époque, arrêter le massacre, endiguer le génocide généralisé, mettre un terme à la fouterie scientifique et effondrer le château de cartes des fausses valeurs. »
« ‒ Un seul conduira la Cormick [la toute nouvelle faucheuse mécanique, qui remplace dix faucheurs] ! mais les neuf autres ? hein ? Qu’est-ce qu’ils feront les neuf autres ? Tu veux que je te le dise ? Ils iront à Dijon, à Paris, esclaves dans les usines ! Et les villages deviendront vides comme des coquilles d’escargots gelés. Le ventre des maisons se crèvera, qu’on ne verra plus que les côtes de leurs chevrons ! Et eux qu’est-ce qu’ils deviendront, là-bas, dans la ville ? Des mendiants de l’industrie, des mécontents-main-tendue, des toujours-la-gueule-ouverte !… »
« Une horloge pointeuse !
Lorsque je vis cet instrument pour la première fois et qu’un huissier m’expliqua comment je devais m’en servir, je crus à une plaisanterie de bizuthage. Je répondis bravement que je trouvais cela plaisant et je passai outre. Mais on me rattrapa vivement en me disant que le pointage était obligatoire !
Oui brave gens : à l’avant-garde du progrès et des techniques de pointe en matière de gestion des entreprises, d’économie et de sociologie, l’École des Hautes Études commerciales donnait, dès cette époque, l’exemple, en imposant aux admirables élites estudiantines, aux futurs dirigeants de la société rationnelle, standardisée, technocratique et totalitaire en pleine gestation en Europe, cet avilissement quatre fois quotidien, cette abjecte génuflexion devant la machine. Ce mouchard impavide ridiculisait tout simplement ce que le Compagnon-fini avait de plus noble et de plus efficace : la Conscience et le libre arbitre.
Le déclic de cet engin pointeur, c’était le bruit de la dignité qui se brisait et toute joie d’œuvrer et de vivre alors m’abandonna.
J’étais atterré. […]
Halte à la technique ! Halte à la croissance ! »
Il y a bien sûr aussi un aspect historique de cette société riche en femmes après la première Guerre Mondiale, et même un témoignage pratiquement de valeur ethnologique sur le lieu. Artisanat et compagnonnage, bourrellerie, forge (feu, fer ‒ puis locomotives !), paysannerie, importance de l’Église ‒ et de croyances plus anciennes.
Beaucoup d’aperçus étonnants, comme l’importance du chant (notamment à l’église, justement), ou la longévité inattendue à cette époque, que les « astuces de la statistique » nous masquent aujourd’hui :
« Oui, pleines de femmes étaient alors les maisons ! Pas de camarade à moi qui n’eût lui aussi, dans nos pays de prodigieuse longévité, deux mémères-bi, une Tontine aussi et, bien entendu, sa mère. Que de girons pour s’y cacher ! […]
Tout ce monde vivait dans la maison familiale au rythme des chansons. On pouvait entrer à n’importe quelle heure, on était sûr d’entendre au moins chanter une femme, et les plus vieilles n’étaient pas les dernières. Le plus souvent, d’ailleurs, elles chantaient toutes ensemble, à l’unisson il est vrai, car la race n’est pas musicienne et se contente de la romance ; on les entendait alors jusque sur le pâtis.
Il faut dire que la radio leur était inconnue. Elles fabriquaient donc elles-mêmes leur musique. »
« En tout, un bon tiers d’animal, quelque vingt-cinq kilos d’une viande noire à force d’être rouge, encore en poil, bardée d’os blancs comme ivoire.
Toutes ces femmes avaient passé deux jours à dépiauter, à mignarder cette chair musquée comme truffe, pour la baigner largement dans le vin du cousin, où macéraient déjà carottes, échalotes, thym, poivre et petits oignons. Tout cela brunissait à l’ombre du cellier dans les grandes coquelles en terre. C’était moi qui descendais dans le cellier pour y chercher la bouteille de vin de table et lorsque j’ouvrais la porte de cette crypte, véritable chambre dolménique qui recueillait et concentrait les humeurs de la terre, un parfum prodigieux me prenait aux amygdales et me saoulait à défaillir. C’était presque en titubant que je remontais dans la salle commune, comme transfiguré par ce bain d’effluves essentiels et je disais, l’œil brillant :
‒ Hum ! ça sent bon au cellier !
Alors les femmes radieuses me regardaient fièrement. Ma mère, ma grand-mère, la mémère Nannette, la mémère Daudiche, toutes étaient suspendues à mes lèvres pour recueillir mon appréciation. C’était là leur récompense.
De son côté, le grand-père s’occupait des viandes à rôtir. Aux femmes les subtiles et multiples combinaisons des bouilletures, meurettes, gibelottes, salmis, civets, saupiquets, qui supposent les casseroles, coquelles, cocottes et sauteuses, mais aux hommes, toujours, depuis le fond des temps, l’exclusivité des cuissons de grand feu, des rôts et des grillades, celles où brasier et venaisons communient sans intermédiaire. C’était alors ainsi. Les dons spécifiques des sexes étaient utilisés, même dans les plus petits détails de la vie. C’était là une des caractéristiques de notre vieille civilisation. »
Mais « la vie à la campagne au temps de la civilisation lente » n’était pas non plus le paradis :
« Aux vacances de Noël, c’était autre chose : le bûcheronnage. À celles de Pâques, les bêchages, les débardages de bois avec trois juments de file dans les fondrières de la montagne, et, en tout temps, deux heures de scie par jour pour débiter, dans le bûcher, le bois pour la journée. »
Encore que l’exercice permette de dévorer impunément, et de garder le contact avec la nature primordiale…
« Qui n’a pas couru pieds nus dans le fumier ne sait pas ce que c’est que la joie de vivre, le fumier frais surtout, somptueux, qui fume dans la fraîcheur du matin et vous entre, bien tiède, entre les orteils. Voilà l’image que j’ai de la misère de cette époque dans nos pays. Je ne peux pas vous en dire davantage, sans inventer mensonge. »
Célébration d’un mode de vie à la fois fort économe et fondé sur l’abondance de bonne chère comme sur l’activité physique (notamment manuelle et pédestre) :
« Après moisson, nous glanions avec acharnement, ramassant épis après épis, pour les volailles. En définitive, qu’achetait-on ? Cinq livres de plat de côtes ou de rondin par semaine, pour le pot-au-feu et chaque mois un litre de caillette pour emprésurer dix litres de lait par jour, car notre vache, une montbéliarde, nous donnait en moyenne vingt à vingt-trois litres quotidiens. On faisait des fromages gras, de gros fromages qui mûrissaient dans le cellier et qu’on lavait à l’eau salée tous les soirs ; ils devenaient roses et mauves sur leur feuille de platane étalée. Le petit lait servait à faire la pâtée du cochon et à me désaltérer en été.
Nous mangions au moins un fromage de quatre livres dans la journée, soit frais, soit passé, c’est-à-dire mûri à cœur et couvert d’une peau rougeâtre qui se ridait à la surface et dont les grand-mères conduisaient la fermentation en le lavant à l’eau plus ou moins salée ou bien la ralentissaient en temps voulu avec des ablutions d’eau-de-vie. »
On retrouve l’inéluctable sacrifice annuel du porc, avec une belle morale finale :
« Chacun connaît si bien son petit travail personnel qu’en moins de deux, les jambons et les épaules sont détachées, les filets levés, le filet mignon mis à l’écart, avec le foie, le cœur, les rognons et la saignette, le côtis partagé en six carrés, les pattes grattées, les ergots arrachés et jetés aux gamins qui tournent autour du sacrifice, avec les chiens, prévenus on ne sait comment.
Ils se les disputent pour les croquer tout crus pendant qu’on fend la hure en deux et que la cervelle jaillit, toute rose, hors de son alvéole. Tous les morceaux s’étalent sur un linge blanc sur la grande table et le grand-père prépare "les présents".
Ce sont les morceaux traditionnels que je vais aller porter à sept ou huit voisins. Ce n’est pas charité, mais équité, car lorsque ces gens-là tuent leur cochon, ils réservent les mêmes morceaux pour nous.
On dit : "Deux façons de conserver le cochon : le sel et l’amitié." Toujours cette morale utilitaire qui règle et stimule les élans du cœur.
Il faut comprendre que la viande qui va au saloir, on la retrouvera salée, tout au long de l’hiver, mais celle qui va au voisin, elle vous reviendra aussi, mais fraîche, sous la forme de présent en retour, avec, en plus, une intention d’amitié qui vous réchauffe. »
C’est encore une expérience de communion à la nature, de prise directe sur la réalité, qui disparaît avec ces mœurs :
« Puis cela se perdit dans les combes, mais, alors que tout redevenait majestueusement silencieux, j’entendis le léger "froutt froutt" d’un lièvre qui se dérobe. Je pensais que c’était la bête de chasse qui, les oreilles en arrière, s’approchait. Et j’en eus la certitude lorsque tout à coup à cent mètres de moi, il y eut une ruée brutale, fulgurante, puis un cri incroyablement aigu. C’était le cri d’agonie du capucin. Là, à une portée de fusil de moi, le couple de renards venait de réussir sa merveilleuse stratégie, maintes fois répétée et modifiée, mise au point inlassablement. Sa stratégie vitale. Et un lièvre venait de manquer la sienne. Tout prenait un sens, le plan universel se déroulait, et moi j’avais ma place dans ce plan. Chacun de nous, le lièvre, le couple Renard et moi étions là où il fallait que nous fussions. »
De façon assez originale, le protagoniste-Vincenot, en pension, dessine une carte des environs qu’il parcourait, et y organise ses rêveries cynégétiques ; une philosophie rustique en découle :
« Nous n’avions pas encore fini d’étudier le premier acte d’Athalie et le dixième théorème de géométrie plane que je me trouvais déjà en possession d’une carte assez satisfaisante de mes propriétés, car je possédais tout cela pour l’avoir parcouru, regardé et retenu dans ma tête et dans mon cœur.
Un mois de claustration, de cette claustration tant redoutée, avait suffi (à quelque chose malheur est bon !) à me faire admettre cette définition de la liberté et de la richesse, que j’inscrivis à l’intérieur de mon pupitre et que je savais par cœur pour l’avoir trouvée je ne sais où, peut-être dans mes propres rêveries :
Toute chose t’appartient que tu peux amasser dans ta mémoire et conserver dans ton cœur.
Je devais y ajouter un peu plus tard, lorsque nous fîmes connaissance des épicuriens et des stoïciens, …et cette richesse-là, rien ni personne ne pourra jamais te l’arracher.
Enfin, cette phrase d’Épictète :
Considère-toi comme homme libre ou comme esclave, cela ne dépend que de toi.
La carte ainsi obtenue était un prodigieux monument de subjectivité. Ainsi les terriers de garenne ou de renard, les repaires des chats sauvages y étaient indiqués soigneusement, les moindres bourbiers que l’on nomme chez nous des mouilles, où les sangliers viennent se vautrer à plaisir, y figuraient avec une grande précision ainsi que les roches, les éboulis, les grands arbres, foyards, chênes et tilleuls sacrés, que l’on appelait les "Ancêtres", et qui pouvaient se vanter d’avoir vu passer les hommes d’armes de Charles le Téméraire et, qui sait ? les convois de la croisade de saint Bernard partant de Vézelay et gagnant, par le travers de nos monts, ces pauvres régions barbares situées au sud de Mâcon, brûlées de soleil, où les guettaient les punaises, la peste et les pires malandres [maladies (lèpre), malheurs ? ]. »
On rencontre aussi de beaux personnages, tels ces colporteurs de nouvelles, Jean Lépée, « messager » plus que roulier, et la Gazette, trimardeur, « le vicaire des alouettes, le prophète des étourneaux, le pape des escargots », celui-là même du roman éponyme.
« Jean Lépée était un des plus grands philosophes que j’aie jamais connus. S’il était à la pêche et qu’on lui demandât : "Ça mord ?", il répondait : "Un peu, un peu, y a pas à se plaindre. – Mais, Jean, votre bourriche est encore vide ? – Oui, oui, j’ai bien encore rien pris, mais ça ne va pas tarder, le vent tourne."
Je l’ai vu rentrer fin bredouille. Il disait à ceux qu’il rencontrait : "Bonne journée ! Bonne journée !" S’il pleuvait, ça faisait pousser ses salades. S’il faisait sec, ça faisait mûrir ses nèfles. La vie était merveilleuse autour de lui.
Le chariot avançait en balançant sa lanterne au rythme des mulets endormis qui marchaient par cœur. Ils s’arrêtaient pour pisser, on descendait en faire autant ; ils repartaient avant qu’on ait fini, on les rattrapait cinq cents mètres plus loin. Ça dégourdissait les jambes. Si on s’endormait, ils continuaient tout seuls, ils connaissaient bien sûr le trajet par cœur. La campagne était immense et le temps était infini. »
« La Gazette but une troisième goulée, puis continua :
‒ … Il est assis dans un très grand fauteuil de velours rembourré, et les anges lui apportent à manger. Et il mange ! Il mange sans s’arrêter, parce qu’il peut manger sans attraper d’indigestion, lui. Pardi, sa panse est grande comme l’univers ! Il peut avaler des mondes et des mondes sans s’arrêter, il a toute l’éternité… Les anges lui versent des tonneaux de passetougrain dans la bouche et quand il avale, cré milliard de loups-garous, ça fait le bruit de la cascade du Goulou ! Oui !… C’est le repas de Dieu !
La Gazette vient de s’étaler sur un sac de riz, le ventre débridé, la mine épanouie et savoure sa phrase finale comme un verre de ce passetougrain divin. »
Dans ce livre décousu, où les chapitres sont de durées fort inégales et vaguement organisés chronologiquement ou par thèmes, un épisode marquant est celui, ultime, de la découverte de la Peuriotte, « ce hameau abandonné dans la plus belle des combes de toute la Bourgogne chevelue », que Vincenot fera revivre.
« Une espèce de sentier nous prit et nous conduisit près d’un lavoir brisé où coulait l’eau d’une source captée entre deux roches, elle remplissait un petit lavoir et, au-delà, elle se perdait dans le cresson, le baume de rivière et la menthe, et divaguait dans un verger mangé de ronces, d’épines noires et d’herbes plates. »
Et bien sûr il trouve femme parfaite pour refonder la Combe-Morte, au « vieux pays »…
Mots-clés : #enfance #famille #identite #nature #ruralité #traditions #xxesiecle
- le Sam 15 Juin - 16:59
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Henri Vincenot
- Réponses: 40
- Vues: 5185
Herman Broch
Les Somnambules (Die Schlafwandler)
Ce gros livre de plus de 700 pages et composé de trois récits distincts :
1888, Pasenow ou le romantisme
1903, Esch ou l’anarchie
1918, Huguenau ou le réalisme
Compte-tenu de ma lenteur de lecture et de la densité du texte, je trouve plus prudent d’examiner successivement ces trois textes
1888, Pasenow ou le romantisme
Joachim Pasenow appartient à une famille de petits hobereaux prussiens. Dans la tradition, en tant que cadet, il entre dans une école d’officiers, l’ainé étant destiné à reprendre la gestion du domaine. Ceci au détriment des désirs des uns et des autres mais c’est sans importance. Ce qui compte ici c’est l’honneur, celui de dieu, du roi et surtout de son nom.
« Assurément parmi les chasseurs qui furent jamais hébergés dans cette chambre, la plupart ont mené une vie profane, happant avidement toute occasion de jouissance ou de profit, ne reculant pas à vendre au marchand leurs récoltes ou leurs porcs avec des gains considérables, s’adonnant à une chasse barbare où se faisaient grands massacres des créatures de Dieu et nombre d’entre eux se livraient avec furie aux voluptés féminines. Mais tout portés qu’ils étaient à accepter cette vie insolente et pècheresse comme un droit et un privilège conférés par Dieu, jamais ils ne regimbaient à l’offrir en holocauste dès lors que l’honneur de la patrie ou la gloire de Dieu l’exigeaient ; et même si l’occasion leur manquait, cette allègre disposition à tenir la vie pour une vétille à peine digne de mention avait-elle vertu chez eux que leur conduite pécheresse ne pesait guère dans la balance. »
Le fils ainé ayant été tué dans un duel, il est mort pour l’honneur de son nom conclut le père. Joachim sera amené tôt ou tard à diriger le domaine :
« Le plus curieux de l’affaire, c’est que dans le monde où nous vivons, le monde des machines et des chemins de fer, dans le même temps que circulent les trains et travaillent les usines, deux hommes s’affrontent et tirent l’un sur l’autre »
Pourtant Joachim sent bien dans son uniforme, garant des valeurs ancestrales, protection des atteintes d’un monde extérieur perçu comme une menace
« Et si jadis seul l’habit sacerdotal, par son inhumanité, se distinguait des autres, si même sous l’uniforme et la toge le civil se trahissait, il fallut, quand vint à se perdre la grande intolérance de la foi, que la toge mondaine remplaçât la toge céleste, que la société se scindât en hiérarchies et en uniforme et élevât ceux-ci à l’absolu au lieu et place de la foi. Et puisque c’est toujours romantisme que d’élever le terrestre à l’absolu, l’austère et véritable romantisme de notre époque est celui de l’uniforme, semblant impliquer l’existence d’une idée supraterrestre et supratemporelle de l’uniforme, idée qui sans exister possède une telle intensité qu’elle s’empare de l’homme avec beaucoup plus de force que ne le pourrait une quelconque vocation terrestre, idée inexistante et pourtant si intense qu’elle fait du porteur d’uniforme un possédé de l’uniforme, mais jamais un homme de métier au sens civil du mot, peut-être précisément parce que l’homme en uniforme est nourri et gonflé de la conscience de réaliser le propre style de vie de son époque et de réaliser également ainsi la sécurité de sa propre vie. »
« Il était tout prêt de souhaiter que l’uniforme fût comme une émanation directe de la peau ; parfois il songeait aussi que c’était là son vrai rôle ou que du moins le linge, à force d’insignes et de distinction, devait devenir partie de l’uniforme. Car il était inquiétant que chacun portât sous sa veste cet élément naturellement anarchique. Peut-être le monde serait-il sorti complètement de ses gonds si, au dernier moment on n’avait inventé pour les civils, le linge empesé qui transforme la chemise en une planche de blancheur et lui ôte son aspect de sous-vêtement ».
L’histoire de Joachim est donc celle d’un individu dont les valeurs se trouvent de plus en plus en décalage avec l’évolution du monde moderne. Pourtant celui-ci exerce une fascination qui se manifeste dans la figure d’un proche ami, Bertrand, perçu comme une sorte de démon tentateur, un Méphistophélès en somme ! Bertrand a quitté l’armée, s’est lancé dans les affaires, parcourt le monde en gagnant beaucoup d’argent.
Un étrange quatuor va se mettre en place : Joachim, Bertrand, la femme charnelle et voluptueuse Ruzena, son double inverse, Elisabeth, icone vertueuse.
Joachim hésite dans ses choix, l’attitude à prendre. Il est perdu dans un monde qu’il ne comprend pas
« Enfin il s’aperçut avec effroi qu’il n’avait plus de prise sur la masse fluente et évanescente de la vie et qu’il s’enlisait sans cesse plus vite et plus profondément dans d’extravagantes chimères frappant le monde entier d’incertitude. »
0n a souvent comparé Broch à Musil ou à Roth. Il y a en effet une parenté certaine. Les trois auteurs autrichiens se sont penchés sur l’individu face aux bouleversements du monde moderne. Toutefois, l’écriture de Broch me semble différente de Musil en ce sens que les considérations philosophiques n’empiètent pas trop sur la fonction romanesque. Disons que ce sont deux approches différentes face à un même problème.
Incontestablement Broch est un écrivain majeur du 20e siècle, relativement méconnu. L’écriture est dense, maîtrisée avec, pour me répéter, une belle alliance entre le narratif, les considérations socio-philosophiques et la poésie. La lecture est très aisée jusqu’à présent. Attendons la suite !
Mots-clés : #xxesiecle
- le Jeu 6 Juin - 17:14
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: Herman Broch
- Réponses: 14
- Vues: 938
Raymond Queneau
Pierrot mon ami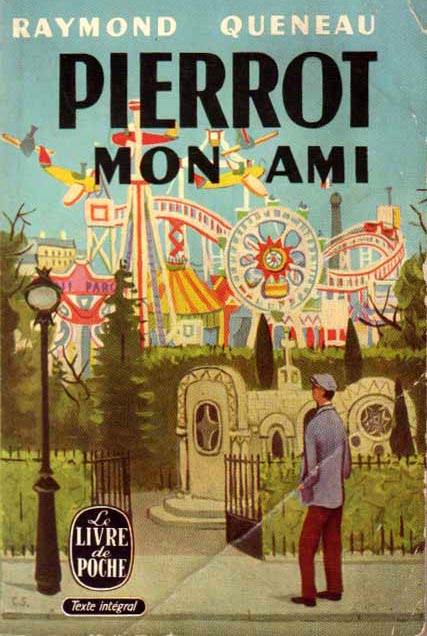
Entre deux périodes de chômage, Pierrot est embauché à l’Uni-Park, un parc d’attractions parisien enclavé d’une parcelle avec la chapelle où repose un prince poldève (Queneau fait écho à un canular du début du XXe sur ce pays imaginaire). Pierrot est tombé amoureux d’Yvonne, qui tient un petit stand, et se trouve être la fille des propriétaires gestionnaires de la foire. D’abord (et brièvement) au Palais de la Rigolade « pour aider les poules à passer le va-t-et-vient » (placeur de chalandes en jupe sur une bouche d’air qui souffle verticalement tandis que matent les « philosophes »), Pierrot devient assistant de sidi Mouilleminche (le frère du défunt Jojo, première amour de la patronne), alias le fakir Crouïa-Bey ; il ne le restera qu’une soirée, s’étant évanoui alors que l’artiste se transperçait les joues d’épingles à chapeau… Puis il fait la connaissance de Mounnezergues, le propriétaire de l’enclave, et celle de Psermis, le fameux montreur d’animaux savants du cirque Mamar…
Les personnages sont savoureux, et en tout premier lieu Pierrot, qui ne pense pas trop et ne court pas après le boulot, qui sait aussi apprécier placidement l’existence sans se faire d’illusions.
C’est aussi l’occasion d’affectueuses descriptions de la zone banlieusarde des fortifications dans l’entre-deux-guerres.
Une ambiance désuète, bonhomme, marque cette histoire dont l’intrigue maintient un temps les personnages dans un petit remous :
« Une sorte de courant l’avait déporté loin de ces rencontres hasardeuses où la vie ne voulait pas l’attacher. C’était un des épisodes de sa vie les plus ronds, les plus complets, les plus autonomes, et quand il y pensait avec toute l’attention voulue (ce qui lui arrivait d’ailleurs rarement), il voyait bien comment tous les éléments qui le constituaient auraient pu se lier en une aventure qui se serait développée sur le plan du mystère pour se résoudre ensuite comme un problème d’algèbre où il y a autant d’équations que d’inconnues, et comment il n’en avait pas été ainsi, il voyait le roman que cela aurait pu faire, un roman policier avec un crime, un coupable et un détective, et les engrènements voulus entre les différentes aspérités de la démonstration, et il voyait le roman que cela avait fait, un roman si dépouillé d’artifice qu’il n’était point possible de savoir s’il y avait une énigme à résoudre ou s’il n’y en avait pas, un roman où tout aurait pu s’enchaîner suivant des plans de police, et, en fait, parfaitement dégarni de tous les plaisirs que provoque le spectacle, une activité de cet ordre. »
Cet extrait de l’épilogue éclaire et obombre à la fois le dénouement, plus astucieux qu’attendu.
Ce roman recèle tant d’échantillons de vocabulaire châtié ou trivial qu’il sert de vivier à citations illustratives dans Le Grand Robert : 248 extraits ! (en comptant quelques néologismes, comme « vibrionique » ou « sinistromanu » pour qualifier une belle-mère de la main gauche). Le langage est souvent académique (d’élégants passés simples et imparfaits du subjonctif, surtout appréciables conjugués avec des termes d’argot), parfois fantaisiste, le plus souvent humoristique, toujours délicieusement quenien.
Exemples de prose :
« Les principales fonctions physiologiques du corps humain furent invoquées par les uns comme par les autres, ainsi que différents organes situés entre le genou et la ceinture. »
« ‒ Pas la peine d’essayer de me mettre en boîte avec vos allusions que je ne comprends pas, dit Léonie. Je ne suis pas idiote, allez. »
« …] alors il ressentit les parfums troublants dont elle s’était imbibée, son cœur chavira de nouveau à la mnémonique olfaction de cet appât sexuel et, pendant quelques instants, il s’abîma dans la reviviscence d’odeurs qui donnaient tant de luxueux attrait à la sueur féminine. »
« Le bonisseur vint voir s'il pouvait y aller. On pouvait commencer. Il fit donc fonctionner le piqueupe qui se mit à débagouler Travadja la moukère et le Boléro de Ravel, et, lorsque des luxurieux supposant quelque danse du ventre se furent arrêtés devant l'établissement, il dégoisa son boniment. »
« Quand tu auras un passé, Vovonne, tu t’apercevras quelle drôle de chose que c’est. D’abord y en a des coins entiers d’éboulés : plus rien. Ailleurs, c’est les mauvaises herbes qui ont poussé au hasard, et l’on y reconnaît plus rien non plus. Et puis il y a des endroits qu’on trouve si beaux qu’on les repeint tous les ans, des fois d’une couleur, des fois d’une autre, et ça finit par ne plus ressembler du tout à ce que c’était. Sans compter ce qu’on a cru très simple et sans mystère quand ça s’est passé, et qu’on découvre pas si clair que ça des années après, comme des fois tu passes tous les jours devant un truc que tu ne remarques pas et puis tout d’un coup tu t’en aperçois. »
« Fermez cette fenêtre simplement, et revenez demain ou après-demain voir si je suis mort. J’aime autant être seul pour procéder à cette transformation. Adieu, mon jeune ami, et merci. »
« Son vêtissement et sa toilette ne s’accompagnèrent que de vagues rêveries accompagnées du chantonnement spasmodique de refrains connus. »
J’ai tout particulièrement pris plaisir à la lecture de ce roman : Queneau sait s’y faire bien agréable compagnie...
Mots-clés : #humour #xxesiecle
- le Lun 15 Avr - 0:22
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Raymond Queneau
- Réponses: 47
- Vues: 5553
Page 10 sur 10 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
|
|


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages