La date/heure actuelle est Sam 27 Juil - 1:55
353 résultats trouvés pour famille
Henri Bosco
Un oubli moins profond
Dans le premier volume de ses souvenirs d'enfance, Henri Bosco présente d’entrée son projet et sa démarche :
« Voici des souvenirs.
Tels qu'ils sont revenus à moi du fond de ma mémoire, je les ai notés et je les présente.
Je ne raconte pas une suite d'événements qui se succèdent pas à pas, et ainsi qui s'enchaînent.
Je prends, au hasard des retours, les personnages et les faits qui vivaient encore, ou qui sommeillaient, dans le passé de mon enfance.
Je ne les ai pas recherchés, j'ai attendu. »
Première partie, Ces premières images… : « enfant docile et secret », douloureusement sensible, rêveur (et fils unique et couvé), il naît en Avignon, puis vit dès trois ans à la campagne, mais toujours dans un univers maternel de « signes », souvent funestes, un monde de l’invisible et des morts toujours présent.
Née peu après lui, sa sœur ne vit pas :
« Mais parmi les Ombres qui hantent mes oraisons nocturnes (et il y en a onze que je nomme toutes), celle-ci a sa place. »
S’ensuit un commerce avec les revenants, qui imprégna toute l’œuvre future.
Une enfance solitaire, mais aussi l’âne à pantalons du marchand des quatre-saisons des mas isolés, Gros-Lapin aux onze enfants, qui mourut lorsqu’il eut vendu le vieil animal aux Caraques ; les chouettes qui inspirent une méfiance superstitieuse ; outre cultivateurs et artisans, sept acrobates espagnols, un équilibriste, un jongleur, deux clowns et une danseuse, tous tristes, font partie du maigre voisinage ; le village de Barbentane, la Durance et le Rhône ; Tante Martine ; Bargabot le braconnier et Béranger, le vieux pâtre ; Tortille et Rachel, d’origine caraque, et le vieux Peppino gardant un hangar de costumes de théâtre...
« Et tout ce qui est plat m'attriste beaucoup.
– Plat pays, pays pour la pluie, disait Tante Martine.
Elle avait raison. Car jamais pays plat n'est aussi plat que quand il pleut, et jamais pluie n'est aussi pluie qu'en pays plat. Qui ne l'a noté ne sait rien, ni de la pluie ni de la plaine. Encore qu'il y ait, je le reconnais, plaine et plaine. Ainsi la Camargue en est une, mais quels lointains !... Rien ne les coupe. Et c'est la chance des beaux pays plats que rien n'en interrompe au loin la platitude, sauf les immenses et mystérieux nuages qui y prennent naissance, mais alors c'est un autre monde qui monte sur la plaine, et qui met tant d'imaginaires pays sur l'horizon, que la plaine bientôt est pareille à la mer et devient à perte de vue comme une étendue chimérique. On n'est plus sur la terre… »
« Mais ailleurs [L'enfant et la Rivière, Le Renard dans l'île, Barboche, Bargabot] j'ai assez parlé de Bargabot et du vieux Béranger pour me dispenser d'en dire plus long sur leur compte. Je me borne ici à en rappeler l'existence et, par amitié pour leurs Ombres dont personne au monde n'a plus de souci, j'ai placé au milieu de mes vieux souvenirs leurs deux noms où sont attachées leurs âmes disparues. Lorsque je les prononce, ces âmes sortent de l'oubli et je les vois encore dans la forme de ces figures qui vivaient et erraient au bord de la rivière, au temps où j'y errais moi-même, enfant solitaire que hantaient les eaux, qu'attiraient au-delà des eaux les collines…
J'ai conservé en moi ces eaux et ces collines. Je n'ai guère d'efforts à faire pour m'y retrouver, non tel que je suis devenu, mais tel que j'étais aux jours les plus émouvants d'une enfance qui dut suppléer par des songes à la monotonie d'une vie inégale aux désirs, aux chaleurs du sang, au besoin d'espérance. Tout me revient quand je l'évoque, et je l'évoque plus souvent à mesure que je m'enfonce davantage dans la vieillesse. Ce n'est pas mouvement de regret, nostalgie, car cette enfance ne fut pas heureuse, mais pour me découvrir tel que je suis, puisque je l'étais bien plus clairement à cet âge tendre, où ce qui sera aspire de toutes ses forces à le devenir. Et il y a aussi ce qui ne sera pas, ce qui était possible, et qui non moins vivement voulait vivre, mais que les malchances ou quelque faiblesse cachée ont peu à peu écarté de la vie. Nuage qui est né entre la rivière lointaine et cet aujourd'hui, ce poste de veille, éminence mélancolique, d'où l'on revoit en bas, dans une vague plaine, les ruines éparses le long des années. »
Seconde partie, Nocturnes… : inquiétudes, comme avec Babâou, qui se promène la nuit et aboie :
« Fait curieux, il avait perdu la raison, mais non pas la mémoire. Seulement on n'arrivait pas à savoir si ce qu'il en tirait était du souvenir, ou un rêve sur ce souvenir. Comme il racontait quelquefois d'étranges choses, on se disait qu'il inventait, et on le croyait naturellement, quand il en racontait de tout à fait banales. Or, on le sut plus tard, les étranges événements qu'il se rappelait étaient bien de vrais souvenirs, et les banalités, des bribes, des déchets de mauvais rêves. »
« Gros Sel », la petite épicerie écartée, à la limite de l’octroi de ville, et les « rats de cave » luttant contre une « contrebande communale »…
« Dame Gude était timorée, trotte-petit, grignotte-galette, tricote-menu. Une souris qui fait ses comptes. »
Même les amours… : le bastidon des vacances, près des « Lauzes » et de Lourmarin (découverte à huit ans de l’amour dans Paul et Virginie, et Cyprienne au faîte du cyprès) :
« Tout le mal (les soucis, les remords, les folles initiatives) résultent trop souvent des commentaires qu'on se croit obligé de donner à la vie, dont le grand secret, pour les sages, se réduit toujours à la vivre. »
« Un « bastidon », c'est au plus trois pièces, un fronton, sa génoise, le roc, un peu d'eau (pas beaucoup), du soleil, beaucoup de soleil et très peu d'ombre. Mais le grand air, une vue immense et la paix. »
La génoise, c’est la frise provençale composée de tuiles superposées et fixées dans le mortier (Louis Réau, Dictionnaire polyglotte des termes d'art et d'archéologie).
« De nature j'ai toujours été très timide, mais, également de nature, j'ai été curieux, plus curieux que timide. D'autre part quand un geste à faire m'intimidait trop, il me prenait toujours une envie inquiétante de l'accomplir le plus vite possible, pour en finir aussi le plus vite possible avec cette timidité insupportable. J'étais alors si tourmenté que je finissais par céder à mon envie. De là mes plus étranges escapades, en contradiction, semblait-il, avec ce que tout le monde louait de mon humble personne. »
Puis ce sont les histoires de Thérèse, et d’Isabelle la boulangère.
« Car Thérèse tenait bien moins à tel ou tel galant qu'à l'amour même. Si chacun de ceux-ci pouvait lui offrir de l'amour, l'un pouvait donc remplacer l'autre, sans que Thérèse y vît beaucoup de différence. Elle en aimait trop pour avoir l'obsession d'en aimer un seul. »
Familles : de grand-mère Louise et grand-père Marcelin, dit « La Vertu de Lorgues », à la famille marseillaise, en passant par Tante Martine et Baptistin, « Oncle Sabre », l'Oncle Thomas, etc.
Un romancier… : sa mère lui ayant appris le sortilège de la lecture, son père lui ayant fabriqué un petit pupitre (ainsi qu’une canisse qui occulte la vue et le livre aux songes) Henri Bosco écrit sa première fiction à sept ans (il a été scolarisé bien plus tard). Il dit tenir son imagination de son père, qui lui contait le soir une histoire pastorale :
« Créés d'abord pour m'endormir, ces contes ne m'endormant pas, mon père et ma mère, qui le constataient, auraient pu raisonnablement les interrompre. Mais sans doute eux-mêmes en les supprimant y eussent perdu un plaisir. Car ce plaisir, ils le prenaient, et déjà je n'en doutais guère. Il y avait, en effet, de ces nuits dans ma petite chambre où un émerveillement en commun nous saisissait tous trois. Mon père était charmé des trouvailles inattendues qu'il tirait si facilement de sa tête, ma mère s'étonnait d'une telle imagination et, quoi qu'elle en eût, l'admirait.
Et moi, ah ! où étais-je ? sinon dans ce monde où tout est si vrai qu'on y croit, mais serait d'ailleurs incroyable si tout n'était pas inventé. »
Il observe la canisse "en soi" :
« J'ai acquis à la regarder chaque jour et pendant des heures entières, le goût de connaître les choses. Car c'était une chose. Or, un goût poussé à ce point vous fait peu à peu découvrir que, sous un mot qui nous la voile, un seul mot, un mot qu'on répète, il y a plus de choses qu'il ne nous en offre dans la seule chose qu'il nomme. Il nous montre le tout et l'on s'y tient. Il nous cache ce que ce tout renferme nécessairement, quel qu'il soit, d'indicible, pour être ce qu'il est, et rien de moins. En somme, à étudier roseau par roseau, cette muraille végétale, à en suivre la vie qu'y menaient avec persévérance des bêtes minuscules, j'ai pris alors le sens positif du concret. […]
Ainsi, ma « canisse » m'offrait, d'une part un objet riche de matière et de vie, et d'autre part un stimulant à passer outre par les puissances imaginatives. Elle me montrait ce qui était là, et me donnait l'envie, le besoin, la passion de cet au-delà d'où nous vient la révélation et la nostalgie des étendues.
Quoi qu'il en soit, me voilà donc regardant la « canisse » et rêvant à la regarder.
Je me vois encore devant mon pupitre où, à force de demeurer sans rien faire, mais l'esprit toujours en travail, je sentais en moi le désir de faire quelque chose. Mais, du moins au début, ce désir n'est pas suffisant à nous mettre en train. Désirer faire quelque chose c'est d'abord désirer que se produise quelque événement. On est inactif, on attend, il n'arrive rien et, on a beau attendre, désirer et attendre, rien ne répond à ce désir, à cette attente. Il ne nous reste qu'à nous inventer ce que la solitude nous refuse. »
Et il rédige ce qui deviendra L'Enfant et la Rivière.
« J'entrepris un rêve, un rêve éveillé. »
Annonces de la solitude :
« Ce qu'on doit être, on l'est. On l'est avant le fruit, avant la fleur, avant même la graine close. Il suffit pour le devenir que le temps commence à pousser notre vie encore en sommeil vers une existence formelle et que les événements – créatures et circonstances – y imposent les premières flexions qui en détermineront le dessin futur. »
« Une maison vit comme vit un homme, un homme qui parfois, mais non pas toujours, est son âme. Rien en ce monde n'est construit qui ne soit, si l'on cherche bien, à l'image du monde, et l'homme comme la maison, la maison comme l'homme. C'est pourquoi tout événement qui se produit dans l'un est entendu de l'autre. »
Accent pongien ?
« Le silence d'un objet calme – d'un objet aux formes très bien accordées – en raconte plus long que l'imaginaire réponse de tel autre objet contourné, façonné dramatiquement, expressif à dessein et qui violente la matière naturellement sans impatience. »
« Jadis l'enfant ne commentait pas, il vivait. Il était là où il était. Je n'y suis plus et je rôde, faute de mieux, autour de ma mémoire. C'est vouloir circonscrire des nuées. On s'y perd… »
Accent bachelardien dans « l'être de la lampe » :
« Mais quelques-uns avaient, par leurs dimensions, leur activité, leur rôle nécessaire, une place prééminente. Ainsi la lampe et la pendule. Ce ne sont pas là des choses passives. »
« Le jour n'a pas besoin de lampes. La lampe a besoin de la nuit. »
Et pour finir… : sa religion, maternelle.
Le chantre de l’enfance nous révèle ainsi que tout ce qu’il écrivit par la suite fut véridique, aussi vrai que dans son rêve.
\Mots-clés : #autobiographie #contemythe #ecriture #enfance #famille #lieu #nature #relationenfantparent #reve #ruralité #solitude
- le Lun 1 Juil - 12:30
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Henri Bosco
- Réponses: 127
- Vues: 14869
Eugène Dabit
Un Mort tout neuf
Albert Singer est mort dans la nuit, à Belleville, en ce début d’année 1933. Mais c’est dans le lit de Paula, sa maîtresse, une actrice italienne, qu’est décédé ce rentier de cinquante-deux ans.
C’est l’entre-deux-guerres :
« Et aussi, tous ces bruits qui courent, comme en 1914. »
Avec le ton du constat, Eugène Dabit déroule sur quatre jours la réaction des proches du défunt, d’abord stupéfaction et douleur, puis assez vite les intérêts familiaux et personnels prennent le dessus, alimentés par le doute à propos de Paula que devait épouser Albert, après leur récente rencontre via les petites annonces.
« Alors que Ferdinand et Gaston, s’ils bougent, disent un mot, c’est pour évoquer Albert. C’est la mort qui leur souffle presque chaque parole, qui commande à chacun de leurs gestes, elle qui a pris pour vivre la forme d’Albert. »
La famille fouille dans ses papiers, son courrier, sa vie privée. Sa sœur Lucienne, son neveu Gaston sont plus sincèrement émus. Guère de croyants dans la famille : enterrement civil, dans le caveau d’un de ses frères, qui s’avère trop étroit.
« – Et moi, pour entrer, comment je ferai ? demande le gros Édouard. »
\Mots-clés : #famille #mort #social #xxesiecle
- le Sam 13 Avr - 17:58
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Eugène Dabit
- Réponses: 11
- Vues: 387
Pierre Bergounioux
Carnet de notes 1980-1990
Journal commencé à la trentaine, où Bergounioux note pour s’en souvenir les faits saillants de sa vie quotidienne (y compris la météo, à laquelle il est très sensible, étant plus rural qu’urbain) entre la Corrèze et la région parisienne, minéralogie, entomologie, pêche (à la truite), peinture, modelage, travail du bois puis de la ferraille, piano, archéologie préhistorique, descriptions (paysages, oiseaux), rêves nocturnes, ennuis de santé (lui et ses proches), famille et amis, son travail d’enseignant, et surtout ses copieuses lectures (et sa bibliophilie !), ses études qu’il prolonge ainsi, et ses souvenirs d’enfance (sa « vie antérieure », jusque dix-sept ans).
« Sur les zinnias voletaient Flambés et Machaons, ainsi que l’insaisissable Morosphinx. Jamais il ne se posait. Il oscillait dans l’air au-dessus du calice des fleurs, dans lequel il plongeait sa longue et fine trompe noire. Je n’ai jamais réussi, alors, à m’en emparer. J’en étais venu à le regarder comme une créature des rêves. Je percevais avec perplexité, avec dépit, l’existence de deux ordres, l’un que nos désirs édifient spontanément, l’autre, décevant, des choses effectivement accessibles, et l’impossibilité de franchir sans dommage ni perte la frontière. Est-ce que je m’en suis ouvert à quelqu’un ? Ai-je demandé des éclaircissements à ce sujet ? Peut-être. Papa aime à répéter, sardoniquement, que je fatiguais déjà tout le monde de questions. Mais je ne garde pas souvenir d’avoir obtenu la réponse. »
« Laver, nourrir, habiller les petits nous prend un temps infini. Comme la génération qui se forme pèse sur l’âge intermédiaire où nous sommes entrés, entre la dépendance à laquelle on est réduit, quand on commence, et celle où l’on va retomber avant de finir. »
« Ensuite, je peins – approches de la ville, avec, au premier plan, un canal, puis, sans l’avoir voulu, la façade de quelque château, flanqué de masures. À l’origine, c’était un pont sur l’eau à quoi j’ai fait faire un quart de tour. Quelque chose est apparu. Je ne parviens jamais de façon concertée à un résultat. Ce qui résulte d’un dessein arrêté est d’une banalité sans remède. C’est dans un angle mort, une dimension négligée, d’abord, d’un geste involontaire, que naissent la demeure des songes, la rive inconnue, la fête mystérieuse. »
« Toujours des soulèvements d’inquiétude, des éclairs d’angoisse, la crainte soudaine, panique, que le sursis qui me tient lieu de vie va prendre fin, que l’heure a sonné. Et ma réaction immédiate, indignée : qu’il est bien tôt, que j’ai beaucoup à faire, encore, qu’il me reste à connaître, à expérimenter, à aimer. »
« Tenté, au retour, de faire des essais de drapé avec du plâtre coulé dans un sac poubelle. J’avais été frappé, en avril, lors de la construction de la terrasse, des plis et volutes du ciment tombé, frais, dans la toile plastique froissée. Le résultat est décevant. Comment pourrait-il en aller autrement, au premier essai ? Et puis il faut que je revienne à ma lecture. Si j’excepte cette occupation dévorante, infinie, j’aurais bâclé ma vie, désireux que j’étais de répondre à l’appel de mille choses et conscient, tragiquement, qu’elle est trop brève pour pouvoir m’attarder plus qu’un court instant auprès de chacune d’elles. Comment étudier, pêcher, traquer les bêtes, chercher les pierres, les fossiles, peindre, modeler, menuiser, fondre, forger, rêver, respirer, regarder de tous ses yeux, être époux et père, professeur, fils et camarade, apprendre, avancer, ne pas oublier, ne jamais céder quand je suis sous la menace chronique d’être pris à la gorge sans rémission ? »
Début 1983, Bergounioux commence à écrire de la littérature.
« Malgré la fatigue, je reprends mon récit au commencement. J’essaie de le purger des approximations, des gaucheries. Je fais des phrases trop longues. C’est un de mes vices. Je me crois tenu, par mimétisme, d’envelopper une chose dans une seule et unique coulée syntaxique alors que, justement, le registre symbolique est autonome, relativement. »
Sa vie est partagée entre deux pôles, le travail dans l’Île-de-France, la nature pendant les vacances scolaires dans le Midi – et aussi le travail professionnel versus son « bureau » où il s’échine.
Ses phares sont Flaubert, Faulkner, Beckett, mais pas les seuls auteurs appréciés.
« Je lis les Chroniques italiennes de Stendhal avec un grand bonheur. Mais il a un âcre revers. Tout ce que je pourrais écrire s’en trouve terni. »
« Ensuite, j’extrais mes dernières lectures. Mais j’ai peu de preuves à présenter au tribunal qui siège en moi et me somme, le soir, d’expliquer, si je peux, ce que j’ai fait de ma journée. »
« Dans la même nuit, nous avons brisé le sortilège qui nous condamne à l’exil aux portes de Paris, traversé quatre cents kilomètres de ténèbres et de pluie, atteint le seuil de la seule existence que je sache, du seul monde qui lui fasse écho. »
« Je ne saurais lire puisque je suis parmi les choses. »
« Je regarde une émission de la série Histoires naturelles consacrée à la pêche au sandre. Les images du bord de l’eau, la lente marche du fleuve m’exaltent et m’accablent. J’aurais pu, moi aussi, passer des jours sur la rivière, dans l’oubli miséricordieux de tout. J’ai connu ce bonheur sans soupçonner qu’il me serait retiré bientôt. J’ai eu de ces heures, sur la Dordogne, et puis j’ai découvert, à dix-sept ans, qu’il semblait permis de comprendre ce qui nous arrivait, que cela se pouvait, et j’ai cessé de vivre. »
« J’esquisse un plan, jette, dirait-on, des grains de sable dans le vide, autour desquels pourraient se former des concrétions. Il me manque toujours l’arête. Je m’en remets sur l’avancée d’apporter ses propres rails, d’engendrer sa substance. Les mots, en revanche, tombent d’eux-mêmes, épousent la vision. »
« Je n’ai toujours pas pris mon parti de ne plus m’appartenir. »
« Paris excède la mesure de l’homme, la mienne, du moins. »
« La question est de savoir s’il est préférable de vivre ou de se retirer de la vie pour tenter d’y comprendre quelque chose, qui est encore une façon de vivre, mais combien désolée, amère, celle-ci. »
« Et comme je travaille de mes mains, et que je suis ici [les Bordes, en Corrèze], mes vieux compagnons, le noir souci, la contrariété, le désespoir chronique m’ont oublié. »
« Je songe aux profonds échos que la disparition de Mamie a soulevés, aux grandes profondeurs cachées sous la chatoyante et fragile surface des jours. J’y pensais, hier matin, dans la nuit noire, quand tout dormait, et j’y pense encore. Et c’est cela, peut-être, qu’il faudrait essayer de porter au jour. C’est le moment. Les figures tutélaires de mon enfance s’en vont, sans avoir seulement soupçonné, je suppose, ce qui s’est passé et les concernait, pourtant, au suprême degré. J’ai atteint l’âge où l’on peut tenter de comprendre, de porter dans l’ordre second, distinct, de l’écrit ce qu’on a confusément senti : la vie saisie à des moments successifs qui s’éclairent l’un l’autre, à l’occasion de ces subites et brutales retrouvailles que les naissances, les décès, surtout les décès, provoquent de loin en loin, les grandes permanences et le changement, l’œuvre fatidique, effrayante du temps. »
« Je reste un très long moment à me demander si j’ai bien de quoi remplir six autres chapitres, songe à croiser les voix, donc à modifier le poids, l’importance, le sens des choses qui commandent, à leur insu, parfois, mais parfois en conscience, les agissements des générations successives, la destinée unique, reprise par trois fois, de l’individu générique, supra-individuel auquel, sous le rapport de la longue durée, s’apparente celui, périssable, en qui nous consistons. »
« C’est à la faveur de ces instants limitrophes que m’apparaissent la hâte folle, la fureur concentrée qui m’emportent depuis ma dix-septième année et m’arrachent aux instants, aux lieux, aux êtres parmi lesquels nous aurons vécu, respiré. Toujours hors de moi, la tête ailleurs, l’esprit occupé de choses qui ne sont que dans les livres, ou alors du passé ou encore des éventualités redoutables, sans doute insurmontables, qui peuplent l’avenir. Et le seul bien véritable, le présent, ses authentiques et charmants habitants, je n’en aurai pas connu le goût, la douceur, la simple réalité. »
Bergounioux s’acharne, se force à écrire chaque jour – quand il en a le loisir.
« Je lance lessive sur lessive, range tout ce qui traîne partout, descends faire quelques achats, conduis Jean à sa dernière leçon de piano de l’année. Comment travailler ? Il ne me semble pas tant faire ce qu’il paraît, les courses, de la cuisine, prendre soin des petits, enseigner, etc. que combattre l’envahissement chronique de la vie, du métier, du chagrin, de tout, afin d’avoir un peu de temps pour la table de travail, méditer, endurer les affres sans nom de la réflexion, de l’explicitation. C’est un souci de chaque instant, une hantise vieille de vingt-deux ans et qui me ronge comme au premier jour. »
« Enfoncé dans la tâche d’écrire dont j’ai retrouvé, reconnu la rudesse, l’âpreté, le tempo – la facilité toute relative du matin, les lenteurs et les pesanteurs de l’après-midi, l’hébétude où je finis. C’est d’entrée de jeu qu’il faut emporter le morceau, arracher au vide rebelle, à l’opposition de la vie au retour réflexif, le sens de ce qui a eu lieu, le chiffre des heures passées. La violence du geste inaugural, et en vérité de cette occupation contre nature, dépasse de beaucoup celle que je mobilise, à l’atelier, contre les bois durs, l’acier. Que je relâche si peu que ce soit la pression à laquelle il faut soumettre la vapeur du souvenir, l’impalpable matière de la pensée, et la plume cesse de courir, le fil rompt. Je réussis à couvrir la deuxième page vers trois heures de l’après-midi après avoir douté, à chaque mot, d’extorquer le suivant, et un autre, encore, à l’inexpiable ennemi. C’est pur hasard, me semble-t-il, s’il a cédé. L’espoir s’est évanoui. On recommence, pourtant, puisque là est le chemin, et c’est ainsi qu’un autre terme vient, qu’on s’empresse, incrédule, d’ajouter au précédent. Et c’est à ce régime que je vais me trouver réduit pour des mois. »
« Je ne suis pas encore sorti de la voiture qu’un type à l’air malheureux, misérable, vient me demander une pièce. Il se passe des choses graves, que les rues soient pleines de gens qui mendient, qu’on soit partout et continuellement sollicité. »
« Les petits qui tournicotent sans rien faire m’irritent beaucoup. Mais c’est – j’essaie de me le rappeler – le privilège de l’âge où ils sont encore de n’avoir pas à compter, de dilapider les heures, les jours en petit nombre qui nous sont alloués. J’en ai usé, moi aussi, à leur âge, en très grand seigneur avant de me faire épicier. »
« Je me lève à six heures. Il s’agit de mordre sur le nouveau chapitre. Les premières lignes me coûtent mille maux. Je passe par toutes les couleurs de la désespérance. Partout, la muraille ou le puits, comme dans le conte d’Edgar Poe. Il doit être neuf heures lorsque les premiers mots apparaissent sur la page. Les mots d’Helvétius sur le malheur d’être et la fatigue de penser me reviennent. Dans l’intervalle, un jour clair et tiède s’est levé. C’est l’été de la Saint-Martin. Je m’acharne, gagne deux mots, trois autres un peu plus tard. À midi, j’aurai progressé d’une page. »
« La difficulté d’écrire se dresse, intacte, malgré les années. Je devine le grouillement obscur des possibles, l’enchevêtrement des thèmes, la confusion première, foncière, peut-être définitive de l’esprit aussi longtemps qu’il n’a pas fait retour sur lui-même, passé outre à l’interdit qui lui défend de se connaître, de porter en lui-même ordre et clarté. »
« Je lis La Psychologie des sentiments de Th. Ribot. Ce qu’il dit du sentiment esthétique est étrangement conforme à ce que j’ai toujours éprouvé, sous ce chef : un besoin aussi impérieux que la soif et la faim, plus impérieux, en vérité, plus violent, ab origine. »
« Je reprendrai plus tard la fin, qui est très insatisfaisante. Je reviens au début pour la première passe de rabotage. Il est deux heures et demie de l’après-midi lorsque j’ai grossièrement élagué le premier chapitre. La dialectique abstruse du deuxième m’arrête net et j’ai un accès de détresse. Jamais je ne serai content. Toujours mon esprit revient buter sur son insuffisance essentielle, son incurable infirmité. »
C’est une figure opiniâtre qui se dégage de ce journal, avec en filigrane un grand élan vers l’authenticité.
J’ai lu avec plaisir ces carnets, comme une histoire, tant le propos est bien énoncé, l’écriture agréable, la syntaxe soignée et riche le vocabulaire. Bien sûr cette lecture est laborieuse, puisqu’il s’agit d’un journal, donc non structuré, où abondent les récurrences des évocations de peines diverses ; mais les préoccupations de Bergounioux, les soucis qu’il consigne plus volontiers que les satisfactions, recoupent souvent les nôtres.
\Mots-clés : #autobiographie #creationartistique #ecriture #education #enfance #famille #journal #mort #nature #relationenfantparent #ruralité #urbanité #viequotidienne #xxesiecle
- le Jeu 14 Mar - 11:20
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Pierre Bergounioux
- Réponses: 40
- Vues: 4741
Thomas Savage
Le Pouvoir du chien
Les frères Burbank, Phil et George, 40 et 38 ans, gèrent le plus grand ranch d’une rude région de l’Ouest, et un lien fort les unit depuis l’enfance.
Le bienveillant docteur Johnny Gordon et son épouse Rose tiennent l’Auberge de Beech, où tourne un moulin à vent inutile ; ils ont un fils, Peter, une « chochotte » (efféminé), risée de ses camarades d’école, et ils connaissent la misère ; John se pend. Suivent la Première Guerre, la prohibition. Puis le lent et réservé, l’impénétrable et impassible George épouse Rose sans prévenir sa famille.
Nous découvrons les faits concernant les Burbank essentiellement au travers de Phil, charismatique et doué, mais qui aime se moquer cruellement, est réactionnaire (le monde change, surtout pour la tradition puritaine, ou plutôt anglicane) et raciste (juifs, indiens, immigrés récents, etc.). Il évoque fréquemment Bronco Henry, un légendaire rancher : le bon vieux temps des premiers colons (et aussi une relation personnelle).
« Phil n’avait pas lieu d’être inquiet, mais on se demande parfois si les gens sont bien comme on le croit, ou si on les croit seulement tels alors qu’ils sont comme ils sont et pas comme on le croit.
Phil eut un instant envie de se lever et de féliciter George de ne pas l’avoir déçu, d’être bien comme il l’avait espéré, comme il l’avait cru, comme il avait su qu’il était. Mais évidemment il ne l’avait pas fait, parce qu’il n’y avait jamais eu de sentiment exprimé entre eux par des mots et il n’y en aurait jamais. Leur relation n’était pas fondée sur la parole. Phil n’avait encore jamais connu qui que ce soit qui puisse se permettre de trop parler sans être un pauvre imbécile. »
Renfermé et froid, Peter, aussi propre que Phil est sale, veut devenir médecin comme son père.
« La vérité faisait sursauter toutes les personnes qu’il connaissait. »
Phil déteste la sensible et tolérante Rose, qui se met à boire pour soigner les migraines qu’il provoque en tramant son éviction.
« Elle ne pouvait rien être s’il n’y avait pas quelqu’un pour croire en elle, rien du tout. Elle ne pouvait rien être d’autre que ce que quelqu’un croyait qu’elle était. »
Phil se rapproche adroitement du distant Peter qu’il méprisait. Puis le récit bascule soudainement (dans le dernier chapitre) : Phil meurt.
C’est le personnage fort complexe de Phil, manipulateur et victime, qui est le plus approfondi (et subtilement, car on a une impression de caricature au début du livre). Malgré quelques indices habilement distillés par Savage, celui-ci fait magistralement monter la tension dramatique sans que l’on devine le dénouement avant la dernière ligne (il nous a pourtant lourdement précisé depuis le début que Phil ne portait jamais de gants).
Western psychologique d'un auteur du Montana qui mérite d'être lu.
\Mots-clés : #famille #ruralité
- le Dim 24 Déc - 10:00
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Thomas Savage
- Réponses: 4
- Vues: 753
Jean Giono
Le Chant du monde
Antonio, du fleuve (c’est un pêcheur qui vit sur l’île des geais), dit « bouche d’or », et Matelot, de la forêt (un ancien marin devenu bûcheron), partent à la recherche du besson, le dernier fils de ce dernier, parti dans le nord former un radeau de bois. Parvenus en pays Rebeillard, ils secourent une jeune aveugle, Clara « aux yeux de menthe », qui met au monde son fils seule dans la nuit, et la confient à « la mère de la route ». C’est le pays de Maudru, et ses bouviers traquent le besson.
Giono est toujours attentif à la nature.
« L’odeur des mousses se leva de son nid et élargit ses belles ailes d’anis. Une pie craqua en dormant comme une pomme de pin qu’on écrase. Une chouette de coton passa en silence, elle se posa dans le pin, elle alluma ses yeux. »
Ils cheminent vers Villevieille et ses tanneries, avec les malades d’une mystérieuse maladie (on pense à Le hussard sur le toit), et Médéric, le fils de la sœur de Maudru, que le « cheveu-rouge » (le besson) a blessé à mort. Ils retrouvent ce dernier chez monsieur Toussaint, le marchand d’almanachs (le guérisseur), qui est Jérôme, frère bossu de Junie, la femme de Matelot. Le dernier de deux jumeaux s'y est réfugié avec Gina, la fille de Maudru, qu’il a enlevée (et qui est déçue).
Médéric, donc Gina était la promise, meurt ; les Maudru les surveillent. Antonio rêve de Clara, Matelot de la mort qu’il voit comme un grand voilier blanc sur la montagne. Ce dernier meurt poignardé par les bouviers. Le besson et Antonio incendient Puberclaire, résidence de Maudru avec ses étables à taureaux.
Clara retrouvée par Antonio, les deux couples redescendent vers le sud pour y construire une nouvelle vie.
Le personnage du fleuve est sensible lorsqu’Antonio s’y baigne, et aussi lors de la débâcle printanière du renouveau de l’amour.
Ce roman est baigné d’une atmosphère légendaire, accentuée par certains vocables des lieux, et une faune fantastique, comme le congre d’eau douce et les houldres, mais aussi par des obscurités dans les dialogues et les péripéties.
« Il y avait une espèce d’oiseau qu’au pays Rebeillard on appelait les houldres. Ils étaient en jaquette couleur de fer avec une cravate d’or. »
C’est un univers apparemment symbolique, où j’ai reconnu des allusions mythologiques, mais sans qu’il semblât décryptable à la façon d’une parabole : c’est un fusionnement syncrétiste des humains avec les éléments et animaux et vice-versa, de l’homme-fleuve aux oiseaux qui parlent, tous participant d’une source de vie commune.
\Mots-clés : #amitié #amour #famille #jeunesse #merlacriviere #mort #nature #relationenfantparent #ruralité #violence
- le Dim 19 Nov - 13:02
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean Giono
- Réponses: 188
- Vues: 20068
Louise Erdrich
Love Medicine
Comme dans tout roman choral, il est difficile au lecteur de mémoriser les nombreux personnages (et ce malgré la présence d’une sorte d’arbre généalogique assez peu clair) – et encore plus difficile d’en rendre compte. De plus, il y a deux Nector, deux King, deux Henry… Mais ce mixte chaotique et profus d’enfants et de liaisons de parenté (avec ou sans mariage, catholique ou pas) est certainement volontaire chez Louise Erdrich.
À travers les interactions des membres de deux (ou trois) familles ayant des racines remontant jusqu’à six générations, c’est l’existence des Indiens de nos jours dans une réserve du Dakota du Nord qui est exposée, avec les drames de l’alcoolisme, du chômage, de la misère, de la prison, de la guerre du Vietnam, du désarroi entre Dieu, le Très-bas et les Manitous (Marie Lazarre Kashpaw) et la pure superstition (Lipsha Morrissey). C’est également une grande diversité d’attitudes individuelles, épisodes marquants de la vie des personnages présentés par eux-mêmes (tout en restant profondément rattachés à leurs histoires familiales et tribales). "Galerie de portraits hauts en couleur", ce poncif caractérise pourtant excellemment cette "fresque pittoresque"…
Ainsi, Moses Pillager, qui était nourrisson lors d’une épidémie :
« Ne voulant pas perdre son fils, elle décida de tromper les esprits en prétendant que Moses était déjà mort, un fantôme. Elle chanta son chant funèbre, bâtit sa tombe, déposa sur le sol la nourriture destinée aux esprits, lui enfila ses habits à l’envers. Sa famille parlait par-dessus sa tête. Personne ne prononçait jamais son vrai nom. Personne ne le voyait. Il était invisible, et il survécut. »
Moses devint windigo, se retira seul sur une île avec des chats, portant toujours ses habits à l’envers et marchant à reculons…
La joyeuse et vorace Lulu Nanapush Lamartine, qu’on pourrait désigner comme une femme facile, qui fait entrer « la beauté du monde » en elle avec constance et élève une ribambelle d’enfants, forme comme un pendant de Marie, opposition en miroir, et ces deux fortes personnalités font une image des femmes globalement plus puissante que celle des hommes.
« Elle déplia une courtepointe coupée et cousue dans des vêtements de laine trop déchirés pour être raccommodés. Chaque carré était maintenu en place avec un bout de fil noué. La courtepointe était marron, jaune moutarde, de tous les tons de vert. En la regardant, Marie reconnut le premier manteau qu’elle avait acheté à Gordie, une tache pâle, gris dur, et la couverture qu’il avait rapportée de l’armée. Il y avait l’écossais de la veste de son mari. Une grosse chemise. Une couverture de bébé à demi réduite en dentelle par les mites. Deux vieilles jambes de pantalon bleues. »
La situation tragique d’un peuple vaincu et en voie de déculturation reste bien sûr le thème nodal de ces destins croisés.
« Pour commencer, ils vous donnaient des terres qui ne valaient rien et puis ils vous les retiraient de sous les pieds. Ils vous prenaient vos gosses et leur fourraient la langue anglaise dans la bouche. Ils envoyaient votre frère en enfer, et vous le réexpédiaient totalement frit. Ils vous vendaient de la gnôle en échange de fourrures, et puis vous disaient de ne pas picoler. »
Dès ce premier roman, Louise Erdrich maîtrise l’art de la narration, tant en composition que dans le style, riche d’aperçus métaphoriques comme descriptifs. La traduction m’a paru bancale par endroits.
\Mots-clés : #amérindiens #discrimination #famille #identite #minoriteethnique #relationenfantparent #romanchoral #ruralité #social #temoignage #traditions #xxesiecle
- le Mer 20 Sep - 12:12
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Louise Erdrich
- Réponses: 37
- Vues: 3115
Jonathan Coe
Le Cœur de l'Angleterre
Troisième et dernier tome de la trilogie Les Enfants de Longbridge (paru bien après Bienvenue au club et Le Cercle fermé), sur la famille Trotter dans la seconde moitié du XXe, et ici au début du XXIe.
2010, le racisme est patent sous le couvert de la société multiculturelle épanouie. Août 2011 : émeutes et pillages de jeunes (la fracture est aussi générationnelle).
« On apercevait bien quelques émeutiers blancs et quelques policiers noirs, mais le face-à-face donnait l’impression écrasante d’un conflit racial. »
Le gouvernement considère qu’il s’agit de « débordements criminels, pas politiques ».
« Mais regardez plutôt comment ça a commencé. La police a abattu un Noir et refusé de communiquer avec sa famille sur les circonstances de sa mort. Une foule s’est rassemblée devant le commissariat pour protester et les choses ont tourné à l’aigre. Ce qui est en cause c’est le problème racial et les relations de pouvoir au sein de la communauté. Les gens se sentent victimes. On ne les écoute pas. »
Comme de coutume dans cette trilogie, Coe nous entraîne dans les arcanes de la politique (notamment grâce à Doug, journaliste positionné à gauche, qui semble porter l’opinion de Coe) ; mais on aborde aussi, avec le personnage de Sophie, le milieu universitaire, « cette manie de se polariser sur un sujet jusqu’à l’obsession en ignorant superbement le reste du monde », et celui de l’édition avec Philip et Benjamin.
Après la crise de 2008, David Cameron mène une politique d’austérité, et initie le référendum qui conduira au Brexit ; il recourt au nationalisme, mais la peur de l’immigration est prépondérante ; la désindustrialisation est passée par là. Et arrive Boris Johnson…
« Pourquoi est-ce que les journalistes aiment tant les questions hypothétiques ? Et qu’est-ce qui se passe si vous perdez ? Et qu’est-ce qui se passe si on quitte l’UE ? Qu’est-ce qui se passe si Donald Trump est élu président ? Vous vivez dans un monde imaginaire, vous autres. »
« Les gens vont voter comme ils votent toujours, c’est-à-dire avec leurs tripes. Cette campagne va se gagner avec des slogans, des accroches, à l’instinct et à l’émotion. Sans parler des préjugés [… »
Entretemps, Benjamin connaît un certain succès avec la publication du roman extrait de son énorme manuscrit, roman qui reprend son histoire avec Cicely (qui est partie seule en Australie soigner sa sclérose en plaques).
Côté social, le politiquement correct est présenté comme la cible de conservateurs âgés que rebutent la société multiculturelle ; en contrepoint est présenté le cas de Sophie, suspendue (et jetée en pâture aux réseaux sociaux) car (injustement) accusée de discrimination genrée par Coriandre, l’hargneuse fille de Doug.
Les retrouvailles de Benjamin et Charlie Chappell, clown pour goûters d’enfants en conflit avec son rival Duncan Field, sont l’occasion pour Coe de réitérer sa conception du destin :
« Benjamin comprenait qu’il voyait la vie comme une succession d’aléas qu’on ne pouvait ni prévenir ni maîtriser, si bien qu’il ne restait plus qu’à les accepter et tâcher d’en tirer parti autant que faire se pouvait. C’était une saine conception des choses mais qu’il n’avait jamais réussi à faire tout à fait sienne, pour sa part. »
C’est surtout la nostalgie et la désillusion qui percent dans cet après-Brexit, marqué par un exil en Europe pour quelques Trotter cherchant à échapper au passé.
\Mots-clés : #contemporain #famille #historique #nostalgie #politique #relationenfantparent #romanchoral #social #xxesiecle
- le Ven 25 Aoû - 17:27
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Jonathan Coe
- Réponses: 57
- Vues: 3505
Jonathan Coe
Le Cercle fermé
(En complément au commentaire approfondi de Pinky.)
1999 (livre paru en 2004), Claire revient d’Italie en Angleterre après cinq ans d’absence, et se confie par écrit à sa sœur Miriam, disparue (c’est la suite de Bienvenue au club, où les mêmes personnages vivaient dans les années soixante-dix). Le portable est devenu inévitable :
« …] quantité de gens qui ne travaillent plus, qui ne fabriquent rien, ne vendent rien. Comme si c’était démodé. Les gens se contentent de se voir et de parler. Et quand ils ne se voient pas pour parler directement, ils sont généralement occupés à parler au téléphone. Et de quoi ils parlent ? Ils prennent rendez-vous pour se voir. Mais je me pose la question : quand enfin ils se voient, de quoi ils parlent ? »
Nous savons depuis que lorsque les gens se voient, ils parlent à d’autres, sur leur portable.
Intéressante mise en parallèle des vies de couple de Benjamin et Doug, qui parviennent à se ménager une vie privée digne d’un célibataire – non sans une autre présence féminine, à laquelle ils ne savent guère faire face, incapables de prendre une décision.
« C’est là un défaut pathologique du sexe masculin. Nous n’avons aucune loyauté, aucun sens du foyer, aucun instinct qui nous pousserait à protéger le nid : tous ces réflexes naturels et sains qui sont inhérents aux femmes. On est des ratés. Un homme, c’est une femme ratée. C’est aussi simple que ça. »
Les profonds changements dans la communication sont particulièrement approfondis :
« Donc, d’après vous, si je comprends bien, disait Paul, le discours politique est devenu un genre de champ de bataille où politiciens et journalistes s’affrontent jour après jour sur le sens des mots.
— Oui, parce que les politiciens font tellement attention à ce qu’ils disent, les déclarations politiques sont devenues tellement neutres que c’est aux journalistes qu’il incombe de créer du sens à partir des mots qu’on leur donne. Ce qui compte aujourd’hui, ce n’est plus ce que vous dites, vous autres, c’est la manière dont c’est interprété. »
« C’est très moderne, l’ironie, assura-t-elle. Très in. Vous voyez, vous n’avez plus besoin d’expliciter ce que vous voulez dire. En fait, vous n’avez même pas besoin de penser ce que vous dites. C’est toute la beauté de la chose. »
« Il y a quelques mois, par exemple, ils ont pris des photos d’un top model particulièrement rachitique pour un article de mode du supplément dominical, mais elle avait l’air tellement squelettique et mal en point qu’ils ont renoncé à les utiliser. Et puis la semaine dernière ils ont fini par les déterrer pour illustrer un article sur l’anorexie psychosomatique. Visiblement, ça ne leur posait aucun problème. »
« Oh, de nos jours, tout dépend de la manière dont c’est présenté par les médias, pas vrai ? À croire que tout dépend de ça. »
Le Cercle fermé est créé au sein de la Commission travailliste réfléchissant au financement privé du secteur public (on est sous Tony Blair) ; l’extrême droite commence à monter.
Benjamin est un personnage central ; écrivain et musicien (assez raté), il reflète peut-être un aspect (ironique) du projet romanesque de Coe.
« Ce serait satisfaisant, d’une certaine façon ; il y aurait là un peu de la symétrie qu’il passait tant de temps à traquer en vain dans la vie, le sentiment d’un cercle qui se referme... »
« Je suis un homme, blanc, d’âge moyen, de classe moyenne, un pur produit des écoles privées et de Cambridge. Le monde n’en a pas marre des gens comme moi ? Est-ce que je n’appartiens pas à un groupe qui a fait son temps ? Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux fermer notre gueule et laisser la place aux autres ? Est-ce que je me fais des illusions en croyant que ce que j’écris est important ? Est-ce que je me contente de remuer les cendres de ma petite vie et d’en gonfler artificiellement la portée en plaquant dessus des bouts de politique ? »
Puis c’est le 11 septembre 2001, et l’approche de la « guerre à l’Irak ».
« La guerre n’avait pas encore commencé, mais tout le monde en parlait comme si elle était inévitable, et on était forcément pour ou contre. À vrai dire, presque tout le monde était contre, semblait-il, à part les Américains, Tony Blair, la plupart de ses ministres, la plupart de ses députés et les conservateurs. Sinon, tout le monde trouvait que c’était une très mauvaise idée, et on ne comprenait pas pourquoi on en parlait soudain comme si c’était inévitable. »
Le compte à rebours des chapitres souligne le suspense des drames personnels de la petite communauté quadragénaire immergée dans cette fresque historique.
\Mots-clés : #actualité #famille #historique #medias #politique #psychologique #relationdecouple #romanchoral #social #xxesiecle
- le Lun 21 Aoû - 13:08
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Jonathan Coe
- Réponses: 57
- Vues: 3505
William Faulkner
Descends, Moïse
Sept récits paraissant indépendants de prime abord, qui mettent en scène des personnages du Sud des USA, blancs, nègres (et Indiens ; je respecte, comme j’ai coutume de le faire, l’orthographe de mon édition, exactitude encore permise je pense). Plus précisément, c’est la lignée des Mac Caslin, qui mêle blancs et noirs sur la terre qu’elle a conquise (les premiers émancipant les seconds). Oppositions raciale, mais aussi genrée sur un siècle, plus de quatre générations dans le Mississipi.
Le titre fait référence à des injonctions du Seigneur à Moïse sur le Sinaï, notamment dans l’Exode. Ce roman est dédicacé à la mammy de Faulkner enfant, née esclave.
Autre temps : apparition de Isaac Mac Caslin, « oncle Ike », et la poursuite burlesque d’un nègre enfui.
Le Feu et le Foyer : affrontement de Lucas Beauchamp et Edmonds, fils de Mac Caslin, qui a pris la femme du premier :
« – Ramasse ton rasoir, dit Edmonds.
– Quel rasoir ? » fit Lucas. Il leva la main, regarda le rasoir comme s’il ne savait pas qu’il l’avait, comme s’il ne l’avait encore jamais vu, et, d’un seul geste, il le jeta vers la fenêtre ouverte, la lame nue tournoyant avant de disparaître, presque couleur de sang dans le premier rayon cuivré du soleil. « J’ai point besoin de rasoir. Mes mains toutes seules suffiront. Maintenant, prenez le revolver sous votre oreiller. » »
« Alors Lucas fut près du lit. Il ne se rappela pas s’être déplacé. II était à genoux, leurs mains enlacées, se regardant face à face par-dessus le lit et le revolver : l’homme qu’il connaissait depuis sa petite enfance, avec lequel il avait vécu jusqu’à ce qu’ils fussent devenus grands, presque comme vivent deux frères. Ils avaient péché et chassé ensemble, appris à nager dans la même eau, mangé à la même table dans la cuisine du petit blanc et dans la case de la mère du petit nègre ; ils avaient dormi sous la même couverture devant le feu dans les bois. »
Péripéties autour d’alambics de whisky de contrebande, et de la recherche d’un trésor. Lucas, bien que noir, a plus de sang de la famille que Roth Edmonds, le blanc, que sa mère a élevé avec lui dès sa naissance. Le même schéma se reproduit de père en fils, si bien qu’on s’y perd, et qu’un arbre généalogique de la famille avec tous les protagonistes serait utile au lecteur (quoique ce flou entre générations soit vraisemblablement prémédité par Faulkner, de même que le doute sur la "couleur" de certains personnages, sans parler des phrases contorsionnées).
« Lucas n’était pas seulement le plus ancien des habitants du domaine, plus âgé même que ne l’aurait été le père d’Edmonds, il y avait ce quart de parenté, non seulement de sang blanc ni même du sang d’Edmonds, mais du vieux Carothers Mac Caslin lui-même de qui Lucas descendait non seulement en ligne masculine, mais aussi à la seconde génération, tandis qu’Edmonds descendait en ligne féminine et remontait à cinq générations ; même tout gamin, il remarquait que Lucas appelait toujours son père M. Edmonds, jamais Mister Zack comme le faisaient les autres nègres, et qu’il évitait avec une froide et délibérée préméditation de donner à un blanc quelque titre que ce fût en s’adressant à lui. »
« Ce n’était pas toutefois que Lucas tirât parti de son sang blanc ou même de son sang Mac Caslin, tout au contraire. On l’eût dit non seulement imperméable à ce sang, mais indifférent. Il n’avait pas même besoin de lutter contre lui. Il ne lui fallait pas même se donner le mal de le braver. Il lui résistait par le simple fait d’être le mélange des deux races qui l’avaient engendré, par le seul fait qu’il possédait ce sang. Au lieu d’être à la fois le champ de bataille et la victime de deux lignées, il était l’éprouvette permanente, anonyme, aseptique, dans laquelle toxines et antitoxines s’annulaient mutuellement, à froid et sans bruit, à l’air libre. Ils avaient été trois autrefois : James, puis une sœur nommée Fonsiba, puis Lucas, enfants de Tomey’ Turl, fils du vieux Carothers Mac Caslin et de Tennie Beauchamp, que le grand-oncle d’Edmonds, Amédée Mac Caslin, avait gagnée au poker à un voisin en 1859. »
« Il ressemble plus au vieux Carothers que nous tous réunis, y compris le vieux Carothers. Il est à la fois l’héritier et le prototype de toute la géographie, le climat, la biologie, qui ont engendré le vieux Carothers, nous tous et notre race, infinie, innombrable, sans visage, sans nom même, sauf lui qui s’est engendré lui-même, entier, parfait, dédaigneux, comme le vieux Carothers a dû l’être, de toute race, noire, blanche, jaune ou rouge, y compris la sienne propre. »
Bouffonnerie noire : Rider, un colosse noir, enterre sa femme et tue un blanc.
Gens de jadis : Sam Fathers, fils d’un chef indien et d’une esclave quarteronne, vendu avec sa mère par son père à Carothers Mac Caslin ; septuagénaire, il enseigne d’année en année la chasse à un jeune garçon, Isaac (Ike).
« L’enfant ne le questionnait jamais ; Sam ne répondait pas aux questions. Il se contentait d’attendre et d’écouter, et Sam se mettait à parler. Il parlait des anciens jours et de la famille qu’il n’avait jamais eu le temps de connaître et dont, par conséquent, il ne pouvait se souvenir (il ne se rappelait pas avoir jamais aperçu le visage de son père), et à la place de qui l’autre race à laquelle s’était heurtée la sienne pourvoyait à ses besoins sans se faire remplacer.
Et, lorsqu’il lui parlait de cet ancien temps et de ces gens, morts et disparus, d’une race différente des deux seules que connaissait l’enfant, peu à peu, pour celui-ci, cet autrefois cessait d’être l’autrefois et faisait partie de son présent à lui, non seulement comme si c’était arrivé hier, mais comme si cela n’avait jamais cessé d’arriver, les hommes qui l’avaient traversé continuaient, en vérité, de marcher, de respirer dans l’air, de projeter une ombre réelle sur la terre qu’ils n’avaient pas quittée. Et, qui plus est, comme si certains de ces événements ne s’étaient pas encore produits mais devaient se produire demain, au point que l’enfant finissait par avoir lui-même l’impression qu’il n’avait pas encore commencé d’exister, que personne de sa race ni de l’autre race sujette, qu’avaient introduite avec eux sur ces terres les gens de sa famille, n’y était encore arrivé, que, bien qu’elles eussent appartenu à son grand-père, puis à son père et à son oncle, qu’elles appartinssent à présent à son cousin et qu’elles dussent être un jour ses terres à lui, sur lesquelles ils chasseraient, Sam et lui, leur possession actuelle était pour ainsi dire anonyme et sans réalité, comme l’inscription ancienne et décolorée, dans le registre du cadastre de Jefferson, qui les leur avaient concédées, et que c’était lui, l’enfant, qui était en ces lieux l’invité, et la voix de Sam Fathers l’interprète de l’hôte qui l’y accueillait.
Jusqu’à il y avait trois ans de cela, ils avaient été deux, l’autre, un Chickasaw pur sang, encore plus incroyablement isolé dans un sens que Sam Fathers. Il se nommait Jobaker, comme si c’eût été un seul mot. Personne ne connaissait son histoire. C’était un ermite, il vivait dans une sordide petite cabane au tournant de la rivière, à cinq milles de la plantation et presque aussi loin de toute autre habitation. C’était un chasseur et un pêcheur consommé ; il ne fréquentait personne, blanc ou noir ; aucun nègre ne traversait même le sentier qui menait à sa demeure, et personne, excepté Sam, n’osait approcher de sa hutte. »
Jobaker décédé, Sam se retire au Grand Fond, et prépare l’enfant à son premier cerf :
« …] l’inoubliable impression qu’avaient faite sur lui les grands bois – non point le sentiment d’un danger, d’une hostilité particulière, mais de quelque chose de profond, de sensible, de gigantesque et de rêveur, au milieu de quoi il lui avait été permis de circuler en tous sens à son gré, impunément, sans qu’il sache pourquoi, mais comme un nain, et, jusqu’à ce qu’il eût versé honorablement un sang qui fût digne d’être versé, un étranger. »
« …] la brousse […] semblait se pencher, se baisser légèrement, les regarder, les écouter, non pas véritablement hostile, parce qu’ils étaient trop petits, même ceux comme Walter, le major de Spain et le vieux général Compson, qui avaient tué beaucoup de daims et d’ours, leur séjour trop bref et trop inoffensif pour l’y inciter, mais simplement pensive, secrète, énorme, presque indifférente. »
L’ours :
« Cette fois, il y avait un homme et aussi un chien. Deux bêtes, en comptant le vieux Ben, l’ours, et deux hommes, en comptant Boon Hogganbeck, dans les veines de qui coulait un peu du même sang que dans celles de Sam Fathers, bien que celui de Boon en fût une déviation plébéienne et que seul celui du vieux Ben et de Lion, le chien bâtard, fût sans tache et sans souillure. »
Cet incipit railleur de Faulkner dénote les conceptions de l’époque sur les races et la pureté du sang.
Ce récit et le précédent, dont il constitue une variante, une reprise et/ou une extension, sont un peu dans la même veine que London. Ils m’ont impressionné par la façon fort juste dont sont évoqués le wild, la wilderness, la forêt sauvage (la « brousse »), « la masse compacte quoique fluide qui les entourait, somnolente, sourde, presque obscure ». Ben, le vieil ours qui « s’était fait un nom » et qui est traqué, Sam et « le grand chien bleu » laisseront la vie dans l’ultime scène dramatique.
Puis Ike, devenu un chasseur et un homme, refuse la terre héritée de ses ancêtres, achetée comme les esclaves (depuis affranchis) ; se basant sur les registres familiaux, il discourt sur la malédiction divine marquant le pays.
Automne dans le Delta : Ike participe une fois encore à la traditionnelle partie de chasse de novembre dans la « brousse », qui a reculé avec le progrès états-unien, et il se confirme que Faulkner est, aussi, un grand auteur de nature writing.
« …] rivières Tallahatchie ou Sunflower, dont la réunion formait le Yazoo, la Rivière du Mort des anciens Choctaws – les eaux épaisses, lentes, noires, sans soleil, presque sans courant, qui, une fois l’an, cessaient complètement de couler, remontaient alors leur cours, s’étalant, noyant la terre fertile, puis se retiraient la laissant plus fertile encore. »
« Car c’était sa terre, bien qu’il n’en eût jamais possédé un pied carré. Il ne l’avait jamais désiré, pas même après avoir vu clairement son suprême destin, la regardant reculer d’année en année devant l’attaque de la hache, de la scie, des chemins de fer forestiers, de la dynamite et des charrues à tracteur, car elle n’appartenait à personne. Elle appartenait à tous : on devait seulement en user avec sagesse, humblement, fièrement. »
La chasse est centrale, avec son ancrage ancestral, son initiation, son folklore, son narratif, et son éthique (c’est le vieil Ike qui parle) :
« Le seul combat, en quelque lieu que ce soit, qui ait jamais eu quelque bénédiction divine, ça a été quand les hommes ont combattu pour protéger les biches et les faons. »
Descends, Moïse : mort d’un des derniers Beauchamp.
Les personnages fort typés mis en scène dans ce recueil se rattachent à la formidable galerie des figures faulknériennes ; ainsi apparaissent des Sartoris, des Compson, et même Sutpen d’Absalon ! Absalon !.
Ces épisodes d’apparence indépendants me semblent former, plus qu’un puzzle, un archipel des évènements émergents d’un sang dans la durée.
\Mots-clés : #colonisation #discrimination #esclavage #famille #identite #initiatique #lieu #nature #portrait #racisme #religion #ruralité #social #violence
- le Mer 2 Aoû - 13:36
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William Faulkner
- Réponses: 103
- Vues: 13100
Chris Kraus
Christopher "Chris" Johannes Kraus, né à Göttingen (alors en Allemagne de l'Ouest) en 1963, est un auteur et réalisateur allemand.
Réalisateur, scénariste, écrivain, Chris Kraus a notamment étudié à l'Académie allemande du film et de la télévision de Berlin. Il est l’auteur de plusieurs œuvres cinématographiques qui lui ont valu de nombreux prix, parmi d'autres 22 nominations aux Oscars allemands.
Son long-métrage Quatre Minutes (2006) a été couronné de succès dans le monde entier. Ce drame carcéral a obtenu un grand succès critique et commercial en France et a été adapté au théâtre (Théatre La Bruyère, Paris, 2014).
En 2011, l'actrice Paula Beer, alors âgée de 14 ans, a commencé sa carrière internationale avec le drame historique Poll.
En 2017, la comédie The Bloom of Yesterday (Die Blumen von gestern), plusieurs fois primée, est sortie en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Pour sa performance, l'actrice française Adèle Haenel a reçu une nomination pour la meilleure actrice pour le Prix du film autrichien 2018.
Outre des fictions, Chris Kraus a également coréalisé un documentaire sur l’écrivain et réalisateur Rosa von Praunheim, Rosakinder (2012).
Chris Kraus est par ailleurs l’auteur de quatre romans, dont Das kalte Blut (2017), son ouvrage le plus connu, paru en Belgique et en France en 2019 sous le titre La Fabrique des salauds.
Ouvrage traduit en français :
La fabrique des salauds
--------------------------------------------------------
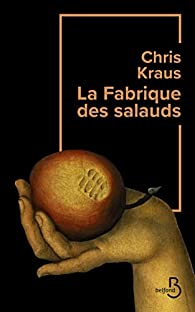
L'histoire commence dans un hôpital : deux hommes partagent la même chambre, l'un atteint d'une fracture du crâne, avec en permanence une « soupape » pour drainer le liquide céphalorachidien pour éviter l'hypertension intracrânienne, hippie tout en cheveux, et l'autre, Koja, guère mieux loti car il a une balle dans le crâne impossible à extraire.
Koja va raconter sa vie et celle de sa famille : épopée qui commence en 1905 pour s'achever autour de 1974.
On découvre ainsi la famille Solm, originaire de Riga. Lors des soulèvements de 1905, les bolchéviks s'en prennent à Großpaping le grand-père paternel, qui défend son église et périra noyé, assassiné par eux. Il a un fils artiste peintre qui a épousé la baronne won Schilling, qui a côtoyé le Tsar Nicolas II, au caractère bien trempé. Par opposition, le grand-père maternel est appelé Opapabaron.
De cette union naît Hubert, alias, Hub ou Hubsi pour les intimes, favorisé dès le départ : il est né le jour de l'assassinat de Großpaping donc béni des Dieux, surtout de sa mère. Ensuite vient Konstantin alias Koja .
Enfin, Eva alias Ev' une petite fille fait son entrée, dans la famille Solm. Ses parents sont morts pendant les premières émeutes ou échauffourées de Riga. Elle est confiée, via la nounou, à la famille Solm qui finira par l'adopter sans savoir qu'elle est juive.
Le décor est planté pour la famille que l'on va suivre de Riga, ville où alternent les règnes passagers des populistes de tout bord. de persécutant on devient persécuté et le cycle recommence.
Evidemment, c'est préférable si on a quelques connaissances historiques sur l'époque....on peut mieux remettre tout en situation.
Je dois dire que je me suis un peu perdue dans les diverses fonctions de Koja, agent simple, double, triple....
Lui, l'ancien nazi qui se fait circoncire pour mieux infiltrer le Mossad....le personnage trouble d'Ev qui se révélera (évidemment) juive d'origine...mariée à un SS ça fait désordre...qui se partage entre les deux frères...à l'insu de l'un d'eux (ça va de soi)...une petite fille naît, destin tragique (je m'y attendais) .... On découvrira tardivement l'histoire abracadabrante de la balle logée dans le crâne de ce sinistre Koja....
Bref, je n'ai pas aimé, la transformation d'hommes ordinaires en criminels de guerre....etc...seule la partie historique est intéressante..du moins c'est mon avis.... surtout l'après-guerre d'ailleurs.
La seule particularité qui est assez amusante, si je puis dire, est l'acharnement de Koja a vider son sac dans la malheureuse tête fracassée de ce hippie qui est contraint de l'écouter à son grand désespoir...
Voilà, 1000 pages, de tours et détours des vilains garçons pour parodier le titre d'un roman de Mario Vargas Liosa...mais le thème était beaucoup plus léger évidemment.
Assez éprouvant à lire comme tous les récits qui ont trait à cet épisode tragique de la guerre de 40...le massacre des juifs et pas que...
\Mots-clés : #antisémitisme #famille #guerre
- le Mer 5 Juil - 6:22
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: Chris Kraus
- Réponses: 1
- Vues: 266
Madeleine Thien
Nationalité : Canada
Né(e) à : Vancouver , le 25/05/1974
Biographie :
Madeleine Thien est une romancière et nouvelliste canadienne, née à Vancouver d'un père chinois de Malaisie et d'une mère chinoise de Hong Kong.
Elle a étudié la danse à la Simon Fraser University et l'écriture créative à l' University of British Columbia.
Ses oeuvres sont publiées à partir de 2001.
Depuis, Madeleine Thien participe à divers ateliers et congrès d'écriture créative aux États-Unis et en Chine.Elle vit à Montréal. Ses livres sont traduits dans 25 langues. (Babelio)
Son quatrième roman "Nous qui n'étions rien" (2016 édition canadienne) a obtenu de nombreux prix:
Prix littéraire du Gouverneur général 2016 Prix Giller 2016 Finaliste du Man Booker Prize 2016Finaliste Baileys Women's Prize for Fiction 2017 (source Phebus)
-----------------------------------------
Nous qui n'étions rien

Marie, 10 ans, habite à Vancouver avec sa mère. Son père s'est suicidé peu de temps avant. Ses parents sont des chinois émigrés de la Chine populaire. Un jour, Ai-Ming, jeune fille chinoise arrive de Pékin clandestinement. Elle espère bénéficier du Chinese Student Protection Act qui offre une résidence permanente aux étudiants ayant participé aux manifestation de la place Tian'anmen.
On va peu à peu remonter l'histoire des deux familles, comprendre les liens qui se sont tressés. Chaque génération a vécu et subi les différents remous de l'histoire de la Chine moderne, la grande Marche, le Grand Bond en avant, la Révolution Culturelle. Chaque fois ils vivent les dénonciations, les déportations, la fuite, la perte de certains membres de la famille.
Quand je suis arrivé à Shangaï, j'ai compris que j'avais atterri sur une autre planète. Les gens n'avaient pas...Ils ne savaient rien de la famine ni de la dévastation. J'étais jeune, déterminé à trouver ma place dans ce monde nouveau, à me sauver moi-même parce que Shangaï était le paradis. p.177
On suit la vie de la grand mère, Mère Couteau, de son mari Ba-luth maoïste convaincu et musiciens tous les deux, de leur fils Pinson compositeur, de Vrille la sœur de Mère Couteau et de son mari Wei, de Zhuli, la fille de Vrille et de Wei, violoniste, et de Ai-min la fille de Pinson.
Nos propres fils m'ont dénoncé, révéla Ba Luth, défait. Da Shan et Ours Volant disent qu'ils ne veulent plus rien savoir de nous. mais j'ai confiance: le président Mao, notre Grand Dirigeant, notre Étoile salvatrice, finira par nous racheter.
De tout ce qu'il avait dit dans sa vie, ce fut la seule chose qui fit pleurer Mère Couteau.p. 121
Le récit est guidé par deux fils rouges: le livre des Traces, histoire imaginaire recopiée à la main en différents carnets, qui sert également à dissimuler des informations, et la musique de Bach, particulièrement les variations Goldberg jouées par Glenn Gould.
Si l'histoire est tragique, elle est toujours racontée avec légèreté sans pathos, avec pour les personnages le déchirement entre la parole qui doit être dite pour être conforme aux exigences des autorités et les vraies pensées.
C'est un excellent récit, qui permet de mieux comprendre la Chine en suivant plusieurs générations, qui tentent de survivre sous un régime autoritaire en préservant leurs familles, leur identité et leur amour de la musique.
Pendant vingt ans, Pinson s'était convaincu qu'il avait soustrait au Parti l'élément le plus important de sa vie intérieure, la partie de son être qui composait et appréhendait le monde par la musique. Mais comment était-ce possible? Le temps refaisait les gens. Le temps l'avait réécrit. Comment pouvait-on s'opposer au temps? (p.425)
\Mots-clés : #famille #revolutionculturelle
- le Lun 5 Juin - 8:52
- Rechercher dans: Écrivains du Canada
- Sujet: Madeleine Thien
- Réponses: 0
- Vues: 451
Joe Wilkins
La Montagne et les Pères
Souvenirs d’enfance à la ferme retirée dans le Big Dry, dans l’est du Montana, du côté de Melstone dans le comté de Musselshell, une contrée où la vie est dure.
« Les serpents compliquent et présagent, ils se déplacent comme un vent rampant, ils se cachent à découvert. »
Élevage ou chasse, « Dans le Big Dry, il fallait tuer pour vivre »…
Le grand-père maternel et ses histoires (qui auront un rôle déterminant dans son existence : les « fragments du corps de mon grand-père ») ; sa mère, indépendante et engagée, démocrate (on est principalement républicain dans la région, et profondément croyant).
« Chaque année, songe-t-elle, un peu plus vieille, un peu plus moi-même. »
Et son père, ce roc mourant d’un cancer quand il a neuf ans.
Les amis paternels, pêcheurs et chasseurs, puis sa grand-tante, lithographe à Billings, ensuite le professeur qui un temps comble son besoin de père. Un autre enseignant marquant, et les livres ; et les rêves d’ailleurs.
Sécheresse, inondation, incendie, sauterelles… Alcool, armes à feu… Le ranch du grand-père, que seul son père aurait su gérer, est vendu. Beaucoup de fermiers perdent leurs terres.
« La terre du Big Dry était mauvaise, mais nous faisions de notre mieux pour la rendre fertile.
Nous canalisions la rivière pour irriguer, nous abattions les peupliers et labourions jusqu’au lit de la rivière, nous disposions des bidons usagés d’huile à moteur pour piéger les sauterelles. Nous aspergions les champs pour éliminer les centaurées et les graminées, nous fertilisions et irriguions et arrosions de désherbant le chiendent. Nous passions des nuits entières dans la bergerie à extraire des agneaux en siège, nous vermifugions et vaccinions et écornions, nous donnions à manger des tonnes et des tonnes de maïs. Et quand rien de tout cela ne fonctionnait, quand les foins brûlaient toujours au soleil et que les sauterelles s’abattaient sur les cultures tel le septième sceau de l’Apocalypse, et que les moutons n’avaient plus que la peau sur les os sous le ciel brûlant, quand ces mauvaises terres prenaient malgré tout le dessus sur nous, alors nous priions. Et quand les prières étaient inefficaces, nous blasphémions. Puis nous jetions les cadavres dans la fosse à ossements et retentions notre chance – plus sérieusement encore, cette fois, nos rouages graissés par une nouvelle dose de bile.
Même si c’était bien fait, on ne pouvait pas appeler ça gagner sa vie ; ce n’était qu’une série d’agonies ritualisées. Et ce n’est pas pour dénigrer un mode d’existence. C’est simplement pour dire les choses telles qu’elles sont. Vivre de la terre, n’importe quelle terre, est difficile. Vivre de ces mauvaises terres, cette partie de plaines d’altitude le long des contreforts orientaux des Rocheuses qu’on appelait jadis le Grand Désert Américain, était presque impossible. Surtout quand les lois agricoles ont changé sous Nixon et Reagan, quand nous sommes passés d’un élevage de moutons, de vaches et de poules, d’une culture de blé, de froment et d’avoine et d’un peu tout, à l’élevage de vaches et la culture de maïs, point final. C’est environ à cette époque aussi que les étés se sont faits plus longs et les hivers plus courts, que les torrents printaniers qui alimentaient autrefois les ravines se sont asséchés. Et même à ce moment-là, nous n’avons rien cherché à changer. Nous ne nous sommes pas défendus ni instruits. Nous nous sommes contentés de plier et de nous endurcir, de travailler davantage – davantage d’emprunts à la banque, davantage d’hectares pâturés jusqu’à la terre nue, davantage de produits chimiques dispersés à travers la région. »
« C’était une violence lente et psychologique. Et la plupart d’entre eux retournèrent cette violence contre eux-mêmes. »
« À la télévision, les politiciens évoquaient ce projet-ci ou celui-là, afin de venir en aide à l’Amérique rurale, mais quelqu’un avait parfaitement compris de quoi il retournait : on mit en service une permanence téléphonique contre le suicide dédiée spécifiquement aux fermiers et aux exploitants ruinés, obligés de vendre, qui se trouvaient soudain piégés dans un monde qu’ils ne reconnaissaient pas. »
« Reprenons donc : comment tout débute avec les caprices du vent et de la nécessité, ou peut-être juste dans un bref instant de stupidité ; comment l’échec et la honte, en l’espace d’une seconde, deviennent si impossiblement lourds, un sac de pierres qu’il faut hisser sur son épaule ; comme ils se muent en peur ; et comme la peur éclate un jour en vous – une lente implosion, une détonation à vous briser la nuque.
Ce n’est pourtant pas ainsi que doivent forcément se passer les choses. Nous échouerons, nous continuerons à agir parfois sans raison valable, nous porterons à jamais le fardeau de l’échec et de la honte – mais c’est là, me semble-t-il, que tout peut changer : il existe une sorte de fascination terrible et facile, proche de la peur mais qui n’est pas de la peur. C’est le fait de comprendre le sang qui sèche sur nos mains, le paquet de viande emballée par nos soins qu’on sort du congélateur. C’est accepter la beauté habituelle de nos journées, c’est respecter le labeur de subsistance. C’est comprendre qu’il n’est pas nécessaire de posséder la terre pour être issus de la terre, c’est admettre que nous vivons tous sur ces terres et que nous assumons la responsabilité de cette violence infligée au sol par nos simples existences. C’est reconnaître combien les histoires nous trompent, combien les histoires nous sauvent. C’est d’avoir entendu les deux versions et, dans nos instants d’intenses difficultés, c’est de conter l’histoire qui nous sauvera. »
« Loin dans la prairie, la malchance et les mauvais choix ne faisaient qu’un, l’échec était l’unique péché impardonnable, car nous devions avoir une foi inébranlable en notre capacité à vivre de ces terres ingrates. Nous devions croire que c’était possible, que ce n’était pas de la folie. […]
Nous tournions donc le dos à toute forme d’échec, nous n’accusions ni le projet, ni le vent, ni les nécessités, mais la personnalité des participants. »
D’où le refus de toute forme d’assistance gouvernementale.
À mi-chemin de l’autobiographie et du témoignage, Joe Wilkins rapporte une à une, grosso modo chronologiquement, des scènes qui lui restent, parfois de brefs instantanés. Vers la fin du livre, il développe ses réflexions sur ses difficultés d’intégration et surtout celles de la région.
\Mots-clés : #autobiographie #enfance #famille #lieu #nature #ruralité #viequotidienne #xxesiecle
- le Dim 28 Mai - 13:49
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Joe Wilkins
- Réponses: 9
- Vues: 1027
Joe Wilkins
La vie dans le Montana, et particulièrement dans les Bulls Mountains. A travers le "journal" de l'assassin d'un garde Forestier nous découvrons le drame qui s'est déroulé il y a plusieurs années et qui a des répercussions sur les descendants des deux familles impliquées dans ce drame. D'autant que l'homme qui s'est enfuit, caché et a disparu dans les montagnes devient pour les séparatistes un héros.
La vie est dure dans ce territoire de sècheresse et de montagnes, les terres données aux aIeux, les pionniers, ne nourissent pas, les gens sont pauvres, pas instruits, les fermes sont perdues (pour diverses causes sociales) et les gens pour laplupart vivent dans des mobil-home, c'est le cas de Wendell le fils de l'assassin, qui travaille dur chez un éleveur. Il va recueillir son petit cousin, le fils de sa cousine Lacy emprisonnée pour drogue et négligence parentale ; le gamin est autiste et difficile à élever mais Wendell le fera de tout son coeur, il s'attache rapidement à Rowdy et le considère comme son fils. Il donnera d'ailleurs sa vie pour le sauver.
Evidemment les circonstances font que la femme du forestier tué et sa fille Maddy rencontreront Wendell et par delà le temps, la souffrance ces deux femmes s'occuperont de Rowdy à la disparition de Wendell que Maddy a eu le temps d'apprécier.
Les milices ignorent les lois et notamment celles de l'agence de protection de l'environnement : ils veulent tuer le loup et tout ce qui se trouve sur "leur terre", dans "leurs montagnes".
Wendell
"Il comprit à cet instant ce qui le séparait des autres – ils croyaient qu’on leur devait quelque chose. Freddie, Toby, Daniel. Betts. Son paternel. Quelqu’un leur avait dit qu’on leur devait quelque chose. Il ne savait pas qui, exactement, il n’avait pas eu le temps d’y réfléchir davantage, mais c’était ce qu’ils pensaient, que c’était injuste. Wendell écrasa la peau de serpent dans son poing. On ne nous doit que dalle, rien du tout. Il l’avait toujours su, il l’avait su si profondément dans ses os qu’il n’y avait jamais vraiment pensé avant, et maintenant qu’il y réfléchissait, il comprit que Maddy avait eu raison. "
"Ce n’était pas l’Agence de Protection de l’Environnement ni le BLM qui avaient soudain compliqué les choses. Ç’avait toujours été difficile. C’est pour ça que les loups revenaient. Ils étaient bâtis pour ces contrées. Ils ne se préoccupaient pas de ce qui leur était dû. Ils vivaient selon les exigences de la terre. Wendell le comprenait désormais. La terre elle-même avait pris son père, l’avait laissé avec cette pauvre histoire en forme de devinette, une histoire que ces types lisaient complètement à l’envers."
Une excellente lecture, pour moi, de superbes descriptions, une atmosphère prégnante et des personnages qui ne laissent pas indifférents.
autres extraits
"Betts renifla et croisa les bras devant son torse.
— Mon père s’est tiré une balle, continua-t-il. C’est ce qu’a fait mon paternel après avoir été viré, puis réembauché, puis viré à nouveau, après qu’on lui a confisqué son camion, et qu’on lui a globalement volé toute sa putain de vie. Qu’on lui a volée, au nom de cette putain de chouette tachetée. Mais ton paternel a pas courbé le dos. Non, il a refusé d’être une victime. Il s’est pas collé le canon sous le menton. Il a épaulé et il a riposté, il a tiré sur ce putain de garde-chasse qui aurait dû savoir qu’il fallait se méfier. Ton père est un héros, voilà ce qu’il est. On l’admire franchement pour tout ce qu’il a fait, et on espère que le fils de Verl Newman saura à son tour prendre le chemin vers le bon droit. Qu’il nous rejoindra."
"Un délégué de comté intentait un procès au gouvernement Obama, à propos de régulations écologiques"
" Écoute-moi fiston. Je disais une chose avec ma bouche et une autre avec mes deux mains. J’encaissais les chèques d’incapacité de travail de ta mère et j’achetais du fourrage et de l’essence et je sais pas quoi d’autre encore. Je touchais l’argent du Programme de conservation écologique sur le vieux pâturage en bordure de rivière. Je prenais de l’herbe qui n’était pas à moi. Je me mentais à moi-même. C’est si facile à faire. Un conseil fiston. Quand les choses sont faciles c’est souvent qu’elles sont mauvaises. Souvent malhonnêtes et lâches. C’est pour ça que je suis ici dehors. Parce que j’ai refusé de mentir davantage. J’ai refusé d’être un lâche. J’ai refusé de respecter les règles des lâches et des enculés quelle bande d’enculés"
\Mots-clés : #criminalite #ecologie #famille #social #viequotidienne
- le Dim 14 Mai - 19:05
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Joe Wilkins
- Réponses: 9
- Vues: 1027
Paul Auster
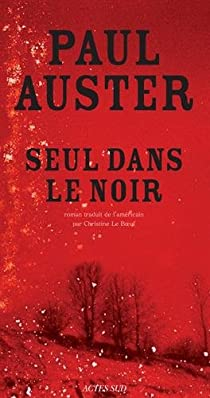
Contraint à l’immobilité par un accident de voiture, August Brill, critique littéraire à la retraite, s’est installé dans le Vermont chez sa fille Miriam, qui ne se remet pas d’un divorce vieux de cinq ans.
Elle vient de recueillir sa propre fille, Katya, anéantie par la mort en Irak d’un jeune homme parti pour Bagdad juste après leur rupture…
Pour échapper aux inquiétudes du présent et au poids des souvenirs peu glorieux qui l’assaillent, Brill se réfugie dans des fictions diverses dont il agrémente ses innombrables insomnies.
Cette nuit-là, il met en scène un monde parallèle où le 11 Septembre n’aurait pas eu lieu et où l’Amérique ne serait pas en guerre contre l’Irak mais en proie à une impitoyable guerre civile. Tandis que la nuit avance, imagination et réalité en viennent peu à peu à s’interpénétrer, comme pour interroger la responsabilité de l’individu vis-à-vis de sa propre existence et vis-à-vis de l’Histoire.
Allégorie puissante et inspirée, Seul dans le noir établit un lien entre les désarrois de la conscience américaine contemporaine et le questionnement de Paul Auster quant à l’étrangeté des chemins qu’emprunte l’invention romanesque.
source Babelio
En résumé, trois âmes en peine cohabitant dans la maison familiale du Vermont. Trois générations qui chacune et ensemble mêlent leur peine et leur espoir.
Le grand-père, August Brill, a perdu Sonia, la femme de sa vie ? Il passe de longues nuits, seul dans le noir, à s'inventer des histoires, à créer des mondes parallèles où des événements tragiques n'auraient pas eu lieu...l'attentat du 11 septembre 2001, ni de guerre en Irak, mais une drôle de guerre civile entre Etats... dans laquelle le héros, dont il n'est que le double, s'enlise, qu'il ne comprend pas (moi non plus) et chargé d'une étrange mission ...(invraisemblable).

Myriam, sa fille, semble s'être retirée du monde après un divorce dont elle ne se remet pas. L'écriture, peut-être, la sauvera...
Katya, la petite-fille, passionnée de cinéma, la plus meurtrie peut-être; ayant rompu avec son ami, Titus, celui-ci est parti pour Bagdad...tout en étant farouchement opposé à cette guerre, mais l'opportunité de gagner une somme d'argent considérable en conduisant un camion de transport aura raison de ses scrupules....et autre but avoué : acquérir de l'expérience afin d'écrire...il connaîtra malheureusement une fin aussi prématurée que violente, très, très violente...
Accablée de culpabilité, Katya se rapproche de son grand-père au cours de leurs longues nuits d'insomnies partagées.
Bill qui est donc contraint de rester couché suite à un grave accident de voiture, une jambe fracassée, regarde avec Katya des films à la chaîne ... s'en suit d'ailleurs une intéressante interprétation sur la signification des objets dans certains films.... .
Bref, on le voit se lamenter sur son sort, Sonia, pourquoi m'as-tu abandonné ? Sonia son ex femme avec laquelle il a repris la vie commune au bout d'une dizaine d'années et qui vient de mourir d'un cancer....On apprend au cours de l'histoire qu'il l'avait lui-même quittée pour une femme plus jeune avec laquelle il avait vécu de nombreuses années avant qu'elle-même le quitte pour un homme plus riche .... discuter avec sa petite-fille de sa vie passée avec Sonia...avec quelques annotations sexuelles..on se demande ce que ça vient faire là....car qui parlerait de sa vie très très privée à sa petite-fille ? " Le corps possède un nombre limité d'orifices. Contentons-nous de dire que nous les avons tous explorés".
« Comme tout cela va vite. Hier enfant, aujourd'hui vieillard, et d'alors à maintenant, combien de battements de coeur, combien de respirations, combien de mots prononcés et entendus ? Touchez-moi, quelqu'un. Posez la main sur mon visage et parlez-moi... »
Voilà....très bien écrit, c'est quand même Paul Auster, mais je n'ai pas accroché une seconde...passant de la fiction à la réalité sans arrêt, laborieux...pas passionnant...
Je déconseille formellement à tous ceux qui sont limite dépressifs....
Au final, pas très bien saisi ce qu'il voulait prouver, le désarroi d'une certaine classe bourgeoise américaine sans doute, c'est dur la réalité, ça fait (parfois) très mal.
Me laissera pas un souvenir impérissable...
\Mots-clés : #famille #guerre
- le Ven 12 Mai - 1:49
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Paul Auster
- Réponses: 154
- Vues: 16060
Rabindranath TAGORE
Les Goshal, riche famille de Brahmanes, ont été ruiné par une autre famille de brahmanes propriétaires terriens. Ils en ont gardé une rancune qui se transmet de générations en générations.
Madhusudan, descendant des Goshal, a réussi à force de travail et de subtiles manipulations des européens, à reconstruire une fortune.
Décidé à venger sa famille, il va demander à épouser Kumudini, descendante de la famille rivale, les Chatterji, ruinés à leur tour par une mauvaise gestion de leurs biens.
Cette jeune fille de 19 ans, n'est pas une enfant. Elle a été éduquée par son frère Vipradas. Elle est profondément religieuse et considère qu'il est de son devoir envers sa famille, de se sacrifier pour éviter la ruine définitive de ses frères.
Malheureusement, la grossièreté de son mari, qui jusque là ne s'est intéressé qu'à ses affaires, va rendre sa vie éprouvante. Elle a le soutien de son beau-frère et de sa belle sœur, mais tous dépendent de l'argent de Madhusudan.
Kumudini est déchirée entre ses convictions religieuses, la crainte que ses frères ne soient détruits par son mari, son éducation, qui lui a enseigné à obéir à celui qu'elle a épousé, et ses propres aspirations à une vie plus éduquée, plus respectueuse des désirs de chacun.
Madhusudan, habitué à ne rencontrer aucune résistance parmi les siens, et à inspirer du respect et de la crainte, va être dérouté par la résistance subtile de la jeune femme, et perdre peu à peu ses moyens.
Pour Madhusudan, dont la vie n'avait été faite que de luttes, et qui avait dû rester constamment vigilant devant les caprices du sort, la merveilleuse maturité de Kumu et sa gravité étaient une source d'étonnement extraordinaire. Il ne prenait rien simplement, tandis qu'elle semblait aussi simple qu'une divinité. Cette opposition entre leurs natures l'attirait très fortement vers elle. Revivant en esprit toute la scène de l'entrée de la mariée dans la belle-famille, il prit la mesure d'un côté, de sa propre colère devant son impuissance, et, de l'autre, chez la jeune femme, de la parfaite démonstration de son indomptable dignité.
Le roman est l'histoire de cette lutte entre deux personnalités opposées, dans le cadre social de l'Inde qui codifie impitoyablement les règles de vie entre les différents niveaux sociaux, même dans la même caste, ainsi que les relations entre hommes et femmes.
On peut y voir un plaidoyer pour l'éducation des femmes, l'éducation ayant été une des luttes de l'auteur.
Un livre que j'ai trouvé intéressant, sans plus, particulièrement par le récit de l'opposition entre ces deux personnalités.
\Mots-clés : #conditionfeminine #famille #traditions
- le Lun 8 Mai - 15:34
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: Rabindranath TAGORE
- Réponses: 16
- Vues: 1353
Antonio Lobo Antunes
L'Ordre naturel des choses
Livre premier, Douces odeurs, doux morts
Un cinquantenaire (on apprendra plus tard qu’il se prénomme Alfredo) vivant avec une jeune diabétique, Iolanda, amoureux d’elle et l’entretenant avec sa famille, soliloque sur cet amour (il la dégoûte) et son enfance.
Portas, membre de la Police politique sous la dictature mis à l’écart par la Révolution, qui vit misérablement de cours d'hypnotisme par correspondance (ses élèves, portant un turban avec un rubis, déplaçant leurs proches par lévitation), poursuivi par les tourterelles et épris de Lucilia, une prostituée mulâtre, louchonne et battue, Portas retrouve cet homme (on apprend qu’il s’appelle « Saramago ») à la demande de son « ami écrivain ». Ces deux récits alternent par chapitres, dérivant souvent dans le délire halluciné d’un flux de conscience onirique, hantés par le fascisme et sa peur des communistes, les défunts de la morgue, l’odeur de chrysanthème, de jacinthe ou de dahlia du diabète. Lisbonne et le Tage sont omniprésents, entre sordidité et tristesse.
Livre Deux, Les Argonautes
Le père de Iolanda est un ancien mineur : « À Johannesburg, en 1936, je volais sous terre, extrayant de l'or » ; revenu au Portugal, il creuse l’asphalte jusqu’à crever une canalisation, provoquant un débordement d'excréments. Il est convaincu d’avoir laissé sa femme folle en Afrique, alors qu’elle est morte du diabète à la naissance de Iolanda. Orquídea, sa sœur qui vit aves eux, souffre de monstrueux calculs rénaux qui passionnent son médecin.
« Je venais de décider de m'embarquer pour retourner à Johannesburg car je n'aime pas le Portugal, je n'aime pas Lisbonne, je n'aime pas Alcântara, je n'aime pas la Quinta do Jacinto ["la fermes des jacinthes", son quartier à Lisbonne], je n'aime pas cette absence de galeries et de buvettes, cette absence de wagonnets de minerai, de m'embarquer pour retourner à Johannesburg parce que Solange [sa métisse sénégalaise] me manque, ainsi que la lampe à huile qui agrandissait son visage, qui embrouillait mes rêves et prolongeait jusqu'à l'aube les gestes de tendresse, quand on a sonné à la porte et un homme avec un magnétophone en bandoulière, incapable de voler, m'a dit sur le paillasson J'ai été agent de la Police politique, monsieur Oliveira, j'ai à peine une demi-douzaine de questions à vous poser à propos de votre fille et de votre gendre et je cesse de vous embêter. »
Livre Trois, Le voyage en Chine
Le major Jorge Valadas, qui a couché avec la fille du commodore Capelo, est arrêté pour conspiration démocratique sous Salazar, et torturé.
« Quand on m'a fourré pour la première fois dans l'ambulance, après m'avoir arrêté, et que j'ai demandé où nous allions, on m'a répondu En Chine, mon garçon, et il faut un bon bout de temps pour arriver là-bas, or depuis ce temps-là j'ai navigué d'un côté et de l'autre avant de jeter l'ancre à Tavira, dans la caserne près de la mer d'où je ne vois pas la mer, où j'entends les vagues mais où je ne les vois pas, où j'entends les oiseaux mais où je ne les vois pas, de sorte que j'ai compris qu'on m'avait menti, que je ne suis pas à Tavira, que je ne suis pas dans une caserne, que je ne suis pas dans l'Algarve, qu'on m'avait fait traverser sans que je m'en rende compte une masse de pays et de fleuves, une masse de continents, et qu'on m'avait largué ici, non pas au Portugal mais près de la frontière avec la Chine, dans un pays semblable aux assiettes orientales de ma grand-mère, avec des femmes tenant des éventails, avec des pagodes ressemblant à des kiosques à journaux et des arbustes penchés au-dessus de lacs bordés d'hibiscus, aux berges reliées par des ponts délicats comme des sourcils arqués par la surprise. J'ai compris que j'habite non pas une prison mais une soupière de faïence rangée dans une armoire entre des cuillers en porcelaine ornées de dragons qui tirent la langue le long du manche. »
Sa sœur Julieta vit enfermée au grenier parce qu’elle est d’un autre père, puis enceinte du fils de la couturière. Son frère Fernando, « le stupide » de la famille, a épousé Conceiçao, une bonne :
« …] monsieur Esteves qui t'avait amenée de Beja quand il était devenu veuf
(le froid de Beja l'hiver, les moissons brûlées par la gelée, le vent roulant dans la plaine comme un train hurlant)
afin que tu travailles pour lui, que tu lui réchauffes son dîner, que tu lui nettoies son appartement de la rue Conde de Valbom et que tu occupes sur le matelas le côté que la défunte avait troqué pour une dalle funéraire dans une allée des Prazeres,
monsieur Esteves dont j'ai fait la connaissance quand je t'ai accompagnée pour que tu prennes ta valise au rez-de-chaussée où tu habitais, avec la photo de la défunte sur un ovale en crochet,
monsieur Esteves, pas rasé, qui n'avait personne en dehors de toi, serrant dans ses poings la frange de la couverture,
un homme plus âgé que je ne le suis à présent, au cou fait de rouleaux de peau qui disparaissaient dans sa veste comme une tortue se recroqueville dans sa carapace,
monsieur Esteves avec les moitiés mal ajustées de son visage, semblables à des pièces de puzzle emboîtées de force, [… »
(C’est sans doute la partie la plus satirique et grinçante du roman.)
Livre Quatre, La vie avec toi
Cette fois nous écoutons Iolanda, et Alfredo, qui parle de son oncle, le prophète biblique qui annonce le Déluge, maintenant enfermé à l’asile.
« – Tu en connais des histoires qui ne sont pas idiotes, Iolanda ? »
« …] je refuse d'être comme eux, Iolanda, mais je serai comme eux, un jour je m'approcherai de la glace, j'observerai mon visage et je vivrai du passé comme d'une pension de retraite et j'aurai pitié de moi [… »
Livre Cinq, La représentation hallucinatoire du désir
Vieillie, Orquídea se meurt d’un cancer en revisitant son enfance, mêlant celle des autres personnages ; Julieta qui chassait les poulets retrouve son père, vieilli.
« …] et avec moi mourront les personnages de ce livre qu'on appellera roman et que j'ai écrit dans ma tête habitée d'une épouvante dont je ne parle pas et que quelqu'un, une année ou une autre, répétera pour moi, suivant en cela l'ordre naturel des choses [… »
Un cousin éloigné vend la vieille maison familiale où vit Julieta, seule survivante et sans identité connue – et celle-ci va rejoindre la mer, et Jorge.
Portas l’enquêteur réapparaît souvent, de même que le cirque, et les morts (et les cistes, et un renard en cage).
Ce roman est une sorte de polyphonie des personnages tous liés entr’eux, évoquant leurs destinées individuelles et, au-delà, les hantises et attentes, souvenirs et rêves, misères et sordidités, vérités inavouées et culpabilités historiques d’un Portugal fratricide et colonial coincé entre passé et présent.
\Mots-clés : #famille #guerre #pathologie #regimeautoritaire #romanchoral #vieillesse #xxesiecle
- le Sam 6 Mai - 12:55
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Antonio Lobo Antunes
- Réponses: 41
- Vues: 6796
Charles D'Ambrosio
Le Musée des Poissons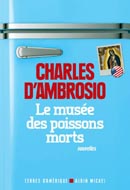
Partage des eaux
Ignace, le narrateur, a été placé en orphelinat parce que son père est insensé depuis un accident. Il rencontre Donny, et part en randonnée avec celui-ci et son père, qui lui apprend qu’il divorce.
« C’est le désespoir qui est le contraire de l’amour. »
Drummond & Fils
Drummond est réparateur de machines à écrire à Seattle, et son fils Pete, 25 ans et déséquilibré, vit avec lui.
« Je crois que je me contenterais bien d’être un fils, dit-il. Pas un dieu. »
« Prier m’aidait à m’endormir ou à penser aux filles. »
Scénariste
Le narrateur est interné en psychiatrie, et on lui a adjoint un surveillant pour éviter qu’il se suicide ; c’est aussi un scénariste, en quête d’inspiration pour un scénario. Il rencontre une ballerine qui se brûle le corps.
« Elle me tourna le dos et activa la mollette du briquet, abritant la cigarette du vent avec sa main. Une assiette en papier roula plusieurs fois autour de la terrasse comme dans une course-poursuite, comme dans un jeu d’enfant sans enfant. Une phalène blanche tomba du ciel à la manière d’un pétale, passa par une maille du grillage et atterrit sur ma main. La fraîcheur du soir me donna la chair de poule et un nuage de fumée déchira l’air. La tenue de la jeune femme se consumait. Un liséré de flammes orange grignotait l’ourlet. Je me levai d’un bond pour dire à la ballerine qu’elle brûlait. La phalène s’envola de ma main, une rafale de vent attisa les flammes, il y eut un éclair et la jeune femme prit feu, s’embrasant comme une lanterne japonaise. Elle était enveloppée par les flammes. La chaleur affluait par vagues sur mon visage et je clignais des yeux à cause de la luminosité. La ballerine déploya ses bras et entra en lévitation, sur les pointes, quittant la terrasse tandis que ses jambes, son cul et son dos émergeaient tel le phénix de cette chrysalide en papier, s’élevant jusqu’à ce que la tenue finisse par glisser de ses épaules et flotter au loin, fantôme noirâtre en lambeaux aspiré par une colonne de fumée et de cendres, alors la jeune femme redescendit, nue et blanche, presque imperturbable, les pieds en position de première. »
« Après un mois en psychiatrie, on ne reçoit plus ni télégrammes ni cartes de prompt rétablissement ni peluches, les fleurs perdent leurs pétales, qui se recroquevillent comme des peaux mortes sur la commode, pendant que les tiges se ramollissent et pourrissent dans leur vase. C’est une mauvaise passe, cette mer des Sargasses dans le service psychiatrie, quand les derniers vents de votre ancienne vie ne soufflent plus. Dans le monde réel, je restais légalement marié – ma femme était productrice de films, mais elle m’avait laissé pour quelqu’un de plus sexy, l’acteur vedette de notre dernier film. J’en avais écrit le scénario, plus ou moins autobiographique, et le personnage qu’il jouait était inspiré par feu mon père. Ma femme s’envoyait donc la doublure de papa et on ne s’était pas parlé depuis une éternité. »
Là-haut vers le nord
Le narrateur est invité pour Thanksgiving à un séjour de chasse dans le chalet familial de sa femme, Caroline, qui y fut violée. Sa famille ne le sait pas ; elle n’a jamais connu d’orgasme et enchaîne les infidélités.
L’ordre des choses
Lance et Kirsten se sont connus lors de leur incarcération en Floride, lui pour les amphétamines, elle pour l’héroïne ; ils vivent d’un trafic de quête pour les bébés de drogués et de larcins dans l’Iowa rural.
« Il croyait à l’existence d’une vie riche et méritée parallèle à la leur, vie qu’elle seule pouvait voir, et il sondait ses rêves à la recherche d’indications, tentait de trouver un sens à ses prémonitions, comme si ses cauchemars et ses sautes d’humeur donnaient accès à un monde fait de certitudes, alors que Kirsten, elle, connaissait la vérité : chaque rêve n’est qu’un réservoir de doutes. À force de graviter autour de divers foyers et institutions, elle avait au moins appris cela. Famille d’accueil, centre de désintoxication, de détention – même la femme qu’elle appelait « maman » appartenait à l’institution, à un programme d’aide sociale maladroit. »
Le musée des poissons morts
Ravage dirige l’équipe de charpentiers qui travaille pour Greenfield, un réalisateur de films pornos : Rigo, un réfugié salvadorien, et RB, un Noir. Dans sa sacoche, « le pistolet avec lequel il avait depuis un an l’intention de se suicider. »
« Pour ma femme, impossible de dire “réfrigérateur”. Elle apprend. Alors elle dit “le musée des poissons morts”. »
Bénédiction
Le narrateur et sa femme Meagan vivent depuis peu dans leur première maison, non loin de la Skagit River, dont une crue approche.
« Peut-être parce que mon père était mort dans ma petite enfance et que, fils unique, j’avais été accueilli au sein d’un clan informel d’oncles, de tantes et de cousins, ma conception de la famille, ainsi que de l’amour et de la loyauté, avait toujours été placée sous le signe de la sérénité et de la tolérance plutôt que sous celui de la division et de l’agressivité. Le poids de mes attentes et par conséquent le fardeau de mes déceptions se répartissaient entre un grand nombre de personnes [… »
Ils reçoivent le père et le frère de Meagan ainsi que la femme et le bébé de celui-ci ; cette famille n’est que tensions.
Le jeu des cendres
Kype est parti avec les cendres, le pistolet et la canne à pêche de son grand-père décédé à 99 ans, un pionnier qui l’a élevé ; il va hériter de sa fortune. Kype a pris en stop D’Angelo, qui fait la route depuis Brooklyn, puis Nell, une Makah de la réserve près de l’océan ; c’est le temps de la migration des saumons.
C’est sombre et dense, peu explicable, entièrement dans une atmosphère rendue par un style contenu. Quelque chose d’indicible est suggéré par ces aperçus de rapports humains, quelque chose que les sciences ne peuvent apparemment pas exprimer – en tout cas pas moi ; c’est sans doute à ça que sert la littérature, évoquer un sens subliminaire qu'il n'est pas possible d'aborder autrement.
\Mots-clés : #contemporain #famille #nouvelle #pathologie #psychologique #xxesiecle
- le Mar 11 Avr - 12:58
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Charles D'Ambrosio
- Réponses: 3
- Vues: 309
Salman Rushdie
Quichotte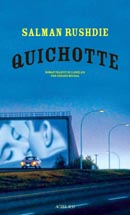
M. Ismail Smile, vieil États-unien originaire de Bombay et voyageur de commerce, est si addict aux « programmes télévisés ineptes » qu’il a glissé dans cette « réalité irréelle », suite à un mystérieux « Événement Intérieur ».
« Des acteurs qui jouaient des rôles de président pouvaient devenir présidents. L’eau pouvait venir à manquer. Une femme pouvait être enceinte d’un enfant qui se révélait être un dieu revenant sur terre. Des mots pouvaient perdre leur sens et en acquérir de nouveaux. »
« À l’ère du Tout-Peut-Arriver », sous le pseudonyme de Quichotte il se lance dans la quête amoureuse d’une vedette de télé, Miss Salma R., elle aussi d'origine indienne.
Quichotte se crée un « petit Sancho », un fils né de Salma dans le futur, inspiré du garçon rondouillard qu’il fut avant de devenir un adulte grand et mince
Ce premier chapitre a été écrit par l’écrivain Sam DuChamp, dit Brother, auteur de romans d’espionnage aux tendances paranoïaques, qui trouve en Quichotte une grande similitude avec sa propre situation.
« Ils étaient à peu près du même âge, l’âge auquel pratiquement tout un chacun est orphelin et leur génération qui avait fait de la planète un formidable chaos était sur le point de tirer sa révérence. »
Situation des immigrants indiens :
« Puis, en 1965, un nouvel Immigration and Nationality Act ouvrit les frontières. Après quoi, retournement inattendu, il s’avéra que les Indiens n’allaient pas, après tout, devenir une cible majeure du racisme américain. Cet honneur continua à être réservé à la communauté afro-américaine et les immigrants indiens, dont beaucoup étaient habitués au racisme des Blancs britanniques en Afrique du Sud et en Afrique de l’Est tout comme en Inde et en Grande-Bretagne, se sentaient presque embarrassés de se retrouver exonérés de la violence et des attaques raciales, et embarqués dans un devenir de citoyens modèles. »
Dans ce roman, Rushdie met en scène (de nouveau) l’état du monde, politique, culturel, en faisant des allers-retours des sociétés d’Asie du Sud à celles d’Occident.
« Une remarque, au passage, cher lecteur, si vous le permettez : on pourrait défendre l’idée que les récits ne devraient pas s’étaler de la sorte, qu’ils devraient s’enraciner dans un endroit ou dans un autre, y enfoncer leurs racines et fleurir sur ce terreau particulier, mais beaucoup de récits contemporains sont, et doivent être, pluriels, à la manière des plantes vivaces rampantes, en raison d’une espèce de fission nucléaire qui s’est produite dans la vie et les relations humaines et qui a séparé les familles, fait voyager des millions et des millions d’entre nous aux quatre coins du globe (dont tout le monde admet qu’il est sphérique et n’a donc pas de coins), soit par nécessité soit par choix. De telles familles brisées pourraient bien être les meilleures lunettes pour observer notre monde brisé. Et, au sein de ces familles brisées, il y a des êtres brisés, par la défaite, la pauvreté, les mauvais traitements, les échecs, l’âge, la maladie, la souffrance et la haine, et qui s’efforcent pourtant, envers et contre tout, de se raccrocher à l’espoir et à l’amour, et il se pourrait bien que ces gens brisés – nous, le peuple brisé ! – soient les plus fidèles miroirs de notre époque, brillants éclats reflétant la vérité, quel que soit l’endroit où nous voyageons, échouons, vivons. Car nous autres, les immigrants, nous sommes devenus telles les spores emportées dans les airs et regardez, la brise nous entraîne où elle veut jusqu’à ce que nous nous installions sur un sol étranger où, très souvent, comme c’est le cas par exemple à présent en Angleterre avec sa violente nostalgie d’un âge d’or imaginaire où toutes les attitudes étaient anglo-saxonnes et où tous les Anglais avaient la peau blanche, on nous fait sentir que nous ne sommes pas les bienvenus, quelle que soit la beauté des fruits que portent les branches des vergers de fruitiers que nous sommes devenus. »
À Londres, Sister (sœur de… Brother avec qui elle est brouillée), est une coléreuse « avocate réputée, s’intéressant tout particulièrement aux questions des droits civiques et aux droits de l’homme ».
« Sister était idéaliste. Elle pensait que l’État de droit était l’un des deux fondements d’une société libre, au même titre que la liberté d’expression. »
Le Dr R. K. Smile, riche industriel pharmaceutique cousin et employeur d’Ismail, se révèle être un escroc, distribuant fort largement ses produits opiacés.
Sancho Smile est une créature au second degré (imaginé par Quichotte imaginé par Brother) qui s’interroge sur son identité.
« Il y a un nom pour cela. Pour la personne qui est derrière l’histoire. Le vieux bonhomme, papa, dispose de plein d’éléments sur cette question. Il n’a pas l’air de croire en une telle entité, n’a pas l’air de sentir sa présence comme moi mais sa tête est tout de même remplie de pensées sur cette entité. Sa tête et par conséquent la mienne aussi. Il faut que je réfléchisse à cela dès maintenant. Je vais le dire ouvertement : Dieu. Peut-être lui et moi, Dieu et moi, pouvons-nous nous comprendre ? Peut-être pourrions-nous avoir une bonne discussion ensemble, puisque, vous savez, nous sommes tous deux imaginaires. »
« C’est simplement lui, papa, qui se dédouble en un écho de lui-même. C’est tout. Je vais me contenter de cela. Au-delà, on ne peut que sombrer dans la folie, autrement dit devenir croyant. »
« Il y a trois crimes que l’on peut commettre dans un pensionnat anglais. Être étranger, c’est le premier. Être intelligent, c’est le deuxième. Être mauvais en sports, c’est le troisième coup, vous êtes éliminé. On peut s’en sortir avec deux des trois défauts mais pas avec les trois à la fois. »
« Il y a des gens qui ont besoin de donner par la force une forme au caractère informe de la vie. Pour eux, l’histoire d’une quête est toujours très attirante. Elle les empêche de souffrir les affres de la sensation, comment dit-on, d’incohérence. »
Sancho est aussi un personnage (fictif) qui rêve d’émancipation, ombre de Quichotte et qui ne veut plus en être esclave. Tout ce chapitre 6 où il parle forme un morceau d’anthologie sur le sens de l’existence et de la littérature, via l’intertextualité. Ainsi, en référence à Pinocchio :
« “Grillo Parlante, à ton service, dit le criquet. C’est vrai, je suis d’origine italienne. Mais tu peux m’appeler Jiminy si tu veux. […]
Je suis une projection de ton esprit, exactement comme tu as commencé toi-même par être une projection du sien. Il semble que tu devrais bientôt avoir une insula. »
Salma, bipolaire issue d’une lignée féminine de belles vedettes devenues folles, est dorénavant superstar dans son talk-show (en référence assumée à Oprah Winfrey) ; elle s’adonne à « l’automédication » avec des « opiacés récréatifs ».
« Elle était une femme privilégiée qui se plaignait de soucis mineurs. Une femme dont la vie se déroulait à la surface des choses et qui, ayant choisi le superficiel, n’avait pas le droit de se plaindre de l’absence de profondeur. »
Road-trip où le confiant, souriant et bavard Quichotte emmène Sancho, qui découvre la réalité, les USA, la télé :
« Nous sommes sous-éduqués et suralimentés. Nous sommes très fiers de qui vous savez. Nous fonçons aux urgences et nous envoyons Grand-Mère nous chercher des armes et des cigarettes. Nous n’avons besoin d’aucun allié pourri parce que nous sommes stupides et vous pouvez bien nous sucer la bite. Nous sommes Beavis et Butt-Head sous stéroïdes. Nous buvons le Roundup directement à la canette. Notre président a l’air d’un jambon de Noël et il parle comme Chucky. C’est nous l’Amérique, bordel. Zap. Les immigrants violent nos femmes tous les jours. Nous avons besoin d’une force spatiale à cause de Daech. Zap. […]
“Le normal ne me paraît pas très normal, lui dis-je.
– C’est normal de penser cela”, répond-il. […]
Chaque émission sur chaque chaîne dit la même chose : d’après une histoire vraie. Mais cela non plus ce n’est pas vrai. La vérité, c’est qu’il n’y a plus d’histoires vraies. Il n’existe plus de vérité sur laquelle tout le monde peut s’accorder. »
… et la vie en motels, qui nous vaut cette belle énumération d’images :
« Ce qu’il y a, surtout, ce sont des ronflements. La musique des narines américaines a de quoi vous impressionner. La mitrailleuse, le pivert, le lion de la MGM, le solo de batterie, l’aboiement du chien, le jappement du chien, le sifflet, le moteur de voiture au ralenti, le turbo d’une voiture de course, le hoquet, les grognements en forme de SOS, trois courts, trois longs, trois courts, le long grondement de la vague, le fracas plus menaçant des roulements de tonnerre, la brève explosion d’un éternuement en plein sommeil, le grognement sur deux tons du joueur de tennis, la simple inspiration/expiration ordinaire ou ronflement classique, le ronflement irrégulier, toujours surprenant, avec, de temps en temps, des pauses imprévisibles, la moto, la tondeuse à gazon, le marteau-piqueur, la poêle grésillante, le feu de bois, le stand de tir, la zone de guerre, le coq matinal, le rossignol, le feu d’artifice, le tunnel à l’heure de pointe, l’embouteillage, Alban Berg, Schoenberg, Webern, Philip Glass, Steve Reich, le retour en boucle de l’écho, le bruit d’une radio mal réglée, le serpent à sonnette, le râle d’agonie, les castagnettes, la planche à laver musicale, le bourdonnement. »
« En fait, voilà : quand je m’éveille le matin et que j’ouvre la porte de la chambre, je ne sais pas quelle ville je vais découvrir dehors, ni quel jour de la semaine, du mois ou de l’année on sera. Je ne sais même pas dans quel État nous allons nous trouver, même si cela me met dans tous mes états, merci bien. C’est comme si nous demeurions immobiles et que le monde nous dépassait. À moins que le monde ne soit une sorte de télévision, mais je ne sais pas qui détient la télécommande. Et s’il y avait un Dieu ? Serait-ce la troisième personne présente ? Un Dieu qui, au demeurant, nous baise, moi, les autres, en changeant arbitrairement les règles ? Et moi qui croyais qu’il y avait des règles pour changer les règles. Je pensais, même si j’accepte l’idée que quelqu’un virgule quelque chose a créé tout ceci, ce quelque chose virgule ce quelqu’un n’est-il, virgule ou n’est-elle, pas lié.e par les lois de la création une fois qu’il, ou elle, l’a achevée ? Ou peut-il virgule, peut-elle hausser les épaules et déclarer finie la gravité, et adieu, et nous voici flottant tous dans le vide ? Et si cette entité, appelons-la Dieu, pourquoi pas, c’est la tradition, peut réellement changer les règles tout simplement parce qu’elle est d’humeur à le faire, essayons de comprendre précisément quelle est la règle qui est changée en l’occurrence. »
Ils arrivent à New-York.
« Il y a deux villes, dit Quichotte. Celle que tu vois, les trottoirs défoncés de la ville ancienne et les squelettes d’acier de la nouvelle, des lumières dans le ciel, des ordures dans les caniveaux, la musique des sirènes et des marteaux-piqueurs, un vieil homme qui fait la manche en dansant des claquettes, dont les pieds disent, j’ai été quelqu’un, dans le temps, mais dont les yeux disent, c’est fini, mon gars, bien fini. La circulation sur les avenues et les rues embouteillées. Une souris qui fait de la voile sur une mare dans le parc. Un type avec une crête d’Iroquois qui hurle en direction d’un taxi jaune. Des mafieux affranchis avec une serviette coincée sous le menton dans une gargote italienne de Harlem. Des gars de Wall Street qui ont tombé la veste et se commandent des bouteilles d’alcool dans des night-clubs ou se prennent des shots de tequila et se jettent sur les femmes comme sur des billets de banque. De grandes femmes et de petits gars chauves, des restaurants à steaks et des boîtes de strip-tease. Des vitrines vides, des soldes définitifs, tout-doit-disparaître, un sourire auquel manquent quelques-unes de ses meilleures dents. Des travaux partout mais les conduites de vapeur continuent à exploser. Des hommes qui portent des anglaises avec un million de dollars en diamants dans la poche de leur long manteau noir. Ferronnerie. Grès rouge. Musique. Nourriture. Drogues. Sans-abris. Chasse-neige, baseball, véhicules de police labellisés CPR – courtoisie, professionnalisme, respect –, que-voulez-vous-que-je-vous-dise, ils-ne-manquent-pas-d’humour. Toutes les langues de la Terre, le russe, le panjabi, le taishanais, le créole, le yiddish, le kru. Et sans oublier le cœur battant de l’industrie de la télévision, Colbert au Ed Sullivan Theater, Noah dans Hell’s Kitchen, The View, The Chew, Seth Meyers, Fallon, tout le monde. Des avocats souriants sur les chaînes du câble qui promettent de vous faire gagner une fortune s’il vous arrive un accident. Rock Center, CNN, Fox. L’entrepôt du centre-ville où est tourné le show Salma. Les rues où elle marche, la voiture qu’elle prend pour rentrer chez elle, l’ascenseur vers son appartement en terrasse, les restaurants d’où elle fait venir ses repas, les endroits qu’elle connaît, ceux qu’elle fréquente, les gens qui ont son numéro de téléphone, les choses qu’elle aime. La ville tout entière belle et laide, belle dans sa laideur, jolie-laide, c’est français, comme la statue dans le port. Tout ce qu’on peut voir ici.
– Et l’autre ville ? demanda Sancho, sourcils froncés. Parce que ça fait déjà pas mal, tout ça.
– L’autre ville est invisible, répondit Quichotte, c’est la cité interdite, avec ses hauts murs menaçants bâtis de richesse et de pouvoir, et c’est là que se trouve la réalité. Ils sont très peu à détenir la clef qui permet d’accéder à cet espace sacré. »
Après avoir « renoncé à la croyance, à l’incroyance, à la raison et à la connaissance », ils doivent parvenir dans la « quatrième vallée » au détachement, là où « ce qu’on appelle communément « la réalité », qui est en réalité l’irréel, comme nous le montre la télévision, cessera d’exister. »
Quichotte envoie des lettres à Salma, puis sa photo, qui rappelle à celle-ci Babajan, son « grand-père pédophile ».
« Ma chère Miss Salma,
Dans une histoire que j’ai lue, enfant, et que, par une chance inespérée, vous pouvez voir aujourd’hui portée à l’écran sur Amazon Prime, un monastère tibétain fait l’acquisition du super-ordinateur le plus puissant du monde parce que les moines sont convaincus que la mission de leur ordre est de dresser la liste des neuf milliards de noms de Dieu et que l’ordinateur pourrait les aider à y parvenir rapidement et avec précision. Mais apparemment, il ne relevait pas de la seule mission de leur ordre d’accomplir cet acte héroïque d’énumération. La mission relevait également de l’univers lui-même, si bien que, lorsque l’ordinateur eut accompli sa tâche, les étoiles, tout doucement et sans tapage aucun, se mirent à disparaître. Mes sentiments à votre égard sont tels que je suis persuadé que tout l’objectif de l’univers jusqu’à présent a été de faire advenir cet instant où nous serons, vous et moi, réunis dans les délices éternelles et que, quand nous y serons parvenus, le cosmos, ayant atteint son but, cessera paisiblement d’exister et que, ensemble, nous entamerons alors notre ascension au-delà de l’annihilation pour pénétrer dans la sphère de l’Intemporel. »
« Autrefois, les gens croyaient vivre dans de petites boîtes, des boîtes qui contenaient la totalité de leur histoire et ils jugeaient inutile de se préoccuper de ce que faisaient les autres dans leurs autres petites boîtes, qu’elles soient proches ou lointaines. Les histoires des autres n’avaient rien à voir avec les leurs. Mais le monde a rétréci et toutes les boîtes se sont trouvées bousculées les unes contre les autres et elles se sont ouvertes et à présent que toutes les boîtes sont reliées les unes aux autres il nous faut admettre que nous devons comprendre ce qui se passe dans les boîtes où nous ne sommes pas, faute de quoi nous ne comprenons plus la raison de ce qui se passe dans nos propres boîtes. Tout est connecté. »
Quichotte a (comme Brother) une demi-sœur, « Trampoline », avec qui il s’est brouillé en l’accusant de détournement de leur héritage, devenue une défenderesse des démunis, et dont il voudrait maintenant se faire pardonner.
« Il n’accordait guère de temps aux chaînes d’actualités et d’informations, mais quand il les regardait distraitement il voyait bien qu’elles aussi imposaient un sens au tourbillon des événements et cela le réconfortait. »
Son, le fils de Brother, s’est aussi éloigné de ce dernier depuis des années, « passant tout son temps, jour et nuit, perdu quelque part dans son ordinateur, à s’immerger dans des vidéos musicales, jouer aux échecs en ligne ou mater du porno, ou Dieu sait quoi. »
Un agent secret (nippo-américain) apprend à Brother que son fils serait le mystérieux Marcel DuChamp, cyberterroriste qui porte le masque de L’Homme de la Manche, et l’engage à le convertir à servir les USA dans cette « Troisième Guerre mondiale ».
« Je ne suis pas critique littéraire mais je pense que vous expliquez au lecteur que le surréel, voire l’absurde, sont potentiellement devenus la meilleure façon de décrire la vraie vie. Le message est intéressant même s’il exige parfois, pour y adhérer, un considérable renoncement à l’incrédulité. »
Le destin d’Ignatius Sancho, esclave devenu abolitionniste, écrivain et compositeur en Grande-Bretagne, est évoqué à propos.
« Les réseaux sociaux n’ont pas de mémoire. Aujourd’hui, le scandale se suffisait à lui-même. L’engagement de Sister, toute une vie durant, contre le racisme, c’était comme s’il n’avait jamais existé. Différentes personnes qui se posaient en chefs de la communauté étaient prêtes à la dénoncer, comme si faire de la musique à fond tard le soir était une caractéristique indéniable de la culture afro-caribéenne et que toute critique à son égard ne pouvait relever que du préjugé, comme si personne n’avait pris la peine de remarquer que la grande majorité des jeunes buveurs nocturnes, ceux qui faisaient du scandale ou déclenchaient des bagarres, étaient blancs et aisés. »
« Mais aujourd’hui c’était le règne de la discontinuité. Hier ne signifiait plus rien et ne pouvait pas nous aider à comprendre demain. La vie était devenue une suite de clichés disparaissant les uns après les autres, un nouveau posté chaque jour et remplaçant le précédent. On n’avait plus d’histoire. Les personnages, le récit, l’histoire, tout cela avait disparu. Seule demeurait la plate caricature de l’instant et c’est là-dessus qu’on était jugé. Avoir vécu assez longtemps pour assister au remplacement, par sa simple surface, de la profonde culture du monde qu’elle s’était choisi était une bien triste chose. »
Trampoline est passée par un cancer qui lui a valu une double mastectomie, et elle recouvrit confiance en elle grâce à Evel Cent (Evil Scent, « mauvaise odeur » – Elon Musk !), un techno-milliardaire qui prétend sauver l’humanité en lui faisant quitter notre planète dans un monde en voie de désintégration ; Quichotte la brouilla avec lui, actuellement invité de Salma dans son talk-show. Trampoline révèle à Sancho que son « Événement Intérieur » fut une attaque cérébrale, et Quichotte obtient le pardon de ses offenses envers elle, rétablissant ainsi l’harmonie, prêt pour la sixième vallée, celle de l’Émerveillement.
« La mort de Don Quichotte ressemblait à l’extinction, en chacun d’entre nous, d’une forme particulière de folie magnifique, une grandeur innocente, une chose qui n’a plus sa place ici-bas, mais qu’on pourrait appeler l’humanité. Le marginal, l’homme dont on ridiculise la déconnexion d’avec la réalité, le décalage radical et l’incontestable démence, se révèle, au moment de sa mort, être l’homme le plus précieux d’entre tous et celui dont il faut déplorer la perte le plus profondément. Retenez bien cela. Gardez-le à l’esprit plus que tout. »
Brother retrouve Sister à Londres, qui se meurt d’un cancer (elle aussi), pour présenter ses excuses alors qu’il n’a pas souvenir de ses torts. Elle lui apprend que leur père avait abusé d’elle.
« C’était déconcertant à un âge aussi avancé de découvrir que votre récit familial, celui que vous aviez porté en vous, celui dans lequel, dans un sens, vous aviez vécu, était faux, ou, à tout le moins, que vous en aviez ignoré la vérité la plus essentielle, qu’elle vous avait été cachée. Si l’on ne vous dit pas toute la vérité, et Sister avec son expérience de la justice le savait parfaitement bien, c’est comme si on vous racontait un mensonge. Ce mensonge avait constitué sa vérité à lui. C’était peut-être cela la condition humaine : vivre dans des fictions créées par des contre-vérités ou par la dissimulation des vérités réelles. Peut-être la vie humaine était-elle dans ce sens véritablement fictive, car ceux qui la vivaient ne savaient pas qu’elle était irréelle.
Et puis il avait écrit sur une gamine imaginaire dans une famille imaginaire et il l’avait dotée d’un destin très proche de celui de sa sœur, sans même savoir à quel point il s’était approché de la vérité. Avait-il, quand il était enfant, soupçonné quelque chose, puis, effrayé de ce qu’il avait deviné, avait-il enfoui cette intuition si profondément qu’il n’en gardait aucun souvenir ? Et est-ce que les livres, certains livres, pouvaient accéder à ces chambres secrètes et faire usage de ce qu’ils y trouvaient ? Il était assis au chevet de Sister rendu sourd par l’écho entre la fiction qu’il avait inventée et celle dans laquelle on l’avait fait vivre. »
Sister et son mari (un juge qui aime s’habiller en robe de soirée) se suicident ensemble avec le « spray InSmileTM » qu’il a apporté à sa demande. Le Dr R. K. Smile charge Quichotte d’une livraison du même produit pour… Salma !
« …] elle passait à la télévision, sur le mode agressif, son monologue introductif portant le titre de “Errorisme en Amérique” ce qui lui permettait à elle et à son équipe de scénaristes de s’en prendre à tous les ennemis de la réalité contemporaine : les adversaires de la vaccination, les fondus du changement climatique, les nouveaux paranoïaques, les spécialistes des soucoupes volantes, le président, les fanatiques religieux, ceux qui affirment que Barack Obama n’est pas né en Amérique, ceux qui soutiennent que la Terre est plate, les jeunes prêts à tout censurer, les vieux cupides, les trolls, les clochards bouddhistes, les négationnistes, les fumeurs d’herbe, les amoureux des chiens (elle détestait qu’on domestique les animaux) et la chaîne Fox. “La vérité, déclamait-elle, est toujours là, elle respire encore, ensevelie sous les gravats des bombes de la bêtise. »
Des troubles visuels et d’autres signes rappellent la théorie de l’effilochement de la réalité dans un cosmos en amorce de désagrégation.
Le nouveau Galaad rencontre Salma pour lui remettre cette « potion » qui devait la rendre amoureuse de lui ; son message d’amour ne passe pas, et Salma fait une overdose avec le produit du Dr R. K. Smile, qui est arrêté pour trafic de stupéfiants (bizarrement, se greffe un chef d’inculpation portant sur son comportement incorrect avec les femmes…).
Maintenant, la télévision s’adresse directement à Quichotte, et son pistolet lui conseille de tuer Salma, sortie de l’hôpital mais dorénavant inatteignable. Sancho, qui lui aussi s’est trouvé une dulcinée et s’émancipe de plus en plus, agresse sa tante pour la voler ; il a changé depuis qu’il a été victime d’une agression raciste.
« Depuis qu’il avait été passé à tabac dans le parc, Sancho avait eu l’impression que quelque chose n’allait pas en lui, rien de physique, plutôt un trouble d’ordre existentiel. Quand vous avez été sévèrement battu, la part essentielle de vous-même, celle qui fait de vous un être humain, peut se détacher du monde comme si le moi était un petit bateau et que l’amarre le rattachant au quai avait glissé de son taquet laissant le canot dériver inéluctablement vers le milieu du plan d’eau, ou comme si un grand bateau, un navire marchand, par exemple, se mettait, sous l’effet d’un courant puissant, à chasser sur son ancre et courait le risque d’entrer en collision avec d’autres navires ou de s’échouer de manière désastreuse. Il comprenait à présent que ce relâchement n’était peut-être pas seulement d’ordre physique mais aussi éthique, que, lorsqu’on soumettait quelqu’un à la violence, la violence entrait dans la catégorie de ce que cette personne, jusque-là pacifique et respectueuse des lois, allait inclure ensuite dans l’éventail des possibilités. La violence devenait une option. »
Des « ruptures dans le réel » et autres « trous dans l’espace-temps » signalent de plus en plus l’imminente fin du monde.
Dans des propos tenus à son fils Son, « l’Auteur » met en abyme dans la fiction le projet de l’auteur.
« “Tant de grands écrivains m’ont guidé dans cette voie”, dit-il ; et il cita aussi Cervantès et Arthur C. Clarke. “C’est normal de faire ça ? demanda Son, ce genre d’emprunt ?” Il avait répondu en citant Newton, lequel avait déclaré que s’il avait été capable de voir plus loin c’était parce qu’il s’était tenu sur les épaules de géants. »
« Il essaya de lui expliquer la tradition picaresque, son fonctionnement par épisodes, et comment les épisodes d’une œuvre de ce genre pouvaient adopter des styles divers, relevé ou ordinaire, imaginatif ou banal, comment elle pouvait être à la fois parodique et originale et ainsi, au moyen de ses métamorphoses impertinentes, mettre en évidence et englober la diversité de la vie humaine. »
« Je pense qu’il est légitime pour une œuvre d’art contemporaine de dire que nous sommes paralysés par la culture que nous avons produite, surtout par ses éléments les plus populaires, répondit-il. Et par la stupidité, l’ignorance et le sectarisme, oui. »
Dans la septième vallée, celle de l’annihilation d’un monde apocalyptique livré aux vides, Quichotte (et son pistolet) convainc Salma d’aller avec lui au portail d’Evel Cent en Californie pour fuir dans la Terre voisine : celle de l’Auteur.
C’est excellemment conté, plutôt foutraque et avec humour, mais en jouant de tous les registres de la poésie au polar en passant par le picaresque ; relativement facile à suivre, quoique les références, notamment au show business, soient parfois difficiles à saisir pour un lecteur français. Beaucoup de personnages et d’imbroglios dans cette illustration de la complexité du monde. De nombreuses mises en abîme farfelues, comme l’histoire des mastodontes (dont certains se tenant sur les pattes arrière et portant un costume vert), perturbent chacun des deux fils parallèles en miroir (celui de Quichotte et celui de Brother), tout en les enrichissant. Récurrences (jeu d’échec, etc.), intertextualité (le « flétan », qui rappelle Günter Grass, etc.). J’ai aussi pensé à Umberto Eco, Philip K. Dick.
\Mots-clés : #Contemporain #ecriture #famille #Identite #immigration #initiatique #Mondialisation #racisme #sciencefiction #XXeSiecle
- le Sam 4 Mar - 12:51
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Salman Rushdie
- Réponses: 18
- Vues: 1621
Colum McCann
Les Saisons de la nuit
1991, Treefrog, que j’hésite à désigner comme clochard, mendiant, vagabond, SDF ou sans-abri, puisqu’il réside dans un tunnel et ne demande pas l’aumône, subsistant d’expédients ; c’est un personnage singulier, maniaque de symétrie et de parité, passionné de cartographie et de construction mécanique.
Narré concomitamment, 1916, Nathan Walker (un Noir de Géorgie), Sean Power (« polaque »), « Rhubarbe » Vannucci (Italien) et Con O’Leary (un Irlandais, qui y laissera la vie) creusent à la main sur le front de taille d’un tunnel avec air comprimé sous l’East River entre Brooklyn et Manhattan.
Walker est resté proche des deux autres survivants, ainsi que de Maura et d’Eleanor, la veuve et la fille d’O’Leary, malgré le racisme dont il fait l’objet. Eleanor et Walker se marient et ont des enfants. Son petit-fils, Clarence Nathan, a un tel sens de l’équilibre qu’il travaille à la construction des gratte-ciel de Manhattan (annonce Et que le vaste monde poursuive sa course folle).
Treefrog a été marié avec Dancesca, et ils eurent une fille, Lenora ; il rencontre Angela, une droguée régulièrement tabassée par Elijah (la faune de ce monde souterrain est particulière). C’est Clarence, égaré depuis la mort de Walker.
« Seigneur, j’suis tellement au fond du trou, quand je lève les yeux, il me semble que j’vois que le fond. »
« Seigneur, maintenant que j’suis en haut du ciel, quand je baisse les yeux, il me semble que j’vois que du ciel. »
La façon de présenter l’histoire familiale, de rendre la psychologie des personnages marginaux et les faiblesses stylistiques (ou de traduction ?) font que ce livre n’est pas aussi accompli qu’il aurait pu être, mais demeure une restitution bien documentée de l’odyssée états-unienne et tout spécialement new-yorkaise.
Dans ma précédente lecture, Stoner de John Williams, l’oiseau leitmotive est la cigogne (ou plutôt le couple de cigognes), ici c’est la grue ; les cigognes condensaient l’enfance ramentue, ici la grue n’est apparue comme gratuite (voire incidente lorsqu’elle est engin de levage), encore que ce ne soit pas vain tant elle est belle quand elle danse…
\Mots-clés : #famille #racisme #xxesiecle
- le Sam 31 Déc - 10:06
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Colum McCann
- Réponses: 46
- Vues: 4779
Antonio Lobo Antunes
Traité des passions de l'âme
Le Juge d’instruction a été sommé de convaincre l’Homme, un membre d'une organisation terroriste, de renseigner la justice.
« Vous ne trouvez pas que c'est une aide généreuse, a-t-il demandé à l'Homme en lui tournant le dos et en lui présentant sous son costume des omoplates maigres d'ange inachevé. »
Le père du juge était le pauvre fermier (alcoolique) du grand-père du détenu, et les souvenirs de leur enfance commune s’entremêlent à leurs pensées tandis qu’ils s’entretiennent, en viennent à l’évoquer en se chamaillant, perturbant l’interrogatoire en s’y mélangeant inextricablement. Délirante, fantasmagorique et même farcesque, parfois nauséabonde, cette féroce peinture de mœurs dans un Portugal, un Lisbonne apparemment en ruine, est rendue dans une baroque profusion de détails.
« La villa, avec son toit d'ardoises noires, dégringolait comme une construction de dominos depuis les deux ou trois derniers hivers : le revêtement des angles se détachait par grandes plaques molles, une des vérandas en ruine inclinait ses planches vers les broussailles de la clôture, les rideaux se déchiraient à travers les losanges des fenêtres, les feux de navigation des fantômes défunts qui dérivaient de fenêtre en fenêtre devenaient de plus en plus dispersés et faibles et la musique titubait en hésitant sur les dénivellations des notes au bord d'une agonie douloureuse. Le gazon dévorait la clôture, maintenant complètement démolie, qui séparait la villa du bâtiment de l'école, les chats s'y recherchaient dans la frénésie du rut. Des oiseaux avec des pupilles démentes sortaient des fenêtres du vestibule dans un volettement de pages de dictionnaire et une silhouette claire se montrait de temps en temps à un appui de fenêtre pour contempler le fouillis de giroflées avec l'étonnement des statues de porcelaine. »
Dans cette villa vit le père de l’Homme (« António Antunes »), violoniste fou caché par ses parents-parents depuis la mort de sa mère…
Évocation de ses complices, « le Curé, l'Étudiant, l'Artiste, la Propriétaire de la maison de repos, l'Employé de banque », cellule marxiste enchaînant les sanglants assassinats mal ciblés. L’action se passe apparemment après la chute de Salazar, mais ce n’est pas toujours évident.
Le Monsieur de la Brigade spéciale annonce à Zé, le Magistrat, qu’il va servir d’appât pour les terroristes, actuellement occupés à éliminer les (faux) repentis et les infiltrés (c’est aussi un roman de trahisons croisées, de violence aveugle) ; l’Homme a rejoint la bande, renseignant la police qui lui a promis une exfiltration au Brésil.
Ce Monsieur, souvent occuper à reluquer la pédicure d’en face, ne dépare pas dans la galerie de grotesques salopards lubriques et corrompus issus de l’armée (exemple de la narration alternée).
« J'ai rangé ma serviette, mon canif en nacre, mon trousseau de clés et l'argent dans mon pantalon à côté d'une photo d'elle prise à Malaga l'été précédent et entourée d'un cadre en cuir à l'époque où elle s'était avisée de s'enticher d'un architecte italien à qui j'avais dû casser un coude pour le persuader poliment de rentrer bien tranquillement dans le pays de ses aïeux, et je me suis installé sur le pouf pour me battre avec mes lacets qui me désobéissent quand j'aurais le plus besoin qu'ils se défassent et avec mes souliers qui augmentent de taille comme ceux des clowns de cirque et qui m'obligent à avancer sur le parquet en levant exagérément les genoux, à l'instar des hommes-grenouilles chaussés de palmes qui se déplacent sur la plage comme s'ils évitaient à chaque pas des monticules de bouse invisible semés sur le sable par des vaches inexistantes. »
Petitesse de tous, qui vont et viennent entre le présent et le passé, souvent leurs souvenirs d’enfance.
En compagnie du cadavre de l’Artiste abattu par la police, les piètres terroristes retranchés dans un appartement avec leur quincaillerie achetée à des trafiquants africains tentent un attentat risible contre le Juge et la Judiciaire : du grand cirque.
« Les fruits du verger luisaient dans l'obscurité, des chandeliers sans but se promenaient derrière les stores de la villa, la constellation de Brandoa clignotait derrière les contours de la porcherie. Le chauffeur, la cuisinière, ma mère et moi, a pensé le Magistrat, nous glissions tous les quatre sur des racines, dans des rigoles d'irrigation, sur des pierres, des arbustes, des briques qui traînaient par terre, nous avons descendu mon père qui exhalait des vapeurs d'alambic, nous l'avons couché sur le lit que ma mère a recouvert de la nappe du dîner pour qu'il ne salisse pas les draps avec la boue de ses bottes et, un quart d'heure plus tard, après avoir enterré la chienne dans ce qui fut une plate-bande d'oignons et qui se transformait peu à peu en un parterre de mauvaises herbes, le chauffeur est revenu flanqué du pharmacien, dont la petite moustache filiforme semblait dessinée au crayon sur la lèvre supérieure, qui a examiné les pupilles de mon père avec une lanterne docte tout en lorgnant à la dérobée les jambes des bonnes, il a tâté sa carotide pour s'assurer du flux du sang, il a administré des coups de marteau sur ses rotules avec le bord de la main pour vérifier ses réflexes, il a souri à la cuisinière en se nettoyant les gencives avec la langue et il a annoncé à ma mère en projetant des ovales plus clairs sur les murs avec sa lampe, Pour moi, ça ne fait aucun doute, il a avalé son bulletin de naissance, si vous voulez, emmenez-le à l'hôpital Saint-Joseph par acquit de conscience, il faut qu'un médecin délivre le certificat de décès.
– Je lui ai fait comprendre que je le mettais dans un avion pour le Brésil, le type m'a pris au sérieux et c'est sur cette base qu'il a collaboré avec nous, a dit le Magistrat en regardant le Monsieur en face pour la première fois. Je lui ai affirmé qu'il n'aurait pas d'ennuis, et si vos hommes de main le descendent en arguant de la légitime défense ou de tout autre prétexte, je vous jure que je ferai un foin terrible dans les journaux.
– Mort ? s'est étonné le chauffeur en collant son oreille contre la bouche du fermier, puis se redressant et dansant sur ses souliers pointus vers le pharmacien qui examinait avec sa lampe la grimace jalouse de la cuisinière et les nichons des servantes. C'est drôle ça, j'ai vu des morts tant et plus quand je travaillais à la Miséricorde mais c'est bien le premier que j'entends ronfler.
– On se change, on prend une douche froide, on se met sur son trente et un, et après le dîner on se tire à Pedralvas, a proposé l'Homme qui se cramponnait au cèdre en essayant de se tenir sur ses genoux et ses chevilles gélatineuses. (Sa tête lui faisait mal comme une blessure ouverte, ses intestins semblaient sur le point d'expulser un hérisson par l'anus, le visage flou du Juge d'instruction le regardait derrière une rangée de narcisses.) Moi je me porte comme un charme, je pourrais aller jusqu'à Leiria au pas de course. »
L’Homme est en fuite, cerné par les forces armées (très présentes, ainsi que l’empreinte de la guerre d’Angola), et il appelle son ami d’enfance...
« Nous avons passé notre vie à nous faire mutuellement des crocs-en-jambe et quand des soldats encerclent votre maison, qui se souvient de son enfance ? »
Mais l’enfance revient toujours, avec le leitmotiv des cigognes. La justice impuissante et la révolte inepte sont en quelque sorte renvoyées dos à dos, s’engloutissant dans la violence brute, et l’état de fait ne change guère (après la révolution des Œillets).
\Mots-clés : #corruption #Enfance #famille #justice #politique #regimeautoritaire #terrorisme #trahison #violence #xxesiecle
- le Mar 27 Déc - 11:37
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Antonio Lobo Antunes
- Réponses: 41
- Vues: 6796
Page 1 sur 18 • 1, 2, 3 ... 9 ... 18 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages



