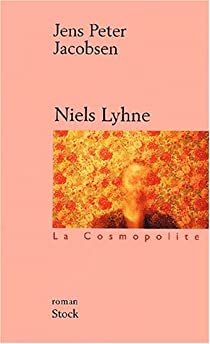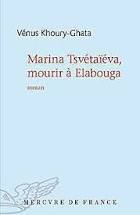La date/heure actuelle est Mer 8 Mai - 4:42
34 résultats trouvés pour portrait
Philip Roth
Pastorale américaine
Le romancier Nathan Zuckerman, la soixantaine, est contacté par l’idole de son enfance à Newark, Seymour Levov, « le Suédois », une star sportive, un Juif comme lui et son aîné de quelques années. Seymour est l’image-même de la réussite états-unienne, familiale, sociale, professionnelle. À ce propos, il a repris l’entreprise de son père, et dit avoir dû délocaliser son usine à regret, après les émeutes raciales de Newark de 1967, à cause de la situation sociale (violence et insécurité), pour former une main-d’œuvre compétente à l’étranger (ce qui constitue la succession inverse des faits telle qu’elle est souvent présentée). Seymour est vu comme un brave, gentil conformiste, dans le prolongement de sa jeunesse de « héros de lycée », « notre Kennedy ». Mais Nathan doit revoir son jugement :
« Le fait est que comprendre les autres n’est pas la règle, dans la vie. L’histoire de la vie, c’est de se tromper sur leur compte, encore et encore, encore et toujours, avec acharnement et, après y avoir bien réfléchi, se tromper à nouveau. C’est même comme ça qu’on sait qu’on est vivant : on se trompe. »
Jerry, le frère de Seymour, apprend à Nathan que ce dernier vient de mourir d’un cancer, et surtout qu’il était dévasté par l’attentat à la bombe perpétré par sa fille de seize ans en 1968 contre la guerre au Vietnam.
« Or survient la fille perdue, la fille en cavale, cette Américaine de la quatrième génération censée reproduire en plus parfait encore l’image de son père, lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite… survient la fille en colère, la malgracieuse, qui crache sur son monde et se fiche éperdument de prendre sa place dans la lignée Levov en pleine ascension sociale, sa fille, enfin, qui le débusque comme un fugitif, qui le pousse la première dans la transhumance d’une tout autre Amérique ; sa fille et ces années soixante qui font voler en éclats le type d’utopie qui lui est cher, à lui. Voilà la mort rouge qui contamine le château du Suédois, et personne n’en réchappe. Voilà sa fille qui l’exile de sa pastorale américaine tant désirée pour le précipiter dans un univers hostile qui en est le parfait contraire, dans la fureur, la violence, le désespoir d’un chaos infernal qui n’appartient qu’à l’Amérique. […]
Qui est fait pour la tragédie et la souffrance absurde ? Personne. La tragédie de l’homme qui n’était pas fait pour la tragédie, c’est la tragédie de tout homme. »
Meredith, dite Merry Levov, fait l’objet d’une « étiologie » (notamment psychiatrique) de son bégaiement de jeune adolescente révoltée qui se tourne vers l’extrémisme. Alors qu'elle est en cavale après l’attentat qu’elle a perpétré, Rita Cohen, qui s’avère être une terroriste communiste, prend contact avec Seymour.
Roth rend le calvaire de Seymour, lui si raisonnable, responsable.
« Telle est la vie extérieure, qu’il mène autant que faire se peut sans changement apparent. Mais elle se double d’une vie intérieure, d’une vie intérieure morbide, hantée par des obsessions tyranniques, des pulsions refoulées, des espoirs superstitieux, des imaginations effroyables, des conversations fantasmées, des questions insolubles. De nuit en nuit, insomnies, autopunition. Solitude colossale. […]
Et au quotidien rien à faire, sinon assumer cette imposture, continuer de vivre sous son identité, avec l’ignominie de se faire passer pour l’homme idéal. »
« S’il avait pu de nouveau fonctionner comme tout un chacun, redevenir tel qu’en lui-même, au lieu d’être ce charlatan à la sincérité schizophrène, lisse dehors, tourmenté dedans, stable aux yeux d’autrui, et pourtant le dos au mur en son for intérieur, puisque son personnage social détendu, souriant et factice servait de linceul au Suédois enterré vivant. S’il avait pu, si peu que ce fût, recouvrer son existence cohérente, indivise, qui lui avait donné son assurance physique, sa liberté d’allure avant d’engendrer une meurtrière présumée. »
Il décrit aussi la dépression de sa femme Dawn, une Irlandaise, ex-Miss New Jersey, musicienne, éleveuse de bétail, qui en est venue à le rendre responsable du drame ; il expose le métier de la ganterie transmis par son père à Seymour, ainsi que les valeurs de travail et d’excellence.
Puis Seymour retrouve Merry, devenue une adepte jaïn (« l’ahimsa, le respect systématique de la vie »), clandestine vivant dans des conditions sordides ; la terroriste a perdu son bégaiement, peut-être en se voilant pour ne pas tuer de petites vies. Fabricant des bombes, elle est la responsable directe de quatre morts (et a été victime de deux viols).
C’est tout le rêve américain fracassé qui est brossé, aboutissant dans la violence à une sorte de nihilisme dans un terrible conflit de génération.
« Trois générations. Toutes en ascension sociale. Le travail, l’épargne, la réussite. Trois générations en extase devant l’Amérique. Trois générations pour se fondre dans un peuple. Et maintenant, avec la quatrième, anéantissement des espoirs. Vandalisation totale de leur monde. »
« Il avait fait du mieux qu’un parent pouvait faire — il avait écouté tant et plus, alors même qu’il se retenait de toutes ses forces pour ne pas se lever de table et s’en aller en attendant qu’elle ait craché son venin. »
« Toujours dans la peau d’un personnage. Ce qui avait commencé de manière assez anodine du temps qu’elle jouait les Audrey Hepburn avait donc conduit en dix ans à ce mythe exotique de l’abnégation ? D’abord la niaise abnégation au nom du Peuple, maintenant la niaise abnégation de l’âme parachevée. Phase suivante, le crucifix de grand-mère Dwyer ? Est-ce qu’on allait revenir à l’abnégation suprême de l’éternelle chandelle et du Sacré-Cœur ? On était toujours dans l’irréalité grandiose, dans l’abstraction la plus lointaine — on ne s’occupait jamais de sa petite personne, alors là, jamais de la vie. Quelle imposture, quelle horreur inhumaine, cette abnégation ! »
« Tuer Conlon [le médecin victime collatérale de sa première bombe] n’avait fait que confirmer son ardeur de révolutionnaire idéaliste, qui n’hésitait pas à adopter les moyens, même impitoyables, de détruire un système injuste. »
Nombre de personnalités politiques états-uniennes sont évoquées, mais aussi Frantz Fanon, comme "influenceurs" de Merry. Jerry rabroue son frère à cause de son attitude envers le « monstre ». Puis Dawn décide de se refaire chirurgicalement une beauté, et de quitter la résidence rurale traditionnelle qui plaisait tant à Seymour (pleine de souvenirs) pour une maison lumineuse conçue par un architecte wasp (avec lequel elle trompe son mari – mais ce dernier a aussi fauté, avec Jessie, l’orthophoniste de Merry, qui accueillit celle-ci après son départ…). Cette confrontation avec ces amis, les Bill et Jessie Orcutt, les Barry et Marcia Umanoff, d’une certaine aristocratie ou élite intellectuelle établies, révèle (outre un fabuleux jeu de masques) un autre aspect social des États-Unis de la seconde moitié du XXe (et qui éclaire toujours la société contemporaine).
Des phrases comme celle-ci, en début de paragraphe, font d’avance sourire si on connaît un peu Roth :
« Au dîner la conversation roula sur le Watergate et sur Gorge profonde. »
Lou, le bavard père de Seymour, vieux has been, a des propos, certes décousus, mais pas forcément incohérents (il soutient aussi le fait que les délocalisations ont commencé avant les problèmes raciaux).
« C’est pas les syndicats à eux tout seuls qui nous ont cassés, cela dit. Les syndicats ont rien compris, mais certains industriels non plus. “Je veux pas payer ces fils de putes cinq cents de plus”, et le gars qui dit ça roule en Cadillac et passe l’hiver en Floride. Non, y a beaucoup d’industriels qui ont pas su réagir. Mais les syndicats n’ont jamais compris la concurrence d’outre-mer et, à mon avis, ils ont bel et bien accéléré la ruine de l’industrie du gant par leur intransigeance : on ne pouvait plus faire de bénéfices. »
Bill Orcutt :
« La permissivité. La perversion drapée dans les voiles de l’idéologie. La contestation perpétuelle. »
Roth évite de donner directement son avis en forçant le trait avec humour, en rapportant des points de vue erronés, des pensées attribuées à un personnage par le biais d’un autre (notamment son alter ego Zuckerman). Difficile de donner un résumé de ce livre sans être partial ; dans ce roman fouillé, qui compte près de 600 pages, Roth lance son lecteur sur de nombreuses pistes, le mène si bien qu’il le déroute souvent. Demeure cependant le constat d’un échec social, sociétal, voire civilisationnel d’une culture en pointe du monde occidental.
Au vu de son commentaire, ce n'est pas Topocl qui me contredira comme je recommande la lecture de ce livre.
\Mots-clés : #culpabilité #historique #humour #mondedutravail #politique #portrait #psychologique #relationenfantparent #satirique #social #solitude #terrorisme #xxesiecle
- le Sam 27 Avr - 13:38
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Philip Roth
- Réponses: 114
- Vues: 11922
Joseph Conrad
Jeunesse, Cœur des ténèbres, Au bout du rouleau
Jeunesse
Marlow (dont c’est la première apparition dans l’œuvre de Conrad) raconte à ses compagnons marins (dont le narrateur) son premier voyage de lieutenant de la marine marchande, à bord de la « “Judée, Londres, Marche ou meurs.” », « vieille baille » sur laquelle il embarqua avec l’enthousiasme de ses vingt ans à destination de Bangkok. Le rafiot, qu’il chérit, est en si mauvais état qu’il doit revenir trois fois en Angleterre, changeant autant de fois d’équipage. Après avoir failli couler tant il faisait eau, c’est la combustion de sa cargaison de charbon qui l’enverra par le fond. Récit épique et aussi plein d’humour, avec de frappantes descriptions qui en font un chef-d’œuvre des aventures maritimes.
Cœur des ténèbres
C’est encore Charlie Marlow (et l’auteur) qui parle(nt), sensiblement dans les mêmes conditions que le texte précédent – en fait un monologue, d’abord méditatif sur les ténèbres et la lumière sur la Tamise au cours du temps, puis la narration de son expérience de marin d’eau douce sur un autre fleuve, cette fois au cœur du continent africain. L’idée lui en est venue de sa fascination pour les blancs des cartes de géographie ; Conrad a rapporté dans Du goût des voyages ce même enthousiasme cartographique à l’origine de ses voyages.
Marlow décrit son embauche par « la Compagnie » à Paris, « la ville sépulcrale », dans une atmosphère de malaise assez sinistre et inquiétante (des secrétaires-Parques tricotent une « laine noire », mise en abyme de ce récit sur le destin).
L’absurde et l’irréalité s’additionnent à la situation pratique tandis qu’il se rapproche de son commandement, un vapeur coulé qu’il remet en état près d’un comptoir d’ivoire. Cette histoire est le lieu de considérations sur la colonisation et le progrès civilisateur (depuis la conquête de l’Angleterre par les Romains ; dans le prolongement d’Un avant-poste du progrès), qui sont pour le moins remis en question (versus la « nature sauvage »).
Marlow entend beaucoup parler de Mr. Kurtz, le chef de la station de l’intérieur, le meilleur agent de la Société, et pour le rencontrer remonte le fleuve (façon L’odyssée de l’African Queen de Cecil Scott Forester) avec un équipage de coupeurs de bois pour la chaudière (noirs) et les « pèlerins » (blancs) avec à leur tête le directeur, homme ambitieux, mesquin et désagréable. Marlow rencontre un jeune Russe, en admiration devant Kurtz comme la tribu qui les assaille d’abord. Apparaît aussi la « femme barbare et magnifique », la « Promise » de Kurtz. Celui-ci est malade, mais son éloquence convainc toujours.
« Quelle voix ! Quelle voix ! Elle conserva sa profonde sonorité jusqu’à la fin. Elle survivait à sa force pour continuer de dissimuler sous les draperies magnifiques de l’éloquence les arides ténèbres de son cœur. »
Angoissé par « l’horreur », l’homme a encore de vastes projets, il fascine toujours, avec une puissance obscure, avide et parfois violente, explorant la contrée, accumulant l’ivoire ; sa tête a le teint de ce dernier (cf. Marlon Brando dans Apocalypse Now, film de Coppola tiré de cette novella). Il a toujours de l’ascendant, même devenu une « ombre ».
« Il était d’une noirceur impénétrable. »
Et cette cargaison est emportée par le vapeur lors d’un retour au cours duquel Kurtz meurt. Marlow, « fiévreux », demeure fidèle à la mémoire de « l’homme remarquable » qu’il a si peu connu, et devient le dépositaire de ses papiers personnels (mais apparemment pas de ceux qui traitent de ses découvertes).
Une fois encore je suis incapable de définir la nature exacte du personnage, et du cauchemar ; il me semble maintenant que cette ambiguïté fut peut-être plus sciemment voulue par Conrad que je ne le pensais jusqu’alors. Ce qui ne fait qu’ajouter à la profondeur de ce questionnement métaphysique, existentiel.
Au bout du rouleau
Le capitaine Whalley, soixante-sept ans, ne court plus l’aventure, mais cabote en Extrême-Orient. Ruiné, il n’a plus de bateau, mais a mis l’argent qu’il lui restait dans le Sofala, vieux vapeur du chef mécanicien-armateur Massy dont il devint ainsi le capitaine. Massy déborde de ressentiment, le second, Sterne, de malveillance au service de son ambition. Un petit Malais, le serang (pilote), semble inséparable du capitaine.
Mr. Van Wyk, un Hollandais qui vit retiré dans sa plantation sur une île, a sympathisé avec Whalley, qui lui apporte son courrier tous les mois. Ce dernier lui avoue qu’il devient aveugle, et qu’il en est réduit à cacher sa cécité grandissante pour préserver ce qui lui restera d’argent au terme d’un contrat de trois ans, au profit de sa fille dans le besoin. Massy a compris la situation, mais Van Wyk le circonvient ; Massy naufrage le navire.
L’intérêt de cette novella (où les évènements sont parfois à la limite de la plausibilité) réside essentiellement dans la psychologie des personnages (elle aussi assez tortue), et surtout l’imposante figure qu’est cet intègre et pathétique capitaine Whalley.
« Il n’avait plus rien à lui ; même son propre passé d’honneur, de vérité, de juste fierté, avait disparu. Toute son existence sans tache s’était effondrée dans l’abîme ; il lui avait dit son dernier adieu. Mais ce qui appartenait à sa fille, cela il voulait le sauver. Rien qu’un peu d’argent. Il le lui porterait lui-même, ce dernier don d’un homme qui avait trop duré. Et une immense et farouche impulsion, la passion même de la paternité, déchaîna dans toute la vigueur inextinguible de sa misérable vie, le désir de voir son visage. »
Trois délectables relectures, telles que rassemblées par l’auteur et publiées dans le Quarto Gallimard.
\Mots-clés : #aventure #colonisation #culpabilité #merlacriviere #portrait #psychologique #voyage
- le Ven 22 Mar - 11:45
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Joseph Conrad
- Réponses: 95
- Vues: 13410
Saul Bellow
Ravelstein
Chick, le narrateur, parle d’Abe Ravelstein à la requête de ce dernier. Son proche ami, qui devint riche en suivant son conseil de consigner dans un livre grand public sa philosophie politique (entre Moïse et Socrate en passant par Thucydide, Machiavel et Rousseau), est depuis détesté par les autres professeurs d’université. Ravelstein, élégant, intelligent, lucide, franc, polémique et passionné par autrui, est adulé par son cercle d’étudiants favoris ; ses anciens élèves sont parvenus à des postes importants, le consultent toujours et le tiennent averti des décisions politiques en temps réel (il est aussi amateur de commérages). Pour lui, « chaque âme était en quête de son autre singulier, désireuse de son complément », et il vit avec son compagnon Nikki, puis s’avère atteint du sida.
Après son divorce d’avec Vera, une physicienne d’origine slave, Chick vit avec Rosamund, une des jeunes étudiantes en « Grande Politique » de Ravelstein (qui est aussi une sorte d’entremetteur, mais fut là mis devant le fait accompli) ; ce dernier lui a demandé de dresser son portrait.
Entre Paris, Chicago et le Midwest, les deux hommes discutent et philosophent avec humour sur la judaïté, la marche du monde, et Chick relate leur relation non sans redites et allers-retours dans le temps, comme dans un premier jet ou une conversation.
« Mais, heureusement — ou peut-être pas trop heureusement —, nous sommes à l’ère de l’abondance, du trop-plein parmi toutes les nations civilisées. Jamais, du côté matériel, d’immenses populations n’ont mieux été protégées de la faim et la maladie. Et cette délivrance partielle de la lutte pour la survie rend les gens ingénus. Par là, je veux dire que leurs fantasmes s’expriment sans retenue. On se met, selon un accord implicite, à accepter les termes, invariablement falsifiés, sous lesquels les autres se présentent. On anéantit sa puissance critique. On étouffe son astuce. Avant même de s’en rendre compte, on paie une pension alimentaire colossale à une femme qui a plus d’une fois déclaré qu’elle était une innocente qui n’entendait rien aux questions d’argent. »
« Nous étions parfaitement francs l’un avec l’autre. Nous pouvions nous parler ouvertement sans nous offenser. D’un autre côté, rien n’était trop personnel, trop honteux pour être dit, rien n’était trop méchant ou trop criminel. Il me semblait parfois qu’il m’épargnait ses jugements les plus sévères si je n’étais pas encore prêt à les assumer. Je le ménageais, moi aussi. Mais c’était pour moi un immense soulagement d’être aussi net et carré avec lui que je l’aurais été avec moi-même devant les faiblesses ou les vices. Il me dépassait de très loin dans la compréhension de soi-même. Mais toute discussion personnelle virait finalement à la bonne vieille rigolade nihiliste. »
« Il exposait les défaillances du système dans lequel ils avaient été formés, la superficialité de leur historicisme, leur susceptibilité au nihilisme européen. Un résumé de sa thèse était que, si on pouvait acquérir une excellente formation technique aux USA, la formation générale s’était réduite au point de disparaître. Nous étions les esclaves de la technologie, qui avait métamorphosé le monde moderne. »
« Tout cela vous remettait en mémoire les manifestations de masse organisées et mises en scène par l’imprésario de Hitler, Albert Speer : rencontres sportives et grands rassemblements fascistes empruntaient les uns aux autres. »
« Ses élèves étaient devenus historiens, professeurs, journalistes, experts, hauts fonctionnaires, membres de cellules de réflexion. Ravelstein avait produit (endoctriné) trois ou quatre générations de diplômés. Qui plus est, ses jeunes gens devenaient fous de lui. Ils ne se limitaient pas à ses doctrines, ses interprétations, mais imitaient ses manières et essayaient de marcher et de parler comme lui — librement, furieusement, acerbement, avec un brio aussi proche du sien qu’il leur était possible. »
« J’avais découvert que, si l’on plaçait les gens sous un éclairage comique, ils devenaient plus sympathiques — si vous parliez de quelqu’un comme d’un brochet humain frustre, pétomane et strabique, vous vous entendiez d’autant mieux avec lui par la suite, en partie parce que vous aviez conscience d’être le sadique qui l’avait dépouillé de ses attributs humains. En outre, lui ayant infligé quelques violences métaphoriques, vous lui deviez une considération particulière. »
« Mais les Juifs pensent que le monde a été créé pour chacun d’entre nous, autant que nous sommes, et que détruire une vie humaine, c’est détruire un univers entier — l’univers tel qu’il existait pour cette personne. »
« — Bien sûr que c’est autour de ça que tourne la conversation — ce que cela signifie pour les Juifs que tant d’autres, des millions d’autres, aient voulu leur mort. Le reste de l’humanité les expulsait. Hitler aurait dit qu’une fois au pouvoir il ferait dresser des échafauds, des rangées entières, sur la Marienplatz à Munich et que tous les Juifs, jusqu’au dernier, y seraient pendus. Ce sont les Juifs qui ont été le marchepied de Hitler vers le pouvoir. Il n’avait pas d’autre programme, et n’en avait aucun besoin. Il est devenu chancelier en rassemblant l’Allemagne et une bonne part du reste de l’Europe contre les Juifs. »
« Il fallait penser ces centaines de milliers de millions détruits pour des motifs idéologiques — c’est-à-dire sous quelque prétexte habillé de rationalité. Un raisonnement présente une valeur considérable comme manifestation d’ordre ou de fermeté de propos. Mais les formes de nihilisme les plus folles sont les plus strictement allemandes et militarisées. »
Ravelstein décédé, c’est le narrateur (plus âgé que ce dernier) qui manque succomber à une ciguatera contractée à Saint-Martin.
« Je disais souvent à Rosamund que l’un des problèmes du vieillissement était l’accélération du temps. Les jours passaient « comme des stations de métro traversées par un express ». Je me référais souvent à La Mort d’Ivan Ilitch afin d’illustrer cela pour Rosamund. Les jours des enfants sont très longs, mais, dans le vieil âge, ils filent « plus vite que la navette du tisserand », comme dit Job. Et Ivan Ilitch mentionne aussi la lente ascension d’une pierre jetée en l’air. « Quand elle retourne à la terre, elle est accélérée de dix mètres par seconde. » Nous sommes régis par le magnétisme gravitationnel et l’univers tout entier est impliqué dans cette accélération de votre fin. Si seulement nous pouvions retrouver les journées pleines que nous connaissions étant enfants. Mais nous sommes devenus trop familiers avec les données de l’expérience, me semble-t-il. Notre manière d’organiser les données qui affluent sous forme de Gestalt — c’est-à-dire de manière de plus en plus abstraite — accélère les expériences en une dangereuse dégringolade de comédie. Notre précipitation élimine les détails qui enchantent, retiennent ou retardent les enfants. L’art est un moyen d’échapper à cette accélération chaotique. Le mètre en poésie, le tempo en musique, la forme et la couleur en peinture. Mais nous sentons bien que nous filons vers la terre, vers l’enfouissement de la tombe. "Si ce n’étaient que des mots, dis-je à Rosamund. Mais je le ressens tous les jours. Une méditation impuissante dévore elle-même ce qui reste de la vie..." »
« — Il me citait à moi-même. » Il avait déterré une déclaration que j’avais faite sur le désenchantement moderne. Sous les débris des idées modernes, le monde était toujours là, prêt à être redécouvert. Et sa manière de le présenter était que le filet gris de l’abstraction jeté sur le monde dans le but de le simplifier et de l’expliquer d’une manière adéquate à nos objectifs culturels était devenu le monde à nos yeux. Nous avions besoin de visions alternatives, d’une diversité de regards — et il parlait de regards qui ne soient pas régentés par des idées. Il y voyait une question de mots : « valeurs », « modes de vie », « relativisme ». J’étais d’accord, dans une certaine mesure. Nous avions besoin de savoir — mais notre besoin humain profond ne peut être comblé par ces termes. Nous ne pouvons nous échapper du fossé de la « culture » et des « idées » qui sont censées l’exprimer. Les mots justes seraient d’un grand secours. Mais, plus encore, un don pour lire la réalité — l’élan de tourner son visage aimant vers elle et de presser ses mains contre elle. »
Il s’agit d’un roman à clef (Ravelstein est le philosophe Allan Bloom, ami de l’auteur), en partie autobiographique (on y trouve des portraits de femmes de Saul Bellow), mais cette face cachée de l’œuvre m’échappe largement dans cette publication en français sans appareil critique (il semble y avoir de nombreuses allusions, comme avec le Bloomsbury Group). Sinon, c’est un roman du cercle universitaire (comme L'hiver du doyen), et de celui du passé plombé des juifs (qui augure de Philip Roth notamment), mais qui ne vaut pas Herzog à mes yeux.
\Mots-clés : #amitié #antisémitisme #autobiographie #biographie #communautejuive #mort #pathologie #portrait #vieillesse #xxesiecle
- le Dim 3 Mar - 11:21
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Saul Bellow
- Réponses: 8
- Vues: 221
William H. Gass
Sonate cartésienne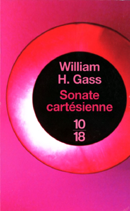
Le texte éponyme :
« Ceci est l’histoire d’Ella Bend Hess, de la façon dont elle est devenue extralucide, et de ce qu’elle a pu voir. »
Dans la première partie, un auteur phrase et divague oisivement, notamment sur l’écriture, et la description de ses personnages.
« …] traçant un des secrets de sa vie sur le mur ou dans la lunette des cabinets, pas toujours quelque chose de bas ou de vulgaire, d’ailleurs, car après tout c’est la forme et non le contenu qui importe [… »
« Sauf quand j’aurai mal, ceci sera votre histoire. Alors, bien que les qualités physiques d’une dame, disons une dame pour le moment, existent en tant qu’unité et apparaissent pour l’essentiel de la même façon, sa description, dans la mesure où elle doit former une séquence de mots, dispose ces qualités pour la compréhension du lecteur, de sorte qu’elle apparaît au regard à la manière d’un navire lointain, petit bout par petit bout. Sa description peut être dessinée avec des lignes droites ou des zigzags, des courbes ou un nuage de petits points discrets mais, quelle que soit la géométrie, l’auteur, pour autant qu’il comprend la nature de son art et en a la capacité, composera une image à partir des inflexions fournies à notre attention qui non seulement seront aussi passionnantes qu’une aventure narrée par le détail, mais constitueront aussi, lorsque le lecteur saisit l’ensemble comme il saisit un thème musical, un drame du passage de l’esprit, son début, son milieu et sa fin y compris, reconnaissance et renversement inclus, l’art de l’auteur l’exigerait-il ; et ce qui peut être vrai de la description physique d’une dame peut être vrai de l’arrangement de n’importe quel ensemble de mots, même si le but de cet arrangement peut être plus difficile à discerner, les liens plus subtilement établis. […]
Ce sont précisément des considérations de cette sorte qui distinguent l’attitude de l’artiste envers le langage de celle des autres ; c’est l’intensité de son souci qui est la mesure de son engagement, leur multiplication qui révèle la grandeur de sa vision ; et c’est l’effet de pareils scrupules, lorsqu’ils réussissent à prendre corps, que ce soit avec la facilité d’un génie débordant ou au prix des douleurs d’un talent allié à l’ambition, que de faire s’élever une fiction, ou toute autre œuvre de création, de ce qui serait sous tous autres rapports un lieu commun, à la hauteur du beau. »
« Quand Dieu écrivit sur le mur de Belschatsar, le critique Daniel décida que les mots énigmatiques signifiaient « compté compté pesé et divisé », et qu’ils voulaient dire que le règne du roi avait été jugé insatisfaisant, et que sa terre devait être divisée. Mais ici, plutôt que d’un jugement, il s’agit d’une injonction : écrivain lecteur, pesez deux fois chaque chose, veillez à ce que tout compte, et séparez-vous de votre écriture lecture à la manière dont un serpent se débarrasse de sa peau, en gardant également à l’esprit qui vous êtes, écrivain lecteur – vous êtes la mue, et le texte qui vous est commun est le serpent luisant et rusé. »
Dans la seconde partie, Ella elle-même rend compte d’une sorte d’hyperesthésie de l'ouïe, et d’une métamorphose tératologique.
« L’espace n’était pas de l’espace pour Ella, c’était des signaux. Tout émettait quelque chose : une fleur son parfum, une chauve-souris son bip, une lime sa rugosité, un citron son acidité, une fille sa magnificence, une rue d’été sa chaleur d’été, chaque muscle son mouvement ; l’espace fait plus de vagues que l’océan : rayons X, transmissions radiophoniques et télévisuelles, conversations sur walkie-talkie, messages de téléphone de voiture, ultraviolets, micro-ondes, cosmitudes en tous genres, gosses qui se causent avec des boîtes de conserve, radiations des lignes à haute tension, boîtes à signaux, transistors et transformateurs, infinillions de pièces électroniques suintant l’information, tremblements de la terre, avions à réaction, autres sillages, autres vents ; mais au-delà de tout ça, et de surcroît, l’odeur dit sucre, le bip dit victime, le rugueux émet un avertissement râpeux, l’amertume stimule la salivation, cette magnificence mérite turgescence, ou au moins d’éveiller l’intérêt, la chaleur est sa propre menace, et le mouvement témoigne d’une volonté ; pendant ce temps l’odeur qui voulait dire sucre pour l’abeille lui enduit le flanc de pollen, chaque victime que mange la chauve-souris signifie que moins d’insectes mordront cette cuisse tant admirée ; il est de plus écrit qu’on n’évite une bagarre que pour tomber dans une autre, que le citron fait passer la salade dans une bouche qui mâche jusque dans un estomac où les vitamines sont diffusées comme des informations ou des messages publicitaires, le pénis qui a eu son plaisir, à supposer un tel résultat, peut causer une grossesse inattendue – peut-être, dans ce cas précis, s’agit-il d’un déséquilibre entre cause et conséquence –, des pieds échauffés recherchent l’ombre là où l’herbe qui pointe tant bien que mal se fait piétiner, et la volonté frustrée s’acharne péniblement à atteindre une fois de plus un but remis à plus tard ; de sorte que parfum, surface, acidité, son, vision, sexe, la chaleur du monde, la volonté des hommes ne sont que médiocre crincrin de violoniste des rues parmi tous ces messages, une fête riquiqui sous pareille avalanche de confettis ; car chaque petite alvéole d’un morceau de métal alvéolé hurle, et les plantes s’imprègnent doucement de leurs propres jus jusqu’à la musique, et le duvet des oiseaux murmure dans un autre registre ce que l’oiseau recèle en son cœur. »
Dans la troisième et dernière partie bartlebyennement intitulée J’aimerais autant pas), son mari, l’auteur, parle d’elle avec rancœur.
Avec le compte rendu de ces états d’âme et flux de conscience, ce texte me paraît être une prolongation de l’Ulysse de Joyce, ne dédaignant pas la vulgarité, riche en innovation formelle et notamment lexicale.
Chambres d’hôtes
C’est cette fois de Walt Riff (Walter Riffaterre), comptable itinérant (et véreux), dont on suit le monologue tandis qu’il examine de vieux livres dans sa « chambre de motel ringarde », et songe à « maman », à certaines Eleanor et Kim, et à son ancienne secrétaire Miz Biz. Le lendemain, sa chambre d’hôtes est totalement différente, un havre bourré de souvenirs familiaux, précieusement décoré et kitsch, qu’il ne se résigne pas à quitter.
« La télé, s’il l’allumait, lui proposerait des images pareilles à de la tourte sous cellophane, l’appareil se souciant aussi peu de sa fonction que le dessert s’intéresse au comptoir de Formica sur lequel il attend le client. »
« Une lumière conçue dans des globes gravés et peints traversait en dansant le plissé des voilages pour baigner de confort la pièce et tous ses aménagements. Le tapis de cheviotte bleu pâle semblait la boire. Il existait un nom pour ce genre de tapis, mais Riff n’arrivait pas à le retrouver. C’était là tout un univers auquel il était étranger. »
« Il éprouvait ce besoin de noms. Son œil, une fois qu’il s’était mis enfin à regarder les choses, s’était fait littéral. »
Même procédé que dans le texte précédent, avec plaisanteries intimes, recherche du mot juste, description minutieuse des lieux (qui m’a ramentu le Nouveau Roman).
Emma s’introduit dans une phrase d’Élizabeth Bishop
Emma Bishop est une maigre vieille fille qui se ressouvient de sa misérable enfance (son père la dénigrait physiquement), au cours de laquelle elle lisait sous son frêne (qui va être abattu) ; elle évoque la vie et l’œuvre d’Elizabeth Bishop et Marianne Moore, poètes (et amantes), mais aussi Edith Sitwell et Emily Dickinson. Solitaire dans sa ruralité, vivant à peine, elle tue les mouches, crée des babioles pour exister. Peu à peu elle se détache du monde, voire de la poésie, de façon de plus en plus bizarre et dramatique.
« Comme les autres Emmas avant moi, je lisais sur l’amour à la lumière d’une demi-vie, et l’ombre de sa moitié absente donne de la profondeur à la page. »
Poétique et avec de nouveau beaucoup d’inventivité formelle, ce texte m’a cette fois remis en mémoire Virginia Woolf.
Le maître des vengeances secrètes
Luther Penner cultive de discrètes et mesquines vengeances depuis un âge puéril, et en fait un système théologique inspiré de la loi du talion, développant une rhétorique basée sur l’histoire de l’antiquité au cinéma nord-américain en passant par la Bible et Shakespeare (entr’autres auteurs).
« Il nous faut écarter, avec le plus grand respect, naturellement, la vision exagérément linéaire qu’a Descartes de l’explication rationnelle, parce que les révélations résultent rarement de l’escalade d’une échelle par l’esprit, chaque barreau bien net et bien placé gravi par un pied puis par l’autre comme un pompier en opération de sauvetage ; elles s’accomplissent plutôt à la manière indirecte dont la crème remonte à la surface d’un carton de lait : le petit-lait coule partout vers le fond alors que dans le même temps d’innombrables globules de graisse se libèrent et glissent vers le haut, chacun seul de son côté, aussi indépendant des autres que les monades de Leibniz, jusqu’à ce que, progressivement, presque sans qu’on s’en aperçoive, les globules en question forment une masse qui submerge le lait bleu alors que la crème douce couronne la surface, qui attend qu’on l’écrème. »
« C’est peut-être à cause de la façon dont on les élève, mais il semble que les gosses, dans notre société, on s’attende à ce qu’ils déçoivent leurs parents en ne réussissant pas à « concrétiser » telle ou telle attente, en prenant une orientation qu’on ne voulait pas leur voir prendre, ou en embrassant des valeurs et des opinions parfaitement insupportables. »
« Je pense que nous nous traitons mutuellement comme des imbéciles parce que nous avons acquis, à force d’entraînement, la parfaite compétence qui nous permet à la fois d’être des imbéciles et de traiter les autres comme tels, de sorte que nous méritons les insultes qui nous grêlent sur la tête. »
« Donc : les vengeances secrètes sont secrètes dès lors qu’elles ne sont pas perçues comme représailles par leur victime, qui vit avec une claudication qu’elle apprend à considérer comme normale ; et elles deviennent transcendantales lorsque même celui qui les inflige est ignorant de la nature de son acte. La transmission d’idées stupides, par exemple. Ou la création d’illusions absolues avec une parfaite sincérité, lorsqu’il ne s’agit plus de mensonges mais de notions fallacieuses servies sur des plats de porcelaine et mangées avec des couverts en argent. »
« Je pense plutôt que Luther Penner nous a apporté une métaphysique, caustique, assurément, mais magnifique : la vie perçue non pas simplement comme si elle était vécue dans un tourbillon de mythes en conflit et en concurrence, mais comme si elle était habillée d’illusions délibérément conçues par ceux qui, ayant été précédemment égarés, prennent ainsi leur revanche comme seuls peuvent secrètement le faire des ennemis secrets. Combien, dans notre propre maison ou notre propre quartier – pour ne considérer qu’un échantillon réduit –, ont-ils été trahis par des ismes et des logies d’une espèce ou d’une autre, ont donné de l’argent pour des causes démentes, et gaspillé une énorme partie du temps précieux de leur vie en vaines quêtes spirituelles ? »
Sur le mode humoristique, parfois d’une causticité politiquement incorrecte, toujours avec des comparaisons percutantes, c’est une belle analyse de l’esprit tordu, voire du complotiste parano, des dérives évangéliques et de l’avènement de l’ère post-vérité, éclairés fort tôt avant leurs récents développements, d’abord états-uniens.
Quatre nouvelles (voire novellas) qui démontrent (au minimum) une façon d’écrire assez expérimentale (mais restant fort lisible), c'est-à-dire hors de l’ornière ordinaire.
\Mots-clés : #contemporain #creationartistique #ecriture #nouvelle #portrait
- le Ven 15 Déc - 11:03
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William H. Gass
- Réponses: 4
- Vues: 411
David Grann
La Cité perdue de Z – Une expédition légendaire au cœur de l’Amazonie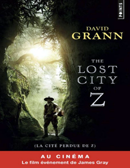
Le colonel Percy Harrison Fawcett est disparu en 1925 lors d’une expédition amazonienne, parti à la recherche d’une cité perdue. Il avait déjà, en 1906-1907, établi une cartographie de la frontière entre le Brésil et la Bolivie pour la Société royale de géographie. Intrépide et apparemment invincible, il multiplie les explorations du proverbial « enfer vert » – finalement l’image ne me paraît pas totalement erronée, surtout vécue dans les conditions de l’époque. Quoique empêtré dans ses convictions victoriennes élitistes et racistes, il ne se borne pas à suivre les principaux cours d’eau mais s’enfonce à pied en forêt, et approche ainsi des tribus indiennes inconnues, dont il reconnaît la culture et le savoir-faire (en bref des civilisés) dans une approche qui annonce l’anthropologie moderne.
Mais c’est le mythique El Dorado des conquistadors qui obsède surtout Fawcett, qu’il appelle la cité perdue de Z.
En 1911, Hiram Bingham découvre les ruines incas de Machu Picchu. En 1913/1914, l’ex-président Théodore Roosevelt et Cândido Rondon, orphelin d’origine indienne devenu le colonel brésilien qui fondera le Service de protection des Indiens, explorent la rivière du Doute.
Pour son ultime expédition, Fawcett a été approché par le colonel T. E. Lawrence, mais préfère emmener son fils Jack et l’ami de ce dernier, Raleigh ; il manque de fonds, est devenu adepte du spiritisme et craint d’être devancé, cependant ils parviennent à partir dans le Mato Grosso. Fawcett emporte une idole de pierre, cadeau de Henry Rider Haggard (auteur de Les Mines du roi Salomon et She)…
David Grann, journaliste néophyte en la matière, raconte comment il suit ses traces en 2004 pour enquêter sur le terrain (comme tant d’autres, dont des dizaines ne revinrent jamais) ; il expose comme les dernières recherches archéologiques rendent compte d’une société qui a su se développer dans ce milieu avant d’être éradiquée par les maladies importées.
Brian, le fils cadet de Fawcett, présente les carnets de route et journaux intimes de son père dans Le continent perdu. Sir Arthur Conan Doyle, ami de Fawcett, fait de son histoire le cadre de son roman Le Monde perdu. J’ai eu une pensée pour Les Maufrais (père et fils). Autant de livres qui alimentèrent mon imaginaire depuis l’adolescence...
\Mots-clés : #amérindiens #aventure #biographie #contemythe #historique #lieu #nature #portrait #voyage
- le Mar 5 Déc - 11:36
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: David Grann
- Réponses: 15
- Vues: 1739
Alejo Carpentier
Le Recours de la méthode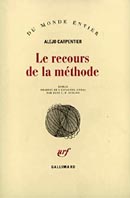
À Paris, au début du XXe, le Premier Magistrat, autocrate d’un pays andin, apprend que s’est déclarée une nouvelle insurrection d’une partie de l’armée ; après avoir joint son fils Ariel, ambassadeur à Washington, il se met en campagne avec son secrétaire le docteur Peralta et le colonel Hoffmann, puis mate les rebelles dans le sang.
Reparti à Paris, il apprend que cette fois c’est Hoffmann qui tente de prendre le pouvoir.
« C'est dans une semblable région qu'il lui faudrait poursuivre le général Hoffmann, l'assiéger, le traquer, et enfin le placer le dos au mur d'un couvent, d'une église ou d'un cimetière, et le passer par les armes. « Feu ! » Il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'était la règle du jeu. Recours de la Méthode. »
Mais il n’a pas besoin de faire fusiller le séditieux, qui meurt enseveli par des sables mouvants.
« Quand on ne vit plus flotter que le képi, l'un des spectateurs jeta sur ce dernier un petit crucifix, vite englouti par le bourbier, à présent revenu à sa glauque quiétude. »
Pour contrer le militaire germanophile (la Première Guerre mondiale vient d’éclater, et apportera la prospérité économique au pays) et renouveler le contenu de ses discours "patriotiques" (les notions de liberté et autres valeurs ayant perdu tout sens) le Premier Magistrat prône le métissage créole, zambas (zambos, ou métis de Noirs et d’Amérindiens) ou mulâtres (pas trop foncés quand même) et les vertus latines, notamment la Vierge Marie (qu’il révère superstitieusement) : la civilisation gréco-romaine contre la barbarie germanique.
Puis il rencontre l’Étudiant, un communiste.
« Mais celui d’En Haut, pragmatique à sa façon et connaissant bien le milieu, avait pris dans la hâte de son impatience la voie ascendante que jalonnaient à présent ses bustes et ses statues ; celui d’En Bas était tombé dans le piège d’un messianisme d’un nouveau genre, qui sur tout le continent, par un fatal processus, conduisait le naïf aux Sibéries des Tropiques, à la piètre gloire du Bertillon ou, dénouement dont les journalistes de l’avenir feraient le thème de leurs articles, à la disparition qui-ne-laisse-pas-de-traces : les familles de la victime, volatilisée, devraient déposer des fleurs, en des dates anniversaires supposées, sur des tombes sans objet, avec un prénom et un nom inscrits sur la tristesse, pire encore que celle d’un cercueil, d’une fosse vide... »
Une fois la guerre terminée, la ruine économique provoque une crise qui intensifie le chaos dans le pays, en butte notamment à une grève générale organisée par l’Étudiant.
« Tout cela confinait de plus en plus le Premier Magistrat dans une île ; cette île avec des tours de guet, des miradors, de nombreuses grilles et une parure de palmiers symétriquement alignés, qu'était le palais présidentiel, où parvenaient tant de nouvelles confuses, contradictoires, fausses ou vraies, optimistes ou poussées au noir, qu'il était impossible de se faire une idée claire, générale, chronologique, de ce qui se passait réellement. Celui qui voulait minimiser la portée d'une défaite, ôtait de l'importance à l'événement, et parlait de rencontres avec des hors-la-loi et des voleurs de bestiaux alors qu'il s'était heurté à une véritable force populaire ; tel autre qui voulait justifier son impuissance, exagérait la force des adversaires ; ou s'il voulait dissimuler les lacunes de son information, escamotait la véritable situation. »
Finalement abandonné de tous, y compris de Peralta, sauf de sa gouvernante, et de l’étrange agent consulaire yankee amateur de racines (les marines ont débarqué), « L’Ex » Premier Magistrat retrouve son havre parisien, redécoré aux goûts modernes par sa fille Ofélia ; il emploie le je, et semble être (devenu) le narrateur. Plus que jamais « métèque », il sera maintenant dépassé par le temps.
Ce récit vaut surtout pour le lyrisme baroque des descriptions, notamment du monde créole et de l’extravagance rococo en architecture.
« C'était une maison qui faisait penser à la fois au style balkanique et à celui de la rue de la Faisanderie, avec des cariatides 1900, vêtues à la Sarah Bernhardt, qui grâce à la magique résistance de leurs chapeaux garnis de plumes supportaient mieux qu'un atlante de palais berlinois, un vaste balcon-terrasse fermé par des balustres en forme d'hippocampes. Une tour-mirador-phare dont les majoliques jaspées jetaient un perpétuel éclat dominait les toits en terrasse. »
Chaque chapitre et sous-chapitre est introduit par une citation de Descartes, dont la pensée structurée s’oppose à l’exubérance tropicale.
« C'est que, selon lui, l'esprit cartésien n'étant pas notre fort (et c'est vrai : dans le Discours de la méthode on ne voit pas pousser des plantes carnivores, ni voler des toucans, ni souffler des cyclones...) nous prisons exagérément l'éloquence débordante, le pathos, la pompe du tribun toute pétrie d'emphase romantique... Légèrement froissé – notre ami ne peut s'en rendre compte – par un jugement qui blesse au vif ma conception de la nature de l'éloquence (celle-ci est pour nous d'autant plus efficace qu'elle est plus touffue, sonore, ampoulée, cicéronienne, que ses images sont plus imprévues, ses épithètes plus incisives, ses crescendos plus irrésistibles...) [… »
Avec sa profusion érudite, le baroquisme stylistique de Carpentier correspond au foisonnement de la nature, de la musique et des sons, des odeurs, de la cuisine, comme de la surabondance de l’ornementation liturgique.
« Ici en revanche, à cette heure même, les forêts vierges chevauchaient les forêts vierges, les estuaires changeaient de place, les fleuves abandonnaient leurs lits du soir au matin et empruntaient d'autres cours, tandis que vingt villes construites en un jour, passant de la cahute en pisé à la demeure de marbre, du taudis au palais, de la complainte du chanteur des rues à la voix d'Enrico Caruso, tombaient subitement en ruine, lépreuses, abandonnées dès l'instant où un gisement de salpêtre avait cessé d'intéresser le monde, où la fiente de certains oiseaux marins qui enneigeait les récifs de ses flocons laiteux, avait cessé d'être cotée en Bourse, une Bourse fiévreuse, toute bruyante d'enchères et de surenchères, parce que des chimistes allemands avaient trouvé au fond d'une éprouvette le moyen de la remplacer... »
« Car c'étaient des terres de forêts, sur des flancs de montagnes toujours enveloppées de brouillard, estompées par des brumes qui se dissipaient ici quand elles s'épaississaient plus loin, laissant s'infiltrer le soleil quelques minutes par-ci par-là, par une brèche du ciel – pour éclairer la superbe ignorée de fleurs sans nom, grimpées sur les cimes des arbres impénétrables, ou magnifier inutilement, puisque personne ne la verrait, une splendide éclosion d'orchidées sur le toit de la sylve ; terres de forêts où sur des acajous, des jucaros, des cèdres et des quebrachos, et des essences si nombreuses et si rares qu'elles prenaient en défaut les classifications traditionnelles – elles avaient déconcerté Humboldt lui-même –, tombaient des pluies telles que les hommes, devinant leur approche par une odeur venue de loin, avaient l'impression d'entrer dans une année de sept mois, comprise avec son propre cycle dans une année de douze, et qui ne connaissait que deux saisons : l'une courte, empire de la moisissure, aux gestations précipitées, et l'autre longue, pluvieuse, mère d'un ennui sans limite. Lorsque retentissait le dernier coup de tonnerre de la saison, une nouvelle vie commençait – nouvelle étape, nouveau saut en avant – dans une végétation si humide et si empêtrée en son humidité qu'elle semblait engendrée par les lagunes et les marécages de la contrée, où coassaient inlassablement les grenouilles, grouillants de crapauds, irisés par les bulles errantes de pourritures englouties... »
« Le gros bourdon de la cathédrale se mit à sonner des coups solennels et rythmés. Et comme si sur l’œuvre primitive d’un gigantesque fondeur de cloches, eût retenti un énorme marteau père de cloches-filles, de filles-cloches, répondirent les clochettes vierges, au son aigu, jamais fêlées, de l’ermitage de la Paloma, juché sur les hauteurs, aux frontières neigeuses du Volcan Tutélaire. Leurs voix furent reprises par le soprano de Saint-Vincent de Río Frío, le baryton des petites sœurs de Saint-Joseph-de- Tarbes, le registre aigu du carillon des Jésuites, le contralto de Saint-Denis, la basse profonde de Saint-Jean-de-Latran, les notes argentines du sanctuaire de la Vierge Mère. Alors éclata une fête de sons, de gammes, d’appels, de tintements, d’accords joyeux. Des sonneurs de cloches et des enfants de chœur, des séminaristes et des capucins, malins et agiles, étaient suspendus aux cordes, montaient et descendaient, les jambes écartées, gigotaient dans les airs, remontaient d’un coup de talon, pour s’élever en un va-et-vient incessant au rythme du scandale du ciel, dans le grand puits sonore des clochers. Concerto du nord au sud, symphonie d’est en ouest, enveloppant la ville dans une prodigieuse polyphonie de pendules, de battements et de percussions, tandis que les sirènes des usines, les klaxons des automobiles, les poêles frappées avec des cuillères, les casseroles, les boîtes de conserve, tout ce qui pouvait faire du bruit, résonner, produire un vacarme assourdissant, élevait son tintamarre au-dessus des rues étroites de la vieille ville ou des nouvelles et larges avenues asphaltées. À présent les locomotives sifflaient, les voitures de pompiers hululaient, les sonneries de tramways vibraient avec une résonance de cuivre. »
« L’agent consulaire me montre à présent une curieuse collection de racines-sculptures, de sculptures-racines, de racines-formes, de racines-objets – racines baroques ou d’aspect sévère, avec leur surface polie ; compliquées, enchevêtrées, ou noblement géométriques ; dansantes, parfois, parfois statiques, ou totémiques, ou sexuelles, mi-animal, mi-théorème, jeu de nœuds, d’asymétries, tantôt vivantes, tantôt fossiles – que le yankee dit avoir recueillies au cours de ses nombreuses randonnées sur les côtes du continent. Racines arrachées à leurs sols lointains, entraînées en un flux et reflux incessant par les cours d’eau en crue ; racines sculptées par l’eau, culbutées, polies, patinées, argentées, désargentées, qui à force de tant voyager, secouées, se heurtant aux rochers, se cognant à d’autres souches charriées par les eaux, finissaient par perdre leur morphologie végétale ; détachées de l’arbre-mère, arbre généalogique, elles présentaient des rondeurs de seins, des arêtes de polyèdre, des têtes de sangliers, des faces d’idoles, des dentures, des crocs, des tentacules, des phallus, et des couronnes, elles se mariaient en d’obscènes imbrications, avant d’échouer, au terme de voyages séculaires, sur quelque plage que les cartes ignoraient. »
La satire, quoiqu’elle dépasse celle du dictateur (comme avec l'Académicien français admirateur de Gobineau), regroupe les constantes chez les tyrans : rapports ambigus avec la puissance des « Amerloques », manipulations constitutionnelles en vue de réélection, fortune bâtie sur la corruption, projets monumentaux mégalomanes (Capitole, prison modèle), éloquence oratoire, élimination physique des opposants, résidence (et soins médicaux) à l’étranger, etc.
Portrait générique du dictateur sud-américain auquel se sont adonnés plusieurs écrivains majeurs de l’Amérique latine, celui-ci est peut-être un peu plus sympathique que les autres, déchiré entre l’« ici » et le « là-bas », alternativement Paris et son pays. Passionné d’art, opéra et peinture occidentale principalement, le Premier Magistrat est fasciné par la civilisation raffinée de l’ancien monde (beaucoup d’allusions à l’univers proustien : Vinteuil, Verdurin, etc.), et curieusement cultivé pour un despote sanguinaire.
\Mots-clés : #portrait #regimeautoritaire
- le Lun 9 Oct - 16:59
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Alejo Carpentier
- Réponses: 16
- Vues: 1728
João Guimarães Rosa
Diadorim
Le titre original est Grande Sertão : veredas. Le sertão désigne les vastes régions semi-arides de l’intérieur du Brésil, où une population clairsemée vit surtout de l’élevage ; les chapadas, plateaux désertiques, sont parsemées de veredas, verdoyantes dépressions où l’eau se concentre, et donc la vie.
Riobaldo, surnommé Tatarana, ancien jagunço devenu fazendeiro (propriétaire d’une fazenda, ou vaste ferme), évoque devant le narrateur sa vie passée dans le sertão (les jagunços sont les hommes de main des fazendeiros, vivant en bandes armées et se livrant au brigandage, aussi considérés comme des preux).
« Vous le savez : le sertão c’est là où est le plus fort, à force d’astuces, fait la loi. Dieu lui-même, quand il s’amènera, qu’il s’amène armé. Et une balle est un tout petit bout de métal. »
« J’ai ramé une vie libre. Le sertão : ces vides qu’il est. »
« Le sertão est bon. Tout ici se perd ; tout ici se retrouve… disait le sieur Ornelas. Le sertão c’est la confusion dans un grand calme démesuré. »
Le sertão est hostile, mais a ses beautés, et les descriptions qui en sont données constituent un intérêt supplémentaire. À ce propos, l’emblématique buruti, c’est le palmier-bâche qui vit les pieds dans l’eau, le bem-te-vi, c’est le quiquivi, oiseau également fréquent en Guyane.
Riobaldo, comme beaucoup, ne connaît pas son père (en fait, à la mort de sa mère, il est recueilli par son parrain, qui serait son géniteur).
« L’homme voyage, il fait halte, repart : il change d’endroit, de femme – ce qui perdure c’est un enfant. »
Riobaldo parle de ses pensées qui l’obsèdent à propos du démon (qui a d’innombrables noms, dont « celui-qui-n’existe-pas ») : peut-on faire pacte avec lui ? Il parle aussi de Diadorim, son ami et amour, et des femmes qu’il aime. Il digresse, reprend le fil de son monologue : il évoque leur lieutenant, Medeiro Vaz, qui brûla sa fazenda, éparpilla les pierres de la tombe de sa mère pour aller mener une guerre de justice dans les hautes-terres, et leurs ennemis, les deux Judas félons (Hermὀgenes, protégé des enfers, et Ricardo) qui ont tué Joca Ramiro (père de Diadorim), et les soldats qui les combattent, et Zé Bebelo, stratège enjoué qui rêve de batailles et d’être député, puis remplace Medeiro Vaz à sa mort (et de qui Riobaldo fut percepteur, avant d’être dans le camp adverse, ce qui le tourmente). Car ce dernier narre dorénavant son existence depuis son enfance : comment il rencontra Reinaldo et fut séduit (ses amours sont plus généralement féminines, notamment la belle Otacilia, ou encore Norinha), Reinaldo qui lui confie s’appeler Diadorim.
À propos de la sensualité féminine, un passage qui rappelle Jorge Amado dans ses bonnes pages :
« L’une d’elles – Maria-des-Lumières – était brune : haute d’un huitième de cannelier. La chevelure énorme, noire, épaisse comme la fourrure d’un animal – elle lui cachait presque toute la figure, à cette petite mauresque. Mais la bouche était le bouton éclos, et elle s’offrait rouge charnue. Elle souriait les lèvres retroussées et avait le menton fin et délicat. Et les yeux eau-et-miel, avec des langueurs vertes, à me faire croire que j’étais à Goïas… Elle avait beaucoup de savoir-faire. Elle s’occupa aussitôt de moi. Ce n’était pas qu’une petite péronnelle.
L’autre, Hortense, une très gentille oiselle de taille moyenne, c’était Gelée-Blanche ce surnom parce qu’elle avait le corps si blanc ravissant, que c’était comme étreindre la froide blancheur de l’aube… Elle était elle-même jusqu’au parfum de ses aisselles. Et la ligne des reins, courbes ondulantes d’un ruisseau de montagne, confondait. De sorte que sa longueur exacte, vous n’arriviez jamais à la mesurer. Entre elles deux à la fois, je découvris que mon corps aussi avait ses tendretés et ses duretés. J’étais là, pour ce que je sais, comme le crocodile. »
Ce qui vaut surtout, c’est le monologue noté par son auditeur :
« Nous vivons en répétant, et bon, en une minime minute le répété dérape, et nous voilà déjà projetés sur une autre branche. »
Son récit décousu se commente lui-même, et sans doute l’auteur s’exprime-t-il lui-même par moments :
« Je sais que je raconte mal, je survole. Sans rectifier. Mais ce n’est pas pour donner le change, n’allez pas croire. […] Raconter à la suite, en enfilade, ce n’est vraiment que pour les choses de peu d’importance. De chaque vécu que j’ai réellement passé, de joie forte ou de peine, je vois aujourd’hui que j’étais chaque fois comme s’il s’agissait de personnes différentes. Se succédant incontrôlées. Tel je pense, tel je raconte. […] Et ce que je raconte n’est pas une vie d’homme du sertão, aurait-il été jagunço, mais la matière qui déborde. »
Riobaldo n’a jamais connu la peur, mais…
« Je sentis un goût de fiel sur le bout de ma langue. La peur. La peur qui vous coince. Qui me rattrapa au tournant. Un bananier prend le vent par tous les bords. L’homme ? C’est une chose qui tremble. Mon cheval me menait sans échéance. Les mulets et les ânes de la caravane, Dieu sait si je les enviais… Il y a plusieurs inventions de peur, je sais, et vous le savez. La pire de toutes est celle-ci : qui d’abord vous étourdit, et ensuite vous vide. Une peur qui commence d’emblée par une grande fatigue. Là où naissent nos énergies, je sentis qu’une de mes sueurs se glaçait. La peur de ce qui peut toujours arriver et qui n’est pas encore là. Vous me comprenez : le dos du monde. […] Je n’y arrivais pas, je ne pensais pas distinctement. La peur ne permettait pas. J’avais la cervelle embrumée, la tête me tournait. Je bus jusqu’à la lie le passage de la peur : je traversais un grand vide. »
« La peur manifeste provoque la colère qui châtie ; c’est bien tout ce à quoi elle sert. »
Le ton est celui du langage populaire, volontiers proverbial, traversé de fulgurances condensées voire lapidaires, très inventives et souvent poétiques, à l’encontre d’une rédaction rationnelle et claire. Allers-retours dans le temps de la remémoration (étonnamment riche, précise et détaillée), à l’instar des chevauchées et contre-marches de la troupe.
« Veuillez m’excuser, je sais que je parle trop, des à-côtés. Je dérape. C’est le fait de la vieillesse. Mais aussi, qu’est-ce qui vaut et qu’est-ce qui ne vaut pas ? Tout. Voyez plutôt : savez-vous pourquoi le remords ne me lâche pas ? Je crois que ce qui ne le permet pas c’est la bonne mémoire que j’ai. »
« Ah, mais je parle faux. Vous le sentez ? Si je démens ? Je démens. Raconter est très, très laborieux. Non à cause des années, passées depuis beau temps. Mais à cause de l’habileté qu’ont certaines choses passées – à faire le balancier, à ne pas rester en place. Ce que j’ai dit était-il exact ? Ça l’était. Mais ce qui était exact a-t-il été dit ? Aujourd’hui je crois que non. Ce sont tant d’heures passées avec les gens, tant de choses arrivées en tant de temps, tout se découpant par le menu. »
« Non, nenni. Je n’avais aucun regret. Ce que j’aurais voulu, c’était redevenir enfant, mais là, dans l’instant, si j’avais pu. J’en avais déjà plus qu’assez de leurs égarements à tous. C’est qu’à cette époque je trouvais déjà que la vie des gens va à vau-l’eau, comme un récit sans queue ni tête, par manque de joie et de jugement. La vie devrait être comme dans une salle de théâtre, et que chacun joue son rôle avec un bel entrain du début à la fin, qu’il s’en acquitte. C’était ce que je trouve, c’est ce que je trouvais. »
« Nous sommes des hommes d’armes, pour le risque de chaque jour et toutes les menues choses de l’air. »
« Mais les chemins sont ce qui gît partout sur la terre, et toujours les uns contre les autres ; il me revient que les formes les plus fausses du démon se reproduisent. Plus vous allez m’entendre, plus vous allez me comprendre. »
« On ne se met pas en colère contre le boa. Le boa étranglavale, mais il n’a pas de venin. Et il accomplissait son destin, tout réduire à un contenu. »
« La vie en invente ! On commence les choses, à l’obscur de savoir pourquoi, et dès lors le pouvoir de les continuer, on le perd – parce que la vie est le boulot de tous, triturée, assaisonnée par tous. »
« Tout cela pour vous, mon cher monsieur, ne tient pas debout, n’éclaire rien. Je suis là, à tout répéter par le menu, à vivre ce qui me manquait. Des choses minuscules, je sais. La lune est morte ? Mais je suis fait de ce que j’ai éprouvé et reperdu. De l’oublié. Je vais errant. Et se succédèrent nombre de petits faits. »
« Je sais : qui aime est toujours très esclave, mais ne se soumet jamais vraiment. »
« Qui le sait vraiment ce qu’est une personne ? Compte tenu avant tout : qu’un jugement est toujours défectueux, parce que ce qu’on juge c’est le passé. Eh, bé. Mais pour l’écriture de la vie, juger on ne peut s’en dispenser ; il le faut ? C’est ce que font seuls certains poissons, qui nagent en remontant le courant, depuis l’embouchure vers les sources. La loi est la loi ? Mensonge ! Qui juge, est déjà mort. Vivre est très dangereux, vraiment. »
La dernière phrase revient comme un leitmotiv dans le récit de Riobaldo :
« Vivre est très dangereux, je vous l’ai déjà dit. »
Apprécié en tant que bon tireur, Riobaldo parcourt donc le sertão qu’il aime, malgré les vicissitudes de cette existence itinérante, chevauchant de peines en batailles. Il médite sans cesse, sur la vie, l’amour, et par un curieux défi, dans sa haine d’Hermὀgenes qui aurait signé un pacte avec « l’Autre », décide d’en faire un lui aussi, bien qu’il ne croie ni à cette puissance maléfique, ni même à l’âme. Le démon ne se présente pas à la « croisée des chemins de Veredas-Mortes ».
« Alors, je ne sais ou non si j’ai vendu ? Je vous le dis : ma peur c’est ça. Tous la vendent, non ? Je vous le dis : de diable il n’y en a pas, le diable n’existe pas, et l’âme je la lui ai vendue… Ma peur, c’est ça. À qui l’ai-je vendue ? C’est ça, monsieur, ma peur : l’âme, on la vend, c’est tout, sans qu’il y ait acheteur… »
Cependant Riobaldo change. Lui, pour qui il n’était pas question de commander, devient le chef, Crotale-Blanc. Il reprend avec succès la traversée du Plan de Suçuarão, où avait échoué Medeiro Vaz, pour prendre à revers la fazenda d’Hermὀgenes.
Il y a encore les « pacants », rustres paysans croupissant dans la misère, victimes d’épidémies et des fazendeiros obnubilés par le profit, ou Siruiz, le jagunço poète, dont Riobaldo donne le nom à son cheval, ou encore le compère Quelémém, de bon conseil, évidemment Diadorim qu'il aime, et nombre d'autres personnages.
Ce livre-monde aux différentes strates-facettes (allégorie de la condition humaine, roman d’amour, épopée donquichottesque, geste initiatique – alchimique et/ou mythologique –, combat occulte du bien et du mal, cheminement du souvenir, témoignage ethnographique, récit de campagnes guerrières, etc.) est incessamment parcouru d’un souffle génial qui ramentoit Faust, mais aussi Ulysse (les deux).
Il est encore dans la ligne du fameux Hautes Terres (Os Sertões) d’Euclides da Cunha, par la démesure de la contrée comme de ceux qui y errent. L’esprit épique m’a aussi ramentu Borges et son exaltation des brigands de la pampa.
Sans chapitres, ce récit est un fleuve formidable dont le cours parfois s’accélère dans les péripéties de l’action, parfois s’alentit dans les interrogations du conteur : flot de parole, fil de pensée, flux de conscience. Et il vaut beaucoup pour la narration de Riobaldo ou, autrement dit, pour le style (c’est la façon de dire) rosien.
Le texte m’a paru excellemment rendu par la traductrice (autant qu’on puisse en juger sans avoir recours à l’original) ; cependant, il semble être difficilement réductible à une traduction, compte tenu de la langue créée par Rosa, inspirée du parler local et fort inventive.
\Mots-clés : #amour #aventure #contemythe #criminalite #ecriture #guerre #historique #initiatique #lieu #mort #nature #philosophique #portrait #ruralité #spiritualité #voyage
- le Ven 22 Sep - 13:06
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: João Guimarães Rosa
- Réponses: 26
- Vues: 1539
William Faulkner
Descends, Moïse
Sept récits paraissant indépendants de prime abord, qui mettent en scène des personnages du Sud des USA, blancs, nègres (et Indiens ; je respecte, comme j’ai coutume de le faire, l’orthographe de mon édition, exactitude encore permise je pense). Plus précisément, c’est la lignée des Mac Caslin, qui mêle blancs et noirs sur la terre qu’elle a conquise (les premiers émancipant les seconds). Oppositions raciale, mais aussi genrée sur un siècle, plus de quatre générations dans le Mississipi.
Le titre fait référence à des injonctions du Seigneur à Moïse sur le Sinaï, notamment dans l’Exode. Ce roman est dédicacé à la mammy de Faulkner enfant, née esclave.
Autre temps : apparition de Isaac Mac Caslin, « oncle Ike », et la poursuite burlesque d’un nègre enfui.
Le Feu et le Foyer : affrontement de Lucas Beauchamp et Edmonds, fils de Mac Caslin, qui a pris la femme du premier :
« – Ramasse ton rasoir, dit Edmonds.
– Quel rasoir ? » fit Lucas. Il leva la main, regarda le rasoir comme s’il ne savait pas qu’il l’avait, comme s’il ne l’avait encore jamais vu, et, d’un seul geste, il le jeta vers la fenêtre ouverte, la lame nue tournoyant avant de disparaître, presque couleur de sang dans le premier rayon cuivré du soleil. « J’ai point besoin de rasoir. Mes mains toutes seules suffiront. Maintenant, prenez le revolver sous votre oreiller. » »
« Alors Lucas fut près du lit. Il ne se rappela pas s’être déplacé. II était à genoux, leurs mains enlacées, se regardant face à face par-dessus le lit et le revolver : l’homme qu’il connaissait depuis sa petite enfance, avec lequel il avait vécu jusqu’à ce qu’ils fussent devenus grands, presque comme vivent deux frères. Ils avaient péché et chassé ensemble, appris à nager dans la même eau, mangé à la même table dans la cuisine du petit blanc et dans la case de la mère du petit nègre ; ils avaient dormi sous la même couverture devant le feu dans les bois. »
Péripéties autour d’alambics de whisky de contrebande, et de la recherche d’un trésor. Lucas, bien que noir, a plus de sang de la famille que Roth Edmonds, le blanc, que sa mère a élevé avec lui dès sa naissance. Le même schéma se reproduit de père en fils, si bien qu’on s’y perd, et qu’un arbre généalogique de la famille avec tous les protagonistes serait utile au lecteur (quoique ce flou entre générations soit vraisemblablement prémédité par Faulkner, de même que le doute sur la "couleur" de certains personnages, sans parler des phrases contorsionnées).
« Lucas n’était pas seulement le plus ancien des habitants du domaine, plus âgé même que ne l’aurait été le père d’Edmonds, il y avait ce quart de parenté, non seulement de sang blanc ni même du sang d’Edmonds, mais du vieux Carothers Mac Caslin lui-même de qui Lucas descendait non seulement en ligne masculine, mais aussi à la seconde génération, tandis qu’Edmonds descendait en ligne féminine et remontait à cinq générations ; même tout gamin, il remarquait que Lucas appelait toujours son père M. Edmonds, jamais Mister Zack comme le faisaient les autres nègres, et qu’il évitait avec une froide et délibérée préméditation de donner à un blanc quelque titre que ce fût en s’adressant à lui. »
« Ce n’était pas toutefois que Lucas tirât parti de son sang blanc ou même de son sang Mac Caslin, tout au contraire. On l’eût dit non seulement imperméable à ce sang, mais indifférent. Il n’avait pas même besoin de lutter contre lui. Il ne lui fallait pas même se donner le mal de le braver. Il lui résistait par le simple fait d’être le mélange des deux races qui l’avaient engendré, par le seul fait qu’il possédait ce sang. Au lieu d’être à la fois le champ de bataille et la victime de deux lignées, il était l’éprouvette permanente, anonyme, aseptique, dans laquelle toxines et antitoxines s’annulaient mutuellement, à froid et sans bruit, à l’air libre. Ils avaient été trois autrefois : James, puis une sœur nommée Fonsiba, puis Lucas, enfants de Tomey’ Turl, fils du vieux Carothers Mac Caslin et de Tennie Beauchamp, que le grand-oncle d’Edmonds, Amédée Mac Caslin, avait gagnée au poker à un voisin en 1859. »
« Il ressemble plus au vieux Carothers que nous tous réunis, y compris le vieux Carothers. Il est à la fois l’héritier et le prototype de toute la géographie, le climat, la biologie, qui ont engendré le vieux Carothers, nous tous et notre race, infinie, innombrable, sans visage, sans nom même, sauf lui qui s’est engendré lui-même, entier, parfait, dédaigneux, comme le vieux Carothers a dû l’être, de toute race, noire, blanche, jaune ou rouge, y compris la sienne propre. »
Bouffonnerie noire : Rider, un colosse noir, enterre sa femme et tue un blanc.
Gens de jadis : Sam Fathers, fils d’un chef indien et d’une esclave quarteronne, vendu avec sa mère par son père à Carothers Mac Caslin ; septuagénaire, il enseigne d’année en année la chasse à un jeune garçon, Isaac (Ike).
« L’enfant ne le questionnait jamais ; Sam ne répondait pas aux questions. Il se contentait d’attendre et d’écouter, et Sam se mettait à parler. Il parlait des anciens jours et de la famille qu’il n’avait jamais eu le temps de connaître et dont, par conséquent, il ne pouvait se souvenir (il ne se rappelait pas avoir jamais aperçu le visage de son père), et à la place de qui l’autre race à laquelle s’était heurtée la sienne pourvoyait à ses besoins sans se faire remplacer.
Et, lorsqu’il lui parlait de cet ancien temps et de ces gens, morts et disparus, d’une race différente des deux seules que connaissait l’enfant, peu à peu, pour celui-ci, cet autrefois cessait d’être l’autrefois et faisait partie de son présent à lui, non seulement comme si c’était arrivé hier, mais comme si cela n’avait jamais cessé d’arriver, les hommes qui l’avaient traversé continuaient, en vérité, de marcher, de respirer dans l’air, de projeter une ombre réelle sur la terre qu’ils n’avaient pas quittée. Et, qui plus est, comme si certains de ces événements ne s’étaient pas encore produits mais devaient se produire demain, au point que l’enfant finissait par avoir lui-même l’impression qu’il n’avait pas encore commencé d’exister, que personne de sa race ni de l’autre race sujette, qu’avaient introduite avec eux sur ces terres les gens de sa famille, n’y était encore arrivé, que, bien qu’elles eussent appartenu à son grand-père, puis à son père et à son oncle, qu’elles appartinssent à présent à son cousin et qu’elles dussent être un jour ses terres à lui, sur lesquelles ils chasseraient, Sam et lui, leur possession actuelle était pour ainsi dire anonyme et sans réalité, comme l’inscription ancienne et décolorée, dans le registre du cadastre de Jefferson, qui les leur avaient concédées, et que c’était lui, l’enfant, qui était en ces lieux l’invité, et la voix de Sam Fathers l’interprète de l’hôte qui l’y accueillait.
Jusqu’à il y avait trois ans de cela, ils avaient été deux, l’autre, un Chickasaw pur sang, encore plus incroyablement isolé dans un sens que Sam Fathers. Il se nommait Jobaker, comme si c’eût été un seul mot. Personne ne connaissait son histoire. C’était un ermite, il vivait dans une sordide petite cabane au tournant de la rivière, à cinq milles de la plantation et presque aussi loin de toute autre habitation. C’était un chasseur et un pêcheur consommé ; il ne fréquentait personne, blanc ou noir ; aucun nègre ne traversait même le sentier qui menait à sa demeure, et personne, excepté Sam, n’osait approcher de sa hutte. »
Jobaker décédé, Sam se retire au Grand Fond, et prépare l’enfant à son premier cerf :
« …] l’inoubliable impression qu’avaient faite sur lui les grands bois – non point le sentiment d’un danger, d’une hostilité particulière, mais de quelque chose de profond, de sensible, de gigantesque et de rêveur, au milieu de quoi il lui avait été permis de circuler en tous sens à son gré, impunément, sans qu’il sache pourquoi, mais comme un nain, et, jusqu’à ce qu’il eût versé honorablement un sang qui fût digne d’être versé, un étranger. »
« …] la brousse […] semblait se pencher, se baisser légèrement, les regarder, les écouter, non pas véritablement hostile, parce qu’ils étaient trop petits, même ceux comme Walter, le major de Spain et le vieux général Compson, qui avaient tué beaucoup de daims et d’ours, leur séjour trop bref et trop inoffensif pour l’y inciter, mais simplement pensive, secrète, énorme, presque indifférente. »
L’ours :
« Cette fois, il y avait un homme et aussi un chien. Deux bêtes, en comptant le vieux Ben, l’ours, et deux hommes, en comptant Boon Hogganbeck, dans les veines de qui coulait un peu du même sang que dans celles de Sam Fathers, bien que celui de Boon en fût une déviation plébéienne et que seul celui du vieux Ben et de Lion, le chien bâtard, fût sans tache et sans souillure. »
Cet incipit railleur de Faulkner dénote les conceptions de l’époque sur les races et la pureté du sang.
Ce récit et le précédent, dont il constitue une variante, une reprise et/ou une extension, sont un peu dans la même veine que London. Ils m’ont impressionné par la façon fort juste dont sont évoqués le wild, la wilderness, la forêt sauvage (la « brousse »), « la masse compacte quoique fluide qui les entourait, somnolente, sourde, presque obscure ». Ben, le vieil ours qui « s’était fait un nom » et qui est traqué, Sam et « le grand chien bleu » laisseront la vie dans l’ultime scène dramatique.
Puis Ike, devenu un chasseur et un homme, refuse la terre héritée de ses ancêtres, achetée comme les esclaves (depuis affranchis) ; se basant sur les registres familiaux, il discourt sur la malédiction divine marquant le pays.
Automne dans le Delta : Ike participe une fois encore à la traditionnelle partie de chasse de novembre dans la « brousse », qui a reculé avec le progrès états-unien, et il se confirme que Faulkner est, aussi, un grand auteur de nature writing.
« …] rivières Tallahatchie ou Sunflower, dont la réunion formait le Yazoo, la Rivière du Mort des anciens Choctaws – les eaux épaisses, lentes, noires, sans soleil, presque sans courant, qui, une fois l’an, cessaient complètement de couler, remontaient alors leur cours, s’étalant, noyant la terre fertile, puis se retiraient la laissant plus fertile encore. »
« Car c’était sa terre, bien qu’il n’en eût jamais possédé un pied carré. Il ne l’avait jamais désiré, pas même après avoir vu clairement son suprême destin, la regardant reculer d’année en année devant l’attaque de la hache, de la scie, des chemins de fer forestiers, de la dynamite et des charrues à tracteur, car elle n’appartenait à personne. Elle appartenait à tous : on devait seulement en user avec sagesse, humblement, fièrement. »
La chasse est centrale, avec son ancrage ancestral, son initiation, son folklore, son narratif, et son éthique (c’est le vieil Ike qui parle) :
« Le seul combat, en quelque lieu que ce soit, qui ait jamais eu quelque bénédiction divine, ça a été quand les hommes ont combattu pour protéger les biches et les faons. »
Descends, Moïse : mort d’un des derniers Beauchamp.
Les personnages fort typés mis en scène dans ce recueil se rattachent à la formidable galerie des figures faulknériennes ; ainsi apparaissent des Sartoris, des Compson, et même Sutpen d’Absalon ! Absalon !.
Ces épisodes d’apparence indépendants me semblent former, plus qu’un puzzle, un archipel des évènements émergents d’un sang dans la durée.
\Mots-clés : #colonisation #discrimination #esclavage #famille #identite #initiatique #lieu #nature #portrait #racisme #religion #ruralité #social #violence
- le Mer 2 Aoû - 13:36
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William Faulkner
- Réponses: 103
- Vues: 12198
Romain Gary
Les Mangeurs d'étoiles
« Le vol fut agréablement dépourvu d'intérêt. C'était la première fois que le Dr Horwat s'aventurait sur un avion d'une ligne non américaine, et il était obligé de reconnaître que, pour peu qu'on les aidât, ces gens-là apprenaient vite. »
Dans cet incipit qui donne le ton, c’est un pasteur évangélique, prédicateur à succès, qui se rend à l’invitation du général José Almayo, lider maximo d’un petit pays sous-développé d'Amérique centrale, avec l’intention d’y combattre le Démon (« le Mal »).
« La Vérité n'était-elle pas un produit de première nécessité et fallait-il hésiter à utiliser les méthodes modernes pour assurer sa diffusion ? Certes, il n'était pas question de comparer la conquête des âmes à celle des marchés, mais il eût été aberrant que, dans un monde où la concurrence était impitoyable, Dieu se privât des conseils des experts passés maîtres dans le maniement des foules. »
Avec Charlie Kuhn, un illassable prospecteur de talents de music-hall, Mr John Sheldon, avocat s'occupant des intérêts d’Almayo aux États-Unis, un superman cubain (performeur porno), M. Antoine, un jongleur marseillais avide d’excellence, Agge Olsen, un ventriloque danois et son pantin, M. Manulesco, un pathétique violoniste classique prodige roumain qui joue sur la tête, déguisé en clown blanc, afin d’être reconnu pour son talent, la mère abêtie par les « étoiles » des drogues locales et la « fiancée » américaine (comprendre nord-américaine) du dictateur, ils vont être fusillés par le capitaine Garcia, afin de faire porter la responsabilité de leur mort aux insurgés d’une soudaine insurrection. Histrions d’un vrai cirque !
Otto Radetzky, aventurier cynique, ancien nazi et conseiller militaire du dictateur, est presque parvenu à comprendre ce dernier, un Indien « cujon » avec un peu de sang espagnol, ancien élève des Jésuites qui, soutenu par un gros corrompu, tenta de devenir torero, et pense avoir trouvé comment favoriser sa chance, protección qu’il croit allouée par le Diable, le vrai Maître du monde, El Señor par euphémisme.
« Radetzky avait connu quelques-uns des plus grands aventuriers de son temps : leur foi profonde dans la puissance du mal et dans la violence l'avait toujours beaucoup amusé. Il fallait une bonne dose de naïveté pour imaginer que les massacres, la cruauté et le « pouvoir » pouvaient vous mener quelque part. Au fond, ils étaient des croyants et manquaient totalement de scepticisme. »
« Dieu est bon, dit-il [Almayo], le monde est mauvais. Le gouvernement, les politiciens, les soldats, les riches, ceux qui possèdent la terre sont des... fientas. Dieu n'a rien à voir avec eux. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe d'eux, qui est leur patron. Dieu est seulement au paradis. La terre, c'est pas à Lui. »
La progression d’Almayo est retracée depuis son enfance, avec ses efforts incessants pour être élu par le Mal.
« Quand on est né indien, si on veut en sortir, il faut le talent, ou il faut se battre. Il faut être torero, boxeur ou pistolero. Sinon, on n'arrive nulle part. Ils ne vous laissent pas passer. Vous n'avez aucune chance de vous frayer un chemin. Tout est fermé, pas moyen de passer. Ils gardent tout ça pour eux-mêmes. Ils se sont arrangés entre eux. Mais si on a le talent, même si on n'est qu'un Cujon, ils vous laissent passer. Ça leur est égal, parce qu'il n'y en a qu'un sur des millions, et puis ils vous prennent en main, et ça leur rapporte. Ils vous laissent passer, ils vous laissent monter, vous pouvez avoir toutes les bonnes choses. Même leurs femmes, elles ouvrent les cuisses, et on peut vivre comme un roi. Seulement, il faut avoir le talent. Sans ça, ils vous laissent pourrir dans votre merde d'Indien. Il n'y a rien à faire. J'ai ça en moi, je le sais. Le talent, je l'ai, je le sens là, dans mes cojones... »
Entre le ressentiment d’une misère séculaire et l’éducation catholique inculquée par les frates de l’Inquisition venus avec les conquistadores, les Indiens, qui regrettent leurs anciens dieux sanguinaires, se tournèrent vers le Diable. La « señora Almayo » à l’évangéliste :
« En fait, tout était mal, il n'y avait de bien que la résignation, la soumission, l'acceptation silencieuse de leur sort et la prière pour le repos de l'âme de leurs enfants morts de sous-alimentation ou d'absence totale d'hygiène, de médecins ou de médicaments. Tout ce qu'ils avaient envie de faire, les Indiens : forniquer, travailler un peu moins, tuer leurs maîtres et leur prendre la terre, tout cela était très mauvais, non ? Le Diable rôdait derrière ces idées, on leur expliquait ça sans arrêt. Alors, il y en a qui ont fini par comprendre et qui se sont mis à croire très sérieusement au Diable, comme vous le leur conseillez. »
« …] les bons hériteront le ciel, et les méchants hériteront la terre. »
Almayo est fasciné par les saltimbanques et charlatans, dans l’espoir que l’un d’eux lui permettra par son talent d’accéder au pouvoir : il acquiert dès que possible la boîte de nuit El Señor.
« Il fallait être prudent avec ces Indiens primitifs et superstitieux. Ils étaient tous croyants. Seulement, on leur avait pris leurs dieux anciens, et le nouveau Dieu qu'on leur avait enfoncé dans la gorge à coups de fouet et de massacres, ils ne le comprenaient pas. On leur avait dit que c'était un Dieu de bonté, de générosité et de pitié, mais pourtant ils continuaient à crever dans la faim, l'ordure et la servitude malgré toutes leurs prières. Ils gardaient donc la nostalgie de leurs dieux anciens, un besoin profond et douloureux de quelque manifestation surnaturelle, ce qui faisait d'eux le meilleur public du monde, le plus facile à impressionner et le plus crédule. Dans toute l'Amérique centrale et en Amérique du Sud, il s'était toujours efforcé de choisir un Indien comme sujet. Pour un hypnotiseur, ils étaient vraiment du pain bénit. »
Les hommes de pouvoir sud-américains inspirent Almayo : Batista, Trujillo, Jimenez, Duvalier (Hitler est aussi un modèle fort inspirant).
« Il continuait à se rendre de temps en temps dans le petit magasin d'archives historiques derrière la place du Libérateur, pour nourrir ses yeux respectueux et graves de documents photographiques, portraits de toutes les grandes figures nationales, politiciens, généraux, qui s'étaient rendus célèbres par leur cruauté et leur avidité, et qui avaient réussi. Il était décidé à devenir un grand homme. »
Les communistes confortent Almayo dans sa conviction :
« Il se mit à prêter une grande attention à la propagande anti-yankee qui déferlait sur le pays et commença à être vivement impressionné par les États-Unis. Il s'arrêtait toujours pour écouter les agitateurs politiques sur les marchés, qui expliquaient aux Indiens combien il était puéril et stupide de croire que le Diable avait des cornes et des pieds fourchus : non, il conduisait une Cadillac, fumait le cigare, c'était un gros homme d'affaires américain, un impérialiste qui possédait la terre même sur laquelle les paysans trimaient, et qui essayait toujours d'acheter à coups de dollars l'âme et la conscience des gens, leur sueur et leur sang, comme l'American Fruit Company qui avait le monopole des bananes dans le pays et les achetait pour rien. »
Sa liaison avec une Américaine relativement cultivée, membre du Peace Corps de Kennedy, lui est opportune pour asseoir son ascension sociale. La jeune idéaliste est transportée par son aspiration à participer au progrès social du pays. Empêtrée dans ses troubles psychologiques, elle s’adonne progressivement à l’alcool, passe même par l’héroïne ; aveuglée par sa conception d’une moralité différente selon les pays, elle admet le maintien des « mangeurs d’étoiles », cette culture qui soulagerait les misères populaires et enrichit son trafiquant de compagnon, quant à lui fourvoyé dans sa vision faustienne du monde, ce « déversoir des surplus américains ».
« Il avait besoin d'elle et lorsque vous trouvez enfin quelqu'un qui a besoin de vous, une bonne partie de vos problèmes sont résolus. Vous cessez d'être aliénée... d'errer à la recherche d'une identité, d'une place dans le monde, d'un but qui vous permettrait de vous libérer de vous-même, de choisir, de vous engager...
– Vous pouvez enfin vous justifier... C'était très important pour moi. »
Elle rêve d’épouser enfin Almayo, quoique assumant, à cause de l'antiaméricanisme de rigueur, de n’être qu’une de ses maîtresses (sans compter les dernières starlettes du « firmament de Hollywood » qu’il couvre d’étincelants bijoux) tandis qu’il devient l’homme fort du pays – lui qui craint son influence bénéfique de « propre » sainte destinée au Paradis. Elle le décide à installer un réseau téléphonique moderne, un grand Centre culturel et une nouvelle Université dans ce pays d’une insondable misère, « où quatre-vingt-quinze pour cent de la population ne savaient pas lire ».
« Elle avait toujours cru que l'art et l'architecture, la grande musique aussi pouvaient transformer radicalement les conditions de vie d'un peuple. Dès que de grands ensembles architecturaux conçus par des hommes comme Niemeyer couvriraient le pays, la solution des problèmes sociaux et économiques suivrait automatiquement comme une sorte de sous-produit de la beauté. »
Il y a bien sûr des soubresauts populaires malgré la grande "popularité" du despote, comme lorsqu’il doit condamner le ministre de l'Éducation pour détournement de l’aide nord-américaine afin de construire la nouvelle Université et la Maison de la Culture :
« Le ministre fut condamné à mort pour sabotage et détournement de fonds, mais, sur l'intervention de l'Alliance des États interaméricains, il ne fut pas fusillé mais simplement envoyé comme ambassadeur à Paris. »
Le pantin d’Agge Olsen, à propos de « l'illusion du pouvoir surnaturel » :
« Personne n'a encore jamais réussi à vendre son âme, mon bon monsieur. Il n'y a pas preneur. […]
Car la vérité sur l'affaire Faust et sur nous tous, qui nous donnons tant de mal et qui faisons, si je puis dire, des pieds et des mains pour trouver preneur, c'est qu'il n'y a hélas ! pas de Diable pour acheter notre âme... Rien que des charlatans. Une succession d'escrocs, d'imposteurs, de combinards, de tricheurs et de petits margoulins. Ils promettent, ils promettent toujours, mais ils ne livrent jamais. Il n'y a pas de vrai et de grand talent auquel on pourrait s'adresser. Il n'y a pas d'acheteur pour notre pauvre petite camelote. Pas de suprême talent, pas de maîtrise absolue. C'est là toute ma tragédie en tant qu'artiste, mon bon monsieur, et cela brise mon petit cœur. »
Le castriste Rafael Gomez, provocateur manipulé par Almayo, se retourne contre lui et le chasse du pouvoir. Le Cujon et son « cabinet d'ombres » (dont Radetzky) se réfugient à l’ambassade d’Uruguay, et c’est une nouvelle scène de guignol. Ils prennent la fuite en emmenant la fille de l’ambassadeur en otage.
« Une révolution qui hésite devant le sang des femmes et des enfants est vouée à l'échec. C'est une révolution qui manque d'idéal. »
« Depuis qu'ils avaient quitté l'ambassade, elle n'avait pas manifesté la moindre trace d'inquiétude et avait conservé cet air d'indifférence un peu hautaine qui n'était peut-être que l'effet de sa beauté. […]
Il n'y avait pas de mystère, et c'était bien pour cela que les hommes se contentaient de beauté. »
Radetzky se révèle être un journaliste suédois infiltré pour enquêter sur Almayo (un des nombreux personnages à peine esquissés par Gary, comme le mystérieux Jack).
Descendant de bandits des montagnes, Garcia n’a pas exécuté les otages, et les a emmenés dans la Sierra, escomptant négocier son exfiltration. Bien sûr les deux groupes se rencontrent, ce qui occasionne une cascade de rebondissements.
« Car, après tout, il n'existait pas d'autre authenticité accessible à l'homme que de mimer jusqu'au bout son rôle et de demeurer fidèle jusqu'à la mort à la comédie et au personnage qu'il avait choisis. C'est ainsi que les hommes faisaient l'Histoire, leur seule authenticité véritable et posthume. »
« Les généraux à la peau noire ou jaune dans leurs blindés, dans leurs palais ou derrière leurs mitrailleuses, allaient suivre pendant longtemps encore la leçon que leurs maîtres leur avaient apprise. Du Congo au Vietnam, ils allaient continuer fidèlement les rites les plus obscurs des civilisés : pendre, torturer et opprimer au nom de la liberté, du progrès et de la foi. Il fallait bien autre chose que l'« indépendance » pour tirer les « primitifs » des pattes des colonisateurs. »
Cette analyse des ressorts du despotisme et de ses dérives, assurément basée sur les observations d’un Gary bien placé pour les faire, est marquée d’un regard qu’on pourrait juger réactionnaire de nos jours ; mais j’y ai trouvé des vues pertinentes, si je me base sur ce que je sais des dictateurs (rencontrés dans la littérature) et des sphères du pouvoir (surtout en Afrique). Cette approche est à contre-courant du mouvement actuel d’adulation un peu béate de tout ce qui est autochtone, rejetant peut-être un peu trop vite toute idée de superstition obscurantiste. Le rôle prépondérant des États-Unis, vus d’une part comme puissant empire du Mal et de l’autre comme dispensateur d’une importante aide financière (détournée), également marché pour l'écoulement de la drogue, me paraît bien exposé.
Cette farce tragi-comique, assez cinématographique, est malheureusement desservie par des longueurs et redites, et des lourdeurs de traduction mal relue. Me reste à lire le deuxième tome de La Comédie américaine, Adieu Gary Cooper.
\Mots-clés : #amérindiens #discrimination #misere #politique #portrait #regimeautoritaire #religion #social
- le Dim 4 Juin - 14:06
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Romain Gary
- Réponses: 111
- Vues: 9731
Romain Gary
Le Grand Vestiaire
Le narrateur, Luc Martin, quatorze ans au sortir de la Deuxième Guerre et à la mort de son père, devient pupille de la nation. Mais très vite il est recueilli par le vieux Vanderputte, un des nombreux escrocs dans le chaos de la Libération, et volontiers métaphysicien...
« Il rejeta sa casquette en arrière, remua rapidement sa moustache, et braqua sur moi son ongle sale, tout en regardant soigneusement de côté.
– Apprenez cela, jeune homme, dès aujourd'hui : dans la vie, il s'agit de ne pas être là au bon moment, voilà tout. Il faut se faufiler adroitement entre les années, le ventre rentré et sans faire de silhouette, pour ne pas se faire pincer. Voilà ce que c'est, la vie. Pour cela, naturellement, il faut être seul. Ab-so-lu-ment ! La vie, c'est comme l'assassinat, il ne faut pas avoir de complice. Ne jamais se laisser surprendre en flagrant délit de vie. Vous ne le croirez peut-être pas, jeune homme, mais il y a des millions de gens qui y arrivent. Ils passent inaperçus, mais à un point... ini-ma-gi-nable ! C'est simple : à eux, la destinée ne s'applique pas. Ils passent au travers. La condition humaine – vous connaissez cette expression ? – eh bien, elle coule sur eux, comme une eau un peu tiède. Elle ne les mouille même pas. Ils meurent de vieillesse, de décrépitude générale, dans leur sommeil, triomphalement. Ils ont roulé tout le monde. Ils ne se sont pas fait repérer. Pro-di-gieux ! C'est du grand art. Ne pas se faire repérer, jeune homme, apprenez cela dès ce soir. Rentrer la tête dans les épaules, écouter s'il pleut, avant de mettre le nez dehors. Se retourner trois fois, écouter si l'on ne marche pas derrière vous, se faire petit, petit, mais petit ! Être, dans le plein sens du terme, homme et poussière. Jeune homme, je suis persuadé qu'en faisant vraiment très attention, la mort elle-même ne vous remarque pas. Elle passe à côté. Elle vous loupe. C'est dur à repérer, un homme, lorsque ça se planque bien. On peut vivre très vieux et jouir de tout, naturellement, en cachette. La vie, jeune homme, apprenez-le dès maintenant, c'est uniquement une question de camouflage. Réalisez bien ceci et tous les espoirs vous sont permis. Pour commencer, tenez, un beau vieillard, c'est toujours quelqu'un qui a su éviter la jeunesse. C'est très dangereux ça, la jeunesse. Horriblement dangereux. Il est très difficile de l'éviter, mais on y arrive. Moi, par exemple, tel que vous me voyez, j'y suis arrivé. Avez-vous jamais réfléchi, jeune homme, au trésor de prudence et de circonspection qu'il faut dépenser pour durer, mettons, cinquante ans ? Moi, j'en ai soixante... Co-los-sal ! »
Venu du maquis du Véziers à Paris avec Roxane la chienne de son père instituteur tué dans la Résistance (et son « petit volume relié des Pensées de Pascal » qui lui reste hermétique), Luc le rat des champs se sent perdu parmi les rats des villes.
« Mon père aimait à me plonger ainsi dans une atmosphère de mystère et de conte de fées ; je me demande, aujourd'hui, si ce n'était pas pour brouiller les pistes, pour atténuer les contours des choses et adoucir les lumières trop crues, m'habituant ainsi à ne pas m'arrêter à la réalité et à chercher au-delà d'elle un mystère à la fois plus significatif et plus général. »
Intéressante vision du cinéma et de son influence :
« La beauté des femmes, la force des hommes, la violence de l'action [… »
« Je cherchais alors à bâtir toute ma personnalité autour d'une cigarette bien serrée entre les lèvres, ce qui me permettait de fermer à demi un œil et d'avancer un peu la lèvre inférieure dans une moue qui était censée donner à mon visage une expression extrêmement virile, derrière laquelle pouvait se cacher et passer inaperçue la petite bête inquiète et traquée que j'étais. »
Avec Léonce (et comme beaucoup de gosses), ils rêvent d’être adultes, d’aller en Amérique, de devenir gangsters et riches. Il est amoureux de Josette, la sœur de Léonce, mais fort embarrassé.
« – Quelquefois, ça se guérit, me consolait-elle. Il y a des médecins qui font ça, en Amérique. On te colle la glande d'un singe et du coup, tu deviens sentimental. »
Vanderputte, un destin misérable :
« Je posais pour un fabricant de cartes postales. Sujets de famille, uniquement. J'ai jamais voulu me faire photographier pour des cochonneries. On pouvait me mettre dans toutes les mains. »
« Cet amour instinctif qu'il avait pour les objets déchus, cette espèce de sollicitude fraternelle dont il les entourait, avaient je ne sais quoi de poignant et c'est lorsque je le vis pour la première fois s'arrêter dans la rue, ramasser un peigne édenté et le glisser dans sa poche, que je me rendis compte à quel point ce vieil homme était seul. Les antiquités, les beaux objets de valeur finement travaillés ne l'intéressaient pas : il ne s'attachait qu'aux épaves. Elles s'accumulaient dans sa chambre et la transformaient en une immense boîte à ordures, une sorte de maison de retraite pour vieilles fioles et vieux clous. »
Avec son ami l’Alsacien Kuhl (son antithèse, épris d’ordre et de propreté ; employé à la préfecture de police, il reçoit mensuellement une enveloppe de Vanderputte), les deux cultivent un humanisme sentimental, convaincus de la décadence civilisationnelle.
Galerie de portraits hauts en couleur, tel Sacha Darlington « grand acteur du muet » et travesti vivant reclus dans un bordel, ou M. Jourdain :
« Le fripier, un M. Jourdain, était un bonhomme âgé ; il portait sa belle tête de penseur barbu, une calotte de velours noir extrêmement sale ; il était l'éditeur, le rédacteur en chef et l'unique collaborateur d'une publication anarchiste violemment anticléricale, Le Jugement dernier, qu'il distribuait gratuitement tous les dimanches à la sortie des églises et qu'il envoyait régulièrement, depuis trente-cinq ans, au curé de Notre-Dame, avec lequel il était devenu ami. Il nous accueillit avec une mine sombre, se plaignit du manque de charbon – on était en juin – et à la question de Vanderputte, qui s'enquérait de l'état de ses organes, il se plaignit amèrement de la vessie, de la prostate et de l'Assemblée nationale, dont il décrivit le mauvais fonctionnement et le rôle néfaste en des termes profondément sentis. »
Vanderputte tombe fréquemment amoureux d’un vêtement miteux, tel celui d’un Gestard-Feluche, fonctionnaire médaillé, qui ira augmenter le grand vestiaire de sa chambre.
Dans une France en pleine pagaille (et dans la crainte du communisme, de la bombe atomique), Léonce et Luc passent du trafic de « médicaments patentés » au vol de voitures, et envisagent un gros coup.
Josette meurt de la tuberculose, et Luc s’interroge toujours sur la société.
« Où étaient-ils donc, ces fameux hommes, dont mon père m'avait parlé, dont tout le monde parlait tant ? Parfois, je quittais mon fauteuil, je m'approchais de la fenêtre et je les regardais. Ils marchaient sur les trottoirs, achetaient des journaux, prenaient l'autobus, petites solitudes ambulantes qui se saluent et s'évitent, petites îles désertes qui ne croient pas aux continents, mon père m'avait menti, les hommes n'existaient pas et ce que je voyais ainsi dans la rue, c'était seulement leur vestiaire, des dépouilles, des défroques – le monde était un immense Gestard-Feluche aux manches vides, d'où aucune main fraternelle ne se tendait vers moi. La rue était pleine de vestons et de pantalons, de chapeaux et de souliers, un immense vestiaire abandonné qui essaye de tromper le monde, de se parer d'un nom, d'une adresse, d'une idée. J'avais beau appuyer mon front brûlant contre la vitre, chercher ceux pour qui mon père était mort, je ne voyais que le vestiaire dérisoire et les milles visages qui imitaient, en la calomniant, la figure humaine. Le sang de mon père se réveillait en moi et battait à mes tempes, il me poussait à chercher un sens à mon aventure et personne n'était là pour me dire que l'on ne peut demander à la vie son sens, mais seulement lui en prêter un, que le vide autour de nous n'est que refus de combler et que toute la grandeur de notre aventure est dans cette vie qui vient vers nous les mains vides, mais qui peut nous quitter enrichie et transfigurée. J'étais un raton, un pauvre raton tapi dans le trou d'une époque rétrécie aux limites des sens et personne n'était là pour lever le couvercle et me libérer, en me disant simplement ceci : que la seule tragédie de l'homme n'est pas qu'il souffre et meurt, mais qu'il se donne sa propre souffrance et sa propre mort pour limites... »
Les « ratons » (vaut tantôt pour petits rats, tantôt pour Nord-Africains) entrent dans le monde des « dudules » (vaut apparemment plus pour adultes, individus, que pour idiots) : le « gang des adolescents » devient célèbre pour ses braquages de transports de fonds. Léonce est tué ; Luc se retrouve dans la peau de Vanderputte, qu‘il craint de devenir cinquante ans plus tard. Ce dernier est poursuivi : entré dans la Résistance et arrêté par les Allemands, il avait très vite collaboré et dénoncé, principalement des juifs. Luc s’enfuit avec lui, pris par la pitié, mais…
\Mots-clés : #corruption #criminalite #deuxiemeguerre #enfance #humour #initiatique #jeunesse #portrait #vieillesse #xxesiecle
- le Ven 10 Mar - 11:56
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Romain Gary
- Réponses: 111
- Vues: 9731
Ernest Chouinard
Ernest Chouinard
(1856 – 1924)
(1856 – 1924)
Ecrivain québecois.
Je n'ai pas trouvé plus malheureusement.
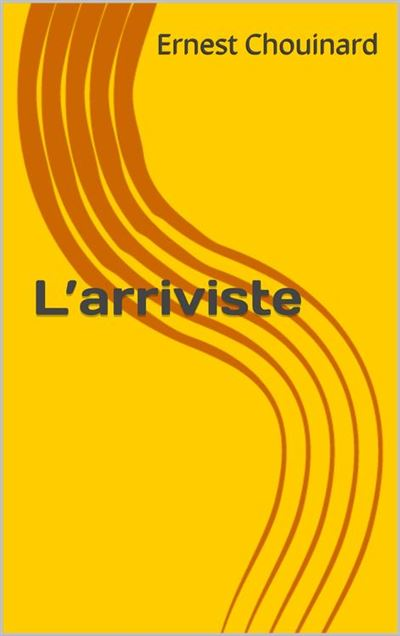
L'arriviste (1919)
Un court roman qui pourrait commencer comme un Grand Meaulnes avec plus d'intérêt avec les années de lycée de deux camarades que tout pourrait opposer si n'était leur amitié. Un campagnard besogneux et un citadin argenté prêts à se lancer dans la vie. Leurs débuts se feront d'ailleurs dans la même étude.
Des deux c'est surtout "l'arriviste" qui nous intéresse. Les études laissant à la place à la politique on le verra se laisser aller et chercher à aller plus loin. Partie pas inintéressante mais moins séduisante que les années de jeunesse. La fin qui nous ramène à une intégrité plus contemplative, aux accents moralistes, ne manque pas de charme non plus.
Une étude psychologique satirique légèrement dépaysante qui en parlant de presse et de pouvoir fait penser que certaines choses ne changent pas !
Mots-clés : #politique #portrait #québec #satirique
- le Dim 18 Déc - 18:46
- Rechercher dans: Écrivains du Canada
- Sujet: Ernest Chouinard
- Réponses: 0
- Vues: 1172
Claudio Magris
Une autre mer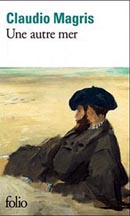
Enrico est un jeune étudiant en philologie de Gorizia en Autriche-Hongrie qui s’embarque à Trieste pour l’Argentine fin 1909, renonçant au bonheur avec son frère Nino et son ami Carlo, avec qui il pratiquait les philosophes grecs (notamment Platon), Schopenhauer, Ibsen, Tolstoï, Bouddha, Beethoven.
« Ce mélange de peuples et son agonie sont une grande leçon de civilisation et de mort ; une grande leçon de linguistique générale aussi, car la mort est spécialiste en matière de plus-que-parfait et de futur antérieur. »
« Sur ce bateau qui à présent file à travers l’Atlantique, Enrico est-il en train de courir pour courir ou bien pour arriver, pour avoir déjà couru et vécu ? À vrai dire, il reste immobile ; déjà les quelques pas qu’il fait entre sa cabine, le pont et la salle à manger lui semblent inconvenants dans la grande immobilité de la mer, égale et toujours à sa place autour du bateau qui prétend la labourer, alors que l’eau se retire un instant et se referme aussitôt. La terre supporte, maternelle, le soc de charrue qui la fend, mais la mer est un grand rire inaccessible ; rien n’y laisse de trace, les bras qui y nagent ne l’étreignent pas, ils l’éloignent et la perdent, elle ne se donne pas. »
Enrico devient éleveur en Patagonie, toujours en selle ; il est patient, détaché, libre, éprouvant dans l’instant la vie à laquelle il ne demande rien, refusant tout engagement professionnel, politique, sentimental ou familial.
« Une fois il se trouve face à un puma, son cheval s’emballe, il le fouette rageusement et même le mord, l’animal le désarçonne et le piétine ; pendant des mois il pisse du sang, jusqu’à ce que des Indiens lui fassent boire certaines décoctions d’écorces et que ça lui passe. »
« Il y a toujours du vent mais au bout d’un certain temps on apprend à distinguer ses tonalités diverses selon les heures et les saisons, un sifflement qui s’effiloche ou un coup sec comme une toux. Parfois il semble que le vent a des couleurs, il y a le vent jaune d’or entre les haies, le vent noir sur le plateau nu. »
« Enrico tire, le canard sauvage s’abat sur le sol, en un instant le vol héraldique est un déchet jeté par la fenêtre. La loi de la pesanteur est décidément un facteur de gaucherie dans la nature ; il n’y a que les mots qui en soient préservés, entre autres ceux imprimés dans les classiques grecs et latins de la collection Teubner de Leipzig. »
Venu de la mansarde de Nino dans Gorizia à une cabane de l’altiplano, fuyant le vacarme des villes (et la guerre), il correspond avec Carlo (qui est le philosophe Carlo Michelstaedter), jusqu’à ce que celui-ci se suicide après avoir rédigé La persuasion et la rhétorique. Cet essai théorise la persuasion comme « plénitude de l’être en accord avec la vie et l’instant », la rhétorique en tant que « tout ce qui nous fait désirer d’être ailleurs, plus tard, plus fort, tandis qu’irrévocablement s’écoule et s’enfuit notre vie véritable » (Gallimard). Enrico est l’incarnation du « persuadé ».
« Carlo est la conscience sensible du siècle et la mort n’a aucun pouvoir sur la conjugaison du verbe être, seulement sur l’avoir. Enrico a ses troupeaux, son cheval, quelques livres. »
« Carlo parlait de toi, il regardait ta vie comme la seule chose qui mérite de l’estime… ce que Carlo nous a donné tu le fais et le démontres dans chacun des actes de ta vie actuelle et tu ne le sais même pas… »
« Dans ces pages ultimes Carlo le représente comme l’homme libre à qui les choses disent « tu es » et qui jouit uniquement parce que sans rien demander ni craindre, ni la vie ni la mort, il est pleinement vivant toujours et à chaque instant, même au dernier. »
« Les hommes ne sont pas tristes parce qu’ils meurent, a dit Carlo, ils meurent parce qu’ils sont tristes. »
« Dans ces pages il y a la parole définitive, le diagnostic de la maladie qui ronge la civilisation. La persuasion, dit Carlo, c’est la possession au présent de sa propre vie et de sa propre personne, la capacité de vivre pleinement l’instant, sans le sacrifier à quelque chose qui est à venir ou dont on espère la venue prochaine, détruisant ainsi sa vie dans l’attente qu’elle passe le plus vite possible. Mais la civilisation est l’histoire des hommes incapables de vivre dans la persuasion, qui édifient l’énorme muraille de la rhétorique, l’organisation sociale du savoir et de l’agir, pour se cacher à eux-mêmes la vue et la conscience de leur propre vacuité. »
Enrico revient à Gorizia après la Grande Guerre ; l’empire austro-hongrois a éclaté. Il vit à Punta Salvore en Istrie, alors italienne, se marie, est quitté, demeure avec une autre femme. L’Istrie passe du régime fasciste au communisme (puis au titisme) en devenant part de la Yougoslavie après la Seconde Guerre mondiale. Il contemple toujours la mer, songeant à Carlo, de plus en plus hors du temps, à l’écart de la vie ; il montre peu à peu des signes de mesquinerie égoïste, puis meurt.
« Mais il ne peut en être autrement, les mots ne peuvent faire écho qu’à d’autres mots, pas à la vie. »
« …] le plaisir c’est de ne pas dépendre des choses qui ne sont pas absolument nécessaires, et même celles qui le sont doivent être accueillies avec indifférence. »
« Ce sont les esclaves qui ont toujours le mot droit à la bouche, ceux qui sont libres ont des devoirs. »
Magris a mis beaucoup de choses dans ce beau livre, qui m’a ramentu… Yourcenar !
\Mots-clés : #biographie #historique #philosophique #portrait #xxesiecle
- le Ven 7 Oct - 12:33
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Claudio Magris
- Réponses: 17
- Vues: 2322
Michel Layaz
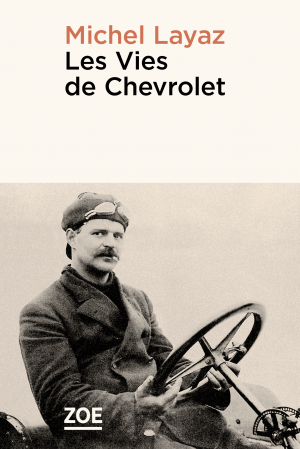
Les Vies de Chevrolet
éditeur a écrit:« Che-vro-let ! Che-vro-let ! » : début XXe siècle, l’Amérique est ébahie devant les prouesses de Louis Chevrolet. Né en Suisse en 1878, le jeune homme a grandi en Bourgogne où il est devenu mécanicien sur vélo avant de rejoindre, près de Paris, de florissants ateliers automobiles. En 1900, il quitte la France pour le continent américain. Très vite, au volant des bolides du moment, Fiat ou Buick, il s’impose comme l’un des meilleurs pilotes de course. En parallèle, il dessine, conçoit et construit des moteurs. Ce n’est pas tout, avec Billy Durant, le fondateur de la General Motors, Louis crée la marque Chevrolet. Billy Durant la lui rachète pour une bouchée de pain et obtient le droit d’utiliser le nom de Chevrolet en exclusivité. Des millions de Chevrolet seront vendues sans que Louis ne touche un sou. Peu lui importe. L’essentiel est ailleurs.
Pied au plancher, Michel Layaz raconte la vie romanesque de ce personnage flamboyant qui mêle loyauté et coups de colère, bonté et amour de la vitesse. À l’heure des voitures électriques, voici les débuts de l’histoire de l’automobile, avec ses ratés, ses dangers et ses conquêtes.
Un livre assez court et écrit assez gros dans un style dans l'air du temps, animé, vif avec des phrases brèves et une part de mélancolie. Pas complètement ma came mais je me suis laissé happé par les tranches de vie et les mouvements de ce drôle de bonhomme, compétiteur et trompe la mort dans l'âme tout à la fois pilote et mécanicien-ingénieur dans l'âme.
C'est aussi la page d'histoire automobile et industrielle. Une drôle d'histoire individuelle, pas toujours réjouissante. Mais aussi sans grande leçon. Qualité sensible du livre dont l'emphase (ou l'emportement ?) ne nous emmène pas dans la sentence mais nous fait naviguer comme au hasard entre la plus grande histoire et les grandes tensions de l'âme humaine. En arrière plan le "rien" dont vient ce héros "moderne" et la présence forte de la famille, l'exil aussi pour trouver la prospérité outre Atlantique dans la frénésie du début du siècle dernier.
Epoque oblige, les faits (de courses) à faire dresser les cheveux sur la tête !
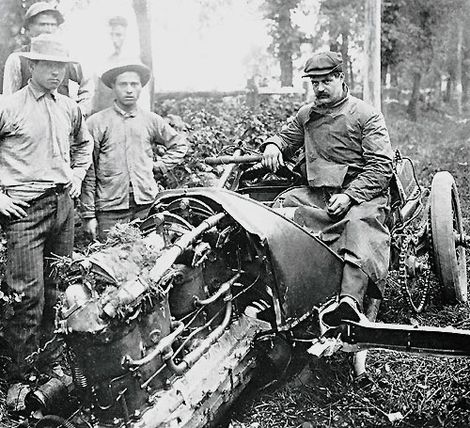
Mots-clés : #biographie #contemporain #portrait #xxesiecle
- le Mer 1 Déc - 21:52
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Michel Layaz
- Réponses: 2
- Vues: 367
Henry Miller
Un diable au paradis
Henry Miller, dont on sait l’importance qu’avaient pour lui les amis (et les livres) dresse de Conrad Téricand (Moricand en réalité) un portrait approfondi, fouillé, où il témoigne aussi de grandes qualités chez cet astrologue, écrivain et illustrateur − même si son esprit diffère explicitement du sien, et lui inspire d’abord de la suspicion, puis un agacement grandissant.
Au début de leurs relations, Miller aide dans sa dèche parisienne ce riche Suisse ruiné par un escroc.
« Pauvre Téricand ! Combien, ô combien familier m’était cet aspect comique de ses tribulations ! Marcher l’estomac vide, marcher l’estomac plein, marcher pour digérer un repas, marcher parce que c’est la seule récréation que vous permette votre porte-monnaie, comme Balzac en fit l’expérience lorsqu’il vint à Paris. Marcher pour fuir sa hantise. Marcher pour ne pas pleurer. Marcher dans l’attente vaine et désespérée de rencontrer un visage amical. Marcher, marcher, marcher… Mais pourquoi aborder ce sujet ? Rangeons-le sous l’étiquette : "paranoïa ambulatoire". »
Par bouffées inspirées, le flux stylistique de Miller l’emporte (et avec lui le lecteur), lyrique et délirant, comme dans cette liste lautréamontesque évoquant la place de Rungis au petit matin, juste avant la Seconde Guerre mondiale (français en italique) :
« Chèvres de la banlieue, appontements, bocks à injections, ceintures de sûreté, mulets, passerelles et sauterelles flottaient devant mes yeux vitreux avec des volailles décapitées, des bois de cerf enrubannés, des machines à coudre rouillées, des icônes et autres phénomènes incroyables. Ce n’était ni une communauté, ni un quartier, mais un vecteur, un vecteur très spécial, créé entièrement pour mon bénéfice artistique, créé expressément pour me nouer émotionnellement. »
Évidemment la compagnie de « Moriturus », ce raté tatillon, ce raseur funèbre, ne peut qu’être une épreuve pour Miller, cette incarnation de la vie tumultueuse. Même si Miller est sincère quoique peut-être outrancier, la version de son hôte manque (qu’elle ait existé ou pas). Le dipôle est d’autant plus étonnant que tous deux ont oscillé entre pique-assiette et parasite… Tous deux baignent dans les croyances irrationnelles, d’un côté la divination et de l’autre le scientisme chrétien. On retrouve aussi l’opposition Américain « naïf, optimiste, jobard » et Européen cynique.
Sur fond de conflit avec sa troisième épouse, Janina Lepska, Miller adore sa fille Val, tandis que son hôte raconte une aventure pédophile à Paris...
Téricand est antipathique, mais je comprends l’homme affamé qui erre dans une scène de guerre, traînant les deux valises contenant son œuvre, tandis que Miller est profondément détaché de tout ce qui est matériel (mais une œuvre n’est-elle que matérielle ?).
Ce diable se révèle finalement être un personnage fort complexe, et forme un livre très curieux…
\Mots-clés : #amitié #autobiographie #portrait
- le Lun 19 Juil - 13:00
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Henry Miller
- Réponses: 75
- Vues: 5203
Kazuo Ishiguro
Les Vestiges du jour
Une fois n’est pas coutume, j’ai le film en mémoire – et un peu trop ?! Le souvenir de la prestation des acteurs de ce scenario fort original nuit à celle d’Ishiguro ; bien évidement, il faudrait lire le livre avant de voir sa transposition à l'écran.
Stevens, (grand) majordome d’une maison « distinguée », fait preuve d’un dévouement total, d’une rigueur pratiquement sans défaut dans son appartenance à un univers social désuet, dépassé – de dignité dans sa subordination à laquelle il se conforme le plus exactement possible, incarnant jusqu’à l’abnégation son idéal professionnel. De même que celui d’un aristocrate, c’est un rôle à vie (cf. le père, lui-même majordome, devenu sénile et toujours en service).
« Un majordome d’une certaine qualité doit, aux yeux du monde, habiter son rôle, pleinement, absolument ; on ne peut le voir s’en dépouiller à un moment donné pour le revêtir à nouveau l’instant d’après, comme si ce n’était qu’un costume d’opérette. Il existe une situation et une seule où un majordome qui se préoccupe de sa dignité peut se sentir libre de se décharger de son rôle : lorsqu’il est entièrement seul. »
Stevens garde la réserve toujours à l’esprit (il vante la retenue du paysage anglais, qu’il considère comme supérieur alors qu’il n’en connaît pas d’autre), et se caractérise par une stoïque maîtrise de soi.
Cette fierté pleine de morgue transposée dans la servitude féale inclut donc la nation (l’Angleterre actuelle n’est d’ailleurs pas encore totalement affranchie du servage) :
« On dit parfois que les majordomes, les "butlers", n’existent qu’en Angleterre. Dans les autres pays, quel que soit le titre utilisé, il n’y a que des domestiques. »
Cette profession le place parfois bien près du déroulement de l’Histoire (lors des tractations pour alléger les sanctions du traité de Versailles dans le premier après-guerre) :
« Certains d’entre eux estimaient, comme Sa Seigneurie elle-même, que l’on avait manqué de fair-play à Versailles et qu’il était immoral de continuer à punir une nation pour une guerre qui était maintenant révolue. »
L’attachement à la valeur morale de l’employeur, plus qu’à sa noblesse de sang comme auparavant, conduit même à s’efforcer d'être utile à l’humanité au travers d’un personnage important, en servant près « du moyeu de cette roue qu’est le monde ».
« "Cet employeur incarne tout ce que je trouve noble et admirable. Dorénavant, je me consacrerai à son service." Cela, c’est de la loyauté jurée intelligemment. Où est l’absence de "dignité" dans cette attitude ? On accepte simplement une vérité inéluctable : que les gens comme vous et moi ne seront jamais à même de comprendre les grandes affaires du monde d’aujourd’hui, et que le meilleur choix est toujours de faire confiance à un employeur que nous jugeons sage et honorable, et de mettre notre énergie à son service, en nous efforçant de nous acquitter le mieux possible de cette tâche. »
Cette ambition est plutôt déçue avec le maître de Stevens, Lord Darlington, manipulé par Hitler dans l’entre-deux-guerres (mais à la mémoire duquel il restera loyal).
« Herr Hitler n’a sans doute pas eu dans ce pays de pion plus utile que Sa Seigneurie pour faire passer sa propagande. »
Son comportement est particulièrement distant et emprunté avec Miss Kenton, l’intendante.
Le comble de la rigidité mentale est atteint avec ses efforts pour s’exercer au badinage que semble lui suggérer son nouvel employeur, un homme d’affaires américain (entraînement reporté non sans humour par Ishiguro, comme l’absurde mais rituel entretien de l’argenterie).
« Il me vient à l’idée, de surcroît, que l’employeur qui s’attend à ce qu’un professionnel soit capable de badiner n’exige pas vraiment de lui une tâche exorbitante. Bien entendu, j’ai déjà consacré beaucoup de temps à améliorer ma pratique du badinage, mais il est possible que je n’aie jamais envisagé cette activité avec tout l’ardeur souhaitable. »
Sa raideur psychique ne lui permet pas de s’émanciper de l’élitisme :
« La démocratie convenait à une ère révolue. Le monde est devenu bien trop compliqué pour le suffrage universel et toutes ces histoires. Pour un parlement où les députés se perdent en débats interminables sans avancer d’un pas. Tout ça, c’était peut-être très bien il y a quelques années, mais dans le monde d’aujourd’hui ? »
Le style guindé rend parfaitement les déférentes circonlocutions de Stevens, même lorsqu’il pense (essentiellement à son service).
L’autoportrait du majordome par Ishiguro est magistral, et il pousse à des réflexions sur de possibles perspectives allégoriques sur la vie en société, le conformisme, etc.
Au soir de sa vie de majordome, c’est un bilan peu satisfaisant de son existence qui justifie le titre : gâchis de sa vie affective, d’abord avec son père, et déceptif don absolu à « Sa Seigneurie ».
\Mots-clés : #portrait #psychologique #social #traditions #xxesiecle
- le Lun 22 Mar - 13:05
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Kazuo Ishiguro
- Réponses: 45
- Vues: 4433
Erri De Luca
Le tour de l'oie

Titre original Il giro dell'oca, parution en langue originale: 2018, traduction française: 2019.

Titre original Il giro dell'oca, parution en langue originale: 2018, traduction française: 2019.
Un soir, l'orage, le feu de cheminée, la bougie.
Erri de Luca imagine -disons plutôt se crée- un fils de quarante ans. S'ensuit un dialogue, imaginaire évidemment, dans lequel toute l'introspection de l'auteur transparaît.
J'ai eu du mal avec cet opus, pourtant truffé de qualités: fluide, alerte, pas prise tête, etc.
Une difficulté, en fait, à entrer vraiment dedans. Peut-être est-ce le sujet (?).
Un livre comme un bilan aux heures d'automne de son propre parcours, pour compenser un manque -il ne le dit pas tout-à-fait-, celui de ne pas avoir connu la paternité ?
Ceci implique qu'il n'a pas non plus fait de ses parents des grands-parents, c'est souvent par le biais de ses parents à lui qu'il veut communiquer à son fils imaginaire.
Peut-être, mais pas sûr.
Sans doute peut-on faire remarquer à l'auteur qu'il s'écoute soliloquer avec un rien de complaisance tempérée.
Toutefois quelques jolis traits, de belles cavalcades bien dans son style, quelques pistes de réflexion fort générales -et donc à portée universelle- feront l'agrément du lecteur: pour ma part, je crains d'oublier assez vite cette lecture, peut-être suis-je passé au travers, mais je me trompe si souvent sur mes pronostics d'oubli ou d'intérêt à la vraie aune, celle de la durée !
Dans les vieux livres, les chevaux pleuraient la mort de leurs cavaliers. C'était une époque qui donnait du poids aux larmes. Aujourd'hui, les yeux restent secs sans effort pour les contenir.
Je suis d'une époque révolue, je pleure pour un deuil, un sauvetage, le souvenir de ceux que je vois en rêve.
Les larmes sont différentes entre elles, légères, chaleureuses, graves ,inutiles.
Mes yeux vieillissants se réveillent avant le jour, ils mettent en route le premier café alors qu'il fait encore nuit.
Je parle tout seul ? J'invente ta compagnie ?
Je l'invente si fort que la réalité ne peut l'égaler. Ta présence suffit ici et ce soir pour créer ma paternité.
\Mots-clés : #ecriture #portrait
- le Mar 19 Jan - 16:39
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Erri De Luca
- Réponses: 38
- Vues: 3471
Jens Peter Jacobsen
Niels Lyhne
Les parents de Niels, dont il perçoit très jeune les caractères différents ; son père : » Il ne concevait pas l’amour comme une flamme sans cesse renaissante […]mais comme un feu tranquille couvant sous la cendre […]qui rapproche davantage et rend plus familière toute chose proche et connue. »
Sa mère : « Avec un redoublement d’ardeur, elle se lança à la poursuite de l’idéal, elle anéantit son mari sous l’averse de ses poétiques imaginations et de ses enthousiasmes. Elle chercha l’isolement pour y pleurer ses illusions perdues. »
Niels est confronté à la mort alors que sa tante Edel meurt, malgré ses prières.
« […]il n’avait vu en Jésus que le fils de Dieu, non un Dieu, et c’est pourquoi il avait adressé sa prière à Dieu le Père. Or Dieu le Père l’avait abandonné dans sa détresse. Si Dieu n’avait pas d’oreilles, il n’avait, lui pas de lèvres ; si Dieu n’avait pas de pitié, il n’avait pas d’adoration. Il bravait Dieu et le bannissait de son cœur. »
« Ce fut ainsi toute sa vie. Il rompit par bravade avec les croyances que l’éducation lui avait inculquées, il passa du côté des révoltés qui usent leurs forces dans la lutte. »
Niels part à Copenhague faire ses études ; il décide qu’il doit devenir poète, son ami Erik devient lui peintre ; il l’introduit dans le cercle d’une veuve, Madame Boye dont Niels devient amoureux.
« Mais lorsque la victoire lui fut acquise et qu’il l’eut rendue telle qu’il la voulait, il vit qu’il avait trop bien travaillé, qu’il l’avait aimée avec ses illusions, ses préjugés, ses rêves et ses erreurs, non telle qu’elle était maintenant. »
Celle-ci commençait à l’aimer, mais lui « Mécontent de lui, d’elle de ses compatriotes, il partit et ne revint pas. »
Niels avait pour Idéal l’athéisme, il le brandissait comme un drapeau.
Après le décès de son père, il s’occupe de sa mère malade, il voyage avec elle mais celle-ci toujours portée par ses rêves n’apprécie pas la réelle beauté des paysages, des choses, elle meurt. Niels repart à Copenhague retrouver Madame Boye, laquelle lui annonce son prochain mariage. Niels perd donc la femme qu’il aimait ; ce sera ainsi toute sa vie. Amoureux d’une cousine, Fennimore, celle-ci lui préfère son ami Erik.
Niels continue à avancer, travaille mais poursuit en vain et son ideal et la position de poète qu’il désire. Rappelé par Erik qui n’arrive plus à créer, il retombe amoureux de Fennimore, et consomme avec elle l’amour adultère. Lorsqu’ Erik meurt brutalement dans un accident, Fennimore rongée par les remords chasse haineuse Niels. Il l’a perd donc une seconde fois.
Après avoir voyager pendant 2 ans, il décide de regagner la maison paternelle et ses terres, les valorise avec son jardinier et reprend une vie de simplicité. Une famille qui était amie de son père s’installe dans une ville voisine, la jeune Gerda attire son attention, ils se marient et ont un enfant. Serait-ce enfin le bonheur ? Niels convainc Gerda à son Ideal, à l’athéisme, elle devient fanatique. Une grave maladie atteint Gerda et au seuil de la mort, alors que Niels ne pouvait l’imaginer, elle réclame le secours du Pasteur.
A son tour l’enfant tombe gravement malade, il n’y a pas de médecin qui puisse venir rapidement, il meurt malgré que
: « Oh alors ! il menaça le ciel de ses poings fermés, il fit le geste d’éteindre son enfant, pour l’emporter, bien loin, et puis il se jeta à genoux et il pria Dieu, ce Dieu qui est au ciel, qui tient le monde sous l’empire de la terreur en lui infligeant la misère, la maladie, la souffrance et la mort, qui veut que tous les genoux fléchissent et au regard de qui l’on ne peut échapper, pas plus à l’extrémité des mers qu’au fond des abîmes ; ce Dieu qui, si telle est sa volonté, écrasera sous son pied l’être que tu chéris le plus au monde et, en le torturant, le fera retourner à la poussière dont il le crea.. »
« Dans son désespoir il savait ce qu’il faisait. Il avait été tenté et il avait succombé. C’était une chute, une défection ; il avait renié ses principes et trahi son idéal. Sans doute il avait la tradition dans le sang ; depuis des milliers d’années l’humanité s’adressait au ciel dans sa détresse. Il savait pourtant que les dieux sont des chimères, et qu’en priant il s’adressait à une chimère […] »
« En effet, ces grands mots, athéisme et sainte cause de la vérité, n’étaient que des noms pompeux décernés à cette chose si simple : accepter la vie comme elle est avec ses inéluctables lois »
Anéanti Niels s’engage dans l’armée alors que meurt le roi Frédéric VII, il est rapidement touché par une balle , il se meurt, son ami et médecin Hjerrild lui demande s’il veut voir un prêtre. Niels s’insurge mais à force de souffrance il arrive à penser : « C’eut été une bonne chose, tout de même, d’avoir un Dieu à qui adresser des plaintes et des prières. Il s’éteint deux jours après.
***
Donc Niels toute sa vie porta le drapeau d’un Idéal qui lui échappa, il perdit les femmes qu’il aimait et sa vie pour son pays. Nul ne peut lutter contre les lois de la vie, contre la réalité de la vie. Si les dieux sont des chimères, les idéaux aussi, hélas pour Niels (et pour nous ?)
Le poids de l'héritage religieux est aussi évoqué, dans l'enfance de Niels, puis lors des tristes épisodes où la mort surgit.
Très belle écriture, qu’elle évoque la réalité ou la poésie. C’est un livre qui ne délivre pas du bonheur, plutôt une attente vaine. Telle la vie de l’auteur à ce que j’ai pu comprendre dans la préface de Rilke.
Mots-clés : #jeunesse #portrait #psychologique #reve
- le Sam 9 Jan - 11:24
- Rechercher dans: Écrivains de Scandinavie
- Sujet: Jens Peter Jacobsen
- Réponses: 6
- Vues: 726
Paule du Bouchet
Emportée

Parution augmentée mars 2020 (1ère édition Actes Sud 2011), édition des femmes - Antoinette Fouque, 120 pages environ, suivies de 80 pages environ de correspondances entre Tina Jolas et Carmen Meyer.
Cet Emportée est poignant, en ce sens que Paule du Bouchet nous fait toucher du doigt, sans fard ni emphase, toute la souffrance et la détresse de la vie des du Bouchet, en premier lieu la sienne.
Résumons:
Août 1949, André du Bouchet et Tina Jolas s'épousent, fraîchement débarqués de New-York.
Naissent Paule et 1951 et Gilles en 1954.
En 1956, c'est le début pour Tina Jolas-du Bouchet d'une liaison passionnée avec René Char, ami d'André du Bouchet.
Tout en devenant une ethnologue relativement en vue, Tina Jolas est aux côtés de René Char, un appui sans faille, pas vraiment un rôle de muse, René Char finira pourtant, octogénaire, à un an de son décès, par en épouser une autre, Marie-Claude Le Gouz de Saint-Seine, éditrice, aujourd'hui Mme veuve Char.
Tina Jolas survivra à Char une dizaine d'années à Faucon (Vaucluse) avant de s'éteindre en septembre 1999, soit un peu moins de deux ans avant le décès d'André du Bouchet.
Paule du Bouchet a énormément souffert. André du Bouchet aussi, pour Gilles du Bouchet on ne sait pas: peut-être dans un prochain opus de sa sœur (ce serait le continuum des deux que je commente sur ce fil), à moins, bien sûr, que l'intéressé...
J'ai toujours su qu'il faudrait la mort. Enfant, je pensais que celle de Char me rendrait ma mère. Il y avait dans leur amour quelque chose d'irrémédiable comme la mort. [...] Petite fille, j'ai souhaité ardemment, de façon constante, qu'il disparaisse, prié tous les dieux du ciel et de la terre, fabriqué et piqué d'aiguilles des poupées de chiffon pour qu'il meure. "Mon Dieu, faites qu'il meure". Il ne mourait pas, et il était le Dieu de ma mère.
Ma mère a été l'incarnation de ma détresse et l'incarnation de la lumière.
Un jour, mon père m'a rapporté une formule qui lui était venue autrefois, au temps de la grande souffrance. Une pensée avait surgi, qui l'avait frappé et soulagé, comme l'évidence, parfois, a ce pouvoir de cautériser. Énoncée ainsi: "la souffrance n'est pas un argument". Surtout, il m'avait dit cela, à moi. Sur le moment, je n'ai pas compris. Je l('ai entendu alors, mais compris des années plus tard. Ma souffrance, je l'ai certainement utilisée comme un "argument", un levier qui a justifié tous mes errements, tout le poids que j'ai fait peser à ceux qui m'aimaient, elle en particulier, ma mère.
(avec sa mère, les avant-bras tailladés après une tentative de suicide)
- Tu aurais préféré que je meure plutôt que de t'appeler quand tu es chez lui.
- oui.
Reste la fin, très belle, poétique, je me retiens -parce que c'est la fin- de reproduire ici un extrait, j'ai vraiment été étonné de trouver ça là, et l'ai beaucoup apprécié.
Les missives de la correspondance Tina Jolas -Carmen Meyer viennent faire contrepoint. Tina Jolas nous échappe, d'ailleurs, n'a-t-elle pas échappé à tous, sauf à René Char ? Mais, l'espèce de vivacité solaire de sa plume, sa liberté, son ton - du moins avec son amie, cela illustre un caractère, une personnalité hors normes.
Et puis je vais peut-être redonner une chance aux écrits de René Char - à commencer par ceux que Tina Jolas indique, qui n'étaient pas ceux sur lesquels mes tentatives avant permis personnel d'inhumer m'avaient conduit...
Mots-clés : #famille #portrait #relationdecouple #relationenfantparent #temoignage
- le Mar 5 Jan - 20:45
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Paule du Bouchet
- Réponses: 4
- Vues: 827
Vénus Khoury-Ghata
Marina Tsvétaïéva, mourir à Elabouga
Boulimique d'écriture et de liaisons, une vie d'une rare dureté, faite d'épreuves dont on ne se relève généralement pas.
Hors ceci, Marina Tsvétaïéva est et restera une poétesse-phare de la langue russe au XXème -si je puis conseiller son recueil Insomnie, lequel s'ouvre sur de très touchants poèmes saphiques-, cet opus de Vénus Khoury-Ghata permet d'apréhender le phénomène:
Marina Tsvétaïéva ce sont plusieurs vies, généralement misérables et déchirées, et un talent multi-facettes boudé de son vivant, du moins après la révolution d'Octobre mais reconnu et pleinement appréhendé de nos jours (autre exemple, ses traductions, surtout celles du russe vers le français, étaient dédaignées à son époque, elles font autorité aujourd'hui).
Le livre s'ouvre sur Marina Tsvétaïéva, revenue en Russie, dans une masure insalubre à Elabouga (Russie), en haillons, qui gratte les sillons de la terre gelée de ses mains pour glaner quelques pommes de terre échappées à la récolte, efin de nourrir son fils Mour, qu'elle se plaît à croire issu de plusieurs pères, avant de se suicider par pendaison au bout de sa trajectoire d'errante misère.
Elle fut de la très haute société moscovite du temps du Tsar, puis épousa un futur Blanc (Serge) contre l'avis paternel (déjà rebelle). Déçue par la France, mais aussi par l'Autriche et l'Allemagne, l'exil de la haute société russe bardée d'argent, par les cercles et coteries littéraires françaises et occidentales, marquée par la mort de faim de sa fille Irina dans un pensionnat et la culpabilité qui va avec, puis par les rapports détestables qu'elle entretient avec sa fille Alia, très douée, qu'elle refuse de mettre en pension et dont elle se sert comme souillon, comme bonne à tout faire. Marina Tsvétaïéva n'a jamais su être mère.
Déçue aussi par Natalie Clifford Barney et Renée Vivien, leur cercle huppé littéraire et saphique, dans lequel, paraissant en haillons (elle, née princesse !) parmi ces belles dames en atours splendides, elle est une curiosité, l'ornithorynque dans le lac aux cygnes.
En dépit de ses engouements, de ses amours, de ses contacts tellement multiples (Rilke avec lequel elle entretint une longue correspondance, Mandelstam, Gorki, Nicolas Granki, André Biely, Anna Akhmatova, Pasternak, Nina Berberova, Ilya Erhenbourg, etc....) elle choisit l'irrémédiable, retourner en Russie prétextant que les littérateurs de l'exil ne valent pas ceux restés au pays, malgré ce que cela signifie: une mort encore plus misérable qu'en occident, la prison ou à tout le moins l'exil (ce sera Elabouga).
Vénus Khoury-Ghata, inspirée, nous narre cela d'une écriture dure, sans concession, aux teintes bleu-froid. Avec son côté cru, son refus d'apitoiement (il eût été si facile de signer une bio qui fût un tantinet mélo, mais la grande dame de Bcharré ne semble pas manger de ce pain-là...).
Volochine a vite compris que tu étais une sauvage incapable de penser comme tout le monde, incapable d'adhérer à un mouvement.
Tu l'amusais alors que tu voulais attirer son attention.
C'est chez lui à Koktebel en Crimée que tu as rencontré le jeune Serge Efron, épousé un an plus tard contre l'avis de ton père incapable de s'opposer à tes désirs. Tu imposais ta volonté, imposais une écriture qui n'avait aucun lien avec celle des poètes qui t'ont précédée.
Tu fascinais, dérangeais. Tu faisais peur.
Mots-clés : #biographie #ecriture #immigration #portrait #violence #xxesiecle
- le Dim 6 Sep - 10:09
- Rechercher dans: Écrivains du Proche et Moyen Orient
- Sujet: Vénus Khoury-Ghata
- Réponses: 27
- Vues: 6893
Yasunari KAWABATA
Tristesse et Beauté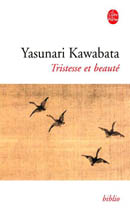
Dès le début, le lecteur apprend que Oki, le personnage principal, se rend à Kyôto avec l’intention de rencontrer Otoko qui y réside ; Oki a violé Otoko, qui avait seize ans, il y a vingt-quatre années de cela, alors que lui-même avait trente et un ans (et était marié avec un enfant) ; elle eut de lui un bébé mort-né avant de tenter de se suicider et d’être internée dans un hôpital psychiatrique ; Oki regrette « d’avoir arraché cette femme aux joies du mariage et de la maternité », qui était tombée amoureuse de lui… et l’est toujours.
Oki est écrivain, et a écrit un roman à succès, son chef-d’œuvre, sur son amour pour Otoko (ce qui a d’ailleurs ravagé sa femme, qui tapait le manuscrit et fit une fausse couche) ; on peut soupçonner une mise en abyme autobiographique, ou au moins fantasmatique…
« Oki avait intitulé son roman Une jeune fille de seize ans. C’était un titre ordinaire et sans grande originalité, mais il y avait vingt années de cela, les gens trouvaient assez surprenant qu’une écolière de seize ans prît un amant, mît au monde un bébé prématuré et perdît ensuite la raison pendant quelque temps. Oki, pour sa part, ne voyait rien là de surprenant. »
Jalouse, Keiko, jeune élève peintre et amante d’Otoko, séduit Oki, puis son fils, pour venger celle-ci.
Roman paru en 1964 au Japon, Kawabata, Nobel 1968, dans l’esprit du temps et du lieu, à partir des faits ci-dessus, crée un chef-d’œuvre de délicatesse, de sensualité, de spontanéité, de psychologie autour de la douce Otoko et de la fantasque, ardente, belle, terrible Keiko. Érotisme de l’oreille et tombes de « Ceux dont nul ne porte le deuil »…
« Mais un roman doit-il être forcément une jolie chose ? »
La réponse en l’occurrence est oui, en tout cas pour la forme. Des reprises avec variations répètent par moments des éléments de l’histoire, effet musical qu’on peut aussi rapprocher d’une conversation naturelle du narrateur. C’est notamment remarquable au début de la partie Paysages de pierres (jardins zen), qui m’a particulièrement plu.
Mots-clés : #amour #erotisme #portrait #psychologique
- le Dim 23 Aoû - 21:25
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: Yasunari KAWABATA
- Réponses: 83
- Vues: 8077
Page 1 sur 2 • 1, 2 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages