La date/heure actuelle est Dim 24 Nov - 2:41
228 résultats trouvés pour nature
GRAFF Andrew J.
Le radeau des étoiles
« Claypot, dans le Wisconsin, 1999 habitants, siège du vaste comté boisé et peu densément peuplé de Marigamie », Bread et Fish, dix ans, sont amis, et passent leurs étés à la ferme de Ted, le grand-père de Fish (son père est mort à la guerre). Mais le père de Bread le bat, et Fish l’abat avec son propre revolver. Les deux gamins s’enfuient dans la forêt de Mishicot, et le shérif Cal, arrivé depuis peu du Texas, se lance à leur poursuite avec Ted. La mère de Fish et Tiffany, une jeune déshéritée qui écrit des poèmes et s’est éprise de Cal (et réciproquement, mais sans se déclarer), s’élancent à leur tour, tandis que Jacks, le chien de Cal (confié à Tiffany et s’étant enfui), a rejoint son maître. Bread et Fish construisent un radeau, et descendent une rivière dont ils ne savent pas qu’elle aboutit à des chutes.
Livre rafraîchissant, surtout à cause des deux gamins ‒ peut-être même un livre jeunesse.
La nature tient une place importante dans l’histoire, avec cerfs, ours et coyotes.
« Cal avait entendu dire que lorsqu’une meute se rassemble, hurle et se tait subitement, c’est qu’elle commence à chasser. »
Graff insiste sur certaines précautions d’usage dans le wild, mais trop souvent négligées par les néophytes (répartir les matériaux essentiels entre chaque membre de l’équipe ; la lame emportée ne vaut que si on a aussi emmené de quoi l’affûter).
J’ai également noté la prégnance états-unienne des armes à feu, et de la religion.
\Mots-clés : #aventure #enfance #merlacriviere #nature
- le Jeu 19 Sep - 10:57
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: GRAFF Andrew J.
- Réponses: 17
- Vues: 283
Élisée Reclus
Histoire d'une montagne
Approche de l’orologie, de la géologie, de la sédimentologie, et même de la paléontologie, ce même curieux mélange d’observation juste et de souffle épique. Et toujours cette conscience du temps long qui m’est si sensible.
« Toutefois, dans ce décor changeant ou toujours varié produit par l’action continuelle des forces de la nature, la montagne ne cesse d’offrir une sorte de rythme superbe à celui qui la parcourt pour en connaître la structure. »
Éboulis :
« D’ordinaire, ils en sont avertis quelque temps à l’avance. La poussée intérieure de la montagne en travail fait vibrer incessamment la pierre du haut en bas des parois. De petits fragments, à demi descellés, se détachent d’abord et roulent en bondissant le long des pentes. Des masses plus lourdes, entraînées à leur tour, suivent les pierrailles en dessinant comme elles de puissantes courbes dans l’espace. Puis viennent des pans de roche entiers ; tout ce qui doit crouler rompt les attaches qui le retenaient à l’ossature intérieure de la montagne, et d’un coup la grêle effroyable de quartiers de roches s’abat sur la plaine ébranlée. Le fracas est indicible ; on dirait un conflit entre cent ouragans. Même en plein jour, les débris de roches, mêlés à la poussière, à la terre végétale, aux fragments de plantes, obscurcissent complètement le ciel ; parfois de sinistres éclairs, provenant des rochers qui s’entrechoquent, jaillissent de ces ténèbres. Après la tempête, quand la montagne ne secoue plus dans la plaine ses roches disjointes, quand l’atmosphère s’est éclaircie de nouveau, les habitants des campagnes épargnées se rapprochent et viennent contempler le désastre. Chalets et jardins, enclos et pâturages ont disparu sous le hideux chaos de pierres ; des amis, des parents y dorment aussi de leur grand sommeil. »
Physique des nuages :
« Des nuages détachés s’éparpillent librement dans le ciel, ils se rejoignent, se cardent ou s’effilent sous le vent, s’étalent ou s’envolent et montent jusque dans l’atmosphère supérieure, bien au-dessus des cimes les plus élevées de la terre ; la diversité de leurs formes est beaucoup plus grande que celle des nuages qui ceignent les sommets de la montagne. Cependant ceux-ci présentent également une singulière mobilité d’aspect. Tantôt ce sont des nues isolées qui se déplacent avec les nappes d’air froid ; on les voit alors serpenter en rampant dans les ravins ou cheminer le long des arêtes en s’effrangeant aux roches aiguës. Tantôt ce sont de gros nuages qui cachent à la fois toute une pente de la montagne ; à travers leur masse épaisse, qui grossit ou diminue, se déplace ou se déchire, on distingue de temps en temps la cime bien connue, d'autant plus superbe en apparence qu’elle semble vivre et se mouvoir entre les vapeurs tournoyantes. D’autres fois, les nappes aériennes superposées et de températures différentes sont parfaitement horizontales et distinctes comme des strates géologiques ; les nuages qu’on y voit naître ont une forme analogue : ils sont disposés en bandes régulières et parallèles, cachant ici des forêts, là des pâturages, des neiges et des rochers, ou les voilant à demi comme une écharpe transparente. Parfois encore les cimes, les pentes supérieures, toute la haute montagne est noyée dans la lourde masse des nues, semblable à un ciel gris ou noir qui se serait abaissé vers la terre ; la montagne s’éloigne ou se rapproche suivant le lieu des vapeurs qui diminuent ou s’épaississent. Soudain, tout disparaît de la base au sommet : le mont s’est en entier perdu dans les brumes ; puis l’orage descend des cimes, il fouette cette mer de lourdes vapeurs, et l’on voit le géant apparaître de nouveau "noir, triste, dans le vol éternel des nuées." »
\Mots-clés : #nature
- le Ven 19 Juil - 0:15
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Élisée Reclus
- Réponses: 15
- Vues: 534
Henri Bosco
Un oubli moins profond
Dans le premier volume de ses souvenirs d'enfance, Henri Bosco présente d’entrée son projet et sa démarche :
« Voici des souvenirs.
Tels qu'ils sont revenus à moi du fond de ma mémoire, je les ai notés et je les présente.
Je ne raconte pas une suite d'événements qui se succèdent pas à pas, et ainsi qui s'enchaînent.
Je prends, au hasard des retours, les personnages et les faits qui vivaient encore, ou qui sommeillaient, dans le passé de mon enfance.
Je ne les ai pas recherchés, j'ai attendu. »
Première partie, Ces premières images… : « enfant docile et secret », douloureusement sensible, rêveur (et fils unique et couvé), il naît en Avignon, puis vit dès trois ans à la campagne, mais toujours dans un univers maternel de « signes », souvent funestes, un monde de l’invisible et des morts toujours présent.
Née peu après lui, sa sœur ne vit pas :
« Mais parmi les Ombres qui hantent mes oraisons nocturnes (et il y en a onze que je nomme toutes), celle-ci a sa place. »
S’ensuit un commerce avec les revenants, qui imprégna toute l’œuvre future.
Une enfance solitaire, mais aussi l’âne à pantalons du marchand des quatre-saisons des mas isolés, Gros-Lapin aux onze enfants, qui mourut lorsqu’il eut vendu le vieil animal aux Caraques ; les chouettes qui inspirent une méfiance superstitieuse ; outre cultivateurs et artisans, sept acrobates espagnols, un équilibriste, un jongleur, deux clowns et une danseuse, tous tristes, font partie du maigre voisinage ; le village de Barbentane, la Durance et le Rhône ; Tante Martine ; Bargabot le braconnier et Béranger, le vieux pâtre ; Tortille et Rachel, d’origine caraque, et le vieux Peppino gardant un hangar de costumes de théâtre...
« Et tout ce qui est plat m'attriste beaucoup.
– Plat pays, pays pour la pluie, disait Tante Martine.
Elle avait raison. Car jamais pays plat n'est aussi plat que quand il pleut, et jamais pluie n'est aussi pluie qu'en pays plat. Qui ne l'a noté ne sait rien, ni de la pluie ni de la plaine. Encore qu'il y ait, je le reconnais, plaine et plaine. Ainsi la Camargue en est une, mais quels lointains !... Rien ne les coupe. Et c'est la chance des beaux pays plats que rien n'en interrompe au loin la platitude, sauf les immenses et mystérieux nuages qui y prennent naissance, mais alors c'est un autre monde qui monte sur la plaine, et qui met tant d'imaginaires pays sur l'horizon, que la plaine bientôt est pareille à la mer et devient à perte de vue comme une étendue chimérique. On n'est plus sur la terre… »
« Mais ailleurs [L'enfant et la Rivière, Le Renard dans l'île, Barboche, Bargabot] j'ai assez parlé de Bargabot et du vieux Béranger pour me dispenser d'en dire plus long sur leur compte. Je me borne ici à en rappeler l'existence et, par amitié pour leurs Ombres dont personne au monde n'a plus de souci, j'ai placé au milieu de mes vieux souvenirs leurs deux noms où sont attachées leurs âmes disparues. Lorsque je les prononce, ces âmes sortent de l'oubli et je les vois encore dans la forme de ces figures qui vivaient et erraient au bord de la rivière, au temps où j'y errais moi-même, enfant solitaire que hantaient les eaux, qu'attiraient au-delà des eaux les collines…
J'ai conservé en moi ces eaux et ces collines. Je n'ai guère d'efforts à faire pour m'y retrouver, non tel que je suis devenu, mais tel que j'étais aux jours les plus émouvants d'une enfance qui dut suppléer par des songes à la monotonie d'une vie inégale aux désirs, aux chaleurs du sang, au besoin d'espérance. Tout me revient quand je l'évoque, et je l'évoque plus souvent à mesure que je m'enfonce davantage dans la vieillesse. Ce n'est pas mouvement de regret, nostalgie, car cette enfance ne fut pas heureuse, mais pour me découvrir tel que je suis, puisque je l'étais bien plus clairement à cet âge tendre, où ce qui sera aspire de toutes ses forces à le devenir. Et il y a aussi ce qui ne sera pas, ce qui était possible, et qui non moins vivement voulait vivre, mais que les malchances ou quelque faiblesse cachée ont peu à peu écarté de la vie. Nuage qui est né entre la rivière lointaine et cet aujourd'hui, ce poste de veille, éminence mélancolique, d'où l'on revoit en bas, dans une vague plaine, les ruines éparses le long des années. »
Seconde partie, Nocturnes… : inquiétudes, comme avec Babâou, qui se promène la nuit et aboie :
« Fait curieux, il avait perdu la raison, mais non pas la mémoire. Seulement on n'arrivait pas à savoir si ce qu'il en tirait était du souvenir, ou un rêve sur ce souvenir. Comme il racontait quelquefois d'étranges choses, on se disait qu'il inventait, et on le croyait naturellement, quand il en racontait de tout à fait banales. Or, on le sut plus tard, les étranges événements qu'il se rappelait étaient bien de vrais souvenirs, et les banalités, des bribes, des déchets de mauvais rêves. »
« Gros Sel », la petite épicerie écartée, à la limite de l’octroi de ville, et les « rats de cave » luttant contre une « contrebande communale »…
« Dame Gude était timorée, trotte-petit, grignotte-galette, tricote-menu. Une souris qui fait ses comptes. »
Même les amours… : le bastidon des vacances, près des « Lauzes » et de Lourmarin (découverte à huit ans de l’amour dans Paul et Virginie, et Cyprienne au faîte du cyprès) :
« Tout le mal (les soucis, les remords, les folles initiatives) résultent trop souvent des commentaires qu'on se croit obligé de donner à la vie, dont le grand secret, pour les sages, se réduit toujours à la vivre. »
« Un « bastidon », c'est au plus trois pièces, un fronton, sa génoise, le roc, un peu d'eau (pas beaucoup), du soleil, beaucoup de soleil et très peu d'ombre. Mais le grand air, une vue immense et la paix. »
La génoise, c’est la frise provençale composée de tuiles superposées et fixées dans le mortier (Louis Réau, Dictionnaire polyglotte des termes d'art et d'archéologie).
« De nature j'ai toujours été très timide, mais, également de nature, j'ai été curieux, plus curieux que timide. D'autre part quand un geste à faire m'intimidait trop, il me prenait toujours une envie inquiétante de l'accomplir le plus vite possible, pour en finir aussi le plus vite possible avec cette timidité insupportable. J'étais alors si tourmenté que je finissais par céder à mon envie. De là mes plus étranges escapades, en contradiction, semblait-il, avec ce que tout le monde louait de mon humble personne. »
Puis ce sont les histoires de Thérèse, et d’Isabelle la boulangère.
« Car Thérèse tenait bien moins à tel ou tel galant qu'à l'amour même. Si chacun de ceux-ci pouvait lui offrir de l'amour, l'un pouvait donc remplacer l'autre, sans que Thérèse y vît beaucoup de différence. Elle en aimait trop pour avoir l'obsession d'en aimer un seul. »
Familles : de grand-mère Louise et grand-père Marcelin, dit « La Vertu de Lorgues », à la famille marseillaise, en passant par Tante Martine et Baptistin, « Oncle Sabre », l'Oncle Thomas, etc.
Un romancier… : sa mère lui ayant appris le sortilège de la lecture, son père lui ayant fabriqué un petit pupitre (ainsi qu’une canisse qui occulte la vue et le livre aux songes) Henri Bosco écrit sa première fiction à sept ans (il a été scolarisé bien plus tard). Il dit tenir son imagination de son père, qui lui contait le soir une histoire pastorale :
« Créés d'abord pour m'endormir, ces contes ne m'endormant pas, mon père et ma mère, qui le constataient, auraient pu raisonnablement les interrompre. Mais sans doute eux-mêmes en les supprimant y eussent perdu un plaisir. Car ce plaisir, ils le prenaient, et déjà je n'en doutais guère. Il y avait, en effet, de ces nuits dans ma petite chambre où un émerveillement en commun nous saisissait tous trois. Mon père était charmé des trouvailles inattendues qu'il tirait si facilement de sa tête, ma mère s'étonnait d'une telle imagination et, quoi qu'elle en eût, l'admirait.
Et moi, ah ! où étais-je ? sinon dans ce monde où tout est si vrai qu'on y croit, mais serait d'ailleurs incroyable si tout n'était pas inventé. »
Il observe la canisse "en soi" :
« J'ai acquis à la regarder chaque jour et pendant des heures entières, le goût de connaître les choses. Car c'était une chose. Or, un goût poussé à ce point vous fait peu à peu découvrir que, sous un mot qui nous la voile, un seul mot, un mot qu'on répète, il y a plus de choses qu'il ne nous en offre dans la seule chose qu'il nomme. Il nous montre le tout et l'on s'y tient. Il nous cache ce que ce tout renferme nécessairement, quel qu'il soit, d'indicible, pour être ce qu'il est, et rien de moins. En somme, à étudier roseau par roseau, cette muraille végétale, à en suivre la vie qu'y menaient avec persévérance des bêtes minuscules, j'ai pris alors le sens positif du concret. […]
Ainsi, ma « canisse » m'offrait, d'une part un objet riche de matière et de vie, et d'autre part un stimulant à passer outre par les puissances imaginatives. Elle me montrait ce qui était là, et me donnait l'envie, le besoin, la passion de cet au-delà d'où nous vient la révélation et la nostalgie des étendues.
Quoi qu'il en soit, me voilà donc regardant la « canisse » et rêvant à la regarder.
Je me vois encore devant mon pupitre où, à force de demeurer sans rien faire, mais l'esprit toujours en travail, je sentais en moi le désir de faire quelque chose. Mais, du moins au début, ce désir n'est pas suffisant à nous mettre en train. Désirer faire quelque chose c'est d'abord désirer que se produise quelque événement. On est inactif, on attend, il n'arrive rien et, on a beau attendre, désirer et attendre, rien ne répond à ce désir, à cette attente. Il ne nous reste qu'à nous inventer ce que la solitude nous refuse. »
Et il rédige ce qui deviendra L'Enfant et la Rivière.
« J'entrepris un rêve, un rêve éveillé. »
Annonces de la solitude :
« Ce qu'on doit être, on l'est. On l'est avant le fruit, avant la fleur, avant même la graine close. Il suffit pour le devenir que le temps commence à pousser notre vie encore en sommeil vers une existence formelle et que les événements – créatures et circonstances – y imposent les premières flexions qui en détermineront le dessin futur. »
« Une maison vit comme vit un homme, un homme qui parfois, mais non pas toujours, est son âme. Rien en ce monde n'est construit qui ne soit, si l'on cherche bien, à l'image du monde, et l'homme comme la maison, la maison comme l'homme. C'est pourquoi tout événement qui se produit dans l'un est entendu de l'autre. »
Accent pongien ?
« Le silence d'un objet calme – d'un objet aux formes très bien accordées – en raconte plus long que l'imaginaire réponse de tel autre objet contourné, façonné dramatiquement, expressif à dessein et qui violente la matière naturellement sans impatience. »
« Jadis l'enfant ne commentait pas, il vivait. Il était là où il était. Je n'y suis plus et je rôde, faute de mieux, autour de ma mémoire. C'est vouloir circonscrire des nuées. On s'y perd… »
Accent bachelardien dans « l'être de la lampe » :
« Mais quelques-uns avaient, par leurs dimensions, leur activité, leur rôle nécessaire, une place prééminente. Ainsi la lampe et la pendule. Ce ne sont pas là des choses passives. »
« Le jour n'a pas besoin de lampes. La lampe a besoin de la nuit. »
Et pour finir… : sa religion, maternelle.
Le chantre de l’enfance nous révèle ainsi que tout ce qu’il écrivit par la suite fut véridique, aussi vrai que dans son rêve.
\Mots-clés : #autobiographie #contemythe #ecriture #enfance #famille #lieu #nature #relationenfantparent #reve #ruralité #solitude
- le Lun 1 Juil - 12:30
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Henri Bosco
- Réponses: 129
- Vues: 16160
André Demaison
Intrigues dans la forêt
C’est l’histoire de la déforestation préalable à une nouvelle plantation en Afrique subsaharienne : le narrateur est associé à un jeune homme et un couple d’autres Blancs, et ils sont entourés de tribus leur fournissant la main-d’œuvre.
Le narrateur-auteur est sensible à la nature qu’il détruit partiellement, répugnant notamment à chasser.
« Comme s’ils se réjouissaient d’entendre des nouvelles dans leur altière solitude, les azobés, les dabémas, au panache étalé dans le ciel, balançaient largement leur tête sur d’invisibles épaules. Ainsi la sève, pompée par ces mouvements alternatifs, montait jusqu’aux feuilles dentelées ou arrondies, en forme de cœur ou de spatule. […]
Les fûts de ces grands arbres étaient animés d’un rythme lent et souple. Rien ne peut mieux masser leurs fibres lisses qui montent tout droit jusqu’à trente ou cinquante mètres avant de porter une seule branche. »
« Voyez-vous, l’arbre est à l’animal ce que le glacier est à la rivière. Il n’existe entre eux qu’une différence de forme et d’allure. »
« Les gestes des arbres, qui paraissaient animés dans la clarté confuse du jour, je les voyais immobilisés à la lumière des torches et des lampes. Tout était figé par la surprise. »
« Par moments, nos pieds glissaient sur d’énormes escargots que les nègres ramassaient pour ne point perdre une chair vivante. D’autres fois, nous écrasions des cent-pieds qui laissaient derrière nous une trace phosphorescente. »
« Ce qu’il y a tout de même de merveilleux chez les coloniaux, c’est que la mort vient souvent fréquenter leurs groupes sans réussir à ébranler la volonté des survivants. Ce fatalisme raisonné, cette acceptation des dangereuses conditions de leur existence, leur font pardonner bien des sautes d’humeurs, bien des défauts terribles ou enfantins. »
« Je remarquais des nids, même sur les poteaux du télégraphe qui, sans souci du godet de verre que les hommes avaient fixé à leur sommet, se comportaient comme d’énormes boutures, déjà branchues et feuillues. »
« C’est une pratique néfaste, qui consiste à brûler les hautes herbes dès qu’elles sont sèches, malgré les ordres du Gouvernement. Les Noirs pensent que la cendre enrichit le sol et que les reptiles sont exterminés par ces désastres locaux. Ils oublient qu’ils écartent ainsi les nuages et qu’ils dessèchent leur propre terre nourricière. »
(À noter que cette dernière pratique est toujours courante, quoique préjudiciable et interdite.)
Après diverses péripéties, survient la Seconde Guerre mondiale.
Témoignage évidemment partiel et partial, Demaison expose ses connaissances de la forêt africaine et du milieu des « coloniaux », aussi des tribus locales, mais plus superficiellement. Ses observations sont souvent intéressantes, quoique ses vues soient parfois faussées par une méconnaissance d’époque. De beaux aperçus des arbres, si difficiles à rendre.
\Mots-clés : #aventure #colonisation #nature #xxesiecle
- le Mar 11 Juin - 9:31
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: André Demaison
- Réponses: 2
- Vues: 131
Georges Limbour
Les vanilliers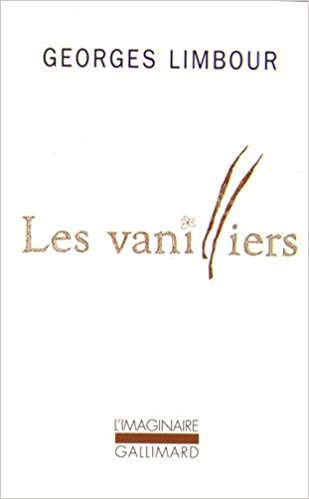
Jenny vit dans une île depuis la mort de sa mère emmi les odorants vanilliers au Mexique, avec son père, l’ancien archéologue De Bonald, maintenant au service d’un commerçant européen, le Hollandais van Houten (celui du chocolat). Ce dernier et Guillaume, son jeune fils, obèse, pâle, maladif, qui mourra bientôt, incarnent l’Occident venu accaparer les richesses indigènes et corrompre la nature.
Une épouvantable et mystérieuse « mort rouge » se répand tandis que les vanilliers importés s’étiolent stérilement, jusqu’à ce que le jeune Edmond, esclave noir, découvre incidemment le secret de la fécondation artificielle de leurs fleurs pendant son initiation érotique avec Jeannette, au cours de laquelle il inséminera secrètement Seira, la servante.
« La grosse bête s’éleva lentement de la boue qui submergeait son corps et levant son museau noir et gluant au-dessus des nénuphars pestilentiels qui semblaient vaguer sur la vase comme des crachoirs à bestiaux, elle souffla violemment pour chasser la fange qui lui obstruait les narines. Elle n’était pas noire, son pelage semblait grisonner. Obèse, empâtée, poivre et sel, elle semblait traîner difficilement le souci de l’île, le grand tracas des vanilliers stériles. »
« La grande main de la tristesse semblait presser doucement les arbres comme l’enfant sur la plage, las de bâtir des châteaux, laisse rêveusement couler du sable de son poing fermé. »
Une histoire de l’introduction de la tulipe de Chine met ce récit lui-même en abîme : le thème principal est le désordre cruellement mis dans la nature par l’humanité avec la mondialisation. Cette histoire reprend l’Histoire factuelle en y instillant subtilement les distorsions de l’imaginaire, empreinte de poésie et de drolatique, rappelant un peu les œuvres de Raymond Roussel.
\Mots-clés : #colonisation #nature #poésie
- le Lun 10 Juin - 7:02
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Georges Limbour
- Réponses: 8
- Vues: 1194
Hubert Haddad
Le Peintre d'éventail
Xu Hi-han, le narrateur (mais pas toujours le seul), raconte comme, dans la pension de dame Hison, une sorte de refuge à l’écart entre mer et montagne, son maître Matabei Reien rencontra le vieux jardinier et peintre d’éventail, Osaki Tanako.
Matabei est venu là oublier son passé : peintre prometteur, il a tué une jeune fille dans un accident de circulation, peu avant le séisme de Kobe.
Chez dame Hison, ancienne courtisane, il y a quelques habitués : Anna et Ken, un couple de jeunes amants clandestins, monsieur Ho, « un bon vivant négociant en thé et grand buveur », et Aé-cha, « l’éternelle vieille fille à demeure, coréenne d’origine ».
À la mort d’Osaki, Matabei, qui est devenu l’amant de dame Hison, le remplace. Xu est le jeune suppléant qui aide la vieille servante de la pension, et dont Matabei devient le mentor. Survient Enjo, une jeune femme dont le regard rappelle à Matabei celui de sa victime involontaire. Elle devient son amante, et Xu, qui l’aimait, part.
« Peindre un éventail, n’était-ce pas ramener sagement l’art à du vent ? »
« Comme au moins cent millions d’humains à cette seconde, tout se précipite, hanches contre hanches, peaux et souffles mêlés, chute de l’un dans l’autre au milieu des morsures et des glissements. Au plus fort de l’étreinte, l’ancienne courtisane considérait d’un autre monde cette sensation somme toute banale d’union intime et d’absence du fond même de la jouissance. C’était pour elle une évidence qu’on pût ressentir et ne pas ressentir les choses. Depuis une certaine nuit à Kyoto, elle avait appris à se détacher de la douleur ou de la volupté, sans rien pourtant en perdre. […]
Les complications burlesques de l’usage du sexe l’avaient effarée toute jeune, au moment des premiers rapports, ce goût de la honte et de la flétrissure, ces prétentions, ces hilarités imbéciles, et puis elle avait compris une fois enceinte l’exception bouffonne de cet acte, et sa monstruosité en accouchant avant terme. Dans les humeurs et la fièvre, chaque coït tentait de ranimer quelque chose de mort-né. »
Le jardin est central dans le récit, avec son harmonie qui répond à la nature fort présente (« la loi d’asymétrie et le juste équilibre comme un art de vivre »), et les lavis et haïkus du vieux maître en participent.
« Pourtant, une inquiétude avait sourdi au fil des saisons : pouvait-on repiquer, transplanter, tuteurer, bouturer, diviser, aérer, buter, attacher, éclaircir, pincer, pailler, et même arroser, sans perdre insensiblement la juste mesure et l’harmonie, ne fût-ce que de l’expression de tel angle facial, d’un détail répété des linéaments, de l’aménité indéfinissable des parties à l’ensemble ? Il avait beau se dire qu’un visage doit avoir le mérite de vieillir en beauté, que l’impermanence touchait toute chose de la nature, la sensation de trahir son vieux maître en cendres s’accusait avec l’automatisme de certains gestes. Chaque coup de cisaille devait être un acte conscient, en rapport avec les mille pousses et rejets, dans l’héritage des lunaisons et la confiance des soleils. Un jardin rassemblait la nature entière, le haut et le bas, ses contrastes et ses lointaines perspectives ; on y corrigeait à des fins exclusives, comme par compensation, les erreurs manifestes des hommes, avec le souci de ne rien tronquer du sentiment natif des plantes et des éléments. »
« Chaque saison est la pensée de celle qui la précède. L’été vérifie les gestes du printemps. »
« Toujours en décalage, hors de tout centrage selon le principe d’asymétrie, mais avec des répétitions convenues comme ces dispositions de rochers et d’arbres aux savantes distorsions et ces diagonales en vol d’oies des baliveaux, le spectacle changeant du jardin accompagnait le regard en se jouant des mouvements naturels de l’œil par à-coups et balayages, ce qui l’égarait dans sa quête d’unité par une manière d’enchantement continu ourdi de surprises et de distractions. »
« — Jardiner, c’est renaître avec chaque fleur… »
« La nature n’a besoin de personne, avait-il déclaré, le temps est son jardinier et elle laisse chacun libre. »
« La révélation qu’eut Matabei, un matin radieux de fin d’automne où les arbres en partie dépouillés semblaient faire connaissance, c’est qu’il devait s’agir pour le vieux sage d’une création simultanée et indissociable. Les lavis et l’arrangement paysager allaient de pair, comme l’esprit et l’esprit, les uns préservant les secrets de l’autre, en double moitié d’un rêve d’excellence dont il aurait été le concepteur obnubilé. »
Un tremblement de terre puis un tsunami suivi d'un accident nucléaire ravagent la région, où Matabei demeure solitaire dans un ermitage abandonné. Il y recompose les lavis délavés des éventails du maître, son « jardin de pensée ». Xu, qui est devenu un lettré et vient de se marier avec Enjo, le retrouve à temps pour sauver son œuvre. Clausule :
« La vie est un chemin de rosée dont la mémoire se perd, comme un rêve de jardin. Mais le jardin renaîtra, un matin de printemps, c’est bien la seule chose qui importe. Il s’épanouira dans une palpitation insensée d’éventails. »
Haddad use cette fois d’un ton poétique, onirique, parfaitement congru à cette histoire, parfaitement nippone, de contemplation de l’impermanence du monde.
« Bec et plumes
l’encre est à peine sèche
qu’il s’envole déjà »
\Mots-clés : #catastrophenaturelle #creationartistique #initiatique #lieu #nature #peinture #poésie #traditions
- le Dim 31 Mar - 11:30
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 31
- Vues: 2165
Hugues Le Roux
Chasses et gens d’Abyssinie
1er janvier 1901, l’expédition part chez les Issas (en actuelle Somalie), Gallas (Oromos) et Abyssins (Éthiopiens), jusqu’au Ouallaga, entre le Nil Blanc et le Nil Bleu. C’est un milieu où règnent la cruauté et la violence dont Le Roux rend compte, lui-même presque aussi impitoyable que bêtes et gens de rencontre. Et c’est, rédigé dans un français châtié, teinté d’humour, un témoignage sur le vif, document où l’histoire et l’ethnographie se rejoignent, et où les limites dans les relations qui vont de l’amitié à l’esclavage se font indécises. L’empathie côtoie le racisme (dont une anglophobie hors de propos).
« Le couple de jeunes gens qu'on me présenta aux chandelles ne laissa pas longtemps mon choix hésitant. Je m'enquis, bien entendu, de leurs aptitudes morales mais j'examinai surtout leurs yeux, leurs dents et leurs pieds. Les ophtalmies sont, au pays où nous vivons, une tare rédhibitoire ; les dents aiguës dans une mâchoire trop lourde indiquent des hérédités féroces. Et il importe que des gens qui auront à marcher pendant des mois aient les pieds nets, comme de bons chevaux. »
« Et vraiment la demi-instruction, que les missionnaires donnent ici à des enfants ramassés sur les chemins, les déclasse plus qu'elle ne leur profite. »
« L'étape des mulets est, presque chaque jour, de sept ou huit heures d’affilée ; il arrive que l'on atteigne douze ou quinze heures, voire, dans un cas de nécessité, que l'on marche vingt heures sur vingt-quatre. Alors, quand le point d'eau est joint, avant de songer à donner à boire aux maudits, ou de fournir à leur appétit un peu d'orge, on les abat brusquement, sur le flanc, on s'approche d'eux avec des couteaux que l'on a fait rougir dans la braise, et là, cruellement, pour leur bien, c'est-à-dire pour qu'ils puissent continuer à porter la charge, on les laboure, profondément, au fer rouge. On raie, on balafre, on sonde toutes les plaies. On explore à la flamme les cavités purulentes. On dessèche les fontaines de décomposition. L'indifférence, hélas ! vient vite en face de ces nécessaires supplices. Par contre, jamais mes narines ne se sont habituées à la fade odeur de poils roussis, de chair grillée vivante, de pus volatilisé, qui à ce moment-là, se répand dans l'air. Elle prend à la gorge. Elle nourrit et elle écœure. D'ailleurs, il n'y a pas à nier, le remède est bon. Abdi, qui n'a pas grande culture théologique, a retenu au moins cette parole évangélique, qu'il ne manque pas de prononcer chaque fois que ses mulets brûlés soigneusement, lui échappent d'un bond, et courent, tout noircis, se rouler dans la poussière :
– Allez, maudits, au feu éternel ! »
C’est Pierre Bergounioux dans son Carnet de notes 1988 qui a attiré mon attention vers ce livre (mais je ne suis finalement pas convaincu par son engouement).
« Je finirai la journée avec un bon livre de H. Le Roux, Bêtes et gens d’Abyssinie (1903). L’auteur est ce que Stendhal appelle « un caractère », à qui ne manquent ni un sens aigu et fort des choses ni un sûr talent d’écrivain. J’ai vérifié à deux reprises le dépôt légal tant m’a semblé neuve, toujours, irréprochable, une prose cynégétique qui est ordinairement médiocre, inégale aux heures exaltées, aux lieux chargés d’émotion, de violence contrôlée, calculée, qu’elle évoque. »
\Mots-clés : #aventure #esclavage #nature #voyage
- le Dim 24 Mar - 11:00
- Rechercher dans: Nature et voyages
- Sujet: Hugues Le Roux
- Réponses: 2
- Vues: 371
Pierre Bergounioux
Carnet de notes 1980-1990
Journal commencé à la trentaine, où Bergounioux note pour s’en souvenir les faits saillants de sa vie quotidienne (y compris la météo, à laquelle il est très sensible, étant plus rural qu’urbain) entre la Corrèze et la région parisienne, minéralogie, entomologie, pêche (à la truite), peinture, modelage, travail du bois puis de la ferraille, piano, archéologie préhistorique, descriptions (paysages, oiseaux), rêves nocturnes, ennuis de santé (lui et ses proches), famille et amis, son travail d’enseignant, et surtout ses copieuses lectures (et sa bibliophilie !), ses études qu’il prolonge ainsi, et ses souvenirs d’enfance (sa « vie antérieure », jusque dix-sept ans).
« Sur les zinnias voletaient Flambés et Machaons, ainsi que l’insaisissable Morosphinx. Jamais il ne se posait. Il oscillait dans l’air au-dessus du calice des fleurs, dans lequel il plongeait sa longue et fine trompe noire. Je n’ai jamais réussi, alors, à m’en emparer. J’en étais venu à le regarder comme une créature des rêves. Je percevais avec perplexité, avec dépit, l’existence de deux ordres, l’un que nos désirs édifient spontanément, l’autre, décevant, des choses effectivement accessibles, et l’impossibilité de franchir sans dommage ni perte la frontière. Est-ce que je m’en suis ouvert à quelqu’un ? Ai-je demandé des éclaircissements à ce sujet ? Peut-être. Papa aime à répéter, sardoniquement, que je fatiguais déjà tout le monde de questions. Mais je ne garde pas souvenir d’avoir obtenu la réponse. »
« Laver, nourrir, habiller les petits nous prend un temps infini. Comme la génération qui se forme pèse sur l’âge intermédiaire où nous sommes entrés, entre la dépendance à laquelle on est réduit, quand on commence, et celle où l’on va retomber avant de finir. »
« Ensuite, je peins – approches de la ville, avec, au premier plan, un canal, puis, sans l’avoir voulu, la façade de quelque château, flanqué de masures. À l’origine, c’était un pont sur l’eau à quoi j’ai fait faire un quart de tour. Quelque chose est apparu. Je ne parviens jamais de façon concertée à un résultat. Ce qui résulte d’un dessein arrêté est d’une banalité sans remède. C’est dans un angle mort, une dimension négligée, d’abord, d’un geste involontaire, que naissent la demeure des songes, la rive inconnue, la fête mystérieuse. »
« Toujours des soulèvements d’inquiétude, des éclairs d’angoisse, la crainte soudaine, panique, que le sursis qui me tient lieu de vie va prendre fin, que l’heure a sonné. Et ma réaction immédiate, indignée : qu’il est bien tôt, que j’ai beaucoup à faire, encore, qu’il me reste à connaître, à expérimenter, à aimer. »
« Tenté, au retour, de faire des essais de drapé avec du plâtre coulé dans un sac poubelle. J’avais été frappé, en avril, lors de la construction de la terrasse, des plis et volutes du ciment tombé, frais, dans la toile plastique froissée. Le résultat est décevant. Comment pourrait-il en aller autrement, au premier essai ? Et puis il faut que je revienne à ma lecture. Si j’excepte cette occupation dévorante, infinie, j’aurais bâclé ma vie, désireux que j’étais de répondre à l’appel de mille choses et conscient, tragiquement, qu’elle est trop brève pour pouvoir m’attarder plus qu’un court instant auprès de chacune d’elles. Comment étudier, pêcher, traquer les bêtes, chercher les pierres, les fossiles, peindre, modeler, menuiser, fondre, forger, rêver, respirer, regarder de tous ses yeux, être époux et père, professeur, fils et camarade, apprendre, avancer, ne pas oublier, ne jamais céder quand je suis sous la menace chronique d’être pris à la gorge sans rémission ? »
Début 1983, Bergounioux commence à écrire de la littérature.
« Malgré la fatigue, je reprends mon récit au commencement. J’essaie de le purger des approximations, des gaucheries. Je fais des phrases trop longues. C’est un de mes vices. Je me crois tenu, par mimétisme, d’envelopper une chose dans une seule et unique coulée syntaxique alors que, justement, le registre symbolique est autonome, relativement. »
Sa vie est partagée entre deux pôles, le travail dans l’Île-de-France, la nature pendant les vacances scolaires dans le Midi – et aussi le travail professionnel versus son « bureau » où il s’échine.
Ses phares sont Flaubert, Faulkner, Beckett, mais pas les seuls auteurs appréciés.
« Je lis les Chroniques italiennes de Stendhal avec un grand bonheur. Mais il a un âcre revers. Tout ce que je pourrais écrire s’en trouve terni. »
« Ensuite, j’extrais mes dernières lectures. Mais j’ai peu de preuves à présenter au tribunal qui siège en moi et me somme, le soir, d’expliquer, si je peux, ce que j’ai fait de ma journée. »
« Dans la même nuit, nous avons brisé le sortilège qui nous condamne à l’exil aux portes de Paris, traversé quatre cents kilomètres de ténèbres et de pluie, atteint le seuil de la seule existence que je sache, du seul monde qui lui fasse écho. »
« Je ne saurais lire puisque je suis parmi les choses. »
« Je regarde une émission de la série Histoires naturelles consacrée à la pêche au sandre. Les images du bord de l’eau, la lente marche du fleuve m’exaltent et m’accablent. J’aurais pu, moi aussi, passer des jours sur la rivière, dans l’oubli miséricordieux de tout. J’ai connu ce bonheur sans soupçonner qu’il me serait retiré bientôt. J’ai eu de ces heures, sur la Dordogne, et puis j’ai découvert, à dix-sept ans, qu’il semblait permis de comprendre ce qui nous arrivait, que cela se pouvait, et j’ai cessé de vivre. »
« J’esquisse un plan, jette, dirait-on, des grains de sable dans le vide, autour desquels pourraient se former des concrétions. Il me manque toujours l’arête. Je m’en remets sur l’avancée d’apporter ses propres rails, d’engendrer sa substance. Les mots, en revanche, tombent d’eux-mêmes, épousent la vision. »
« Je n’ai toujours pas pris mon parti de ne plus m’appartenir. »
« Paris excède la mesure de l’homme, la mienne, du moins. »
« La question est de savoir s’il est préférable de vivre ou de se retirer de la vie pour tenter d’y comprendre quelque chose, qui est encore une façon de vivre, mais combien désolée, amère, celle-ci. »
« Et comme je travaille de mes mains, et que je suis ici [les Bordes, en Corrèze], mes vieux compagnons, le noir souci, la contrariété, le désespoir chronique m’ont oublié. »
« Je songe aux profonds échos que la disparition de Mamie a soulevés, aux grandes profondeurs cachées sous la chatoyante et fragile surface des jours. J’y pensais, hier matin, dans la nuit noire, quand tout dormait, et j’y pense encore. Et c’est cela, peut-être, qu’il faudrait essayer de porter au jour. C’est le moment. Les figures tutélaires de mon enfance s’en vont, sans avoir seulement soupçonné, je suppose, ce qui s’est passé et les concernait, pourtant, au suprême degré. J’ai atteint l’âge où l’on peut tenter de comprendre, de porter dans l’ordre second, distinct, de l’écrit ce qu’on a confusément senti : la vie saisie à des moments successifs qui s’éclairent l’un l’autre, à l’occasion de ces subites et brutales retrouvailles que les naissances, les décès, surtout les décès, provoquent de loin en loin, les grandes permanences et le changement, l’œuvre fatidique, effrayante du temps. »
« Je reste un très long moment à me demander si j’ai bien de quoi remplir six autres chapitres, songe à croiser les voix, donc à modifier le poids, l’importance, le sens des choses qui commandent, à leur insu, parfois, mais parfois en conscience, les agissements des générations successives, la destinée unique, reprise par trois fois, de l’individu générique, supra-individuel auquel, sous le rapport de la longue durée, s’apparente celui, périssable, en qui nous consistons. »
« C’est à la faveur de ces instants limitrophes que m’apparaissent la hâte folle, la fureur concentrée qui m’emportent depuis ma dix-septième année et m’arrachent aux instants, aux lieux, aux êtres parmi lesquels nous aurons vécu, respiré. Toujours hors de moi, la tête ailleurs, l’esprit occupé de choses qui ne sont que dans les livres, ou alors du passé ou encore des éventualités redoutables, sans doute insurmontables, qui peuplent l’avenir. Et le seul bien véritable, le présent, ses authentiques et charmants habitants, je n’en aurai pas connu le goût, la douceur, la simple réalité. »
Bergounioux s’acharne, se force à écrire chaque jour – quand il en a le loisir.
« Je lance lessive sur lessive, range tout ce qui traîne partout, descends faire quelques achats, conduis Jean à sa dernière leçon de piano de l’année. Comment travailler ? Il ne me semble pas tant faire ce qu’il paraît, les courses, de la cuisine, prendre soin des petits, enseigner, etc. que combattre l’envahissement chronique de la vie, du métier, du chagrin, de tout, afin d’avoir un peu de temps pour la table de travail, méditer, endurer les affres sans nom de la réflexion, de l’explicitation. C’est un souci de chaque instant, une hantise vieille de vingt-deux ans et qui me ronge comme au premier jour. »
« Enfoncé dans la tâche d’écrire dont j’ai retrouvé, reconnu la rudesse, l’âpreté, le tempo – la facilité toute relative du matin, les lenteurs et les pesanteurs de l’après-midi, l’hébétude où je finis. C’est d’entrée de jeu qu’il faut emporter le morceau, arracher au vide rebelle, à l’opposition de la vie au retour réflexif, le sens de ce qui a eu lieu, le chiffre des heures passées. La violence du geste inaugural, et en vérité de cette occupation contre nature, dépasse de beaucoup celle que je mobilise, à l’atelier, contre les bois durs, l’acier. Que je relâche si peu que ce soit la pression à laquelle il faut soumettre la vapeur du souvenir, l’impalpable matière de la pensée, et la plume cesse de courir, le fil rompt. Je réussis à couvrir la deuxième page vers trois heures de l’après-midi après avoir douté, à chaque mot, d’extorquer le suivant, et un autre, encore, à l’inexpiable ennemi. C’est pur hasard, me semble-t-il, s’il a cédé. L’espoir s’est évanoui. On recommence, pourtant, puisque là est le chemin, et c’est ainsi qu’un autre terme vient, qu’on s’empresse, incrédule, d’ajouter au précédent. Et c’est à ce régime que je vais me trouver réduit pour des mois. »
« Je ne suis pas encore sorti de la voiture qu’un type à l’air malheureux, misérable, vient me demander une pièce. Il se passe des choses graves, que les rues soient pleines de gens qui mendient, qu’on soit partout et continuellement sollicité. »
« Les petits qui tournicotent sans rien faire m’irritent beaucoup. Mais c’est – j’essaie de me le rappeler – le privilège de l’âge où ils sont encore de n’avoir pas à compter, de dilapider les heures, les jours en petit nombre qui nous sont alloués. J’en ai usé, moi aussi, à leur âge, en très grand seigneur avant de me faire épicier. »
« Je me lève à six heures. Il s’agit de mordre sur le nouveau chapitre. Les premières lignes me coûtent mille maux. Je passe par toutes les couleurs de la désespérance. Partout, la muraille ou le puits, comme dans le conte d’Edgar Poe. Il doit être neuf heures lorsque les premiers mots apparaissent sur la page. Les mots d’Helvétius sur le malheur d’être et la fatigue de penser me reviennent. Dans l’intervalle, un jour clair et tiède s’est levé. C’est l’été de la Saint-Martin. Je m’acharne, gagne deux mots, trois autres un peu plus tard. À midi, j’aurai progressé d’une page. »
« La difficulté d’écrire se dresse, intacte, malgré les années. Je devine le grouillement obscur des possibles, l’enchevêtrement des thèmes, la confusion première, foncière, peut-être définitive de l’esprit aussi longtemps qu’il n’a pas fait retour sur lui-même, passé outre à l’interdit qui lui défend de se connaître, de porter en lui-même ordre et clarté. »
« Je lis La Psychologie des sentiments de Th. Ribot. Ce qu’il dit du sentiment esthétique est étrangement conforme à ce que j’ai toujours éprouvé, sous ce chef : un besoin aussi impérieux que la soif et la faim, plus impérieux, en vérité, plus violent, ab origine. »
« Je reprendrai plus tard la fin, qui est très insatisfaisante. Je reviens au début pour la première passe de rabotage. Il est deux heures et demie de l’après-midi lorsque j’ai grossièrement élagué le premier chapitre. La dialectique abstruse du deuxième m’arrête net et j’ai un accès de détresse. Jamais je ne serai content. Toujours mon esprit revient buter sur son insuffisance essentielle, son incurable infirmité. »
C’est une figure opiniâtre qui se dégage de ce journal, avec en filigrane un grand élan vers l’authenticité.
J’ai lu avec plaisir ces carnets, comme une histoire, tant le propos est bien énoncé, l’écriture agréable, la syntaxe soignée et riche le vocabulaire. Bien sûr cette lecture est laborieuse, puisqu’il s’agit d’un journal, donc non structuré, où abondent les récurrences des évocations de peines diverses ; mais les préoccupations de Bergounioux, les soucis qu’il consigne plus volontiers que les satisfactions, recoupent souvent les nôtres.
\Mots-clés : #autobiographie #creationartistique #ecriture #education #enfance #famille #journal #mort #nature #relationenfantparent #ruralité #urbanité #viequotidienne #xxesiecle
- le Jeu 14 Mar - 11:20
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Pierre Bergounioux
- Réponses: 40
- Vues: 5198
Paolo Cognetti
La félicité du LoupÀ Fontana Fredda, mille huit cent mètres, Fausto, quarante ans, a rejoint son alpe d’origine pour se ressourcer après son divorce. Il est cuisinier au Festin de Babette (nom de restaurant inspiré de Blixen), et a une liaison avec Silvia, la serveuse.
Après l’hiver et la saison de ski, il retourne à Milan finaliser sa séparation, puis revient dans la montagne en tant que cuisinier dans un camp de forestiers ; il revoit Silvia, qui travaille dans un refuge.
Le village s’éteint, et les loups reviennent. Santorso l’ancien garde forestier connaît bien les environs et le contexte.
Fausto écrit, et ses références culturelles sont nombreuses (Hokusai, Hemingway, Rigoni Stern, etc.).
D’emblée ma lecture a été desservie par celle, récente, de Jours à Leontica de Fabio Andina, dont je recommanderais la lecture.
Pour ce qui est de l’écriture/ traduction : peut mieux faire :
« On y arrive en longeant une crête pour y arriver. »
\Mots-clés : #alpinisme #nature
- le Ven 16 Fév - 11:10
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Paolo Cognetti
- Réponses: 27
- Vues: 3031
Nickolas Butler
Nickolas Butler, né le 2 octobre 1979 à Allentown en Pennsylvanie, est un écrivain américain. Il vit aujourd'hui à Eau Claire dans le Wisconsin et étudie à l'Université du Wisconsin à Madison.
Il participe à un atelier d'écriture de l'Université de l'Iowa. Il fait des petits travaux : employé chez Burger King, tuteur, télévendeur, vendeur de hot-dogs, aubergiste, cueilleur de pommes, vendangeurs, Il écrit. Il vit avec son épouse et leurs deux enfants à la campagne, dans le Wisconsin.
Ses nouvelles sont publiées dans les magazines comme Ploughshares (en), The Kenyon Review Online, The Lumberyard, The Christian Science Monitor, Narrative et Sixth Finch, et dans d'autres publications.
En 2014, son premier roman est publié.
Butler a reçu diverses bourses et récompenses de la part de fondations régionales de prix littéraires. Il a remporté le prestigieux prix PAGE America en France, le prix Great Great Great Reads 2014, le prix Midwest Independent Booksellers 2014, le prix littéraire 2015 de la Wisconsin Library Association, le prix littéraire régional 2015 du chancelier UW-Whitewater, et est finaliste pour le prix Flaherty Dunnan 2014 du premier roman et de la sélection pour le prix FNAC en France, selon son site personnel.
Sources wikipedia
Bibliographie
Romans
Retour à Little Wing, Autrement, 2014 ((en) Shotgun Lovesongs, 2014)
Des hommes de peu de foi, Autrement, 2016 ((en) The Hearts of Men, 2017)
Le Petit-Fils, Stock, 2020 ((en) Little Faith, 2019)
La Maison dans les nuages, Stock, 2023
Recueil de nouvelles
Rendez-vous à Crawfish Creek, Autrement, 2015
Tronçonneuse party (The Chainsaw Soirée)
Un goût de nuage (Rainwater)
Sven & Lily
Rendez-vous à Crawfish Creek (In Western countries)
Sous le feu de joie (Benneath the bonfire)
Brut aromatique (Sweet Light Crude)
Les restes (Leftovers)
Morilles (Morels)
Lenteur ferroviaire (Train people move slow)
Pommes (Apples)
========================================
"Cette maison allait changer leur fortune. Ils le sentaient. »
Cole, Bart et Teddy sont associés d’une petite entreprise de construction à Jackson, dans le Wyoming. Lorsque Gretchen Connors, une richissime avocate californienne, leur propose de terminer de bâtir une sublime maison au cœur des montagnes voisines, le trio aperçoit une porte de sortie, loin de leur quotidien banal. Cette maison serait un bijou architectural, la plus belle de toute la région, leur chef-d’œuvre.
Un seul problème : ils doivent terminer le chantier en quatre mois, ce qui signifie travailler jour et nuit. Et pourquoi le précédent entrepreneur a-t-il jeté l’éponge ?Mais l’appât du gain est trop fort. Ils acceptent.Alors qu’un hiver glacial s’installe, que le chantier se met en difficilement en branle, Cole doit aussi gérer son divorce malheureux, Teddy ses quatre filles et Bart son addiction à la méthadone. Cette maison qui semblait être un petit coin de paradis, ne deviendrait-elle pas leur pire cauchemar ?
Portrait d’une Amérique orpheline de ses rêves, coincée entre le mirage du bien-être et un capitalisme implacable, La Maison dans les nuages est un roman noir à couper le souffle. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Mireille Vignol
Ce livre est inspiré de faits réels.
Butler a trouvé le sujet assez intéressant pour en faire un roman, tu m'étonnes Nicko !
Il y a temps à dire sur l'individualisme du nanti richissime, tant à écrire sur la société américaine décomplexée, indécente et concupiscente.
Et j'y suis rentrée dans le Wyoming
accrochée dans le pickup avec Cole, Bart et Teddy, j'ai longé les ravins et les canyons délaissés peu de temps auparavant alors embarquée avec les Cowboys lors de la ruée vers l'or, accompagnée de Dorothy Marie Johnson, sous la colline des potences et m'y revoilà près de 70 ans plus tard, dans une Amérique toujours plus libéraliste, toujours plus capitaliste.
On troque le scalp des indiens contre celui bien plus sournois des nababs qui n'hésitent pas à dépouiller son prochain et ce à tous les étages d' une société consumériste.
L' Amérique de tous les possibles, de tous les rêves, chacun veut son lot, à commencer par l'opportunité de vivre décemment, se fixer ou s'orienter, puis surtout, à terme, se faire un tas de pognon, le leitmotiv majeur, vecteur autorisant toutes les manières d'y arriver.
Alors pourquoi pas accepter la construction de cette maison dans les nuages, dans les hauteurs des canyons, à 80 bornes de la ville, projet aussi incroyable que dément, sans doute parce que terminée à temps, le bonus est colossal pour nos trois amis.
Le présent c'est maintenant, action !
Prenons le challenge, nous, Cole, Bart et Teddy, les prolos, potes d'enfance et chefs d'une petite d'entreprise de construction de quartier, à peine connus, à peine certains de terminer ce chantier extravagant destiné en général à des entreprises calibrées avec pignon sur rue, à des hommes d'affaires aux dents longues rayant le parquet à peine posé.
4 mois de délai en plein hiver, à peine entendable (voire réalisable) et pourtant, ils s'y collent, prenant avec les exigences d'une propriétaire à laquelle on ne dit pas non et peu importe finalement les questionnements legitimes sur le pourquoi de leur embauche...
Et on les comprend, il faut dire qu'on s'y attache à ces trois là, Nickolas Butler, avec ce talent que je découvre, nous les rend proches, dresse des portraits intimistes qui font que la proximité s'installe.
Elle s'établit tellement qu'on se marre, stresse, souffre avec eux, on attend l'accident de chantier en sachant que la populace aux states n'a majoritairement pas les moyens de se payer une assurance , mais youpi, peut-être l'Obamacare sera bénéfique...
on suit la construction, un chantier soumis à un climat capricieux et déplorable à cette période de l'année et peu importe les conditions pour le ou la millionnaire, un délai et un délai, d'ailleurs, que vaut la vie d'un ouvrier ?
" c'est la nature des choses avec t'il raisonné, ça se passe peut-être ainsi depuis des temps immémoriaux. À cette heure même, des hommes s'affairaient pour ériger ce palais contemporain, ce projet "phare" destiné à une personne d'une richesse inconcevable.
Des milliers d'années auparavant l'histoire était la même, sauf qu'une main d'oeuvre multipliée par plusieurs centaines avait bâti une pyramide pour un type quelconque qui se prenait pour un dieu.
Il y avait ceux qui faisaient construire et ceux qui construisaient. Tout comme il y avait ceux qui se retroussaient les manches et les autres. "
Et je les ai presque retroussées mes manches, même si mes connaissances en matière de travaux sont presqu'aussi désastreuses que ma defense criarde pour faire fuir un grizzli.
Je les ai vus se tuer à la tâche, avaler les heures jour après jour comme des forcenés, j'ai observé l'arrivée de la meth comme palliatif et carburant, assisté aux pertes de repères et à tout bon sens, perçu l'inévitable... au nom de l'argent, de l'appât du gain qui s'ancre au plus profond des exploités ne rêvant que d'évasion , de se libérer d'une vie contrariée, d'offrir une vie meilleure à une famille d'invisibles.
Ils sont si proches de cette entreprise, nos associés.
Si loin, pourtant, du monde qui leur donne la becquée, quelques miettes à l'orée d'une frontière dorée hors d'atteinte...
Un roman noir qui ne manque pas de panache. Doté d'un style acéré et d'un regard critique, Nickolas Butler met en lumière les dérives d'une partie de l'Amérique désespérée et désemparée.
Derrière le suspense qui monte en puissance, c'est un cri silencieux que l'on entend, celui de tous les imperceptibles, des oubliés , cahotés, chahutés, maltraités, dominés et opprimés.
C'est le monde du bas, celui que l'on monnaie, puisque tout s' achète, même la mort.
Un roman percutant et éloquent.
\Mots-clés : #addiction #amitié #lieu #nature #reve
- le Jeu 15 Fév - 7:51
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Nickolas Butler
- Réponses: 1
- Vues: 403
Fabio Andina
Jours à Leontica
« Nous avions parlé un moment puis je lui avais demandé s’il serait d’accord que je le suive dans ses journées. Histoire de vivre un peu comme lui. »
Le narrateur accompagne donc le Felice, ancien maçon de « nonante ans », à la « gouille » (point d’eau) où il se baigne chaque petit matin (on est fin novembre, à mille quatre cents mètres d’altitude).
« Le plus souvent, Felice ne marche pas pour se déplacer mais pour passer le temps. »
« Le Felice n’a pas la télévision, ni la radio, ou le téléphone. Il n’a même pas de boîte aux lettres. Le peu de courrier qu’il reçoit, la factrice Alfonsa le lui remet en mains propres, ou alors elle le laisse sur le banc avec une pierre par-dessus, et s’il pleut elle le pose sur la table de la cuisine, de toute façon la porte est toujours ouverte. »
« C’était nous, les enfants, qui allions dans les bois les ramasser avec nos paniers, parce qu’à l’époque c’était ou patates ou châtaignes, ou châtaignes ou patates, si tu veux savoir. Ou grillées ou cuites. Ou cuites ou grillées, les châtaignes. C’était soit l’un soit l’autre. C’était pas comme les patates, qu’elle savait préparer de mille et une façons, alors on pouvait pas dire qu’on mangeait tout le temps la même chose. Non, on mangeait des gnocchis, de la purée, des patates cuites au four avec du romarin ou dans les braises. On mangeait la soupe de patates, les patates avec des oignons, ou juste cuites à l’eau avec un peu de sel, et j’en passe. »
À Leontica, village des Alpes tessinoises avec ses baite (chalets) couvertes de piole (lauzes, pierres plates), il y a aussi le Floro dit le Ramoneur, le Sosto et le Brenno, la Vittorina, la Sabina, la Candida, la Muette, le Pep, l’Emilio…
« À ses bestioles il donne un fourrage fait d’herbes triées sur le volet qu’il ramasse en se promenant à travers champs. Un jour je lui avais apporté un plein sac d’herbe de mon jardin, mais il m’avait dit que ses lapins n’y toucheraient pas, parce que je l’avais coupée à la débroussailleuse et qu’ils le sentent quand ça pue les gaz d’échappement. »
Et les chiens, les chats, et la nature.
« Des lames de lumière froide percent la pinède. Les rayons obliques illuminent les plumes bleues des ailes de deux geais qui se pourchassent en jasant entre les sapins. Hors de la pinède, au bord de l’étroit chemin de terre, sur le tronçon qui relie les deux ponts, un écureuil fourrage dans les taillis. Il nous aperçoit, bondit sur un grand tronc et disparaît dans une cavité, une châtaigne entre les dents. Ses dernières provisions avant l’hiver. »
« L’Adula, avec son glacier en lutte contre le réchauffement climatique, contraint jour après jour de laisser dévaler des pans entiers de notre histoire. Ses souvenirs toujours plus étriqués, comme un vieillard devenant sénile. »
Il y a aussi quelques points mystérieux : le Felice semble lire les pensées, à été en Russie, prépare l’arrivée de quelqu’un.
« Puis j’entends encore ses mots, ses histoires, celle de sa mère qui cuisinait des gnocchis le dimanche, celle de la gouille en Russie et de la vache tuée pendant son service militaire et que le monde est rempli de crétins qui se font plumer comme des pigeons, que le monde est aux mains des plus grands margoulins de cette terre. Et au fait qu’il ne croyait qu’au respect réciproque et rien d’autre. »
Sorte de chronique testimoniale, à valeur quasiment historique voire ethnologique (avec notamment le recours judicieux au vocabulaire local), sur un terroir, et une personne sensible à son environnement. La paisible routine du hameau, élevage de la volaille à la vache, potager, troc, entraide (et pourtant indépendance respectée), une certaine sobriété (mais pas toujours en ce qui concerne l’alcool et le tabac), une qualité de silence, de lenteur (pas toujours non plus), et beaucoup de routine, parties de scopa au bar et l’essentielle Sarina (fourneau à bois). Une communauté avec aussi ses drames, dans un passé prégnant.
Merci @Topocl, j'ai aimé !
\Mots-clés : #amitié #lieu #nature #nostalgie #ruralité #solidarite #vieillesse #viequotidienne
- le Jeu 1 Fév - 11:30
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Fabio Andina
- Réponses: 20
- Vues: 1424
Rachel Carson
Printemps silencieux
Un essai historique, ou comment un problème écologique grave et méconnu a été révélé et (partiellement) résolu grâce à un livre ; il reste d’une actualité intense et dramatique de nos jours (paru en 1962).
« Je prétends encore que nous avons laissé employer ces produits chimiques sans s’interroger outre mesure sur leurs effets sur le sol, sur l’eau, les animaux et plantes sauvages, sur l’homme lui-même. Les générations à venir nous reprocheront probablement de ne pas nous être souciés davantage du sort futur du monde naturel, duquel dépend toute vie. »
Ces produits chimiques détruisent la vie, l’équilibre naturel : pesticides, mais aussi herbicides.
« L’eau, le sol et le manteau végétal forment le monde qui soutient la vie animale de la Terre. Qu’il s’en souvienne ou pas, l’homme moderne ne pourrait exister sans les plantes qui captent l’énergie solaire et produisent les aliments de base nécessaires à sa subsistance. »
Carson explique comme un toxique se concentre dans la chaîne alimentaire. Tout est lié dans l’environnement. Elle souligne aussi les effets cumulatifs dans le temps des agents de pollution, et les risques induits par leurs interactions.
Des campagnes de pulvérisation illogiques (notamment pour tenter de sauver les ormes ; Carson parle essentiellement de l’Amérique du Nord) détruisent les insectes, et donc les oiseaux qui s’en nourrissent, ainsi que des mammifères. De plus, les facultés génésiques de cette faune sont détériorées par les insecticides. C’est valable également pour les poissons, les crustacés, etc. ; ces poisons se retrouvent jusque dans le lait des vaches.
« Lorsque les insectes réapparaissent – ce qui arrive presque toujours – les oiseaux ne sont plus là pour enrayer l’invasion. »
« Autrefois, ces substances étaient conservées dans des boîtes couvertes de têtes de morts et de tibias croisés, et lorsqu’on les employait – chose évidemment rare – on prenait grand soin de les appliquer où il convenait, et nulle part ailleurs. Mais l’apparition des insecticides organiques, jointe à l’abondance des avions en surplus de la Seconde Guerre mondiale, ont changé tout cela. Les poisons modernes ont beau être beaucoup plus dangereux que leurs prédécesseurs, on trouve normal de les jeter indistinctement du ciel. Les insectes ou les plantes visés, mais également tous les êtres du secteur – humains ou non humains – pourront entrer en contact avec le poison. On arrose les forêts et les champs, mais aussi bien les villes et les bourgs. »
« Nous sommes à l’âge du poison ; le premier venu peut acheter sans explications à tous les coins de rue des substances beaucoup plus dangereuses que les produits pour lesquels le pharmacien exige une ordonnance médicale. »
« En bref, admettre une tolérance, c’est autoriser la contamination des denrées alimentaires destinées au public dans le but d’accorder aux producteurs et aux industries de transformation le bénéfice d’un moindre prix de revient ; c’est aussi pénaliser le consommateur, en lui faisant payer l’entretien d’une police économique chargée de veiller à ce qu’on ne lui administre pas de doses mortelles de poison. Mais étant donné le volume et la toxicité des ingrédients agricoles actuels, ce travail de contrôle demanderait, pour être bien fait, des crédits que nulle assemblée n’osera jamais voter. En conséquence la police est médiocre, et le consommateur est à la fois pénalisé et empoisonné. »
« Notre grand sujet d’inquiétude est l’effet différé produit sur l’ensemble de la population par les absorptions répétées de petites quantités de ces pesticides invisibles qui contaminent notre globe. »
Les produits dénoncés sont surtout les hydrocarbures chlorurés et les phosphates organiques. Ils sont souvent carcinogènes. Et ils induisent une résistance chez les insectes ciblés qui s’y adaptent rapidement, d’autant plus que leurs prédateurs naturels sont également atteints par les pulvérisations. Les dégâts sont aussi économiques.
« Les pulvérisations d’insecticide dérangent les lois qui régissent la dynamique des populations chez les insectes. C’est pour cela qu’à chaque traitement les agriculteurs voient un mauvais insecte remplacé par un pire. »
« Nous voici maintenant à la croisée des chemins. Deux routes s’offrent à nous, mais elles ne sont pas également belles, comme dans le poème classique de Robert Frost. Celle qui prolonge la voie que nous avons déjà trop longtemps suivie est facile, trompeusement aisée ; c’est une autoroute, où toutes les vitesses sont permises, mais qui mène droit au désastre. L’autre, « le chemin moins battu », nous offre notre dernière, notre unique chance d’atteindre une destination qui garantit la préservation de notre terre. »
L’alternative est biologique, et non chimique : outre l’introduction de leurs prédateurs naturels lorsqu’ils manquent, sont proposés le lâchage d’insectes stérilisés, les leurres sélectifs (olfactifs ou acoustiques), insecticides bactériens et viraux.
La situation a certainement beaucoup évolué depuis, mais les principes demeurent.
\Mots-clés : #contemporain #ecologie #economie #essai #nature #pathologie #ruralité #xxesiecle
- le Lun 29 Jan - 11:09
- Rechercher dans: Sciences formelles et expérimentales
- Sujet: Rachel Carson
- Réponses: 12
- Vues: 1677
Jean-Henri Fabre
Souvenirs entomologiques (Livre I du tome 1)
Fabre commence par observer (avec ses élèves) le Scarabée sacré, avec autant d’humour que de rigueur et de patience. Puis vient l’observation (avec expérimentations) des adroits prédateurs qui paralysent leur proie afin de les préserver vivantes pour leur progéniture.
« Je viens de dire que l'aiguillon est dardé à plusieurs reprises dans le corps du patient : d'abord sous le cou, puis en arrière du prothorax, puis enfin vers la naissance de l'abdomen. C'est dans ce triple coup de poignard que se montrent, dans toute leur magnificence, l'infaillibilité, la science infuse de l'instinct. […]
Mais ouvrons un Grillon. Qu'y trouvons-nous pour animer les trois paires de pattes ? On y trouve ce que le Sphex savait fort bien avant les anatomistes : trois centres nerveux largement distants l'un de l'autre. De là, la sublime logique de ces coups d'aiguillon réitérés à trois reprises. »
Le temps long de l’évolution pour parvenir à une telle maîtrise de la connaissance des centres nerveux des proies est vertigineux !
« On prend un insecte, on le transperce d'une longue épingle, on le fixe dans la boîte à fond de liège, on lui met sous les pattes une étiquette avec un nom latin, et tout est dit sur son compte. Cette manière de comprendre l'histoire entomologique ne me satisfait pas. Vainement on me dira que telle espèce a tant d'articles aux antennes, tant de nervures aux ailes, tant de poils en une région du ventre ou du thorax ; je ne connaîtrai réellement la bête que lorsque je saurai sa manière de vivre, ses instincts, ses mœurs. »
« Pour l'instinct rien n'est difficile, tant que l'acte ne sort pas de l'immuable cycle dévolu à l'animal ; pour l'instinct aussi, rien n'est facile si l'acte doit s'écarter des voies habituellement suivies. »
« L'Hyménoptère agit avec une précision que jalouserait la science ; il sait ce que l'homme presque toujours ignore ; il connaît l'appareil nerveux complexe de sa victime, et pour les ganglions répétés de sa Chenille réserve ses coups de poignard répétés. Je dis : il sait et connaît ; je devrais dire : il se comporte comme s'il savait et connaissait. Son acte est tout d'inspiration. L'animal, sans se rendre nullement compte de ce qu'il fait, obéit à l'instinct qui le pousse. Mais cette inspiration sublime, d'où vient-elle ? Les théories de l'atavisme, de la sélection, du combat pour l'existence, sont-elles en mesure de l'interpréter raisonnablement ? »
« En vain, des centaines de fois, j'ai assisté au retour du Bembex dans son domicile ; c'est toujours avec un étonnement nouveau que je vois le clairvoyant insecte retrouver sans hésitation une porte que rien n'indique. Cette porte, en effet, est dissimulée avec un soin jaloux, non maintenant après l'entrée du Bembex, car le sable, plus ou moins bien éboulé ne se nivelle pas par sa propre chute et laisse tantôt une légère dépression, tantôt un porche incomplètement obstrué ; mais bien après la sortie de l'Hyménoptère, car celui-ci, partant pour une expédition, ne néglige jamais de retoucher le résultat de l'éboulement naturel. Attendons son départ, et nous le verrons, avant de s'éloigner, balayer les devants de sa porte et les niveler avec une scrupuleuse attention. La bête partie, je défierais l’œil le plus perspicace de retrouver l'entrée. Pour la retrouver, lorsque la nappe sablonneuse était de quelque étendue, il me fallait recourir à une sorte de triangulation ; et, que de fois encore, après quelques heures d'absence, mes combinaisons de triangles et mes efforts de mémoire se sont trouvés en défaut ! Il me restait le jalon, le fétu de graminée implanté sur le seuil de la porte, moyen non toujours efficace, car l'insecte, en ses continuelles retouches à l'extérieur du nid, trop souvent faisait disparaître le bout de paille. »
Puis sont observées les Abeilles maçonnes – non sans expérimentation.
« Pour étudier avec quelque fruit les facultés psychiques de la bête, il ne suffit pas de savoir profiter des circonstances qu'un heureux hasard présente à l'observation ; il faut savoir en faire naître d'autres, les varier autant que possible, et les soumettre à un contrôle mutuel ; il faut enfin expérimenter pour donner à la science une base solide de faits. »
Fabre ajoute un second obstacle, de papier, à l’insecte émergeant de sa cellule de mortier :
« Autour du nid une autre barrière se présente, la paroi du cornet ; mais pour la percer il faudrait renouveler l'acte qui vient d'être accompli, cet acte auquel l'insecte ne doit se livrer qu'une fois en sa vie ; il faudrait enfin doubler ce qui de sa nature est un, et l'animal ne le peut, uniquement parce qu'il n'en a pas le vouloir. L'Abeille maçonne périt faute de la moindre lueur d'intelligence. Et, dans ce singulier intellect, il est de mode aujourd'hui de voir un rudiment de la raison humaine ! La mode passera, et les faits resteront, nous ramenant aux bonnes vieilleries de l'âme et de ses immortelles destinées. »
À la fin du livre, Fabre décrit trois nouveaux insectes qu’il a découverts.
« Je désire que ces trois Hyménoptères portent le nom de mon fils Jules, à qui je les dédie.
« Cher enfant, ravi si jeune à ton amour passionné des fleurs et des insectes, tu étais mon collaborateur, rien n'échappait à ton regard clairvoyant ; pour toi, je devais écrire ce livre, dont les récits faisaient ta joie ; et tu devais toi-même le continuer un jour. Hélas ! tu es parti pour une meilleure demeure, ne connaissant encore du livre que les premières lignes ! Que ton nom du moins y figure, porté par quelques-uns de ces industrieux et beaux Hyménoptères que tu aimais tant. »
Inspiré par La Fontaine, riche en anecdotes autobiographiques (des démêlés avec les gardes champêtres à un égarement dans la brume du mont Ventoux), cette prose amène engage à poursuivre la lecture, qui éveille sans cesse l’attention sur les merveilles de l’instinct et de l’évolution.
\Mots-clés : #ecologie #nature
- le Mar 9 Jan - 12:11
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean-Henri Fabre
- Réponses: 3
- Vues: 212
Ernst Zürcher
Les arbres, entre visible et invisible – s'étonner, comprendre, agir
Dans la préface, Francis Hallé soutient nombre des assertions de Ernst Zürcher. Dans son introduction, ce dernier montre comme la pensée (invisible) permet de saisir les fonctions à partir des structures (visibles), notamment chez les arbres.
Dans le premier chapitre, Arbres sacrés et peuples de l’arbre, est pris l’exemple de l’if.
Dans le second, c’est la structure arborescente qui est revisitée, la longévité et le gigantisme de certains arbres, mais aussi la physiologie du bois.
Dans le troisième, Zürcher évoque notamment la croissance et les flux de sève hélicoïdes selon la section dorée.
Dans le quatrième, Chronobiologie (« les manifestations rythmiques des processus vitaux »), il rapporte « des synchronicités avec les grands rythmes de nature astronomique », notamment des cycles lunaires à prendre en compte pour les semis et l’abattage.
Le cinquième traite du bois à cet égard.
Le sixième évoque les parfums, mais aussi l’ionisation négative ambiante des forêts, et autres « messages subtils ».
Le septième et dernier chapitre, Partenariats pour la fertilité met en valeur la gestion forestière et ses intérêts, et diverses techniques, comme les jardins-forêts.
« …] le maximum de diversité floristique fut également atteint vers la fin de l'ère préindustrielle, où l'on mettait en valeur divers types de prairies (avec des régimes de coupe et de pacage correspondants), allant des zones marécageuses aux coteaux maigres et secs extrêmement riches en espèces, peuplés d'innombrables insectes et papillons.
Il ressort de ces faits que certaines formes de gestion active de la nature par l'homme – à but de production – ont eu, dans certaines conditions, l'effet paradoxal non de l'appauvrir, mais d'en augmenter la biodiversité. En ce sens, le dualisme "écologie-économie" ou "nature-culture", ou encore "réserves naturelles intégrales (dont l'homme serait censé être banni)-zones agro-industrielles intensives" doit être remis en question et dépassé. De multiples exemples l'ont démontré : l'homme n'a pas fatalement un impact destructeur sur la nature – il est aussi capable de s'y insérer et d'y agir dans une sorte de "partenariat" constructif et dynamisant, à condition d'en avoir compris les principes de fonctionnement et d'en tenir compte. »
La postface "inspirée" de Bruno Sirven, en pendant de la préface de Francis Hallé et « où le savoir ne connaît pas la limite de la stricte rationalité ou d'un quelconque carcan matérialiste », synthétise bien mes réserves. D’apparence rigoureusement scientifique, cet essai me paraît considérer comme des faits établis et significatifs (au sens d’effets importants) des phénomènes tels que l’influence lunaire, l’eau « nouvelle » (apparentée à celle qui aurait une mémoire !) et l’électrosmog. Je ne suis pas certain qu’un tel mixte de faits scientifiques, d’ailleurs tout à fait étonnants, et de théories à la limite de la mystique ou de la superstition soit vraiment éclairant, mais voilà assurément une lecture qui intéressera ceux qui s’inquiètent des arbres et plus généralement de notre environnement.
\Mots-clés : #essai #nature
- le Jeu 28 Déc - 11:15
- Rechercher dans: Nature et voyages
- Sujet: Ernst Zürcher
- Réponses: 9
- Vues: 614
David Grann
La Cité perdue de Z – Une expédition légendaire au cœur de l’Amazonie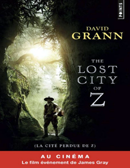
Le colonel Percy Harrison Fawcett est disparu en 1925 lors d’une expédition amazonienne, parti à la recherche d’une cité perdue. Il avait déjà, en 1906-1907, établi une cartographie de la frontière entre le Brésil et la Bolivie pour la Société royale de géographie. Intrépide et apparemment invincible, il multiplie les explorations du proverbial « enfer vert » – finalement l’image ne me paraît pas totalement erronée, surtout vécue dans les conditions de l’époque. Quoique empêtré dans ses convictions victoriennes élitistes et racistes, il ne se borne pas à suivre les principaux cours d’eau mais s’enfonce à pied en forêt, et approche ainsi des tribus indiennes inconnues, dont il reconnaît la culture et le savoir-faire (en bref des civilisés) dans une approche qui annonce l’anthropologie moderne.
Mais c’est le mythique El Dorado des conquistadors qui obsède surtout Fawcett, qu’il appelle la cité perdue de Z.
En 1911, Hiram Bingham découvre les ruines incas de Machu Picchu. En 1913/1914, l’ex-président Théodore Roosevelt et Cândido Rondon, orphelin d’origine indienne devenu le colonel brésilien qui fondera le Service de protection des Indiens, explorent la rivière du Doute.
Pour son ultime expédition, Fawcett a été approché par le colonel T. E. Lawrence, mais préfère emmener son fils Jack et l’ami de ce dernier, Raleigh ; il manque de fonds, est devenu adepte du spiritisme et craint d’être devancé, cependant ils parviennent à partir dans le Mato Grosso. Fawcett emporte une idole de pierre, cadeau de Henry Rider Haggard (auteur de Les Mines du roi Salomon et She)…
David Grann, journaliste néophyte en la matière, raconte comment il suit ses traces en 2004 pour enquêter sur le terrain (comme tant d’autres, dont des dizaines ne revinrent jamais) ; il expose comme les dernières recherches archéologiques rendent compte d’une société qui a su se développer dans ce milieu avant d’être éradiquée par les maladies importées.
Brian, le fils cadet de Fawcett, présente les carnets de route et journaux intimes de son père dans Le continent perdu. Sir Arthur Conan Doyle, ami de Fawcett, fait de son histoire le cadre de son roman Le Monde perdu. J’ai eu une pensée pour Les Maufrais (père et fils). Autant de livres qui alimentèrent mon imaginaire depuis l’adolescence...
\Mots-clés : #amérindiens #aventure #biographie #contemythe #historique #lieu #nature #portrait #voyage
- le Mar 5 Déc - 11:36
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: David Grann
- Réponses: 15
- Vues: 2002
David James Duncan
La Rivière Pourquoi
Henning Hale-Orviston, illustre pêcheur à la mouche, est H2O pour son fils, Gus, le narrateur ; et Ma, sa mère, pêche à l’appât… L’intello et la péquenaude, voilà le socle de la famille, à laquelle il faut ajouter Bill Bob, le petit frère (qui s’intéresse à beaucoup de choses, mais absolument pas à la pêche). La première partie constitue une sorte de satire de cette institution de la pêche à la mouche aux États-Unis (cf. Brautigan et nombre d’autres auteurs), dans une verve humoristique qui rappelle John Irving (de même que l’attention aux enfants), et avec comme point d’orgue la guerre du Parfait Pêcheur à la ligne d’Izaak Walton, Bible paternelle (la raillerie de la religion est aussi fort marquée).
Dans la seconde partie, Gus part vivre seul sa monomanie (auprès de la rivière Tamanawis, qui fait un ?). Comblé en pêchant sans cesse, il ne vit cependant pas le rêve escompté, qui tourne au cauchemar quand il récupère un pêcheur noyé. Profondément déprimé, il remue des considérations métaphysiques, inspirées des « nourêves » (dont le « Monde Jardin ») de la cosmo-mythologie de son frère et des souvenirs d’un Indien respectueux de la nature, Thomas Bigeater ; il renonce à la pêche (où il a détruit des quantités de poissons) et décide de frayer avec ses semblables afin de se réconcilier avec le monde. Puis il rencontre une superbe pêcheuse, Eddy, qui disparaît. Titus, un philosophe, l’initie à la connaissance, en commençant par les mystiques et sages, surtout orientaux. Puis Gus vit de ses mouches montées, et y travaille avec Nick, qui porte sur la paume la cicatrice laissée par l’hameçon qui permit de le sortir de l’eau en mer nordique. Comme il a remonté le ruisseau mort de son enfance jusqu’à sa source cloaquale, Gus remonte la Tamanawis tel un Indien Tillamook lors de son initiation.
« Les troncs s’élevaient comme des piliers pour former tout en haut une mosaïque de vert, de noir et de ciel. Seule une lumière de vitrail filtrait. Au centre, il y avait un creux, entouré de fougères et d’arbres abattus. Au fond du creux, il y avait un large bassin rocheux étrangement tapissé de pierres de la taille de têtes humaines et aux cheveux de mousse. Et au milieu de ces pierres sourdait une paisible source d’où, coulait, inlassable, une eau ancienne et pure. »
« Je me suis remémoré les paroles des anciens Tillamooks : la source est partout. Je commençais à appréhender leur signification, peut-être pas à un degré très profond, mais au moins sur un plan météorologique et géographique, ce qui, somme toute, était suffisamment profond pour un cas désespéré de pêcheur affamé assis dans la forêt la pipe à la bouche. J’ai compris qu’une mecque n’avait de valeur que s’il s’agissait d’un endroit en soi plutôt que d’un endroit dans le monde. J’ai compris que cette mecque-source, ici, dans la maison d’épicéas, était à la Tamanawis ce qu’était pour moi mon lieu de naissance : un point de départ tangible et non une source ultime. J’ai compris que la vraie Tamanawis était la Tamanawis tout entière et que la source de cette rivière-là était la pluie, les nappes phréatiques, la rosée, la fonte des neiges, le brouillard, la brume, la pisse des animaux, les ruisselets anonymes, les marécages perdus, les sources souterraines, et la source de toutes ces sources était les nuages, et la source des nuages était la mer, si bien que la rivière qui coulait devant ma cabane prenait réellement sa source « partout », du moins partout où cette eau était passée, ce qui inclut tout l’espace et le temps de la terre… »
C’est le sens du mythe des filles aveugles de la mer et du soleil qui, dispersées par le vent, regagnent leur mère. Puis c’est le retour :
« Cette nuit-là, j’ai fait quelques découvertes. D’abord, j’ai découvert qu’outre le « deuxième souffle » bien connu, il en existe un troisième, un quatrième et un cinquième, chacun plus faible et plus bref que le précédent. Puis, alors que l’aube ne se lèverait pas avant des heures, j’ai découvert qu’il y a un dernier souffle essoufflé qui dure jusqu’au moment où tu t’écroules. Celui-là, tu le sens davantage dans le ventre que dans le cœur ou les poumons. Tu sais qu’il est là quand tu t’aperçois que des parties essentielles de ton être commencent à mâcher et à dévorer les parties moins essentielles. Tu marches en te digérant toi-même, désormais incapable de faire semblant de comprendre, d’aimer, de désirer ou de rechercher quoi que ce soit. Tu oublies tout ce qui a pu t’arriver et tu en viens à croire que rien d’autre n’arrivera que cette marche interminable dans la nuit détrempée. Tu cesses de réfléchir, de percevoir, de te donner du mal, d’effectuer le moindre geste conscient. Tu ne sens plus tes pieds et tu te laisses emporter par la route telle une feuille morte par le courant. »
« Si le corbeau continue vers la mer, il survolera bientôt le ? Il regardera en bas et verra les mêmes méandres que ceux que tu as vus, mais tu sais à présent que le corbeau n’y lira rien, ni question, ni mot, ni ordre, parce qu’il n’est nul besoin de mot ou de question, parce qu’il n’y a pas de désordre. Le corbeau verra le ? comme la rivière l’a écrit, une simple affirmation. La complexité de l’univers de la rivière depuis sa source jusqu’à l’océan, la vie et les vies que l’eau nourrit et contient, l’infinité de facettes qu’elle soude en une seule, tout cela ne doit pas être questionné, mais affirmé. Affirmé ainsi que cela a été créé, dans un langage si simple, si pur, si primordial qu’il échappe à notre examen et à notre compréhension, de même qu’à notre esprit et à notre langue. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il existe… et, grâce au corbeau, tu en as eu un aperçu. »
Eddy réapparaît – et le défie d’accompagner un saumon remontant le courant, à peine lié par un bas de ligne trop fin, dans une anabase taoïste et amoureuse.
Une approche originale, assez bizarre, mais Augustin, le pêcheur qui ne parle qu’à sa canne Rodney (fishing rod) ne m’a pas totalement convaincu.
\Mots-clés : #amérindiens #amour #initiatique #merlacriviere #nature #solitude
- le Lun 27 Nov - 20:30
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: David James Duncan
- Réponses: 12
- Vues: 728
Jean Giono
Le Chant du monde
Antonio, du fleuve (c’est un pêcheur qui vit sur l’île des geais), dit « bouche d’or », et Matelot, de la forêt (un ancien marin devenu bûcheron), partent à la recherche du besson, le dernier fils de ce dernier, parti dans le nord former un radeau de bois. Parvenus en pays Rebeillard, ils secourent une jeune aveugle, Clara « aux yeux de menthe », qui met au monde son fils seule dans la nuit, et la confient à « la mère de la route ». C’est le pays de Maudru, et ses bouviers traquent le besson.
Giono est toujours attentif à la nature.
« L’odeur des mousses se leva de son nid et élargit ses belles ailes d’anis. Une pie craqua en dormant comme une pomme de pin qu’on écrase. Une chouette de coton passa en silence, elle se posa dans le pin, elle alluma ses yeux. »
Ils cheminent vers Villevieille et ses tanneries, avec les malades d’une mystérieuse maladie (on pense à Le hussard sur le toit), et Médéric, le fils de la sœur de Maudru, que le « cheveu-rouge » (le besson) a blessé à mort. Ils retrouvent ce dernier chez monsieur Toussaint, le marchand d’almanachs (le guérisseur), qui est Jérôme, frère bossu de Junie, la femme de Matelot. Le dernier de deux jumeaux s'y est réfugié avec Gina, la fille de Maudru, qu’il a enlevée (et qui est déçue).
Médéric, donc Gina était la promise, meurt ; les Maudru les surveillent. Antonio rêve de Clara, Matelot de la mort qu’il voit comme un grand voilier blanc sur la montagne. Ce dernier meurt poignardé par les bouviers. Le besson et Antonio incendient Puberclaire, résidence de Maudru avec ses étables à taureaux.
Clara retrouvée par Antonio, les deux couples redescendent vers le sud pour y construire une nouvelle vie.
Le personnage du fleuve est sensible lorsqu’Antonio s’y baigne, et aussi lors de la débâcle printanière du renouveau de l’amour.
Ce roman est baigné d’une atmosphère légendaire, accentuée par certains vocables des lieux, et une faune fantastique, comme le congre d’eau douce et les houldres, mais aussi par des obscurités dans les dialogues et les péripéties.
« Il y avait une espèce d’oiseau qu’au pays Rebeillard on appelait les houldres. Ils étaient en jaquette couleur de fer avec une cravate d’or. »
C’est un univers apparemment symbolique, où j’ai reconnu des allusions mythologiques, mais sans qu’il semblât décryptable à la façon d’une parabole : c’est un fusionnement syncrétiste des humains avec les éléments et animaux et vice-versa, de l’homme-fleuve aux oiseaux qui parlent, tous participant d’une source de vie commune.
\Mots-clés : #amitié #amour #famille #jeunesse #merlacriviere #mort #nature #relationenfantparent #ruralité #violence
- le Dim 19 Nov - 13:02
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean Giono
- Réponses: 188
- Vues: 22166
Jean Giono
Solitude de la pitié
Vingt nouvelles souvent assez brèves :
Solitude de la pitié
Prélude de Pan
Champs
Ivan Ivanovitch Kossiakoff
La main
Annette ou une affaire de famille
Au bord des routes
Jofroi de la Maussan
Philemon
Joselet
Sylvie
Babeau
Le mouton
Au pays des coupeurs d'arbres
La grande barrière
Destruction de Paris
Magnétisme
Peur de la terre
Radeaux perdus
Le chant du monde
La première et l’éponyme me choque toujours malgré les relectures : un curé de village et sa servante profitent de manière particulièrement sordide du dénuement de nécessiteux, sans songer dans leurs calculs à en soulager la misère.
La seconde, Prélude de Pan, déjà présentée par Aventin ICI, demeure extraordinaire : après de menaçants signes météorologiques de la nature, l’homme avec « sa face de chèvre avec ses deux grands yeux tristes allumés », révolté par un assassin d’arbres (un bûcheron) qui a brisé l’aile d’une colombe des bois pour l’assujettir…
« De quel droit toi, tu l'as prise, et tu l'as tordue ? De quel droit, toi, le fort, le solide, tu as écrasé la bête grise ? Dis-moi ! Ça a du sang, ça, comme toi ; ça a le sang de la même couleur et ça a le droit au soleil et au vent, comme toi. Tu n'as pas plus de droit que la bête. On t'a donné la même chose à elle et à toi. T'en prends assez avec ton nez, t'en prends assez avec tes yeux. T'as dû en écraser des choses pour être si gros que ça... au milieu de la vie. T'as pas compris que, jusqu'à présent, c'était miracle que tu aies pu tuer et meurtrir et puis vivre, toi, quand même, avec la bouche pleine de sang, avec ce ventre plein de sang ? T'as pas compris que c'était miracle que tu aies pu digérer tout ce sang et toute cette douleur que tu as bus ? Et alors, pourquoi ? »
…Pan déchaîne une bacchanale orgiaque en manière de leçon aux hommes.
« Et ça entrait dans la pâte que l'homme pétrissait par la seule puissance de ses yeux, et ça entrait dans la pâte du grand pain de malheur qu'il était en train de pétrir. »
Ivan Ivanovitch Kossiakoff est une histoire apparemment autobiographique : agent de liaison avec les Russes dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, il lie une amitié sans parole avec un colosse.
L’auteur est d’ailleurs mis en scène dans la plupart des textes, où « Monsieur Jean » converse avec paysans, vieillards et bergères ; il collecte ainsi les paroles, l’enseignement du monde.
Il s’intéresse notamment aux arbres :
« On voit que vous ne le connaissez pas. Si on n'y était pas, ça ferait tout à sa fantaisie. L'arbre, c'est tout en fantaisie. C'est intelligent, je dis pas ; ça comprend des choses... mais c'est comme des bêtes, ça passe son temps à l'amusement. »
(Le mouton)
« Donc, pour nous remplacer la fontaine on plantait un cyprès au bord de la ferme, et comme ça, à la place de la fontaine de l'eau, on avait la fontaine de l'air avec autant de compagnie, autant de plaisir. Le cyprès, c'était comme cette canette qu'on enfonce dans le talus humide pour avoir un fil d'eau. On enfonçait le cyprès dans l'air et on avait un fil d'air. »
Le dernier extrait provient d’Au pays des coupeurs d'arbres où Giono, déjà écologiste, déplore les coupes rases :
« On a passé toute notre terre à la tondeuse double zéro : le pays vient d'être condamné aux travaux forcés à perpétuité. »
Ce recueil est une pépinière d’images, mais aussi de romans, comme avec le thème de la réaction cataclysmale de la nature ; c’est notamment le cas du dernier texte, Le chant du monde, qui annonce le roman du même nom et revendique l’égalité de traitement (sensoriel, littéraire, voire juridique) des éléments de la nature comme de l’homme, jusque dans leur violence.
« Il faut, je crois, voir, aimer, comprendre, haïr l'entourage des hommes, le monde d'autour, comme on est obligé de regarder, d'aimer, de détester profondément les hommes pour les peindre. Il ne faut plus isoler le personnage-homme, l'ensemencer de simples graines habituelles, mais le montrer tel qu'il est, c'est-à-dire traversé, imbibé, lourd et lumineux des effluves, des influences, du chant du monde. »
Ce qui m’a cette fois encore marqué dans ce recueil, c’est la « lutte entre l'homme et la garrigue » (Champs), combat désespéré qui trouve souvent son issue dans le suicide « Des hommes perdus sur des radeaux, en pleine terre » (Radeaux perdus), faibles dans le dur monde : pas la moindre notion de liberté évoquée à propos de l’humanité.
\Mots-clés : #amitié #contemythe #ecologie #nature #nouvelle #ruralité #spiritualité
- le Ven 17 Nov - 11:09
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean Giono
- Réponses: 188
- Vues: 22166
Jorn Riel
Le jour avant le lendemain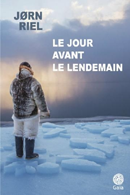
Ninioq, l’ancienne, est inquiète : le changement transforme son monde.
« Tout avait changé et continuait à changer. Si la mer, le ciel et les montagnes étaient tels qu’ils l’avaient toujours été, si les hommes continuaient à naître et à mourir, elle ressentait pourtant intensément que tout était en décomposition, qu’elle et sa tribu étaient en train d’abandonner la vie qui avait toujours été celle des hommes.
D’abord le renne avait disparu, ce qui avait été un grand malheur. Car sur ses traces étaient parties bien des tribus qui, autrefois, avaient peuplé le pays. Puis étaient survenues de longues périodes où les animaux de mer s’étaient tenus loin des côtes, entraînant de mauvaises chasses et des famines. Peut-être étaient-ce ces temps difficiles qui changeaient les hommes. Les tribus étaient devenues plus petites, plus sédentaires, et l’on avait commencé des querelles de sang qui se prolongeaient sur plusieurs générations. »
« À bien des points de vue, d’ailleurs, la vie de vieille femme lui paraissait aussi plaisante que celle de jeune femme. Parfois même plus amusante, puisqu’elle ne désirait plus tout ce qu’un être humain ne peut jamais atteindre. »
La vie des chasseurs nomades est évoquée, avec ses violences et malheurs, comme la famine, mais c’est le sort des vieillards qui est particulièrement souligné, qui vont s’exposer à la mort sur la glace lorsqu’ils sont devenus à charge.
C’est le départ du camp d’hiver pour celui d’été en kayaks et « bateaux de femmes », et les savoir-faire de Ninioq sont toujours précieux, qu’elle transmet aux plus jeunes. Pêche et chasse ayant été fructueuses, elle se porte volontaire pour le séchage de la provende sur une île à viande, avec son jeune petit-fils Manik qui en a exprimé le souhait, et Kongujuk la rhumatisante, qui meurt bientôt. Comme les autres ne viennent pas les rechercher, ils retournent au campement, où tout le monde est mort après une visite du grand bateau (des Blancs ; apparemment de maladie).
Ninioq raconte son existence et ses rêves à Manik, pressé de devenir son « pourvoyeur », mais qui a encore tant à apprendre…
« C’était en tout cas un fait que cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas contemplé de visages étrangers et que, partout où l’on voyageait, on ne rencontrait que ruines de maisons et emplacements de tentes abandonnés. »
« Manik buvait ses paroles. Il les prenait à lui, il les enfouissait au fond de sa conscience comme de précieux trésors et sentait qu’elles lui appartenaient comme elles avaient appartenu à tous les autres qui les avaient entendues avant lui. »
« Elle était fatiguée. Si fatiguée que la vie elle-même ne lui semblait plus souhaitable. Mais elle devait continuer à vivre pour le garçon. Elle n’avait pas peur de la mort. La mort viendrait comme une délivrance, un changement longtemps espéré dans cette existence à laquelle elle n’appartenait plus. Par contre, elle avait peur de la vie. Car la vie était devenue solitude, vide et crainte de ce qui pouvait arriver. Elle avait surtout peur pour le garçon. Que deviendrait-il quand elle mourrait ? »
C’est vrai qu’on ne rit guère dans cette évocation (malheureusement peu approfondie) assez effroyable de la vie des « eskimos » ; tout au long de cette lecture, j’ai pensé qu’elle ferait peut-être reconsidérer le retour aux sources "ethniques" en vogue actuellement chez les wannabes…
\Mots-clés : #mort #nature #solitude #vieillesse
- le Jeu 9 Nov - 11:15
- Rechercher dans: Écrivains de Scandinavie
- Sujet: Jorn Riel
- Réponses: 51
- Vues: 7415
Craig Johnson
Dark Horse
Absalom est un petit bled peu accueillant, et son nom évoque tant Faulkner que la Bible.
« Absalom était le fils du roi David – le fils maudit, celui qui s’est retourné contre lui. »
À propos, un dark horse est un outsider, mais aussi « une personne qui se dévoile très peu ; en particulier, qui a des capacités ou des talents inattendus », nous apprend la traductrice. À la fin du livre, Johnson explique que c’est aussi un étalon que son propriétaire faisait passer pour « un cheval de bât ordinaire », afin de gagner les paris de courses.
Le shérif Walt Longmire enquête à Absalom en « mission sous couverture » parce qu’il a un doute quant à la culpabilité de Mary Barsad, qui vient d’avouer avoir tué son mari. Polar bien mené (suspense, action), qui se passe dans un milieu rural, et même désertique, où Longmire revoit le ranch de son enfance. À souligner une présence attachante du chien et des chevaux (@Silveradow).
Pour ce qui est de lire les romans à la suite, et avec ou sans écart de temps, je n’avais plus en tête les personnages proches de Longmire, ce qui est un peu dommage, mais le livre se lit de façon autonome.
« Je pensai à la manière dont nous labourions et cultivions la terre, dont nous y plantions des arbres, l’enfermions avec des clôtures, y construisions des maisons et faisions tout notre possible pour repousser l’éternité de la distance – tout pour donner au paysage une espèce d’échelle humaine. Mais peu importait ce que nous faisions pour essayer de façonner l’Ouest, c’était l’Ouest qui nous façonnait inévitablement. »
\Mots-clés : #amérindiens #nature #polar #ruralité
- le Jeu 2 Nov - 16:34
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Craig Johnson
- Réponses: 38
- Vues: 2462
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages

