La date/heure actuelle est Sam 27 Juil - 10:09
234 résultats trouvés pour psychologique
Philip Roth
Pastorale américaine
Le romancier Nathan Zuckerman, la soixantaine, est contacté par l’idole de son enfance à Newark, Seymour Levov, « le Suédois », une star sportive, un Juif comme lui et son aîné de quelques années. Seymour est l’image-même de la réussite états-unienne, familiale, sociale, professionnelle. À ce propos, il a repris l’entreprise de son père, et dit avoir dû délocaliser son usine à regret, après les émeutes raciales de Newark de 1967, à cause de la situation sociale (violence et insécurité), pour former une main-d’œuvre compétente à l’étranger (ce qui constitue la succession inverse des faits telle qu’elle est souvent présentée). Seymour est vu comme un brave, gentil conformiste, dans le prolongement de sa jeunesse de « héros de lycée », « notre Kennedy ». Mais Nathan doit revoir son jugement :
« Le fait est que comprendre les autres n’est pas la règle, dans la vie. L’histoire de la vie, c’est de se tromper sur leur compte, encore et encore, encore et toujours, avec acharnement et, après y avoir bien réfléchi, se tromper à nouveau. C’est même comme ça qu’on sait qu’on est vivant : on se trompe. »
Jerry, le frère de Seymour, apprend à Nathan que ce dernier vient de mourir d’un cancer, et surtout qu’il était dévasté par l’attentat à la bombe perpétré par sa fille de seize ans en 1968 contre la guerre au Vietnam.
« Or survient la fille perdue, la fille en cavale, cette Américaine de la quatrième génération censée reproduire en plus parfait encore l’image de son père, lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite… survient la fille en colère, la malgracieuse, qui crache sur son monde et se fiche éperdument de prendre sa place dans la lignée Levov en pleine ascension sociale, sa fille, enfin, qui le débusque comme un fugitif, qui le pousse la première dans la transhumance d’une tout autre Amérique ; sa fille et ces années soixante qui font voler en éclats le type d’utopie qui lui est cher, à lui. Voilà la mort rouge qui contamine le château du Suédois, et personne n’en réchappe. Voilà sa fille qui l’exile de sa pastorale américaine tant désirée pour le précipiter dans un univers hostile qui en est le parfait contraire, dans la fureur, la violence, le désespoir d’un chaos infernal qui n’appartient qu’à l’Amérique. […]
Qui est fait pour la tragédie et la souffrance absurde ? Personne. La tragédie de l’homme qui n’était pas fait pour la tragédie, c’est la tragédie de tout homme. »
Meredith, dite Merry Levov, fait l’objet d’une « étiologie » (notamment psychiatrique) de son bégaiement de jeune adolescente révoltée qui se tourne vers l’extrémisme. Alors qu'elle est en cavale après l’attentat qu’elle a perpétré, Rita Cohen, qui s’avère être une terroriste communiste, prend contact avec Seymour.
Roth rend le calvaire de Seymour, lui si raisonnable, responsable.
« Telle est la vie extérieure, qu’il mène autant que faire se peut sans changement apparent. Mais elle se double d’une vie intérieure, d’une vie intérieure morbide, hantée par des obsessions tyranniques, des pulsions refoulées, des espoirs superstitieux, des imaginations effroyables, des conversations fantasmées, des questions insolubles. De nuit en nuit, insomnies, autopunition. Solitude colossale. […]
Et au quotidien rien à faire, sinon assumer cette imposture, continuer de vivre sous son identité, avec l’ignominie de se faire passer pour l’homme idéal. »
« S’il avait pu de nouveau fonctionner comme tout un chacun, redevenir tel qu’en lui-même, au lieu d’être ce charlatan à la sincérité schizophrène, lisse dehors, tourmenté dedans, stable aux yeux d’autrui, et pourtant le dos au mur en son for intérieur, puisque son personnage social détendu, souriant et factice servait de linceul au Suédois enterré vivant. S’il avait pu, si peu que ce fût, recouvrer son existence cohérente, indivise, qui lui avait donné son assurance physique, sa liberté d’allure avant d’engendrer une meurtrière présumée. »
Il décrit aussi la dépression de sa femme Dawn, une Irlandaise, ex-Miss New Jersey, musicienne, éleveuse de bétail, qui en est venue à le rendre responsable du drame ; il expose le métier de la ganterie transmis par son père à Seymour, ainsi que les valeurs de travail et d’excellence.
Puis Seymour retrouve Merry, devenue une adepte jaïn (« l’ahimsa, le respect systématique de la vie »), clandestine vivant dans des conditions sordides ; la terroriste a perdu son bégaiement, peut-être en se voilant pour ne pas tuer de petites vies. Fabricant des bombes, elle est la responsable directe de quatre morts (et a été victime de deux viols).
C’est tout le rêve américain fracassé qui est brossé, aboutissant dans la violence à une sorte de nihilisme dans un terrible conflit de génération.
« Trois générations. Toutes en ascension sociale. Le travail, l’épargne, la réussite. Trois générations en extase devant l’Amérique. Trois générations pour se fondre dans un peuple. Et maintenant, avec la quatrième, anéantissement des espoirs. Vandalisation totale de leur monde. »
« Il avait fait du mieux qu’un parent pouvait faire — il avait écouté tant et plus, alors même qu’il se retenait de toutes ses forces pour ne pas se lever de table et s’en aller en attendant qu’elle ait craché son venin. »
« Toujours dans la peau d’un personnage. Ce qui avait commencé de manière assez anodine du temps qu’elle jouait les Audrey Hepburn avait donc conduit en dix ans à ce mythe exotique de l’abnégation ? D’abord la niaise abnégation au nom du Peuple, maintenant la niaise abnégation de l’âme parachevée. Phase suivante, le crucifix de grand-mère Dwyer ? Est-ce qu’on allait revenir à l’abnégation suprême de l’éternelle chandelle et du Sacré-Cœur ? On était toujours dans l’irréalité grandiose, dans l’abstraction la plus lointaine — on ne s’occupait jamais de sa petite personne, alors là, jamais de la vie. Quelle imposture, quelle horreur inhumaine, cette abnégation ! »
« Tuer Conlon [le médecin victime collatérale de sa première bombe] n’avait fait que confirmer son ardeur de révolutionnaire idéaliste, qui n’hésitait pas à adopter les moyens, même impitoyables, de détruire un système injuste. »
Nombre de personnalités politiques états-uniennes sont évoquées, mais aussi Frantz Fanon, comme "influenceurs" de Merry. Jerry rabroue son frère à cause de son attitude envers le « monstre ». Puis Dawn décide de se refaire chirurgicalement une beauté, et de quitter la résidence rurale traditionnelle qui plaisait tant à Seymour (pleine de souvenirs) pour une maison lumineuse conçue par un architecte wasp (avec lequel elle trompe son mari – mais ce dernier a aussi fauté, avec Jessie, l’orthophoniste de Merry, qui accueillit celle-ci après son départ…). Cette confrontation avec ces amis, les Bill et Jessie Orcutt, les Barry et Marcia Umanoff, d’une certaine aristocratie ou élite intellectuelle établies, révèle (outre un fabuleux jeu de masques) un autre aspect social des États-Unis de la seconde moitié du XXe (et qui éclaire toujours la société contemporaine).
Des phrases comme celle-ci, en début de paragraphe, font d’avance sourire si on connaît un peu Roth :
« Au dîner la conversation roula sur le Watergate et sur Gorge profonde. »
Lou, le bavard père de Seymour, vieux has been, a des propos, certes décousus, mais pas forcément incohérents (il soutient aussi le fait que les délocalisations ont commencé avant les problèmes raciaux).
« C’est pas les syndicats à eux tout seuls qui nous ont cassés, cela dit. Les syndicats ont rien compris, mais certains industriels non plus. “Je veux pas payer ces fils de putes cinq cents de plus”, et le gars qui dit ça roule en Cadillac et passe l’hiver en Floride. Non, y a beaucoup d’industriels qui ont pas su réagir. Mais les syndicats n’ont jamais compris la concurrence d’outre-mer et, à mon avis, ils ont bel et bien accéléré la ruine de l’industrie du gant par leur intransigeance : on ne pouvait plus faire de bénéfices. »
Bill Orcutt :
« La permissivité. La perversion drapée dans les voiles de l’idéologie. La contestation perpétuelle. »
Roth évite de donner directement son avis en forçant le trait avec humour, en rapportant des points de vue erronés, des pensées attribuées à un personnage par le biais d’un autre (notamment son alter ego Zuckerman). Difficile de donner un résumé de ce livre sans être partial ; dans ce roman fouillé, qui compte près de 600 pages, Roth lance son lecteur sur de nombreuses pistes, le mène si bien qu’il le déroute souvent. Demeure cependant le constat d’un échec social, sociétal, voire civilisationnel d’une culture en pointe du monde occidental.
Au vu de son commentaire, ce n'est pas Topocl qui me contredira comme je recommande la lecture de ce livre.
\Mots-clés : #culpabilité #historique #humour #mondedutravail #politique #portrait #psychologique #relationenfantparent #satirique #social #solitude #terrorisme #xxesiecle
- le Sam 27 Avr - 13:38
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Philip Roth
- Réponses: 114
- Vues: 12705
Lawrence Block
Voilà, j'ai terminéSujet : Une jeune fille Wendy Hanniford a été assassinée avec une arme tranchante, son colocataire Richie Van Derpoele est retrouvé errant dans la rue et s'accusant. Matt Scudder est chargé par le père de la victime d'une enquête ; il veux "connaître" la personne qu'était devenue sa fille et sa vie, alors qu'il ne la voyait plus depuis 3 ans.environ.
J'ai beaucoup apprécié ; l'écriture sobre mais malgré tout invitante.
Est-ce à cause de l'intéressant personnage déchiré qu'est Matt ancien flic qui a démissionné (et qui porte toujours la culpabilité d'avoir tuer par ricochet, une fillette) mais qui a conservé les valeurs de son ancien métier et consent à "rendre service" à ceux qui le réclame ; des autres personnages sympathiques ou pas ; certainement, mais surtout pour la mentalité de Matt, sa persévérance à découvrir la vérité et s'il le faut à se procurer tous les éléments qui peuvent contribuer à prendre ou donner l'essentiel.
Tout meurtrier doit être puni, qu'importe la main qui agira, la parole qui livrera ou délivrera. Ce n'est que justice !
La force de Matt : sa psychologie, son honnêteté ; sa faiblesse : son alcoolisme et son humanité.
L'un de ses traits touchant, allume des cierges dans les églises pour la mémoire des victimes et coupables et faire un don dans tes troncs alors même qu'il avoue n'être pas croyant.
Un récit qui m'a emportée à la suite de Matt, à son rythme allègre, étourdie et curieuse.
Extraits :
"— L’instinct, sans doute. J’ai passé beaucoup d’années à regarder des gens décider jusqu’où ils voulaient aller dans la découverte de la vérité. Vous n’êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit, mais…"
"— Je n’ai même jamais seulement envisagé la possibilité que Richard soit innocent. J’ai toujours pensé que c’était lui qui l’avait tuée. Si ce que vous croyez est vrai…
— Ça l’est.
— Alors… il est mort pour rien.
— Il est mort pour vous, monsieur. L’agneau pour l’holocauste, c’est lui.
— Vous ne pensez pas sérieusement que j’ai tué cette fille, si ?
— De fait, je le sais."
"Les catholiques reçoivent plus d’argent de moi que tous les autres. Ce n’est pas que je les préfère, c’est simplement qu’ils restent ouverts plus longtemps. La plupart des protestants ferment boutique pendant la semaine.
Cela dit, les catholiques ont un plus. Ils ont des cierges qu’on peut allumer. J’en allumai trois avant de sortir. Un pour Wendy Hanniford qui n’aurait jamais vingt-cinq ans et un autre pour Richard Vanderpœl qui, lui, n’en aurait jamais vingt et un. Et, bien sûr, j’en allumai un troisième pour Estrella Rivers qui, elle, n’en aurait jamais huit."
"À un moment donné, je lui dis :
— Quelle que soit la culpabilité que vous décidiez de retenir à votre encontre, n’oubliez jamais ceci : Wendy était en train de devenir une fille bien. Je ne sais pas combien de temps il lui aurait fallu pour gagner sa vie un peu plus proprement, mais je doute fort que ç’ait dépassé une année."
"Parce que ce monde était de solitude et qu’elle y avait toujours vécu dans la seule compagnie du fantôme de son père. Les hommes qu’elle trouvait, ceux qui l’attiraient, appartenaient à d’autres femmes et rentraient chez eux pour les retrouver lorsqu’ils en avaient fini avec elle. Dans son appartement de Bethune Street, elle voulait quelqu’un qui n’essaie pas de coucher avec elle. Quelqu’un qui serait une compagnie de qualité. D’abord Marcia – et Wendy n’avait-elle pas été un peu déçue lorsqu’elle avait accepté de sortir avec ses hommes ? Je suis sûr que si, parce que au moment même où elle trouvait quelqu’un pour partager ses hommes, elle perdait une compagne qui n’appartenait pas à ce monde éclaté, mais avait encore cette innocence que Marcia avait reconnue en Wendy."
"Il m’arrive de penser que nous n’avons guère les moyens de changer notre destin. Nos existences se jouent selon un plan qui nous échappe. (Il eut un bref sourire.) C’est là une idée très réconfortante ou désespérante, monsieur Scudder.
— Je le vois bien"
je continuerai la trilogie.
\Mots-clés : #criminalite #culpabilité #psychologique #sexualité
- le Dim 7 Avr - 14:42
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Lawrence Block
- Réponses: 20
- Vues: 1097
Joseph Conrad
Jeunesse, Cœur des ténèbres, Au bout du rouleau
Jeunesse
Marlow (dont c’est la première apparition dans l’œuvre de Conrad) raconte à ses compagnons marins (dont le narrateur) son premier voyage de lieutenant de la marine marchande, à bord de la « “Judée, Londres, Marche ou meurs.” », « vieille baille » sur laquelle il embarqua avec l’enthousiasme de ses vingt ans à destination de Bangkok. Le rafiot, qu’il chérit, est en si mauvais état qu’il doit revenir trois fois en Angleterre, changeant autant de fois d’équipage. Après avoir failli couler tant il faisait eau, c’est la combustion de sa cargaison de charbon qui l’enverra par le fond. Récit épique et aussi plein d’humour, avec de frappantes descriptions qui en font un chef-d’œuvre des aventures maritimes.
Cœur des ténèbres
C’est encore Charlie Marlow (et l’auteur) qui parle(nt), sensiblement dans les mêmes conditions que le texte précédent – en fait un monologue, d’abord méditatif sur les ténèbres et la lumière sur la Tamise au cours du temps, puis la narration de son expérience de marin d’eau douce sur un autre fleuve, cette fois au cœur du continent africain. L’idée lui en est venue de sa fascination pour les blancs des cartes de géographie ; Conrad a rapporté dans Du goût des voyages ce même enthousiasme cartographique à l’origine de ses voyages.
Marlow décrit son embauche par « la Compagnie » à Paris, « la ville sépulcrale », dans une atmosphère de malaise assez sinistre et inquiétante (des secrétaires-Parques tricotent une « laine noire », mise en abyme de ce récit sur le destin).
L’absurde et l’irréalité s’additionnent à la situation pratique tandis qu’il se rapproche de son commandement, un vapeur coulé qu’il remet en état près d’un comptoir d’ivoire. Cette histoire est le lieu de considérations sur la colonisation et le progrès civilisateur (depuis la conquête de l’Angleterre par les Romains ; dans le prolongement d’Un avant-poste du progrès), qui sont pour le moins remis en question (versus la « nature sauvage »).
Marlow entend beaucoup parler de Mr. Kurtz, le chef de la station de l’intérieur, le meilleur agent de la Société, et pour le rencontrer remonte le fleuve (façon L’odyssée de l’African Queen de Cecil Scott Forester) avec un équipage de coupeurs de bois pour la chaudière (noirs) et les « pèlerins » (blancs) avec à leur tête le directeur, homme ambitieux, mesquin et désagréable. Marlow rencontre un jeune Russe, en admiration devant Kurtz comme la tribu qui les assaille d’abord. Apparaît aussi la « femme barbare et magnifique », la « Promise » de Kurtz. Celui-ci est malade, mais son éloquence convainc toujours.
« Quelle voix ! Quelle voix ! Elle conserva sa profonde sonorité jusqu’à la fin. Elle survivait à sa force pour continuer de dissimuler sous les draperies magnifiques de l’éloquence les arides ténèbres de son cœur. »
Angoissé par « l’horreur », l’homme a encore de vastes projets, il fascine toujours, avec une puissance obscure, avide et parfois violente, explorant la contrée, accumulant l’ivoire ; sa tête a le teint de ce dernier (cf. Marlon Brando dans Apocalypse Now, film de Coppola tiré de cette novella). Il a toujours de l’ascendant, même devenu une « ombre ».
« Il était d’une noirceur impénétrable. »
Et cette cargaison est emportée par le vapeur lors d’un retour au cours duquel Kurtz meurt. Marlow, « fiévreux », demeure fidèle à la mémoire de « l’homme remarquable » qu’il a si peu connu, et devient le dépositaire de ses papiers personnels (mais apparemment pas de ceux qui traitent de ses découvertes).
Une fois encore je suis incapable de définir la nature exacte du personnage, et du cauchemar ; il me semble maintenant que cette ambiguïté fut peut-être plus sciemment voulue par Conrad que je ne le pensais jusqu’alors. Ce qui ne fait qu’ajouter à la profondeur de ce questionnement métaphysique, existentiel.
Au bout du rouleau
Le capitaine Whalley, soixante-sept ans, ne court plus l’aventure, mais cabote en Extrême-Orient. Ruiné, il n’a plus de bateau, mais a mis l’argent qu’il lui restait dans le Sofala, vieux vapeur du chef mécanicien-armateur Massy dont il devint ainsi le capitaine. Massy déborde de ressentiment, le second, Sterne, de malveillance au service de son ambition. Un petit Malais, le serang (pilote), semble inséparable du capitaine.
Mr. Van Wyk, un Hollandais qui vit retiré dans sa plantation sur une île, a sympathisé avec Whalley, qui lui apporte son courrier tous les mois. Ce dernier lui avoue qu’il devient aveugle, et qu’il en est réduit à cacher sa cécité grandissante pour préserver ce qui lui restera d’argent au terme d’un contrat de trois ans, au profit de sa fille dans le besoin. Massy a compris la situation, mais Van Wyk le circonvient ; Massy naufrage le navire.
L’intérêt de cette novella (où les évènements sont parfois à la limite de la plausibilité) réside essentiellement dans la psychologie des personnages (elle aussi assez tortue), et surtout l’imposante figure qu’est cet intègre et pathétique capitaine Whalley.
« Il n’avait plus rien à lui ; même son propre passé d’honneur, de vérité, de juste fierté, avait disparu. Toute son existence sans tache s’était effondrée dans l’abîme ; il lui avait dit son dernier adieu. Mais ce qui appartenait à sa fille, cela il voulait le sauver. Rien qu’un peu d’argent. Il le lui porterait lui-même, ce dernier don d’un homme qui avait trop duré. Et une immense et farouche impulsion, la passion même de la paternité, déchaîna dans toute la vigueur inextinguible de sa misérable vie, le désir de voir son visage. »
Trois délectables relectures, telles que rassemblées par l’auteur et publiées dans le Quarto Gallimard.
\Mots-clés : #aventure #colonisation #culpabilité #merlacriviere #portrait #psychologique #voyage
- le Ven 22 Mar - 11:45
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Joseph Conrad
- Réponses: 104
- Vues: 15782
Lawrence Block
Un ticket pour la morgue
De nouveau Matthew Scudder, lorsqu’il a quitté l’alcool et la police pour les Alcooliques Anonymes. Il est toujours assez assidu à leurs réunions (et lit, plus irrégulièrement, les Pensées de Marc Aurèle) : le livre contient plusieurs témoignages sur cette organisation, et la lutte perpétuelle de ses membres pour leur abstinence.
« — J’ai toujours voulu croire que tout irait bien pour nous une fois que nous aurions cessé de boire, mais ce n’est pas vrai. Le miracle de la sobriété, ce n’est pas de rendre notre vie meilleure, c’est que nous arrivons à rester sobres même quand tout va mal. Quand Cody a attrapé le sida, j’en étais malade, tellement je trouvais ça injuste. Je pensais que les gens sobres n’attrapent pas le sida. Et que les gens sobres ne se suicident pas. Mon Dieu, toutes les fois où j’ai pensé à me tuer, quand je buvais et ça ne m’arrive plus du tout et je croyais que c’était comme ça pour tout le monde. Et puis aujourd’hui j’apprends que Toni s’est suicidée et j’ai pensé que ce n’était pas juste, que ça n’aurait pas dû arriver. Mais n’importe quoi peut arriver et je ne me remets quand même pas à boire. »
Elaine est une prostituée avec qui Matt eut une liaison. Il fit envoyer en prison (par imposture) James Leo Motley, qui aimait à terroriser ses pareilles, et vient de finir de purger sa peine (de un à dix ans, au total douze ans à cause de sa conduite meurtrière).
« Il disait qu’il donnait toujours à ses femmes ce qu’elles voulaient. La plupart rêvaient d’être battues, disait-il. Certaines voulaient être tuées. »
Motley (plus adepte de Nietzsche) s’en prend aux relations féminines de Matt, proches ou éloignées. C’est un type assez effrayant, et fort : il subjugue, presque par suggestion, et connaît les points sensibles de la douleur physique.
« Une pensée me vint, une vague idée en marge. Il était là dehors, il menaçait toutes ces femmes qui avaient été les miennes et moi j’étais là, courant en tous sens comme un jongleur essayant de garder toutes ses balles en l’air. Cherchant à les sauver, à les protéger, Elaine, Anita et Jan, tout en essayant par la même occasion de les retenir. En essayant, dans un sens, de confirmer ce qu’elles étaient d’après lui, mes femmes, les miennes.
En tentant dans la foulée de nier la vérité, de fermer les yeux à la réalité. De réfuter l’amère vérité, que ces femmes n’étaient pas les miennes et ne l’avaient probablement jamais été. Que je n’avais personne et n’aurai sans doute jamais personne. »
Matt est quasiment dominé par Motley, qui parvient à atteindre Elaine dans leur duel à travers New York.
La question de la peine de mort revient plusieurs fois, et finalement Matt tue Motley, maquillant son assassinat en suicide. Explicit :
« L’hiver a été froid et on dit que ce n’est pas fini. C’est dur pour les sans toit ; il y a eu deux morts la semaine dernière quand la température est tombée à moins vingt. Mais pour la majorité d’entre nous, ce n’est pas trop grave. On s’habille plus chaudement et on marche un peu plus vite, voilà tout. »
J’ai découvert dans ce roman paru en 1990 l’origine états-unienne de l’expression « abus de "substance" », qui était le nouvel euphémisme pour la cocaïne.
\Mots-clés : #addiction #polar #psychologique
- le Mer 24 Jan - 11:47
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Lawrence Block
- Réponses: 20
- Vues: 1097
Jean-Jacques Rousseau
Les Rêveries du promeneur solitaire
J’ai retrouvé après un demi-siècle ces lamentations autocentrées, déjà romantiques dans leur hypersensibilité et leur solitude élitiste, larmoiements égotistes et même paranos qui m’avaient agacé, comme dans ce suffisant jugement :
« Je fais la même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire au sien : car il n'écrivait ses Essais que pour les autres, et je n'écris mes rêveries que pour moi. »
Mais il est vrai que ce n’est pas Rousseau lui-même qui a publié ce recueil (inachevé) de dix promenades, conçu dans la prolongation des Confessions. J’ai donc fait l’effort d’en reprendre la lecture, et d’ailleurs la prose est belle et sensible.
« Mon imagination déjà moins vive ne s'enflamme plus comme autrefois à la contemplation de l'objet qui l'anime, je m'enivre moins du délire de la rêverie ; il y a plus de réminiscence que de création dans ce qu'elle produit désormais, un tiède alanguissement énerve toutes mes facultés, l'esprit de vie s'éteint en moi par degrés ; mon âme ne s'élance plus qu'avec peine hors de sa caduque enveloppe, et sans l'espérance de l'état auquel j'aspire parce que je m'y sens avoir droit, je n'existerais plus que par des souvenirs. »
Il n’en reste pas moins que demeurent en travers de la gorge des propos tels que :
« Après les recherches les plus ardentes et les plus sincères qui jamais peut-être aient été faites par aucun mortel, je [… »
« Je me refuse ainsi à toutes nouvelles idées comme à des erreurs funestes qui n'ont qu'une fausse apparence et ne sont bonnes qu'à troubler mon repos. »
« …] car j'ai très peu fait de bien, je l'avoue, mais pour du mal, il n'en est entré dans ma volonté de ma vie, et je doute qu'il y ait aucun homme au monde qui en ait réellement moins fait que moi. »
La Quatrième promenade présente des arguties captieuses sur ses mensonges, au nom de la morale qui lui serait naturelle ; mieux, il ne tolère que la fiction qui a une finalité morale.
« Il suit de toutes ces réflexions que la profession de véracité que je me suis faite a plus son fondement sur des sentiments de droiture et d'équité que sur la réalité des choses, et que j'ai plus suivi dans la pratique les directions morales de ma conscience que les notions abstraites du vrai et du faux. »
Dans la Cinquième promenade, Rousseau avoue qu’il serait demeuré avec plaisir dans « l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne », seul (avec du personnel), herborisant et se promenant oisivement.
Quelque chose qui semble participer de la misanthropie et de la mise à distance dédaigneuse teinte souvent cette autocritique un peu partisane.
« Le résultat que je puis tirer de toutes ces réflexions est que je n'ai jamais été vraiment propre à la société civile où tout est gêne, obligation, devoir, et que mon naturel indépendant me rendit toujours incapable des assujettissements nécessaires à qui veut vivre avec les hommes. »
Dans le Septième promenade, après la société des hommes, ce sont la géologie, la zoologie, l’astronomie qu’il dénigre, et ne lui reste que la botanique pour jouir de la nature où il fuit la société humaine : encore une autojustification oiseuse.
« Je sens des extases, des ravissements inexprimables à me fondre pour ainsi dire dans le système des êtres, à m'identifier avec la nature entière. Tant que les hommes furent mes frères, je me faisais des projets de félicité terrestre ; ces projets étant toujours relatifs au tout, je ne pouvais être heureux que de la félicité publique, et jamais l'idée d'un bonheur particulier n'a touché mon cœur que quand j'ai vu mes frères ne chercher le leur que dans ma misère. Alors pour ne les pas haïr il a bien fallu les fuir ; alors me réfugiant chez la mère commune j'ai cherché dans ses bras à me soustraire aux atteintes de ses enfants, je suis devenu solitaire, ou, comme ils disent, insociable et misanthrope, parce que la plus sauvage solitude me paraît préférable à la société des méchants, qui ne se nourrit que de trahisons et de haine. »
Dans la Huitième promenade, le dépressif et autosatisfait Rousseau se révèle aussi précurseur du complotisme.
« Moi qui me sentais digne d'amour et d'estime, moi qui me croyais honoré, chéri comme je méritais de l'être, je me vis travesti tout d'un coup en un monstre affreux tel qu'il n'en exista jamais. Je vois toute une génération se précipiter tout entière dans cette étrange opinion, sans explication, sans doute, sans honte, et sans que je puisse au moins parvenir à savoir jamais la cause de cette étrange révolution. Je me débattis avec violence et ne fis que mieux m'enlacer. Je voulus forcer mes persécuteurs à s'expliquer avec moi ; ils n'avaient garde. Après m'être longtemps tourmenté sans succès, il fallut bien prendre haleine. Cependant j'espérais toujours ; je me disais : un aveuglement si stupide, une si absurde prévention, ne saurait gagner tout le genre humain. Il y a des hommes de sens qui ne partagent pas ce délire ; il y a des âmes justes qui détestent la fourberie et les traîtres. Cherchons, je trouverai peut-être enfin un homme ; si je le trouve, ils sont confondus. J'ai cherché vainement, je ne l'ai point trouvé. La ligue est universelle, sans exception, sans retour, et je suis sûr d'achever mes jours dans cette affreuse proscription, sans jamais en pénétrer le mystère. »
La parade psychique est soigneusement décrite : il se tourne alors vers l’« amour de moi-même » (et non plus l’amour-propre) : sa propre estime, inaltérable, contre l’opinion des autres. Il vit dans le présent, dans l’oubli, dans "son" monde.
Neuvième promenade : Rousseau est persécuté ; en voici la cause bénigne :
« Je comprends que le reproche d'avoir mis mes enfants aux Enfants-Trouvés a facilement dégénéré, avec un peu de tournure, en celui d'être un père dénaturé et de haïr les enfants. Cependant il est sûr que c'est la crainte d'une destinée pour eux mille fois pire et presque inévitable par toute autre voie, qui m'a le plus déterminé dans cette démarche. »
Dans cette introspection d'un individualisme novateur en littérature, je n'ai pas su démêler tout l'apport philosophique, d'ailleurs gêné par une religiosité foncière.
\Mots-clés : #autobiographie #intimiste #philosophique #psychologique #solitude #vieillesse
- le Lun 22 Jan - 11:12
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean-Jacques Rousseau
- Réponses: 47
- Vues: 2222
Ian McEwan
L'Enfant volé
Angleterre, juste avant 1987 (date de parution du livre) : Kate, la fille de trois ans de Stephen Lewis, auteur à succès de livres pour enfants, est mystérieusement enlevée comme ils faisaient des courses. La dévastation du couple qu’il formait avec Julie est excellemment rendue.
« Il était père d’un enfant invisible. »
Charles Darke, son éditeur devenu un ami, s’est lancé dans la politique après une brillante carrière dans les affaires, choisissant cyniquement la droite au pouvoir.
Stephen rêvasse pendant les séances d’un comité gouvernemental en charge de la préparation d’un manuel de pédagogie (qui s’avèrera avoir écrit d’avance par les services du Premier ministre). Il voit en hallucination ses parents venus à bicyclette dans un pub avant sa naissance. Il leur rend visite, réchappe d’un accident de la circulation, répond à l’invitation de Charles et Thelma, son épouse enseignante en physique quantique, qui ont quitté la vie publique pour se retirer à la campagne (lui semble retombé en enfance). Puis Stephen retourne au whisky et aux émissions télévisées. Enfin il sort de sa catatonie et reprend des activités. Le Premier ministre l’invite, l’interroge sur Charles.
Charles, qui a rédigé le manuel pour ce dernier qui le désire, se laisse mourir de froid, déchiré entre son désir d’enfance et son existence sociale ambitieuse.
Stephen retrouve Julie qui, trois ans après la disparition de Kate, donne vie à un nouvel enfant.
« Tout l’art d’un mauvais gouvernement consistait à rompre le lien entre la politique adoptée dans le domaine public et le sens profond et instinctif de bonté et d’équité de l’individu. »
« Tous ces esprits prometteurs, cultivés, brûlants d’enthousiasme, après des études de littérature anglaise qui avaient inspiré leurs brefs slogans – L’énergie est une joie perpétuelle, à bas les contraintes, vive les étreintes –, tous avaient déferlé des bibliothèques au tournant des années soixante-dix, fermement résolus à entreprendre des voyages intérieurs, ou des voyages vers l’Orient dans des cars bariolés. Une fois le monde devenu moins vaste et plus sérieux, ils étaient rentrés au pays afin de se mettre au service de l’Éducation, carrière qui avait à présent perdu son envergure et son attrait ; les écoles étaient mises en vente sur le marché de l’investissement privé, et l’âge de scolarité obligatoire allait bientôt être abaissé. »
« Il donnait l’impression d’être raisonnable et tout à fait concerné, tout en préconisant la nécessité de laisser les pauvres se débrouiller tout seuls et d’encourager les riches. »
« Une minorité perturbatrice de l’humanité considérait tout voyage, aussi bref soit-il, comme l’occasion de faire de plaisantes rencontres. Il se trouvait des gens prêts à infliger des détails intimes à de parfaits inconnus. Des gens à éviter si vous faisiez partie de la majorité de ceux pour qui un voyage offre une opportunité de silence, de réflexion, de rêve. »
« Ils faisaient face à deux possibilités, de poids égal, en équilibre sur un pivot affilé. Dès l’instant où ils pencheraient en faveur de l’une, l’autre, tout en continuant à exister, disparaîtrait à tout jamais. Il pourrait se lever maintenant, et passer devant elle pour se rendre à la salle de bains en lui adressant un sourire plein d’affection. Il s’y enfermerait, sauvegardant son indépendance et sa fierté. Elle l’attendrait en bas, et ils reprendraient le fil de leur conversation prudente jusqu’à ce qu’il fût temps qu’il traverse le champ pour reprendre le train. Ou alors, il fallait risquer quelque chose, il voyait se déployer devant lui une vie différente dans laquelle son propre malheur pouvait redoubler ou disparaître. »
« Et il n’y avait pas de terrain plus propice aux spéculations péremptoirement maquillées en véritables faits que celui de l’éducation des enfants. »
Ce roman brillamment écrit part un peu dans tous les sens, mais vaut pour son regard sur la société (celle aussi des mendiants badgés), la politique (notamment thatchérienne) et même la science (surtout par rapport au temps), aussi par la psychologie des personnages (et l’humour de l’auteur).
\Mots-clés : #culpabilité #education #politique #psychologique #relationdecouple #social #xxesiecle
- le Mer 17 Jan - 11:23
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Ian McEwan
- Réponses: 41
- Vues: 4461
Joe Wilkins
Ces montagnes à jamais
Montana, plus précisément dans le comté de Musselshell (cf. La Montagne et les Pères), peu après l’élection d’Obama. Wendell est un travailleur agricole d’origine modeste dans un élevage de bovins, et il recueille en tant que cousin de sa mère en prison Rowdy, un gamin mutique « dans le spectre autistique » (personnage attachant car bien rendu). Joe Wilkins nous fait progressivement (et habilement, car on suit chaque protagoniste séparément et simultanément) découvrir qu’il est le fils de Verl, disparu dans la montagne après avoir tué un loup, puis un garde-chasse.
Gillian, enseignante démocrate (de Rowdy notamment), est la veuve de Kevin, diplômé en foresterie devenu garde-chasse, abattu par Verl.
D’un côté « des gens libéraux, universitaires, pas particulièrement intéressés par les résultats sportifs du lycée ni par la religion », de l’autre « la pauvreté rurale, […] le manque d’instruction, […] le fondamentalisme religieux et les idées politiques réactionnaires, […] la montagne elle-même – et la famille » qui se confrontent (et c’est évidemment la fracture démocrates et républicains).
Gillian :
« Elle s’adressait à Brian, le beau-père du garçon, et à tous ces hommes violents, ignorants et arrogants dans ces montagnes, à ceux qui pensaient que l’est du Montana tout entier leur appartenait et qu’ils pouvaient y agir à leur guise, qui oubliaient avec une facilité déconcertante que leurs arrière-grands-pères avaient reçu ces terres gratuitement, que leurs grands-pères avaient provoqué le Dust Bowl, que leurs grands-pères et leurs pères avaient empoisonné les rivières et presque décimé la population de cerfs, d’antilopes pronghorn et de grouses, et que le gouvernement fédéral était intervenu à chaque fois – de l’installation d’un réseau électrique dans les régions reculées jusqu’aux prêts des terres gouvernementales pour laisser paître le bétail, en passant par les contrats de location très généreux – afin de subventionner ce mode de vie dont ils se vantaient toujours. Elle en avait sa claque. À l’exception de Billings, ce territoire de l’est Montana était un trou noir où s’engouffrait l’argent du contribuable, un tourbillon terrible de dégradation écologique, d’absence d’instruction, d’alcool, de méthamphétamines et de familles brisées. Et les gens comme elle, ceux qui travaillaient vraiment dur, les professeurs d’école et les assistants sociaux et les agents du BLM [Bureau of Land Management, agence américaine faisant partie du département de l’Intérieur des États-Unis et chargée de la gestion des terres publiques], c’était toujours à eux de réparer et de nettoyer. »
« Les bus-nord et ouest arrivèrent en grondant et s’arrêtèrent dans un soupir presque au même instant, l’un derrière l’autre, puis les portes jaunes coulissèrent. Les enfants des Bull Mountains bondirent du bus-nord, souriant et hurlant. Ils s’essuyaient le nez aux manches de leurs manteaux trop fins, et presque aucun ne portait de bonnet, leurs cheveux sales en bataille. Les enfants qui vivaient dans les petits ranchs et les banlieues à mi-chemin de Billings descendirent du bus-ouest, emmitouflés et enjoués, leurs cartables à l’effigie de super-héros et de personnages de dessins animés populaires, les filles arborant des rubans et des barrettes dans les cheveux, les garçons robustes et lumineux, de petites ampoules rouges clignotant autour de leurs semelles de baskets. »
« Gillian avait longtemps méprisé l’influence considérable que les gros fermiers et ranchers exerçaient dans le Montana. Elle n’était pas versée dans la lutte des classes, pas franchement, mais elle n’avait rien reçu en héritage. Non, elle avait payé ses propres études universitaires en travaillant à la bibliothèque pendant l’année scolaire et comme serveuse l’été. Elle avait économisé et acheté seule la maison de Billings, elle avait réussi à économiser pour les futurs frais de scolarité de Maddy et pour sa propre retraite. Mais tous ces ranchers vivaient sur des terres qui avaient été simplement données à leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, et ils pensaient parfois être les seuls à travailler dur, que leur mode de vie était le seul qui importait lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions pour l’État du Montana. »
La nature est centrale, souvent endommagée par l’activité humaine.
« Une terre de pins ravagés par les insectes, d’étés toujours plus longs et d’hivers plus courts et plus secs. »
Maddy, la fille de Gillian, rencontre Wendell sans qu’ils connaissent l’identité de l’autre ; des indépendantistes chasseurs de loups, pour qui Verl est un héros, surgissent…
C’est l’aspect humain (psychologique et social) qui m’a plu, davantage que l’histoire en elle-même (bien que le suspense soit entretenu avec adresse).
\Mots-clés : #misere #politique #psychologique #ruralité
- le Jeu 7 Déc - 11:27
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Joe Wilkins
- Réponses: 9
- Vues: 1028
Guy de Maupassant
Fort comme la mort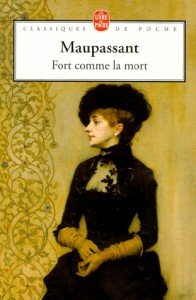
Olivier Bertin, peintre célèbre mais assujetti à son « désir de plaire », a depuis douze ans pour maîtresse la comtesse de Guilleroy, mariée à un riche député, lorsque la fille de ceux-ci revient vivre avec eux. Lassé de sa solitude de célibataire, Bertin fréquente assidûment la comtesse, et de fait, sa fille, qui lui ressemble beaucoup, similitude qu’Annette et sa mère Anne cultivent.
La beauté d’Anne, affectée par la mort de sa propre mère, perd de sa fraîcheur, et le vieillissant Olivier dépérit loin d’elle, et de sa fille. Anne le prévient du danger, celui de s’éprendre de d'Annette.
« Le grand soleil les éclairant, il confondait moins à présent la comtesse avec Annette, mais il confondait de plus en plus la fille avec le souvenir renaissant de ce qu’avait été la mère. Il avait envie de les embrasser l’une et l’autre, l’une pour retrouver sur sa joue et sur sa nuque un peu de cette fraîcheur rose et blonde qu’il avait savourée jadis, et qu’il revoyait aujourd’hui miraculeusement reparue, l’autre parce qu’il l’aimait toujours et qu’il sentait venir d’elle l’appel puissant d’une habitude ancienne. »
« Quelquefois elle avait prié parce que son cœur était triste, quand elle redoutait surtout les abandons d’Olivier. Sans confier au ciel, alors, la cause de sa supplication, traitant Dieu avec la même hypocrisie naïve qu’un mari, elle lui demandait de la secourir. »
« Il voulait reproduire exactement ce qu’il avait vu au parc Monceau, en se promenant avec Annette : une fille pauvre, rêvant, un livre ouvert sur les genoux. Il avait beaucoup hésité s’il la ferait laide ou jolie ? Laide, elle aurait plus de caractère, éveillerait plus de pensée, plus d’émotion, contiendrait plus de philosophie. Jolie, elle séduirait davantage, répandrait plus de charme, plairait mieux.
Le désir de faire une étude d’après sa petite amie le décida. La Rêveuse serait jolie, et pourrait, par suite, réaliser son rêve poétique, un jour ou l’autre, tandis que la laide demeurerait condamnée au rêve sans fin et sans espoir. »
« Elle avait compris cela, tout d’un coup, en sentant les hommages s’en aller vers Annette. Dans ce royaume, la maison d’une jolie femme, dans ce royaume où elle ne supporte aucun ombrage, d’où elle écarte avec un soin discret et tenace toute redoutable comparaison, où elle ne laisse entrer ses égales que pour essayer d’en faire des vassales, elle voyait bien que sa fille allait devenir la souveraine. »
« Ce qu’on aime, en somme, ce n’est pas tant Mme X... ou M. Z... c’est une femme ou un homme, une créature sans nom, sortie de la Nature, cette grande femelle, avec des organes, une forme, un cœur, un esprit, une manière d’être générale qui attirent comme un aimant nos organes, nos yeux, nos lèvres, notre cœur, notre pensée, tous nos appétits sensuels et intelligents. On aime un type, c’est-à-dire la réunion, dans une seule personne, de toutes les qualités humaines qui peuvent nous séduire isolément dans les autres. »
« Le temps passait, insensible et doux, dans ce joli travail de sélection [d’un bijou] plus captivant que tous les plaisirs du monde, distrayant et varié comme un spectacle, émouvant aussi, presque sensuel, jouissance exquise pour un cœur de femme. »
La lecture de ce roman est assez longue, surtout l’indispensable exposition de la première partie. La psychologie fouillée est remarquable par sa clarté d’énonciation, qui laisse peu d’ombre et de non-dits dans le sujet traité (on se demande quand même quelle est l’extension du terme "baiser" dans les relations du couple adultère) ; le vocabulaire reste simple, accessible, la prose tendant vers une sobre netteté de la langue française.
\Mots-clés : #psychologique
- le Mar 21 Nov - 11:26
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Guy de Maupassant
- Réponses: 25
- Vues: 1560
Javier Cercas
L'imposteur
Cercas détaille comme, troublé par l'histoire d’Enric Marco, « le grand imposteur et le grand maudit » qui s'est fait passer pour un survivant des camps de concentration et est devenu une célébrité espagnole de la mémoire historique des horreurs nazies, il s’est finalement résolu à écrire ce roman non fictionnel. « Comprendre, est-ce justifier ? » N’est-il pas lui-même un imposteur ?
« La pensée et l’art, me disais-je, essaient d’explorer ce que nous sommes, ils révèlent notre infinie variété, ambiguë et contradictoire, ils cartographient ainsi notre nature : Shakespeare et Dostoïevski, me disais-je, éclairent les labyrinthes de la morale jusque dans leurs derniers recoins, ils démontrent que l’amour est capable de conduire à l’assassinat ou au suicide et ils réussissent à nous faire ressentir de la compassion pour les psychopathes et les scélérats ; c’est leur devoir, me disais-je, parce que le devoir de l’art (ou de la pensée) consiste à nous montrer la complexité de l’existence, afin de nous rendre plus complexes, à analyser les ressorts du mal pour pouvoir s’en éloigner, et même du bien, pour pouvoir peut-être l’apprendre. »
« Un génie ou presque. Car il est bien sûr difficile de se départir de l’idée que certaines faiblesses collectives ont rendu possible le triomphe de la bouffonnerie de Marco. Celui-ci, tout d’abord, a été le produit de deux prestiges parallèles et indépassables : le prestige de la victime et le prestige du témoin ; personne n’ose mettre en doute l’autorité de la victime, personne n’ose mettre en doute l’autorité du témoin : le retrait pusillanime devant cette double subornation – la première d’ordre moral, la seconde d’ordre intellectuel – a fait le lit de l’escroquerie de Marco. »
« Depuis un certain temps, la psychologie insiste sur le fait qu’on peut à peine vivre sans mentir, que l’homme est un animal qui ment : la vie en société exige cette dose de mensonge qu’on appelle éducation (et que seuls les hypocrites confondent avec l’hypocrisie) ; Marco a amplifié et a perverti monstrueusement cette nécessité humaine. En ce sens, il ressemble à Don Quichotte ou à Emma Bovary, deux autres grands menteurs qui, comme Marco, ne se sont pas résignés à la grisaille de leur vie réelle et qui se sont inventés et qui ont vécu une vie héroïque fictive ; en ce sens, il y a quelque chose dans le destin de Marco, comme dans celui de Don Quichotte et d’Emma Bovary, qui nous concerne profondément tous : nous jouons tous un rôle ; nous sommes tous qui nous ne sommes pas ; d’une certaine façon, nous sommes tous Enric Marco. »
Simultanément s’entrelace l’histoire de Marco depuis l’enfance, retiré nourrisson à sa mère enfermée à l’asile psychiatrique ; il aurait été maltraité par sa marâtre et ignoré par son père ouvrier libertaire, puis ballotté d’un foyer à l’autre, marqué par les évènements de la tentative d’indépendance catalane d’octobre 1934, juste avant que le putsch et la guerre civile éclatent. Cercas a longuement interviewé Marco, un vieillard fort dynamique, bavard et imbu de lui-même, criant à l’injustice parce qu’il aurait combattu pour une juste cause.
D’après Tzvetan Todorov :
« [Les victimes] n’ont pas à essayer de comprendre leurs bourreaux, disait Todorov, parce que la compréhension implique une identification avec eux, si partielle et provisoire qu’elle soit, et cela peut entraîner l’anéantissement de soi-même. Mais nous, les autres, nous ne pouvons pas faire l’économie de l’effort consistant à comprendre le mal, surtout le mal extrême, parce que, et c’était la conclusion de Todorov, “comprendre le mal ne signifie pas le justifier mais se doter des moyens pour empêcher son retour”. »
Militant anarcho-syndicaliste, Marco aurait combattu dans les rangs de la République, et Cercas analyse le « processus d’invention rétrospective de sa biographie glorieuse » chez ce dernier.
« Et je me suis dit, encore une fois, que tout grand mensonge se fabrique avec de petites vérités, en est pétri. Mais j’ai aussi pensé que, malgré la vérité documentée et imprévue qui venait de surgir, la plus grande partie de l’aventure guerrière de Marco était un mensonge, une invention de plus de son égocentrisme et de son insatiable désir de notoriété. »
Cercas ne ménage pas les redites, procédé (didactique ?) un peu lassant.
« Parce que le passé ne passe jamais, il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit ; le passé n’est qu’une dimension du présent. »
« Mais nous savons déjà qu’on n’arrive pas à dépasser le passé ou qu’il est très difficile de le faire, que le passé ne passe jamais, qu’il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit –, qu’il n’est qu’une dimension du présent. »
« La raison essentielle a été sa découverte du pouvoir du passé : il a découvert que le passé ne passe jamais ou que, du moins, son passé à lui et celui de son pays n’étaient pas passés, et il a découvert que celui qui a la maîtrise du passé a celle du présent et celle de l’avenir ; ainsi, en plus de changer de nouveau et radicalement tout ce qu’il avait changé pendant sa première grande réinvention (son métier, sa ville, sa femme, sa famille, jusqu’à son nom), il a également décidé de changer son passé. »
Cercas évoque De sang-froid de Truman Capote et L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, deux « chefs-d’œuvre » du « roman sans fiction » dont il juge le premier auteur atteint de « turpitude » pour avoir laissé espérer tout en souhaitant leur exécution les deux meurtriers condamnés à mort, et doute du procédé du second, présent à la première personne dans son récit peut-être pour se donner une légitimité morale fallacieuse.
Intéressantes questions du kitch du narcissique, et du mensonge (peut-il être légitime ? un roman est-il mensonge ?)
« Il y a deux mille quatre cents ans, Gorgias, cité par Plutarque, l’a dit de façon indépassable : “La poésie [c’est-à-dire, la fiction] est une tromperie où celui qui trompe est plus honnête que celui qui ne trompe pas et où celui qui se laisse tromper est plus sage que celui qui ne se laisse pas tromper.” »
En fait de déportation, Marco a été travailleur volontaire en Allemagne fin 1941, et emprisonné au bout de trois mois comme « volontaire communiste ». Revenu en Espagne, il a effectivement connu « les prisons franquistes, non comme prisonnier politique mais comme détenu de droit commun. » Il abandonne ses premiers femme et enfants, change de nom pour refaire sa vie (grand lecteur autodidacte, il suit des cours universitaires d’histoire) – et devenir le secrétaire général de la CNT, le syndicat anarchiste, puis président de l’Amicale de Mauthausen, l’association des anciens déportés espagnols. Il a toujours été un séducteur, un amuseur, un bouffon qui veut plus que tout qu’on l’aime et qu’on l’admire.
« …] de même, certaines qualités personnelles l’ont beaucoup aidé : ses dons exceptionnels d’orateur, son activisme frénétique, ses talents extraordinaires de comédien et son manque de convictions politiques sérieuses – en réalité, l’objectif principal de Marco était de faire la une et satisfaire ainsi sa médiapathie, son besoin d’être aimé et admiré et son désir d’être en toute occasion la vedette – de sorte qu’un jour il pouvait dire une chose et le lendemain son contraire, et surtout il pouvait dire aux uns et aux autres ce qu’ils voulaient entendre. »
« Le résultat du mélange d’une vérité et d’un mensonge est toujours un mensonge, sauf dans les romans où c’est une vérité. »
« Marco a fait un roman de sa vie. C’est pourquoi il nous paraît horrible : parce qu’il n’a pas accepté d’être ce qu’il était et qu’il a eu l’audace et l’insolence de s’inventer à coups de mensonges ; parce que les mensonges ne conviennent pas du tout à la vie, même s’ils conviennent très bien aux romans. Dans tous les romans, bien entendu, sauf dans un roman sans fiction ou dans un récit réel. Dans tous les livres, sauf dans celui-ci. »
Après la Transition de la dictature franquiste à la démocratie, la génération qui n’avait pas connu la guerre civile a plébiscité le concept de “mémoire historique”, qui devait reconnaître le statut des victimes.
« La démocratie espagnole s’est construite sur un grand mensonge, ou plutôt sur une longue série de petits mensonges individuels, parce que, et Marco le savait mieux que quiconque, dans la transition de la dictature à la démocratie, énormément de gens se sont construit un passé fictif, mentant sur le passé véritable ou le maquillant ou l’embellissant [… »
Cercas raconte ensuite comment l’historien Benito Bermejo a découvert l’imposture de Marco, alors devenu un héros national, et s’est résolu à la rendre publique (c’est loin d’être la seule du même genre). Marco tente depuis de se justifier par son réel travail de défense de la cause mémorielle. Cercas décrit ses rapports avec Marco partagé entre le désir d’être le personnage de son livre, et le dépit de ne pas pouvoir contrôler ce dernier.
« — S’il te plaît, laisse-moi quelque chose. »
Opiniâtre quant à la recherche de la vérité, outre ses pensées Cercas détaille son ressenti, qui va du dégoût initial à une certaine sympathie ; "donquichottesque", il pense même un temps à sauver Marco non pas en le réhabilitant, mais en le plaçant devant la vérité…
Manifestement basée sur une abondante documentation, cette étude approfondie, fouillée dans toutes ses ramifications tant historiques que psychologiques ou morales, évoque aussi le rôle de la fiction comme expression de la vérité.
\Mots-clés : #biographie #campsconcentration #devoirdememoire #ecriture #guerredespagne #historique #politique #psychologique #xxesiecle
- le Mar 17 Oct - 12:34
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Javier Cercas
- Réponses: 96
- Vues: 13041
Jonathan Coe
Le Cercle fermé
(En complément au commentaire approfondi de Pinky.)
1999 (livre paru en 2004), Claire revient d’Italie en Angleterre après cinq ans d’absence, et se confie par écrit à sa sœur Miriam, disparue (c’est la suite de Bienvenue au club, où les mêmes personnages vivaient dans les années soixante-dix). Le portable est devenu inévitable :
« …] quantité de gens qui ne travaillent plus, qui ne fabriquent rien, ne vendent rien. Comme si c’était démodé. Les gens se contentent de se voir et de parler. Et quand ils ne se voient pas pour parler directement, ils sont généralement occupés à parler au téléphone. Et de quoi ils parlent ? Ils prennent rendez-vous pour se voir. Mais je me pose la question : quand enfin ils se voient, de quoi ils parlent ? »
Nous savons depuis que lorsque les gens se voient, ils parlent à d’autres, sur leur portable.
Intéressante mise en parallèle des vies de couple de Benjamin et Doug, qui parviennent à se ménager une vie privée digne d’un célibataire – non sans une autre présence féminine, à laquelle ils ne savent guère faire face, incapables de prendre une décision.
« C’est là un défaut pathologique du sexe masculin. Nous n’avons aucune loyauté, aucun sens du foyer, aucun instinct qui nous pousserait à protéger le nid : tous ces réflexes naturels et sains qui sont inhérents aux femmes. On est des ratés. Un homme, c’est une femme ratée. C’est aussi simple que ça. »
Les profonds changements dans la communication sont particulièrement approfondis :
« Donc, d’après vous, si je comprends bien, disait Paul, le discours politique est devenu un genre de champ de bataille où politiciens et journalistes s’affrontent jour après jour sur le sens des mots.
— Oui, parce que les politiciens font tellement attention à ce qu’ils disent, les déclarations politiques sont devenues tellement neutres que c’est aux journalistes qu’il incombe de créer du sens à partir des mots qu’on leur donne. Ce qui compte aujourd’hui, ce n’est plus ce que vous dites, vous autres, c’est la manière dont c’est interprété. »
« C’est très moderne, l’ironie, assura-t-elle. Très in. Vous voyez, vous n’avez plus besoin d’expliciter ce que vous voulez dire. En fait, vous n’avez même pas besoin de penser ce que vous dites. C’est toute la beauté de la chose. »
« Il y a quelques mois, par exemple, ils ont pris des photos d’un top model particulièrement rachitique pour un article de mode du supplément dominical, mais elle avait l’air tellement squelettique et mal en point qu’ils ont renoncé à les utiliser. Et puis la semaine dernière ils ont fini par les déterrer pour illustrer un article sur l’anorexie psychosomatique. Visiblement, ça ne leur posait aucun problème. »
« Oh, de nos jours, tout dépend de la manière dont c’est présenté par les médias, pas vrai ? À croire que tout dépend de ça. »
Le Cercle fermé est créé au sein de la Commission travailliste réfléchissant au financement privé du secteur public (on est sous Tony Blair) ; l’extrême droite commence à monter.
Benjamin est un personnage central ; écrivain et musicien (assez raté), il reflète peut-être un aspect (ironique) du projet romanesque de Coe.
« Ce serait satisfaisant, d’une certaine façon ; il y aurait là un peu de la symétrie qu’il passait tant de temps à traquer en vain dans la vie, le sentiment d’un cercle qui se referme... »
« Je suis un homme, blanc, d’âge moyen, de classe moyenne, un pur produit des écoles privées et de Cambridge. Le monde n’en a pas marre des gens comme moi ? Est-ce que je n’appartiens pas à un groupe qui a fait son temps ? Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux fermer notre gueule et laisser la place aux autres ? Est-ce que je me fais des illusions en croyant que ce que j’écris est important ? Est-ce que je me contente de remuer les cendres de ma petite vie et d’en gonfler artificiellement la portée en plaquant dessus des bouts de politique ? »
Puis c’est le 11 septembre 2001, et l’approche de la « guerre à l’Irak ».
« La guerre n’avait pas encore commencé, mais tout le monde en parlait comme si elle était inévitable, et on était forcément pour ou contre. À vrai dire, presque tout le monde était contre, semblait-il, à part les Américains, Tony Blair, la plupart de ses ministres, la plupart de ses députés et les conservateurs. Sinon, tout le monde trouvait que c’était une très mauvaise idée, et on ne comprenait pas pourquoi on en parlait soudain comme si c’était inévitable. »
Le compte à rebours des chapitres souligne le suspense des drames personnels de la petite communauté quadragénaire immergée dans cette fresque historique.
\Mots-clés : #actualité #famille #historique #medias #politique #psychologique #relationdecouple #romanchoral #social #xxesiecle
- le Lun 21 Aoû - 13:08
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Jonathan Coe
- Réponses: 57
- Vues: 3511
Benjamin Constant
Adolphe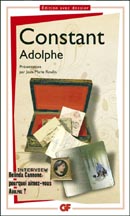
Adolphe, le narrateur, décide d’être aimé, et jette son dévolu sur Ellénore, maîtresse du comte de P***, dont elle a deux enfants.
Parvenu à ses fins, le jeune homme, ainsi comblé par son amante qui l’aime passionnément, ne tarde pourtant pas à ressentir le joug de cet empire assidu. D’ailleurs, dès avant il avait la conviction qu’une telle liaison ne pouvait durer.
« Ellénore était sans doute un vif plaisir dans mon existence, mais elle n'était plus un but : elle était devenue un lien. »
Mais les aléas relancent toujours la passion d’Adolphe, faible qui se rebiffe contre toute contrainte, extérieure comme venue de lui-même.
Sous la pression sociale et celle du père d’Adolphe, s’enchaînent les scènes du couple, et les intermittences du désamour du héros.
Au terme de trois ans, la mort d’Ellénore mettra fin aux atermoiements d’Adolphe.
Les deux principaux personnages du roman demeurent indéchiffrables, inattendus, complexes, ambivalents.
La langue est admirable, alliant concision et précision dans cette fine observation baignée de romantisme.
« Presque toujours, pour vivre en repos avec nous-mêmes, nous travestissons en calculs et en systèmes nos impuissances ou nos faiblesses : cela satisfait cette portion de nous, qui est, pour ainsi dire, spectatrice de l'autre. »
Des échanges avec un éditeur fictif encadrent le récit.
« La grande question dans la vie, c'est la douleur que l'on cause, et la métaphysique la plus ingénieuse ne justifie pas l'homme qui a déchiré le cœur qui l'aimait. […]
Je hais cette faiblesse qui s'en prend toujours aux autres de sa propre impuissance, et qui ne voit pas que le mal n'est point dans ses alentours, mais qu'il est en elle. »
On est sous le Directoire, au temps de Madame de Staël et de Chateaubriand, mais les sujétions sociales et familiales, les ressorts psychologiques sont aisément transposables à d’autres époques.
« Les circonstances sont bien peu de chose, le caractère est tout ; c'est en vain qu'on brise avec les objets et les êtres extérieurs, on ne saurait briser avec soi-même. On change de situation, mais on transporte dans chacune le tourment dont on espérait se délivrer ; et comme on ne se corrige pas, en se déplaçant, l'on se trouve seulement avoir ajouté des remords aux regrets et des fautes aux souffrances. »
\Mots-clés : #amour #psychologique
- le Mar 15 Aoû - 16:47
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Benjamin Constant
- Réponses: 5
- Vues: 165
Paul Morand
L'homme pressé
Pierre Nioxe est l’homme pressé, un antiquaire qui court sans cesse, incapable d’attendre, obsédé par le temps qui passe.
« Une malédiction veut que je sois lancé au galop dans un univers qui trottine. »
« La balle qui fuse hors du canon ne se demande pas si elle va trouer un carton ou fracasser un crâne ; Pierre non plus. À lire ceci, on pourrait le croire audacieux. « Voilà, dira-t-on, un homme assuré qui ne doit pas rater son coup. » Au contraire, Pierre est timide car sa hâte lui a valu beaucoup d’échecs alternant avec de foudroyants succès. Et ce sera la moralité de cette histoire que de montrer l’impatient plus souvent puni que récompensé. »
« Les secondes que tu gagnes, qu’en fais-tu ?
— J’en fais des minutes, grogna Pierre… »
« Je me croyais un homme comme les autres, doué seulement d’un peu plus de vivacité. Cette vivacité dont je suis fier est-elle la vitesse ? Ou bien une traînasserie déguisée, un moyen de temporiser, d’éluder les vraies réponses, de suspendre, grâce à des sautillements, le grand saut que chaque homme doit faire dans l’inconnu ? »
Nioxe constitue un peu le type de l’homme pressé dans la galerie de caractères où Oblomov serait son antithèse.
Avec son ami Placide, un chartiste, il file acheter in extremis le Mas Vieux de M. de Boisrosé, un créole. La femme de ce dernier, l’indolente Bonne toujours alitée, et ses filles, la blonde Angélique (vingt-quatre ans, mariée), la rousse Hedwige (vingt ans) et la brune Fromentine (dix-huit ans), vivent en cocon familial dans la région parisienne, et voudraient lui faire reconsidérer cet achat qui les dépossèdent. Surtout séduit par Hedwige, il entretient avec les trois belles des rapports distendus.
« Pierre chiffonnait avec grâce les objets de ses soins, les agaçait juste ce qu’il faut avec son agitation ; il avait l’embrassade franche, la bouche fraîche, la peau chaude. Il enchaînait bien, se précipitait sur elles, les dévorait sans les assimiler, disparaissait avant qu’elles aient eu le temps de dire ouf, en admettant qu’une femme pousse jamais ce cri-là. Il télescopait les situations, revenait classiquement à l’unité de temps, de lieu et d’action. Il confondait volontiers la déclaration avec l’enlèvement en taxi, le taxi avec la loge grillée, l’escalier avec le canapé, la main serrée avec la taille prise, le mouchoir avec le soutien-gorge, le premier rendez-vous avec le dernier, et les ménagements du début avec les délires de la fin. Tout cela avec si peu d’espace entre le point de départ et celui d’arrivée qu’elles croyaient recevoir un premier tribut de reconnaissance que déjà il leur offrait un cadeau d’adieu. »
Il épouse finalement Hedwige, travaillant à maîtriser sa hâte. Ils sont amoureux, et lui commence à apprécier le présent. Mais, Hedwige enceinte, l’avenir reprend place pour lui, tandis qu’elle retourne peu à peu au gynécée de « Mamicha ». Pierre s’impatiente, et sa précipitation, l’urgence permanente pour toujours aboutir au plus tôt, son impuissance à ralentir ou s’arrêter ne sont pas sans l’égocentrisme d’un maniaque tyrannique, ni provoquer le désordre.
« Attendre écrasait Pierre. Pour lui la lenteur se traduisait toujours en kilogrammes, en tonnes. Quand il lui fallait ralentir le pas dans la rue pour se laisser rattraper par le compagnon qu’il avait distancé de cent mètres sans s’en apercevoir et tout en continuant à lui parler, il se sentait soudain métamorphosé en un âne pliant sous le bât. Or, l’amour est d’un grand poids dans la vie des hommes ; c’est une surcharge. Rien d’écrasant comme les impondérables. Le cœur est un organe de plomb. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils s’étudient moins qu’ils ne se soupèsent ; ils savent qu’un jour l’un des deux portera l’autre sur ses épaules. Car un couple, ce n’est pas un appareillage latéral, c’est un assemblage vertical. »
Il propose à Hedwige d’écourter sa grossesse de deux mois… et elle décide de la poursuivre chez sa mère.
« – C’est toi qui n’as pas compris, malheureux, combien c’est inhumain ce que tu proposes là ! Attendre cet enfant, mais c’est tout mon plaisir, toute ma vie !
Et je ne l’attends même pas ; il existe, ce petit être, aussi vivant que s’il était déjà parmi nous. »
Pierre s’est spécialisé dans la « haute époque », à l’époque où justement régnait la course au bel objet rare, plus ou moins honnêtement acquis ici ou là sur la planète. Il a découvert un cloître roman sur son nouveau domaine, et pour éviter l’afflux touristique, l’a fait démonter et l’a vendu aux États-Unis, où il se rend et apprécie d’abord la frénésie, qui rapidement le lasse.
« Je suis infatigable ; à peine installé dans cette rame, je m’envole déjà par la pensée dans l’auto qui m’attend. Que j’aime ce bruit du vent qui me siffle aux oreilles ! Ce que je fais m’échauffe et me presse ; je laisse tomber ce qui me retarde ; je suis satisfait d’être ainsi dans l’instant suivant. Je n’existe pas, je préexiste ; je suis un homme antidaté ; non, je ne suis pas un homme, je suis un moment ! »
« D’ailleurs, la ville [New York] et lui reposent sur rien, sont sans racines ; vacillants et faibles comme l’instant. »
« C’est vraiment curieux, pensait Pierre : j’ai pris successivement un omnibus, un express, une auto rapide et un avion dernier cri, c’est-à-dire que j’ai chaque fois augmenté l’allure et plus je file, plus les choses paraissent s’immobiliser. Nous faisons du cinq cents à l’heure, et il me semble que ça n’avance plus. Je suis ici suspendu en un arrêt total, détaché du monde ; tout devient sempiternel ; plus c’est grand, moins ça bouge ; le port glisse à peine sous mes yeux parce qu’il est énorme ; la mer se fige, à mesure qu’elle devient océan.
Sans doute ne voyais-je l’univers sous son aspect tumultueux que parce que j’avais le nez dessus. On ne va vite qu’à ras du sol. Dès que je prends du recul pour regarder ma vieille planète, elle me paraît morte. La vitesse, c’est un mot inventé par le ver de terre. »
Regencrantz, un cosmopolite médecin juif qui l’appelle le « Vélociférique », d’après Goethe, lui raconta l’histoire du commodore Swift, un coureur automobile américain qu’il a rencontré, attendant depuis quatre mois les conditions nécessaires à sa course, et l’image de l’homme pressé prend une dimension sociétale ambigüe ; le docteur lui apprend que son cœur est prêt à lâcher : le temps le quitte, et enfin il se ménage pour voir son enfant à naître – et même ce dernier regard sera vain.
Brillant, écrit tambour battant et avec un grand sens de la formule d’un style riche, j’ai trouvé cette analyse approfondie de la précipitation et de la fuite en avant un peu datée par un ton de vaudeville.
J’ai aussi vu le film tiré de ce roman par Molinaro (avec Darc et Delon), qui n’en retient que certains éléments.
\Mots-clés : #philosophique #psychologique #xxesiecle
- le Lun 29 Mai - 12:40
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Paul Morand
- Réponses: 23
- Vues: 1583
Christian Salmon
Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits
Dès l’introduction, le livre est rattrapé par l’actualité, voire dépassé par le phénomène dont il constate la naissance dans les années 90 :
« La clé du leadership américain et le secret du succès présidentiel résident, dans une grande mesure, dans le storytelling », écrivait en 2004 Evan Cornog, professeur de journalisme à l'université de Columbia, dans The Power and the Story, un essai qui réexamine l'histoire des présidences américaines de George Washington à George W. Bush à travers le prisme du storytelling : « Depuis les origines de la république américaine jusqu'à nos jours, écrit-il, ceux qui ont cherché à conquérir la plus haute charge ont dû raconter à ceux qui avaient le pouvoir de les élire des histoires convaincantes, sur la nation, ses problèmes et, avant tout, sur eux-mêmes. Une fois élu, la capacité du nouveau président à raconter la bonne histoire et à en changer chaque fois que c'est nécessaire est une qualité déterminante pour le succès de son administration. Et quand il a quitté le pouvoir, après une défaite ou à la fin de son mandat, il occupe souvent les années suivantes à s'assurer que sa version de sa présidence est bien celle qui sera retenue par l'Histoire. Sans une bonne histoire, il n'y a ni pouvoir ni gloire. »
Notre perception de l'histoire des États-Unis n'a-t-elle d'ailleurs pas le plus grand mal à démêler le vrai du faux, le réel de la fiction ? Qu'on se souvienne du président Ronald Reagan, qui évoquait parfois un épisode d'un vieux film de guerre comme s'il appartenait à l'histoire réelle des États-Unis… N'est-elle pas encombrée de fictions et de légendes, comme en atteste la réplique souvent citée du film de John Ford, Qui a tué Liberty Valance ? : « Lorsque la légende devient un fait établi, on imprime la légende. »
Dans Des logos à la story, Salmon nous montre comme le « marketing viral » des entreprises prospères les fait passer de la production des marchandises à celle des marques, puis des histoires.
« La publicité telle que nous la connaissons est morte, déclarait enfin en 2002 Sergio Zyman, ex-directeur marketing de Coca-Cola, dans son livre Les Derniers Jours de la publicité : Cela ne marche plus. C'est un colossal gaspillage d'argent, et, si vous n'y prenez garde, cela finira par détruire votre société… et votre marque. »
« Le paradoxe du marketing moderne est en effet qu'il doit fidéliser des comportements d'achat devenus changeants, labiles, imprévisibles. Ramener le consommateur volage au bercail de la marque et l'inciter à s'engager dans une relation durable et émotionnelle. »
« La consommation comme seul rapport au monde. On attribue aux marques les pouvoirs qu'on cherchait jadis dans les mythes ou la drogue : passer la limite, faire l'expérience d'un soi sans pesanteur, voler, planer ; c'était hier Icare ou le LSD, c'est aujourd'hui Nike ou Adidas. […] Les marques sont les vecteurs d'un « univers » : elles ouvrent la voie à un récit fictif, un monde scénarisé et développé par les agences de « marketing expérientiel », dont l'ambition n'est plus de répondre à des besoins ni même de les créer, mais de faire converger des « visions du monde ». »
Dans L’invention du storytelling management, c’est l’histoire des gourous qui ont révolutionné l’entreprise. L’idée est de motiver par l’émotion, et la rhétorique.
« Les gourous sont des pourvoyeurs de modes managériales. La popularité de leurs idées va et vient selon des cycles d'invention (quand l'idée est créée), de dissémination (quand l'idée est portée à l'attention d'un public ciblé), d'adhésion (quand l'idée est acceptée), de désenchantement (quand les évaluations négatives et les frustrations liées à cette idée commencent à émerger), puis de déclin ou d'abandon de l'idée… »
« De nombreux auteurs décrivent les gourous du management comme des experts en persuasion, qui cherchent à formater leur public par le biais de discours efficaces, à tel point que certains ont comparé leur puissance oratoire à celle des prédicateurs évangéliques. »
« « Les gens ne veulent plus d'informations, écrit Annette Simmons, auteure d'un des best-sellers du storytelling. Ils veulent croire – en vous, en vos buts, en votre succès, dans l'histoire que vous racontez. C'est la foi qui fait bouger les montagnes et non les faits. Les faits ne donnent pas naissance à la foi. La foi a besoin d'une histoire pour la soutenir – une histoire signifiante qui soit crédible et qui donne foi en vous. » D'où l'importance des pratiques d'autolégitimation et d'autovalidation, puisque la source unique de la performance d'un gourou, c'est sa personne même : c'est lui la source des récits utiles et de leurs effets mystérieux, c'est en lui que se concentrent les compétences narratives. Il est l'agent et le médiateur, le passeur et le message. Il doit vous convaincre que tout est en ordre, conforme au bon sens, au droit naturel. Il ne vous enseigne pas un savoir technique, il transmet une sagesse proverbiale, qui cultive le bon sens populaire, fait appel aux lois de la nature et convoque un ordre mythique. »
Dans La nouvelle « économie fiction » sont évoqués les (nombreux) employés des call centers du « nouveau rêve indien », à Bombay, qui se font passer pour des États-Uniens et sont déshumanisés et acculturés dans le formatage identitaire de la globalisation au travers de cette délocalisation virtuelle.
« Depuis le début des années 1980, la figure du cadre a ainsi cédé la place à celle du manager, puis au leader et au coach, et finalement au storyteller, dont les récits parlent au cœur des hommes et non seulement à leur raison, en leur proposant des visions de l'entreprise et des fictions qui les aident à fonctionner [… »
Le néomanagement impose une fiction de processus de groupe ou équipe dans l’entreprise (ce qui m’a ramentu mes doutes lors d’un MOOC sur le digital).
« L'autorité d'un récit – celui du « changement » – a pris sa place [à l’autorité]. Un récit écrit par le marché sous ses nombreux pseudonymes, aussi nombreux que les hétéronymes de Pessoa : la mondialisation, la globalisation, le progrès technique, la concurrence… »
Renvois à la créativité, à l’authenticité…
« Les techniques du management s'apparentent de plus en plus à celles de la mise en scène, les partenaires doivent s'ajuster le mieux possible à leurs rôles, de façon à rendre le récit crédible aux yeux d'un public de consommateurs et d'investisseurs. »
Dans Joueurs de Don DeLillo, une entreprise préfigure les sociétés de services à la personne.
« L'ironie de DeLillo, qui prenait pour cible la tendance des sociétés capitalistes à transformer toute émotion en marchandise, y compris les sentiments les plus intimes, comme le deuil, le remords ou la dépression, pouvait paraître excessive en 1977. »
« La nouvelle idéologie du capitalisme privilégie le changement à la continuité, la mobilité à la stabilité, la tension à l'équilibre et propose un nouveau paradigme organisationnel : l'entreprise sans frontières, décentralisée et nomade, libérée des lois et des emplois, légère, agile, furtive, qui ne se reconnaît d'autre loi que le récit qu'elle se donne, d'autre réalité que les fictions qu'elle répand dans le monde. »
« « Légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité et consistance » : cela pourrait constituer un bon résumé des valeurs du nouveau management. Il n'en est rien. Ce sont les titres de six conférences que devait prononcer l'écrivain italien Italo Calvino en 1985-1986 aux États-Unis. Il avait choisi six valeurs essentielles à ses yeux, qui devaient constituer l'épistémè du XXIe siècle. Il rédigea les cinq premières, qui furent publiées à titre posthume sous le titre Leçons américaines. »
Les entreprises mutantes du nouvel âge du capitalisme : ou « créer un mythe collectif contraignant » et enfumer tout le monde, en interne comme à l’extérieur de l’entreprise.
« Les applications du storytelling en entreprise accompagnent le mouvement par lequel chacun est mis en demeure de raconter sa vie et son travail, de transmettre son savoir-faire, de mobiliser ses énergies et d'accepter un changement. »
« Le récit y [dans les storytelling organisations] est en effet considéré tout à la fois comme un facteur d'innovation et de changement, un vecteur d'apprentissage et un outil de communication. Il constitue une réponse à la crise du sens dans les organisations et une méthode pour construire une identité d'entreprise. Il structure et formate la communication, à l'intention des consommateurs comme des actionnaires. »
Cas d’école de dérégulation :
« Enron était devenu un véritable mirage financier, producteur d'illusions non seulement pour ses salariés intéressés à la croyance, mais aussi pour les plus grandes banques du monde, les analystes financiers, les experts comptables et les actionnaires de Wall Street. »
« Plus le monde de la finance s'éloignait des estimations rationnelles et des performances économiques, plus la cosmétique d'entreprise consistant à rendre une entreprise belle et désirable pour les investisseurs a pris de l'importance dans la gestion des nouvelles organisations. […] Dans un monde rationnel, ce fiasco exemplaire aurait signé la mort du storytelling et de ses vertus hypnotiques. Et pourtant, près de dix ans plus tard, il reste plus que jamais la bible des « gourous du management ». »
La « mise en histoires » de la politique :
L’exploitation émotionnelle de l’histoire « évangélique » d’une fille d'une victime du 11 septembre réconfortée par le président dans la campagne de George W. Bush en 2004 : le rôle du « conseiller en communication », ou spin doctor (depuis Reagan), le récit du héros contre des méchants (simple et reprenant la forme narrative des mythes anciens).
« Si l'exercice du pouvoir présidentiel tend à s'identifier à une sorte de campagne électorale ininterrompue, les critères d'une bonne communication politique obéissent de plus en plus à une rhétorique performative (les discours fabriquent des faits ou des situations) qui n'a plus pour objectif de transmettre des informations ni d'éclairer des décisions, mais d'agir sur les émotions et les états d'âme des électeurs, considérés de plus en plus comme le public d'un spectacle. Et pour cela de proposer non plus un argumentaire et des programmes, mais des personnages et des récits, la mise en scène de la démocratie plutôt que son exercice.
La capacité à structurer une vision politique non pas avec des arguments rationnels, mais en racontant des histoires, est devenue la clé de la conquête du pouvoir et de son exercice dans des sociétés hypermédiatisées, parcourues par des flux continuels de rumeurs, de fausses nouvelles, de manipulations. »
Storytelling de guerre
Les centres de simulation du Pentagone deviennent, avec l’aide d’Hollywood, des théâtres de réalité virtuelle privilégiant des situations expérientielles plutôt que cognitives. Le recrutement militaire se fait via la vidéo, comme le traitement psychologique des états de stress posttraumatique.
« L'invention d'un modèle de société dans lequel les agents fédéraux, réels ou fictifs, doivent disposer d'une autonomie d'action suffisante pour protéger efficacement la population n'est rien d'autre que l'instauration d'un état d'exception permanent qui, ne trouvant plus sa légitimité dans le droit et la Constitution, la cherche et la trouve dans la fiction. »
« …] la puissance de l'entreprise américaine de mise en fiction du réel permet le triomphe des préjugés sur la morale la plus élémentaire, la négation du réel par la toute-puissance des représentations qui prétendent le transformer. »
L'empire de la propagande
Le gouvernement George W. Bush, juste avant la guerre en Irak :
« Nous sommes un empire maintenant, poursuivit-il, et, lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. »
« …] les dirigeants de la première puissance mondiale se détournent non seulement de la realpolitik, mais du simple réalisme, pour devenir créateurs de leur propre réalité, maîtres des apparences, revendiquant ce qu'on pourrait appeler une realpolitik de la fiction. »
Ron Susking, journaliste d’investigation (2004) :
« Il ne nous restera plus ainsi qu'une culture et un débat public fondés sur l'affirmation plutôt que sur la vérité, sur les opinions et non sur les faits. Parce que, lorsque vous en êtes là, vous êtes contraint de vous fier à la perception du pouvoir. »
Renouvellement de la propagande en infotainment type Fox News, aux contenus dictés par le gouvernement républicain, les fake news, dès 2004, manipulation de l'information marquée d’un obscurantisme émanant de la droite fondamentaliste chrétienne et opposé aux réalistes. C’est la droite chrétienne conservatrice contre la connaissance objective, la foi contre la raison.
Conclusion – Le nouvel ordre narratif : en France aussi, depuis le rôle de Henri Guaino dans la campagne de 2007.
« Don Quichotte lui aussi voulait changer le monde en racontant une histoire… Comme l'écrivait Michel Foucault : « À lui de refaire l'épopée, mais en sens inverse : celle-ci racontait […] des exploits réels, promis à la mémoire ; Don Quichotte, lui, doit combler de réalité les signes sans contenus du récit. » »
« Les « campagnes marketing » de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal signent donc une profonde évolution — et peut-être une vraie rupture — dans la culture politique française. Formatés par leurs conseillers experts en storytelling, réduits à leurs talents respectifs pour appliquer les consignes de « mise en scène » - et Sarkozy l'a nettement emporté sur ce terrain -, les deux candidats ont de concert contribué à délégitimer la politique : s'adressant aux individus comme à une « audience », évitant l'adversaire, contournant les partis, ils ont substitué au débat public la captation des émotions et des désirs. Ce faisant, ils ont inauguré une ère nouvelle de la démocratie, que l'on pourrait qualifier de « postpolitique ». »
Postface à l'édition de 2008 : en prolongement de l’analyse précédente du storytelling sarkozien, Salmon évoque la réaction au contrôle gouvernemental de l'agenda médiatique du décryptage par la presse. Puis pointe le « nouvel ordre narratif » :
« Ce qui est en jeu aujourd'hui, à tous ces niveaux à la fois, c'est l'apparition d'une même raison régulatrice qui consiste à réduire et à contrôler, par le storytelling et les machines de fiction, les conduites individuelles. »
Cet essai est proprement époustouflant lorsqu’on le lit en ayant connu l’ère Trump ; même autrement, il explique nombre de curieuses constatations qu’on a pu faire en observant notre société.
\Mots-clés : #actualité #contemporain #essai #guerre #historique #medias #politique #psychologique #social #xxesiecle
- le Sam 15 Avr - 17:09
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Christian Salmon
- Réponses: 3
- Vues: 402
Charles D'Ambrosio
Le Musée des Poissons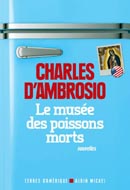
Partage des eaux
Ignace, le narrateur, a été placé en orphelinat parce que son père est insensé depuis un accident. Il rencontre Donny, et part en randonnée avec celui-ci et son père, qui lui apprend qu’il divorce.
« C’est le désespoir qui est le contraire de l’amour. »
Drummond & Fils
Drummond est réparateur de machines à écrire à Seattle, et son fils Pete, 25 ans et déséquilibré, vit avec lui.
« Je crois que je me contenterais bien d’être un fils, dit-il. Pas un dieu. »
« Prier m’aidait à m’endormir ou à penser aux filles. »
Scénariste
Le narrateur est interné en psychiatrie, et on lui a adjoint un surveillant pour éviter qu’il se suicide ; c’est aussi un scénariste, en quête d’inspiration pour un scénario. Il rencontre une ballerine qui se brûle le corps.
« Elle me tourna le dos et activa la mollette du briquet, abritant la cigarette du vent avec sa main. Une assiette en papier roula plusieurs fois autour de la terrasse comme dans une course-poursuite, comme dans un jeu d’enfant sans enfant. Une phalène blanche tomba du ciel à la manière d’un pétale, passa par une maille du grillage et atterrit sur ma main. La fraîcheur du soir me donna la chair de poule et un nuage de fumée déchira l’air. La tenue de la jeune femme se consumait. Un liséré de flammes orange grignotait l’ourlet. Je me levai d’un bond pour dire à la ballerine qu’elle brûlait. La phalène s’envola de ma main, une rafale de vent attisa les flammes, il y eut un éclair et la jeune femme prit feu, s’embrasant comme une lanterne japonaise. Elle était enveloppée par les flammes. La chaleur affluait par vagues sur mon visage et je clignais des yeux à cause de la luminosité. La ballerine déploya ses bras et entra en lévitation, sur les pointes, quittant la terrasse tandis que ses jambes, son cul et son dos émergeaient tel le phénix de cette chrysalide en papier, s’élevant jusqu’à ce que la tenue finisse par glisser de ses épaules et flotter au loin, fantôme noirâtre en lambeaux aspiré par une colonne de fumée et de cendres, alors la jeune femme redescendit, nue et blanche, presque imperturbable, les pieds en position de première. »
« Après un mois en psychiatrie, on ne reçoit plus ni télégrammes ni cartes de prompt rétablissement ni peluches, les fleurs perdent leurs pétales, qui se recroquevillent comme des peaux mortes sur la commode, pendant que les tiges se ramollissent et pourrissent dans leur vase. C’est une mauvaise passe, cette mer des Sargasses dans le service psychiatrie, quand les derniers vents de votre ancienne vie ne soufflent plus. Dans le monde réel, je restais légalement marié – ma femme était productrice de films, mais elle m’avait laissé pour quelqu’un de plus sexy, l’acteur vedette de notre dernier film. J’en avais écrit le scénario, plus ou moins autobiographique, et le personnage qu’il jouait était inspiré par feu mon père. Ma femme s’envoyait donc la doublure de papa et on ne s’était pas parlé depuis une éternité. »
Là-haut vers le nord
Le narrateur est invité pour Thanksgiving à un séjour de chasse dans le chalet familial de sa femme, Caroline, qui y fut violée. Sa famille ne le sait pas ; elle n’a jamais connu d’orgasme et enchaîne les infidélités.
L’ordre des choses
Lance et Kirsten se sont connus lors de leur incarcération en Floride, lui pour les amphétamines, elle pour l’héroïne ; ils vivent d’un trafic de quête pour les bébés de drogués et de larcins dans l’Iowa rural.
« Il croyait à l’existence d’une vie riche et méritée parallèle à la leur, vie qu’elle seule pouvait voir, et il sondait ses rêves à la recherche d’indications, tentait de trouver un sens à ses prémonitions, comme si ses cauchemars et ses sautes d’humeur donnaient accès à un monde fait de certitudes, alors que Kirsten, elle, connaissait la vérité : chaque rêve n’est qu’un réservoir de doutes. À force de graviter autour de divers foyers et institutions, elle avait au moins appris cela. Famille d’accueil, centre de désintoxication, de détention – même la femme qu’elle appelait « maman » appartenait à l’institution, à un programme d’aide sociale maladroit. »
Le musée des poissons morts
Ravage dirige l’équipe de charpentiers qui travaille pour Greenfield, un réalisateur de films pornos : Rigo, un réfugié salvadorien, et RB, un Noir. Dans sa sacoche, « le pistolet avec lequel il avait depuis un an l’intention de se suicider. »
« Pour ma femme, impossible de dire “réfrigérateur”. Elle apprend. Alors elle dit “le musée des poissons morts”. »
Bénédiction
Le narrateur et sa femme Meagan vivent depuis peu dans leur première maison, non loin de la Skagit River, dont une crue approche.
« Peut-être parce que mon père était mort dans ma petite enfance et que, fils unique, j’avais été accueilli au sein d’un clan informel d’oncles, de tantes et de cousins, ma conception de la famille, ainsi que de l’amour et de la loyauté, avait toujours été placée sous le signe de la sérénité et de la tolérance plutôt que sous celui de la division et de l’agressivité. Le poids de mes attentes et par conséquent le fardeau de mes déceptions se répartissaient entre un grand nombre de personnes [… »
Ils reçoivent le père et le frère de Meagan ainsi que la femme et le bébé de celui-ci ; cette famille n’est que tensions.
Le jeu des cendres
Kype est parti avec les cendres, le pistolet et la canne à pêche de son grand-père décédé à 99 ans, un pionnier qui l’a élevé ; il va hériter de sa fortune. Kype a pris en stop D’Angelo, qui fait la route depuis Brooklyn, puis Nell, une Makah de la réserve près de l’océan ; c’est le temps de la migration des saumons.
C’est sombre et dense, peu explicable, entièrement dans une atmosphère rendue par un style contenu. Quelque chose d’indicible est suggéré par ces aperçus de rapports humains, quelque chose que les sciences ne peuvent apparemment pas exprimer – en tout cas pas moi ; c’est sans doute à ça que sert la littérature, évoquer un sens subliminaire qu'il n'est pas possible d'aborder autrement.
\Mots-clés : #contemporain #famille #nouvelle #pathologie #psychologique #xxesiecle
- le Mar 11 Avr - 12:58
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Charles D'Ambrosio
- Réponses: 3
- Vues: 310
Roland Barthes
Fragments d'un discours amoureux
« On a donc substitué à la description du discours amoureux sa simulation, et l’on a rendu à ce discours sa personne fondamentale, qui est le je, de façon à mettre en scène une énonciation, non une analyse. »
Réflexions sur le (ou les) sentiment(s) amoureux informellement regroupées par entrées alphabétiques, avec des renvois en marge, notamment à la littérature (Werther, Le Banquet, etc.) et à des « conversations d’amis » (J.-L.B. ne serait-il pas Jean-Louis Barrault ? Ph. S., Philippe Sollers ?), mais aussi dans le corps du texte aux étymologies grecque et latine ; j’ai souvent pensé aux écrits de Quignard. Étrangement asexué, c'est l’amour en tant qu’aspiration, désir…
« Les mots ne sont jamais fous (tout au plus pervers), c’est la syntaxe qui est folle : n’est-ce pas au niveau de la phrase que le sujet cherche sa place – et ne la trouve pas – ou trouve une place fausse qui lui est imposée par la langue ? »
« Le dis-cursus amoureux n’est pas dialectique ; il tourne comme un calendrier perpétuel, une encyclopédie de la culture affective (dans l’amoureux, quelque chose de Bouvard et Pécuchet). »
« Tantôt le monde est irréel (je le parle différemment), tantôt il est déréel (je le parle avec peine). »
« Diderot : "Le mot n’est pas la chose, mais un éclair à la lueur duquel on l’aperçoit." »
(Faire une) scène :
« Lorsque deux sujets se disputent selon un échange réglé de répliques et en vue d’avoir le « dernier mot », ces deux sujets sont déjà mariés : la scène est pour eux l’exercice d’un droit, la pratique d’un langage dont ils sont copropriétaires ; chacun son tour, dit la scène, ce qui veut dire : jamais toi sans moi, et réciproquement. Tel est le sens de ce qu’on appelle euphémiquement le dialogue : ne pas s’écouter l’un l’autre, mais s’asservir en commun à un principe égalitaire de répartition des biens de parole. Les partenaires savent que l’affrontement auquel ils se livrent et qui ne les séparera pas est aussi inconséquent qu’une jouissance perverse (la scène serait une manière de se donner du plaisir sans le risque de faire des enfants).
Avec la première scène, le langage commence sa longue carrière de chose agitée et inutile. »
Sur le souvenir :
« "Nous avons eu un magnifique été et je suis souvent dans le verger de Lotte, perché sur les arbres, la longue perche du cueille-fruits à la main, pour dépouiller de leurs poires les branches du faîte. Elle, en bas, les reçoit à mesure que je les lui envoie." Werther raconte, parle au présent, mais son tableau a déjà vocation de souvenir ; à voix basse, l’imparfait murmure derrière ce présent. Un jour, je me souviendrai de la scène, je m’y perdrai au passé. Le tableau amoureux, à l’égal du premier ravissement, n’est fait que d’après-coups : c’est l’anamnèse, qui ne retrouve que des traits insignifiants, nullement dramatiques, comme si je me souvenais du temps lui-même et seulement du temps : c’est un parfum sans support, un grain de mémoire, une simple fragrance ; quelque chose comme une dépense pure, telle que seul le haïku japonais a su la dire, sans la récupérer dans aucun destin. »
À propos de la tendresse :
« Ce n’est pas seulement besoin de tendresse, c’est aussi besoin d’être tendre pour l’autre : nous nous enfermons dans une bonté mutuelle, nous nous maternons réciproquement ; nous revenons à la racine de toute relation, là où besoin et désir se joignent. »
Lu en discontinu ; me paraît d’ailleurs difficile à lire d’une traite.
\Mots-clés : #amour #essai #psychologique
- le Dim 2 Avr - 12:47
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Roland Barthes
- Réponses: 3
- Vues: 813
Javier Marías
Comme les amours
La narratrice apprécie ses petits déjeuners dans une cafétéria à cause de la présence d’un couple heureux et jovial qui la met de bonne humeur pour sa journée de travail à Madrid, dans une maison d’édition. Il s’agit de Miguel Desvern ou Deverne et Luisa Alday ; lui est poignardé à mort le jour de ses cinquante ans, par erreur, pratiquement par hasard, pour tout dire stupidement, par un indigent.
Habituel décri cocasse des auteurs, si prétentieux, exigeants, exaspérants :
« Il voulait passer pour anticonventionnel et transcontemporain, mais dans le fond il était comme Zola et quelques autres : il faisait l'impossible pour vivre ce qu'il imaginait, voilà pourquoi tout paraissait artificiel et travaillé dans ses livres. »
Le drame est inattendu, presque improbable.
« Toutes ces informations étaient réparties sur deux jours, les deux qui suivaient l'assassinat. Ensuite la nouvelle avait complètement disparu des journaux, comme c'est le cas pour toutes actuellement : les gens ne veulent pas savoir pourquoi les choses se passent, seulement ce qui se passe, et que le monde est plein d'imprudences, de dangers, de menaces et d'infortunes qui nous frôlent, mais en revanche atteignent et tuent nos semblables négligents, ou peut-être non choisis par le sort. Nous vivons ensemble sans problème avec mille mystères irrésolus qui nous occupent dix minutes le matin et que nous oublions ensuite sans qu'ils nous laissent d'irritation ni de trace. Nous avons besoin de ne rien approfondir, de ne pas nous attarder sur un fait ou sur une histoire quelle qu'elle soit, que notre attention passe d'une chose à l'autre et que les malheurs des autres se renouvellent, comme si après chacun d'eux nous pensions : "Eh bien, quelle horreur. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre. À quelles autres horreurs avons-nous échappé. Chaque jour, par contraste, nous avons besoin de nous sentir survivants et immortels, alors racontez-nous d'autres atrocités, parce que celles d'hier nous les avons déjà épuisées." »
María Dolz, la narratrice, rencontre Luisa, puis Javier Díaz-Varela, ami du défunt qui lui a demandé de s’occuper de sa femme s’il décédait, et ce sont de longues considérations sur la mort et le deuil. Javier couche avec María, temporairement, en succédané de Luisa, tandis qu’elle garde son autre amant, Leopoldo, au cas où.
« Oui, nous sommes tous des succédanés de gens que nous n'avons presque jamais connus, des gens qui ne s'approchèrent pas ou qui passèrent sans s'arrêter dans la vie de ceux que nous aimons à présent, ou qui s'y arrêtèrent mais se lassèrent finalement et qui disparurent sans laisser de trace ou seulement la poussière que soulèvent leurs pieds dans la fuite, ou qui moururent causant à ceux que nous aimons une mortelle blessure qui presque toujours finit par se refermer. Nous ne pouvons prétendre être les premiers, ou les préférés, nous sommes tout simplement ce qui est disponible, les laissés-pour-compte, les survivants, ce qui désormais reste, les soldes, et c'est sur des bases si peu nobles que s'érigent les amours les plus grandes et que se fondent les meilleures familles, nous provenons tous de là, de ce produit du hasard et du conformisme, des rejets, des timidités et des échecs d'autrui, et même dans ces conditions nous donnerions parfois n'importe quoi pour continuer auprès de celui que nous avons un jour récupéré dans un grenier ou une brocante, que par chance nous avons gagné aux cartes ou qui nous ramassa parmi les déchets ; contre toute vraisemblance nous parvenons à nous convaincre de nos engouements hasardeux, et nombreux sont ceux qui croient voir la main du destin dans ce qui n'est autre qu'une tombola de village quand l'été agonise... »
« Bien entendu on pleure l'ami, comme j'ai moi-même pleuré Miguel, mais il y a là aussi une agréable sensation de survie et de meilleure perspective, d'être celui qui assiste à la mort de l'autre et non l'inverse, de pouvoir contempler le tableau achevé et de raconter son histoire à la fin, de prendre en charge les personnes qu'il laisse désemparées et de les consoler. À mesure que les amis meurent on se sent rapetissé et plus seul, et parallèlement on commence le compte à rebours. "Un de moins, un de moins, je sais ce qu'il en fut d'eux jusqu'au dernier instant, et je suis celui qui reste pour le relater. Moi, en revanche, personne parmi ceux pour qui je compte vraiment ne me verra mourir ni ne sera capable de me raconter totalement, ainsi dans un certain sens je serai toujours inachevé parce qu'ils n'auront pas la certitude que je ne continue pas à être éternellement vivant, s'ils ne m'ont pas vu tomber." »
Javier analyse Le Colonel Chabert de Balzac (Shakespeare est aussi beaucoup cité).
« --- Ce qui lui arrive est secondaire. C'est un roman, et ce qui se passe dans les romans n'a pas d'importance et on l'oublie, une fois qu'ils sont finis. Ce sont les possibilités et les idées qu'ils nous inoculent et nous apportent à travers leurs cas imaginaires qui sont intéressantes, on s'en souvient plus nettement que des événements réels et on en tient compte. »
Précises observations psychologiques et sociales.
« Admettons, peut-être son interlocuteur était-il l'un de ces hommes, ils sont légion, à qui l'on ne peut s'adresser qu'avec un vocabulaire déterminé, le leur, pas celui que l'on emploie normalement, à qui il vaut mieux toujours s'adapter pour qu'ils ne se défient pas de vous, ne se sentent pas mal à l'aise ou diminués. Je n'en fus pas du tout vexée, pour la plupart des types de la planète je ne serais qu'"une gonzesse". »
María surprend une conversation de Javier avec un certain Ruibérriz, d’où il ressort qu’ils sont complices dans l’assassinat de Miguel.
Elle évoque Athos et Milady dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas.
« Nous ne sommes plus dans ces temps reculés où tout devait être jugé ou du moins être su ; aujourd'hui les crimes jamais élucidés ni punis sont incalculables parce qu'on ignore qui peut les commettre --- il y en a tant qu'il n'y a pas assez d'yeux pour regarder à l'entour --- et l'on trouve rarement quelqu'un à mettre sur la sellette avec un peu de vraisemblance : attentats terroristes, assassinats de femmes au Guatemala ou à Ciudad Juárez, règlements de comptes entre trafiquants, massacres sans discrimination en Afrique, bombardements de civils par ces avions sans pilote et par conséquent sans visage... Encore plus nombreux sont ceux dont personne ne s'occupe et qui ne donnent même pas lieu à enquête, c'est considéré comme peine perdue et on les classe sitôt qu'ils ont eu lieu ; et plus encore ceux qui ne laissent pas de trace, qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont jamais découverts, ceux qui sont inconnus. »
Javier explique à María comme, bien que commanditaire, il laissa une grande part d’incertitude dans l’enchaînement meurtrier, dégageant ainsi sa responsabilité personnelle.
« --- Oui, Luisa sortira de l'abîme, n'aie aucun doute là-dessus. En fait elle en sort déjà, un peu plus chaque jour qui passe, je le vois bien et il n'est pas de retour en arrière possible une fois commencé le processus d'adieu, le second et définitif, celui qui n'est que mental et qui nous donne mauvaise conscience parce qu'il nous semble que nous nous déchargeons du mort --- c'est ce qu'il nous semble et c'est bien le cas. Un recul ponctuel peut se produire, selon le cours de la vie de chacun ou en fonction d'un hasard quelconque, mais rien de plus. Les morts n'ont que la force que leur accordent les vivants, et si on la leur retire... Luisa se libérera de Miguel, dans une bien plus large mesure qu'elle ne pourrait se l'imaginer à cet instant, et cela il le savait parfaitement. Qui plus est, il décida de lui faciliter la tâche selon ses possibilités, ce fut en partie pour cette raison qu'il me fit sa demande. En partie seulement. Bien entendu il y avait une raison qui pesait davantage. »
Miguel aurait été condamné à court terme par un cancer généralisé, avec des étapes atroces à brève échéance.
« Les gens croient qu'ils ont droit à la vie. De plus, cela figure presque partout dans les religions et les lois, quand ce n'est pas dans les Constitutions, et cependant lui ne le voyait pas ainsi. Comment avoir droit à ce que l'on n'a ni construit ni mérité ? disait-il. Personne ne peut se plaindre de ne pas être né, ou de ne pas avoir été avant dans le monde, ou de ne pas y avoir toujours été, alors pourquoi faudrait-il se plaindre de mourir, ou de ne pas être après dans le monde, ou de ne pas toujours y rester ? L'une comme l'autre de ces assertions lui semblaient absurdes. Personne ne fait d'objection sur sa date de naissance, donc on ne devrait pas non plus en faire sur celle de sa mort, également due à un hasard. Même les morts violentes, même les suicides, sont dus à un hasard. Et si on a déjà été dans le néant, ou dans la non-existence, il n'est pas si étonnant ou si grave d'y retourner bien que nous ayons maintenant un point de comparaison et que nous connaissions la faculté de regretter. »
María est draguée par Ruibérriz, l’ami voyou de Javier, et obtient ainsi d’autres informations sur leur « homicide compassionnel ».
Le récit s’autocite et ratiocine, et vaut essentiellement pour les réflexions sur la place des morts, l’amour, ou encore l’impunité, qu’il explore dans un style précis.
\Mots-clés : #amitié #amour #contemporain #criminalite #mort #psychologique #relationdecouple #xxesiecle
- le Dim 19 Fév - 11:42
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Javier Marías
- Réponses: 7
- Vues: 693
Raymond Chandler
The Long Goodbye
C’est le sixième roman de Chandler où apparaît le célèbre (pour nous) détective privé Philip Marlowe, et que son auteur considérait comme son meilleur livre. J’ai tout de suite apprécié la réaction de Marlowe, qui aide gratuitement un pauvre type ivre, Terry Lennox, refusant même de s’intéresser à sa vie privée. Marlowe, personnage aussi tenace que taciturne, est le narrateur, précis et observateur.
« Pourquoi entrais-je à ce point dans les détails ? C’est que, dans une atmosphère aussi tendue, chaque geste devenait une performance, un acte d’une importance capitale. C’était un de ces moments cruciaux où tous les mouvements automatiques, bien qu’établis de longue date et consacrés par l’habitude, se muent en manifestations isolées de volonté. Vous êtes alors comme un homme qui réapprend à marcher après une polio. Rien de vous paraît aller de soi ; rien du tout. »
Plus conventionnellement, ce dur-à-cuire s’insurge contre la brutalité policière (là aussi, l’histoire récente peut donner du crédit à son point de vue).
« La loi n’est pas la justice. C’est un mécanisme très imparfait. Si vous appuyez exactement sur les boutons adéquats et qu’en plus vous avez de la chance, l’ombre de la justice peut apparaître dans la réponse. Jamais la loi n’a été conçue comme un mécanisme. »
Terry est un trentenaire aux cheveux blancs et au visage couturé, dont Marlowe décrit « le charme de sa faiblesse et son genre très particulier de fierté ».
« Je ne le jugeais pas, ne l’analysais pas, comme je ne lui avais jamais posé de questions sur l’origine de ses blessures ou sur les conditions dans lesquelles il s’était marié à une femme comme Sylvia. »
Terry se remarie avec Sylvia, belle et riche cadette du millionnaire Potter, qui mène une vie dissolue avant d’être massacrée. Terry est accusé de sa mort, ce qui est invraisemblable pour ; il se serait suicidé en laissant des aveux. Marlowe est inquiété par la police, qui comprend qu’il l’a aidé à fuir au Mexique, mais Potter étouffe l’enquête pour sauvegarder sa vie privée. Toutes les personnes proches de l’affaire conseillent à Marlowe de laisser tomber.
« Un mort est le bouc émissaire idéal. C’est pas lui qui pourrait vous contredire. »
Terry aurait été blessé à la guerre, sauvant deux compagnons devenus depuis des caïds, Mendy Menendez et Randy Starr, auxquels il n’a pas eu recours alors qu’il était dans la mélasse.
« Ce type avait été un homme impossible à détester. Combien en rencontre-t-on dans la vie dont on puisse en dire autant ? »
Roger Wade est un auteur à succès qui a un fort penchant pour l’alcool ; son éditeur, Spencer, demande à Marlowe de l’empêcher de boire pour qu’il puisse finir son roman en cours, et sa femme, la belle Eileen Howard aux yeux violets, de le retrouver car il a disparu en pleine phase éthylique.
Regard attentif sur les marges de la société.
« Tous les bureaux étaient occupés par divers charlatans, adeptes miteux de la Christian Science, avocats de l’espèce qu’on souhaiterait à ses adversaires, docteurs et dentistes dans la débine, maladroits, malpropres, attardés, trois dollars et payez l’infirmière, s’il vous plaît, des hommes fatigués, découragés, qui savent exactement à quoi s’en tenir sur eux-mêmes, à quel genre de patients ils peuvent s’attendre et combien ils peuvent leur soutirer. Prière de ne pas demander de crédit. Le docteur est là ; le docteur est absent. Vous avez une molaire bien branlante, madame Karinski. Maintenant, si vous voulez ce nouveau plombage en acrylique, ça vaut n’importe quel inlay en or. Je peux vous poser ça pour quatorze dollars. Pour la Novocaïne, ça fera deux dollars de plus, si vous voulez. Le docteur est là ; le docteur est absent. Ça fera trois dollars. Payez l’infirmière, s’il vous plaît.
Dans un immeuble pareil, il y aura toujours une poignée de gens pour se faire du fric mais ça ne se voit pas sur eux. Ils se fondent dans un anonymat grisâtre qui leur sert d’écran protecteur. Avocats marrons associés à des rackets de récupération de caution (deux pour cent en moyenne de tous les versements gagés sont récupérés). Avorteurs se faisant passer pour n’importe quels fricoteurs pour justifier la présence de leur matériel. Trafiquants de came qui se prétendent urologues, dermatologues ou toute autre branche de la médecine où le traitement peut être suivi et où l’usage répété des anesthésiques est normal. »
De nombreux personnages et situations pittoresques sont décrites, vie ordinaire d’un privé de L.A. ; Chandler a le talent des portraits lapidaires.
« Il était roux, les cheveux coupés court et son visage me fit l’effet d’un poumon vidé d’air. J’avais rarement vu un gazier aussi laid. »
On trouve aussi de la sociologie (datée, livre paru en 1953).
« Le téléphone est un objet tyrannique, envahissant. Le gadgetomane de notre époque l’adore, l’abhorre, le craint. Mais il le traite toujours avec respect, même quand il a bu. Le téléphone est un fétiche. »
Marlowe récupère Wade chez un médecin charlatan ; il rencontre Linda Loring, sœur de Sylvia et épouse du docteur d’Eileen.
« Il croit avoir un secret enfoui dans sa mémoire et il ne peut pas y accéder. Peut-être est-ce une forme de culpabilité vis-à-vis de lui-même, peut-être vis-à-vis de quelqu’un d’autre. Il croit que c’est ce qui le pousse à boire parce que, précisément, il n’arrive pas à élucider ce mystère. Il s’imagine sans doute que quoiqu’il ait pu se passer, c’est arrivé quand il était ivre et il se figure qu’en buvant il finira par voir clair. C’est un cas qui relève du psychiatre. Bon, si je me trompe, alors il se soûle parce qu’il en a envie ou ne peut s’en empêcher et cette histoire de secret n’est qu’une mauvaise excuse. Il ne peut pas écrire son livre ou, du moins, le terminer. Parce qu’il boit. Je veux dire qu’apparemment il est incapable de finir son livre parce qu’il se soûle à mort. »
Considérations sur l’écriture, solipsiste, via Wade.
« Ce monde, c’est toi qui l’as fait toi-même et le peu de secours que tu as reçu du dehors tu en es aussi l’auteur. Alors, cesse de prier, tocard. Lève-toi et bois ce verre. Il est maintenant trop tard pour quoi que ce soit d’autre. »
Wade se suicide, selon toutes apparences ; Marlowe, à proximité lors des faits, est innocenté, toujours grâce à l’influence de Potter. Il a affaire à Bernie Ohls, un lieutenant de police qu’il connaît depuis longtemps.
« – Il n’existe aucun moyen pour faire cent millions de dollars honnêtement, dit Ohls. Le grand chef se figure peut-être qu’il a les mains propres, mais sur le trajet, il y a des gars qui se font arnaquer jusqu’à l’os, de bonnes petites affaires peinardes qui sont liquidées et vendues pour trois sous, des types tout ce qu’il y a de réglos qui perdent leur boulot, des stocks de marchandises rayés du marché, des prête-noms achetés au rabais et de grands cabinets juridiques payés des fortunes pour tourner des lois dont se réclament le commun des mortels mais qui dérangent les riches parce qu’elles leur rognent leurs bénéfices. La grosse galette donne le pouvoir et le pouvoir on en fait pas bon usage. C’est le système qui veut ça. C’est peut-être pas possible d’en avoir un meilleur mais c’est pas encore la promotion de la blancheur Persil. »
« – Je suis un romantique, Bernie. J’entends des voix qui pleurent la nuit, et je ne peux pas m’empêcher d’aller voir ce qui se passe. On ne fait pas un rond comme ça. Si t’as un peu de jugeote, tu fermes tes fenêtres et tu augmentes le son de ta télé. Ou tu appuies sur le champignon et tu fous le camp au diable. Tu te mêles surtout pas des ennuis des autres. Tout ce que ça peut te rapporter, c’est d’être mal vu. La dernière fois que j’ai vu Terry Lennox, on a pris ensemble le café que j’avais préparé chez moi et on a fumé une cigarette. Alors, quand j’ai appris sa mort, je suis allé à la cuisine, j’ai fait du café, j’en ai servi une tasse pour lui, j’ai allumé une cigarette pour lui et quand le café a été froid et la cigarette consumée, je lui ai dit bonne nuit. On fait pas un rond comme ça, je te dis. Tu ferais pas ça, toi, c’est pour ça que t’es un bon flic et que je suis privé. Eileen Wade s’inquiète pour son mari, alors je me mets en chasse et je le ramène chez lui. Une autre fois, il est dans le pétrin, il m’appelle, j’y vais, je le ramasse sur la pelouse, je le mets au lit et je ne me fais pas un rond. Zéro pour cent. Rien, sauf qu’à l’occasion je me fais casser la gueule, foutre au trou ou menacer par un malfrat comme Mendy Menendez. Mais pas d’argent, pas un centime. J’ai un billet de cinq mille dollars dans mon coffre mais jamais j’en dépenserai une miette. Parce que c’est par une combine louche que je l’ai reçu. Au début, ça m’a amusé, et je le sors encore de temps en temps pour le regarder. Mais c’est tout – ce fric-là ne se dépense pas. »
« On ne fait plus un boulot de policiers, on devient une branche du racket de la médecine. On les voit partout en taule, devant les tribunaux, dans les salles d’interrogatoire. Ils écrivent des rapports de quinze pages pour expliquer pourquoi un petit voyou a braqué un débit de boissons, violé une écolière ou refilé de la came aux élèves de terminale. Dans dix ans, les zèbres comme Hernandez et moi subiront les tests de Rorschach ou d’associations de mots au lieu de faire de la gym et de s’entraîner à la cible. Quand on partira sur un coup, en emportera des petits sacs de cuir noir avec des détecteurs de mensonge portatifs et des ampoules de sérum de vérité. »
« Tu t’imagines que dans leurs grosses boîtes de Las Vegas et de Reno, il n’y a que des types pleins aux as qui vont prendre des culottes pour se marrer ? Mais c’est pas ceux-là qui font marcher le racket, c’est la foule des pauvres pigeons qui paument régulièrement le peu de fric qu’ils peuvent mettre de côté. Le flambeur plein aux as perd quarante mille dollars, se marre et remet ça. Mais le flambeur plein aux as n’enrichit pas le racket. C’est les petites pièces, la mitraille, un demi-dollar par-ci, par-là, quelquefois même un billet de cinq qui grossissent le magot. Le fric du racket rentre comme l’eau coule dans les conduites de ta salle de bains sans jamais s’arrêter. Chaque fois qu’on veut avoir la peau d’un flambeur professionnel, c’est à moi de jouer. Et chaque fois que le gouvernement prend sa dîme sur le jeu en appelant ça des impôts, il contribue à la prospérité de la pègre. […]
— Tu es un flic épatant, Bernie, mais tu te goures complètement. En un sens, les flics sont tous pareils. Ils interviennent toujours à tort. Si un type perd sa chemise à la passe anglaise, interdisez le jeu. S’il se cuite, interdisez l’alcool, s’il tue quelqu’un dans un accident de voiture, arrêtez de fabriquer des bagnoles, s’il se fait pincer avec une nana dans une chambre d’hôtel, interdisez la baise. S’il tombe dans l’escalier, ne bâtissez plus de maisons.
– Ah, mets une sourdine !
– Une sourdine, naturellement. Je ne suis qu’un citoyen quelconque. Passe la main, Bernie. Si on a des truands, des mafiosi, des équipes de tueurs, ce n’est pas à cause des politiciens véreux et de leurs acolytes à l’hôtel de ville et dans les instances juridiques. Le crime n’est pas une maladie, c’est un symptôme. Les flics me font penser aux toubibs qui te refilent de l’aspirine pour une tumeur au cerveau, à part que les flics la soigneraient plutôt à la matraque. Nous formons une grande population riche, rude, sauvage et le crime représente le prix à payer en échange, et le crime organisé est le prix à payer pour l’organisation de cette société. Ça va encore durer comme ça un bon bout de temps. Le crime organisé n’est que le côté malpropre du dollar roi. »
L’intrigue est finement, longuement exposée, de façon circonstanciée, analytique ; dénouée, elle se prolonge, prenant aussi le temps de dénoncer le système de l’argent, tout comme de fouiller le personnage de Marlowe l’indépendant. L'alcoolisme est également décortiqué, sans doute basé sur l'expérience personnelle de Chandler.
C’est une sorte de classique du roman policier, apprécié par de nombreux écrivains, par forcément de la veine polar, comme Jim Harrison, et son influence marquera de nombreux auteurs ultérieurs.
Il est fort agréable de lire un polar de temps à autre : mais il y en a tant, encore faut-il en lire un bon – celui-ci en est un !
\Mots-clés : #polar #psychologique
- le Sam 18 Fév - 11:47
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Raymond Chandler
- Réponses: 2
- Vues: 391
Henry James
La Source sacrée
Le narrateur, lors du trajet en train vers une partie de campagne au domaine de Newmarch, rencontre Gilbert Long, une relation qui le snobait jusqu’alors et dont il avait une piètre estime (« le crétin prétentieux »), et Grace Brissenden, qu’il ne reconnaît d’abord pas tant elle paraît n’être plus laide et vieille. En aparté, Long lui dit qu’elle a rajeuni à cause de son mariage avec Guy (« Briss »), plus jeune qu’elle, et Grace lui dit que Long est devenu intelligent et distingué sous l’influence de lady John, son épouse (qui vient par le train suivant avec Guy).
Guy paraît fort vieilli au narrateur, qui observe la petite société (notamment, outre les deux couples et lui-même, le peintre Ford Obert et la ravissante May Server) et enquête sur ce secret, élaborant une théorie de transfert de jeunesse ou d’esprit par sacrifice amoureux, de vases communicants de la « source sacrée » dans une liaison entre deux personnes.
Un portrait représente un homme marqué comme par la mort, rappelant la face de « ce pauvre Briss », et qui tient un masque qu’on peut voir comme de vie, de beauté féminine. (Ce topos littéraire fait partie du registre fantastique qui crée d'abord une appréciation erronée du roman par le lecteur, une fausse piste qui signale aussi les différences de perception des divers personnages).
Grace suggère que Mrs Server, naguère si calme et devenue si nerveuse (et en quelque sorte imbécile), soit la partenaire mystérieuse de Guy ; Obert trouve cette dernière changée depuis qu’elle posa pour lui un an plus tôt. Le narrateur (empli de compassion pour ses proies, et qui en est peut-être une lui-même, si dogmatique et imbu de lui-même) est inquiet de l’avoir exposée aux soupçons avec ses spéculations confiées à Obert et Grace.
« Cette femme est aussi charmante que possible à chaque minute, et avec chaque homme. »
« La popularité est un abri et une sanctification... elle dispose le monde à s'accorder pour ne rien voir. »
« Je m'aperçus ainsi que la discrétion avait un très étrange effet, lorsqu'elle permettait simplement une plus grande prise morale sur une proie. »
« La simple mécanique de son expression, cette lanterne de papier qui oscillait, était maintenant tout ce qui restait sur son visage. »
« Splendide, profonde, involontaire, son exquise faiblesse révélait simplement des abîmes qu'elle aurait voulu cacher. Bref, c'était une tentative merveilleusement ratée de ne rien dire. Elle disait tout, et, au bout d'une minute, mon bavardage, bien audible, mais par là complètement déplacé, cessa par net effroi de ce qu'il avait provoqué. »
Dans le laboratoire de ce microcosme social de la gentry, dans la « cage de cristal » de Newmarch durant ce week-end, le narrateur braque la « torche de l’analogie » entre les personnages qu’il scrute pour échafauder ses déductions logiques, traquant la relation cachée, de même que font, à son instigation, Mrs Brissenden et Obert.
Une subtile impression d’irréel, de jubilatoire mise en scène ludique et d’incertitude sur le narrateur (sa santé mentale est même mise en doute) est savamment entretenue.
On retrouve dans ce roman l’énigme non révélée par l’auteur de Le Motif dans le tapis, qui m’a aussi ramentu Le point aveugle de Cercas.
Il m’a fallu quelques efforts pour m’y retrouver dans l’imbroglio des personnages et les circonvolutions d’un style splendide (assurément le dessein d’un auteur retors), mais cela valait la peine : c’est étonnant, brillant d’intelligence : du grand art !
\Mots-clés : #psychologique
- le Dim 5 Fév - 12:19
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Henry James
- Réponses: 69
- Vues: 6423
John Williams
Stoner
William Stoner, fils unique de paysans assez misérables, va fortuitement à l’université du Missouri à Columbia (que fréquenta John Williams), s’y complaît et commence à y faire carrière dans l’enseignement lorsque la Première Guerre mondiale survient, intrusion du monde extérieur dont il est à l’abri dans ce sanctuaire du savoir et de la culture.
Gordon Finch vu par David Masters (collègues à l’université) :
« – Mais tu es assez malin, disons juste assez malin, pour pouvoir deviner ce qui t’arriverait une fois dehors : tu es un raté et tu le sais parfaitement. Tu es tout à fait capable de te comporter comme un salopard, mais tu n’es pas assez impitoyable pour l’être en permanence. De plus, et bien que tu ne sois pas exactement l’homme le plus honnête qu’il m’ait été donné de connaître, tu n’es pas non plus LE salaud magnifique. D’un côté, tu es capable de donner le change avec juste ce qu’il faut de fumisterie pour ne pas travailler autant que le monde pourrait l’exiger de toi, de l’autre, tu n’es pas encore assez malin pour pouvoir lui faire gober que tu es important… Et puis tu n’es pas chanceux… du moins pas vraiment. Tu n’as aucun charisme et tu as toujours l’air un peu niaiseux… Dehors, tu passerais toujours à – Masters écarta légèrement le pouce et l’index – ça du succès et ce sentiment d’échec te détruirait complètement. Donc tu as été choisi. Élu. La providence, dont le sens de l’humour m’enchantera toujours, t’a arraché aux cruelles mandibules de ce monde et t’a placé ici même, en sûreté, au milieu de tes frères… »
Archer Sloane, son professeur :
« Une guerre ne tue pas seulement quelques milliers ou quelques centaines de milliers de jeunes hommes, elle détruit aussi, chez un peuple, quelque chose qui ne pourra jamais être remplacé… Et si ce même peuple traverse plusieurs guerres successives, très vite, la seule chose qui demeure, c’est la brute. »
William étudie la littérature anglaise.
« L’intitulé du sujet de thèse avait été De l’influence de l’Antiquité grecque et romaine dans la poésie lyrique du Moyen Âge et il passa beaucoup de temps, cet été-là, à relire les poètes en latin classique et médiéval. Et plus particulièrement leurs écrits sur la mort. De nouveau, il admira la simplicité et l’élégance avec lesquelles les poètes romains en acceptaient l’idée. Comme si le néant qui les attendait n’était que le juste tribut à payer pour toute la richesse des années dont ils avaient pu jouir. »
Il rencontre puis épouse la pâle et délicate Edith Elaine Bostwick, de Saint-Louis, qui se révèle une conjointe distante, déconcertante, dans « leur intime inimitié ». Ils ont une fille, Grace, dont lui s’occupe.
Sloane décédé, le désinvolte et ambitieux Finch assure l’intérim régulièrement reconduit de sa présidence du département et Hollis Lomax est nommé maître de conférences à sa place ; c’est un infirme, lui aussi sauvé par les livres.
« Il comprit que Lomax avait eu une sorte de révélation – une appréhension du monde rendue possible par les mots, mais que les mots, justement, ne pouvaient traduire – semblable à celle qui l’avait saisi un matin d’hiver pendant l’un des cours d’Archer Sloane. »
À l’instigation d’Edith, Stoner a acquis une maison, dispendieuse au regard de ses maigres émoluments, mais où il a son bureau.
« En s’activant ainsi dans cette pièce qui commençait tout juste à prendre forme, il réalisa que pendant de très nombreuses années, il avait vécu avec une image cadenassée quelque part dans les méandres de son inconscient. Une image refoulée comme s’il s’était agi d’un secret honteux et qui prétendait se faire passer pour un lieu, mais qui, en réalité, n’était autre qu’une représentation de lui-même. Ainsi donc, c’était lui et lui seul qu’il essayait de circonscrire en aménageant ce bureau.
En ponçant ces vieilles planches pour les transformer en bibliothèques, il les sentait devenir plus douces sous sa paume. Il regardait disparaître la patine grisâtre du temps qui, éclat après éclat, laissait deviner l’essence du bois et la pureté de ses veines. En rafistolant ces vieux meubles, en les disposant du mieux qu’il pouvait, c’était lui qu’il façonnait lentement. C’était lui qu’il arrangeait, qu’il retapait et c’était à lui aussi qu’il offrait une seconde chance. »
Stoner s'adonne entièrement aux livres.
« Cet amour de la littérature, de la langue, du verbe, tous ces grands mystères de l’esprit et du cœur qui jaillissaient soudain au détour d’une page, ces combinaisons mystérieuses et toujours surprenantes de lettres et de mots enchâssés là, dans la plus froide et la plus noire des encres, et pourtant si vivants, cette passion dont il s’était toujours défendu comme si elle était illicite et dangereuse, il commença à l’afficher, prudemment d’abord, ensuite avec un peu plus d’audace et enfin… fièrement. […]
Voilà, se disait-il, je deviens un enseignant, un passeur, un homme dont la parole est juste et auquel on accorde un respect et une légitimité qui n’ont rien à voir avec ses carences, ses défaillances et sa fragilité de simple mortel. »
À la mort de son père banquier pendant la crise de 1929, Edith change de vie, écarte William de sa fille chérie, puis de son bureau où il écrivait un second livre.
Charles Walker, un étudiant protégé par Lomax, est un trublion d’une telle inaptitude que Stoner s’oppose à son maintien en cours, ce qui dresse contre lui Lomax ; devenu le nouveau doyen, et son ennemi, ne pouvant éliminer un titulaire, ce dernier use de toutes les brimades possibles.
« Il prenait une sorte de plaisir amer et jouissif à ressasser que le peu de connaissances qu’il avait réussi à acquérir jusque-là l’avait mené à cette seule et unique certitude : en définitive, tout, toute chose, et même ce magnifique savoir qui lui permettait de cogiter ainsi, était futile et vain et finirait par se dissoudre dans un néant qu’il avait été incapable ne serait-ce que d’égratigner. »
Stoner rencontre Katherine Driscoll, et c’est réciproquement l’amour, tant physique que spirituel, jusqu’à leur séparation, à cause de Lomax.
« Au cours de sa quarante-troisième année, William Stoner apprit ce que d’autres, bien plus jeunes, avaient compris avant lui : que la personne que l’on aime en premier n’est pas celle que l’on aime en dernier et que l’amour n’est pas une fin en soi, mais un cheminement grâce auquel un être humain apprend à en connaître un autre. »
Son désespoir existentiel s’approfondit, mais il inflige un revers à Lomax et devient une vedette pour ses étudiants ; il est maintenant sans prise dans son « armure d’indifférence » pour la malveillante Edith, qui se replie sur elle-même.
« Enfin, de guerre lasse, épuisée et presque reconnaissante, elle finit par accepter sa défaite. Les crises se firent plus rares et moins bruyantes jusqu’à devenir aussi convenues que l’intérêt qu’il leur portait et ses longs silences devinrent autant de replis dans une intimité dont il ne s’émouvait plus guère plutôt qu’une attitude de reproche à son égard.
À quarante ans, Edith Stoner était aussi mince qu’elle l’était jeune fille, mais avec une dureté et une friabilité que l’on pouvait imputer à une sorte d’extrême raideur. Comme un corset qui n’aurait pas été taillé à sa mesure et qui, à force d’entraver ses mouvements, avait fini par la blesser. La peau de son visage émacié semblait tendue sur ses pommettes comme une toile sur un châssis et tout en elle n’était qu’angles, arêtes et douleur.
Chaque matin, elle usait de tant de fards et de poudre qu’on avait l’impression qu’elle se composait un visage sur un masque blanc. Ses mains étaient extrêmement maigres, comme si un squelette avait enfilé des gants de peau sèche et puis elles remuaient sans cesse. Se tordant, s’ouvrant, se refermant et se crispant, même dans les moments les plus tranquilles. »
Grace tombe enceinte avec détachement, en fait par fuite. La Seconde Guerre mondiale survient, et son mari y meurt ; elle s’adonne à l’alcool.
« Comme beaucoup d’autres qui avaient déjà vécu une époque similaire, il était… hébété. Ce malaise sans nom tentait de se faire passer pour une sorte de torpeur, seulement lui savait. Il savait que c’était un sentiment dû à des émotions tellement profondes et tellement terribles que l’on s’interdisait de les admettre pour la seule et bonne raison qu’il était impossible de vivre avec. C’était, pensait-il, la force des grandes tragédies. Elles jetaient sur l’humanité une telle chape de malheur qu’elles replaçaient aussitôt nos petites misères dans une tout autre perspective. Les petites histoires se fondaient dans la grande et le fait même qu’elles soient ainsi emportées dans une sorte de maelström qui les dépassait les rendait plus émouvantes encore. Comme une tombe paraît d’autant plus poignante qu’elle a été creusée au milieu de nulle part… »
« Il avait vu la folie du monde et des siens dans les années qui avaient suivi la Grande Guerre. Il avait vu la haine et la méfiance devenir une sorte d’aliénation qui avait gangrené tout le pays aussi sûrement qu’une peste noire. Il avait vu des jeunes gens, des garçons, repartir faire la guerre, piaffer d’impatience et marcher gaiement vers un destin qui n’avait aucun sens. Le chagrin et la pitié qu’il en concevait étaient si absolus et si profondément ancrés en lui que rien ne semblait plus pouvoir l’atteindre… »
Stoner meurt d’un cancer.
« Il laissa ses doigts courir sur le grain du papier et ressentit un léger picotement : ces mots… ils étaient vivants… Ce fourmillement remonta le long de ses poignets et vint se répercuter dans tout son corps. Il y fut très attentif, guetta leur cheminement et attendit d’en être tout entier embrasé. Que cette passion de toujours, cette ardeur, qui avait été comme un affolement, l’épinglât là où il se trouvait étendu. Pourtant il ne pouvait pas lire ce qu’il avait écrit un jour : un rayon de soleil dansait dessus.
Un bruit sourd vint troubler le silence.
Il avait lâché prise et son livre en tombant s’en trouva refermé. »
Ce roman, classiquement chronologique, est rédigé dans un style académique qui lui donne une sorte de pureté détachée ; il est empreint d’une distance partiellement due à l’austère retenue tant de Stoner que de l’auteur, à l’indécision sur les motivations des personnages (malgré une description approfondie par le narrateur omniscient), à l’impression de rendu d’évènements réels dans leur incohérence caractéristique, et au manque avoué d’une représentation nette de cet univers de la littérature illuminant Stoner, passion vitale où il alterne étude et enseignement. Car c’est aussi ce métier qui est le thème du livre (dans la lignée des Coe, Lodge, Philip Roth, Cercas et tutti quanti), et encore le cours du XXe siècle avec ses guerres sidérantes. Mais la matière principale demeure ces solitudes, voire amertumes juxtaposées dans l’insignifiance résignée.
\Mots-clés : #psychologique #xxesiecle
- le Ven 30 Déc - 12:48
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: John Williams
- Réponses: 23
- Vues: 1432
Albert Cossery
Une ambition dans le désert
Au début, sensation de déjà lu tant la situation rappelle celle d’Un complot de saltimbanques : à « Dofa », la capitale d’un petit l’émirat « du golfe », Samantar (au lit avec Gawhara, quinze ans) s’inquiète des récents attentats à la bombe revendiqués par des tracts maladroits, qu’il considère comme une mystification risquant de déclencher la répression du régime autoritaire de cet État pauvre jusque-là épargné par les puissances impérialistes, étant dépourvu de ressources pétrolières.
« La révolution ? Cela ne me paraît pas d’une nécessité vitale dans cette région, ni en ce moment. Même un enfant saurait que la puissance impérialiste qui protège nos richissimes voisins ne laisserait pas sans bouger un mouvement subversif s’implanter dans une partie de la péninsule. »
Il décide d’enquêter avec Hicham, le populaire joueur de tabla (père de la petite Nejma), et effectivement, le peuple, certes pauvre, ne s’intéresse pas à ces signes de révolution. Il retrouve Shaat, son ami d’enfance, à la fois enthousiaste et lucide, inopinément libéré par anticipation de prison pour fraude grâce à un certain Higazi.
« Shaat accueillait toujours avec la même ferveur tous les événements que le hasard pouvait accumuler sur son chemin. Pour lui il n’y avait pas de bonnes et de mauvaises situations. Toutes les situations méritaient d’être vécues avec délectation, car il y avait dans chacune d’elles cette parcelle d’humour qui sauvait l’homme de la dégénérescence et de la mort. Sa nouvelle fonction n’avait en aucune manière changé son caractère éminemment futile. Diriger une révolution n’impliquait nullement de sa part un renoncement à la lucidité. Son analyse des valeurs et des principes qui depuis des millénaires régissaient la terre des hommes n’avait subi aucune altération du fait de son engagement politique. Il restait toujours convaincu de la bêtise fondamentale du monde et n’éprouvait aucune envie de le réformer. D’ailleurs on n’avait pas exigé de lui la foi d’un justicier luttant pour une meilleure répartition des biens terrestres. Tout cela avait plutôt l’air d’un jeu stupide. Fabriquer des bombes et les faire poser par des complices dûment appointés dans différents points de la ville était une occupation surprenante, certes, mais pas plus répréhensible que celle d’un chef d’État faisant bombarder par ses avions une population sans défense. Au moins, ses bombes à lui ne faisaient pas de victimes. Shaat se sentait dans une situation sans équivalent dans les annales révolutionnaires. Participer à une révolution sans être concerné par son triomphe ou son insuccès c’était tout de même quelque chose d’étonnant et qui concrétisait dans une certaine mesure un rêve d’enfance qu’il avait partagé avec Samantar. C’était le rêve merveilleux de tous les enfants intelligents : fabriquer une arme magique capable d’anéantir à jamais le monde ennuyeux des adultes. Malheureusement Samantar avait trahi son rêve d’enfant ; il ne recherchait plus que la paix. Une paix que Shaat, obéissant aux caprices de sa destinée, était en train de saper avec une touchante bonne conscience. »
Un jeune poseur de bombes (Mohi) :
« C’est vrai, il n’y a pas plus débilitant qu’un homme sincère. Mais celui-là ne nous causera aucun ennui. Il approuve tout ce qui peut démanteler le pouvoir, n’importe quel pouvoir. Il hait le monde entier et si je lui en donnais l’ordre, il ferait un carnage. Je ne sais pas ce qu’on lui a fait, mais tu peux compter sur lui pour faire sauter la ville. De toute ma vie je n’ai rencontré quelqu’un trimbalant une haine aussi farouche. »
Le but des attentats n’est pas dans l’émirat, mais chez ses voisins corrompus :
« L’argent du pétrole qui s’accumule entre les mains de quelques potentats, tandis que la majorité du peuple vit dans l’indigence, rend ce dernier plus sensible à l’injustice sociale. Il y a des millions de mécontents à nos frontières. Il suffit d’une étincelle pour qu’ils se soulèvent. Notre action sera pour eux exemplaire. Le partage des biens est une utopie toujours d’actualité et qui fait encore rêver les foules. »
Le cheikh Ben Kadem, Premier ministre de l’émirat, en est le vrai maître, et ambitionne de devenir celui de toute la péninsule, étant farouchement opposé à l’impérialisme étranger ; Samantar, son cousin, anarchisant uniquement préoccupé de plaisirs (femmes, haschisch), est aussi son « conseiller clandestin » à cause de sa perspicacité, même si tout les oppose. Cossery nous fait vite comprendre que c’est le rigoureux Ben Kadem, cette « ambition dans le désert », qui est l’instigateur de ces attentats, comptant sur la « solidarité prolétarienne » internationale pour financer son projet.
« À force de discuter pendant des nuits entières avec son jeune parent Samantar (cet esprit foncièrement contestataire, mais pour qui l’action était une chose dérisoire), il avait fini par admettre que seule une révolution populaire, par l’impact qu’elle aurait dans les autres États du golfe, parviendrait à remuer ces masses amorphes et ferait éclater cet ordre granitique qui s’opposait à son ambition. Cette arme suprême des pauvres lui apparut comme un don de la providence à la pureté de son idéal patriotique. »
« Ben Kadem n’était pas mécontent d’avoir mis en pratique un principe – fondement d’une philosophie cynique – que son jeune parent Samantar avait toujours soutenu devant lui : à savoir que toutes les institutions humaines étaient basées sur une imposture. »
Cossery montre la manipulation et récupération des révolutionnaires avec leur « ordinaire stupidité ».
« Une révolution crédible se fait surtout avec du bruit. »
Une seconde vague d’attentats terroristes, visant clairement les possédants, fait sauter la banque et l’agence d’import-export ; ce n’est plus une farce, et les déshérités craignent pour leurs rares biens ! Gawhara :
« La jeune fille portait son tablier d’écolière et agitait à bout de bras son cartable comme si elle se défendait contre une meute de chiens lancée à sa poursuite. Avec ses sandales en cuir rouge éclaboussées de soleil, elle semblait, dans sa ruée trépidante, répandre son sang sur la pierraille. […]
Pourquoi ne pas partir ?
– Parce que c’est ici que j’aime vivre.
– Il n’y a pas un autre désert comme celui-ci ?
– Non, c’est le dernier. Tous les déserts environnants sont pollués par le pétrole et les marchands du monde entier. Les fiers nomades portent désormais l’uniforme de l’infamie et travaillent tous dans les industries pétrolières. La vue de ces esclaves ternirait notre amour. »
« – Je comprends et même j’admire volontiers la violence contre toutes les formes de l’oppression. Mais nous sommes ici loin de toute tyrannie. Ceux qui à Dofa prônent la violence, il me semble qu’ils s’amusent à instaurer la tyrannie, mais sans doute sont-ils trop bêtes pour s’en soucier.
– Pourtant ces gens sacrifient leur vie pour une juste cause.
– Tu es trop bon pour le croire. Laisse-moi te dire que personne ne fait don de sa vie à une cause, fût-elle juste ou injuste, mais seulement pour obéir à une pulsion intérieure plus forte que l’attachement à la vie. »
« Là où il n’y a rien à partager la révolution est déjà pratiquement accomplie. Alors je me demande si ce chef n’a pas d’autres objectifs plus lointains, plus grandioses que la conquête de ce misérable royaume. Aussi je soupçonne derrière cette macabre exhibition l’ambition d’un homme. »
Mohi ayant explosé avec la bombe qu’il allait placer au palais du Premier ministre en outrepassant les ordres, Shaat avoue à Samantar la part qu’il eut dans le faux mouvement insurrectionnel et la première vague d’attentats, ainsi que l’identité de son promoteur, Ben Kadem. Mohi était le fils secret de ce dernier, qu’il haïssait, et qui renonce à son projet. Tareq, le simple d’esprit aux discours subversifs qui fait la joie des enfants, apparaissant peu à peu comme un simulateur utilisant l’arme de la dérision, n’est en fait pas fou, mais à l’origine de la seconde vague d’attentats, destinés à supprimer les ressources financières du premier mouvement.
« C’est très jeune que j’ai décidé de devenir fou, comme on décide de devenir médecin ou avocat. Les fous jouissent de circonstances atténuantes et il leur est permis de s’exprimer en toute liberté. Et je voulais – c’était ma seule ambition – pouvoir dire au monde tout mon dégoût et ma haine sans encourir de représailles. »
C’est habilement structuré et remarquablement observé, même si le ton guindé de Cossery est parfois laborieux. Outre de beaux personnages (où on devine des positions de l’auteur, portant toujours les valeurs du dénuement et de l’inaction), j’ai trouvé cet ouvrage particulièrement révélateur de la mentalité moyen-orientale, singulièrement au vu de l’histoire récente (livre publié en 1984).
\Mots-clés : #insurrection #politique #psychologique #revolution
- le Dim 25 Déc - 10:49
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Albert Cossery
- Réponses: 59
- Vues: 6206
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages
