La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 11:54
133 résultats trouvés pour politique
Mathias Enard
Déserter
Deux récits racontés alternativement, sans jamais vraiment se rejoindre :
D’une part, un homme déserte le camp des vainqueurs lors d’une guerre civile (en Yougoslavie ?), et regagne la masure écartée de son père ; il est reconnu comme ancien voisin par une jeune femme, qui fuit elle aussi, et sera foudroyée avec son âne.
« Il observe la catastrophe, elle sent peut-être ses yeux sur son corps, il se rappelle si bien la violence qu’il a fait subir qu’aucune surprise ne déforme son visage, aucune pitié, aucune compassion, il voit la jambe brisée et noire, il voit le bois enfoncé dans la chair, il voit l’immense ecchymose sur les côtes, la chemise déchirée, la peau blanche zébrée de peine [… »
D'autre part, Irina, historienne des mathématiques, évoque (notamment la veille d’un colloque commémoratif à Berlin le 10 septembre 2001) la vie de ses parents, Paul Heudeber et Maja Scharnhorst, respectivement mathématicien communiste célèbre en Allemagne de l’Est, ancien résistant antifasciste qui a été déporté à Buchenwald (« le camp sur l’Ettersberg », là où se promenaient Goethe et Schiller) et elle femme politique de l’Ouest, militante des droits des femmes, également ancienne résistante ; pas mariés, ils vécurent généralement éloignés l’un de l’autre, l’un en RDA, l’autre en RFA, séparés par le Mur.
« Pour lui les mathématiques étaient un sens, au même titre que la vue ou l’ouïe, et donc une façon de percevoir la nature. »
« Après 1991, il ne cachait plus son désespoir politique. La fin de la RDA, mais aussi l’explosion yougoslave le rendaient fou de douleur. L’humanité me semble, en gagnant le capitalisme, avoir perdu l’humanité. Partout dans le monde, disait-il. Guerre, violence et injustice. »
Le déserteur secourt la femme et l’emmène dans la montagne, vers la frontière au nord, dans la forteresse en ruine de la Roche Noire ; on apprend qu’elle a été victime de sévices de la part des troupes auxquelles le déserteur appartenait. Lui, tortionnaire croyant, est las de la guerre.
Paul a été rendu célèbre par Les Conjectures de Buchenwald :
« Robert Kant soutenait que l’originalité du texte de Paul, outre son côté indiscutablement littéraire, ses considérations sur la Révolution, ses passages obscurs, sa poésie si sombre, provient de sa radicalité scientifique : de ce croisement, au fond du XXe siècle, du désespoir historique avec l’espérance mathématique. »
À Weimar, Irina consulte le dossier établi par la Stasi sur sa mère, tandis que la Russie bombarde l’Ukraine.
« En 1942 le directeur des Musées de Weimar, en accord avec le maire, décide d’organiser la protection des collections prestigieuses des différents lieux de souvenir de la ville, en cas de bombardement aérien. Musée d’archéologie, Musée des Beaux-Arts, Maisons de Goethe et de Schiller. Il a l’idée de commander des caisses en bois au camp de concentration de Buchenwald, là-haut dans la forêt, qui possède un atelier de menuiserie et toute une hêtraie à disposition. Quarante grandes malles de bois pour emballer des meubles et des livres de la Maison de Schiller, de la Maison de Goethe et des collections du Musée d’histoire ancienne.
Le directeur souhaite aussi passer commande à Buchenwald des copies des meubles de la chambre du dernier étage de la Maison de Schiller : le lit de mort de Schiller, le bureau sur lequel il écrivait, l’épinette sur laquelle il jouait des danses de Haydn, ainsi qu’un fauteuil par étage. Tous ces meubles furent chargés dans un camion et confiés aux SS pour qu’ils en établissent des copies. Le bureau de Schiller et les danses de Haydn furent donc enfermés à Buchenwald et des détenus se mirent au travail pour les copier. Il fallut trouver des prisonniers non seulement ébénistes, mais aussi un facteur de piano pour l’épinette – il y avait le monde entier à Buchenwald, et les copies furent parfaites. »
Un intellectuel utopiste, un jeune rural qui fuit la guerre, avec peut-être pour point commun d’avoir été trompés dans leurs engagements…
Érudition certes (en Histoire, voire en mathématiques : Nasiruddin Tusi, etc.), mais bien amenée, et servie par un style exigeant (avec un peu trop de pathos à mes yeux). Des réflexions aussi, parfois surprenantes, comme en politique.
\Mots-clés : #guerre #historique #politique #science #violence #xxesiecle
- le Mar 23 Avr - 12:13
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Mathias Enard
- Réponses: 103
- Vues: 7966
Valerio Varesi
Ce n'est qu'un début commissaire Soneri
Suicide d’un Roumain, puis meurtre d’un ancien communiste, idéaux déçus d’une lutte qui s’avéra finalement inutile, sur toile de fond du typique antagonisme avec les fascistes (qui semblent eux avoir encore de l’avenir).
« — Supporteur ultra de La Spezia, néofasciste, spécifia l’autre.
— Ça va souvent ensemble.
— Toujours, mon cher. L’extrême droite est en train de conquérir une bonne partie des clubs de supporteurs. Une stratégie, pourrait-on dire. Il n’y a pas de meilleur entraînement au squadrisme et à la guérilla. »
Toujours à Parme, mais aussi en Ligurie et dans les Apennins. Sinon, une Vespa et au menu, des pisarei e fasò, « Petits gnocchis de farine et de chapelure (pisarei) servis dans une sauce aux haricots (fasò), au lard (ou couenne, ou saucisse, ou tout à la fois), à la tomate et aux oignons » !
« — La seule chose qui se maintienne, c’est ce qu’on a dans l’assiette, nota Soneri. Le reste, c’est terminé. Je crois que c’est pour ça que j’aime bien manger. Mes sensations gustatives sont les seules à ne pas avoir muté, depuis toutes ces années. »
Et bien sûr la brume.
« Le brouillard dégageait une vapeur inquiète en caressant de ses ailes grises le pare-brise.
— Quand les nuits sont brumeuses, on se croirait seuls au monde, médita Angela à voix haute. Tu crois que c’est ça qui nous fait peur ?
— On l’est toujours, sauf qu’on ne s’en rend pas compte. Le brouillard nous le rappelle, répondit le commissaire en regardant droit devant lui. »
« Il s’arrêta pour contempler l’horizon aussi loin que la pureté du ciel le permettait et constata qu’il ressentait la même impuissance que devant le brouillard. Il comprit alors le malaise qu’il éprouvait dans les villages côtiers, pourquoi il finissait toujours par fuir afin de se réfugier dans les brumes de la plaine. Ici, dans la limpidité propre aux matins d’hiver où le regard plongeait jusqu’à ce que ciel et mer se touchent, il n’entrevoyait rien derrière les apparences. La clarté supprimait tout espoir d’une intimité, même si, derrière le rideau de la brume, on ne la percevait qu’au travers d’ombres ou de sensations. Sans le brouillard, le monde paraissait vide, impitoyable, géométrique, et bien trop vaste. »
Une revisitation du communisme à l’italienne, et surtout la mélancolie, l’amertume « de perdants complètement désillusionnés. »
« — On a perdu, on doit l’admettre, s’épancha tout à coup Soneri. Culturellement, je veux dire. C’est un échec.
— On a trop fait confiance à nos idées, observa Angela. Croire que les gens sont disposés à devenir meilleurs est la plus grosse connerie qu’on puisse imaginer. Comme de refuser d’admettre que les instincts sont plus puissants que tout notre arsenal culturel. La majorité des individus ne pense qu’au sexe, à la bouffe et au désir de domination. Biologie pure et simple, comme pour les autres animaux. Si on en avait pris acte, on ne se serait pas obstinés à prêcher. Rester du côté des idées, ça veut dire vivre avec la rage. »
« À partir de là, la majorité s’est vendue au plus offrant. On est passés des projets collectifs aux projets individuels, et la consommation a remplacé les idéaux. Les années 80 ont tout balayé. C’est là que le désir de posséder a pris le dessus, imposé par la dictature de la télé. On n’a pas compris que les places où on continuait de se rassembler étaient devenues des sites archéologiques. Le vrai rassemblement, c’étaient les millions de gens devant la télé au moment du dîner qui croyaient que le bonheur, c’était de s’acheter une bagnole et un téléviseur, acheva Monti. »
« — J’ai l’impression d’être dans un roman-photo, ronchonna-t-il. La mer, la lune, nous à nous embrasser à la fenêtre… La télé nous a matraqués avec ses messages à la con, on ne se rend même pas compte qu’on est comme des acteurs de télénovelas.
— À force de galvauder le langage et les sentiments, ils ont banalisé tout ce qu’on a de plus précieux. Ils ont détruit toute authenticité, c’est ça le pire, admit Angela. »
« Des années entières à lutter… Pour quel résultat ? Aucun. »
« Il n’y a plus de continuité entre générations, tout est à recommencer. Même les enfants des révolutionnaires sont de droite. »
\Mots-clés : #polar #politique
- le Mer 27 Mar - 11:17
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Valerio Varesi
- Réponses: 55
- Vues: 5815
QIU Xiaolong
Chine retiens ton souffle
Shanghai, « la Perle de l’Orient », la cité de la réussite économique, et son smog. Chen, qui est placardisé, doit enquêter en tant que « conseiller » sur un meurtrier en série avec Yu (et sa femme Peiqin) ; de plus, il doit se renseigner (à l’instigation de Zhao, son vieux protecteur du Parti à Pékin) sur « un groupe d’activistes [qui] doit se réunir secrètement à Shanghai afin de mettre en place un plan d’action », et auquel appartient Shanshan, sa liaison dans Les Courants fourbes du lac Tai, devenue une influente militante écologiste. Pour être « l’inspecteur solitaire qui manœuvre dans l’ombre », Chen compte s’inspirer de « l’ouvrage classique intitulé Les 36 Stratagèmes ».
On retrouve nombre de personnages des romans précédents, en plus d’allusions à ceux-ci, et les mêmes ingrédients (de cuisine, mais aussi les références littéraires classiques).
« Le présent est, quand on y pense/ déjà le passé… »
Une piste de masques antipollution remonte jusqu’à un veuf qui accomplit le rituel des sept-sept, un repas fastueux offert hebdomadairement pendant les sept semaines qui suivent son décès à un être cher, tandis que Shanshan, qui va sortir un documentaire accablant pour les industries pétrolières, est visée par une sextape : croissance économique à tout prix versus préservation de l’écosystème.
Il y a effectivement une sorte d’épuisement de la veine de Xiaolong, mais je trouve toujours de l’intérêt – et du plaisir – à sa lecture.
\Mots-clés : #ecologie #polar #politique #regimeautoritaire
- le Sam 3 Fév - 11:11
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: QIU Xiaolong
- Réponses: 25
- Vues: 2800
Ian McEwan
L'Enfant volé
Angleterre, juste avant 1987 (date de parution du livre) : Kate, la fille de trois ans de Stephen Lewis, auteur à succès de livres pour enfants, est mystérieusement enlevée comme ils faisaient des courses. La dévastation du couple qu’il formait avec Julie est excellemment rendue.
« Il était père d’un enfant invisible. »
Charles Darke, son éditeur devenu un ami, s’est lancé dans la politique après une brillante carrière dans les affaires, choisissant cyniquement la droite au pouvoir.
Stephen rêvasse pendant les séances d’un comité gouvernemental en charge de la préparation d’un manuel de pédagogie (qui s’avèrera avoir écrit d’avance par les services du Premier ministre). Il voit en hallucination ses parents venus à bicyclette dans un pub avant sa naissance. Il leur rend visite, réchappe d’un accident de la circulation, répond à l’invitation de Charles et Thelma, son épouse enseignante en physique quantique, qui ont quitté la vie publique pour se retirer à la campagne (lui semble retombé en enfance). Puis Stephen retourne au whisky et aux émissions télévisées. Enfin il sort de sa catatonie et reprend des activités. Le Premier ministre l’invite, l’interroge sur Charles.
Charles, qui a rédigé le manuel pour ce dernier qui le désire, se laisse mourir de froid, déchiré entre son désir d’enfance et son existence sociale ambitieuse.
Stephen retrouve Julie qui, trois ans après la disparition de Kate, donne vie à un nouvel enfant.
« Tout l’art d’un mauvais gouvernement consistait à rompre le lien entre la politique adoptée dans le domaine public et le sens profond et instinctif de bonté et d’équité de l’individu. »
« Tous ces esprits prometteurs, cultivés, brûlants d’enthousiasme, après des études de littérature anglaise qui avaient inspiré leurs brefs slogans – L’énergie est une joie perpétuelle, à bas les contraintes, vive les étreintes –, tous avaient déferlé des bibliothèques au tournant des années soixante-dix, fermement résolus à entreprendre des voyages intérieurs, ou des voyages vers l’Orient dans des cars bariolés. Une fois le monde devenu moins vaste et plus sérieux, ils étaient rentrés au pays afin de se mettre au service de l’Éducation, carrière qui avait à présent perdu son envergure et son attrait ; les écoles étaient mises en vente sur le marché de l’investissement privé, et l’âge de scolarité obligatoire allait bientôt être abaissé. »
« Il donnait l’impression d’être raisonnable et tout à fait concerné, tout en préconisant la nécessité de laisser les pauvres se débrouiller tout seuls et d’encourager les riches. »
« Une minorité perturbatrice de l’humanité considérait tout voyage, aussi bref soit-il, comme l’occasion de faire de plaisantes rencontres. Il se trouvait des gens prêts à infliger des détails intimes à de parfaits inconnus. Des gens à éviter si vous faisiez partie de la majorité de ceux pour qui un voyage offre une opportunité de silence, de réflexion, de rêve. »
« Ils faisaient face à deux possibilités, de poids égal, en équilibre sur un pivot affilé. Dès l’instant où ils pencheraient en faveur de l’une, l’autre, tout en continuant à exister, disparaîtrait à tout jamais. Il pourrait se lever maintenant, et passer devant elle pour se rendre à la salle de bains en lui adressant un sourire plein d’affection. Il s’y enfermerait, sauvegardant son indépendance et sa fierté. Elle l’attendrait en bas, et ils reprendraient le fil de leur conversation prudente jusqu’à ce qu’il fût temps qu’il traverse le champ pour reprendre le train. Ou alors, il fallait risquer quelque chose, il voyait se déployer devant lui une vie différente dans laquelle son propre malheur pouvait redoubler ou disparaître. »
« Et il n’y avait pas de terrain plus propice aux spéculations péremptoirement maquillées en véritables faits que celui de l’éducation des enfants. »
Ce roman brillamment écrit part un peu dans tous les sens, mais vaut pour son regard sur la société (celle aussi des mendiants badgés), la politique (notamment thatchérienne) et même la science (surtout par rapport au temps), aussi par la psychologie des personnages (et l’humour de l’auteur).
\Mots-clés : #culpabilité #education #politique #psychologique #relationdecouple #social #xxesiecle
- le Mer 17 Jan - 11:23
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Ian McEwan
- Réponses: 40
- Vues: 4001
Joe Wilkins
Ces montagnes à jamais
Montana, plus précisément dans le comté de Musselshell (cf. La Montagne et les Pères), peu après l’élection d’Obama. Wendell est un travailleur agricole d’origine modeste dans un élevage de bovins, et il recueille en tant que cousin de sa mère en prison Rowdy, un gamin mutique « dans le spectre autistique » (personnage attachant car bien rendu). Joe Wilkins nous fait progressivement (et habilement, car on suit chaque protagoniste séparément et simultanément) découvrir qu’il est le fils de Verl, disparu dans la montagne après avoir tué un loup, puis un garde-chasse.
Gillian, enseignante démocrate (de Rowdy notamment), est la veuve de Kevin, diplômé en foresterie devenu garde-chasse, abattu par Verl.
D’un côté « des gens libéraux, universitaires, pas particulièrement intéressés par les résultats sportifs du lycée ni par la religion », de l’autre « la pauvreté rurale, […] le manque d’instruction, […] le fondamentalisme religieux et les idées politiques réactionnaires, […] la montagne elle-même – et la famille » qui se confrontent (et c’est évidemment la fracture démocrates et républicains).
Gillian :
« Elle s’adressait à Brian, le beau-père du garçon, et à tous ces hommes violents, ignorants et arrogants dans ces montagnes, à ceux qui pensaient que l’est du Montana tout entier leur appartenait et qu’ils pouvaient y agir à leur guise, qui oubliaient avec une facilité déconcertante que leurs arrière-grands-pères avaient reçu ces terres gratuitement, que leurs grands-pères avaient provoqué le Dust Bowl, que leurs grands-pères et leurs pères avaient empoisonné les rivières et presque décimé la population de cerfs, d’antilopes pronghorn et de grouses, et que le gouvernement fédéral était intervenu à chaque fois – de l’installation d’un réseau électrique dans les régions reculées jusqu’aux prêts des terres gouvernementales pour laisser paître le bétail, en passant par les contrats de location très généreux – afin de subventionner ce mode de vie dont ils se vantaient toujours. Elle en avait sa claque. À l’exception de Billings, ce territoire de l’est Montana était un trou noir où s’engouffrait l’argent du contribuable, un tourbillon terrible de dégradation écologique, d’absence d’instruction, d’alcool, de méthamphétamines et de familles brisées. Et les gens comme elle, ceux qui travaillaient vraiment dur, les professeurs d’école et les assistants sociaux et les agents du BLM [Bureau of Land Management, agence américaine faisant partie du département de l’Intérieur des États-Unis et chargée de la gestion des terres publiques], c’était toujours à eux de réparer et de nettoyer. »
« Les bus-nord et ouest arrivèrent en grondant et s’arrêtèrent dans un soupir presque au même instant, l’un derrière l’autre, puis les portes jaunes coulissèrent. Les enfants des Bull Mountains bondirent du bus-nord, souriant et hurlant. Ils s’essuyaient le nez aux manches de leurs manteaux trop fins, et presque aucun ne portait de bonnet, leurs cheveux sales en bataille. Les enfants qui vivaient dans les petits ranchs et les banlieues à mi-chemin de Billings descendirent du bus-ouest, emmitouflés et enjoués, leurs cartables à l’effigie de super-héros et de personnages de dessins animés populaires, les filles arborant des rubans et des barrettes dans les cheveux, les garçons robustes et lumineux, de petites ampoules rouges clignotant autour de leurs semelles de baskets. »
« Gillian avait longtemps méprisé l’influence considérable que les gros fermiers et ranchers exerçaient dans le Montana. Elle n’était pas versée dans la lutte des classes, pas franchement, mais elle n’avait rien reçu en héritage. Non, elle avait payé ses propres études universitaires en travaillant à la bibliothèque pendant l’année scolaire et comme serveuse l’été. Elle avait économisé et acheté seule la maison de Billings, elle avait réussi à économiser pour les futurs frais de scolarité de Maddy et pour sa propre retraite. Mais tous ces ranchers vivaient sur des terres qui avaient été simplement données à leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, et ils pensaient parfois être les seuls à travailler dur, que leur mode de vie était le seul qui importait lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions pour l’État du Montana. »
La nature est centrale, souvent endommagée par l’activité humaine.
« Une terre de pins ravagés par les insectes, d’étés toujours plus longs et d’hivers plus courts et plus secs. »
Maddy, la fille de Gillian, rencontre Wendell sans qu’ils connaissent l’identité de l’autre ; des indépendantistes chasseurs de loups, pour qui Verl est un héros, surgissent…
C’est l’aspect humain (psychologique et social) qui m’a plu, davantage que l’histoire en elle-même (bien que le suspense soit entretenu avec adresse).
\Mots-clés : #misere #politique #psychologique #ruralité
- le Jeu 7 Déc - 11:27
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Joe Wilkins
- Réponses: 9
- Vues: 451
Javier Cercas
L'imposteur
Cercas détaille comme, troublé par l'histoire d’Enric Marco, « le grand imposteur et le grand maudit » qui s'est fait passer pour un survivant des camps de concentration et est devenu une célébrité espagnole de la mémoire historique des horreurs nazies, il s’est finalement résolu à écrire ce roman non fictionnel. « Comprendre, est-ce justifier ? » N’est-il pas lui-même un imposteur ?
« La pensée et l’art, me disais-je, essaient d’explorer ce que nous sommes, ils révèlent notre infinie variété, ambiguë et contradictoire, ils cartographient ainsi notre nature : Shakespeare et Dostoïevski, me disais-je, éclairent les labyrinthes de la morale jusque dans leurs derniers recoins, ils démontrent que l’amour est capable de conduire à l’assassinat ou au suicide et ils réussissent à nous faire ressentir de la compassion pour les psychopathes et les scélérats ; c’est leur devoir, me disais-je, parce que le devoir de l’art (ou de la pensée) consiste à nous montrer la complexité de l’existence, afin de nous rendre plus complexes, à analyser les ressorts du mal pour pouvoir s’en éloigner, et même du bien, pour pouvoir peut-être l’apprendre. »
« Un génie ou presque. Car il est bien sûr difficile de se départir de l’idée que certaines faiblesses collectives ont rendu possible le triomphe de la bouffonnerie de Marco. Celui-ci, tout d’abord, a été le produit de deux prestiges parallèles et indépassables : le prestige de la victime et le prestige du témoin ; personne n’ose mettre en doute l’autorité de la victime, personne n’ose mettre en doute l’autorité du témoin : le retrait pusillanime devant cette double subornation – la première d’ordre moral, la seconde d’ordre intellectuel – a fait le lit de l’escroquerie de Marco. »
« Depuis un certain temps, la psychologie insiste sur le fait qu’on peut à peine vivre sans mentir, que l’homme est un animal qui ment : la vie en société exige cette dose de mensonge qu’on appelle éducation (et que seuls les hypocrites confondent avec l’hypocrisie) ; Marco a amplifié et a perverti monstrueusement cette nécessité humaine. En ce sens, il ressemble à Don Quichotte ou à Emma Bovary, deux autres grands menteurs qui, comme Marco, ne se sont pas résignés à la grisaille de leur vie réelle et qui se sont inventés et qui ont vécu une vie héroïque fictive ; en ce sens, il y a quelque chose dans le destin de Marco, comme dans celui de Don Quichotte et d’Emma Bovary, qui nous concerne profondément tous : nous jouons tous un rôle ; nous sommes tous qui nous ne sommes pas ; d’une certaine façon, nous sommes tous Enric Marco. »
Simultanément s’entrelace l’histoire de Marco depuis l’enfance, retiré nourrisson à sa mère enfermée à l’asile psychiatrique ; il aurait été maltraité par sa marâtre et ignoré par son père ouvrier libertaire, puis ballotté d’un foyer à l’autre, marqué par les évènements de la tentative d’indépendance catalane d’octobre 1934, juste avant que le putsch et la guerre civile éclatent. Cercas a longuement interviewé Marco, un vieillard fort dynamique, bavard et imbu de lui-même, criant à l’injustice parce qu’il aurait combattu pour une juste cause.
D’après Tzvetan Todorov :
« [Les victimes] n’ont pas à essayer de comprendre leurs bourreaux, disait Todorov, parce que la compréhension implique une identification avec eux, si partielle et provisoire qu’elle soit, et cela peut entraîner l’anéantissement de soi-même. Mais nous, les autres, nous ne pouvons pas faire l’économie de l’effort consistant à comprendre le mal, surtout le mal extrême, parce que, et c’était la conclusion de Todorov, “comprendre le mal ne signifie pas le justifier mais se doter des moyens pour empêcher son retour”. »
Militant anarcho-syndicaliste, Marco aurait combattu dans les rangs de la République, et Cercas analyse le « processus d’invention rétrospective de sa biographie glorieuse » chez ce dernier.
« Et je me suis dit, encore une fois, que tout grand mensonge se fabrique avec de petites vérités, en est pétri. Mais j’ai aussi pensé que, malgré la vérité documentée et imprévue qui venait de surgir, la plus grande partie de l’aventure guerrière de Marco était un mensonge, une invention de plus de son égocentrisme et de son insatiable désir de notoriété. »
Cercas ne ménage pas les redites, procédé (didactique ?) un peu lassant.
« Parce que le passé ne passe jamais, il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit ; le passé n’est qu’une dimension du présent. »
« Mais nous savons déjà qu’on n’arrive pas à dépasser le passé ou qu’il est très difficile de le faire, que le passé ne passe jamais, qu’il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit –, qu’il n’est qu’une dimension du présent. »
« La raison essentielle a été sa découverte du pouvoir du passé : il a découvert que le passé ne passe jamais ou que, du moins, son passé à lui et celui de son pays n’étaient pas passés, et il a découvert que celui qui a la maîtrise du passé a celle du présent et celle de l’avenir ; ainsi, en plus de changer de nouveau et radicalement tout ce qu’il avait changé pendant sa première grande réinvention (son métier, sa ville, sa femme, sa famille, jusqu’à son nom), il a également décidé de changer son passé. »
Cercas évoque De sang-froid de Truman Capote et L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, deux « chefs-d’œuvre » du « roman sans fiction » dont il juge le premier auteur atteint de « turpitude » pour avoir laissé espérer tout en souhaitant leur exécution les deux meurtriers condamnés à mort, et doute du procédé du second, présent à la première personne dans son récit peut-être pour se donner une légitimité morale fallacieuse.
Intéressantes questions du kitch du narcissique, et du mensonge (peut-il être légitime ? un roman est-il mensonge ?)
« Il y a deux mille quatre cents ans, Gorgias, cité par Plutarque, l’a dit de façon indépassable : “La poésie [c’est-à-dire, la fiction] est une tromperie où celui qui trompe est plus honnête que celui qui ne trompe pas et où celui qui se laisse tromper est plus sage que celui qui ne se laisse pas tromper.” »
En fait de déportation, Marco a été travailleur volontaire en Allemagne fin 1941, et emprisonné au bout de trois mois comme « volontaire communiste ». Revenu en Espagne, il a effectivement connu « les prisons franquistes, non comme prisonnier politique mais comme détenu de droit commun. » Il abandonne ses premiers femme et enfants, change de nom pour refaire sa vie (grand lecteur autodidacte, il suit des cours universitaires d’histoire) – et devenir le secrétaire général de la CNT, le syndicat anarchiste, puis président de l’Amicale de Mauthausen, l’association des anciens déportés espagnols. Il a toujours été un séducteur, un amuseur, un bouffon qui veut plus que tout qu’on l’aime et qu’on l’admire.
« …] de même, certaines qualités personnelles l’ont beaucoup aidé : ses dons exceptionnels d’orateur, son activisme frénétique, ses talents extraordinaires de comédien et son manque de convictions politiques sérieuses – en réalité, l’objectif principal de Marco était de faire la une et satisfaire ainsi sa médiapathie, son besoin d’être aimé et admiré et son désir d’être en toute occasion la vedette – de sorte qu’un jour il pouvait dire une chose et le lendemain son contraire, et surtout il pouvait dire aux uns et aux autres ce qu’ils voulaient entendre. »
« Le résultat du mélange d’une vérité et d’un mensonge est toujours un mensonge, sauf dans les romans où c’est une vérité. »
« Marco a fait un roman de sa vie. C’est pourquoi il nous paraît horrible : parce qu’il n’a pas accepté d’être ce qu’il était et qu’il a eu l’audace et l’insolence de s’inventer à coups de mensonges ; parce que les mensonges ne conviennent pas du tout à la vie, même s’ils conviennent très bien aux romans. Dans tous les romans, bien entendu, sauf dans un roman sans fiction ou dans un récit réel. Dans tous les livres, sauf dans celui-ci. »
Après la Transition de la dictature franquiste à la démocratie, la génération qui n’avait pas connu la guerre civile a plébiscité le concept de “mémoire historique”, qui devait reconnaître le statut des victimes.
« La démocratie espagnole s’est construite sur un grand mensonge, ou plutôt sur une longue série de petits mensonges individuels, parce que, et Marco le savait mieux que quiconque, dans la transition de la dictature à la démocratie, énormément de gens se sont construit un passé fictif, mentant sur le passé véritable ou le maquillant ou l’embellissant [… »
Cercas raconte ensuite comment l’historien Benito Bermejo a découvert l’imposture de Marco, alors devenu un héros national, et s’est résolu à la rendre publique (c’est loin d’être la seule du même genre). Marco tente depuis de se justifier par son réel travail de défense de la cause mémorielle. Cercas décrit ses rapports avec Marco partagé entre le désir d’être le personnage de son livre, et le dépit de ne pas pouvoir contrôler ce dernier.
« — S’il te plaît, laisse-moi quelque chose. »
Opiniâtre quant à la recherche de la vérité, outre ses pensées Cercas détaille son ressenti, qui va du dégoût initial à une certaine sympathie ; "donquichottesque", il pense même un temps à sauver Marco non pas en le réhabilitant, mais en le plaçant devant la vérité…
Manifestement basée sur une abondante documentation, cette étude approfondie, fouillée dans toutes ses ramifications tant historiques que psychologiques ou morales, évoque aussi le rôle de la fiction comme expression de la vérité.
\Mots-clés : #biographie #campsconcentration #devoirdememoire #ecriture #guerredespagne #historique #politique #psychologique #xxesiecle
- le Mar 17 Oct - 12:34
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Javier Cercas
- Réponses: 96
- Vues: 12465
Jorge Semprun
Le Mort qu’il faut
À Buchenwald, en décembre 1944, Semprun est déporté depuis un an comme résistant ; il a vingt ans. Il fréquente notamment le sociologue Maurice Halbwachs et le sinologue Henri Maspero, qui vont y mourir l’année suivante, et un jeune Français lui aussi « Musulman », c'est-à-dire « les invalides et les exclus, marginalisés par le despotisme productiviste du système de travail forcé ».
« Prendre sur soi pour sortir de soi, somme toute. »
« Malgré tous les subterfuges, les ruses et les détours, il y avait toujours trop peu de pain pour que j’en garde en mémoire. C’était fini, pas moyen de me souvenir. Il n’y avait jamais assez de pain pour que j’en « fasse de la mémoire », aurait-on dit en espagnol, hacer memoria. La faim revenait aussitôt, insidieuse, envahissante, comme une sourde pulsion nauséeuse.
On ne pouvait faire de la mémoire qu’avec des souvenirs. Avec de l’irréel, en somme, de l’imaginaire. »
Comme il appartient à l’Arbeitsstatistik du « camp de rééducation » (« C’est la marotte des dictatures, la rééducation ! ») devenu « un camp punitif, d’extermination par le travail forcé », Semprun est un temps « animateur culturel », et peut lire Absalon ! Absalon ! (Faulkner) pendant ses nuits de comptabilisation des mouvements des travailleurs. Ainsi que disent les rescapés des premières années du camp, Buchenwald est devenu un « sana » (la fin de la guerre approche, les Américains tiennent Bastogne)… Dans les latrines collectives, leur seul asile, Semprun discute de Dieu et du Mal avec « Lenoir », un Juif autrichien, et Otto, « un "triangle violet", un Bibelforscher, un témoin de Jéhovah ».
« Quoi qu’il en soit, Otto, jadis, dans l’arrière-salle de l’Arbeit, venait de m’exposer une notion cruciale de Schelling, selon laquelle nulle part l’ordre et la forme ne représentent quelque chose d’originaire : c’est une irrégularité initiale qui constitue le fond cosmologique et existentiel. »
« Les kapos rouges de Buchenwald évitaient le bâtiment des latrines du Petit Camp : cour des miracles, piscine de Bethsaïda, souk d’échanges de toute sorte. Ils détestaient la vapeur pestilentielle de « bain populaire », de « buanderie militaire », l’amas des corps décharnés, couverts d’ulcères, de hardes informes, les yeux exorbités dans les visages gris, ravinés par une souffrance abominable.
— Un jour, me disait Kaminsky, effaré d’apprendre que j’y descendais parfois, le dimanche, en allant voir Halbwachs au block 56, ou en revenant d’un entretien avec lui, un jour, ils se jetteront sur toi, en s’y mettant nombreux, pour te voler tes chaussures et ton caban de Prominent ! Qu’y cherches-tu, bon sang ?
Il n’y avait pas moyen de le lui faire entendre.
J’y cherchais justement ce qui l’effrayait, lui, ce qu’il craignait : le désordre vital, ubuesque, bouleversant et chaleureux, de la mort qui nous était échue en partage, dont le cheminement visible rendait ces épaves fraternelles. C’est nous-mêmes qui mourions d’épuisement et de chiasse dans cette pestilence. C’est là que l’on pouvait faire l’expérience de la mort d’autrui comme horizon personnel : être-avec-pour-la-mort, Mitsein zum Tode.
On peut comprendre, cependant, pourquoi les kapos rouges évitaient cette baraque.
C’était le seul endroit de Buchenwald qui échappât à leur pouvoir, que leur stratégie de résistance ne parviendrait jamais à investir. Le spectacle qui s’y donnait, en somme, était celui de leur échec toujours possible. Le spectacle de leur défaite toujours menaçante. Ils savaient bien que leur pouvoir restait fragile, par essence, exposé qu’il était aux caprices et aux volte-face imprévisibles de la politique globale de répression de Berlin.
Et les Musulmans étaient l’incarnation, pitoyable et pathétique, sans doute, mais insupportable, de cette défaite toujours à craindre. Ils montraient de façon éclatante que la victoire des SS n’était pas impossible. Les SS ne prétendaient-ils pas que nous n’étions que de la merde, des moins-que-rien, des sous-hommes ? La vue des Musulmans ne pouvait que les conforter dans cette idée.
Précisément pour cette raison, il était, en revanche, difficile de comprendre pourquoi les SS, eux aussi, évitaient les latrines du Petit Camp, au point d’en avoir fait, involontairement sans doute, un lieu d’asile et de liberté. Pourquoi les SS fuyaient-ils le spectacle qui aurait dû les réjouir et les réconforter, le spectacle de la déchéance de leurs ennemis ?
Aux latrines du Petit Camp de Buchenwald, ils auraient pu jouir du spectacle des sous-hommes dont ils avaient postulé l’existence pour justifier leur arrogance raciale et idéologique. Mais non, ils s’abstenaient d’y venir : paradoxalement, ce lieu de leur victoire possible était un lieu maudit. Comme si les SS – dans ce cas, ç’aurait été un ultime signal, une ultime lueur de leur humanité (indiscutable : une année à Buchenwald m’avait appris concrètement ce que Kant enseigne, que le Mal n’est pas l’inhumain, mais, bien au contraire, une expression radicale de l’humaine liberté) – comme si les SS avaient fermé les yeux devant le spectacle de leur propre victoire, devant l’image insoutenable du monde qu’ils prétendaient établir grâce au Reich millénaire. »
Des vers de Rimbaud, Valéry, Machado, Lorca et d’autres poètes, des passages de L’espoir de Malraux reviennent à Semprun.
Apparemment bien organisé, l’appareil de renseignement des communistes allemands au sein du camp (en la personne de « Kaminsky ») apprend qu’il est recherché par la Gestapo, et a trouvé un moribond qui correspond à son profil, dont il pourra endosser l’identité – l’homme en question est « le jeune Musulman français ». À ses cotés sur un châlit du Revier, l’infirmerie, il suit son agonie, médite la finitude humaine.
« Non, pas moi, François, je ne vais pas mourir. Pas cette nuit, en tout cas, je te le promets. Je vais survivre à cette nuit, je vais essayer de survivre à beaucoup d’autres nuits, pour me souvenir.
Sans doute, et je te demande pardon d’avance, il m’arrivera d’oublier. Je ne pourrai pas vivre tout le temps dans cette mémoire, François : tu sais bien que c’est une mémoire mortifère. Mais je reviendrai à ce souvenir, comme on revient à la vie. Paradoxalement, du moins à première vue, à courte vue, je reviendrai à ce souvenir, délibérément, aux moments où il me faudra reprendre pied, remettre en question le monde, et moi-même dans le monde, repartir, relancer l’envie de vivre épuisée par l’opaque insignifiance de la vie. Je reviendrai à ce souvenir de la maison des morts, du mouroir de Buchenwald, pour retrouver le goût de la vie. »
La mémoire, les douloureuses modalités du souvenir sont centrales dans cet ouvrage, avec la puissance de la littérature ; Semprun évoque aussi la vie quotidienne du camp : la promiscuité, les castes, la lutte pour la survie, la solidarité et ses limites – et les musiques, des chanteuses allemandes diffusées au jazz clandestin, en passant par les souvenirs de flamenco et la fanfare qui accompagne le départ au travail (voir https://expo-musique-camps-nazis.memorialdelashoah.org/). Impressionnant témoignage, qui complète Le Grand Voyage et L'Écriture ou la Vie. Étonnamment (pour moi), Semprun remet en question le travail des historiens sur la période : d’après lui, ils auront les coudées franches lorsque les derniers témoins se tairont à jamais…
\Mots-clés : #autobiographie #campsconcentration #deuxiemeguerre #historique #politique #temoignage #xxesiecle
- le Sam 9 Sep - 18:34
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jorge Semprun
- Réponses: 30
- Vues: 2676
Jonathan Coe
Le Cœur de l'Angleterre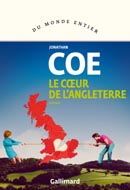
Troisième et dernier tome de la trilogie Les Enfants de Longbridge (paru bien après Bienvenue au club et Le Cercle fermé), sur la famille Trotter dans la seconde moitié du XXe, et ici au début du XXIe.
2010, le racisme est patent sous le couvert de la société multiculturelle épanouie. Août 2011 : émeutes et pillages de jeunes (la fracture est aussi générationnelle).
« On apercevait bien quelques émeutiers blancs et quelques policiers noirs, mais le face-à-face donnait l’impression écrasante d’un conflit racial. »
Le gouvernement considère qu’il s’agit de « débordements criminels, pas politiques ».
« Mais regardez plutôt comment ça a commencé. La police a abattu un Noir et refusé de communiquer avec sa famille sur les circonstances de sa mort. Une foule s’est rassemblée devant le commissariat pour protester et les choses ont tourné à l’aigre. Ce qui est en cause c’est le problème racial et les relations de pouvoir au sein de la communauté. Les gens se sentent victimes. On ne les écoute pas. »
Comme de coutume dans cette trilogie, Coe nous entraîne dans les arcanes de la politique (notamment grâce à Doug, journaliste positionné à gauche, qui semble porter l’opinion de Coe) ; mais on aborde aussi, avec le personnage de Sophie, le milieu universitaire, « cette manie de se polariser sur un sujet jusqu’à l’obsession en ignorant superbement le reste du monde », et celui de l’édition avec Philip et Benjamin.
Après la crise de 2008, David Cameron mène une politique d’austérité, et initie le référendum qui conduira au Brexit ; il recourt au nationalisme, mais la peur de l’immigration est prépondérante ; la désindustrialisation est passée par là. Et arrive Boris Johnson…
« Pourquoi est-ce que les journalistes aiment tant les questions hypothétiques ? Et qu’est-ce qui se passe si vous perdez ? Et qu’est-ce qui se passe si on quitte l’UE ? Qu’est-ce qui se passe si Donald Trump est élu président ? Vous vivez dans un monde imaginaire, vous autres. »
« Les gens vont voter comme ils votent toujours, c’est-à-dire avec leurs tripes. Cette campagne va se gagner avec des slogans, des accroches, à l’instinct et à l’émotion. Sans parler des préjugés [… »
Entretemps, Benjamin connaît un certain succès avec la publication du roman extrait de son énorme manuscrit, roman qui reprend son histoire avec Cicely (qui est partie seule en Australie soigner sa sclérose en plaques).
Côté social, le politiquement correct est présenté comme la cible de conservateurs âgés que rebutent la société multiculturelle ; en contrepoint est présenté le cas de Sophie, suspendue (et jetée en pâture aux réseaux sociaux) car (injustement) accusée de discrimination genrée par Coriandre, l’hargneuse fille de Doug.
Les retrouvailles de Benjamin et Charlie Chappell, clown pour goûters d’enfants en conflit avec son rival Duncan Field, sont l’occasion pour Coe de réitérer sa conception du destin :
« Benjamin comprenait qu’il voyait la vie comme une succession d’aléas qu’on ne pouvait ni prévenir ni maîtriser, si bien qu’il ne restait plus qu’à les accepter et tâcher d’en tirer parti autant que faire se pouvait. C’était une saine conception des choses mais qu’il n’avait jamais réussi à faire tout à fait sienne, pour sa part. »
C’est surtout la nostalgie et la désillusion qui percent dans cet après-Brexit, marqué par un exil en Europe pour quelques Trotter cherchant à échapper au passé.
\Mots-clés : #contemporain #famille #historique #nostalgie #politique #relationenfantparent #romanchoral #social #xxesiecle
- le Ven 25 Aoû - 17:27
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Jonathan Coe
- Réponses: 57
- Vues: 3185
Jonathan Coe
Le Cercle fermé
(En complément au commentaire approfondi de Pinky.)
1999 (livre paru en 2004), Claire revient d’Italie en Angleterre après cinq ans d’absence, et se confie par écrit à sa sœur Miriam, disparue (c’est la suite de Bienvenue au club, où les mêmes personnages vivaient dans les années soixante-dix). Le portable est devenu inévitable :
« …] quantité de gens qui ne travaillent plus, qui ne fabriquent rien, ne vendent rien. Comme si c’était démodé. Les gens se contentent de se voir et de parler. Et quand ils ne se voient pas pour parler directement, ils sont généralement occupés à parler au téléphone. Et de quoi ils parlent ? Ils prennent rendez-vous pour se voir. Mais je me pose la question : quand enfin ils se voient, de quoi ils parlent ? »
Nous savons depuis que lorsque les gens se voient, ils parlent à d’autres, sur leur portable.
Intéressante mise en parallèle des vies de couple de Benjamin et Doug, qui parviennent à se ménager une vie privée digne d’un célibataire – non sans une autre présence féminine, à laquelle ils ne savent guère faire face, incapables de prendre une décision.
« C’est là un défaut pathologique du sexe masculin. Nous n’avons aucune loyauté, aucun sens du foyer, aucun instinct qui nous pousserait à protéger le nid : tous ces réflexes naturels et sains qui sont inhérents aux femmes. On est des ratés. Un homme, c’est une femme ratée. C’est aussi simple que ça. »
Les profonds changements dans la communication sont particulièrement approfondis :
« Donc, d’après vous, si je comprends bien, disait Paul, le discours politique est devenu un genre de champ de bataille où politiciens et journalistes s’affrontent jour après jour sur le sens des mots.
— Oui, parce que les politiciens font tellement attention à ce qu’ils disent, les déclarations politiques sont devenues tellement neutres que c’est aux journalistes qu’il incombe de créer du sens à partir des mots qu’on leur donne. Ce qui compte aujourd’hui, ce n’est plus ce que vous dites, vous autres, c’est la manière dont c’est interprété. »
« C’est très moderne, l’ironie, assura-t-elle. Très in. Vous voyez, vous n’avez plus besoin d’expliciter ce que vous voulez dire. En fait, vous n’avez même pas besoin de penser ce que vous dites. C’est toute la beauté de la chose. »
« Il y a quelques mois, par exemple, ils ont pris des photos d’un top model particulièrement rachitique pour un article de mode du supplément dominical, mais elle avait l’air tellement squelettique et mal en point qu’ils ont renoncé à les utiliser. Et puis la semaine dernière ils ont fini par les déterrer pour illustrer un article sur l’anorexie psychosomatique. Visiblement, ça ne leur posait aucun problème. »
« Oh, de nos jours, tout dépend de la manière dont c’est présenté par les médias, pas vrai ? À croire que tout dépend de ça. »
Le Cercle fermé est créé au sein de la Commission travailliste réfléchissant au financement privé du secteur public (on est sous Tony Blair) ; l’extrême droite commence à monter.
Benjamin est un personnage central ; écrivain et musicien (assez raté), il reflète peut-être un aspect (ironique) du projet romanesque de Coe.
« Ce serait satisfaisant, d’une certaine façon ; il y aurait là un peu de la symétrie qu’il passait tant de temps à traquer en vain dans la vie, le sentiment d’un cercle qui se referme... »
« Je suis un homme, blanc, d’âge moyen, de classe moyenne, un pur produit des écoles privées et de Cambridge. Le monde n’en a pas marre des gens comme moi ? Est-ce que je n’appartiens pas à un groupe qui a fait son temps ? Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux fermer notre gueule et laisser la place aux autres ? Est-ce que je me fais des illusions en croyant que ce que j’écris est important ? Est-ce que je me contente de remuer les cendres de ma petite vie et d’en gonfler artificiellement la portée en plaquant dessus des bouts de politique ? »
Puis c’est le 11 septembre 2001, et l’approche de la « guerre à l’Irak ».
« La guerre n’avait pas encore commencé, mais tout le monde en parlait comme si elle était inévitable, et on était forcément pour ou contre. À vrai dire, presque tout le monde était contre, semblait-il, à part les Américains, Tony Blair, la plupart de ses ministres, la plupart de ses députés et les conservateurs. Sinon, tout le monde trouvait que c’était une très mauvaise idée, et on ne comprenait pas pourquoi on en parlait soudain comme si c’était inévitable. »
Le compte à rebours des chapitres souligne le suspense des drames personnels de la petite communauté quadragénaire immergée dans cette fresque historique.
\Mots-clés : #actualité #famille #historique #medias #politique #psychologique #relationdecouple #romanchoral #social #xxesiecle
- le Lun 21 Aoû - 13:08
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Jonathan Coe
- Réponses: 57
- Vues: 3185
Alaa al-Aswany
J'ai couru vers le Nil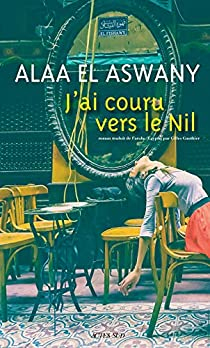
Dans le premier chapitre est racontée la journée ordinaire du général Ahmed Alouani, avec les invraisemblables arrangements moraux qui lui permettent de se considérer comme un bon musulman tout en torturant activement les opposants au régime (il appartient à « l’Organisation », apparemment au-dessus des services de sécurité étatiques, et même des ministres au gouvernement).
Suit un texte de démonstration de l’opportunité des amours ancillaires, parfaitement misogyne, rédigé par Achraf Ouissa, « acteur raté » et nanti copte marié à Magda, son « bourreau qui me torture depuis un quart de siècle ».
« Achraf Ouissa s’arrêta d’écrire et alluma une cigarette de haschich dont il garda la fumée dans la bouche pour renforcer l’effet de la drogue. Le sujet du livre lui apparaissait très clairement maintenant. Son premier chapitre s’intitulerait “Guide des jouissances dans la conjonction des servantes”. Le second, “Mémoires d’un âne heureux”. Quant au troisième, il le nommerait “Comment devenir un maquereau en cinq étapes”. »
Asma Zenati, qui refuse la société patriarcale et le port du voile (pas expressément prescrit par les textes religieux), s’adresse à Mazen, du mouvement Kifaya, à propos de son affrontement avec le directeur corrompu de l’école où elle enseigne.
« Parfois je voudrais être en accord avec la société plutôt que de l’affronter, mais je ne peux tout simplement pas être autre chose que moi-même. »
Le cheikh Chamel prêche le port du voile (emballage protecteur du fruit qu’est la femme) comme précepte obligatoire avec la prière et le jeûne chez Ahmed Alouani, tandis que ce dernier tente de raisonner sa fille Dania, qui s’insurge contre la torture policière. Son épouse, Hadja Tahani, le soutient en tout.
La pieuse présentatrice de télévision Nourhane se maria discrètement avec un de ses professeurs à la faculté de lettres, le docteur Hani el-Aassar puis, à la mort de ce dernier, avec Issam, le directeur de la cimenterie Bellini, un des anciens leaders marxistes des manifestations étudiantes de 1972, sous Sadate.
Dania est influencée par Khaled, son condisciple au Centre universitaire hospitalier du Caire.
« Nous prions et nous jeûnons pour notre propre éducation. L’islam n’est pas quelque chose de formel et de rituel, comme le croient les salafistes, et ce n’est pas non plus un moyen de s’emparer du pouvoir, comme le croient les frères [musulmans]. Si l’islam ne nous rend pas plus humains, il ne sert à rien, et nous non plus. »
Madani, le chauffeur d’Issam, se trouve être le père de Khaled, qui participe aux manifestations contre Hosni Moubarak, le président.
Mazen participe à la grève des ouvriers de la cimenterie, et devient un des quatre membres de la commission qui la dirige dorénavant.
Achraf est tombé amoureux de sa bonne, Akram (et réciproquement).
« En toute franchise, c’était d’abord ton corps qui me plaisait. Mon but c’était seulement le sexe. Ensuite, lorsque je t’ai connue, j’ai vu que tu étais bonne, et sensible, et digne. À ce moment-là, je t’ai aimée tout entière. »
« Les gens en Égypte héritent de leurs conditions et il leur est très difficile d’en changer. Même la religion, personne d’entre nous ne l’a choisie. »
Puis ce sont les manifestations populaires de la place Tahrir (2011).
« La place Tahrir était devenue une petite république indépendante – la première terre égyptienne libérée de la dictature. »
Pour le général Alouani (comme pour Issam l’ex-marxiste), le peuple égyptien est de tout temps peureux et servile, guère susceptible de se révolter pour des idéaux de liberté et de dignité, contre l’injustice et le pouvoir établi. Il s’agit donc pour les autorités d’un complot de traîtres (étrangers) à la nation. Les réseaux de communication sont coupés. Armée et police tirent sur les manifestants qui occupent la place ; les martyrs sont nombreux.
Asma se réfugie chez Achraf, qui habite sur la place Tahrir, et commence à se sentir concerné par ce qui se passe sous ses yeux.
À propos du père d’Asma, comptable besogneux et obséquieux :
« Peut-on dire que Zenati est hypocrite ? Par tact nous dirons qu’il sait très bien s’adapter aux circonstances. Il est comme des millions d’Égyptiens. Il ne dépense son énergie que pour les trois objectifs de sa vie : gagner son pain d’une façon licite, élever les enfants et gagner la protection de Dieu sur terre et dans l’au-delà. »
« Moubarak et ses hommes ont des milliards et, si le régime tombe, leurs fortunes seront confisquées et ils seront jugés. Ils sont prêts à tuer un million d’Égyptiens pour rester au pouvoir. »
Moubarak abdique, mais le régime existant persiste.
L’Organisation s’entend avec les frères musulmans pour qu’ils mobilisent « les gens contre l’établissement d’une nouvelle constitution ».
Ayant obtenu le droit de porter le hijab à l’antenne, Nourhane se plie avec complaisance à déformer les informations télévisées conformément aux ordres du régime, qui recrute des beltagui (voyous) et ouvre les prisons pour semer le désordre et terroriser les Égyptiens.
« Votre mission, en tant que professionnels des médias, est de penser à la place du peuple. »
Khaled est abattu.
Six témoignages sont présentés en note comme « la transcription littérale de déclarations faites à chaud par les victimes et les témoins des événements qu’ils décrivent ». Des manifestantes sont soumises à l’ignominieux « test de virginité » pratiqué par l’armée, dont les chars écrasent littéralement un cortège copte, qui protestait contre la destruction d’églises par des beltagui.
« Le pays appartient à l’armée. »
Achraf s’investit dans le soulèvement (et se révolte contre Magda). Il délaisse un peu le haschich tandis qu’Issam s’adonne de plus en plus au whisky alors que son usine est prise en main par les ouvriers.
Nourhane participe activement à la mobilisation médiatique qui désinforme la population, convainquant celle-ci que les jeunes de Tahrir sont grassement payés par l’étranger après des entraînements en Israël. Elle est devenue la directrice de la chaîne de télévision créée par son nouveau mari, le milliardaire Hadj Chanouani, escroc proche de la famille présidentielle, en entente avec le Conseil suprême des forces armées de facto au pouvoir.
À l’usine harcelée par les beltagui, les ouvriers déboutent la commission de Mazen, qui est emprisonné et torturé, mais ne cède pas. Lui et Asma se sont déclarés leur amour ; elle est arrêtée par l’armée, tabassée et violée ; puis elle fuit l’Égypte, convaincue que les Égyptiens préfèrent « une république comme si » (titre du livre en arabe) à la démocratie.
Tous les officiers meurtriers sont graciés, et Madani se venge sur celui qui tua Khaled.
Comme pour tout roman choral, la lecture de celui-ci est difficile au commencement, lorsque les différents intervenants sont présentés.
J’ai retrouvé beaucoup de l’Égypte que j’ai connue (au siècle précédent), les lieux où j’ai vécu une dizaine d’année et les gens que j’y ai côtoyés. Comme mon séjour, ce roman-documentaire me laisse dubitatif sur cette société profondément pieuse et policée, mais aussi inique et hypocrite.
L'auteur évoque ce livre : https://www.dailymotion.com/video/x794bm2
\Mots-clés : #historique #insurrection #politique #regimeautoritaire #religion #romanchoral #social
- le Ven 18 Aoû - 12:14
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Alaa al-Aswany
- Réponses: 35
- Vues: 6104
QIU Xiaolong
Il était une fois l'inspecteur Chen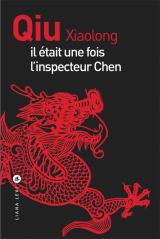
Dans son préambule, Qiu Xiaolong rappelle qu’au début de la Révolution culturelle, dans les années cinquante, la « critique révolutionnaire de masse des ennemis de classe » du peuple caractérisait la dictature du prolétariat, et raconte comme son propre père, considéré comme un capitaliste, fut alors victime des Gardes rouges (récit de dégradation impitoyable qui à lui seul vaut la lecture).
Le roman lui-même commence comme Chen Cao, étudiant juste après la fin de la Révolution culturelle (et encore dans l’ombre de sa famille « noire »), prépare un mémoire sur Eliot (comme Xiaolong) dans la bibliothèque de Pékin, où travaille la ravissante Ling. Puis il devient policier, un peu par hasard, et s’engage dans sa première enquête, qui le replonge dans son passé (et la cité de la Poussière Rouge à Shanghai). Cette enquête, qui réunit les principales caractéristiques des romans de Xiaolong (la société chinoise contemporaine, la cuisine et la poésie chinoises), est plus un support (presque un prétexte) à évoquer les séquelles de la Révolution culturelle et ses iniques aberrations discriminatoires. C’est certes un polar, mais aussi et peut-être surtout un témoignage, à la fois historique et personnel.
« Monsieur » Fu a été assassiné ; Chen se renseigne, notamment lors des « conversations du soir » au quartier. L’homme fut accusé de capitalisme pour avoir ouvert un petit commerce de fruits de mer avant la campagne d’éradication des « Quatre Vieilleries » (« Vieilles idées, vieille culture, vieilles coutumes et vieilles habitudes »), et sa femme mourut à cause des bijoux où le couple avait placé ses gains :
« « Ensuite, elle a dû rester debout dans la rue, un tableau noir autour du cou avec son nom barré au-dessus de la phrase : Pour ma résistance contre la Révolution culturelle, je mérite de mourir des milliers de morts. Plus tard dans la nuit, pendant son supplice, elle est tombée et s’est cogné la tête contre l’évier commun. Elle ne s’est jamais réveillée. »
Fu, qui était délaissé de tous y compris ses enfants, reçut de l’État une compensation financière pour ces spoliations (après la réforme du camarade Deng Xiaoping), qui le rendit riche. Il prit une bonne, Meihua, qui lui concoctait de bons petits plats.
Cette affaire résolue, plusieurs autres sont rapidement narrées, autant d’étapes dans la carrière de l’intègre inspecteur. Autant de nouvelles aussi, qui illustrent la corruption dans une société qui combat officiellement la décadence et l’indécence dans une politique hostile à l’étranger, aux intellectuels. Également des souvenirs de jeunesse de Xiaolong (sans surprise, grand appétit pour la gastronomie et les livres, notamment occidentaux et à l’index), avec son amitié pour Lu le Chinois d’outre-mer, devenu un de ses personnages récurrents.
Cet ouvrage constitue un prequel des enquêtes de l’inspecteur Chen publiées auparavant, narrant sa jeunesse en la rapprochant de l’histoire de son auteur et de son pays d'origine. Il peut difficilement être lu uniquement comme un polar, et je comprends qu’Armor ait été déçue à sa lecture.
\Mots-clés : #autobiographie #discrimination #ecriture #historique #polar #politique #regimeautoritaire #revolutionculturelle #temoignage
- le Sam 12 Aoû - 13:03
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: QIU Xiaolong
- Réponses: 25
- Vues: 2800
Philip Kerr
Une douce flamme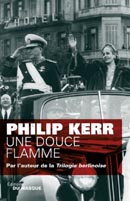
« Le navire était le SS Giovanni, ce qui semblait tout à fait approprié puisque trois au moins de ses passagers, moi y compris, avaient appartenu à la SS. »
Avec cet incipit, Bernhard (Bernie) Gunther, alias Doktor Carlos Hausner, nous apprend qu’il rejoint l’Argentine avec Herbert Kuhlmann et… Adolf Eichmann…
Nous sommes à Buenos Aires en 1950, et le roman s’y passe (ainsi qu’à Tucumán), mais aussi à Berlin en 1932, quand Gunther y vivait la chute de la République de Weimar avec son sergent Heinrich Grund. Ce dernier est alors un fervent partisan du parti national-socialiste, qui s’oppose au SPD, « Front de fer », le parti social-démocrate, et prend le pouvoir.
L’Argentine est le salut de nombre de « vieux camarades » dans l’après-guerre, quoique…
« À Buenos Aires, il vaut mieux tout savoir qu’en savoir trop »
Le Troisième Reich s’est effondré, mais ses rescapés survivent en exil et s’organisent sous le régime de Juan (et Evita) Perón, continuant à perpétrer leurs crimes, même s’ils ne sont plus de guerre.
« — Tous les journaux sont fascistes par nature, Bernie. Quel que soit le pays. Tous les rédacteurs en chef sont des dictateurs. Tout journalisme est autoritaire. Voilà pourquoi les gens s’en servent pour tapisser les cages à oiseaux. »
« Qu’est-ce que prétend Hitler ? demandai-je. Que la force réside non dans la défense mais dans l’attaque ? »
Gunther est recruté par le SIDE, les services de renseignement péronistes, et enquête sur la mort de jeunes adolescentes auxquelles on a enlevé l’appareil génital. Il rapproche ces crimes d’une affaire similaire non élucidée en 1932 ; il apparaît qu’ils furent perpétrés pour dissimuler des avortements ratés par des psychopathes ayant profité de l’aubaine constituée par le nazisme ; Bernie retrouvera notamment le Dr Hans Kammler (ingénieur responsable « de tous les grands projets de construction SS pendant la guerre », et Herr Doktor Mengele…
« Pour être un grand détective, il faut être aussi un protagoniste. Un personnage dynamique qui provoque les événements rien qu’en étant lui-même. Et je pense que vous appartenez à cette catégorie, Gunther. »
Il se confie aussi, bourrelé par sa mauvaise conscience, à Anna, son amante juive.
« Tous les Allemands portent en eux l’image d’Adolf Hitler, dis-je. Même ceux qui, comme moi, le haïssaient, lui et tout ce qu’il représentait. Ce visage, avec ses cheveux ébouriffés et sa moustache en timbre-poste, continue de nous hanter, aujourd’hui encore et à jamais, et, telle une douce flamme impossible à éteindre, brûle dans nos âmes. Les nazis parlaient d’un Reich de mille ans. Mais, parfois, je me dis qu’à cause de ce que nous avons fait, le nom de l’Allemagne et les Allemands sont couverts d’infamie pour mille ans. Qu’il faudra au reste du monde mille ans pour oublier. Vivrais-je un millier d’années que jamais je n’oublierais certaines des choses que j’ai vues. Et certaines de celles que j’ai commises. »
« J’en veux aux communistes d’avoir appelé en novembre 1932 à la grève générale qui a précipité la tenue d’élections. J’en veux à Hindenburg d’avoir été trop vieux pour se débarrasser de Hitler. J’en veux aux six millions de chômeurs – un tiers de la population active – d’avoir désiré un emploi à n’importe quel prix, même au prix d’Adolf Hitler. J’en veux à l’armée de ne pas avoir mis fin aux violences dans les rues pendant la République de Weimar et d’avoir soutenu Hitler en 1933. J’en veux aux Français. J’en veux à Schleicher. J’en veux aux Britanniques. J’en veux à Gœbbels et à tous ces hommes d’affaires bourrés de fric qui ont financé les nazis. J’en veux à Papen et à Rathenau, à Ebert et à Scheidemann, à Liebknecht et à Rosa Luxemburg. J’en veux aux spartakistes et aux Freikorps. J’en veux à la Grande Guerre d’avoir ôté toute valeur à la vie humaine. J’en veux à l’inflation, au Bauhaus, à Dada et à Max Reinhardt. J’en veux à Himmler, à Gœring, à Hitler et à la SS, à Weimar, aux putains et aux maquereaux. Mais, par-dessus tout, je m’en veux à moi-même. Je m’en veux de n’avoir rien fait. Ce qui est moins que ce que j’aurais dû faire. Ce qui est tout ce dont le nazisme avait besoin pour l’emporter. Je suis coupable, moi aussi. J’ai mis ma survie au-dessus de toute autre considération. C’est une évidence. Si j’étais vraiment innocent, je serais mort, Anna. Ce qui n’est pas le cas. »
« — Mon ange, s’il y a bien une chose qu’a montrée la dernière guerre, c’est que n’importe qui peut tuer n’importe qui. Tout ce qu’il faut, c’est un motif. Et une arme.
— Je n’y crois pas.
— Il n’y a pas de tueurs. Seulement des plombiers, des commerçants, et aussi des avocats. Chacun est parfaitement normal jusqu’à ce qu’il appuie sur la détente. Il n’en faut pas plus pour livrer une guerre. Des tas de gens ordinaires pour tuer des tas d’autres gens ordinaires. Rien de plus facile. »
Entr’autres lieux communs, on fera une petite virée au-dessus du Rio de la Plata avec des opposants de Perón, et on retrouvera même les ruines d’un camp d’extermination de Juifs dans la pampa, mais cette approche d’une Histoire si difficile à comprendre ne m’a pas paru vaine, même si elle peut sembler oiseuse, ou simpliste. Kerr donne quelques éclaircissements sur ses sources en fin d’ouvrage.
\Mots-clés : #antisémitisme #communautejuive #criminalite #culpabilité #deuxiemeguerre #exil #guerre #historique #politique #xxesiecle
- le Lun 31 Juil - 15:06
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Philip Kerr
- Réponses: 12
- Vues: 1241
Pascal Picq
Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les hommes politiques ou les robots
Dans son introduction à cet essai paru en 2017, Pascal Picq rappelle que les grands singes vont disparaître « d’ici 2050 », et annonce que les hommes pourraient faire de même.
« Si les grands singes se trouvent menacés par les hommes, et non pas l’inverse, en quoi intéressent-ils notre avenir immédiat ? Tout simplement parce que d’autres formes d’intelligence menacent, elles aussi, nos sociétés postindustrielles avec notamment l’arrivée massive des robots collaboratifs et l’intelligence artificielle forte. »
Prenant La Planète des singes de Pierre Boulle en référence, Picq avance que notre lignée de primates pourrait sombrer « dans la décadence d’une vie trop assistée » :
« …] les humains cessèrent d’être actifs, intellectuellement et physiquement. Devenus incapables de réagir, ils finirent par glisser d’un état d’esclavage volontaire à celui d’asservissement sous la férule des grands singes. »
« …] comment apprendre à vivre avec ces nouvelles intelligences artificielles pour assurer un futur meilleur à l’humanité ? Ma réponse d’éthologue et de paléoanthropologue est qu’il nous faut d’abord comprendre les intelligences naturelles qui accompagnent notre évolution, à savoir celles des singes et des grands singes. Si nous continuons à mépriser les intelligences les plus proches de nous dans la nature actuelle, comment imaginer une collaboration avec les nouvelles intelligences artificielles et les objets connectés ? Notre avenir avec les machines intelligentes ne pourra se construire qu’à cette condition. Sinon, nous serons les esclaves des robots. »
Puis l’auteur présente diverses espèces de singes, sans jamais vraiment perdre de vue l’Homo sapiens (ici en le comparant aux capucins dans les choix économiques) :
« Mais comment peut-on un seul instant attendre d’un individu, même humain, qu’il évalue le plus rationnellement possible ses choix et qu’il en mesure toutes les conséquences ? Comment croire, car il s’agit bien de croyance, que le marché, en admettant qu’il en existe une définition claire, se retrouve spontanément en situation d’équilibre ? À partir du moment où nous avons affaire à des individus différents les uns des autres, qui ont des intérêts plus ou moins conscients (plutôt moins que plus), des émotions et des intentions qui les traversent et les dépassent souvent, sans parler du fait qu’ils évoluent dans des groupes sociaux complexes et des environnements qui ne le sont pas moins, comment, donc, croire un seul instant en un idéal rationnel et équilibré ? Il en va de même pour la théorie des équilibres des marchés, c’est un non-sens évolutionniste. […] L’agent économique rationnel, égoïste et calculateur au mépris et au détriment d’autrui, n’est pas un produit de l’évolution, mais une invention des théories économiques. »
Ce texte est plein d’humour, ce qui ne va pas sans induire quelques équivoques ou confusions. Les rapprochements avec des hommes (et femmes) politiques, surtout français (mais pas que), directement nommés et contemporains (campagne présidentielle de 2017), est à la fois savoureux et désappointant (car peu explicité).
« Cela explique une énigme longtemps non résolue dans un groupe ancestral dans lequel les mâles se prévalaient d’un modèle de référence athlétique et blond qui faisait fureur alors que leur chef était petit, chétif et brun. »
Dans la seconde partie, Picq aborde le politique chez les chimpanzés.
« L’accès aux positions dominantes dans leurs systèmes hiérarchiques ne repose pas que sur la force, le sexe ou les liens de parenté : le pouvoir dépend des capacités des individus à constituer des coalitions et des alliances dans le but de monter dans la hiérarchie et de se maintenir par l’exercice du pouvoir, d’en avoir les privilèges et d’en assumer plus ou moins bien les obligations morales envers ses alliés et les autres. »
Picq renvoie au Prince de Machiavel, qui « peut se lire comme le premier traité d’éthologie politique humaine » et à Du rififi chez les chimpanzés, film de Pascal Picq et Nathalie Borgers, Doc en Stock/Arte, 1998, que je n’ai pas pu trouver (mais j’ai vu Les grands singes, qui passait sur ARTE jusqu’au 15 juin).
Il part des observations, notamment de Frans De Waal et lui-même (et d’autres comme Jane Goodall en Tanzanie, etc.), de la colonie de chimpanzés du zoo d’Arnhuem, en Hollande, et d’abord de la femelle dominante, Mama.
« Aucun mâle ne pouvait accéder au statut de dominant sans le soutien de Mama. Elle intervenait dans les conflits entre les mâles, bien plus puissants, en jouant des équilibres et surtout en œuvrant pour les réconciliations et les alliances. »
« Chaque soir, elle veillait à ce que toutes les familles et les clans aient rejoint leurs quartiers de nuit respectifs et, après un dernier tour pour vérifier que tout était en ordre, elle venait saluer l’animalier ou le chercheur responsable de la bonne exécution du mouvement avant de pénétrer dans sa loge. Traduction : « Je me suis chargée de la bonne marche des choses et, surtout, je suis la médiatrice du pouvoir des hommes envers les miens. » »
« Mama représentait le pouvoir des femelles et si ses intérêts passaient du mâle alpha à un prétendant, le pouvoir pouvait basculer. Évidemment, tout cela n’arriverait pas si les mâles se montraient stables et fidèles dans leurs alliances… »
Picq aborde aussi les bonobos, plus proches parents des chimpanzés avec nous-mêmes, au moins du point de vue des affinités sociales et comportementales (ressemblances éthologiques, dans la « classification phénotypique, car fondée sur des caractères adaptatifs sélectionnés arbitrairement », sinon sous l’angle des « relations phylogénétiques, ou de parenté, [qui] sont données par la systématique moléculaire et l’anatomie (ou classifications fondées sur les ressemblances à partir des caractères génétiques et anatomiques). »).
« Sans aucune exagération, les femelles bonobos apportent la démonstration que les archaïsmes machistes en politique sont relativement récents, même s’ils ont la peau dure. Car tout cela remonte à très loin. Chez les singes, les femelles restent généralement toute leur vie dans leur troupe natale et sur le même territoire. Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas d’inceste dans la nature, les mâles arrivés à maturité sexuelle quittent leur groupe pour se reproduire ailleurs (exogamie des mâles ; P. Picq et P. Brenot Le Sexe, l’Homme et l’Évolution, Odile Jacob, 2009). Mais, comme toujours, il y a des exceptions à la règle et on observe le cas de mâles dits « patrilocaux » et de femelles qui s’en vont à l’adolescence (femelles exogames). Ce sont justement les chimpanzés, les bonobos et les hommes. »
Les faits sont frappants, et leur exposition dénuée de tout anthropomorphisme (comme s’en défend Picq, en égratignant au passage les sciences humaines) : a même été observé le « meurtre politique », « meurtre prémédité »…
La prise du pouvoir et le maintien au pouvoir sont basés sur « un moyen de s’imposer aux autres avec ce que ne possèdent pas les autres (les bidons), auquel s’associe la perception des rivalités entre les clans. Tout l’imaginaire et la symbolique du pouvoir dans les sociétés humaines reposent sur de tels artifices, comme le pouvoir de droit divin, qui est bidon comme chacun sait, mais cela a pris des siècles et des siècles pour s’en apercevoir ». Cela explique les « fondamentalismes religieux qui, sous prétexte de contester les théories de l’évolution, œuvrent pour installer des théocraties, notamment aux États-Unis ».
« Tout candidat doit aller sur le terrain et prendre contact avec les électeurs. Chez les chimpanzés et tous les singes, dont l’homme, cela s’appelle l’épouillage.
Chez les chimpanzés, on connaît la chanson depuis fort longtemps. Un mâle voulant accéder au sommet de sa hiérarchie va s’évertuer dans un premier temps à s’assurer le soutien des femelles. Il usera parfois d’intimidation physique mais, le plus souvent, de relations aimables. Il les épouille, partage volontiers la nourriture et leur assure protection. Puis, il en fait de même avec les autres mâles, sans manquer de rassurer le mâle dominant. Une fois qu’il se croit assez sûr de la qualité de ses relations avec les femelles et les autres mâles, il commence à défier le mâle dominant.
L’épouillage entre singes est ainsi le principal moyen de se construire des alliances, avec le partage de la nourriture. Et c’est bien ce que font aussi nos candidats lorsqu’ils viennent dans des lieux publics, participent à des manifestations collectives ou se déplacent sur les places de marché. Le langage et le discours deviennent secondaires. Le plus important se trouve dans les attitudes, les mains serrées, les embrassades, les attouchements. Comme chez les chimpanzés. »
« Pour les primatologues, l’épouillage est l’ancêtre du langage par ses fonctions sociales et politiques. Mais ce n’est pas parce que le langage et les modes de communications ont évolué, de l’agora athénienne aux réseaux sociaux actuels, qu’il a perdu de son importance, bien au contraire. »
« Chez les chimpanzés, on trouve, comme chez les hommes, une acceptation sociale de la violence qui, si elle s’exacerbe, peut finir par se retourner contre les tyrans. Autre caractéristique de la politique et de la violence chez ces singes : leur propension à se faire la guerre. Les mâles apparentés d’une communauté peuvent former des coalitions dans le seul but de s’en prendre aux mâles de la communauté voisine, voire de les exterminer méthodiquement, sans oublier d’accaparer les femelles. »
« …] les chimpanzés nous offrent aussi un des facteurs les plus courants de la politique parmi les hommes, celui d’une menace extérieure qui incite les individus à accepter des formes plus ou moins coercitives de pouvoir contre une hypothétique protection. Les sociétés humaines, plus complexes, inventeront les castes de guerriers dont la justification repose sur la menace que font peser les guerriers d’à côté et qu’ils font eux-mêmes peser sur leurs voisins. Des chimpanzés aux lois liberticides du gouvernement Bush en passant par la guerre froide, l’existence d’une menace extérieure, concrète ou fictive, favorise l’acceptation d’une perte de liberté en échange d’une sécurité, réelle ou illusoire. On touche ici à la question fondamentale de la liberté et de la sécurité, du contrat social comme du Léviathan : concéder une part de liberté individuelle en échange de la sécurité. »
« Entre l’immoralisme pragmatique de Mandeville et le moralisme de la transparence absolue, comment faire de la politique ? Il devient impératif de rechercher de nouvelles formes de consentement au risque de ruiner nos démocraties, si ce n’est la démocratie. »
Dans la troisième partie, Picq expose ce qu’il appelle « le syndrome de la planète des singes » :
« des femmes et des hommes servis par des machines et des grands singes qui, sombrant dans le confort et la paresse physique et intellectuelle, passent du statut d’Homo sapiens à Homo consommatus. Actuellement, des dizaines de millions de personnes du monde occidentalisé ne lisent plus, ne marchent plus, ne réfléchissent plus. Elles se contentent de répondre aux flots des messages futiles des réseaux sociaux et aux stimuli des annonces commerciales. Les dernières études statistiques et épidémiologiques décrivent une baisse de l’espérance de vie comme du QI [… »
Il explique pourquoi la compréhension des (grands) singes nous serait utile aujourd’hui, surtout par rapport au travail (et au revenu universel) et aux droits.
« Notre espèce se distingue de toutes les autres par une capacité unique d’exploiter son prochain et les espèces proches. Le propre d’Homo sapiens semble bien être l’esclavagisme. Aussi loin que nous puissions remonter dans l’histoire de toutes les grandes civilisations, on rencontre des esclaves. Et il en est encore de même de nos jours, les consommateurs des pays riches feignant de ne pas comprendre que chaque centime d’euro gagné sur les produits qu’ils achètent, selon la logique délétère du prix le plus bas, et sous prétexte de sauver le pouvoir d’achat, se gagne sur le labeur et la misère de millions d’enfants, de femmes et d’hommes ailleurs dans le monde, tout en détruisant leurs propres emplois. »
Regard perspicace sur notre société, qui se transforme « à la vitesse du numérique » (cf. le changement d’environnement pour les singes).
« Nous voilà donc face à un immense paradoxe : nous n’avons jamais eu autant de revendications sur la réduction du temps de travail ou de son partage, alors que, chaque jour, nous effectuons de plus en plus de tâches qui, il n’y a pas si longtemps, étaient effectuées par des personnes ayant emplois et rémunérations. »
« Ce qui fait l’humain, c’est la distinction entre les causes immédiates et les causes ultimes. »
« Plus de deux siècles après les Lumières et après la fin des grandes idéologies du XXe siècle, nous savons que notre monde change à l’échelle mondiale. Se produit une révolution « invisible » ou « fluide » qui, pour l’heure, n’a pas de nom et ne répond à aucun projet énoncé, et encore moins annoncé. »
Picq souligne l’importance du ressenti d’iniquité suscité par les inégalités.
« Certes, la pauvreté a massivement reculé dans le monde, mais nos démocraties sont désormais malades de la bipolarisation entre des riches de plus en plus riches et une multitude grandissante de pauvres. Et nos systèmes politiques se montrent impuissants à résoudre ces problèmes socio-économiques. Alors les électeurs, fatigués, votent contre le consensus ou bien osent la différence. Il serait grand temps que nos partis politiques, y compris en France, comprennent le jeu de l’ultimatum : le peuple a désormais moins à perdre en osant la différence que tous les bénéficiaires de ces rentes partisanes de plus en plus fossilisées. Le jeu gagnant/gagnant à deux bosses de plus en plus inégales devient un jeu perdant/perdant quand celles et ceux qui gagnent peu par rapport à ceux qui gagnent beaucoup ressentent un profond sentiment d’iniquité. Dans cette optique, les débats et les décisions prises autour de la taxation ou non des heures supplémentaires et seulement pour quelques euros de plus sont tout simplement insultants. »
« Chez les singes les plus sociaux comme chez les hommes, la vie en société ne consiste pas à nier les différences, mais à faire en sorte qu’elles ne deviennent pas des inégalités, ce qui constitue une rupture du « consentement » cher à Claude Lévi-Strauss. Comme je l’ai dit plus haut, l’anthropologie culturelle a montré que les sociétés « consentent » aux privilèges de celles et ceux qui ont la responsabilité de diriger le groupe. Il s’agit d’un contrat social accepté en pleine conscience. Mais s’il y a rupture, cela conduit à une crise, souvent violente, avec le meurtre, réel ou symbolique, des leaders. On connaît de tels exemples chez les chimpanzés. Il n’y a que dans nos sociétés dites modernes, minées par les idéologies, que les dictateurs finissent dans leur lit (Staline, Mao, Castro) ou au terme d’un chaos dévastateur parce que les peuples n’ont pas osé ou pu s’en débarrasser assez tôt (Hitler, Mussolini, Ceausescu…). Cette question du consentement n’apparaît pas dans les débats actuels alors même que tout le monde a conscience que nous sommes au cœur d’une crise de gouvernance. »
« La tyrannie de l’immédiateté et de la réactivité fait qu’aujourd’hui la viralité des réseaux sociaux impose son désordre. Là aussi, quels changements en quelques années ! Il suffit de comparer l’usage des réseaux, et tout particulièrement de Twitter dans la campagne présidentielle de Barack Obama et dans celle de Donald Trump, sans oublier le récent Brexit. On se retrouve avec des pro-Brexit élus, mais sans programme, qui se défilent et un Président américain presque surpris de se retrouver à la Maison Blanche. Un nouveau terme sert désormais à décrire ce phénomène, celui de post-trust, ou « post-vérité ». Autrement dit, deux piliers fondamentaux de nos démocraties modernes, la politique et le journalisme, se retrouvent hors jeu. Big Brother est déjà dans nos poches et les paranoïas sécuritaires nous précipitent à la vitesse du numérique dans les rets d’une dictature digitale dont nous sommes les victimes actives et consentantes. Relisons vite La Servitude volontaire de La Boétie, car seule la culture sauvera l’humanité postmoderne. »
« Notre système politique et notre démocratie souffrent d’un profond problème de gouvernance entre l’usage de l’article 49-3, les sondages et les référendums. Nos sociétés ont sombré dans l’enfer des causes immédiates, sans plus aucun intérêt pour l’histoire et donc sans avenir. »
« Les mouvements religieux les plus fondamentalistes expriment de plus en plus leurs velléités réactionnaires, notamment aux États-Unis (évangélistes), en Turquie (islam fondamentaliste), en Russie (orthodoxie) et en Chine (confucianisme, mais qui n’est pas une religion au sens strict). De quoi s’inquiéter quand on sait que Vladimir Poutine, Recep Erdogan et Xi Jinping affirment des pouvoirs de plus en plus personnels et autoritaires. Attendons l’évolution de Donald Trump qui, pour l’heure, a inventé la plouto-gérontocratie, tandis que les autres consolident leurs « démocratures », ces régimes de moins en moins démocratiques mais dont la légitimité repose sur des élections démocratiques. »
Aucun programme politique en vue, et disparition déjà bien amorcée de la main-d’œuvre et du « cerveau-d’œuvre » : guère de perspective d’adaptation dans notre monde globalisé…
L’observation des singes est captivante, et le regard sur notre société est révélateur. Je comprends mieux les rapprochements que je fais depuis longtemps entre nos comportements et ceux d’autres animaux, et aussi pourquoi le "politique" me dégoûte !
\Mots-clés : #essai #politique
- le Ven 21 Juil - 12:05
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Pascal Picq
- Réponses: 18
- Vues: 2723
Romain Gary
Les Mangeurs d'étoiles
« Le vol fut agréablement dépourvu d'intérêt. C'était la première fois que le Dr Horwat s'aventurait sur un avion d'une ligne non américaine, et il était obligé de reconnaître que, pour peu qu'on les aidât, ces gens-là apprenaient vite. »
Dans cet incipit qui donne le ton, c’est un pasteur évangélique, prédicateur à succès, qui se rend à l’invitation du général José Almayo, lider maximo d’un petit pays sous-développé d'Amérique centrale, avec l’intention d’y combattre le Démon (« le Mal »).
« La Vérité n'était-elle pas un produit de première nécessité et fallait-il hésiter à utiliser les méthodes modernes pour assurer sa diffusion ? Certes, il n'était pas question de comparer la conquête des âmes à celle des marchés, mais il eût été aberrant que, dans un monde où la concurrence était impitoyable, Dieu se privât des conseils des experts passés maîtres dans le maniement des foules. »
Avec Charlie Kuhn, un illassable prospecteur de talents de music-hall, Mr John Sheldon, avocat s'occupant des intérêts d’Almayo aux États-Unis, un superman cubain (performeur porno), M. Antoine, un jongleur marseillais avide d’excellence, Agge Olsen, un ventriloque danois et son pantin, M. Manulesco, un pathétique violoniste classique prodige roumain qui joue sur la tête, déguisé en clown blanc, afin d’être reconnu pour son talent, la mère abêtie par les « étoiles » des drogues locales et la « fiancée » américaine (comprendre nord-américaine) du dictateur, ils vont être fusillés par le capitaine Garcia, afin de faire porter la responsabilité de leur mort aux insurgés d’une soudaine insurrection. Histrions d’un vrai cirque !
Otto Radetzky, aventurier cynique, ancien nazi et conseiller militaire du dictateur, est presque parvenu à comprendre ce dernier, un Indien « cujon » avec un peu de sang espagnol, ancien élève des Jésuites qui, soutenu par un gros corrompu, tenta de devenir torero, et pense avoir trouvé comment favoriser sa chance, protección qu’il croit allouée par le Diable, le vrai Maître du monde, El Señor par euphémisme.
« Radetzky avait connu quelques-uns des plus grands aventuriers de son temps : leur foi profonde dans la puissance du mal et dans la violence l'avait toujours beaucoup amusé. Il fallait une bonne dose de naïveté pour imaginer que les massacres, la cruauté et le « pouvoir » pouvaient vous mener quelque part. Au fond, ils étaient des croyants et manquaient totalement de scepticisme. »
« Dieu est bon, dit-il [Almayo], le monde est mauvais. Le gouvernement, les politiciens, les soldats, les riches, ceux qui possèdent la terre sont des... fientas. Dieu n'a rien à voir avec eux. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe d'eux, qui est leur patron. Dieu est seulement au paradis. La terre, c'est pas à Lui. »
La progression d’Almayo est retracée depuis son enfance, avec ses efforts incessants pour être élu par le Mal.
« Quand on est né indien, si on veut en sortir, il faut le talent, ou il faut se battre. Il faut être torero, boxeur ou pistolero. Sinon, on n'arrive nulle part. Ils ne vous laissent pas passer. Vous n'avez aucune chance de vous frayer un chemin. Tout est fermé, pas moyen de passer. Ils gardent tout ça pour eux-mêmes. Ils se sont arrangés entre eux. Mais si on a le talent, même si on n'est qu'un Cujon, ils vous laissent passer. Ça leur est égal, parce qu'il n'y en a qu'un sur des millions, et puis ils vous prennent en main, et ça leur rapporte. Ils vous laissent passer, ils vous laissent monter, vous pouvez avoir toutes les bonnes choses. Même leurs femmes, elles ouvrent les cuisses, et on peut vivre comme un roi. Seulement, il faut avoir le talent. Sans ça, ils vous laissent pourrir dans votre merde d'Indien. Il n'y a rien à faire. J'ai ça en moi, je le sais. Le talent, je l'ai, je le sens là, dans mes cojones... »
Entre le ressentiment d’une misère séculaire et l’éducation catholique inculquée par les frates de l’Inquisition venus avec les conquistadores, les Indiens, qui regrettent leurs anciens dieux sanguinaires, se tournèrent vers le Diable. La « señora Almayo » à l’évangéliste :
« En fait, tout était mal, il n'y avait de bien que la résignation, la soumission, l'acceptation silencieuse de leur sort et la prière pour le repos de l'âme de leurs enfants morts de sous-alimentation ou d'absence totale d'hygiène, de médecins ou de médicaments. Tout ce qu'ils avaient envie de faire, les Indiens : forniquer, travailler un peu moins, tuer leurs maîtres et leur prendre la terre, tout cela était très mauvais, non ? Le Diable rôdait derrière ces idées, on leur expliquait ça sans arrêt. Alors, il y en a qui ont fini par comprendre et qui se sont mis à croire très sérieusement au Diable, comme vous le leur conseillez. »
« …] les bons hériteront le ciel, et les méchants hériteront la terre. »
Almayo est fasciné par les saltimbanques et charlatans, dans l’espoir que l’un d’eux lui permettra par son talent d’accéder au pouvoir : il acquiert dès que possible la boîte de nuit El Señor.
« Il fallait être prudent avec ces Indiens primitifs et superstitieux. Ils étaient tous croyants. Seulement, on leur avait pris leurs dieux anciens, et le nouveau Dieu qu'on leur avait enfoncé dans la gorge à coups de fouet et de massacres, ils ne le comprenaient pas. On leur avait dit que c'était un Dieu de bonté, de générosité et de pitié, mais pourtant ils continuaient à crever dans la faim, l'ordure et la servitude malgré toutes leurs prières. Ils gardaient donc la nostalgie de leurs dieux anciens, un besoin profond et douloureux de quelque manifestation surnaturelle, ce qui faisait d'eux le meilleur public du monde, le plus facile à impressionner et le plus crédule. Dans toute l'Amérique centrale et en Amérique du Sud, il s'était toujours efforcé de choisir un Indien comme sujet. Pour un hypnotiseur, ils étaient vraiment du pain bénit. »
Les hommes de pouvoir sud-américains inspirent Almayo : Batista, Trujillo, Jimenez, Duvalier (Hitler est aussi un modèle fort inspirant).
« Il continuait à se rendre de temps en temps dans le petit magasin d'archives historiques derrière la place du Libérateur, pour nourrir ses yeux respectueux et graves de documents photographiques, portraits de toutes les grandes figures nationales, politiciens, généraux, qui s'étaient rendus célèbres par leur cruauté et leur avidité, et qui avaient réussi. Il était décidé à devenir un grand homme. »
Les communistes confortent Almayo dans sa conviction :
« Il se mit à prêter une grande attention à la propagande anti-yankee qui déferlait sur le pays et commença à être vivement impressionné par les États-Unis. Il s'arrêtait toujours pour écouter les agitateurs politiques sur les marchés, qui expliquaient aux Indiens combien il était puéril et stupide de croire que le Diable avait des cornes et des pieds fourchus : non, il conduisait une Cadillac, fumait le cigare, c'était un gros homme d'affaires américain, un impérialiste qui possédait la terre même sur laquelle les paysans trimaient, et qui essayait toujours d'acheter à coups de dollars l'âme et la conscience des gens, leur sueur et leur sang, comme l'American Fruit Company qui avait le monopole des bananes dans le pays et les achetait pour rien. »
Sa liaison avec une Américaine relativement cultivée, membre du Peace Corps de Kennedy, lui est opportune pour asseoir son ascension sociale. La jeune idéaliste est transportée par son aspiration à participer au progrès social du pays. Empêtrée dans ses troubles psychologiques, elle s’adonne progressivement à l’alcool, passe même par l’héroïne ; aveuglée par sa conception d’une moralité différente selon les pays, elle admet le maintien des « mangeurs d’étoiles », cette culture qui soulagerait les misères populaires et enrichit son trafiquant de compagnon, quant à lui fourvoyé dans sa vision faustienne du monde, ce « déversoir des surplus américains ».
« Il avait besoin d'elle et lorsque vous trouvez enfin quelqu'un qui a besoin de vous, une bonne partie de vos problèmes sont résolus. Vous cessez d'être aliénée... d'errer à la recherche d'une identité, d'une place dans le monde, d'un but qui vous permettrait de vous libérer de vous-même, de choisir, de vous engager...
– Vous pouvez enfin vous justifier... C'était très important pour moi. »
Elle rêve d’épouser enfin Almayo, quoique assumant, à cause de l'antiaméricanisme de rigueur, de n’être qu’une de ses maîtresses (sans compter les dernières starlettes du « firmament de Hollywood » qu’il couvre d’étincelants bijoux) tandis qu’il devient l’homme fort du pays – lui qui craint son influence bénéfique de « propre » sainte destinée au Paradis. Elle le décide à installer un réseau téléphonique moderne, un grand Centre culturel et une nouvelle Université dans ce pays d’une insondable misère, « où quatre-vingt-quinze pour cent de la population ne savaient pas lire ».
« Elle avait toujours cru que l'art et l'architecture, la grande musique aussi pouvaient transformer radicalement les conditions de vie d'un peuple. Dès que de grands ensembles architecturaux conçus par des hommes comme Niemeyer couvriraient le pays, la solution des problèmes sociaux et économiques suivrait automatiquement comme une sorte de sous-produit de la beauté. »
Il y a bien sûr des soubresauts populaires malgré la grande "popularité" du despote, comme lorsqu’il doit condamner le ministre de l'Éducation pour détournement de l’aide nord-américaine afin de construire la nouvelle Université et la Maison de la Culture :
« Le ministre fut condamné à mort pour sabotage et détournement de fonds, mais, sur l'intervention de l'Alliance des États interaméricains, il ne fut pas fusillé mais simplement envoyé comme ambassadeur à Paris. »
Le pantin d’Agge Olsen, à propos de « l'illusion du pouvoir surnaturel » :
« Personne n'a encore jamais réussi à vendre son âme, mon bon monsieur. Il n'y a pas preneur. […]
Car la vérité sur l'affaire Faust et sur nous tous, qui nous donnons tant de mal et qui faisons, si je puis dire, des pieds et des mains pour trouver preneur, c'est qu'il n'y a hélas ! pas de Diable pour acheter notre âme... Rien que des charlatans. Une succession d'escrocs, d'imposteurs, de combinards, de tricheurs et de petits margoulins. Ils promettent, ils promettent toujours, mais ils ne livrent jamais. Il n'y a pas de vrai et de grand talent auquel on pourrait s'adresser. Il n'y a pas d'acheteur pour notre pauvre petite camelote. Pas de suprême talent, pas de maîtrise absolue. C'est là toute ma tragédie en tant qu'artiste, mon bon monsieur, et cela brise mon petit cœur. »
Le castriste Rafael Gomez, provocateur manipulé par Almayo, se retourne contre lui et le chasse du pouvoir. Le Cujon et son « cabinet d'ombres » (dont Radetzky) se réfugient à l’ambassade d’Uruguay, et c’est une nouvelle scène de guignol. Ils prennent la fuite en emmenant la fille de l’ambassadeur en otage.
« Une révolution qui hésite devant le sang des femmes et des enfants est vouée à l'échec. C'est une révolution qui manque d'idéal. »
« Depuis qu'ils avaient quitté l'ambassade, elle n'avait pas manifesté la moindre trace d'inquiétude et avait conservé cet air d'indifférence un peu hautaine qui n'était peut-être que l'effet de sa beauté. […]
Il n'y avait pas de mystère, et c'était bien pour cela que les hommes se contentaient de beauté. »
Radetzky se révèle être un journaliste suédois infiltré pour enquêter sur Almayo (un des nombreux personnages à peine esquissés par Gary, comme le mystérieux Jack).
Descendant de bandits des montagnes, Garcia n’a pas exécuté les otages, et les a emmenés dans la Sierra, escomptant négocier son exfiltration. Bien sûr les deux groupes se rencontrent, ce qui occasionne une cascade de rebondissements.
« Car, après tout, il n'existait pas d'autre authenticité accessible à l'homme que de mimer jusqu'au bout son rôle et de demeurer fidèle jusqu'à la mort à la comédie et au personnage qu'il avait choisis. C'est ainsi que les hommes faisaient l'Histoire, leur seule authenticité véritable et posthume. »
« Les généraux à la peau noire ou jaune dans leurs blindés, dans leurs palais ou derrière leurs mitrailleuses, allaient suivre pendant longtemps encore la leçon que leurs maîtres leur avaient apprise. Du Congo au Vietnam, ils allaient continuer fidèlement les rites les plus obscurs des civilisés : pendre, torturer et opprimer au nom de la liberté, du progrès et de la foi. Il fallait bien autre chose que l'« indépendance » pour tirer les « primitifs » des pattes des colonisateurs. »
Cette analyse des ressorts du despotisme et de ses dérives, assurément basée sur les observations d’un Gary bien placé pour les faire, est marquée d’un regard qu’on pourrait juger réactionnaire de nos jours ; mais j’y ai trouvé des vues pertinentes, si je me base sur ce que je sais des dictateurs (rencontrés dans la littérature) et des sphères du pouvoir (surtout en Afrique). Cette approche est à contre-courant du mouvement actuel d’adulation un peu béate de tout ce qui est autochtone, rejetant peut-être un peu trop vite toute idée de superstition obscurantiste. Le rôle prépondérant des États-Unis, vus d’une part comme puissant empire du Mal et de l’autre comme dispensateur d’une importante aide financière (détournée), également marché pour l'écoulement de la drogue, me paraît bien exposé.
Cette farce tragi-comique, assez cinématographique, est malheureusement desservie par des longueurs et redites, et des lourdeurs de traduction mal relue. Me reste à lire le deuxième tome de La Comédie américaine, Adieu Gary Cooper.
\Mots-clés : #amérindiens #discrimination #misere #politique #portrait #regimeautoritaire #religion #social
- le Dim 4 Juin - 14:06
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Romain Gary
- Réponses: 111
- Vues: 9663
Hubert Haddad
Palestine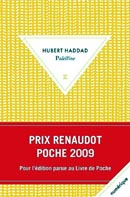
Par un concours de circonstances imprévues, un soldat israélien est capturé par un commando palestinien à l’insu de Tsahal et survit (et en prime il a perdu la mémoire). Il est recueilli par Asmahane, une aveugle, et sa fille Falastìn ; il ressemble au fils et frère disparu, et elles le font passer pour lui.
Devenu Nessim, il erre dans Hébron et alentour, vivant l’abjecte oppression israélienne, ce qui donne un panorama assez approfondi de la condition palestinienne, avec des points de vue arabes mais aussi juifs (et un rejet assez consensuel des « internationaux »). Une étrange attirance mutuelle lie Nessim et Falastìn. Recueilli dans une faction combattante, grâce à un passeport israélien (le sien !) Nessim-Cham se rend à Jérusalem, où il est muni d’une ceinture explosive.
« Tu détisses chaque nuit le temps passé pour garder l’âge de ton amour, tu es comme la reine qui défait son métier. Personne ne reviendra, mais tu restes pareille à ton souvenir. Tes yeux usés de larmes ne voient plus que l’image ancienne… »
« Dans la lumière verticale, les champs d’oliviers ont un tremblement argenté évoquant une source répandue à l’infini. L’ombre manque à midi, sauf sous les arbres séculaires aux petites feuilles d’émeraude et d’argent, innombrables clochettes de lumière au vent soudain et qui tamisent le soleil mieux qu’une ombrelle de lin. À l’est d’Hébron, du côté des colonies et au sommet des collines, ils ont presque tous été arrachés, par milliers, mis en pièces ou confisqués, sous prétexte d’expropriation, de travaux, de châtiment. »
« C’est écrit, ma fille. L’occupant se retirera dans un proche avenir pour ne pas être occupé à son tour. Simple question de démographie. »
Ayant un peu fréquenté Israël, Cisjordanie et bande de Gaza, j’ai retrouvé dans ce livre cette Histoire en marche de nos jours, une colonisation qui ne cache même pas son nom. Et le destin de Nessim-Cham souligne peut-être le déchirement de peuples pourtant si proches, où la répression humiliante mène à la haine qui conduit aux pires extrémités.
\Mots-clés : #actualité #colonisation #conflitisraelopalestinien #contemporain #guerre #politique #segregation #terrorisme #violence #xxesiecle
- le Ven 26 Mai - 12:48
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 20
- Vues: 923
Leonardo Sciascia
Les Paroisses de Regalpetra
Dans son Avertissement, Sciascia donne la chronique de cette petite ville fictive qui ressemble à celle de ses origines, Racalmuto, comme à nombre d’autres en Sicile : pressurisation des paysans et les mineurs (soufre, sel), les braccianti, depuis les comtes du XVIIe jusqu’au fascisme, excluant uniquement les fonctionnaires des Bourbons.
Dans Brève chronique d’un régime, c’est l’enfance du narrateur (Sciascia) sous le fascisme.
« À l’exception de quelques petites invectives, je n’entendais dire que du bien de Mussolini et du fascisme. »
En grandissant, s’épuise l’évidence du fascisme et de son embrigadement, de ses guerres en Éthiopie et en Espagne.
« C’est ça, la dictature : un soupçon venimeux, un réseau de trahisons et de tromperies humaines. »
Compte rendu édifiant instructif du Cercle de la Concorde, celui des galantuomini (mais malheureusement il faudrait bien connaître l’histoire et la politique italiennes pour le savourer en détail). Puis Sciascia est instituteur au bourg, avec des élèves affamés, sans autre perspective que la faim ou l’émigration, dont il désigne chaque jour les heureux bénéficiaires de la cantine.
« Si je m’habitue à cette anatomie quotidienne de misère, d’instincts, à ce cruel rapport humain, si je commence à la voir dans sa nécessité et sa fatalité, comme d’un corps qui est ainsi fait et qui ne peut pas être différent, j’aurai perdu ce sentiment, d’espoir et d’autre chose, qui est, je crois, ce que j’ai de meilleur en moi. »
Les ouvriers sauniers : passage qui vaut document sur leur misérable condition.
Journal d’une campagne électorale : celle de 1955, avec une multitude de partis dans une curieuse démocratie, très « pirandellienne ».
La neige, Noël : le froid ajoute à la pauvreté.
« Moi, le jour de Noël, j’ai joué avec mes cousins et mes camarades. J’avais gagné deux cents lires et quand je suis rentré, mon père me les a prises et c’est lui qui s’en est allé s’amuser. »
Sont marquants les ascendants des prêtres et de la mafia ; j'ai été surpris du renoncement impuissant de Sciascia instituteur.
\Mots-clés : #biographie #corruption #historique #misere #politique #ruralité #xxesiecle
- le Mer 17 Mai - 12:40
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Leonardo Sciascia
- Réponses: 14
- Vues: 2235
Philippe Descola
La Composition des mondes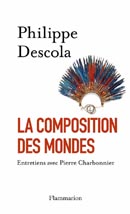
Philippe Descola est pour le moins un digne continuateur de l’œuvre de Lévi-Strauss, et même si je connais peu son travail à ce jour, j’ai apprécié notamment Les lances du crépuscule (je peux vous baller un monceau de citations sur simple demande). Ces entretiens avec Pierre Charbonnier permettent d’aborder l’œuvre et l’homme de biais, aussi introduire à l’ethnographie (cet intérêt pour l’autre) contemporaine. (Dans le même esprit, on peut écouter actuellement https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/a-voix-nue/le-gout-des-autres-4725026, 5 x 28').
Étudiant engagé, Descola se tourne vers la philosophie, puis l’ethnologie.
« Au contraire du mythe populiste qui fait de la « génération 68 » des jouisseurs épris de facilité, beaucoup d’entre nous étions stimulés par la nécessité un peu grandiloquente de manifester une intelligence à la hauteur des circonstances. »
Choix de l’Amazonie comme terrain d’étude, avec Claude Lévi-Strauss comme directeur de thèse.
« C’est bien là que résidait le mystère à percer : ces tribus en apparence totalement anomiques, sans cesse traversées par des conflits sanglants, continuaient pourtant à manifester une très grande résilience malgré quatre siècles de massacres, de spoliations territoriales et d’effondrement démographique provoqué par les maladies infectieuses. Où était leur ressort ? Comment définir ce qui, chez elles, faisait société ? »
Aussi une conscience écologique, c'est-à-dire du rapport à la nature, qui n’était pas courante dans les années 70. Évidemment marqué par le creuset de l’ethnologie américaniste,
« …] prendre les sociétés indigènes d’Amérique du Sud comme une totalité à multiples facettes et non comme réparties entre des blocs géographiques et culturels intrinsèquement différents. »
… et le structuralisme anthropologique,
« …] l’idée d’une combinatoire rendant compte de tous les états d’un ensemble par les différences systématiques qui opposent ses éléments. »
Rôle majeur du Laboratoire d’anthropologie sociale,
« Le choix même du terme « laboratoire », inusité à l’époque dans les sciences sociales, signalait déjà la volonté de placer la recherche en anthropologie sur un pied d’égalité avec les sciences expérimentales, en mettant l’accent autant sur l’enquête de terrain que sur ce qui vaut expérimentation dans notre discipline, à savoir l’élaboration de modèles susceptibles être comparés. Si l’ethnographie est une démarche nécessairement individuelle, l’ethnologie et l’anthropologie supposent en revanche non pas tant un travail collectif que l’existence d’un collectif de chercheurs, réunis avec leurs diverses compétences ethnographiques dans un lieu où ils peuvent échanger jour après jour informations, hypothèses et appréciations critiques, et disposant en outre de l’ample documentation et des systèmes modernes de traitement des données indispensables à leur entreprise. »
… création de Lévi-Strauss.
« Il a toujours encouragé l’originalité chez ceux qui le côtoyaient et découragé les tentatives de faire la même chose que lui. De ce point de vue, la seule exigence qui comptait était celle que l’on s’imposait à soi-même afin d’être digne de celle qu’il s’imposait à lui-même. Pour ma part, et cela depuis ce premier exposé dans son séminaire qui a été publié par la suite dans L’Homme, j’ai toujours écrit pour Lévi-Strauss. On écrit souvent en ayant un lecteur à l’esprit, et le lecteur que je me suis choisi dès l’origine, c’est lui. En effet, outre ses compétences et son savoir d’anthropologue, outre son imagination théorique et son jugement acéré, outre sa familiarité avec les problèmes philosophiques et son talent d’écrivain, Lévi-Strauss avait une grande connaissance de la nature – de la botanique, de la zoologie, de l’écologie – et il avait prêté une attention toute particulière à la façon dont l’esprit exploite les qualités qu’il perçoit dans les objets naturels pour en faire la matière de constructions symboliques complexes et parfois très poétiques. J’éprouvais ainsi une affinité profonde avec sa pensée, et c’est l’une des raisons qui expliquent ce choix de le considérer comme un lecteur idéal de mon travail. »
Rôle important également de Françoise Héritier qui lui fait briguer le Collège de France.
« Au fond, je poursuis l’entreprise que j’avais amorcée à l’École des hautes études, qui est d’explorer des domaines nouveaux, et donc de ne jamais enseigner les choses que je sais déjà, mais plutôt des choses que je suis en train de découvrir ou d’apprendre à connaître. »
À propos de son approche dans sa monographie sur les Achuars :
« Pourtant, en proscrivant toute référence ouverte à sa subjectivité, l’ethnologue se condamne à laisser dans l’ombre ce qui fait la particularité de sa démarche au sein des sciences humaines, un savoir fondé sur la relation personnelle et continue d’un individu singulier avec d’autres individus singuliers, savoir issu d’un concours de circonstances à chaque fois différent, et qui n’est donc strictement comparable à aucun autre, pas même à celui forgé par ses prédécesseurs au contact de la même population. »
Un résumé de son ouvrage anthropologique, Par-delà nature et culture :
« Peut-être faut-il rappeler le point de départ de cet exercice d’ontologie structurale. C’est l’expérience de pensée d’un sujet : je ne peux détecter des qualités dans un autre indéterminé, humain ou non humain, qu’à la condition de pouvoir y reconnaître celles au moyen desquelles je m’appréhende moi-même. Or, celles-ci relèvent à la fois du plan de l’intériorité – états mentaux, intentionnalité, réflexivité… – et du plan de la physicalité – états et processus physiques, schèmes sensori-moteurs, sentiment interne du corps… Le noyau originaire est donc un invariant hypothétique, le rapport entre intériorité et physicalité, dont j’étudie les combinaisons possibles. Elles sont au nombre de quatre : ou bien les non-humains ont une intériorité de même type que la mienne, mais se distinguent de moi, et entre eux, par leurs capacités physiques, c’est ce que j’appelle l’animisme ; ou bien au contraire ils subissent le même genre de déterminations physiques que celles dont je fais l’expérience, mais ils n’ont pas d’intériorité, et c’est le naturalisme ; ou bien encore des humains et des non-humains partagent le même groupe de qualités physiques et morales, tout en se différenciant ainsi par paquets d’autres ensembles d’humains et de non-humains qui ont d’autres qualités physiques et morales en commun, et cela correspond au totémisme ; ou bien enfin chaque existant se démarque du reste par la combinaison propre de ses qualités physiques et morales qu’il faut alors pouvoir relier à celles des autres par des rapports de correspondance, et j’ai baptisé cela du nom d’analogisme. »
Du terrain à la théorie :
« Si l’on n’est pas soi-même passé par l’expérience ethnographique, si l’on ne sait pas de quoi sont faites les briques constitutives que l’on va chercher dans la littérature ethnographique afin de bricoler des modèles anthropologiques, l’on aura toute chance de ne pas prendre les bonnes briques ou de ne pas prendre ces premiers éléments pour ce qu’ils sont. Et c’est aussi en ce sens que le terrain est fondamental, parce qu’il nous donne une appréhension plus juste des conditions sous lesquelles est produit le savoir ethnographique que nous utilisons pour construire nos théories anthropologiques. »
Les plantes cultivées sont considérées comme de même filiation que les Achuars, et le gibier comme des parents par alliance. Dans La Nature domestique, l’ambition de Descola « était de mettre sur le même plan les systèmes techniques de construction et d’usage du milieu et les systèmes d’idées qui informaient ces pratiques. » C’est « l’étude d’un système d’interaction localisé dans lequel dimensions matérielles et dimensions idéelles sont étroitement mêlées » qui constate « l’usage de catégories sociales – en l’occurrence, la consanguinité et l’affinité – pour penser le rapport aux objets naturels. » Descola reprend le terme d’animisme pour désigner ce schème.
Le retour du terrain :
« Ainsi, lorsque l’on a passé plusieurs années avec très peu de biens matériels et que l’on s’est aperçu que, au fond, on n’en avait pas réellement besoin, on se trouve tout à fait décalé vis-à-vis de la surabondance d’artefacts et la valeur centrale accordée à la richesse. Manger au moins une fois par jour, dormir à l’abri de la pluie, une rivière à l’eau claire pour se laver deviennent le maximum auquel on aspire, de sorte que l’on se trouve sans repères lorsque l’on revient au sein d’un monde englué dans les objets. […] Et l’on ne peut manquer, dans ce genre de situations, d’être frappé par la pertinence des analyses que Marx consacre à ce qu’il appelle le « fétichisme de la marchandise » : pour lui, le capitalisme se caractérise par le fait que les relations entre les êtres sont médiatisées par des marchandises, et que l’on finit par leur accorder plus de réalité qu’au monde social et moral. »
Puis Descola explique comment il a pu généraliser ses découvertes sur l’animisme sur la base des données recueillies avant et ailleurs, et les opposer au totémisme tel que vu par Lévi-Strauss tout en le modifiant en intégrant les données australiennes :
« …] dans le totémisme, la nature permet de penser la société, dans l’animisme c’est la société qui permet de penser la nature. »
Puis il articule le naturalisme (notre propre culture occidentale) avec ces deux concepts « ontologiques » « dans le jeu de continuité et de discontinuité des physicalités et des intériorités » entre humains et non-humains, tout en s’inspirant de nombreux travaux de ses pairs et relevant des inversions dans les schèmes différents qu’il contraste en dialectique des pôles du continu et du discret. Alors il discerne logiquement (en combinatoire selon la psychologie cognitive) la quatrième formule ou mode d’identification au(x) monde(s), l’analogisme qui existe en Mésoamérique, système de correspondances qu’il retrouve dans la Renaissance vue par Foucault, la Chine vue par Grenet… parachevant ainsi la matrice analytique qu’il propose.
Évidemment basé sur le structuralisme :
« Mais, comme je l’ai déjà dit, pour nous, l’objet de l’anthropologie [française] ce n’est pas ces agrégats de cultures dont on cherche à tirer des leçons généralisables, ce sont les modèles que l’on construit pour rendre compte d’une totalité constituée de l’ensemble des variantes observables d’un même type de phénomène et afin d’élucider les principes de leurs transformations. »
En dépassant la théorie du déterminisme technique et environnemental, et celle de l’évolutionnisme historique qui nous considère comme un modèle à atteindre en partant du "sauvage" (et l’impérialisme, voire le néocolonialisme) :
« La question principale que pose l’exercice critique de refocalisation auquel je me suis livré est la suivante : comment élaborer des instruments d’analyse qui ne soient ni fondés sur un universalisme issu du développement de la pensée occidentale, ni complètement segmentés selon les types d’ontologie auxquels on a affaire ? »
« L’exigence d’universalisme passe par la recherche d’une articulation entre l’ensemble des modes d’être-au-monde, par l’interopérabilité des concepts, c’est-à-dire par le fait de pouvoir nous voir nous-mêmes comme nous voyons les autres sociétés, de façon à ce que la singularité de notre point de vue ne soit plus un biais dans l’analyse, mais un objet parmi d’autres de cette analyse.
Plutôt qu’à un universalisme militant, ce à quoi j’aspire c’est à une forme de symétrisation qui mette sur un plan d’égalité conceptuelle les anthropologues et ceux dont ils s’occupent. »
« Lévi-Strauss avait employé l’analogie de la table de Mendeleïev, qui illustre bien ce qu’est à mon sens le travail de l’anthropologie : mettre en évidence les composants élémentaires de la syntaxe des mondes et les règles de leur combinaison. »
Exemple pratique : « le passage de l’analogisme au naturalisme entre le XVe et le XVIIe siècle en Europe », en considérant que « les deux pivots d’un mode d’identification naturaliste sont l’intériorité distinctive de chaque humain et la continuité physique des êtres et des choses dans un espace homogène ».
La quatrième et dernière partie confronte le monde contemporain à cette nouvelle grille de lecture. Sont présentés les divergences et échanges avec Bruno Latour, les implications en écologie, et les conséquences de l’économie humaine sur l’environnement.
« La difficulté principale de cette hypothèse est que les raisons du sous-développement volontaire des Achuar sont multiples. Il est vrai que traiter les animaux chassés comme des partenaires sociaux n’incite pas à faire des massacres inutiles, d’autant que les esprits maîtres du gibier sont toujours prompts à punir les excès, en envoyant des maladies, par exemple, ou en causant des « accidents ». Mais il y a aussi et surtout que les Achuar se sont maintenus dans un état d’équilibre environnemental pour des raisons qui sont en grande partie démographiques. Ils ont très longtemps souffert d’une forte mortalité infantile, laquelle, conjuguée aux effets de la guerre, maintenait la population à un taux de densité extrêmement faible sur un territoire assez grand. Cette « capacité de charge » confortable explique aussi pourquoi ils pouvaient se donner le « luxe » d’avoir des excédents potentiels de production considérables. Par ailleurs, comme je l’ai déjà évoqué, le temps qu’ils consacrent à la production de subsistance est très faible et inélastique ; ou plus exactement, ils ne sont pas prêts à renoncer aux mille choses qu’ils font quand ils ne travaillent pas, c’est-à-dire le plus clair du temps. »
« Il me semble, plus généralement, qu’il y a un abîme entre l’importance des questions écologiques dans le destin actuel de l’humanité et le faible développement de l’écologie comme science, en particulier en France. »
De même pour l’anthropologie, qui pourrait être plus politique.
« Je ne crois pas que l’on puisse s’inspirer directement des pensées non modernes, animistes ou autres, car il n’y a pas d’expérience historique qui soit transposable telle quelle dans des circonstances différentes de celles où elle a eu lieu. Quelle que soit l’admiration que l’on éprouve pour ce que l’on considère un peu confusément comme la sagesse des modes de vie ancestraux, et même si les Achuar, les aborigènes d’Australie ou les Inuit peuvent nous en apprendre beaucoup sur l’usage de la nature, notre situation présente est très différente de celles auxquelles ils ont fait face. La fascination pour ces peuples donne lieu à un commerce assez lucratif, en particulier dans le domaine éditorial, mais il faut se garder d’une recherche de modèles. Et la raison principale est que toutes ces sociétés ont résolu des problèmes à une échelle locale, alors que les enjeux qui sont ceux des sociétés urbaines modernes sont globaux. »
« Les milliers de façons de vivre la condition humaine sont en effet autant de preuves vivantes de ce que notre expérience présente n’est pas la seule envisageable. L’anthropologie ne nous fournit pas des idéaux de vie alternatifs, elle nous apporte la preuve que d’autres voies sont possibles puisque certaines d’entre elles, aussi improbables qu’elles puissent paraître, ont été explorées ailleurs ou jadis. Elle nous montre que l’avenir n’est pas un simple prolongement linéaire du présent, qu’il est gros de potentialités inouïes dont nous devons imaginer la réalisation afin de réaliser au plus tôt, sinon peut-être une véritable maison commune, à tout le moins des mondes compatibles, plus accueillants et plus fraternels. »
« La représentation que les Modernes se sont donnée de leur forme d’agrégation politique a ainsi été longtemps transposée à l’analyse des sociétés non modernes, en même temps qu’une kyrielle de spécificités, comme le partage entre nature et culture ou notre propre régime d’historicité ; et c’est avec cela que je voudrais rompre. »
« Notre acception traditionnelle de ce qui est politique, ainsi que notre prise intellectuelle sur ce genre de phénomènes, me paraît ainsi dépassée. Le politique, ici, consiste à maintenir des conditions d’interaction qui peuvent prendre la forme de l’échange, mais aussi de la prédation ou du partage, avec des voisins conçus comme étant autonomes. Et les conséquences que cela peut avoir en retour sur notre conceptualisation du politique sont aussi importantes, puisque nous sommes incités à moduler l’anthropologie politique, non plus, comme jadis, sous la forme d’une typologie des formes d’organisation marquée par un évolutionnisme larvé – horde, tribu, chefferie, État –, mais selon les modalités réelles que prend l’exercice du vivre-ensemble dans des collectifs dont les formes ne sont plus prédéterminées par celles auxquelles nous sommes habitués. C’est un nouveau domaine sur lequel l’exigence de décolonisation de la pensée s’exerce, et qui nous permet de nous défaire des modèles au moyen desquels nous avons été accoutumés à penser sous l’influence d’une riche tradition qui remonte à la philosophie grecque, à la réflexion médiévale sur la cité, au jus gentium, aux théories contractualistes, etc. Ce qui est en jeu, au fond, c’est notre capacité à prendre au sérieux ce que ces modèles politiques nous imposent, en termes de catégories d’analyse, et nous proposent, en termes d’imagination politique. »
« La défense de ces dispositifs de protection des hommes et de la nature m’a conduit à militer contre un certain fondamentalisme écologiste porté par de nombreuses organisations internationales. Pour beaucoup, les populations humaines, et notamment les populations tribales, sont nécessairement des perturbateurs environnementaux, et pour protéger un écosystème, il faut les en expulser. L’idée fondamentale de cette écologie est que les milieux et les paysages naturels doivent être le plus possible déconnectés de l’influence humaine, et maintenus dans un fonctionnement hermétiquement clos. J’ai beaucoup protesté contre cela, car l’exemple de l’Amazonie montre à l’évidence qu’il est absurde d’expulser de zones de forêt que l’on cherche à protéger des populations qui ont contribué à ce que la forêt présente la physionomie qu’elle a actuellement. Cela revient à déplacer les agriculteurs normands pour protéger le bocage ! »
Autre chose, l’avis de Descola sur la muséographie (et le quai Branly, où il a dirigé l’exposition « La fabrique des images ») sont aussi fort intéressantes, comme la question des restitutions.
Conclusion sur l’éloge de la diversité.
« Un monde monotone et monochrome, sans imprévu ni rencontres improbables, sans rien de nouveau pour accrocher l’œil, l’oreille ou la curiosité, un monde sans diversité est un cauchemar. Je ne peux m’empêcher de penser que la diminution de la diversité dans les manières de produire dont la standardisation industrielle du début du XXe siècle est responsable a constitué l’un des ferments des régimes totalitaires, modèles par excellence du rejet de la diversité et de l’uniformisation des consciences et des modes d’être. Chaplin l’avait compris lorsqu’il enchaîna Le Dictateur après Les Temps modernes ! »
Le mot de la fin :
« Car exister, pour un humain, c’est différer. »
J’ai retrouvé à cette lecture une large part de l’éblouissement ressenti à celle de Lévi-Strauss (y compris au sens de perception troublée).
\Mots-clés : #amérindiens #autobiographie #contemythe #ecologie #entretiens #historique #politique #science #social #traditions #voyage
- le Mer 26 Avr - 16:09
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Philippe Descola
- Réponses: 9
- Vues: 362
Albert Cossery
Les Couleurs de l'infamie
Ossama est un adroit voleur professionnel du Caire, à l’éthique de dérision professant que « le seul moteur de l’humanité était le vol et l’escroquerie » ; à ce titre, il vole les riches (voleurs) pour faire circuler l’argent.
« La multitude humaine qui déambulait au rythme nonchalant d’une flânerie estivale sur les trottoirs défoncés de la cité millénaire d’Al Qahira, semblait s’accommoder avec sérénité, et même un certain cynisme, de la dégradation incessante et irréversible de l’environnement. »
Il a trouvé dans le portefeuille volé d’un certain Suleyman, promoteur immobilier véreux, la lettre d’Abdelrazak, frère du ministre des Travaux publics, qui l’implique dans une malversation à propos d’une habitation neuve qui s’est effondrée en tuant cinquante personnes.
Pour faire éclater le scandale, il approche Karamallah, un lettré subversif qui vit dans la Cité des morts, un vaste cimetière urbain squatté par une multitude de démunis.
« Pour Karamallah le choix de cette austère résidence avait pour origine le despotisme d’un gouvernement imperméable à l’humour et férocement hostile à toute information ayant quelque rapport avec la vérité. »
« C’était un principe de sa philosophie que les problèmes se résolvent d’eux-mêmes si on n’y prête pas attention. »
« Il n’y a aucun avenir dans la vérité, tandis que le mensonge est porteur de vastes espérances. »
« Sache que l’honneur est une notion abstraite, inventée comme toujours par la caste des dominateurs pour que le plus pauvre des pauvres puisse s’enorgueillir d’un avoir fantomatique qui ne coûte rien à personne. »
« Atef Suleyman, le promoteur d’anodins génocides urbains, ne portait pas le signe de l’infamie inscrit sur son front, mais cette négligence de la nature n’empêchait pas les innombrables locataires des immeubles construits par sa société immobilière de le maudire à toute heure du jour et de la nuit, sans compter certains extrémistes qui réclamaient sa mort immédiate. Malheureusement ces invectives d’une populace acrimonieuse, dépourvue de toute culture économique pour apprécier les beautés du capitalisme, n’atteignaient jamais leur destinataire. Celui-ci vivait majestueusement dans le quartier résidentiel de Zamalek, distant de plusieurs kilomètres des nouvelles cités conquises sur le désert où il exerçait sa lucrative industrie. Désabusé par la pérennité des monuments pharaoniques, Suleyman se voulait le promoteur de l’ère des constructions éphémères – emblème de la modernité – qui ne léguaient à la postérité que gravats et poussières. En langage clair, des maisons jetables. »
Karamallah décide de faire se rencontrer Ossama et « cet homme [qui] représente toute l’infamie universelle »…
Ce roman est moins abouti que de précédents, mais rend sensiblement Le Caire contemporain et sa population (ainsi que quelques réalités socio-économiques), avec même quelques personnages féminins moins contrefaits, comme Safira la prostituée et Nahed l’étudiante. Ici, j’entends Oum Kalsoum :
« Soudain il s’arrêta pour écouter une voix venue de nulle part, mais qu’il connaissait depuis son enfance. Une radio diffusait les airs adulés de la chanteuse mythique dont la voix accompagnera encore longtemps les hommes dans leurs dérives et leurs amours inassouvis. »
\Mots-clés : #corruption #misere #politique #social #urbanité #xxesiecle
- le Mer 19 Avr - 12:03
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Albert Cossery
- Réponses: 59
- Vues: 5941
Christian Salmon
Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits
Dès l’introduction, le livre est rattrapé par l’actualité, voire dépassé par le phénomène dont il constate la naissance dans les années 90 :
« La clé du leadership américain et le secret du succès présidentiel résident, dans une grande mesure, dans le storytelling », écrivait en 2004 Evan Cornog, professeur de journalisme à l'université de Columbia, dans The Power and the Story, un essai qui réexamine l'histoire des présidences américaines de George Washington à George W. Bush à travers le prisme du storytelling : « Depuis les origines de la république américaine jusqu'à nos jours, écrit-il, ceux qui ont cherché à conquérir la plus haute charge ont dû raconter à ceux qui avaient le pouvoir de les élire des histoires convaincantes, sur la nation, ses problèmes et, avant tout, sur eux-mêmes. Une fois élu, la capacité du nouveau président à raconter la bonne histoire et à en changer chaque fois que c'est nécessaire est une qualité déterminante pour le succès de son administration. Et quand il a quitté le pouvoir, après une défaite ou à la fin de son mandat, il occupe souvent les années suivantes à s'assurer que sa version de sa présidence est bien celle qui sera retenue par l'Histoire. Sans une bonne histoire, il n'y a ni pouvoir ni gloire. »
Notre perception de l'histoire des États-Unis n'a-t-elle d'ailleurs pas le plus grand mal à démêler le vrai du faux, le réel de la fiction ? Qu'on se souvienne du président Ronald Reagan, qui évoquait parfois un épisode d'un vieux film de guerre comme s'il appartenait à l'histoire réelle des États-Unis… N'est-elle pas encombrée de fictions et de légendes, comme en atteste la réplique souvent citée du film de John Ford, Qui a tué Liberty Valance ? : « Lorsque la légende devient un fait établi, on imprime la légende. »
Dans Des logos à la story, Salmon nous montre comme le « marketing viral » des entreprises prospères les fait passer de la production des marchandises à celle des marques, puis des histoires.
« La publicité telle que nous la connaissons est morte, déclarait enfin en 2002 Sergio Zyman, ex-directeur marketing de Coca-Cola, dans son livre Les Derniers Jours de la publicité : Cela ne marche plus. C'est un colossal gaspillage d'argent, et, si vous n'y prenez garde, cela finira par détruire votre société… et votre marque. »
« Le paradoxe du marketing moderne est en effet qu'il doit fidéliser des comportements d'achat devenus changeants, labiles, imprévisibles. Ramener le consommateur volage au bercail de la marque et l'inciter à s'engager dans une relation durable et émotionnelle. »
« La consommation comme seul rapport au monde. On attribue aux marques les pouvoirs qu'on cherchait jadis dans les mythes ou la drogue : passer la limite, faire l'expérience d'un soi sans pesanteur, voler, planer ; c'était hier Icare ou le LSD, c'est aujourd'hui Nike ou Adidas. […] Les marques sont les vecteurs d'un « univers » : elles ouvrent la voie à un récit fictif, un monde scénarisé et développé par les agences de « marketing expérientiel », dont l'ambition n'est plus de répondre à des besoins ni même de les créer, mais de faire converger des « visions du monde ». »
Dans L’invention du storytelling management, c’est l’histoire des gourous qui ont révolutionné l’entreprise. L’idée est de motiver par l’émotion, et la rhétorique.
« Les gourous sont des pourvoyeurs de modes managériales. La popularité de leurs idées va et vient selon des cycles d'invention (quand l'idée est créée), de dissémination (quand l'idée est portée à l'attention d'un public ciblé), d'adhésion (quand l'idée est acceptée), de désenchantement (quand les évaluations négatives et les frustrations liées à cette idée commencent à émerger), puis de déclin ou d'abandon de l'idée… »
« De nombreux auteurs décrivent les gourous du management comme des experts en persuasion, qui cherchent à formater leur public par le biais de discours efficaces, à tel point que certains ont comparé leur puissance oratoire à celle des prédicateurs évangéliques. »
« « Les gens ne veulent plus d'informations, écrit Annette Simmons, auteure d'un des best-sellers du storytelling. Ils veulent croire – en vous, en vos buts, en votre succès, dans l'histoire que vous racontez. C'est la foi qui fait bouger les montagnes et non les faits. Les faits ne donnent pas naissance à la foi. La foi a besoin d'une histoire pour la soutenir – une histoire signifiante qui soit crédible et qui donne foi en vous. » D'où l'importance des pratiques d'autolégitimation et d'autovalidation, puisque la source unique de la performance d'un gourou, c'est sa personne même : c'est lui la source des récits utiles et de leurs effets mystérieux, c'est en lui que se concentrent les compétences narratives. Il est l'agent et le médiateur, le passeur et le message. Il doit vous convaincre que tout est en ordre, conforme au bon sens, au droit naturel. Il ne vous enseigne pas un savoir technique, il transmet une sagesse proverbiale, qui cultive le bon sens populaire, fait appel aux lois de la nature et convoque un ordre mythique. »
Dans La nouvelle « économie fiction » sont évoqués les (nombreux) employés des call centers du « nouveau rêve indien », à Bombay, qui se font passer pour des États-Uniens et sont déshumanisés et acculturés dans le formatage identitaire de la globalisation au travers de cette délocalisation virtuelle.
« Depuis le début des années 1980, la figure du cadre a ainsi cédé la place à celle du manager, puis au leader et au coach, et finalement au storyteller, dont les récits parlent au cœur des hommes et non seulement à leur raison, en leur proposant des visions de l'entreprise et des fictions qui les aident à fonctionner [… »
Le néomanagement impose une fiction de processus de groupe ou équipe dans l’entreprise (ce qui m’a ramentu mes doutes lors d’un MOOC sur le digital).
« L'autorité d'un récit – celui du « changement » – a pris sa place [à l’autorité]. Un récit écrit par le marché sous ses nombreux pseudonymes, aussi nombreux que les hétéronymes de Pessoa : la mondialisation, la globalisation, le progrès technique, la concurrence… »
Renvois à la créativité, à l’authenticité…
« Les techniques du management s'apparentent de plus en plus à celles de la mise en scène, les partenaires doivent s'ajuster le mieux possible à leurs rôles, de façon à rendre le récit crédible aux yeux d'un public de consommateurs et d'investisseurs. »
Dans Joueurs de Don DeLillo, une entreprise préfigure les sociétés de services à la personne.
« L'ironie de DeLillo, qui prenait pour cible la tendance des sociétés capitalistes à transformer toute émotion en marchandise, y compris les sentiments les plus intimes, comme le deuil, le remords ou la dépression, pouvait paraître excessive en 1977. »
« La nouvelle idéologie du capitalisme privilégie le changement à la continuité, la mobilité à la stabilité, la tension à l'équilibre et propose un nouveau paradigme organisationnel : l'entreprise sans frontières, décentralisée et nomade, libérée des lois et des emplois, légère, agile, furtive, qui ne se reconnaît d'autre loi que le récit qu'elle se donne, d'autre réalité que les fictions qu'elle répand dans le monde. »
« « Légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité et consistance » : cela pourrait constituer un bon résumé des valeurs du nouveau management. Il n'en est rien. Ce sont les titres de six conférences que devait prononcer l'écrivain italien Italo Calvino en 1985-1986 aux États-Unis. Il avait choisi six valeurs essentielles à ses yeux, qui devaient constituer l'épistémè du XXIe siècle. Il rédigea les cinq premières, qui furent publiées à titre posthume sous le titre Leçons américaines. »
Les entreprises mutantes du nouvel âge du capitalisme : ou « créer un mythe collectif contraignant » et enfumer tout le monde, en interne comme à l’extérieur de l’entreprise.
« Les applications du storytelling en entreprise accompagnent le mouvement par lequel chacun est mis en demeure de raconter sa vie et son travail, de transmettre son savoir-faire, de mobiliser ses énergies et d'accepter un changement. »
« Le récit y [dans les storytelling organisations] est en effet considéré tout à la fois comme un facteur d'innovation et de changement, un vecteur d'apprentissage et un outil de communication. Il constitue une réponse à la crise du sens dans les organisations et une méthode pour construire une identité d'entreprise. Il structure et formate la communication, à l'intention des consommateurs comme des actionnaires. »
Cas d’école de dérégulation :
« Enron était devenu un véritable mirage financier, producteur d'illusions non seulement pour ses salariés intéressés à la croyance, mais aussi pour les plus grandes banques du monde, les analystes financiers, les experts comptables et les actionnaires de Wall Street. »
« Plus le monde de la finance s'éloignait des estimations rationnelles et des performances économiques, plus la cosmétique d'entreprise consistant à rendre une entreprise belle et désirable pour les investisseurs a pris de l'importance dans la gestion des nouvelles organisations. […] Dans un monde rationnel, ce fiasco exemplaire aurait signé la mort du storytelling et de ses vertus hypnotiques. Et pourtant, près de dix ans plus tard, il reste plus que jamais la bible des « gourous du management ». »
La « mise en histoires » de la politique :
L’exploitation émotionnelle de l’histoire « évangélique » d’une fille d'une victime du 11 septembre réconfortée par le président dans la campagne de George W. Bush en 2004 : le rôle du « conseiller en communication », ou spin doctor (depuis Reagan), le récit du héros contre des méchants (simple et reprenant la forme narrative des mythes anciens).
« Si l'exercice du pouvoir présidentiel tend à s'identifier à une sorte de campagne électorale ininterrompue, les critères d'une bonne communication politique obéissent de plus en plus à une rhétorique performative (les discours fabriquent des faits ou des situations) qui n'a plus pour objectif de transmettre des informations ni d'éclairer des décisions, mais d'agir sur les émotions et les états d'âme des électeurs, considérés de plus en plus comme le public d'un spectacle. Et pour cela de proposer non plus un argumentaire et des programmes, mais des personnages et des récits, la mise en scène de la démocratie plutôt que son exercice.
La capacité à structurer une vision politique non pas avec des arguments rationnels, mais en racontant des histoires, est devenue la clé de la conquête du pouvoir et de son exercice dans des sociétés hypermédiatisées, parcourues par des flux continuels de rumeurs, de fausses nouvelles, de manipulations. »
Storytelling de guerre
Les centres de simulation du Pentagone deviennent, avec l’aide d’Hollywood, des théâtres de réalité virtuelle privilégiant des situations expérientielles plutôt que cognitives. Le recrutement militaire se fait via la vidéo, comme le traitement psychologique des états de stress posttraumatique.
« L'invention d'un modèle de société dans lequel les agents fédéraux, réels ou fictifs, doivent disposer d'une autonomie d'action suffisante pour protéger efficacement la population n'est rien d'autre que l'instauration d'un état d'exception permanent qui, ne trouvant plus sa légitimité dans le droit et la Constitution, la cherche et la trouve dans la fiction. »
« …] la puissance de l'entreprise américaine de mise en fiction du réel permet le triomphe des préjugés sur la morale la plus élémentaire, la négation du réel par la toute-puissance des représentations qui prétendent le transformer. »
L'empire de la propagande
Le gouvernement George W. Bush, juste avant la guerre en Irak :
« Nous sommes un empire maintenant, poursuivit-il, et, lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. »
« …] les dirigeants de la première puissance mondiale se détournent non seulement de la realpolitik, mais du simple réalisme, pour devenir créateurs de leur propre réalité, maîtres des apparences, revendiquant ce qu'on pourrait appeler une realpolitik de la fiction. »
Ron Susking, journaliste d’investigation (2004) :
« Il ne nous restera plus ainsi qu'une culture et un débat public fondés sur l'affirmation plutôt que sur la vérité, sur les opinions et non sur les faits. Parce que, lorsque vous en êtes là, vous êtes contraint de vous fier à la perception du pouvoir. »
Renouvellement de la propagande en infotainment type Fox News, aux contenus dictés par le gouvernement républicain, les fake news, dès 2004, manipulation de l'information marquée d’un obscurantisme émanant de la droite fondamentaliste chrétienne et opposé aux réalistes. C’est la droite chrétienne conservatrice contre la connaissance objective, la foi contre la raison.
Conclusion – Le nouvel ordre narratif : en France aussi, depuis le rôle de Henri Guaino dans la campagne de 2007.
« Don Quichotte lui aussi voulait changer le monde en racontant une histoire… Comme l'écrivait Michel Foucault : « À lui de refaire l'épopée, mais en sens inverse : celle-ci racontait […] des exploits réels, promis à la mémoire ; Don Quichotte, lui, doit combler de réalité les signes sans contenus du récit. » »
« Les « campagnes marketing » de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal signent donc une profonde évolution — et peut-être une vraie rupture — dans la culture politique française. Formatés par leurs conseillers experts en storytelling, réduits à leurs talents respectifs pour appliquer les consignes de « mise en scène » - et Sarkozy l'a nettement emporté sur ce terrain -, les deux candidats ont de concert contribué à délégitimer la politique : s'adressant aux individus comme à une « audience », évitant l'adversaire, contournant les partis, ils ont substitué au débat public la captation des émotions et des désirs. Ce faisant, ils ont inauguré une ère nouvelle de la démocratie, que l'on pourrait qualifier de « postpolitique ». »
Postface à l'édition de 2008 : en prolongement de l’analyse précédente du storytelling sarkozien, Salmon évoque la réaction au contrôle gouvernemental de l'agenda médiatique du décryptage par la presse. Puis pointe le « nouvel ordre narratif » :
« Ce qui est en jeu aujourd'hui, à tous ces niveaux à la fois, c'est l'apparition d'une même raison régulatrice qui consiste à réduire et à contrôler, par le storytelling et les machines de fiction, les conduites individuelles. »
Cet essai est proprement époustouflant lorsqu’on le lit en ayant connu l’ère Trump ; même autrement, il explique nombre de curieuses constatations qu’on a pu faire en observant notre société.
\Mots-clés : #actualité #contemporain #essai #guerre #historique #medias #politique #psychologique #social #xxesiecle
- le Sam 15 Avr - 17:09
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Christian Salmon
- Réponses: 3
- Vues: 320
QIU Xiaolong
Dragon bleu, tigre blanc
L’inspecteur principal Chen Cao, qui a la réputation d’être un qingguan ou populaire fonctionnaire incorruptible, est brusquement muté comme directeur de la Commission de réforme juridique de Shanghai, une promotion qui n’est qu’apparente.
« Dans les hautes sphères chinoises, un avancement cachait souvent une mise au ban. »
« Cet intellectuel indépendant avait publié des articles sur la séparation des pouvoirs dans un blog et le Quotidien du peuple avait répondu par un éditorial affirmant qu’en Chine, les branches législatives, exécutives et judiciaires ne pourraient jamais fonctionner séparément. Zhongtian avait rétorqué que dans un système à parti unique, tant qu’il était admis que les intérêts du Parti se plaçaient au-dessus de la loi, tout débat au sujet de la réforme juridique ne pouvait être qu’une mascarade. À la suite de cela, Zhongtian avait été invité par la Sécurité intérieure à « prendre une tasse de thé », l’équivalent d’un avertissement sérieux délivré en personne. L’intellectuel avait continué à publier ses articles et il se retrouvait maintenant victime de « problèmes fiscaux », du moins d’après les sources d’Internet. »
Les chants rouges de Mao reviennent à la mode, qui avaient annoncé la révolution culturelle. Son père, sur la tombe duquel Chen est venu se recueillir, en avait beaucoup souffert en tant que penseur confucéen ; et l’immobilier funéraire est aussi gagné par l’inflation d’une finance corrompue.
Chen assiste à une hallucinante séance de dédicace en tant que traducteur de T. S. Eliot, organisée par un Gros-Sous dans une boîte de nuit (appartenant à un certain Shen, qui bénéficie de hautes protections), où il manque de se faire arrêter par la brigade des crimes sexuels de Shanghai.
« Les assassinats politiques de ce type étaient généralement d’une efficacité redoutable. »
Ayant échappé à ce coup monté, Chen va voir Nuage Blanc, puis Vieux Chasseur. Ce dernier occupe sa retraite de policier en aidant un détective, qui traite surtout des flagrants délits d’adultère à l’instigation des épouses ou des ernai, « secondes femmes », qui peuvent faire pression en menaçant de lancer une chasse à l’homme en publiant des photos sur Internet.
« Les flics travaillent pour le Parti et les détectives privés pour les individus. C’est pour ça que le terme est encore banni des médias. À l’agence, nous sommes obligés d’utiliser une autre appellation : Conseil et enquête. Le conseil couvre un champ infini. Nous n’avons pas de licence, mais nous ne sommes pas non plus dans l’illégalité. En gros, c’est comme pour le commerce du sexe. On peut appeler ça un salon de coiffure, un karaoké, un salon de pédicure, ou n’importe quoi, tant qu’on ne dit pas ce qui s’y passe vraiment. »
L’action se passe essentiellement à Suzhou, ville qui fut célèbre pour son opéra (et ses nouilles), où Chen s’est retiré pour veiller à la rénovation de la tombe paternelle. Il enquête pour Qian, une chanteuse devenue ernai de Sima, directeur du Bureau de liaison avec l’étranger, puis évincée, et qui veut poursuivre ses études à l’étranger pour faire revivre cet opéra traditionnel.
Vieux Chasseur est le père de l’inspecteur Yu, adjoint et ami de Chen promu à sa position (et mari de Peiqin) ; il manie la digression et l’allusion, caractéristiques de l’opéra de Suzhou qu’il admire, à la narration lente (et dorénavant démodée) :
« Dans la Romance des trois royaumes, le général Liu Bei se trouve dans la capitale en compagnie du premier ministre Cao. Irrité par Liu qu’il considère comme un rival potentiel, Cao veut se débarrasser de lui. Alors Liu lui fait part de son intérêt pour les légumes du jardin, comme un homme ordinaire, un homme fragile même, qui laisse soudain tomber sa coupe de vin en entendant le tonnerre éclater. Après cet incident, Cao cesse de prendre Liu au sérieux et ce dernier réussit à fuir loin de la capitale.
– C’est donc ce que Chen essaie de faire, coupa Peiqin. Il fait semblant d’être faible, de baisser les bras, de ne se soucier de rien en dehors du chantier de Suzhou. Mais pensez-vous vraiment que les autres vont le laisser en paix ? »
Tandis que Chen change de carte SIM, Vieux Chasseur utilise un enregistreur, et Peiqin se renseigne sur Internet : les nouvelles technologies sont assimilées par la population.
Qian est tuée. Yu retrouve le cadavre de Liang, « cadre du Parti véreux », qui fut l’objet d’un shuanggui (détention initiée par la Commission de contrôle de la discipline du Parti en dehors de la voie légale) suite à sa dénonciation sur Internet, avait disparu et a été tué. Chen échappe à un attentat.
Les « cadres nus » sont ceux qui font émigrer leur famille et leur compte en banque à l’étranger.
« « Un dragon bleu et un tigre blanc de bout en bout ! poursuivit-elle. Il se prend pour un dragon, un candidat au trône. » Dans l’imagerie populaire, l’expression « tigre blanc » était une image obscène utilisée pour décrire une femme sans poils pubiens. Selon la superstition, une telle femme portait malheur aux hommes. Quant au « dragon bleu »… Dans la Chine ancienne, l’empereur était perçu comme l’incarnation d’un dragon. Seul le « dragon bleu » était censé pouvoir dompter le « tigre blanc » sans attirer sur lui le mauvais sort. »
Le dragon bleu, c’est Liang, et le tigre blanc, c’est Wei, sa femme, victimes de Kai, avocate « ambitieuse, avare et orgueilleuse, issue d’une famille de princes rouges », et femme de Lai, le secrétaire du Parti de Shanghai, instigateur du retour des chants rouges.
L’ensemble du livre tourne – entr’autres – autour du « déclin moral généralisé dû à la corruption effrénée » de la « société harmonieuse »…
Comme d’habitude rehaussé d’extraits de poèmes et de proverbes (ainsi que de plats raffinés), ce polar donne surtout un aperçu (apparemment renseigné) sur la Chine du XXIe siècle, et l’intrigue est très bien ficelée.
\Mots-clés : #corruption #polar #politique
- le Jeu 13 Avr - 12:59
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: QIU Xiaolong
- Réponses: 25
- Vues: 2800
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages