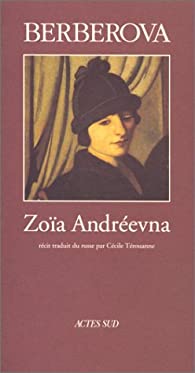La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 10:46
78 résultats trouvés pour temoignage
Patrick Leigh Fermor
Un temps pour se taire
Témoignage des expériences monacales de l’auteur, d’abord à l’abbaye bénédictine de Saint-Wandrille, plus brièvement Solesmes et la Grande Trappe cistercienne, et enfin les monastères rupestres de Cappadoce.
Leigh Fermor offre des rappels historiques, analyse la vie monastique contemplative, sans oublier le rôle de « gardiens de la littérature, des classiques, de l’érudition et des humanités », et le plain-chant grégorien. Il retrace aussi la psychologie à l’œuvre tant dans son expérience personnelle que chez les moines, et évoque Huysmans.
« Le chant alterné, issu des stalles, continuait d’ériger son invisible architecture musicale : un échafaudage qui projetait des colonnes de plain-chant, complétées par une antienne du chœur qui les coiffait comme un toit. »
« On tend en effet à voir la vie monastique comme un phénomène ayant toujours existé, puis à l’écarter de l’esprit sans l’analyser ni le commenter davantage ; c’est seulement en vivant quelque temps dans un monastère qu’on peut commencer à saisir les différences vertigineuses qui le séparent de nos vies ordinaires. Les deux modes de vie ne partagent pas un seul attribut ; non seulement les pensées, les ambitions, les bruits, la lumière, le temps et l’humeur entourant les occupants du cloître sont-ils tout à fait différents de ceux que nous connaissons, mais d’une manière étrange, ils semblent en être l’exact contraire. La période de récession des critères normaux et celle où le nouvel univers devient réalité est longue et d’abord intensément douloureuse. »
« Si mes premiers jours à l’abbaye avaient été une période de dépression, le processus de désaccoutumance, après mon départ, fut dix fois pire. L’abbaye avait d’abord été un cimetière ; le monde extérieur sembla ensuite, par contraste, un enfer de bruit et de vulgarité entièrement peuplé de goujats, de catins et de forbans. »
« Mais la défection, après la fin du long noviciat et la prise des vœux définitifs, est très exceptionnelle. Les monastères français sont un désert pour la chronique scandaleuse hebdomadaire qu’alimentent si libéralement les membres des clergés non soumis au célibat des divers autres pays. »
\Mots-clés : #historique #musique #religion #spiritualité #temoignage #traditions
- le Mar 16 Avr - 12:10
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Patrick Leigh Fermor
- Réponses: 6
- Vues: 69
Louise Erdrich
Love Medicine
Comme dans tout roman choral, il est difficile au lecteur de mémoriser les nombreux personnages (et ce malgré la présence d’une sorte d’arbre généalogique assez peu clair) – et encore plus difficile d’en rendre compte. De plus, il y a deux Nector, deux King, deux Henry… Mais ce mixte chaotique et profus d’enfants et de liaisons de parenté (avec ou sans mariage, catholique ou pas) est certainement volontaire chez Louise Erdrich.
À travers les interactions des membres de deux (ou trois) familles ayant des racines remontant jusqu’à six générations, c’est l’existence des Indiens de nos jours dans une réserve du Dakota du Nord qui est exposée, avec les drames de l’alcoolisme, du chômage, de la misère, de la prison, de la guerre du Vietnam, du désarroi entre Dieu, le Très-bas et les Manitous (Marie Lazarre Kashpaw) et la pure superstition (Lipsha Morrissey). C’est également une grande diversité d’attitudes individuelles, épisodes marquants de la vie des personnages présentés par eux-mêmes (tout en restant profondément rattachés à leurs histoires familiales et tribales). "Galerie de portraits hauts en couleur", ce poncif caractérise pourtant excellemment cette "fresque pittoresque"…
Ainsi, Moses Pillager, qui était nourrisson lors d’une épidémie :
« Ne voulant pas perdre son fils, elle décida de tromper les esprits en prétendant que Moses était déjà mort, un fantôme. Elle chanta son chant funèbre, bâtit sa tombe, déposa sur le sol la nourriture destinée aux esprits, lui enfila ses habits à l’envers. Sa famille parlait par-dessus sa tête. Personne ne prononçait jamais son vrai nom. Personne ne le voyait. Il était invisible, et il survécut. »
Moses devint windigo, se retira seul sur une île avec des chats, portant toujours ses habits à l’envers et marchant à reculons…
La joyeuse et vorace Lulu Nanapush Lamartine, qu’on pourrait désigner comme une femme facile, qui fait entrer « la beauté du monde » en elle avec constance et élève une ribambelle d’enfants, forme comme un pendant de Marie, opposition en miroir, et ces deux fortes personnalités font une image des femmes globalement plus puissante que celle des hommes.
« Elle déplia une courtepointe coupée et cousue dans des vêtements de laine trop déchirés pour être raccommodés. Chaque carré était maintenu en place avec un bout de fil noué. La courtepointe était marron, jaune moutarde, de tous les tons de vert. En la regardant, Marie reconnut le premier manteau qu’elle avait acheté à Gordie, une tache pâle, gris dur, et la couverture qu’il avait rapportée de l’armée. Il y avait l’écossais de la veste de son mari. Une grosse chemise. Une couverture de bébé à demi réduite en dentelle par les mites. Deux vieilles jambes de pantalon bleues. »
La situation tragique d’un peuple vaincu et en voie de déculturation reste bien sûr le thème nodal de ces destins croisés.
« Pour commencer, ils vous donnaient des terres qui ne valaient rien et puis ils vous les retiraient de sous les pieds. Ils vous prenaient vos gosses et leur fourraient la langue anglaise dans la bouche. Ils envoyaient votre frère en enfer, et vous le réexpédiaient totalement frit. Ils vous vendaient de la gnôle en échange de fourrures, et puis vous disaient de ne pas picoler. »
Dès ce premier roman, Louise Erdrich maîtrise l’art de la narration, tant en composition que dans le style, riche d’aperçus métaphoriques comme descriptifs. La traduction m’a paru bancale par endroits.
\Mots-clés : #amérindiens #discrimination #famille #identite #minoriteethnique #relationenfantparent #romanchoral #ruralité #social #temoignage #traditions #xxesiecle
- le Mer 20 Sep - 12:12
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Louise Erdrich
- Réponses: 37
- Vues: 2878
Jorge Semprun
Le Mort qu’il faut
À Buchenwald, en décembre 1944, Semprun est déporté depuis un an comme résistant ; il a vingt ans. Il fréquente notamment le sociologue Maurice Halbwachs et le sinologue Henri Maspero, qui vont y mourir l’année suivante, et un jeune Français lui aussi « Musulman », c'est-à-dire « les invalides et les exclus, marginalisés par le despotisme productiviste du système de travail forcé ».
« Prendre sur soi pour sortir de soi, somme toute. »
« Malgré tous les subterfuges, les ruses et les détours, il y avait toujours trop peu de pain pour que j’en garde en mémoire. C’était fini, pas moyen de me souvenir. Il n’y avait jamais assez de pain pour que j’en « fasse de la mémoire », aurait-on dit en espagnol, hacer memoria. La faim revenait aussitôt, insidieuse, envahissante, comme une sourde pulsion nauséeuse.
On ne pouvait faire de la mémoire qu’avec des souvenirs. Avec de l’irréel, en somme, de l’imaginaire. »
Comme il appartient à l’Arbeitsstatistik du « camp de rééducation » (« C’est la marotte des dictatures, la rééducation ! ») devenu « un camp punitif, d’extermination par le travail forcé », Semprun est un temps « animateur culturel », et peut lire Absalon ! Absalon ! (Faulkner) pendant ses nuits de comptabilisation des mouvements des travailleurs. Ainsi que disent les rescapés des premières années du camp, Buchenwald est devenu un « sana » (la fin de la guerre approche, les Américains tiennent Bastogne)… Dans les latrines collectives, leur seul asile, Semprun discute de Dieu et du Mal avec « Lenoir », un Juif autrichien, et Otto, « un "triangle violet", un Bibelforscher, un témoin de Jéhovah ».
« Quoi qu’il en soit, Otto, jadis, dans l’arrière-salle de l’Arbeit, venait de m’exposer une notion cruciale de Schelling, selon laquelle nulle part l’ordre et la forme ne représentent quelque chose d’originaire : c’est une irrégularité initiale qui constitue le fond cosmologique et existentiel. »
« Les kapos rouges de Buchenwald évitaient le bâtiment des latrines du Petit Camp : cour des miracles, piscine de Bethsaïda, souk d’échanges de toute sorte. Ils détestaient la vapeur pestilentielle de « bain populaire », de « buanderie militaire », l’amas des corps décharnés, couverts d’ulcères, de hardes informes, les yeux exorbités dans les visages gris, ravinés par une souffrance abominable.
— Un jour, me disait Kaminsky, effaré d’apprendre que j’y descendais parfois, le dimanche, en allant voir Halbwachs au block 56, ou en revenant d’un entretien avec lui, un jour, ils se jetteront sur toi, en s’y mettant nombreux, pour te voler tes chaussures et ton caban de Prominent ! Qu’y cherches-tu, bon sang ?
Il n’y avait pas moyen de le lui faire entendre.
J’y cherchais justement ce qui l’effrayait, lui, ce qu’il craignait : le désordre vital, ubuesque, bouleversant et chaleureux, de la mort qui nous était échue en partage, dont le cheminement visible rendait ces épaves fraternelles. C’est nous-mêmes qui mourions d’épuisement et de chiasse dans cette pestilence. C’est là que l’on pouvait faire l’expérience de la mort d’autrui comme horizon personnel : être-avec-pour-la-mort, Mitsein zum Tode.
On peut comprendre, cependant, pourquoi les kapos rouges évitaient cette baraque.
C’était le seul endroit de Buchenwald qui échappât à leur pouvoir, que leur stratégie de résistance ne parviendrait jamais à investir. Le spectacle qui s’y donnait, en somme, était celui de leur échec toujours possible. Le spectacle de leur défaite toujours menaçante. Ils savaient bien que leur pouvoir restait fragile, par essence, exposé qu’il était aux caprices et aux volte-face imprévisibles de la politique globale de répression de Berlin.
Et les Musulmans étaient l’incarnation, pitoyable et pathétique, sans doute, mais insupportable, de cette défaite toujours à craindre. Ils montraient de façon éclatante que la victoire des SS n’était pas impossible. Les SS ne prétendaient-ils pas que nous n’étions que de la merde, des moins-que-rien, des sous-hommes ? La vue des Musulmans ne pouvait que les conforter dans cette idée.
Précisément pour cette raison, il était, en revanche, difficile de comprendre pourquoi les SS, eux aussi, évitaient les latrines du Petit Camp, au point d’en avoir fait, involontairement sans doute, un lieu d’asile et de liberté. Pourquoi les SS fuyaient-ils le spectacle qui aurait dû les réjouir et les réconforter, le spectacle de la déchéance de leurs ennemis ?
Aux latrines du Petit Camp de Buchenwald, ils auraient pu jouir du spectacle des sous-hommes dont ils avaient postulé l’existence pour justifier leur arrogance raciale et idéologique. Mais non, ils s’abstenaient d’y venir : paradoxalement, ce lieu de leur victoire possible était un lieu maudit. Comme si les SS – dans ce cas, ç’aurait été un ultime signal, une ultime lueur de leur humanité (indiscutable : une année à Buchenwald m’avait appris concrètement ce que Kant enseigne, que le Mal n’est pas l’inhumain, mais, bien au contraire, une expression radicale de l’humaine liberté) – comme si les SS avaient fermé les yeux devant le spectacle de leur propre victoire, devant l’image insoutenable du monde qu’ils prétendaient établir grâce au Reich millénaire. »
Des vers de Rimbaud, Valéry, Machado, Lorca et d’autres poètes, des passages de L’espoir de Malraux reviennent à Semprun.
Apparemment bien organisé, l’appareil de renseignement des communistes allemands au sein du camp (en la personne de « Kaminsky ») apprend qu’il est recherché par la Gestapo, et a trouvé un moribond qui correspond à son profil, dont il pourra endosser l’identité – l’homme en question est « le jeune Musulman français ». À ses cotés sur un châlit du Revier, l’infirmerie, il suit son agonie, médite la finitude humaine.
« Non, pas moi, François, je ne vais pas mourir. Pas cette nuit, en tout cas, je te le promets. Je vais survivre à cette nuit, je vais essayer de survivre à beaucoup d’autres nuits, pour me souvenir.
Sans doute, et je te demande pardon d’avance, il m’arrivera d’oublier. Je ne pourrai pas vivre tout le temps dans cette mémoire, François : tu sais bien que c’est une mémoire mortifère. Mais je reviendrai à ce souvenir, comme on revient à la vie. Paradoxalement, du moins à première vue, à courte vue, je reviendrai à ce souvenir, délibérément, aux moments où il me faudra reprendre pied, remettre en question le monde, et moi-même dans le monde, repartir, relancer l’envie de vivre épuisée par l’opaque insignifiance de la vie. Je reviendrai à ce souvenir de la maison des morts, du mouroir de Buchenwald, pour retrouver le goût de la vie. »
La mémoire, les douloureuses modalités du souvenir sont centrales dans cet ouvrage, avec la puissance de la littérature ; Semprun évoque aussi la vie quotidienne du camp : la promiscuité, les castes, la lutte pour la survie, la solidarité et ses limites – et les musiques, des chanteuses allemandes diffusées au jazz clandestin, en passant par les souvenirs de flamenco et la fanfare qui accompagne le départ au travail (voir https://expo-musique-camps-nazis.memorialdelashoah.org/). Impressionnant témoignage, qui complète Le Grand Voyage et L'Écriture ou la Vie. Étonnamment (pour moi), Semprun remet en question le travail des historiens sur la période : d’après lui, ils auront les coudées franches lorsque les derniers témoins se tairont à jamais…
\Mots-clés : #autobiographie #campsconcentration #deuxiemeguerre #historique #politique #temoignage #xxesiecle
- le Sam 9 Sep - 18:34
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jorge Semprun
- Réponses: 30
- Vues: 2676
Kent Nerburn
Ni loup ni chien
Grâce à ses précédents ouvrages sur les Indiens, Kent Nerburn est pressenti par Dan, un vieux Lakota, pour devenir son porte-parole.
« …] Indiens. Je n’avais jamais autant apprécié un peuple ni trouvé ailleurs un tel sens de l’humour et une telle modestie. En outre, j’avais ressenti chez eux une paix et une simplicité qui dépassaient les stéréotypes de sagesse et d’alcoolisme. Ils étaient tout simplement les personnes les plus terre à terre que j’avais rencontrées, dans le bon et le mauvais sens de la chose. Ils étaient différents des Blancs, des Noirs, différents de l’image qu’on m’en avait inculquée, différents de tout ce que j’avais croisé. Je me sentais heureux en leur compagnie, et honoré d’être à leur côté. »
Il le rejoint dans sa réserve des Grandes Plaines. Ils feront une « virée » en Buick avec Grover, l’ami de Dan, tandis qu’il enregistre les « petits discours » de ce dernier.
« Voilà ce qu’il y avait derrière cette idée d’Amérique comme nouveau pays de l’autre côté de l’océan : devenir propriétaire. […] Nous ne savions pas cela. Nous ne savions même pas ce que cela signifiait. Nous appartenions à la terre. Eux voulaient la posséder. »
« Un point important selon moi : votre religion ne venait pas de la terre, elle pouvait être transportée avec vous. Vous ne pouviez pas comprendre ce que ça signifiait pour nous que d’avoir notre religion ancrée dans la terre. Votre religion existait dans une coupelle et un morceau de pain, et elle pouvait être trimballée dans une boîte. Vos prêtres pouvaient sacraliser n’importe où. Vous ne pouviez pas comprendre que, pour nous, ce qui était sacré se trouvait là où nous vivions, parce que c’est là que les choses saintes s’étaient produites et que les esprits nous parlaient. »
« Pendant de nombreuses années, l’Amérique voulait simplement nous détruire. Aujourd’hui, tout d’un coup, on est le seul groupe que les gens essaient d’intégrer. Et pourquoi d’après toi ? […]
– Je pense, reprit-il, que c’est parce que les Blancs savent qu’on avait quelque chose de véritable, qu’on vivait de la manière dont le Créateur voulait que les humains vivent sur cette terre. Ils désirent ça. Ils savent que les Blancs font n’importe quoi. S’ils disent qu’ils sont en partie indiens, c’est pour faire partie de ce que nous avons. »
« Nos aînés nous ont appris que c’était la meilleure façon de faire avec les Blancs : sois silencieux jusqu’à ce qu’ils deviennent nerveux, et ils commenceront à parler. Ils continueront de parler, et si tu restes silencieux, ils en diront trop. Alors tu seras capable de voir dans leur cœur et de savoir ce qu’ils veulent vraiment. Et tu sauras quoi faire. »
« Si tu commences à parler, je ne t’interromps pas. Je t’écoute. Peut-être que j’arrête d’écouter si je n’aime pas ce que tu dis. Mais je ne t’interromps pas. Quand t’as fini, je prends ma décision sur ce que tu as dit, mais je ne t’expose pas mon désaccord, à moins que ça soit important. Autrement, je me tais et je m’en vais simplement. Tu m’as dit ce que j’avais besoin de savoir. Il n’y a rien de plus à ajouter. »
Des épaves de voiture jonchent la réserve :
« J’avais toujours été interloqué par l’acceptation des gens à vivre dans la saleté, quand un simple petit effort aurait suffi à rendre les choses propres. À la longue, j’en étais venu à accepter le vieux bobard sociologique qui racontait que cela reflétait un manque d’estime de soi et un certain accablement.
Mais, au fond de moi, je savais que c’était trop facile, une supposition trop médiocre. C’était cependant certainement préférable aux explications précédentes, selon lesquelles les gens qui vivaient comme cela étaient simplement paresseux ou apathiques. »
« Pour nous, chaque chose avait son utilité, puis retournait à la terre. On avait des bols et des coupelles en bois, ou des objets fabriqués en argile. On montait à cheval ou on marchait. On fabriquait des choses à partir de choses de la terre. Puis quand on n’en avait plus besoin, on les laissait y retourner.
Aujourd’hui, les choses ne retournent pas à la terre. Nos enfants jettent des canettes. On abandonne des vieilles voitures. Avant, ça aurait été des cuillères en os ou des tasses en corne, et les vieilles voitures auraient été des squelettes de chevaux ou de bisons. On aurait pu les brûler ou les laisser là, et elles seraient retournées à la terre. Maintenant, on ne peut plus.
On vit de la même manière, mais avec des choses différentes. On apprend vos manières, mais, tu vois, vous n’apprenez rien. Tout ce dont vous vous souciez vraiment, c’est de garder les choses propres. Vous ne vous souciez pas de ce qu’elles sont réellement, tant qu’elles sont propres. Quand vous voyez une canette au bord d’un chemin, vous trouvez ça pire qu’une énorme autoroute goudronnée qui est maintenue propre. Vous vous énervez davantage devant un sac-poubelle dans une forêt que devant un gros centre commercial tout impeccable et balayé. »
Une autre vision sociale :
« On n’évaluait pas les gens par la richesse ou la pauvreté. On ne savait pas faire cela. Quand les temps étaient bons, tout le monde était riche. Quand les temps étaient durs, tout le monde était pauvre. On évaluait les gens sur leur capacité à partager. »
Les wannabes, qui croient avoir une grand-mère cherokee, portent queue de cheval et bijoux indiens en turquoise et argent, sont particulièrement insupportables ; au cinéma :
« Peuvent plus mettre de sauvages, maintenant. Aujourd’hui, c’est l’Indien sage – tu sais, celui qui ne fait qu’un avec la terre et tout, et qui rend le Blanc meilleur en lui apprenant à vivre à l’indienne, pour qu’il ajoute des valeurs indiennes à sa blanchitude. »
« Nous savons que les Blancs ont une faim infinie. Ils veulent tout consommer et tout englober. Quand ils ne possèdent pas physiquement, ils veulent posséder spirituellement. C’est ce qui est en train de se passer avec les Indiens, aujourd’hui. Les Blancs veulent nous posséder spirituellement. Vous voulez nous avaler pour pouvoir dire que vous êtes nous. C’est quelque chose de nouveau. Avant, vous vouliez qu’on soit comme vous. Mais aujourd’hui, vous êtes malheureux avec vous-mêmes, donc vous voulez vous transformer en nous. Vous voulez nos cérémonies et nos façons de faire pour pouvoir dire que vous êtes spirituels. Vous essayez de devenir des Indiens blancs. »
La leçon tirée des traités non honorés :
« Écoute-moi. Nous, les Indiens, parlons peu au peuple blanc. Il en a toujours été ainsi. Il y a une raison. Les Blancs ne nous ont jamais écoutés quand nous avons pris la parole. Ils ont seulement entendu ce qu’ils voulaient entendre. Parfois ils prétendaient avoir entendu et faisaient des promesses. Puis ils les brisaient. Il n’y avait plus pour nous de raison de parler. Donc nous avons arrêté. Même aujourd’hui, nous disons à nos enfants : “Fais gaffe quand tu parles aux wasichus [hommes blancs en lakota]. Ils utiliseront tes mots contre toi.” »
Le regard de Dan est particulièrement aigu en ce qui concerne la société occidentale.
« Le monde blanc met tout le pouvoir au sommet, Nerburn. Lorsqu’une personne arrive au sommet, elle a le pouvoir de prendre ta liberté. Au début, quand les Blancs sont arrivés ici, c’était pour fuir ces personnes au sommet. Mais ils ont continué de raisonner de cette façon et très vite, il y a eu de nouvelles personnes au sommet dans ce nouveau pays. Parce que c’est comme ça qu’on vous a appris à penser.
Dans vos églises, il y a quelqu’un au sommet. Dans vos écoles aussi. Dans votre gouvernement. Dans vos métiers. Il y a toujours quelqu’un au sommet, et cette personne a le droit de dire si tu es bon ou mauvais.
Elle te possède.
Pas étonnant que les Américains se soucient autant de la liberté. Vous en avez quasiment aucune. Si vous la protégez pas, quelqu’un vous la prendra. Vous devez la surveiller à chaque seconde, comme un chien garde un os. »
« Quand vous êtes arrivés parmi nous, vous ne pouviez pas comprendre notre façon d’être. Vous vouliez trouver la personne au sommet. Vous vouliez trouver les barrières qui nous entouraient – jusqu’où notre terre allait, jusqu’où notre gouvernement allait. Votre monde était fait de cages et vous pensiez que le nôtre aussi. Quand bien même vous détestiez vos cages, vous croyiez en elles. Elles définissaient votre monde et vous aviez besoin d’elles pour définir le nôtre.
Nos anciens ont remarqué ça dès le début. Ils disaient que l’homme blanc vivait dans un monde de cages et que si nous ne nous méfiions pas, ils nous feraient aussi vivre dans un monde de cages.
Donc nous avons commencé à y prêter attention. Tout chez vous ressemblait à des cages. Vos habits se portaient comme des cages. Vos maisons ressemblaient à des cages. Vous mettiez des clôtures autour de vos jardins pour qu’ils ressemblent à des cages. Tout était une cage. Vous avez transformé la terre en cages. En petits carrés.
Puis, une fois que vous avez eu toutes ces cages, vous avez fait un gouvernement pour les protéger. Et ce gouvernement n’était que cages. Uniquement des lois sur ce qu’on ne pouvait pas faire. La seule liberté que vous aviez se trouvait dans votre cage. Puis vous vous êtes demandé pourquoi vous n’étiez pas heureux et pourquoi vous ne vous sentiez pas libres. Vous aviez créé toutes ces cages, puis vous vous êtes demandé pourquoi vous ne vous sentiez pas libres.
Nous les Indiens n’avons jamais pensé de cette façon. Tout le monde était libre. Nous ne faisions pas de cages, de lois, ni de pays. Nous croyions en l’honneur. Pour nous, l’homme blanc ressemblait à un homme aveugle en train de marcher, qui ne comprenait qu’il était sur le mauvais chemin que quand il butait contre les barreaux d’une des cages. Notre guide à nous était à l’intérieur, pas à l’extérieur. C’était l’honneur. Il était plus important pour nous de savoir ce qui était bien que de savoir ce qui était mauvais.
Nous regardions les animaux et voyions ce qui était bien. Nous voyions comment le cerf trompait les animaux les plus puissants et comment l’ours rendait ses enfants forts en les élevant sans pitié. Nous voyions comment le bison se tenait et observait jusqu’à ce qu’il comprenne. Nous voyions comment chaque animal était sage et nous essayions d’apprendre cette sagesse. Nous les regardions pour comprendre comment ils cohabitaient et comment ils élevaient leurs petits. Puis nous faisions comme eux. Nous ne cherchions pas ce qui était mauvais. Non, nous tendions toujours vers ce qui était bien. »
Dan livre ses convictions sur les meneurs « à l’indienne », comment Jésus fut imposé aux Indiens, puis comme l’espoir du messie leur fut refusé ; il développe les différences d’appréciation de l’histoire entre eux et les Blancs…
« Avant, je pensais que vous agissiez comme ça parce que vous étiez avides. Plus maintenant. Maintenant, je pense que ça fait juste partie de qui vous êtes et de ce que vous faites, tout comme écouter la terre fait partie de qui nous sommes et de ce que nous faisons. »
Les femmes, au travers de Dannie, petite-fille de Dan :
« C’est ce que je veux dire quand je dis que c’est notre tour à nous, les femmes indiennes. On a toujours été au centre. La famille indienne était comme un cercle, et la femme était au centre. […] On n’a pas besoin de se libérer. On a besoin de libérer nos hommes. »
Les métis :
« Tout ce qui comptait pour nous, c’était la façon dont ils étaient élevés et les personnes qu’ils devenaient. Vous, vous examiniez la couleur de leur peau et la couleur de leurs cheveux, et essayiez de calculer le pourcentage de blancheur qu’ils avaient à l’intérieur d’eux. Vous les appeliez des métis. Vous ne les laissiez être ni blancs ni indiens. »
Puis ils arrivent à Wounded Knee, là où, comme dans nombre d’autres lieux, enfants et vieillards furent massacrés – tout un peuple.
Outre des faits connus des familiers de lectures sur les Amérindiens, ce livre-témoignage développe une pensée originale (il s’agit de réflexions de Dan, plus que de révélations), qui permet aussi d’approfondir l’appréhension de la conception du monde chez les « Américains natifs ». Et c’est encore (et surtout ?) un récit profondément sensible, plein de colère et de douleur, également d’humour malicieux – humain.
J'ai beaucoup cité, mais il y a bien d'autres choses à retenir de ce livre qui sort de l'ordinaire sur le sujet.
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #culpabilité #discrimination #documentaire #identite #initiatique #racisme #segregation #spiritualité #temoignage #traditions
- le Lun 28 Aoû - 14:39
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Kent Nerburn
- Réponses: 2
- Vues: 253
Kossi Efoui
Une magie ordinaire
À l’annonce de l’hospitalisation de sa mère à Lomé, qu’il a quitté pour la France en tant que réfugié politique voici vingt ans, Kossi, qui a maintenant lui-même des enfants, se souvient de cette mère qui lui a apprit ses fondamentaux, comme la traduction de l’ewe en français et réciproquement, soit un pont entre les deux mondes, celui des colonisateurs et celui de ses origines. Il retrace en fait toute son enfance dans un milieu pauvre, et l’importance des livres pour lui. Venu à la poésie grâce notamment à Baudelaire, il est aussi manifestement imprégné de ses études de philosophie.
« « Aimez-vous les uns les autres », dit Jésus. Quand on sait que l’impératif du verbe « aimer » est une impossibilité en soi, il n’y a pas de religion de l’amour qui ne soit pur délire. Comme il n’y a pas de volonté de changer le monde qui ne procède d’un trouble de la personnalité et du jugement, puisque ce n’est pas le monde qui a besoin d’être changé ni d’être sauvé, mais les hommes qui ont besoin, chacun, de se soigner. »
Ce livre m'a plu, et pas seulement parce qu’il m’a ramentu ce pays aux frontières artificielles qui séparent un peuple en trois, celui aussi des arbres sacrés et des vivantes veillées funèbres : j’ai été fort sensible à ses gens, et c’est encore le cas avec cet auteur.
\Mots-clés : #autobiographie #enfance #exil #relationenfantparent #temoignage
- le Lun 14 Aoû - 13:16
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Kossi Efoui
- Réponses: 1
- Vues: 141
QIU Xiaolong
Il était une fois l'inspecteur Chen
Dans son préambule, Qiu Xiaolong rappelle qu’au début de la Révolution culturelle, dans les années cinquante, la « critique révolutionnaire de masse des ennemis de classe » du peuple caractérisait la dictature du prolétariat, et raconte comme son propre père, considéré comme un capitaliste, fut alors victime des Gardes rouges (récit de dégradation impitoyable qui à lui seul vaut la lecture).
Le roman lui-même commence comme Chen Cao, étudiant juste après la fin de la Révolution culturelle (et encore dans l’ombre de sa famille « noire »), prépare un mémoire sur Eliot (comme Xiaolong) dans la bibliothèque de Pékin, où travaille la ravissante Ling. Puis il devient policier, un peu par hasard, et s’engage dans sa première enquête, qui le replonge dans son passé (et la cité de la Poussière Rouge à Shanghai). Cette enquête, qui réunit les principales caractéristiques des romans de Xiaolong (la société chinoise contemporaine, la cuisine et la poésie chinoises), est plus un support (presque un prétexte) à évoquer les séquelles de la Révolution culturelle et ses iniques aberrations discriminatoires. C’est certes un polar, mais aussi et peut-être surtout un témoignage, à la fois historique et personnel.
« Monsieur » Fu a été assassiné ; Chen se renseigne, notamment lors des « conversations du soir » au quartier. L’homme fut accusé de capitalisme pour avoir ouvert un petit commerce de fruits de mer avant la campagne d’éradication des « Quatre Vieilleries » (« Vieilles idées, vieille culture, vieilles coutumes et vieilles habitudes »), et sa femme mourut à cause des bijoux où le couple avait placé ses gains :
« « Ensuite, elle a dû rester debout dans la rue, un tableau noir autour du cou avec son nom barré au-dessus de la phrase : Pour ma résistance contre la Révolution culturelle, je mérite de mourir des milliers de morts. Plus tard dans la nuit, pendant son supplice, elle est tombée et s’est cogné la tête contre l’évier commun. Elle ne s’est jamais réveillée. »
Fu, qui était délaissé de tous y compris ses enfants, reçut de l’État une compensation financière pour ces spoliations (après la réforme du camarade Deng Xiaoping), qui le rendit riche. Il prit une bonne, Meihua, qui lui concoctait de bons petits plats.
Cette affaire résolue, plusieurs autres sont rapidement narrées, autant d’étapes dans la carrière de l’intègre inspecteur. Autant de nouvelles aussi, qui illustrent la corruption dans une société qui combat officiellement la décadence et l’indécence dans une politique hostile à l’étranger, aux intellectuels. Également des souvenirs de jeunesse de Xiaolong (sans surprise, grand appétit pour la gastronomie et les livres, notamment occidentaux et à l’index), avec son amitié pour Lu le Chinois d’outre-mer, devenu un de ses personnages récurrents.
Cet ouvrage constitue un prequel des enquêtes de l’inspecteur Chen publiées auparavant, narrant sa jeunesse en la rapprochant de l’histoire de son auteur et de son pays d'origine. Il peut difficilement être lu uniquement comme un polar, et je comprends qu’Armor ait été déçue à sa lecture.
\Mots-clés : #autobiographie #discrimination #ecriture #historique #polar #politique #regimeautoritaire #revolutionculturelle #temoignage
- le Sam 12 Aoû - 13:03
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: QIU Xiaolong
- Réponses: 25
- Vues: 2800
Gerald Basil Edwards
Le livre d'Ebenezer Le Page
Le narrateur, le vieil Ebenezer Le Page, présente d’abord ses antécédents.
« Il est dit dans la Bible : « Regarde la pierre dans laquelle tu as été sculpté et le puits dont tu fus extrait. » Eh bien, ces gens sont la pierre dans laquelle j’ai été sculpté et le puits dont j’ai été extrait. Je n’ai pas parlé de mes cousins, ou des cousins de mes cousins, mais il faut dire que la moitié des gens de l’île sont mes cousins, ou les cousins de mes cousins. »
« C’est ça l’ennui, dans le fait d’écrire la vraie histoire de ma famille, ou la mienne, d’ailleurs. Je n’en connais ni le commencement ni la fin. »
Et c’est, plus qu’un roman et/ou autobiographie (ou plutôt une autofiction ?), une histoire de famille autant qu’une chronique de Guernesey (Sarnia en latin) de la fin du XIXe siècle au début des années 1960, tant la parentèle est importante dans ce milieu insulaire. De même, c’est toute l’époque qui est revisitée.
Souvenirs précis rapportés en détail par un vieillard évidemment nostalgique, manifestement doué d’un caractère entier. Simple pêcheur et producteur de légumes en serre, Ebenezer est observateur, et n’aime pas le changement dans l’île qu’il n’a guère quittée pendant près d’un siècle :
« Dieu a doté cette île d’un bon sol et d’un bon climat, particulièrement propres à faire pousser des fruits, des légumes et des fleurs, et à engendrer deux sortes de créatures : les vaches de Guernesey et les gens de Guernesey. J’aurais cru que les États tiendraient à protéger ces espèces, mais il n’y a visiblement plus de place pour elles. »
Sa mère avec qui il vit jusqu’à sa mort (puis avec Tabitha sa sœur), Jim son ami qui mourra à la Première Guerre, et Liza, une de ses petites amies mais son seul amour et jamais accompli, se distinguent dans la foule de personnages qui sont décrits, sans plus nuire à la compréhension que les personnes inconnues évoquées dans une conversation agréable. Remarquables sont également ses deux tantes, la Hetty et la Prissy, mariées à Harold et Percy Martel (des constructeurs dans le bâtiment), et leurs fils Raymond (qui prendra une grande place dans ses affections) et Horace, dans les maisons voisines de Wallaballoo et Tombouctou : elles sont souvent aux prises l’une avec l’autre, entre chicanes et brouilles.
L’opinion d’Ebenezer (et d’autres Guernesiais) sur les femmes et le mariage explique au moins en partie qu’il soit demeuré célibataire.
« J’ai commis une grave erreur dans ma jeunesse. Je pensais à ce moment-là que les filles étaient des êtres humains comme nous, mais c’est faux. Elles sont toujours en quête de quelque chose, de votre corps, de votre argent, ou d’un père pour leurs enfants, et si ce n’est pas le cas, elles veulent quand même que vous deveniez quelqu’un ou que vous fassiez quelque chose qui leur apportera la gloire. Ça ne leur suffit jamais de vous laisser vivre et de vivre avec vous.
– Tu sais, j’ai répliqué, les hommes aussi en ont toujours après quelque chose. »
L’île est protestante, de diverses obédiences (surtout méthodistes et anglicans, mais aussi quelques catholiques ou « papistes »).
« Je dois reconnaître que dans la famille de ma mère, ils ne passaient pas leur temps à essayer de convertir tout le monde. Ils savaient qu’ils étaient dans le vrai et si les autres ne l’étaient pas, c’était leur problème. »
« Je ne sais pas ce que c’est qu’un païen, j’ai répondu, je ne peux donc pas dire si je le suis ou pas, mais je ne sais pas non plus ce qu’est un chrétien. Il y en a des milliers de toutes sortes sur cette île. Ce ne sont peut-être pas tous des dévergondés, du moins pas ouvertement, mais ils partent à la guerre et tuent d’autres gens, et en temps de paix, ils gagnent autant d’argent qu’ils le peuvent sur le dos les uns des autres et ils n’aiment pas plus leur prochain que moi. »
« La religion de ma mère est de loin la plus terrifiante dont j’ai jamais entendu parler. […] Le plus effroyable, c’est que l’endroit où l’on finirait était décidé avant même notre naissance, et qu’il n’y avait rien à y faire. »
Raymond s’est toujours senti la vocation de pasteur, mais sa conception de l’amour divin l’écarte du sacerdoce ; son destin assez dramatique en fait un personnage central, juste après Ebenezer.
« Comme je l’ai déjà dit, je n’aime pas les prêcheurs. Ils se hissent sur un piédestal et prétendent être le porte-parole de la volonté divine en vous assurant que toute autre opinion est le fruit du Diable. J’aime quand les gens disent carrément ce qu’ils pensent sur le moment et se fichent pas mal d’avoir tort ou raison. »
« « Après tout, disais-je, il y a quand même eu des progrès, tu sais. Le monde s’améliore lentement, du moins on peut l’espérer. » C’était le genre d’idée qui le mettait en rage. « Le monde s’est-il amélioré de ton temps ? demandait-il [Raymond]. – Eh bien, je ne sais pas, peut-être pas au point qu’on le remarque, je répondais. – Non, pas plus que du temps de n’importe qui d’autre ! Ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre. Le progrès, c’est la carotte pendue devant l’âne pour le faire tourner en rond. »
Relativement nombreux sont les insulaires tentés par l’émigration. La Première Guerre mondiale ne touche pas directement l’île, mais décime sa jeunesse envoyée au combat. Pendant la Seconde, c’est l’Occupation allemande, famine, et collaboration de certains.
« C’est la seule fois où il [Raymond] ait un peu parlé de la guerre. « Hitler, c’est l’Ancien Testament qui recommence, a-t-il dit. Pas étonnant qu’il déteste les Juifs. » Je ne l’ai pas compris alors, et un tas d’autres réflexions qu’il lâchait brusquement de temps à autre m’échappaient. Cette fois-là, je lui ai demandé ce qu’il entendait par là.
« Méfie-toi de ceux qui se prétendent désignés par l’Histoire ou par Dieu. Ils se sont désignés eux-mêmes. Il n’y a pas de Peuple Élu, a-t-il déclaré. – Ce n’était pas l’avis de ma mère. Elle y croyait, elle, aux Élus de Dieu. – Les communistes aussi, a-t-il rétorqué. C’est ce qu’ils appellent le Prolétariat. Les nazis les appellent les Aryens. Ça revient au même. L’État totalitaire. Rien n’est plus faux. La véritable totalité est inaccessible au cœur et à l’esprit des hommes. Au mieux, nous ne faisons que l’entrevoir. – Ça, je l’ignore, ai-je dit. Je n’en ai même jamais eu le moindre aperçu. – Ça vaut mieux que de s’imaginer qu’on sait tout, a-t-il répliqué. Dieu merci, je suis un îlien, et je ne serai jamais rien de plus. » Je me demande ce qu’il penserait s’il était encore en vie aujourd’hui. Guernesey devient chaque jour de plus en plus un État totalitaire. J’ai l’impression que c’est Hitler qui a gagné la guerre. »
« Quant à moi, je ne me sortirai pas de la tête qu’après la Libération, nous avons eu une chance unique de repartir à zéro. Mais pour je ne sais quelle raison, Guernesey a pris un mauvais tournant, même si elle n’a pas dégringolé la pente aussi vite et aussi volontiers que Jersey. La routine reprenait ses droits, mais en pire. Le chien retournait à son vomi et la truie se vautrait dans la fange. [Pierre] Il y avait sûrement autre chose à faire. Je ne sais pas quoi exactement. Je n’ai aucun droit de critiquer. Je me souviens trop bien comment, dans les pires moments, je me fichais pas mal de tout et de tout le monde, à part moi. Et je n’étais pas le seul. Si c’est bien là la vérité, alors mieux vaut encore ne pas la connaître. C’est peut-être la seule leçon qu’on ait tirée de l’Occupation, sauf que ça n’était pas la bonne. »
C’est aussi l’occasion de quelques scènes cocasses, comme les fouilles archéologiques de vestiges proches des Moulins, où Ebenezer demeure. Malgré ses nombreuses préventions de casanier misanthrope, Ebenezer noue étonnamment des liens d’amitié avec des « ennemis », un Jersiais catholique, un occupant allemand : c’est apparemment la personne qui compte pour lui, pas son appartenance.
« Se battre, forniquer et gagner de l’argent sont les choses les plus faciles au monde. Ayant moi-même pratiqué les trois, je sais de quoi je parle. Je continue à gagner de l’argent comme je peux. Quand on a commencé, on ne peut plus s’arrêter. Cet argent m’en rapporterait lui-même encore plus si je l’avais mis à la banque et touchais les intérêts tous les ans. « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l’abondance mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. » [Matthieu] L’ennui, maintenant que je l’ai, c’est que je ne sais pas quoi en faire. Je ne vivrai pas éternellement et il faut bien que je le lègue à quelqu’un. J’ai dû parcourir plusieurs centaines de kilomètres ces dernières années pour rendre visite à des parents plus ou moins éloignés à la recherche d’un héritier valable. »
Ebenezer parvient finalement à se trouver un digne héritier, Neville Falla, qui plus jeune avait cassé des vitres de sa serre, a gardé une réputation de voyou et est devenu un peintre enthousiaste.
« Je me suis dit que c’était lui l’ancêtre et moi le jeune, car de nos jours les enfants naissent déjà vieux et c’est à nous, les anciens, de leur apprendre à retrouver leur jeunesse. »
« De nos jours, quand on discute avec les gens, rien n’existe à moins que la télé en ait parlé. Elle donne aux gens l’impression d’avoir tout vu et de tout savoir, alors qu’ils n’ont jamais rien vu et ne savent rien. C’est la drogue la plus nocive au monde. Les gens poussent de grands cris indignés quand les jeunes fument de l’herbe. Mais la télévision est l’herbe de millions de drogués qui, les yeux ronds, la regardent tous les soirs. »
J’ai lu sans ennui ces quelques 600 pages, et sans doute leur charme tient aux grandes justesse et humanité dans le rendu, à tel point que le lecteur peine à croire à une fiction. Style conventionnel, jusqu’au relatif happy end en passant par un respect global de la chronologie. Mention spéciale pour les trop rares expressions en guernesiais, proche du normand.
\Mots-clés : #historique #identite #insularite #lieu #religion #ruralité #temoignage #vieillesse #xxesiecle
- le Mer 31 Mai - 13:32
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Gerald Basil Edwards
- Réponses: 3
- Vues: 283
Jon Krakauer
Into the Wild (Voyage au bout de la solitude)
Ce récit, au départ un article de Krakauer, relate la tentative du jeune Christopher McCandless de vivre seul dans l’Alaska sauvage (Sean Penn en a tiré un film dont j’ai gardé le souvenir à cause du bus abandonné dans lequel on retrouvera son corps).
« Au cours de l’été 1990, tout de suite après l’obtention de son diplôme de fin d’études, avec mention, à l’université Emory, son entourage le perdit de vue. Il changea de nom, fit don de ses 24 000 dollars d’économies à une œuvre humanitaire, abandonna sa voiture et presque tout ce qu’il possédait et brûla les billets de banque qu’il avait dans son portefeuille. Puis il vécut une nouvelle vie, logeant chez des marginaux dépenaillés et parcourant l’Amérique du Nord à la recherche de l’expérience pure, transcendante. Sa famille ignorait complètement ce qu’il était devenu, jusqu’à ce qu’on retrouve ses restes en Alaska. »
Inspiré par Léon Tolstoï, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau (« la Désobéissance civile »), Boris Pasternak, Mark Twain et surtout Jack London, Chris quitte les siens et, épris de liberté, prend la route. Il se surnomme lui-même Alexander Supertramp et écrit son journal à la troisième personne du singulier ; il mène la vie errante des vagabonds à travers les États-Unis (y compris une descente du Colorado en canoë jusqu’au Mexique) pendant deux ans, subsistant de petits boulots et de plantes sauvages, faisant de belles rencontres.
Krakauer expose son enquête débutée dès que le corps de Chris est découvert, ses rencontres avec des amis de McCandless, les antécédents similaires en Alaska, comme Everett Ruess (apparemment déjà présenté par Wallace Stegner). Nombre d’autres écrivains de la wilderness sont évoqués, comme John Muir, Edward Abbey. Mais ce qu’on peut savoir de Chris forme un portrait qui me paraît confus. Il me semble qu’on peut retenir qu’il était intrépide (ou téméraire), soucieux de se prouver son autonomie, attiré par l’aventure, et aussi idéaliste antisocial, « romantique », en quête de vérité.
Puis Krakauer raconte en comparaison son cas personnel, et son ascension du Devils Thumb (le Pouce du Diable), en Alaska.
« Et puis brusquement, il n’y eut plus d’endroit où grimper. »
En avril 1992, Chris part seul sur la piste Stampede, avec pour tout bagage cinq kilos de riz, une carabine 22 Long Rifle et quelques livres. Après deux mois de vie dans la taïga aux abords de l’autobus, seul vestige d’un projet abandonné de route minière, il veut revenir, mais la rivière qu’il a passé à gué est devenue infranchissable.
« Il tenta de vivre entièrement sur le pays, et il le fit sans se soucier d’apprendre auparavant à maîtriser tout le répertoire des techniques indispensables. »
Krakauer relate comme il découvrit l’autobus avec tout ce qu’y a laissé Chris, cite le journal où sont énumérés les gibiers et baies consommés par celui qui va mourir de faim (et possiblement d’un empoisonnement par un alcaloïde végétal).
Dans cette revue des "appels de la forêt" contemporains, j’ai été frappé par l’importance marquante de la beauté de la nature (simultanément avec la soif de liberté, d'aventure et de vérité).
\Mots-clés : #aventure #biographie #jeunesse #nature #solitude #temoignage #voyage
- le Mer 10 Mai - 13:03
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Jon Krakauer
- Réponses: 1
- Vues: 187
William Gardner Smith
Le visage de pierre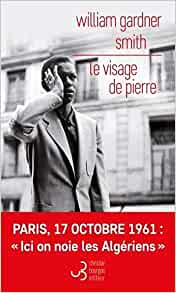
« Âgé d’un peu moins de trente ans, c’était un Noir et il s’appelait Simeon Brown. Il avait un seul œil valide ; une pièce de tissu noir recouvrait l’orbite de l’autre. »
Il vient de "fuir" les USA et le racisme pour le Quartier latin des années 60 ; journaliste et peintre amateur, il travaille à un portrait toujours recommencé, celui de « la tête massive d’un homme, ébauchée si rudement qu’on l’aurait dite taillée dans la pierre ».
Le roman évoque le milieu des jeunes « réfugiés » noirs américains comme lui :
« Il y a en Europe une nouvelle Génération perdue, plein de Noirauds américains qui vivent à Paris ou à Copenhague, à Amsterdam, Rome, Munich ou Barcelone, qui sont venus ici pour échapper à cette pression, si tu vois ce que je veux dire ? »
Il évoque aussi l’enfance du timide Simeon dans la violence de Philadelphie, la perte de son œil pour devenir un homme.
Dans les cafés de Paris, Simeon est un Blanc, les Algériens (vus par les Noirs américains comme des Blancs) sont les négros (livre paru en 1963).
Simeon et Maria, une actrice polonaise rescapée des camps d’extermination qui risque de devenir aveugle, sont épris l’un de l’autre. Maria est Juive, et à ce titre prise à partie par les Arabes.
Dès le départ Gardner Smith évoque la pulsion de meurtre-haine de Simeon, déjà évidemment aux USA (qu’il voulait fuir) mais aussi en France, où il retrouve le « visage de pierre ». Là, il a des contacts avec les Américains blancs, mais assez troubles. Il découvre la ségrégation des « bicots » et leurs bidonvilles, qu’il rapproche de Harlem ; son ami Ahmed, un étudiant, rejoint le FLN. Tandis qu’il se détache de Maria, prise par son métier, il réalise progressivement que sa voie est dans l’action. Il intervient contre la répression policière pendant la manifestation du 17 octobre 1961, puis repart aux USA.
\Mots-clés : #exil #racisme #temoignage #violence
- le Lun 6 Mar - 11:47
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William Gardner Smith
- Réponses: 15
- Vues: 392
Panait Istrati
Les Chardons du Baragan
Incipit :
« Quand arrive septembre les vastes plaines incultes de la Valachie danubienne se mettent à vivre, pendant un mois, leur existence millénaire. »
C’est le baragan, plaine continentale roumaine, « ogre amoureux d’immensité inhabitable » et « assoiffé de solitude », désert où ne poussait que les chardons, qui secs étaient emmenés par le Crivatz (vent froid), comme les virevoltants ou tumbleweeds des westerns.
À neuf ans, le narrateur y part avec son père, dans l’objectif de vendre le poisson qui abonde chez eux, et manque ailleurs.
« Bon pays, mauvaise organisation :
Sacré nom d’un règlement !
C’était cela : un pays riche, mal organisé et mal gouverné ; ma mère le savait comme tout paysan roumain. »
Mais l’expédition est un échec, la mère décède, et à quatorze ans Mataké se sépare de son père pour partir à l’aventure derrière les « petites meules de broussaille » avec son ami Brèche-Dent : il réalise le rêve de tous les enfants, s’évader « à la découverte du monde », « quitter la maison et s’en aller par le monde ».
Ils sont recueillis comme argats [« Valets de ferme »] dans une famille paysanne miséreuse (peut-être les cojans, terme récurrent mais non explicité, comme trop d’autres).
« Sous un ciel si terreux qu’on eût dit la fin du monde, on voyait les chars avancer comme des tortues, sur des champs, sur des routes, sur une terre que Dieu maudissait de toute sa haine. Chars informes ; bêtes rabougries ; hommes méconnaissables ; fourrage boueux ; et aucune pitié nulle part, ni au ciel ni sur la terre ! Nous avions pourtant besoin de pitié divine autant que de pitié humaine, car les chars s’embourbaient ou se renversaient ; car les bêtes tombaient à genoux et nous demandaient grâce ; car les hommes battaient les bêtes et se battaient entre eux ; car les ciocani [« Tiges de maïs, dont les feuilles servent de fourrage et le déchet de combustible »] pourrissaient dans les mares et il fallait en transporter les gerbes à dos d’homme, à dos de femme, à dos d’enfant, et ces hommes, ces femmes, ces enfants n’étaient plus que des tas de hardes imbibées de boue, de grosses mottes de terre pantelante sous l’action de cœurs inutiles.
Tels étaient les paysans roumains, à l’automne de 1906. »
Mataké est tombé amoureux de Toudoritza, ma belle demoiselle éconduite par son amoureux à cause du boyard. Grand nettoyage (deux fois par an, pour Pâques et Noël) :
« Nous vidâmes deux pièces, en entassant les meubles dans une troisième. Au milieu de la tinda, trois brouettes de glaise jaune comme le safran et une brouette de crottin de cheval furent versées avec de l’eau chaude par-dessus, et je fus chargé de piétiner le lut sur le sol des chambres dont Toudoritza badigeonnait les murs en chantant à tue-tête. Elle s’était affublée de vieux vêtements de sa mère ; complètement enfouie, chevelure et visage, sous une grande basma qui ne laissait voir que ses beaux yeux, et armée d’une brosse à long manche, elle couvrait murs et plafond de cette couche de chaux bleuâtre qui fait la joie et la santé du paysan roumain et que connaissent seuls les villages balkaniques. Le badigeonnage fini, ce fut le tour du sol. Le temps de fumer une pipe, il se fit aussi lisse qu’une table, sous les mains adroites de Toudoritza qui le nivelait en marchant à reculons.
Une semaine durant, nous vécûmes une vie de rescapés, couchant un soir ici, le lendemain là, comme ça se trouvait, et mangeant sur le pouce, dans une atmosphère de salle de bain turc dont la vapeur, sentant la chaux et la bouse, nous piquait le nez. »
Mais une mauvaise récolte suscite une famine qui désespère les paysans.
« Soudain, une nouvelle tomba dans le village, comme l’éclair d’une explosion. En Moldavie, les paysans avaient brûlé le konak du grand fermier juif Ficher ! C’est M. Cristea qui nous lut cette nouvelle, dans un journal. Et ce journal concluait : « Cela apprendra aux Juifs à exploiter les paysans jusqu’au sang. À bas, à bas les Juifs ! »
Les cojans qui écoutaient se regardèrent les uns les autres :
– Quels Juifs ? Dans notre département il n’y en a pas ! Et même ailleurs, ils n’ont pas le droit d’être propriétaires ruraux. Or, les fautifs, ce sont les propriétaires, non les fermiers.
À ces paroles, toutes les faces se tournèrent du côté du konak. »
Et les villageois révoltés brûlent le konak. (Un konak est un palais, une grande résidence en Turquie ottomane ; il doit en être de même ici, à propos de la demeure du boyard.) La bourgade est bombardée par l’armée, c’est un massacre.
Outre le témoignage sur une Roumanie rurale misérable et l’insurrection de 1907, ainsi que ses charmes de conte, ce roman offre un éclairage original sur le goût du départ et l’émigration.
\Mots-clés : #historique #lieu #misere #ruralité #temoignage
- le Ven 17 Fév - 12:24
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Panait Istrati
- Réponses: 20
- Vues: 1364
Paolo Rumiz
Appia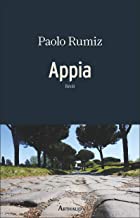
ArenSor nous a déjà présenté ce récit dans un commentaire approfondi, s’y reporter pour une description générale de l’ouvrage. Heureusement, il y a tant dans ce livre si dense que je vais pouvoir y glisser mon petit grain de sel…
C’est donc la redécouverte, presque une découverte, de la Via Appia, « la reine de toutes les routes », « la première route d’Europe », en grande partie oubliée, voire disparue. Périple à quatre randonneurs, pas pèlerins mais routards, « entre la rage et l’émerveillement », de l’antique en mafias en passant par les cuisines régionales (et sans éviter l’incontournable Padre Pio), de Rome la Dominante à Capoue puis Brindisi, du Nord au Sud et l’Est.
D’entrée le ton est vif, stigmatisant l’incurie, la « dilapidation » et bien d’autres maux actuels comme la paysannerie bradée – de ruines en ruines, plus ou moins récentes – et prônant les « paroles "narrabondes" » :
« …] le nomade préfère les paroles prononcées, capables de voler, plutôt que les paroles écrites, condamnées à « rester ». Il sait que la lecture silencieuse détache du monde et porte à la solitude. Les caractères de l’écriture phonétique ont été inventés pour être écoutés et partagés, et aujourd’hui le livre, pour ne pas mourir, a un besoin urgent de redevenir au plus vite le lieu de la voix. Chant, métrique, allure. Tendez l’oreille : dans l’antre des trésors, la Parole résonne que c’en est une merveille. »
Quelques autres extraits au fil de la lecture :
« Suivre notre route de bout en bout équivaut à se réapproprier le pays. »
« Rome, c’était avant toute autre chose le génie civil, la logistique, l’architecture. Routes, ponts, aqueducs, relais de poste. »
« "Vous êtes d’où ?" nous demande le jeune berger qui les suit, avachi dans sa voiture, la casquette à l’envers, visière sur la nuque, le bras gauche pendant le long de la portière. Il n’a jamais vu personne passer à pied sur ce chemin. Les Italiens ne marchent pas dans le ventre du pays.
[…]
Il rit, il se démanche le bras pour nous saluer et passe son chemin, klaxonnant derrière son troupeau lancé à l’assaut de l’abreuvoir, dans un sillage de crottes. Le berger en voiture et les bourgeois à pied : la situation est d’un comique évident. »
« Nous cherchions à faire renaître une route de l’Antiquité, au lieu de quoi nous assistons, lézarde après lézarde, éboulement après éboulement, à la mort en direct d’une route de l’ère moderne. »
« Les Pouilles étaient bien vertes, alors. Aujourd’hui est venu le temps du bitume et des désherbants. »
« Je me rends compte qu’il faudrait un minimum d’efforts pour maintenir cette route en état. »
« Rome était un empire fondé sur les choses. "Res" : entends la force lapidaire de ce mot qui ne laisse aucune place à de verbeuses échappatoires. »
« La lenteur complique les choses, répète toujours Riccardo, et moi, je veux une vie compliquée. »
J’ai pu mesurer combien peu je connais l’Italie (histoire, géographie, cuisine) – mais après tout, les Italiens eux-mêmes…
Une idée de randonnée pour Avadoro ?!
\Mots-clés : #Antiquité #historique #temoignage #voyage
- le Dim 30 Oct - 11:11
- Rechercher dans: Nature et voyages
- Sujet: Paolo Rumiz
- Réponses: 22
- Vues: 4023
Annie Ernaux
Les armoires vides
Denise, « Ninise » Lesur, jeune étudiante, subit un avortement clandestin, et évoque son enfance. Une enfance dans un milieu méprisé (a posteriori), en fait assez heureux (parents faisant « tout » pour elle, chère abondante – c’est l’après-guerre), modeste mais relativement privilégié (commerçants) : la misère est en réalité autour (avec notamment l’alcoolisme), même si on baigne dedans (d’autant plus avec la promiscuité).
« Malheurs lointains qui ne m'arriveront jamais parce qu'il y a des gens qui sont faits pour, à qui il vient des maladies, qui achètent pour cinquante francs de pâté seulement, et ma mère en retire, elle a forcé, des vieux qui ont, a, b, c, d, la chandelle au bout du nez en hiver et des croquenots mal fermés. Ce n'est pas leur faute. La nôtre non plus. C'est comme ça, j'étais heureuse. »
Puis l’autre monde, celui de l’école (libre) ; humiliation sociale, et culpabilité (le péché) insinuée par l’aumônier à la « vicieuse » avec son « quat'sous » (son sexe, avec connotation de peu de valeur) ; puis revanche de première de la classe. Et la lecture.
« Ces mots me fascinent, je veux les attraper, les mettre sur moi, dans mon écriture. Je me les appropriais et en même temps, c'était comme si je m'appropriais toutes les choses dont parlaient les livres. Mes rédactions inventaient une Denise Lesur qui voyageait dans toute la France – je n'avais pas été plus loin que Rouen et Le Havre –, qui portait des robes d'organdi, des gants de filoselle, des écharpes mousseuses, parce que j'avais lu tous ces mots. Ce n'était plus pour fermer la gueule des filles que je racontais ces histoires, c'était pour vivre dans un monde plus beau, plus pur, plus riche que le mien. Tout entier en mots. Je les aime les mots des livres, je les apprends tous. »
« Pour moi, l'auteur n'existait pas, il ne faisait que transcrire la vie de personnages réels. J'avais la tête remplie d'une foule de gens libres, riches et heureux ou bien d'une misère noire, superbe, pas de parents, des haillons, des croûtes de pain, pas de milieu. Le rêve, être une autre fille. »
Rejet du moche, du sale, du café-épicerie de la rue Clopart, honte haineuse d’une inculture (pourtant compréhensible), envie aussi de la vie des autres jeunes, de la liberté : l’adolescente veut "s’en sortir".
Premières menstrues, « chasse aux garçons », découverte du plaisir ; avec quand même la crainte confuse de mal tourner, comme redoutent les parents (qui triment pour lui permettre de poursuivre ses études).
« Dans l'ordre, si tout y avait été, une maison accueillante, de la propreté, si je m'étais plu avec eux, chez eux, oui, ce serait peut-être rentré dans l'ordre. »
Dix-sept ans, l’Algérie et mai 68 en toile de fond, et ce besoin (à la fois légitime et choquant) d’être supérieur à sa condition d’origine.
« J'inscris des passages sur un petit carnet réservé, secret. Découvrir que je pense comme ces écrivains, que je sens comme eux, et voir en même temps que les propos de mes parents, c'est de la moralité de vendeuse à l'ardoise, des vieilles conneries séchées. »
« Mais la fête de l'esprit, pour moi, ce n'est pas de découvrir, c'est de sentir que je grimpe encore, que je suis supérieure aux autres, aux paumés, aux connasses des villas sur les hauteurs qui apprennent le cours et ne savent que le dégueuler. »
Étudiante enfin, puis c’est la « dé-fête », elle est enceinte, et avorte clandestinement.
« J'ai été coupée en deux, c'est ça, mes parents, ma famille d'ouvriers agricoles, de manœuvres, et l'école, les bouquins, les Bornin. Le cul entre deux chaises, ça pousse à la haine, il fallait bien choisir. »
Contrairement à ce qui est parfois prétendu, Ernaux a "un style".
« Ça me fait un peu peur, ça saignera, un petit fût de sang, lie bleue, c'est mon père qui purge les barriques et en sort de grandes peaux molles au bout de l'immense rince-bouteilles chevelu. Que je sois récurée de fond en comble, décrochée de tout ce qui m'empêche d'avancer, l'écrabouillage enfin. Malheureuse tout de même, qui est-il, qui est-il... Mou, infiniment mou et lisse. Pas de sang, une très fine brûlure, une saccade qui s'enfonce, ce cercle, ce cerceau d'enfant, ronds de plaisir, tout au fond... Traversée pour la première fois, écartelée entre les sièges de la bagnole. Le cerceau roule, s'élargit, trop tendu, trop sec. La mouillure enfin, à hurler de délivrance, et macérer doucement, crevée, du sang, de l'eau. »
« Le goût de viande crue m'imbibe, les têtes autour de moi se décomposent, tout ce que je vois se transforme en mangeaille, le palais de dame Tartine à l'envers, tout faisande, et moi je suis une poche d'eau de vaisselle, ça sort, ça brouille tout. Le restau en pleine canicule, les filles sont vertes, je mange des choses immondes et molles, mon triomphe est en train de tourner. Et je croyais qu'il s'agissait d'une crise de foie. Couchée sur mon lit, à la Cité, je m'enfilais de grands verres d'hépatoum tout miroitants, une mare sous des ombrages, à peine au bord des lèvres, ça se changeait en égout saumâtre. La bière se dénature, je rêve de saucisson moelleux, de fraises écarlates. Quand j'ai fini d'engloutir le cervelas à l'ail dont j'avais une envie douloureuse, l'eau sale remonte aussitôt, même pas trois secondes de plaisir. J'ai fini par faire un rapprochement avec les serviettes blanches. Une sorte d'empoisonnement. »
Et pour une écriture "blanche" (certes peu métaphorique), j’ai découvert plusieurs mots nouveaux pour moi : décarpillage, cocoler, polard, pouque et mucre (il est vrai cauchois), etc. ; curieusement (pourtant dans l’œuvre d’une écrivaine nobelisée !), je n’ai pas trouvé en ligne la définition de "creback", apparemment une pâtisserie, ni « troume » (peur vraisemblablement).
Dès ce premier roman, Ernaux parvient, avec l'originalité de son écriture, à nous transmettre une expérience commune. C'est peut-être ça qui explique l'oppression ressentie à cette lecture, comme signalée par Chrysta : Ernaux n'est pas une auteure d'évasion, c'est tout le contraire, on est sans cesse durement ramené à la triste réalité.
\Mots-clés : #autobiographie #conditionfeminine #contemporain #enfance #identite #intimiste #Jeunesse #Misère #relationenfantparent #sexualité #social #temoignage #xxesiecle
- le Ven 28 Oct - 11:23
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Annie Ernaux
- Réponses: 136
- Vues: 12236
Henri Michaux
Misérable Miracle, La mescaline
« Scription » sous mescaline autoadministrée, y compris 48 fac-similé de dessins et notes manuscrites, de quelques expériences de cette drogue avec ses effets à plus ou moins long terme : mouvements alternatifs rapides jusqu’à la vibration, symétries et répétitions, une « tendance à l'allongement, réalisée dans les objets et les hommes », visions « grotesques », etc.
« J'étais dans un mécanisme d'infinité. »
Michaux présente aussi une intéressante comparaison des effets de la mescaline et du haschich. Ce dernier rendrait le relief que la représentation en deux dimensions retire toujours :
« La photographie, contrairement à ce qu'on a cru, (ce qui fait qu'elle pourrait presque passer pour une des causes de l'art abstrait), est cette représentation en fonction de la lumière, spectacle parfait, où vous ne pouvez entrer, quoiqu'il s'agisse de lieux, d'objets, de personnes. Vous passez devant. Vous les passez en revue. Au contraire des tableaux d'autrefois, occidentaux, chinois, persans... elle ne vous met pas au fait des distances, des interdistances qu'il faudrait sentir pour que vous vous mêliez aux êtres et aux lieux représentés. Elle est opaque. Vous êtes repoussé de l'endroit même que vous admirez, par la méticulosité des ombres et des lumières, glacis fâcheux doué d'étanchéité. »
Récit frappant d’une surdose, « expérience de la folie », ravages tourbillonnaires et aussi conséquences dans les semaines suivantes, délires d’enfermement et de persécution, bouffées de violence y compris autodestructrice, interruptions de conscience, toujours avec cette minutie d’observation clinique caractéristique de Michaux, ce rendu qui éclaire les dérèglements et aliénations mentaux comme ses autres textes, et des prolongements métaphysique, spirituel.
« Tout ce que vous présenterez à la schizo mescalienne sera broyé. Ne vous présentez donc pas vous-même. Et ne lui présentez aucune idée vitale, car c'est horrible ce qu'elle en fait.
Présentez le peu important, des images, de petites idées courantes.
Sinon vous serez totalement inhabitable, vous faisant horreur, votre maison dans le torrent, objet de dérision pour vous-même. »
« L'essenciation, qui peut la supporter ? La tendance à l'essence est un plaisir de vertige, une secrète frénésie. »
\Mots-clés : #essai #temoignage
- le Lun 29 Aoû - 11:30
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Henri Michaux
- Réponses: 60
- Vues: 5889
Ryōko Sekiguchi
Ce n'est pas un hasard (Chronique japonaise)
« Chronique tenue du 10 mars au 30 avril 2011, sur la superposition des images, la mémoire des villes, le hasard, la temporalité de la description et les noms propres qui surgissent, fantomatiques, lors d’une catastrophe. »
C’est donc les réflexions de Ryoko Sekiguchi sur les catastrophes du tremblement de terre, du tsunami et de Fukushima, qu’elle a suivies de Paris (puis sur place).
« Je voulais essayer de décrire cette atmosphère palpable et néanmoins indéfinissable de la présence de quelque chose qui n’existe pas encore. »
« L’important, quand on s’interroge sur "ce qui est possible après une catastrophe", question maintes fois posée de par le monde, c’est d’avoir à l’esprit que l’on est aussi à la veille d’autres catastrophes à venir, donc qu’il faut également s’interroger sur ce que l’on peut écrire avant une catastrophe, ou entre deux catastrophes, qui est l’état permanent dans lequel nous vivons. »
« Tout discours sur la catastrophe est fatalement lié à, voire hanté par, la question du temps. »
« Qu’est-ce que j’aurais pu faire dans un lieu d’accueil si je n’avais pas de livre ? Le livre quantifie le temps, il le rend pour ainsi dire concret. Sans cet instrument, l’attente s’éternise, le temps se dilue. Pour ma part, je ne peux pas concevoir de me retrouver où que ce soit sans livre. Même si je ne peux pas me concentrer, si je n’arrive pas à lire, le seul fait d’en avoir un sous la main, que je pourrais ouvrir au besoin, m’apaise. Mais bien sûr, ce n’est là qu’une supposition. Que puis-je savoir du temps qui s’écoule dans un lieu d’accueil ? »
« Dans le magazine Focus, un article intitulé "Dans le cercle de vingt kilomètres autour de Fukushima, même les ombres se sont évaporées". Encore une superposition d’images. Les ombres, l’évaporation : Hiroshima. »
« Plus que la crainte d’être réellement touchés par la radioactivité japonaise, moins probable qu’avec Tchernobyl du fait de la distance, je crois que la terreur des Européens aujourd’hui est due au fait qu’ils savent qu’ils devront désormais compter l’accident nucléaire parmi les risques réels, eux aussi. »
« Hiroshi Yamaguchi, économiste, écrit qu’il ne faut pas chercher à "éradiquer" les rumeurs à tout prix. Bien sûr, il faut dissiper les rumeurs infondées qui mettent des personnes en danger. Mais à la moindre rumeur qui court sur internet, on voit maintenant se mettre en place, à plus ou moins brève échéance, un système autorégulé de vérification des données qui indexe, avec la rumeur, d’autres informations utiles. Si, par crainte de la rumeur, l’on se met à censurer à titre préventif toute information non vérifiée, on se prépare une société dépourvue d’"anticorps" face à la rumeur, et donc fragile. »
« Le livre a fatalement une fin. Et fatalement, la réalité n’en a pas. […]
Au bout du compte, je ne suis pas parvenue donner une fin heureuse à ce livre. Puisque la fin n’existe pas. »
Décidément une auteure qui porte un regard neuf et fin sur des sujets rebattus avec une écriture juste.
\Mots-clés : #catastrophenaturelle #temoignage
- le Lun 15 Aoû - 12:10
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: Ryōko Sekiguchi
- Réponses: 8
- Vues: 580
Pedro Cesarino
L’attrapeur d’oiseaux
Un anthropologue brésilien retourne une fois de plus dans sa famille adoptive amérindienne qu’il étudie, haut sur un fleuve amazonien de Colombie, mais cette fois il est las et mélancolique, quoique toujours torturé par le désir sexuel et obsédé par le mythe de l’attrapeur d’oiseaux, qu’il n’a jamais pu appréhender.
« …] je vais enfin pouvoir de nouveau m’empêtrer dans les trames des rivières et des histoires, en premier lieu celle qui me manque, celle de l’attrapeur d’oiseaux, ce récit étrange dont, pour une raison ou une autre, les racines d’un arbre obscur et inaccessible m’enveloppent. »
Avec la remontée du fleuve, je retrouve une fois encore cet univers fascinant, ces images rares qui ont demandé heures et journées de navigation pour devenir de justes métaphores.
« À ce stade du voyage, le fleuve n’est plus l’immense miroir du début, il est désormais mesurable. Nous apercevons ses deux rives qui forment peu à peu un couloir sinueux et interminable, un couloir-estomac qui nous aspire dans son tempo. »
« Des berges à n’en plus finir, des marigots et des lignes droites qui commencent à altérer la vue et l’ouïe. Le fleuve semble pénétrer comme un ver dans les concavités du cerveau et en modifier les axes. »
Cesarino cite « le vieux Français », Lévi-Strauss, dont la pensée et Tristes tropiques (ainsi que Saudades do Brasil) hantent le texte.
« En vérité, le mythe de référence n’est rien d’autre, comme nous essaierons de le montrer, qu’une transformation d’autres mythes provenant soit de la même société, soit de sociétés proches ou éloignées. »
Il commente :
« La variation des récits constitue pourtant une gymnastique mentale. Elle n’aurait de sens que si elle était motivée par quelque chose de plus – l’expérience de raconter une histoire, peut-être, ou d’être traversé par elle –, par autre chose se trouvant derrière les mots, par un monde singulier. »
Avec la fatigue, le paludisme, les rêves nocturnes, quelques substances absorbées, l’atmosphère est onirique, divinatrice (on peut penser Au cœur des ténèbres de Conrad) ; ainsi le rêve de Pasho, le nain :
« Il a rêvé des chairs et des os de sa mère éparpillés partout dans le ciel. La voûte bleue avait été envahie des os et des chairs de sa défunte mère, qu’il n’a pourtant pas connue, comme s’il s’agissait d’une couverture en patchwork ensanglantée. L’image m’impressionne, un ciel constellé d’os et de chairs, une mère-monde à l’envers. »
Un vague mal-être ronge l’anthropologue parvenu aux malocas de ses amis, dont il partage le quotidien et parle la langue, tandis que des prédictions apocalyptiques annoncent de proches perturbations. S’interrogeant sur le monde extérieur, « Manaus, Europe, Jérusalem », les caciques se réunissent pour choisir un nouveau « président » (et demandent au narrateur de leur ramener une fusée pour voyager plus vite qu’en pirogue), tandis que meurt le vieux pajé (chaman), le « grand épervier » :
« Quand une personne de la valeur d’Apiboréu meurt, il est interdit de faire le moindre effort. On s’allonge.
Les arbres semblent grandir derrière nous, tandis que nous passons devant d’autres villages et sommes suivis par toutes les pirogues qui descendent sans pagaies ni moteur, juste portées par le courant. Au-dessus de nos têtes, un phénomène inhabituel : des oiseaux de proie, qui d’ordinaire volent seuls, nous accompagnent en bande, comme si c’étaient des urubus. Harpies féroces, faucons aplomado, caracas huppés, ils assombrissent le ciel grisâtre de cette étrange journée. »
La cosmologie, c'est-à-dire le mythe en tant que façon de penser l’Autre, est bien sûr au centre du livre.
Le nom du benjamin des quatre frères fondateurs du monde, Amatseratu, le jeune « décepteur » mythique, le gâcheur, d’ailleurs entouré d’allusions au Japon, ne serait-il pas une référence facétieuse à la déesse solaire japonaise ?
L’anthropologue se sent seul, malmené entre ses incompréhensions et ses maladresses en passant par les malentendus, partagé entre la poursuite de son travail et le retour aux siens – enfin, ses autres proches. Cette autre civilisation se résumera aux aventuriers malfaiteurs rencontrés au départ et à la grotesque visite des missionnaires fondamentalistes nord-américains.
\Mots-clés : #amérindiens #autofiction #contemythe #merlacriviere #minoriteethnique #ruralité #temoignage #traditions
- le Dim 31 Juil - 12:48
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Pedro Cesarino
- Réponses: 2
- Vues: 381
Paul Léautaud
Le petit ami
Léautaud se propose, dès le commencement de son premier roman et en référence aux Souvenirs d’égotisme de Stendhal (dont il était féru), d’évoquer ses souvenirs d’enfance et de sa mère disparue, qu’il retrouve un peu chez ses petites amies dans son Paris natal.
« Moi qui pourtant me regarde sans cesse agir et rêver, jamais je n’avais encore autant pensé à moi. »
« Presque chaque soir je partais pour aller retrouver mes amies et me préparer auprès d’elles à écrire ce livre. »
Très tôt, il est attiré par les femmes, notamment les prostituées, et le voilà, vers la trentaine, passant ses soirées à la Belle Époque (celle notamment de Toulouse-Lautrec), surtout aux Folies-Bergère, avec lesdites lorettes ou cocottes − femmes légères, de plaisir, complaisantes, frivoles et/ou volages, s’il est possible de faire abstraction de la connotation péjorative de ces expressions, à prendre à la lettre en admettant qu’une femme puisse être libre de disposer de son corps.
« Pas besoin, avec elles, de faire des phrases. Un coup d’œil significatif, un court colloque, et l’on va s’aimer. »
« Il lui suffit de se prêter, de créer du bonheur, de laisser jouir de sa beauté, de ses gestes bienfaisants apportant à plaire et à satisfaire des soins toujours neufs et, ce qui est inestimable, une impudeur à peine obscène. »
« Ce n’était pas de l’amour que je venais demander à ces femmes. Mes projets de littérature me fatiguaient bien assez. C’était de la grâce, de la douceur, quelque chose qui relevât la fadeur de mes journées, passées à des besognes, parmi des gens sans tendresse. »
Il se présente lui-même comme un personnage otieux, nonchalant et sensible (voire romanesque), las de la littérature où il besogne peu à ses ambitions ; mais surtout il peint ce milieu à la fois brillant, languide et frénétique, et plus encore ses amies, avec tendresse et sincérité, et même un ton trompeusement badin, une ironie à peine perceptible (cf. la mort de la Perruche à l’hôpital). Puis Léautaud narre son ardente passion, assez équivoque, pour sa mère qu’il retrouve momentanément.
« Avoir grandi seul, élevé par des mains étrangères… M’être tant promis de la séduire, pendant tant d’années, si jamais je la retrouvais… »
Léautaud termine en résumant sa méthode d’écriture.
« Je parle de ce travail, le seul vrai, qui consiste à ne rien faire, à penser seulement à ce que l’on veut faire, à le distribuer en soi, à le voir en soi, par fragments et en entier, etc. »
\Mots-clés : #autobiographie #creationartistique #intimiste #jeunesse #nostalgie #temoignage #xxesiecle
- le Ven 29 Juil - 12:04
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Paul Léautaud
- Réponses: 9
- Vues: 430
Albert Londres
L’Homme qui s’évada(Adieu Cayenne ! serait une nouvelle version de 1932.)

Camille-Eugène-Marie Dieudonné, ébéniste proche de la mouvance anarchiste, est accusé d'appartenir à la bande à Bonnot, et d'avoir participé à l'attaque d'un agent de change ; probablement innocent, il est condamné à la guillotine et gracié par Poincaré, puis envoyé aux travaux forcés dans le bagne de Cayenne, où Londres le rencontre en 1923 (voir son enquête Au bagne).
Comme dans Une journée d'Ivan Denissovitch (Soljenitsyne) et les autres camps de concentration,
« Ce ne sont pas les gardiens qui gardent les forçats au bagne, ce sont les forçats qui se gardent mutuellement. »
Londres retrouve Dieudonné en 1927 au Brésil, comme sa troisième tentative d’évasion a réussi. Il le laisse parler, et le livre est leur dialogue. Sa relation est haute en couleur : naufrage en pirogue et séjour dans la mangrove, puis en forêt, traqués par les « chasseurs d’hommes », nouveau départ avec l’étonnant Strong Devil, de Sainte-Lucie, « au nom du Diable » :
« Comptez. Dans la première pirogue : six. L’un est mort ; trois autres sont repris ; Jean-Marie rentre au bagne sur le Casipoor [extradé par le Brésil] ; moi, je suis assis sur mes dalles, derrière mes barreaux.
Cinq dans la seconde pirogue. Ne parlons plus de Jean-Marie et de moi ; le troisième : mort ; les deux autres : pas encore à Belém après quatre mois, ce qui signifie qu’ils n’ont pas réussi. »
On assiste à la noyade de l’un, à l’agonie de « l’Autre ».
« L’Autre vit encore. »
Expérience vécue, avec la confusion des faits véridiques, mais aussi de véritables qualités humaines.
« Quelques maisons.
(Ceux qui n’ont pas entendu Dieudonné – c’est-à-dire vous tous – prononcer à cette minute ces deux mots : quelques maisons, n’entendront jamais tomber du haut de lèvres humaines la condamnation du désert !) »
Quelques inexactitudes cependant, et des faits difficiles à croire.
« – On se nourrissait. L’homme peut manger ce que le singe mange. On les observait. Vous ne pouvez imaginer comme c’est rigolo à regarder vivre les singes ! Ainsi, ils craignent l’eau. Savez-vous comment ils passent les criques ? Le plus fort s’attache à une branche haute ; un autre se pend après le premier, et tous se pendent à la suite, de manière à faire juste la longueur de la crique, dix mètres, vingt mètres, ça dépend. Jamais ils ne se trompent.
Quand ils sont le nombre qu’il faut, ils se mettent à se balancer, le singe de queue attrape une branche de l’autre côté de la crique. Le pont suspendu est établi. Toute la tribu le traverse, dos en bas. Quand elle a passé, le singe de tête, celui qui soutenait la guirlande, lâche tout. Et le "pont" ainsi détaché franchit l’eau redoutée. »
Profitant d’un imbroglio politique, le forçat est paradoxalement protégé par la police brésilienne, qui refuse de le renvoyer à l’administration pénitentiaire française ; il pourra revenir en France avec Londres, gracié.
\Mots-clés : #captivite #exil #historique #temoignage
- le Sam 19 Fév - 11:24
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Albert Londres
- Réponses: 2
- Vues: 648
Alexandre Soljenitsyne
Une journée d'Ivan Denissovitch
Une journée de Choukhov, matricule CH-854, dans un goulag où, condamné à dix ans (au moins) pour avoir été fait prisonnier par les hitlériens pendant la Seconde Guerre mondiale (il aurait pu avoir été retourné comme espion...), il est maçon dans la construction d’une centrale électrique, depuis huit ans (on est en 1951). Le texte, extrêmement factuel et prosaïque, très lisible, est chronologique, rapportant les échanges des prisonniers, avec quelques passages en italiques qui explicitent des situations. Parmi ses compagnons, il y a des intellectuels, comme Vdovouchkine, mais aussi Senka, un rescapé de Buchenwald, et bien sûr on rapproche les deux usines à broyer des hommes ; au goulag, les gardiens sont plus proches des détenus que dans les camps nazis. Une certaine solidarité dans les brigades coexiste avec les comportements égoïstes, dans un quotidien de petites combines au jour le jour (les déportés eux aussi s’organisent).
« Au camp, on a organisé la brigade pour que ce soit les détenus qui se talonnent les uns les autres et pas les gradés. C’est comme ça : ou bien rabiot pour tous, ou bien on la crève tous. Tu ne bosses pas, fumier, et moi à cause de toi, je dois la sauter ? Pas question, tu vas en mettre un coup, mon salaud ! »
Parmi leurs maux de déportés luttant pour leur survie, le froid…
« Il fait moins 27. Choukhov, lui, fait 37,7. C’est à qui aura l’autre. »
« Ça s’est réchauffé, remarque tout de suite Choukhov. Dans les moins 18, c’est tout ; ça ira bien pour poser les parpaings. »
… et la faim, la kacha, claire bouillie de céréales, étant distribuée en maigres rations…
« Ce qu’il a pu en donner, Choukhov, d’avoine aux chevaux depuis son jeune âge... il n’aurait jamais cru qu’un beau jour il aspirerait de tout son être à une poignée de cette avoine ! »
« Choukhov avait moins de difficulté pour nourrir toute sa famille quand il était dehors qu’à se nourrir tout seul ici, mais il savait ce que ces colis coûtaient et il savait qu’on ne pouvait pas en demander à sa famille pendant dix ans. Alors, il valait mieux s’en passer. »
À noter aussi la résilience des zeks, et la dignité humaine préservée de certains, comme Choukhov qui ne parvient pas à se départir de son inclination pour le travail bien fait…
Témoignage d’une expérience vécue par l’auteur, cette novella (que j’ai lue dans sa première traduction française) révéla le Goulag en Occident en 1962 ; on y prend la mesure du système concentrationnaire planifié, quel que soit le régime politique.
« Ce qu’il y a de bien dans un camp de travaux forcés, c’est qu’on est libre à gogo. Si on avait seulement murmuré tout bas à Oust-Ijma qu’on manquait d’allumettes au-dehors, on vous aurait fichu en taule et donné dix ans de mieux. »
« Choukhov regarde le plafond en silence. Il ne sait plus bien lui-même s’il désire être libre. Au début, il le voulait très fort et il comptait, chaque soir, combien de jours de son temps étaient passés, et combien il en restait. Mais ensuite, il en a eu assez. Plus tard, les choses sont devenues claires : on ne laisse pas rentrer chez eux les gens de son espèce, on les envoie en résidence forcée. Et on ne peut pas savoir où on aura la vie meilleure, ici ou bien là-bas.
Or, la seule chose pour laquelle il a envie d’être libre : c’est retourner chez lui.
Mais chez lui, on ne le laissera pas. »
La fin du texte :
« Choukhov s’endort, pleinement contenté. Il a eu bien de la chance aujourd’hui : on ne l’a pas flanqué au cachot ; on n’a pas collé la brigade à la “Cité socialiste”, il s’est organisé une portion de kacha supplémentaire au déjeuner, le chef de brigade s’est bien débrouillé pour le décompte du travail, Choukhov a monté son mur avec entrain, il ne s’est pas fait piquer avec son égoïne à la fouille, il s’est fait des suppléments avec César et il a acheté du tabac. Et, finalement, il a été le plus fort, il a résisté à la maladie. Une journée a passé, sur quoi rien n’est venu jeter une ombre, une journée presque heureuse.
De ces journées, durant son temps, de bout en bout, il y en eut trois mille six cent cinquante-trois.
Les trois en plus, à cause des années bissextiles. »
\Mots-clés : #campsconcentration #captivite #historique #politique #regimeautoritaire #temoignage #xxesiecle
- le Jeu 27 Jan - 15:40
- Rechercher dans: Écrivains Russes
- Sujet: Alexandre Soljenitsyne
- Réponses: 15
- Vues: 1617
Le One-shot des paresseux
Nicolas Bourcier, Les Amazoniens, en sursis
D’abord une petite déception, les témoignages et reportages datent du début du siècle, au moins au début.
Des interviews documentent le sort des Indiens (mais aussi des caboclos et quilombolas), abandonnés par l’État, qui poursuit une politique d’exploitation productiviste de la forêt (quel que soit le régime politique), aux exactions des garimpeiros et de leurs pistoleros, des trafiquants, des fazendeiros et autre agrobusiness qui suivent. La pression des Blancs tend à les sédentariser pour les réduire (gouvernement, congrégations religieuses) : c’est aussi l’histoire de nomades malvenus dans notre société. En plus de la pression économique, il y a également les maladies contagieuses, la pollution au mercure, l’exclusion et la discrimination, la bureaucratie, l’exode et l’acculturation, etc. Mais, dorénavant, la population indienne augmente, ainsi que la réaffirmation de l’identité ethnique traditionnelle.
« Les besoins en matière de santé et d’éducation restent considérables. »
Malgré la reconnaissance des droits des Indiens par la constitution, le gouvernement de Lula a déçu les espoirs, et afin de favoriser le développement les forces politiques se coordonnent pour saper toute cohésion des réclamations sociales et foncières.
« Juridiquement, l’Amazonie a connu la reconnaissance des droits des indigènes en 1988, la reconnaissance de la démarcation des terres trois ans plus tard et une succession de grignotages de ces droits par la suite… »
Face à l’extinction des derniers Indiens isolés, les sertanistes (qui protègent leurs terres), ont fait passer le paradigme de l’intégration (ou de l’éradication) à la suppression quasi intégrale des contacts. L’un d’eux, Sydney Possuelo :
« Darcy Ribeiro, qui contribua à la classification légale de l’Indien, comptait trois types : l’Indien isolé, l’Indien en contact mais de façon intermittente (comme les Yanomami et tous ces groupes vivant entre deux mondes), et l’Indien intégré. De ces trois groupes, je n’en vois que deux : l’isolé et l’intermittent. L’intégré n’existe pas. Il n’y a pas d’ethnie qui vive harmonieusement avec la société brésilienne. L’Indien respecté et intégré dans notre société est une invention. »
« Pour résumer, si on ne fait rien, les fronts pionniers tuent les Indiens isolés ; si on entre en contact, voilà qu’ils disparaissent sous l’effet des maladies. La seule option possible est donc de savoir où ils se trouvent et de délimiter leur territoire. C’est ensuite qu’il faut mettre en place des équipes autour de ce territoire pour en bloquer les accès. Pourquoi ne pouvons-nous pas délimiter une zone où vivent des personnes depuis des temps immémoriaux et empêcher qu’elle ne soit envahie ? »
Qu’on soit intéressé de près ou de loin par le sujet, une lecture qui interpelle.
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #contemporain #discrimination #documentaire #ecologie #genocide #identite #minoriteethnique #nature #racisme #ruralité #temoignage #traditions #xxesiecle
- le Mer 22 Déc - 12:14
- Rechercher dans: Nos lectures
- Sujet: Le One-shot des paresseux
- Réponses: 287
- Vues: 21772
Nina Berberova
Nouvelle, apparemment écrite en 1927, publiée par Actes Sud en 1995, une soixantaine de pages.
À Rostov, une jeune femme, d'un milieu aisé si l'on en croit son habillement, débarque d'un train de marchandises.
Elle loue une chambre, qui est en fait un salon, chez les sœurs Koudélianov, qui ont en quelque sorte démembré leur maison au décès de l'homme de la famille pour louer des chambres et s'assurer quelques subsides.
La nouvelle se passe dans les années de guerre révolutionnaire, le front est proche, l'épidémie de typhus échauffe les cerveaux.
Dans cette atmosphère tout ce qu'il y a de plus délétère les sœurs guignent le peu d'habits, de bijoux, de bien qu'a pu emporter la fuyarde.
Celle-ci, légèrement malade, se retrouve aux mains des tenancières, qui voient là un signe certain du typhus...
Nouvelle sordide, cruelle, mais cependant lumineuse, magnifiquement menée par Berberova, du grand art.
Peut-être reçoit-elle un éclairage nouveau aujourd'hui, pour un enfonçage de porte ouverte précisons en temps de pandémie, et aussi en temps de réfugiés que nous ne savons accueillir...mais il y a bien plus que ça en germe dans ces quelques pages.
\Mots-clés : #exil #huisclos #nouvelle #temoignage #trahison #xxesiecle
- le Lun 8 Nov - 19:27
- Rechercher dans: Écrivains Russes
- Sujet: Nina Berberova
- Réponses: 8
- Vues: 1986
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages