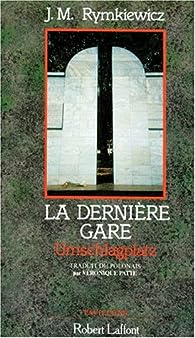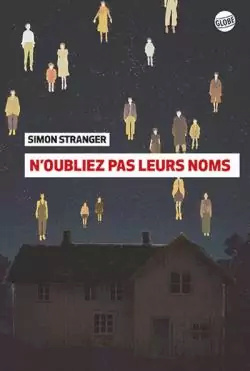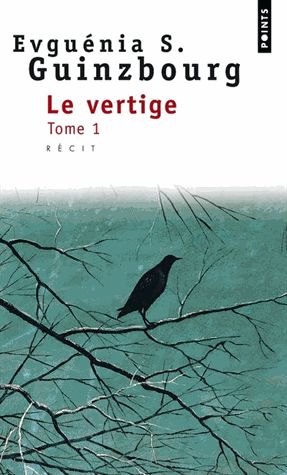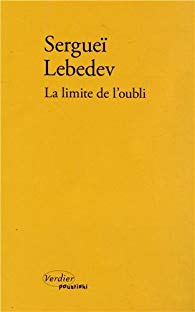La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 10:46
51 résultats trouvés pour campsconcentration
Ken Liu
L'Homme qui mit fin à l'histoire : un documentaire
« Evan Wei, un jeune spécialiste sino-américain du Japon de l’époque de Heian, et Akemi Kirino, une physicienne expérimentale nippo-américaine », mettent au point une exploration du passé en s’y rendant par un voyage dans le temps, mais avec la condition intrinsèque au processus de la destruction des preuves ramenées dudit passé.
« Un des paradoxes cruciaux de l’archéologie, c’est que, pour fouiller un site afin de l’étudier, il faut le détruire. Au sein de la profession, on débat à chaque site pour savoir s’il vaut mieux le fouiller ou le préserver in situ jusqu’à la mise au point de nouvelles techniques moins invasives. Mais sans des fouilles destructrices, comment mettra-t-on au point ces nouvelles techniques ?
Evan aurait sans doute dû lui aussi attendre qu’on invente un moyen d’enregistrer le passé sans l’effacer par la même occasion. Seulement, il aurait peut-être été trop tard pour les familles des victimes qui allaient bénéficier le plus de ces souvenirs. Il se débattait sans cesse entre les revendications antagonistes du passé et du présent. »
Le second propos est l’exposé des atrocités commises par les Japonais dans l’Unité 731 lors de la Seconde Guerre sino-japonaise (vivisections sans anesthésie, etc.).
« Ce même jour en 1931, près de Shenyang, ici en Mandchourie, éclatait la Seconde Guerre sino-japonaise. Pour les Chinois, il s’agissait du début de la Seconde Guerre mondiale, plus d’une décennie avant l’implication des États-Unis.
Nous sommes à la périphérie de Harbin, dans le district de Pingfang. Même si ce nom n’évoque rien à la plupart des Occidentaux, certains n’hésitent pas à surnommer ce lieu l’« Auschwitz d’Asie ». L’Unité 731 de l’Armée impériale japonaise y a mené durant la guerre d’atroces expériences sur des milliers de Chinois et Alliés captifs pour permettre au Japon de créer des armes biologiques et de conduire des recherches sur les limites de l’endurance humaine.
Dans ces locaux, des médecins militaires japonais ont tué des milliers de Chinois et d’Alliés par le biais d’expériences médicales, essais d’armements, vivisections, amputations et autres tortures systématiques. À la fin de la guerre, l’armée nippone qui battait en retraite a supprimé les derniers prisonniers et brûlé le complexe, ne laissant derrière elle que la carcasse du bâtiment administratif et les fosses utilisées pour élever des rats porteurs de maladies. Il n’y a eu aucun survivant.
Les historiens estiment qu’entre deux et cinq cent mille Chinois, presque tous des civils, ont été tués par les armes bactériologiques et chimiques mises au point ici et dans des laboratoires annexes : anthrax, choléra, peste bubonique. À l’issue de la guerre, le général MacArthur, commandant en chef des forces Alliées, a préservé les membres de l’Unité 731 de toute poursuite judiciaire pour crimes de guerre afin de récupérer les résultats de leurs expériences et de soustraire lesdites données à l’Union Soviétique. »
« Le 15 août 1945, nous avons appris que l’Empereur avait capitulé devant l’Amérique. Comme bien d’autres Japonais en Chine alors, mon unité a estimé qu’il serait plus facile de se rendre aux nationalistes chinois. On l’a incorporée dans une unité de l’armée nationaliste sous les ordres de Chiang Kaïchek, et j’ai continué de travailler en tant que médecin militaire pour aider les nationalistes contre les communistes dans la guerre civile. »
Est présentée ensuite l’attitude vis-à-vis de ces faits (de part et d’autre) : silence, oubli élusif, négationnisme, déni de responsabilité historique, opportunisme politique, etc. La question de leur validité en tant que documents historiques est aussi posée, ainsi que le problème du contrôle, de la maîtrise du passé.
« Aux premiers temps de la République populaire, de 1945 à 1956, l’approche idéologique des communistes consistait à tenir l’invasion pour une étape historique parmi d’autres de l’avancée irrésistible de l’humanité vers le socialisme. Tout en condamnant le militarisme japonais et en célébrant la résistance, ils essayaient de pardonner individuellement les Japonais si ces derniers montraient des signes de contrition – une attitude surprenante par son caractère confucéen et chrétien de la part d’un régime athée. Malgré l’atmosphère de zèle révolutionnaire, les prisonniers nippons étaient, pour la plupart, traités avec humanité. On leur donnait des cours de marxisme et on leur disait d’avouer leurs crimes par écrit (du fait de ces cours, le public japonais a pu croire que tout homme qui confessait des crimes horribles commis pendant la Guerre avait subi un lavage de cerveau de la part des communistes). Une fois qu’on les estimait repentis grâce à cette « rééducation », on les rendait au Japon. »
« Voisins sur le plan géographique, les deux pays l’ont été aussi dans leur réponse à la barbarie de la Seconde Guerre mondiale : l’oubli, au nom d’idéaux universels tels que « la paix » et « le socialisme », l’appariement des souvenirs de la Guerre au patriotisme, la déréalisation des victimes comme des bourreaux opérée pour les ramener pareillement à des symboles afin de servir l’État. Sous cet angle, la mémoire abstraite, partielle, fragmentaire en Chine et le silence au Japon ne sont plus que les deux faces de la même pièce. »
Cette novella très dense constitue un bel exemple de réflexion amenée par le biais de la science-fiction. Un assemblage de témoignages, interviews et autres déclarations parcourt les questions éthiques, juridiques, philosophiques portant sur un évènement historique difficile à assumer. Les dimensions personnelle et collective sont discutées.
« Tenter de rajouter l’empathie et l’émotion aux recherches historiques lui a valu l’opprobre de l’élite universitaire. Or, mêler à l’histoire la subjectivité du récit personnel renforce la vérité au lieu d’en détourner. Accepter notre fragilité et notre subjectivité n’est pas renoncer à notre responsabilité morale de dire la vérité, même, et surtout, si « la vérité », loin d’être unique, devient pluralité d’expériences partagées qui, ensemble, composent notre humanité. »
\Mots-clés : #campsconcentration #deuxiemeguerre #devoirdememoire #historique #sciencefiction #xxesiecle
- le Mar 13 Fév - 11:27
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Ken Liu
- Réponses: 2
- Vues: 182
Jorge Semprun
L'Évanouissement
Le six août dix-neuf cent quarante-cinq, Manuel Mora s’évanouit et se blesse grièvement en tombant d’un train ; il a une perte de mémoire dans une « obsession confuse de neige et de lilas » ; voilà trois mois qu’il est revenu d’Allemagne, où il était prisonnier du camp de Buchenwald, et deux jours plus tard survient le bombardement d’Hiroshima.
Le coup sur la tête lui rappelle le début de son interrogatoire par la Gestapo, ses pensées sur la mort et celle de son professeur, Halbwachs (évoquée dans d’autres de ses livres, plus directement autobiographiques ; Mora est le personnage principal de son précédent et premier roman publié, Le Grand Voyage), et l’exécution de la femme qui dénonça aux Allemands son mari et son groupe de résistants.
Il analyse la douleur.
« À chaque instant, il fallait qu’il décide de prolonger sa douleur [en ne parlant pas], à l’infini, il fallait que de sa propre volonté la plus intime jaillisse cette liberté de s’aliéner le monde. »
« Il en reprenait possession [du monde] par l’angoisse de cette femme [l’interprète], par l’hébétude désespérée des types de la Gestapo, échouant dans leur propos de le faire parler, et devenant de plus en plus opaques, de plus en plus lointains, c’est-à-dire éloignés d’eux-mêmes, du sens de leur vie, de plus en plus projetés dans l’agonie de leur métier. »
Puis, venu de Paris (Laurence) à Ascona (Lorène), c’est son existentielle « étrangeté au monde » (et aux femmes) qui est évoquée.
« Peut-être le monde extérieur est-il vraiment incontestable, fermé sur lui-même et ouvert à tout regard, à la fois. Ce serait rassurant. »
Il retrouve l’origine de son souvenir, un Premier Mai à la Nation, six ans auparavant, comme il était venu à Paris à la fin de la guerre d’Espagne.
Hans, Michel, compagnons de lutte, reviennent aussi dans ses pensées, avec notamment la séquence d’un soldat allemand abattu pour récupérer ses armes.
Dans ce deuxième texte de Semprun est rendue sensible la difficulté à communiquer/ témoigner de l’expérience de la guerre, traumatisme et amnésie (et la difficulté d’en parler, d’écrire), où des femmes ont un rôle vital.
\Mots-clés : #campsconcentration #deuxiemeguerre #guerredespagne #xxesiecle
- le Ven 1 Déc - 11:04
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jorge Semprun
- Réponses: 30
- Vues: 2676
Javier Cercas
L'imposteur
Cercas détaille comme, troublé par l'histoire d’Enric Marco, « le grand imposteur et le grand maudit » qui s'est fait passer pour un survivant des camps de concentration et est devenu une célébrité espagnole de la mémoire historique des horreurs nazies, il s’est finalement résolu à écrire ce roman non fictionnel. « Comprendre, est-ce justifier ? » N’est-il pas lui-même un imposteur ?
« La pensée et l’art, me disais-je, essaient d’explorer ce que nous sommes, ils révèlent notre infinie variété, ambiguë et contradictoire, ils cartographient ainsi notre nature : Shakespeare et Dostoïevski, me disais-je, éclairent les labyrinthes de la morale jusque dans leurs derniers recoins, ils démontrent que l’amour est capable de conduire à l’assassinat ou au suicide et ils réussissent à nous faire ressentir de la compassion pour les psychopathes et les scélérats ; c’est leur devoir, me disais-je, parce que le devoir de l’art (ou de la pensée) consiste à nous montrer la complexité de l’existence, afin de nous rendre plus complexes, à analyser les ressorts du mal pour pouvoir s’en éloigner, et même du bien, pour pouvoir peut-être l’apprendre. »
« Un génie ou presque. Car il est bien sûr difficile de se départir de l’idée que certaines faiblesses collectives ont rendu possible le triomphe de la bouffonnerie de Marco. Celui-ci, tout d’abord, a été le produit de deux prestiges parallèles et indépassables : le prestige de la victime et le prestige du témoin ; personne n’ose mettre en doute l’autorité de la victime, personne n’ose mettre en doute l’autorité du témoin : le retrait pusillanime devant cette double subornation – la première d’ordre moral, la seconde d’ordre intellectuel – a fait le lit de l’escroquerie de Marco. »
« Depuis un certain temps, la psychologie insiste sur le fait qu’on peut à peine vivre sans mentir, que l’homme est un animal qui ment : la vie en société exige cette dose de mensonge qu’on appelle éducation (et que seuls les hypocrites confondent avec l’hypocrisie) ; Marco a amplifié et a perverti monstrueusement cette nécessité humaine. En ce sens, il ressemble à Don Quichotte ou à Emma Bovary, deux autres grands menteurs qui, comme Marco, ne se sont pas résignés à la grisaille de leur vie réelle et qui se sont inventés et qui ont vécu une vie héroïque fictive ; en ce sens, il y a quelque chose dans le destin de Marco, comme dans celui de Don Quichotte et d’Emma Bovary, qui nous concerne profondément tous : nous jouons tous un rôle ; nous sommes tous qui nous ne sommes pas ; d’une certaine façon, nous sommes tous Enric Marco. »
Simultanément s’entrelace l’histoire de Marco depuis l’enfance, retiré nourrisson à sa mère enfermée à l’asile psychiatrique ; il aurait été maltraité par sa marâtre et ignoré par son père ouvrier libertaire, puis ballotté d’un foyer à l’autre, marqué par les évènements de la tentative d’indépendance catalane d’octobre 1934, juste avant que le putsch et la guerre civile éclatent. Cercas a longuement interviewé Marco, un vieillard fort dynamique, bavard et imbu de lui-même, criant à l’injustice parce qu’il aurait combattu pour une juste cause.
D’après Tzvetan Todorov :
« [Les victimes] n’ont pas à essayer de comprendre leurs bourreaux, disait Todorov, parce que la compréhension implique une identification avec eux, si partielle et provisoire qu’elle soit, et cela peut entraîner l’anéantissement de soi-même. Mais nous, les autres, nous ne pouvons pas faire l’économie de l’effort consistant à comprendre le mal, surtout le mal extrême, parce que, et c’était la conclusion de Todorov, “comprendre le mal ne signifie pas le justifier mais se doter des moyens pour empêcher son retour”. »
Militant anarcho-syndicaliste, Marco aurait combattu dans les rangs de la République, et Cercas analyse le « processus d’invention rétrospective de sa biographie glorieuse » chez ce dernier.
« Et je me suis dit, encore une fois, que tout grand mensonge se fabrique avec de petites vérités, en est pétri. Mais j’ai aussi pensé que, malgré la vérité documentée et imprévue qui venait de surgir, la plus grande partie de l’aventure guerrière de Marco était un mensonge, une invention de plus de son égocentrisme et de son insatiable désir de notoriété. »
Cercas ne ménage pas les redites, procédé (didactique ?) un peu lassant.
« Parce que le passé ne passe jamais, il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit ; le passé n’est qu’une dimension du présent. »
« Mais nous savons déjà qu’on n’arrive pas à dépasser le passé ou qu’il est très difficile de le faire, que le passé ne passe jamais, qu’il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit –, qu’il n’est qu’une dimension du présent. »
« La raison essentielle a été sa découverte du pouvoir du passé : il a découvert que le passé ne passe jamais ou que, du moins, son passé à lui et celui de son pays n’étaient pas passés, et il a découvert que celui qui a la maîtrise du passé a celle du présent et celle de l’avenir ; ainsi, en plus de changer de nouveau et radicalement tout ce qu’il avait changé pendant sa première grande réinvention (son métier, sa ville, sa femme, sa famille, jusqu’à son nom), il a également décidé de changer son passé. »
Cercas évoque De sang-froid de Truman Capote et L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, deux « chefs-d’œuvre » du « roman sans fiction » dont il juge le premier auteur atteint de « turpitude » pour avoir laissé espérer tout en souhaitant leur exécution les deux meurtriers condamnés à mort, et doute du procédé du second, présent à la première personne dans son récit peut-être pour se donner une légitimité morale fallacieuse.
Intéressantes questions du kitch du narcissique, et du mensonge (peut-il être légitime ? un roman est-il mensonge ?)
« Il y a deux mille quatre cents ans, Gorgias, cité par Plutarque, l’a dit de façon indépassable : “La poésie [c’est-à-dire, la fiction] est une tromperie où celui qui trompe est plus honnête que celui qui ne trompe pas et où celui qui se laisse tromper est plus sage que celui qui ne se laisse pas tromper.” »
En fait de déportation, Marco a été travailleur volontaire en Allemagne fin 1941, et emprisonné au bout de trois mois comme « volontaire communiste ». Revenu en Espagne, il a effectivement connu « les prisons franquistes, non comme prisonnier politique mais comme détenu de droit commun. » Il abandonne ses premiers femme et enfants, change de nom pour refaire sa vie (grand lecteur autodidacte, il suit des cours universitaires d’histoire) – et devenir le secrétaire général de la CNT, le syndicat anarchiste, puis président de l’Amicale de Mauthausen, l’association des anciens déportés espagnols. Il a toujours été un séducteur, un amuseur, un bouffon qui veut plus que tout qu’on l’aime et qu’on l’admire.
« …] de même, certaines qualités personnelles l’ont beaucoup aidé : ses dons exceptionnels d’orateur, son activisme frénétique, ses talents extraordinaires de comédien et son manque de convictions politiques sérieuses – en réalité, l’objectif principal de Marco était de faire la une et satisfaire ainsi sa médiapathie, son besoin d’être aimé et admiré et son désir d’être en toute occasion la vedette – de sorte qu’un jour il pouvait dire une chose et le lendemain son contraire, et surtout il pouvait dire aux uns et aux autres ce qu’ils voulaient entendre. »
« Le résultat du mélange d’une vérité et d’un mensonge est toujours un mensonge, sauf dans les romans où c’est une vérité. »
« Marco a fait un roman de sa vie. C’est pourquoi il nous paraît horrible : parce qu’il n’a pas accepté d’être ce qu’il était et qu’il a eu l’audace et l’insolence de s’inventer à coups de mensonges ; parce que les mensonges ne conviennent pas du tout à la vie, même s’ils conviennent très bien aux romans. Dans tous les romans, bien entendu, sauf dans un roman sans fiction ou dans un récit réel. Dans tous les livres, sauf dans celui-ci. »
Après la Transition de la dictature franquiste à la démocratie, la génération qui n’avait pas connu la guerre civile a plébiscité le concept de “mémoire historique”, qui devait reconnaître le statut des victimes.
« La démocratie espagnole s’est construite sur un grand mensonge, ou plutôt sur une longue série de petits mensonges individuels, parce que, et Marco le savait mieux que quiconque, dans la transition de la dictature à la démocratie, énormément de gens se sont construit un passé fictif, mentant sur le passé véritable ou le maquillant ou l’embellissant [… »
Cercas raconte ensuite comment l’historien Benito Bermejo a découvert l’imposture de Marco, alors devenu un héros national, et s’est résolu à la rendre publique (c’est loin d’être la seule du même genre). Marco tente depuis de se justifier par son réel travail de défense de la cause mémorielle. Cercas décrit ses rapports avec Marco partagé entre le désir d’être le personnage de son livre, et le dépit de ne pas pouvoir contrôler ce dernier.
« — S’il te plaît, laisse-moi quelque chose. »
Opiniâtre quant à la recherche de la vérité, outre ses pensées Cercas détaille son ressenti, qui va du dégoût initial à une certaine sympathie ; "donquichottesque", il pense même un temps à sauver Marco non pas en le réhabilitant, mais en le plaçant devant la vérité…
Manifestement basée sur une abondante documentation, cette étude approfondie, fouillée dans toutes ses ramifications tant historiques que psychologiques ou morales, évoque aussi le rôle de la fiction comme expression de la vérité.
\Mots-clés : #biographie #campsconcentration #devoirdememoire #ecriture #guerredespagne #historique #politique #psychologique #xxesiecle
- le Mar 17 Oct - 12:34
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Javier Cercas
- Réponses: 96
- Vues: 12465
Jorge Semprun
Le Mort qu’il faut
À Buchenwald, en décembre 1944, Semprun est déporté depuis un an comme résistant ; il a vingt ans. Il fréquente notamment le sociologue Maurice Halbwachs et le sinologue Henri Maspero, qui vont y mourir l’année suivante, et un jeune Français lui aussi « Musulman », c'est-à-dire « les invalides et les exclus, marginalisés par le despotisme productiviste du système de travail forcé ».
« Prendre sur soi pour sortir de soi, somme toute. »
« Malgré tous les subterfuges, les ruses et les détours, il y avait toujours trop peu de pain pour que j’en garde en mémoire. C’était fini, pas moyen de me souvenir. Il n’y avait jamais assez de pain pour que j’en « fasse de la mémoire », aurait-on dit en espagnol, hacer memoria. La faim revenait aussitôt, insidieuse, envahissante, comme une sourde pulsion nauséeuse.
On ne pouvait faire de la mémoire qu’avec des souvenirs. Avec de l’irréel, en somme, de l’imaginaire. »
Comme il appartient à l’Arbeitsstatistik du « camp de rééducation » (« C’est la marotte des dictatures, la rééducation ! ») devenu « un camp punitif, d’extermination par le travail forcé », Semprun est un temps « animateur culturel », et peut lire Absalon ! Absalon ! (Faulkner) pendant ses nuits de comptabilisation des mouvements des travailleurs. Ainsi que disent les rescapés des premières années du camp, Buchenwald est devenu un « sana » (la fin de la guerre approche, les Américains tiennent Bastogne)… Dans les latrines collectives, leur seul asile, Semprun discute de Dieu et du Mal avec « Lenoir », un Juif autrichien, et Otto, « un "triangle violet", un Bibelforscher, un témoin de Jéhovah ».
« Quoi qu’il en soit, Otto, jadis, dans l’arrière-salle de l’Arbeit, venait de m’exposer une notion cruciale de Schelling, selon laquelle nulle part l’ordre et la forme ne représentent quelque chose d’originaire : c’est une irrégularité initiale qui constitue le fond cosmologique et existentiel. »
« Les kapos rouges de Buchenwald évitaient le bâtiment des latrines du Petit Camp : cour des miracles, piscine de Bethsaïda, souk d’échanges de toute sorte. Ils détestaient la vapeur pestilentielle de « bain populaire », de « buanderie militaire », l’amas des corps décharnés, couverts d’ulcères, de hardes informes, les yeux exorbités dans les visages gris, ravinés par une souffrance abominable.
— Un jour, me disait Kaminsky, effaré d’apprendre que j’y descendais parfois, le dimanche, en allant voir Halbwachs au block 56, ou en revenant d’un entretien avec lui, un jour, ils se jetteront sur toi, en s’y mettant nombreux, pour te voler tes chaussures et ton caban de Prominent ! Qu’y cherches-tu, bon sang ?
Il n’y avait pas moyen de le lui faire entendre.
J’y cherchais justement ce qui l’effrayait, lui, ce qu’il craignait : le désordre vital, ubuesque, bouleversant et chaleureux, de la mort qui nous était échue en partage, dont le cheminement visible rendait ces épaves fraternelles. C’est nous-mêmes qui mourions d’épuisement et de chiasse dans cette pestilence. C’est là que l’on pouvait faire l’expérience de la mort d’autrui comme horizon personnel : être-avec-pour-la-mort, Mitsein zum Tode.
On peut comprendre, cependant, pourquoi les kapos rouges évitaient cette baraque.
C’était le seul endroit de Buchenwald qui échappât à leur pouvoir, que leur stratégie de résistance ne parviendrait jamais à investir. Le spectacle qui s’y donnait, en somme, était celui de leur échec toujours possible. Le spectacle de leur défaite toujours menaçante. Ils savaient bien que leur pouvoir restait fragile, par essence, exposé qu’il était aux caprices et aux volte-face imprévisibles de la politique globale de répression de Berlin.
Et les Musulmans étaient l’incarnation, pitoyable et pathétique, sans doute, mais insupportable, de cette défaite toujours à craindre. Ils montraient de façon éclatante que la victoire des SS n’était pas impossible. Les SS ne prétendaient-ils pas que nous n’étions que de la merde, des moins-que-rien, des sous-hommes ? La vue des Musulmans ne pouvait que les conforter dans cette idée.
Précisément pour cette raison, il était, en revanche, difficile de comprendre pourquoi les SS, eux aussi, évitaient les latrines du Petit Camp, au point d’en avoir fait, involontairement sans doute, un lieu d’asile et de liberté. Pourquoi les SS fuyaient-ils le spectacle qui aurait dû les réjouir et les réconforter, le spectacle de la déchéance de leurs ennemis ?
Aux latrines du Petit Camp de Buchenwald, ils auraient pu jouir du spectacle des sous-hommes dont ils avaient postulé l’existence pour justifier leur arrogance raciale et idéologique. Mais non, ils s’abstenaient d’y venir : paradoxalement, ce lieu de leur victoire possible était un lieu maudit. Comme si les SS – dans ce cas, ç’aurait été un ultime signal, une ultime lueur de leur humanité (indiscutable : une année à Buchenwald m’avait appris concrètement ce que Kant enseigne, que le Mal n’est pas l’inhumain, mais, bien au contraire, une expression radicale de l’humaine liberté) – comme si les SS avaient fermé les yeux devant le spectacle de leur propre victoire, devant l’image insoutenable du monde qu’ils prétendaient établir grâce au Reich millénaire. »
Des vers de Rimbaud, Valéry, Machado, Lorca et d’autres poètes, des passages de L’espoir de Malraux reviennent à Semprun.
Apparemment bien organisé, l’appareil de renseignement des communistes allemands au sein du camp (en la personne de « Kaminsky ») apprend qu’il est recherché par la Gestapo, et a trouvé un moribond qui correspond à son profil, dont il pourra endosser l’identité – l’homme en question est « le jeune Musulman français ». À ses cotés sur un châlit du Revier, l’infirmerie, il suit son agonie, médite la finitude humaine.
« Non, pas moi, François, je ne vais pas mourir. Pas cette nuit, en tout cas, je te le promets. Je vais survivre à cette nuit, je vais essayer de survivre à beaucoup d’autres nuits, pour me souvenir.
Sans doute, et je te demande pardon d’avance, il m’arrivera d’oublier. Je ne pourrai pas vivre tout le temps dans cette mémoire, François : tu sais bien que c’est une mémoire mortifère. Mais je reviendrai à ce souvenir, comme on revient à la vie. Paradoxalement, du moins à première vue, à courte vue, je reviendrai à ce souvenir, délibérément, aux moments où il me faudra reprendre pied, remettre en question le monde, et moi-même dans le monde, repartir, relancer l’envie de vivre épuisée par l’opaque insignifiance de la vie. Je reviendrai à ce souvenir de la maison des morts, du mouroir de Buchenwald, pour retrouver le goût de la vie. »
La mémoire, les douloureuses modalités du souvenir sont centrales dans cet ouvrage, avec la puissance de la littérature ; Semprun évoque aussi la vie quotidienne du camp : la promiscuité, les castes, la lutte pour la survie, la solidarité et ses limites – et les musiques, des chanteuses allemandes diffusées au jazz clandestin, en passant par les souvenirs de flamenco et la fanfare qui accompagne le départ au travail (voir https://expo-musique-camps-nazis.memorialdelashoah.org/). Impressionnant témoignage, qui complète Le Grand Voyage et L'Écriture ou la Vie. Étonnamment (pour moi), Semprun remet en question le travail des historiens sur la période : d’après lui, ils auront les coudées franches lorsque les derniers témoins se tairont à jamais…
\Mots-clés : #autobiographie #campsconcentration #deuxiemeguerre #historique #politique #temoignage #xxesiecle
- le Sam 9 Sep - 18:34
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jorge Semprun
- Réponses: 30
- Vues: 2676
Jaroslaw Marek Rymkiewicz
Extrait de l’excellente préface de Henri RACZYMOW
« « Pendant très longtemps j’ai recherché le plan d’Umschlagplatz. » C’est ainsi que commence ce livre dont on aura quelque peine à définir le genre. Un roman ? Une chronique ? Une confession ? C’est plutôt un témoignage. À ceci près que l’auteur ne fut pas un témoin de la Catastrophe juive. Mais c’est un témoignage, au sens chrétien du terme. Et ce livre me bouleverse pour cela même : son auteur est un Polonais chrétien. Ce livre porte témoignage d’une blessure, d’une question qui agit comme une blessure, comme une plaie qui jamais ne cicatrisera. Nommer cette plaie, cette blessure serait prématuré, hâtif. Ce livre témoigne de ce qu’un Polonais porte en lui une blessure secrète, que ses compatriotes mêmes ignorent et veulent ignorer. Il la porte en lui, en son cœur, comme la Pologne portait en son cœur un peuple minoritaire qui lui était d’une certaine façon radicalement étranger. Ne parlant pas la même langue, ne se vêtant pas de la même façon, ne partageant pas la même religion, n’exerçant pas les mêmes métiers. Ce peuple majoritaire et ce peuple minoritaire, en son sein, vécurent sur la même terre depuis la fin du Moyen Âge. Ce ne fut pas précisément une idylle. Plutôt une coexistence plus ou moins pacifique. Toujours est-il que cela s’acheva, comme on sait, dans la cendre. »
L’auteur qui a vécu à Otwock mais n’était qu’un enfant de 7 ans à l’époque du ghetto de Varsovie et donc n’a pu voir ce qui s’est déroulé à côté de chez lui et qui est su à l’heure où il écrit ce livre, mais veut comprendre quels étaient les rapports entre les Juifs et les Polonais et porter témoignage de ce qu’il a découvert ; dans le journal d’un Juif, celui d’un Allemand (un metteur en scène connu)écrire sur ce qui s’est passé pendant la deuxième guerre mondiale en Pologne, sa patrie et plus particulièrement dans le ghetto et dans cette gare d’Umschlagplatz où 310 000 Juifs attendaient le train qui les emportait pour un voyage sans retour.
Il s’interroge en tant que Polonais Chrétien, comme son personnage fictif Icyck pourrait le faire s’il revenait à Varsovie, Icyck qui a les mêmes sentiments que lui à 45 ans de distance et à des milliers de kms puisque Icyck se trouve à New-York.
Mais Hania, la femme de l’auteur et narrateur ne comprend pas sa démarche ; pourquoi revenir sur le passé, elle, comme les Juifs survivants ne veulent plus en parler, ils veulent seulement continuer à vivre avec. D’ailleurs Hania (Juive assimilée) lui dit qu’il ne peut comprendre, cela lui est impossible.
Oui mais il veut en prendre une part de responsabilité, en tant que Chrétien et que Polonais. Et à présent en 1987, comment vit-on ici sur le lieux du ghetto, quel poids et quel avenir pour tous ? C’est ce qui importe à l’auteur, quelles réponses à ses interrogations ?
Alors l’auteur interroge sa mère, leur famille qu’a-t-elle fait pendant cette période ? Elle répond qu’ils n’ont rien à se reprocher, ils ont hébergé quelques jours une fillette juive qui clamait sa judéité et les mettait en danger.
Le narrateur arpente maintes et maintes fois les rues où se trouvait le ghetto, Umschlagplatz d’après le plan qu’il a pu se procurer, essaie de reconstituer la gare, le réseau ferroviaire d’après les rares bâtiments restants, quelques questions à des personnes qui n’ont pas l’envie ou ont oublié où se trouvait quoi et qui.
Quelques photos de famille lui indiquent la saison, un lieu et il se demande ce qu’eux les Juifs faisaient et où ils étaient dans le même moment. Alors que les Polonais mangeaient des glaces, à côté d’autres étaient torturés, assassinés ; pouvaient-ils l’ignorer ?
J’ai souvent lu dans les récits et témoignages sur la Shoah que les prisonniers disaient « Dieu n’était pas dans les camps », lui l’auteur nous dit de Dieu : Il fait ce qu’il veut, Il a toujours le droit et raison, Il est Il, la prière est la prière ; ceci à plusieurs reprises dans le récit. On partage ou pas !
Bien sur vouloir comprendre les rapports entre les Juifs et les Polonais de Varsovie, porter lui l’auteur, un Goy, un Chrétien cette « dette », cette blessure est une démarche rare et honorable.
La photo connue de cet enfant Juif, ci-dessous est mentionnée par l’auteur :

La photographie a été prise en 1943, au lendemain de l’insurrection lancée le 19 avril dans un élan désespéré par une poignée de survivants. Les soldats SS mettront un mois à dompter la résistance qui s’achèvera avec la liquidation du ghetto le 16 mai 1943. Cette révolte est trop souvent passée sous silence dans les manuels et documentaires consacrés à la Seconde Guerre mondiale.
\Mots-clés : #antisémitisme #campsconcentration #deuxiemeguerre #devoirdememoire
- le Dim 27 Aoû - 11:52
- Rechercher dans: Écrivains d'Europe centrale et orientale
- Sujet: Jaroslaw Marek Rymkiewicz
- Réponses: 4
- Vues: 264
Simon Stranger
Ceux dont il ne faut pas oublier le nom, ce sont toutes les victimes assassinées par les nazis. Et parmi eux Hirsch Komissar, l’arrière grand-père de la compagne de l’auteur.
Et il s’avère aussi que les grands-parents de cette femme ont vécu plusieurs années à Trondheim dans une maison, ancien repère de nazis, dont la cave a servi de lieu d’incarcération, de torture et d’assassinat, sous les ordres d’un jeune collaborateur très serviable et sanguinaire : Henry Oliver Rinnan.
Le récit alterne : l’histoire de ce bourreau, celle de l’arrière grand-père qui survécut 10 mois en camp de concentration et celle de cette famille dont le quotidien est diversement marqué par l’histoire de la maison.
La forme est plutôt originale, avec 26 chapitres constituant un ingénieux abécédaire, et si cet aspect est séduisant (bravo le traducteur Jean-Baptiste Coursaud), il entraîne un éclatement du récit qui fait que j ‘ai souvent été un peu perdue dans le temps de ces trois histoires.
J’ai été un peu déçue de la place prise par le bourreau - j’attendais quelque chose de plus tourné vers la recherche des ancêtres -, et gênée par la façon de romancer ces histoires vraie.
Une impression mitigée, donc.
\Mots-clés : #biographie #campsconcentration
- le Lun 12 Sep - 20:37
- Rechercher dans: Écrivains de Scandinavie
- Sujet: Simon Stranger
- Réponses: 7
- Vues: 331
Alexandre Soljenitsyne
Une journée d'Ivan Denissovitch
Une journée de Choukhov, matricule CH-854, dans un goulag où, condamné à dix ans (au moins) pour avoir été fait prisonnier par les hitlériens pendant la Seconde Guerre mondiale (il aurait pu avoir été retourné comme espion...), il est maçon dans la construction d’une centrale électrique, depuis huit ans (on est en 1951). Le texte, extrêmement factuel et prosaïque, très lisible, est chronologique, rapportant les échanges des prisonniers, avec quelques passages en italiques qui explicitent des situations. Parmi ses compagnons, il y a des intellectuels, comme Vdovouchkine, mais aussi Senka, un rescapé de Buchenwald, et bien sûr on rapproche les deux usines à broyer des hommes ; au goulag, les gardiens sont plus proches des détenus que dans les camps nazis. Une certaine solidarité dans les brigades coexiste avec les comportements égoïstes, dans un quotidien de petites combines au jour le jour (les déportés eux aussi s’organisent).
« Au camp, on a organisé la brigade pour que ce soit les détenus qui se talonnent les uns les autres et pas les gradés. C’est comme ça : ou bien rabiot pour tous, ou bien on la crève tous. Tu ne bosses pas, fumier, et moi à cause de toi, je dois la sauter ? Pas question, tu vas en mettre un coup, mon salaud ! »
Parmi leurs maux de déportés luttant pour leur survie, le froid…
« Il fait moins 27. Choukhov, lui, fait 37,7. C’est à qui aura l’autre. »
« Ça s’est réchauffé, remarque tout de suite Choukhov. Dans les moins 18, c’est tout ; ça ira bien pour poser les parpaings. »
… et la faim, la kacha, claire bouillie de céréales, étant distribuée en maigres rations…
« Ce qu’il a pu en donner, Choukhov, d’avoine aux chevaux depuis son jeune âge... il n’aurait jamais cru qu’un beau jour il aspirerait de tout son être à une poignée de cette avoine ! »
« Choukhov avait moins de difficulté pour nourrir toute sa famille quand il était dehors qu’à se nourrir tout seul ici, mais il savait ce que ces colis coûtaient et il savait qu’on ne pouvait pas en demander à sa famille pendant dix ans. Alors, il valait mieux s’en passer. »
À noter aussi la résilience des zeks, et la dignité humaine préservée de certains, comme Choukhov qui ne parvient pas à se départir de son inclination pour le travail bien fait…
Témoignage d’une expérience vécue par l’auteur, cette novella (que j’ai lue dans sa première traduction française) révéla le Goulag en Occident en 1962 ; on y prend la mesure du système concentrationnaire planifié, quel que soit le régime politique.
« Ce qu’il y a de bien dans un camp de travaux forcés, c’est qu’on est libre à gogo. Si on avait seulement murmuré tout bas à Oust-Ijma qu’on manquait d’allumettes au-dehors, on vous aurait fichu en taule et donné dix ans de mieux. »
« Choukhov regarde le plafond en silence. Il ne sait plus bien lui-même s’il désire être libre. Au début, il le voulait très fort et il comptait, chaque soir, combien de jours de son temps étaient passés, et combien il en restait. Mais ensuite, il en a eu assez. Plus tard, les choses sont devenues claires : on ne laisse pas rentrer chez eux les gens de son espèce, on les envoie en résidence forcée. Et on ne peut pas savoir où on aura la vie meilleure, ici ou bien là-bas.
Or, la seule chose pour laquelle il a envie d’être libre : c’est retourner chez lui.
Mais chez lui, on ne le laissera pas. »
La fin du texte :
« Choukhov s’endort, pleinement contenté. Il a eu bien de la chance aujourd’hui : on ne l’a pas flanqué au cachot ; on n’a pas collé la brigade à la “Cité socialiste”, il s’est organisé une portion de kacha supplémentaire au déjeuner, le chef de brigade s’est bien débrouillé pour le décompte du travail, Choukhov a monté son mur avec entrain, il ne s’est pas fait piquer avec son égoïne à la fouille, il s’est fait des suppléments avec César et il a acheté du tabac. Et, finalement, il a été le plus fort, il a résisté à la maladie. Une journée a passé, sur quoi rien n’est venu jeter une ombre, une journée presque heureuse.
De ces journées, durant son temps, de bout en bout, il y en eut trois mille six cent cinquante-trois.
Les trois en plus, à cause des années bissextiles. »
\Mots-clés : #campsconcentration #captivite #historique #politique #regimeautoritaire #temoignage #xxesiecle
- le Jeu 27 Jan - 15:40
- Rechercher dans: Écrivains Russes
- Sujet: Alexandre Soljenitsyne
- Réponses: 15
- Vues: 1617
George Steiner
Dans le château de Barbe Bleue. Notes pour une Redéfinition de la Culture
Quatre conférences publiées en 1971, intitulées d’après les Notes pour la définition d’une culture de T. S. Eliot, et portant sur la crise de notre culture.
Le grand ennui
C’est le constat de notre état d’esprit civilisationnel après les années 1798 à 1815, la Révolution et l’Empire : le caractéristique spleen baudelairien post-espoir et post-épopée, une sorte de fin du progrès, de « malaise fondamental » dû aux « contraintes qu’impose une conduite civilisée aux instincts profonds, qui ne sont jamais satisfaits » :
« Je pense à un enchevêtrement d’exaspérations, à une sédimentation de désœuvrements. À l’usure des énergies dissipées dans la routine tandis que croît l’entropie. »
« L’union d’un intense dynamisme économique et technique et d’un immobilisme social rigoureux, fondant un siècle de civilisation bourgeoise et libérale, composait un mélange détonant. L’art et l’esprit lui opposaient des ripostes caractéristiques et, en dernière analyse, funestes. À mes yeux, celles-ci constituent la signification même du romantisme. C’est elles qui engendreront la nostalgie du désastre. »
Une saison en enfer
De 1915 à 1945, c’est l’hécatombe, puis l’holocauste, escalade dans l’inhumanité. Plusieurs explications sont évoquées, d’une revanche de la nietzschéenne mise à mort de Dieu à la freudienne mise en œuvre de l’enfer dantesque.
« Un mélange de puissance intellectuelle et physique, une mosaïque d’hybrides et de types nouveaux dont la richesse passe l’imagination, manqueront au maintien et au progrès de l’homme occidental et de ses institutions. Au sens biologique, nous contemplons déjà une culture diminuée, une "après-culture." »
« En tuant les juifs, la culture occidentale éliminerait ceux qui avaient "inventé" Dieu et s’étaient faits, même imparfaitement, même à leur corps défendant, les hérauts de son Insupportable Absence. L’holocauste est un réflexe, plus intense d’avoir été longtemps réprimé, de la sensibilité naturelle, des tendances polythéistes et animistes de l’instinct. »
« Exaspérant parce qu’"à part", acceptant la souffrance comme clause d’un pacte avec l’absolu, le juif se fit, pour ainsi dire, la "mauvaise conscience" de l’histoire occidentale. »
« Quiconque a essayé de lire Sade peut juger de l’obsédante monotonie de son œuvre ; le cœur vous en monte aux lèvres. Pourtant, cet automatisme, cette délirante répétition ont leur importance. Ils orientent notre attention vers une image ou, plutôt, un profil nouveau et bien particulier de la personne humaine. C’est chez Sade, et aussi chez Hogarth par certains détails, que le corps humain, pour la première fois, est soumis méthodiquement aux opérations de l’industrie.
On ne peut nier que, dans un sens, le camp de concentration reflète la vie de l’usine, que la "solution finale" est l’application aux êtres humains des techniques venues de la chaîne de montage et de l’entrepôt. »
Après-culture
« C’est comme si avait prévalu un puissant besoin d’oublier et de rebâtir, une espèce d’amnésie féconde. Il était choquant de survivre, plus encore de recommencer à prospérer entouré de la présence tangible d’un passé encore récent. Très souvent, en fait, c’est la totalité de la destruction qui a rendu possible la création d’installations industrielles entièrement modernes. Le miracle économique allemand est, par une ironie profonde, exactement proportionnel à l’étendue des ruines du Reich. »
Steiner montre comme l’époque classique éprise d’ordre et d’immortalité glorieuse est devenue la nôtre, défiante des hiérarchies et souvent collective dans la création d’œuvres où prime l’immédiat, l’unique et le transitoire.
« L’histoire n’est plus pour nous une progression. Il est maintenant trop de centres vitaux où nous sommes trop menacés, plus offerts à l’arbitraire de la servitude et de l’extermination que ne l’ont jamais été les hommes et femmes de l’Occident civilisé depuis la fin du seizième siècle. »
« Nous savons que la qualité de l’éducation dispensée et le nombre de gens qu’elle touche ne se traduisent pas nécessairement par une stabilité sociale ou une sagesse politique plus grandes. Les vertus évidentes du gymnase ou du lycée ne garantissent en rien le comportement électoral de la ville lors du prochain plébiscite. Nous comprenons maintenant que les sommets de l’hystérie collective et de la sauvagerie peuvent aller de pair avec le maintien, et même le renforcement, des institutions, de l’appareil et de l’éthique de la haute culture. En d’autres termes, les bibliothèques, musées, théâtres, universités et centres de recherche, qui perpétuent la vie des humanités et de la science, peuvent très bien prospérer à l’ombre des camps de concentration. »
« Est-il fortuit que tant de triomphes ostentatoires de la civilisation, l’Athènes de Périclès, la Florence des Médicis, l’Angleterre élisabéthaine, le Versailles du grand siècle et la Vienne de Mozart aient eu partie liée avec l’absolutisme, un système rigide de castes et la présence de masses asservies ? »
Demain
« Populisme et rigueur académique. Les deux situations s’impliquent mutuellement, et chacune polarise l’autre en une dialectique inéluctable. C’est entre elles que se déploie notre condition présente.
À nous de savoir s’il en a déjà été autrement. »
À partir de l’importance croissante de la musique et de l’image par rapport au verbe, et de celle des sciences et des mathématiques, Steiner essaie de se projeter dans le futur proche (bien vu pour l’informatique connectée, heureusement moins pour les manipulations biologiques).
« Ce passage d’un état de culture triomphant à une après-culture ou à une sous-culture se traduit par une universelle "retraite du mot". Considérée d’un point quelconque de l’histoire à venir, la civilisation occidentale, depuis ses origines gréco-hébraïques jusqu’à nos jours, apparaîtra sans doute comme saturée de verbe. »
« De plus en plus souvent, le mot sert de légende à l’image. »
« Nous privons de leur humanité ceux à qui nous refusons la parole. Nous les exposons nus, grotesques. D’où le désespoir et l’amertume qui marquent le conflit actuel entre les générations. C’est délibérément qu’on s’attaque aux liens élémentaires d’identité et de cohésion sociale créés par une langue commune. »
« Affirmer que "Shakespeare est le plus grand, le plus complet écrivain de l’humanité" est un défi à la logique, et presque à la grammaire. Ceci cependant provoque l’adhésion. Et même si le futur peut, par une aberration grossière, prétendre égaler Rembrandt ou Mozart, il ne les surpassera pas. Les arts sont régis en profondeur par un flot continu d’énergie et ignorent le progrès par accumulation qui gouverne les sciences. On n’y corrige pas d’erreurs, on n’y récuse pas de théorèmes. »
« Il tombe sous le sens que la science et la technologie ont provoqué d’irréparables dégradations de l’environnement, un déséquilibre économique et un relâchement moral. En termes d’écologie et d’idéaux, le coût des révolutions scientifiques et technologiques des quatre derniers siècles a été énorme. Pourtant, en dépit des critiques confuses et bucoliques d’écrivains comme Thoreau et Tolstoï, personne n’a sérieusement douté qu’il fallait en passer par là. Il entre dans cette attitude, le plus souvent irraisonnée, une part d’instinct mercantile aveugle, une soif démesurée de confort et de consommation. Mais aussi un mécanisme bien plus puissant : la conviction, ancrée au cœur de la personnalité occidentale, au moins depuis Athènes, que l’investigation intellectuelle doit aller de l’avant, qu’un tel élan est conforme à la nature et méritoire en soi, que l’homme est voué à la poursuite de la vérité ; le "taïaut" de Socrate acculant sa proie résonne à travers notre histoire. Nous ouvrons les portes en enfilade du château de Barbe-bleue parce qu’"elles sont là", parce que chacune mène à la suivante, selon le processus d’intensification par lequel l’esprit se définit à lui-même. »
« Souscrire, de façon toute superstitieuse, à la supériorité des faits sur les idées, voilà le mal dont souffre l’homme éclairé. »
C’est érudit, tant en références littéraires que scientifiques, mais d’une écriture remarquablement fluide et accessible. Réflexions fort intéressantes, qui ouvre de nombreuses pistes originales − même si j’ai regretté l’absence d’un appareil critique apte à éclairer certaines allégations.
\Mots-clés : #campsconcentration #deuxiemeguerre #essai #philosophique #premiereguerre #religion #xxesiecle
- le Mar 9 Nov - 13:38
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: George Steiner
- Réponses: 9
- Vues: 1459
Friedrich Dürrenmatt
Le soupçon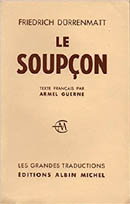
Le commissaire Baerlach, de la police fédérale de Berne, celui-là même de Le juge et son bourreau, va être prochainement à la retraite ; il est hospitalisé avec un cancer lui laissant espérer encore un an de vie. Son ami et médecin le docteur Hungertobel lui transmet un soupçon qui paraît invraisemblable : le docteur Emmenberger, qui dirige une clinique pour patients fort riches, serait-il Nehle, médecin du camp de Stutthof où il pratiquait des opérations sans narcose (avant de se suicider en 1945) ? Baerlach imagine que Nehle aurait pu changer d’identité avec un autre, et se fait hospitaliser dans la clinique du docteur Emmenberger, où il entreprend de démasquer ce dernier en se présentant comme un chasseur de nazis.
C’est en fait, outre une intrigue finalement peu plausible, une réflexion sur l’humanité, le Mal et la justice, centrée sur l’horreur nazie (Dürrenmatt précise que les victimes de Nehle acceptaient la torture par espoir insensé de survivre.)
Des personnages étonnants surgissent, tels que le colosse Gulliver, une sorte de mystérieux Juif errant rescapé de tous les camps, Ulrich Friedrich Fortschig, écrivain malheureux et journaliste éditant La Flèche de Guillaume Tell, une feuille intermittente de protestation attaquant les puissants, et aussi un nain.
J’ai apprécié que Gulliver considère qu’on peut juger les gens, pas les peuples...
« …] et le monde était surtout mauvais par indifférence, et tout allait de mal en pis du fait de cette indifférence. »
… et trouvé dans ce (faux) polar métaphysique une définition qui pourrait être celle de l’écrivain :
« Le criminaliste a pour premier devoir de mettre le réel en question, affirma le commissaire. »
J’ai pensé à Poe et Michel Rio (et que ce n’était pas le meilleur de Dürrenmatt).
\Mots-clés : #campsconcentration #polar
- le Mer 6 Oct - 13:48
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: Friedrich Dürrenmatt
- Réponses: 21
- Vues: 2466
Claudio Magris
Classé sans suite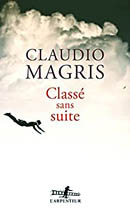
Luisa Brooks, fille d’un soldat noir américain et petite fille d’une juive passée par le four crématoire nazi installé dans une ancienne rizerie triestine, reprend le projet d’un collectionneur d’armes mort dans un incendie :
« Arès pour Irène ou Arcana Belli. Musée total de la Guerre pour l’avènement de la Paix et la désactivation de l’Histoire. »
« Toute exposition – de tableaux, de sculptures, d’objets, d’engins – est une nature morte et les gens qui se pressent dans les salles, en les remplissant et en les vidant comme des ombres, s’entraînent pour leur futur séjour définitif dans le grand Musée de l’humanité, du monde, dans lequel chacun est une nature morte. »[
La mémoire de la Rizerie est occultée pour protéger les familles des collaborateurs, dont le créateur du Musée aurait recopié, dans ses carnets disparus, les noms d’après des graffitis depuis chaulés.
Un livre total, ou de l’importance du big data ?
« Pour comprendre la guerre et donc pour la vaincre, il faut connaître tout ce qui conflue dans la guerre c’est-à-dire tout, les bulletins de salaire, la publicité à la télévision, la courbe des mariages des divorces et des viols, les repas de famille, les contes de grand-mère, la fraternité qui ne se crée que pendant les guerres [… »
Plusieurs biographies sont plus ou moins développées, telle celle du tchécoslovaque Alberto Vojtěch Frič, expert en cactus et ethnographe des Chamacocos (sisi), Indiens du Gran Chaco ; nombre des personnes évoquées (Italiens et Autrichiens notamment) m’est d’ailleurs inconnu.
« Otto Schimek, condamné à mort et exécuté par la Wehrmacht pour avoir refusé de tirer sur des civils polonais. »
Moment fort que ce controversé « martyr antinazi autrichien » ‒ ou simple déserteur :
« Tout ce qui arrive est un faux, l’œuvre d’un copiste. L’univers entier est la copie retouchée de qui sait quel autre monde. »
Martin Pollack est directement impliqué dans la révélation de cette histoire.
Le passé de Luisa est revu en parallèle de l’exposition muséographique du projet auquel elle travaille, et il s’avère peu à peu que son père est Martiniquais, soi du croisement de l’Afrique, l’Amérique (amérindienne) et l’Europe (Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant sont même pris comme références).
Le flot verbal parfois se presse, assez lyrique voire litanique, mêlant surtout éléments bibliques et mitteleuropéens, mais aussi latino-américains.
Une vaste métaphore associe le glioblastome à l’œil, à l’agate et à la guerre tandis que les Allemands, les fascistes, les titistes, les communistes, les Slovènes, les Néo-Zélandais se disputent Trieste à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le collectionneur-notateur serait un certain Carlo Fozzi (en fait le personnage est inspiré de Diego de Henriquez), « Témoin, historien, collectionneur ou maniaque ? », « caricature totalisante du tempérament anal » ; ce syllogomane devient essentiellement recueilleur de noms, jusqu’à la conflagration finale de sa collection-compilation, incendie où il disparaît, en miroir de crématoire.
« …] pourtant c’était le seul four crématoire qui ait existé en Italie et personne, vraiment personne, n’en savait rien, c’est cela qui est tragique, ils étaient parvenus à effacer cette vérité, cette réalité… »
« Mieux, l’acte de disparaître et surtout de faire disparaître est un objet privilégié d’occultation et d’oubli. De refoulement, a dit au procès le docteur Wulz. Effacer l’absence, annuler la personne, la chose qui n’est plus là ; éteindre non seulement le souvenir de celui ou celle qui s’en est allé, mais aussi la conscience qu’il, elle, quelqu’un s’en est allé. Qui n’est plus là encombre, c’est un compte non soldé, un trou dans le mur ; on fait tout alors pour ne pas savoir qu’il n’y est pas, qu’il n’y a jamais été, pour effacer et reboucher ce trou. […]
Le four crématoire est une excellente chirurgie de l’oubli. »
Mots-clés : #antisémitisme #campsconcentration #deuxiemeguerre #historique #mort
- le Lun 28 Sep - 22:11
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Claudio Magris
- Réponses: 17
- Vues: 2320
Evguenia Guinzbourg
Le vertige Tome 1
« L’année 1937 commença, en vérité, à la fin de 1934, très exactement le 1er décembre 1934.
À 4 heures du matin, le téléphone sonna. Mon mari, Pavel Vasilevitchi Axionov, membre du Secrétariat du Comité régional du parti de Tatarie, était en mission. De la pièce à côté me parvenait la respiration régulière des enfants qui dormaient.
— Rendez-vous à 6 heures au Comité régional, bureau 38 !
C’est à moi, membre du parti, qu’on l’ordonnait »
Evguénia (Jénia) est accusé de ne pas avoir dénoncé le Trostkyste Elvov avec qui elle travaillait et qui a été arrêté. Ce dernier la prévient « vous ne comprenez pas les évènements qui viennent pour vous ce sera très difficile ». Ce le fut.
« — Mais il avait toute la confiance du Comité régional. Les communistes l’avaient élu membre du Comité urbain.
— Vous deviez signaler que l’on commettait une erreur. C’est bien pour cela que vous avez reçu une éducation supérieure et un titre académique.
— Mais a-t-on dès à présent prouvé qu’il était trotskyste ?
Cette naïveté provoqua une explosion de sainte indignation.
— Il a été arrêté, oui ou non ? Pensez-vous peut-être qu’on arrête sans disposer de faits précis ? »
Arrestation, procès où les accusés doivent se repentir de ce dont on les accuse, c’est-à-dire tout et n’importe quoi puisque la réalité est la fausseté des accusations.
« se frappant la poitrine, les coupables criaient bien haut qu’ils avaient fait preuve de myopie politique, qu’ils avaient manqué de vigilance, qu’ils s’étaient montrés conciliants à l’égard d’individus douteux, qu’ils avaient porté de l’eau au moulin du coupable, qu’ils avaient fait preuve de libéralisme pourri. Ces formules, et bien d’autres du même genre, retentissaient sous les voûtes des édifices publics »
« Après chaque procès, les choses allaient plus mal. Bientôt se répandit la terrible accusation d’« ennemi du peuple ». Par une logique infernale, chaque région et République devait avoir son quota d’« ennemis » pour ne pas se montrer en retard sur la capitale ».
Sommée de rendre sa carte du parti communiste, qu’elle gardait précieusement, lui est retiré le droit d’enseigner et arrive l’année 1937 où elle est convoquée au « Lac Noir », se suivront l’internement dans plusieurs prisons, le procès : Evguenia ne s’est jamais repentie, elle fut condamnée à 10 ans ! En isolement pendant 3 ans à Laroslavl d’où elle fut envoyé à Kolyma.
Que ce soit en prison, à l’isolement, au cachot disciplinaire Evguenia récitait à haute voix quand s’était permis ou dans sa tête les poèmes d’Essénine, Maïakoski, Nekrassov…….la poèsie, la littérature la soutenaient.
Déjà avant leur départ en train portant mention « outillage spécial »(elles les incarcérées) Jénia et les autres détenues avaient pu avoir des nouvelles de l’extérieur, les bourreaux devenaient à leur tour victimes. Que d’ennemis du peuple , l’année 1937 en était fructueuse !!
Vous pouvez suivre le parcours de Jénia d’après les extraits qui suivent :
« Parfois le convoi, obéissant à je ne sais quel ordre supérieur, s’arrêtait des journées entières. Pas le moindre souffle d’air ne pénétrait dans notre fourgon, qu’envahissait en revanche une terrible puanteur. La porte était fermée hermétiquement. Nous avions l’ordre de nous taire, même lorsque le train était arrêté en pleine campagne. »
Camps de transit de Vladivostok: « Carcérales »… Les affreuses bêtes qu’on appelle « carcérales »… Nous traînerons avec nous cette définition, comme un poids écrasant, pendant près de dix ans. Nous sommes les plus méchantes des méchantes, les plus criminelles des criminelles, les plus malheureuses des malheureuses ; le comble du mal. »
Avec un cynisme qui désarmait et qui n’étonnait plus personne, le médecin du camp faisait son « diagnostic » d’après la condamnation. Les travaux forcés les plus durs, qui exigeaient une santé de « première catégorie », étaient réservés aux « politiques.
« Bizarrement, ce nom de Kolyma qui terrorisait tout homme libre, non seulement ne nous effrayait pas, mais éveillait en nous une espérance.
— Si nous pouvions partir bientôt !
— À Kolyma, au moins, nous mangerons à notre faim.
— Le froid et le gel sont préférables à cet étouffement ! »
Sur le Djourma – le bateau qui emmène à Kolyma, embarque aussi les femmes du « milieu » :
« Ce n’étaient pas des garces banales, mais l’extrême du monde de la délinquance : des récidivistes, des homicides, des perverses, des maniaques sexuelles. Aujourd’hui encore je suis fermement convaincue qu’on ne devrait pas reléguer ce genre de femmes dans des prisons ou dans des camps, mais dans des hôpitaux psychiatriques. Lorsque je vis s’engouffrer dans la cale cette horde aux visages simiesques, ces corps à moitié nus et tatoués, je crus qu’on avait décidé de nous faire exterminer par des folles. »
Poème d’Essénine :
« Pas de chance, aujourd’hui,
Madame la mort ! Au revoir.
Jusqu’à la prochaine. »
A Magadan : Pour Jénia travail de « droit commun » à l’hôtel, puis au réfectoire, elle récupère. Elle a la chance de trouver des « aides », la répartitrice des travaux (contre un manteau), le cuisinier sourd, un médecin.
Arrive un convoi d’hommes : « « Il y a parmi nous un gars de chez vous, oui, de Kazan… C’est la fin. Il ne tiendra pas jusqu’à ce soir. Il a su qu’une femme de Kazan travaillait au réfectoire et il m’a envoyé demander du pain. Pouvez-vous lui en donner ? Avant de mourir, il voudrait au moins manger à sa faim. Il s’agit d’un de vos compatriotes. Vous qui êtes au réfectoire…
« — Tenez, fis-je en lui tendant ma ration. Et donnez-lui un salut de ma part. Attendez ! Comment s’appelle-t-il ?
— C’est le major Elchine. Il travaillait au N.K.V.D., à Kazan.
Je laissai tomber le morceau de pain. Le major Elchine !
Voilà le pain. Donnez-le lui… Attendez ! Dites-lui seulement qui le lui envoie. Rappelez-vous mon nom, et dites-le lui.
C’était l’enquêteur qui avait estimé « ses crimes » ! Le bourreau était à présent victime !
A l’abattage des arbres, départ vers Elguen !
« — Vous avez trois jours pour vous entraîner. Pendant ces trois jours, la nourriture vous sera distribuée sans tenir compte de la norme. Après, on vous la distribuera en proportion de votre travail. Vous mangerez autant que vous abattrez.
Pendant trois jours, Galia et moi, nous tentâmes l’impossible. Pauvres arbres ! Comme ils souffraient sous nos coups maladroits ! »
« À partir de ce jour, celles qui n’atteignaient pas la norme – c’était le cas de toutes les « politiques » tirées de prison, sans exception – furent, au retour du travail, conduites non plus dans les baraques, mais directement au cachot. Il est difficile de décrire ce cachot disciplinaire. C’était une petite baraque sans chauffage et qui ressemblait à des latrines publiques : il était absolument interdit d’en sortir et aucun seau n’y avait été installé. »
« Un jour de mai, alors que j’étais occupée à couper les nœuds d’un mélèze que nous venions d’abattre, je vis pour la première fois, près d’une souche fraîche, dans la vapeur de la glace qui fondait, un petit rameau de myrtilles conservé sous la neige, un vrai miracle de fragilité, une création parfaite de la nature. Il portait six baies d’un rouge presque noir, si délicates qu’on avait le cœur serré à les regarder. Comme tout ce qui est trop mûr, les baies tombaient au moindre contact. On ne pouvait les cueillir sans qu’elles fondissent entre les doigts. Mais en se couchant par terre, sur le ventre, on pouvait les manger directement à même la branche. Je les saisis de mes lèvres sèches et crevassées par le vent, et les pressai une à une entre ma langue et mon palais. Elles avaient une saveur indescriptible : celle d’un vin qui « bonifie en vieillissant ». La saveur acidulée des myrtilles ordinaires n’est en rien comparable à l’arôme enivrant de ces baies que les souffrances endurées pour surmonter l’hiver rendaient encore meilleures. Quelle découverte ! Je mangeai les fruits de deux branches, à moi toute seule. Et ce n’est que lorsque j’en découvris une troisième, que je redevins un être humain, capable de solidarité ; je criai, agitée :
— Galia ! Galia ! Jette ta hache et viens vite ! Regarde… J’ai rencontré « du raisin aux larmes d’or ».
« — On t’envoie à la maison d’enfance. Tu y seras infirmière, me dit d’un ton aimable le jeune soldat qui était venu nous chercher.
Je l’aurais embrassé.
Pendant le trajet, notre remorque se détacha du tracteur et tomba dans le canal qui, bien que nous fussions en juin, était gelé. Mais comment donner de l’importance à cet épisode ? Encore une fois, j’avais échappé à la mort. »
La suite dans le Tome II.
C’est une excellente lecture, nous découvrons le terrifiant régime stalinien, le destin de la personne accusée d’être un « ennemi du Peuple », des premiers instants où on s’interroge d’une convocation, puis où on commence à craindre, l’arrestation, le procès, la condamnation.
L’auteure en racontant son drame personnel montre également celui de ses compagnes de tout horizon, de toutes opinions politiques : des socialistes révolutionnaires, des communistes, des trotkystes ……
En fond la société dans les années 30 et le rappel des évènements internationaux (la guerre d’Espagne…)
Mots-clés : #autobiographie #campsconcentration #regimeautoritaire
- le Sam 28 Mar - 0:08
- Rechercher dans: Écrivains Russes
- Sujet: Evguenia Guinzbourg
- Réponses: 9
- Vues: 1512
François Cheng
Le Dit de Tian-Yi
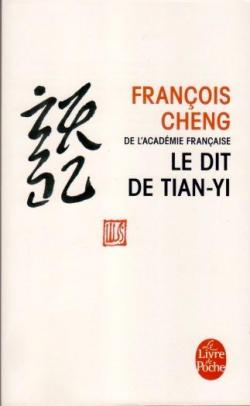
Roman, 1998, 435 pages environ, trois parties de tailles inégales.
L'écriture de François Cheng est gracile, légère, précise; et il faut bien cela pour un ouvrage excédant les 400 pages, pour cet exercice si particulier ambitionnant de couvrir la vie entière d'un personnage, exercice à écueils par excellence, où l'on risque de donner dans l'empâté, l'accessoire, les pages de moindre haleine: c'est un choix courageux d'auteur déjà notoire, qui se risque à un premier roman publié.
Si le roman croise sans nul doute l'autobiographie de François Cheng, il ne se moule jamais dedans: Néanmoins, on a bien un jeune artiste chinois, de sa génération -quasiment de son âge- qui part à Paris, jusque là d'accord, mais à ceci près, et c'est une grosse différence, qu'il revient en Chine et y demeure dès les années 1950 et jusqu'à la fin de ses jours.
C'est la peinture d'un trio, composé de Yumei -l'Amante- artiste de théâtre, d'Hoalang -l'Ami- poète, écrivain et Tian-Yi, le peintre.
De la possibilité, ou de l'impossibilité, d'un amour et d'une amitié, fusionnels, à trois. Mais c'est aussi une fresque de la Chine sur un gros demi-siècle, embrassée depuis la guerre d'invasion nippo-chinoise jusqu'à la fin de la vie de Mao Zedong, ce dernier curieusement jamais nommé, en tous cas jamais autrement que le Chef.
Beaucoup de considérations passionnantes sur la symbolique, l'art, jalonnent ce qui a l'apparence d'un récit (normal au vu de l'auteur).
Tout ce qui est dit en matière de Taoïsme, Bouddhisme, société traditionnelle et société révolutionnaire ne le cède nullement pour ce qui est de l'intérêt du lecteur.
La représentation romanesque de la nature est à l'honneur, manière peut-être de jonction avec l'art pictural chinois traditionnel: par exemple après ce livre, jamais plus vous ne regarderez un fleuve de la même façon qu'avant:
1ère partie, chapitre 30 a écrit:
"Question très intéressante, essentielle même, essentielle..." C'était le professeur F. célèbre spécialiste de la pensée chinoise, que d'aucuns approchaient avec un respect craintif. J'y étais allé de ma naïveté, sans gêne outre mesure, car je ne demandais qu'à écouter.
"Oui, le fleuve comme symbole du temps; que signifie-t-il ? Voyons, comment répondre à cette question ? " Son front se plissa derrière ses lunettes cerclées d'argent. "Il faut bien parler de la Voie, n'est-ce pas ? ... Tiens, quelle coïncidence ! Demain, nous traverserons justement la région dont est originaire notre cher Laozi. Celui qui est, vous le savez bien à l'origine du taoïsme et qui a développé l'idée de la Voie, cet irrésistible mouvement universel mû par le Souffle primordial. A demain alors; on en parlera."
"La Voie donc..." reprit le savant le lendemain, comme s'il n'y avait pas eu l'interruption de la nuit.
Pour ce trio, apprenant une funeste nouvelle touchant Haolang, Tian-Yi reviendra de France en Chine, aux heures sombres et tourmentées, pour son malheur peut-on penser, mais toute l'adresse de François Cheng consiste à montrer combien la quête de Tian-Yi, bien que semblant aussi vaine que dangereuse à nos regards, dépasse nos considérations terre-à-terre: il n'y a que cela qui vaille, parce qu'au fond, c'est bel et bien une passion qu'ils vivent (donc une souffrance à mort).
Si la chronologie par le menu mêle la petite histoire, celle des personnages, à la grande, celle de la Chine du XXème, l'érudit M. François Cheng nous fait aussi caresser, en forme de roman et c'est donc très singulier, l'art pictural ancestral de la Chine, la calligraphie comme la représentation peinte, en démarrant aussi loin que l'art des grottes ornées et en aboutissant au néant sidéral de la révolution -dite- culturelle.
Sans doute est-il nécessaire de s'armer d'un peu d'imagination, et d'effectuer une lecture précautionneuse, mais oui, on a l'impression d'atteindre à cela par les vides, les estompes, les déliés, les courbes, les symboles naissant de sa plume...
#Amitié
#Amour
#CampsConcentration
#Creationartistique
#Exil
#Regimeautoritaire
- le Ven 19 Avr - 1:23
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: François Cheng
- Réponses: 19
- Vues: 2869
Daniel Mendelsohn
Les Disparus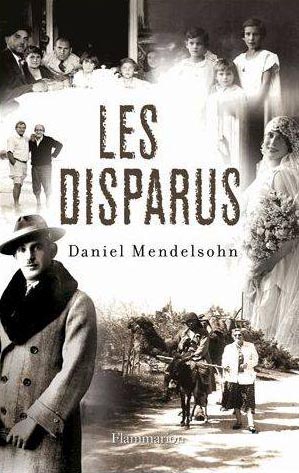
Très tôt dans l’ouvrage, les commentaires du commencement de la Torah, l’origine du monde et le début de l’histoire de l’humanité, le présentent comme une sorte de travelling du général au particulier, procédé choisi par souci de raconter une histoire particulière pour représenter l’universelle. Une intéressante glose de la Bible se déroule en parallèle de l’enquête de l’auteur, insérée en italiques comme tout ce qui est externe à son cours, et concernant notamment les annihilations divines (le déluge, Sodome et Gomorrhe) ; on apprend aussi qu’Abraham, le premier Juif, s’est enrichi comme proxénète de sa propre femme auprès de Pharaon (IV, 1)…
Daniel Mendelsohn revient sur les mêmes points, répète les mêmes choses, cite plusieurs fois le même document ou le même extrait dans une sorte de délayage qui ne m’a pas toujours paru approprié ou plaisamment effectué ; de plus, l’ouvrage fait 750 pages, et c’est long. Peut-être est-ce calqué sur la forme litanique de lamentations du type kaddish, comme le livre éponyme d’Imre Kertész ; il est vrai que par contraste les témoignages précis (et horribles) marquent d’autant plus. En tout cas, on peut s’attendre à des moments d’ennui ou d’agacement avec d’être totalement pris par les attachantes personnes rencontrées dans cette quête étendue dans le temps et l’espace.
Les Disparus, c’est ceux (personnes et culture) dont il ne reste apparemment rien et dont Mendelsohn tente de retrouver trace, mais c’est aussi beaucoup l’histoire de sa parentèle ; le goût prononcé pour la famille et la généalogie, un peu désuet voire étonnant pour certains.
Ce livre, c’est encore comment conter, le compte-rendu de l’élaboration de sa narration, la transmission des faits de la Shoah par les petits-enfants des témoins ; focus et importance des détails.
« Un grand nombre de ces fêtes [juives], je m'en étais alors rendu compte, étaient des commémorations du fait d'avoir, chaque fois, échappé de justesse aux oppressions de différents peuples païens, des peuples que je trouvais, même à ce moment-là, plus intéressants, plus engageants et plus forts, et plus sexy, je suppose, que mes antiques ancêtres hébreux. Quand j'étais enfant, à l'école du dimanche, j'étais secrètement déçu et vaguement gêné par le fait que les Juifs de l'Antiquité étaient toujours opprimés, perdaient toujours les batailles contre les autres nations, plus puissantes et plus grandes ; et lorsque la situation internationale était relativement ordinaire, ils étaient transformés en victimes et châtiés par leur dieu sombre et impossible à apaiser. » I, 2
« …] écrire ‒ imposer un ordre au chaos des faits en les assemblant dans une histoire qui a un commencement, un milieu et une fin. » I, 2
« Nous ne voyons, au bout du compte, que ce que nous voulons voir, et le reste s'efface. » I, 2
« Mais, en même temps, qui ne trouve pas les moyens de faire dire aux textes que nous lisons ce que nous voulons qu’ils disent ? » II, 1
« La première Aktion allemande, a commencé Bob, qui voulait que je comprenne la différence entre les tueries organisées des nazis et les vendettas privées de certains Ukrainiens, ceux qui avaient vécu avec leurs voisins juifs comme dans une grande famille, comme m'avait dit la gentille vieille Ukrainienne à Bolechow, a eu lieu le 28 octobre 1941. » III, 2
Curieuse reconnaissance de la judéité chez quelqu’un, ici par un autre juif :
« Quelqu'un en uniforme français, et je me suis approché de lui, et il avait l'air d'être juif. » III, 2
Francophobie, ou french bashing ?
« (Le rabbin Friedman, au contraire, ne peut se résoudre à envisager seulement ce que les gens de Sodome ont l'intention de faire aux deux anges mâles, lorsqu’ils se rassemblent devant la maison de Lot au début du récit, à savoir les violer, interprétation que Rachi accepte placidement en soulignant assez allègrement que si les Sodomites n'avaient pas eu l'intention d'obtenir un plaisir sexuel des anges, Lot n'aurait pas suggéré, comme il le fait de manière sidérante, aux Sodomites de prendre ses deux filles à titre de substitution. Mais, bon, Rachi était français.) » V
« Parfois, les histoires que nous racontons sont les récits de ce qui s'est passé ; parfois, elles sont l'image de ce que nous aurions souhaité voir se passer, les justifications inconscientes des vies que nous avons fini par vivre. » IV, 1
« …] plus nous vieillissions et nous éloignions du passé, plus ce passé, paradoxalement, devenait important. » IV, 2
« …] les petites choses, les détails minuscules qui, me disais-je, pouvaient ramener les morts à la vie. » IV, 2
« Les gens pensent qu'il n'est pas important de savoir si un homme était heureux ou s'il était malheureux. Mais c'est très important. Parce que, après l'Holocauste, ces choses ont disparu. » IV, 2
« …] la véritable tragédie n'est jamais une confrontation directe entre le Bien et le Mal, mais plutôt, de façon plus exquise et plus douloureuse à la fois, un conflit entre deux conceptions du monde irréconciliables. » V
« Il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de coïncidences magiques. Il n'y a que la recherche et, finalement, la découverte de ce qui a toujours été là. » V
Mots-clés : #antisémitisme #campsconcentration #communautejuive #devoirdememoire #entretiens #famille #genocide #historique
- le Sam 23 Mar - 20:29
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Daniel Mendelsohn
- Réponses: 56
- Vues: 5225
Philippe Apeloig
Enfants de Paris 1939-1945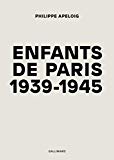
Souvenez-vous d’eux, votre mémoire est leur seule sépulture.
Philippe Apeloig s’est donné pour tâche de répertorier, photographier et transmettre dans un cadrage rigoureux plus de 1000 plaques commémoratives de la période 1939-1945 à Paris, classées par arrondissement, dans un souci d’exhaustivité dont il savait d’avance qu’elle ne serait jamais parfaite.
Des enfants, des hommes, des femmes, arrêtés, déportés, fusillés, décapités, torturés par ceux qui sont nommés selon les plaques les boches, les Allemands, les nazis, l’ennemi, les hitlériens. Des juifs, des résistants, des soldats, des anonymes ou des hommes célèbres réduits à rien par le destin, humblement et fermement commémorés par des plaques éparpillées sur les murs de la capitale, dans les rues, sur les façades, dans des lieux publics ou privés.
Dans un texte très émouvant, il raconte comment son grand-père, émigré de Pologne à Paris, a caché sa famille en zone libre à Châteaumeillant où elle fut sauvée grâce à la constante complicité de la population. Le grand-père, lui, a rejoint le maquis. La mère de Philippe Apeloig n’a eu de cesse de commémorer, à travers cet événement, les habitants salvateurs. Cette démarche s’est confrontée à l’expérience de Philippe Apeloig, son expérience de graphiste et de typographe, sa visite au mur des vétérans de Washington érigé par Maya Lin, son vécu du 11 septembre à travers les milliers de petits mots laissés par les habitants autour du désastre. Tout cela l’a amené à la construction progressive de ce livre, longuement mûri, de cette collection de fourmi obsessionnelle.
Nous avions repéré, Monsieur topocl il y a quelques mois, l’annonce de ce livre dans divers journaux. Nous en avions discuté, admiratifs d’une démarche que certains pourraient qualifier de vaine, mais qui nous avait semblé cruciale. De là à acheter le livre… nous ne nous étions pas lancés. Topocl Junior nous avait gentiment moqué, rappelant que, si nous avions toujours fréquenté les cimetières militaires, y traînant notre marmaille, si nous continuons à e faire encore aujourd’hui, nous ne nous étions jamais « amusés » à en lire successivement chaque pierre tombale.
Mais un ange silencieux et bienveillant a bien vu, lui, que ce livre était pour moi.
C’est d’abord un splendide objet, dont la forme, très rectangulaire, la couleur et la typographie de couverture évoquent évidemment les plaques qu’il enserre. Présentation très soignée, les feuilles de garde, bleu pour la première, rouge pour la dernière enserrant la tranche blanche dans un bel hommage patriotique, que complète des signets tissés également bleus et rouges.
Contemplant tout d’abord songeusement l’ouvrage, témoin de quelque chose qui peut-être considéré comme une performance artistique, je me demandais comment me l’approprier. Une plaque par jour ? J’en avais de plus de trois ans. Je m’étais finalement décidée pour un arrondissement par jour.
Et puis, il faut bien le dire, entrée là-dedans, il m’a semblé impossible d’en sortir, captivée, aimantée, très soigneusement préparée par l’introduction de l’auteur qui parle de mis en page, de typographie, de police, de choix des mots… J’ai avancé, j’ai continué, je n’ai rien pu lâcher jusqu’à la dernière page. C’était une belle promenade, pleine d’émotions et de sérieux, l’impression de quelque chose de bien, quand bien même je ne faisais finalement que quelque chose de très égoïste.
Qui étaient-ils ? Que seraient ils devenus ? Qu’on-t’ils pensé dans leurs derniers moment ? Qui les a pleurés ? Qui pense encore à eux ?
mots-clés : #campsconcentration #communautejuive #deuxiemeguerre #devoirdememoire #temoignage
- le Jeu 24 Jan - 17:58
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Philippe Apeloig
- Réponses: 5
- Vues: 1004
Gila Lustiger
Mon père a toujours voulu nous protéger de lui-même ; pas des Allemands, de lui-même. Pas de l’homme, bien sûr, qu’il était venu après tant d’années vouées à la rigueur et à la discipline de son travail de refoulement; mais de son pire ennemi, qu’il a combattu pendant cinquante nous ans et qu’il croit à présent avoir vaincu, lui, l’homme d’affaires et l’essayiste en vue : le garçon exténué du camp de concentration. Mon père a toujours voulu nous protéger de ce jeune homme et ne nous a jamais laissé voir son visage d’enfant parce qu’il n’était ni innocent, ni tendre, ni joufflu, ni pur. Mais c’est justement ce visage que ma sœur et moi avons cherché toute notre vie. En vain.
Dans ce texte tardivement autobiographique, Gila Lustiger raconte sa famille Ses parents, ses grands-parents. Son grand-père maternel, le jeune sioniste, communiste convaincu, qui embarque de Pologne sa bourgeoise de fiancée, pour de ses mains participer à la création de l’État d’Israël. Son père réchappé d’Auschwitz, enfermé dans son silence, ses journaux, ses livres et qui a nommé ses filles l’une Bonheur, l’autre Joie.
Au-delà des portrait émouvants, et souvent savoureux, elle raconte aussi ce livre en train de se faire, ce que cela coutes d’être écrivain et romancière dans une famille vouée au silence, et qui peut considérer la fiction comme une insulte à ce qu’elle a vécu.
Gila Lustiger est prise entre une fougueuse admiration, une compassion bouleversée, mais aussi une détestation déterminée : le poids du silence, le devoir d’assumer ce fardeau, censé déterminer la conduite de tous les descendants, un devoir de courage et de bonheur par respect pour ceux qui sont revenus.
Pas facile de grandir, puis d’être une adulte libre là au milieu
C’est assez disparate, La traduction joue peut-être son rôle. Mais Gila Lustiger gagne son lecteur par son humour décapant, son ironie, qui peut parfois aller jusqu’à la hargne, sa capacité à briser les tabous et à s’autoriser la subversion.
Eh oui, c’est la vérité, même si elle est inavouable : ce n’est pas aux assassins que j’en voulais, ni aux collaborateurs, aux lâches, aux voleurs, aux tortionnaires et aux traîtres, mais à ma famille qui avait été anéantie pendant la guerre à cause des Allemands. Je pensais : Il fallait que ça tombe sur toi. Être justement ce qui te déprime, le rejeton d’une famille anéantie.
En tout cas, merci à bix pour cette lecture qui, derrière l’émotion, marque son originalité par un côté pas toujours politiquement correcte, pas du tout.
mots-clés : #autofiction #campsconcentration #communautejuive #conflitisraelopalestinien #devoirdememoire #famille
- le Jeu 17 Jan - 20:35
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: Gila Lustiger
- Réponses: 5
- Vues: 809
Sergueï Lebedev
La limite de l’oubli
Histoire : le narrateur étant enfant , mordu par un chien , a été sauvé par un vieillard aveugle, voisin que la famille de l’enfant surnomme « l’Autre Grand-Père ». L’enfant se sent soumis par ce vieil homme, en fait personne ne l’aime. Devenu adulte et héritier de l’appartement de « l’Autre Grand-Père » le narrateur ressent la même contrainte et décide de partir sur les traces du vieil homme, dans son passé pour connaître la part de mystère.
C’est sombre, très sombre ; les phrases de l’auteur commencent souvent par la clarté, la beauté mais l’ ombre, le tragique, la laideur, les mauvaises odeurs, la crasse s’installent.
Etranges relations de l’enfant narrateur vis-à-vis du vieil homme qui malgré son handicap en imposait.
A l’âge d’adulte la découverte de « jouets » dans l’appartement légué, ainsi que les courriers reçus par « l’Autre Grand-Père » décident le narrateur à partir sur les traces de son passé pour découvrir ce qui participe de son rejet et de l’impression qu’il a toujours eue de la privation, de l’ emprise sur sa personne par ce vieillard.
C’est donc dans la toundra que le narrateur découvrira le passé de « l’Autre Grand-Père » mais aussi le passé de son pays, un passé tragique, que ceux qui vivent là-bas veulent oublier, mais dont les stigmates sont bien visibles encore.
C’est une histoire sur la mémoire, la perte d’identité puis l’oubli. La toundra porte en elle mémoire et oubli des hommes, de la vie, particulièrement celle des détenus des camps. Le narrateur connaîtra dans ces recherches cette période tragique de son pays lui qui est né bien après ; il recevra les paroles de ceux qui se souviennent encore, les témoins car les victimes sont disparues.
C’est très bien écrit ! de nombreuses digressions qui confortent les faits, des réflexions intéressantes sur l’enfance, mais je sors de cette lecture avec un sentiment de mal-être tant les images sont évocatrices.
Il me faudra donc lire un autre livre de cet auteur.
Extraits :
« Une gamelle fumante sur le feu, on prépare une soupe de poisson ; l’ombre est tendre, il ne faut pas le faire cuire trop longtemps. Cette chair toute fraîche, frottée de sel et de poivre, laissée longtemps sous un poids, a rendu son jus : un délice. Mais ensuite vous marchez le long de la rivière, le sentier saute d’une rive à l’autre et, pendant une de ces traversées, l’un d’entre vous trébuche sur un crâne humain coincé entre les pierres, recouvert de mousse verte gluante. »
« Je sentais que sa relation avec moi était dépourvue de vie, qu’il y avait là autre chose qui ne se laissait pas nommer ; cet « autre chose », je ne pus le comprendre qu’une vingtaine d’années plus tard. »
« C’est ainsi que mon existence rejoignit la sienne et je ne fus plus jamais moi-même : le sang de l’ Autre Grand-Père qui m’avait sauvé circulait dans mes veines. Mon corps d’enfant était irrigué par le sang de ce vieillard aveugle, maigrichon, ce qui me sépara définitivement des gamins de mon âge. Je grandis sous le signe du sacrifice inappréciable que l’ Autre Grand-Père avait consenti pour moi. Je grandis comme un greffon sur un vieil arbre. »
« Je compris la raison des relégations vers la taïga, vers la toundra : il s’agissait de rayer les hommes de l’existence commune, de les déporter hors de l’histoire. Leur mort n’advenait pas dans l’histoire, mais dans la géographie. »
mots-clés : #campsconcentration #enfance #regimeautoritaire
- le Sam 12 Jan - 19:05
- Rechercher dans: Écrivains Russes
- Sujet: Sergueï Lebedev
- Réponses: 6
- Vues: 1018
Judith Perrignon
Et tu n'es pas revenuavec Marceline Loridan-Ivens
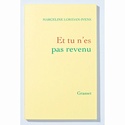
Pourquoi une fois revenue au monde, était-je capable de vivre ? C'était comme une lumière aveuglante après des mois dans le noir, c'était violent, les gens voulaient que tout ressemble à un début, ils voulaient m'arracher à mes souvenirs, ils se croyaient logiques, en phase avec le temps qui passe, la roue qui tourne, mais ils étaient fou, pas que les Juifs, tout le monde ! La guerre terminée nous rongeait tous de l'intérieur.
Des camps, Marceline est revenue à 17 ans, mais son père, parti avec elle, n'est pas revenu. Avec une belle intelligence affective, elle raconte, 75 ans après, parce que c'est toujours là, comment "Mon retour est synonyme de ton absence". Comment ce mari, ce père, dont on ne sait rien de ses derniers mois et de sa mort, qui n'a même pas de tombe, a manqué, laissant une béance impossible à combler, définitivement traumatisante. Elle raconte l'impossible retour, l'impossible réconciliation au monde.
mots-clés : #autobiographie #campsconcentration #relationenfantparent
- le Sam 8 Sep - 13:04
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Judith Perrignon
- Réponses: 8
- Vues: 1483
Marceline Loridan-Ivens avec Judith Perrignon
Et tu n'es pas revenuavec Judith Perrignon
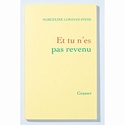
Pourquoi une fois revenue au monde, était-je capable de vivre ? C'était comme une lumière aveuglante après des mois dans le noir, c'était violent, les gens voulaient que tout ressemble à un début, ils voulaient m'arracher à mes souvenirs, ils se croyaient logiques, en phase avec le temps qui passe, la roue qui tourne, mais ils étaient fou, pas que les Juifs, tout le monde ! La guerre terminée nous rongeait tous de l'intérieur.
Des camps, Marceline est revenue à 17 ans, mais son père, parti avec elle, n'est pas revenu. Avec une belle intelligence affective, elle raconte, 75 ans après, parce que c'et toujours là, comment "Mon retour est synonyme de ton absence". Comment ce mari, ce père, dont on ne sait rien de ses derniers mois et de sa mort, qui n'a même pas de tombe, a manqué, laissant une béance impossible à combler, définitivement traumatisante. Elle raconte l'impossible retour, l'impossible réconciliation au monde.
mots-clés : #autobiographie #campsconcentration #relationenfantparent
- le Sam 8 Sep - 13:03
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Marceline Loridan-Ivens avec Judith Perrignon
- Réponses: 33
- Vues: 3377
Chen Ming
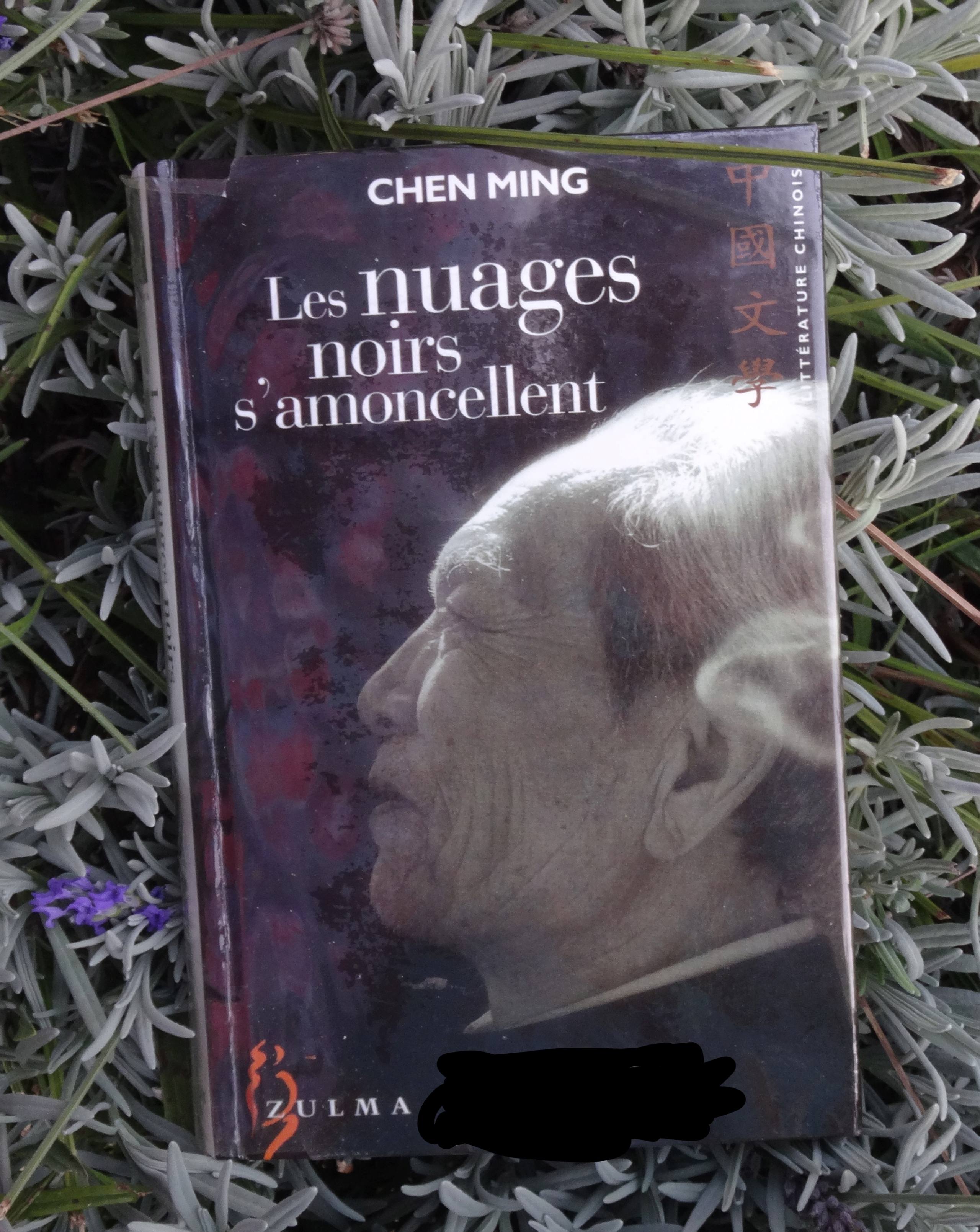
Les nuages noirs s'amoncellent
La moitié de ma vie est le reflet du régime communiste. Ma vie n'a cessé d'être instable. Enfant, je dus me battre contre la misère. Grâce aux études, j'ai réussi à devenir professeur d'université. En plein épanouissement intellectuel, j'ai dû renoncer à toute activité et je fus envoyé dans un camp. Ensuite ce furent vingt-cinq années d'oppression et d'humiliation sans relâche.
Mon cauchemar a duré trente ans à cause d'une erreur de l'histoire.
Chen Ming est né en 1908 dans la province du Shanxi, au nord de la Chine. Son enfance fut misérable, marquée du sceau de la tristesse de sa mère, qui vit plusieurs de ses enfants mourir faute de soins. Chen Ming vivait dans un même habit rapiécé à l'infini, et ne mangeait que rarement à sa faim. Pourtant, sa mère, ignorant les quolibets des voisins, l'envoya coûte que coûte à l'école. Et son fils lui donna raison. A force de ténacité et grâce à la générosité de quelques amis, il devint professeur d'histoire contemporaine à l'université. Il pensait enfin pouvoir couler des jours heureux avec son épouse lorsque l'arrivée des communistes au pouvoir en décida autrement, signifiant le début d'un cauchemar qui devait durer près de 30 ans...
Les purges parmi les intellectuels chinois débutèrent dès 1951. Sans aucun jugement, sans savoir ce qu'on lui reprochait, Chen Ming fut condamné à 5 ans de laogai (le goulag chinois), où il vécut les pires sévices. Et sa libération en 1956 ne signifia en rien la fin de ses tourments...
Comme ancien détenu, mais aussi comme intellectuel, il fut brimé sans fin. Son sort était à la merci des décisions arbitraires et fluctuantes d'un régime totalitaire devenu fou. Vingt années durant, il dut balayer les rues sans relâche. Les fouilles et pressions policières, tout comme les interrogatoires, étaient continuels. Sa femme fut elle aussi cataloguée de «droitière », et dut comme lui subir des « séances d'autocritique », terribles humiliations publiques sous les quolibets de la foule.
Ce cauchemar ne prit fin qu'en 1978, lorsque Chen Ming fut finalement réhabilité, et que l'état chinois reconnut qu'il avait été condamné par erreur. Comme par miracle, les mêmes qui, la veille encore, le vilipendaient et lui crachaient dessus, n'étaient désormais que sourire à son égard... Comment imaginer les sentiments de cet homme de 70 ans, dont la vie avait été broyée par l'Histoire, comme celles de tant de ses compatriotes ?
Ainsi que l'indique Jean-Luc Domenach dans la préface, le récit de Chen Ming « contribue à corriger l'impression fausse, propagée après le retour au pouvoir de Den Xiaoping, qui fait de la Révolution culturelle un délire soudain et comme accidentel. » En réalité, les campagnes visant à écraser le milieu intellectuel ne cessèrent de se succéder, et la Révolution culturelle n'en fut que le paroxysme. Nombreux furent ceux qui se suicidèrent de désespoir. Mais Chen Ming a refusé de se laisser fléchir, de cesser de réfléchir. Le lavage de cerveau n'a jamais pris sur lui ; en secret, il est toujours resté un homme libre.
Au soir de sa vie, devenu veuf, Chen Ming entreprit de rédiger ses mémoires. Conscient qu'il était impossible de les publier dans son pays, il les confia à Camille Loivier, alors jeune étudiante en Chine. A charge pour elle de les traduire et de les faire publier en France.
C'est donc ainsi que nous est parvenu ce récit terrible et poignant. Jusqu'au bout, Chen Ming garda une part de son mystère, ne partageant qu'avec grande parcimonie ses pensées les plus intimes et les ressorts qui lui permirent de tenir face à la barbarie. On sent là toute la retenue d'un être qui vivait encore en Chine, et à qui la vie avait appris qu'on ne peut vraiment faire confiance à personne... Et pourtant, ce sont bien les phrases de cet homme hors du commun qui nous permettent, à nous lecteur, de garder foi en l'humain, en son incroyable capacité de résistance et de résilience...
Un témoignage rare, bouleversant, essentiel.
mots-clés : #autobiographie #campsconcentration #regimeautoritaire #revolutionculturelle
- le Sam 18 Aoû - 21:48
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Chen Ming
- Réponses: 5
- Vues: 785
Marceline Loridan-Ivens avec Judith Perrignon
L'amour aprèsavec Judith Perrignon

Au crépuscule de sa vie, lumineux quoiqu'elle perde la vue, Marceline Loridan-Ivens rouvre la valise de ses archives et se rappelle comment, au retour des camps, avec "l'ombre de la mort" dans son dos, elle a fait le choix de la liberté, là où beaucoup de ses compagnes ont choisi le mariage, la sagesse, les enfants, cadre rassurant pour dépasser l'empreinte infernale. Comment elle joue le "jeu de la séduction dont j'avais abusé pour me rassurer, par simple peur d'être aspirée par le vide".
C'est l'occasion de parler d'un corps qui ne peut que se souvenir des sévices, de l'usage d'une espèce de liberté qu'elle a paradoxalement apprise dans les camps, où, jetée à 15 ans, elle s'est affranchie de toute tutelle pour ne vivre que par elle-même. C'est aussi l'occasion de parler d'amour dans cette incroyable relation partagée avec Joris Ivens, d'amitié, notamment avec quelques pages très fortes sur Simone Veil, si différente et si proche, de ce lien impossible à couper entre les survivant(e)s.
C'est un texte que la belle écriture de Judith Perrignon contribue à rendre aussi joyeux que terrible, vivant, en quelque sorte, de cette énergie de savoirs, de relations, de combats qui a conduit Marceline Loridan-Ivens.
Seuls comptent la quête, le mouvement, le sens.
Sans mentir, franche, résolue, elle ne franchit jamais les limites d'une impudeur, ni sur l'horreur ou la douleur, ni sur la joie, ni sur le plaisir. Les dernières pages sont bouleversantes, elle se retrouve seule dans le lit de son conjoint décédé reste de son côté, puis adopte le milieu. Tout cela est bien remuant. Il y a une beauté à cette façon de mener sa vie.
Mots-clés : #amour #autobiographie #campsconcentration #conditionfeminine #correspondances #temoignage
- le Mer 1 Aoû - 15:42
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Marceline Loridan-Ivens avec Judith Perrignon
- Réponses: 33
- Vues: 3377
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 
|
|
|


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages