Jean Malaquais
Page 2 sur 2 •  1, 2
1, 2
 Re: Jean Malaquais
Re: Jean Malaquais
oui la couverture de Bix illustre la nature et la tienne topocl les gens, non ?
_________________
“Lire et aimer le roman d'un salaud n'est pas lui donner une quelconque absolution, partager ses convictions ou devenir son complice, c'est reconnaître son talent, pas sa moralité ou son idéal.”
― Le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guenassia
[/i]
"Il n'y a pas de mauvais livres. Ce qui est mauvais c'est de les craindre." L'homme de Kiev Malamud

Bédoulène- Messages : 21639
Date d'inscription : 02/12/2016
Age : 79
Localisation : En Provence
 Re: Jean Malaquais
Re: Jean Malaquais
Bédoulène a écrit:merci topocl ! la situation des immigrés rappellent celle actuelle en France ?
A vrai dire, je ne la connais pas, la situation actuelle des immigrés. c'est comme les journalistes qui écrivent "oh, ce film est un tableau parfait des relations entre mafieux: comment savent-ils ça
Oui, ça j'ai compris. ce que je n'ai pas compris, c'est le pourquoi.Bédoulène a écrit:oui la couverture de Bix illustre la nature
_________________
Etre dans le vent, c'est l'histoire d'une feuille morte.
Flore Vasseur

topocl- Messages : 8546
Date d'inscription : 02/12/2016
Age : 64
Localisation : Roanne
 Re: Jean Malaquais
Re: Jean Malaquais
_________________
“Lire et aimer le roman d'un salaud n'est pas lui donner une quelconque absolution, partager ses convictions ou devenir son complice, c'est reconnaître son talent, pas sa moralité ou son idéal.”
― Le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guenassia
[/i]
"Il n'y a pas de mauvais livres. Ce qui est mauvais c'est de les craindre." L'homme de Kiev Malamud

Bédoulène- Messages : 21639
Date d'inscription : 02/12/2016
Age : 79
Localisation : En Provence
 Re: Jean Malaquais
Re: Jean Malaquais
Peut etre utilisé par antiphrase au titre pseudo exotique Les Javanais.
Sur le contenu, je pense personnellement que l' histoire et le style vont bien au delà
du brio. Qui ferait du livre un simple exercice de style meme brillant.
Non seulement le texte est vivant et moderne, mais il est très loin des applications
du réalisme, socialiste ou non de l' époque.
Bien des romans, ceux de Malraux par exemple, ont mal vieilli
Surtout, et je suis bien d' accord avec avec Jorge Semprun, il garde son actualité
sur la situation des immigrés et leur exploitation qui n' a guère changé.
Et pourquoi changerait-il ?
La France macronienne en est un bon exemple.

bix_229- Messages : 15439
Date d'inscription : 06/12/2016
Localisation : Lauragais
 Re: Jean Malaquais
Re: Jean Malaquais
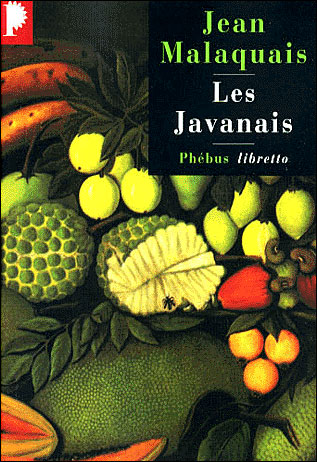
Galerie d’immigrés de provenances diverses, travaillant un maximum pour pas cher, sans compter les risques :« Ils allèrent se débarbouiller à la fontaine. Île de Java s’anime. Des voix filtrent à travers les cloisons disjointes des masures. Des hommes sortent sur le pas de leur porte, l’œil humide, le goût du rêve dans la bouche. Une mélopée d’autrefois s’échappe d’une sorte d’étable flanquée contre le mur à demi écroulé d’une ancienne fonderie. C’est le Bateau-lavoir, ainsi nommé pour le bouillonnement de chaudière qui jamais n’y relâche. Une vingtaine d’hommes y logent, chacun son châlit à soi, bien mieux que sur les galères d’antan ; vingt hommes qui se comprennent à l’aide d’un parler fait de toutes les langues et qui n’est d’aucune, étant celui de Java. Souvent l’étable change d’hôtes, souvent le Bateau varie d’équipage ; mais, surpeuplé ou non, là-dedans ça gueule et ça feule. Quand les Javanais disent qu’il y a réunion au Bateau-lavoir c’est que le Bateau vire de bord, c’est qu’il gondole et craque aux entournures. Quelques enfants, à peine culottés, sont à leur jeu de billes. Retour du marché ou de la messe, des Javanaises lavent des oripeaux au pied de la fontaine. Leurs hommes tournent en rond, glaviotent, dérivent, mettent le cap sur l’épicerie-vins de Mme Michel, à la Double Pesée. Dimanche, jour d’ennui, jour de cafard qui relève la tête. Que faire dans une Île de Java, île flottante, île bâtarde accrochée à la queue du diable ? Me cago en Dios, soliloque le Javanais s’il est espingo. Ruskoff, il soliloque yob twaïou dou-chou. Mêmes mots, mêmes râles pieux d’une langue à l’autre. Henri Lehoux, unique et véritable Français à Île de Java, reluque le postère des Javanaises. Sacré putain de bordel de merde ! se console-t-il. Ce sont des choses on ne peut plus convenables à dire, elles amènent une bouffée d’air dans le trou d’eau morte. Il frotte ses paupières rougies, va chercher du doigt la chique dans sa bouche, en exprime le jus, la remet dans sa bouche. Le nègre Hilary Hodge, libre citoyen de la libre Amérique, attaque un blues sur son cornet à pistons. Il a sorti ses escarpins pour leur faire prendre le frais, c’est dimanche, des escarpins vernis qu’il ne chausse plus, qu’il espère chausser un jour. Alors il leur fait prendre le frais sur le rebord de la fenêtre et il attaque un blues lent sur son cornet à pistons. Il a été cornettiste dans un ensemble de jazz, il chaussait des vernis, il portait un smoking blanc à revers cerise, et maintenant, shiiit ! il perd ses balloches par les accrocs de son froc. Le Polonais Tomasz Warski fait le tour de l’île, ça y est, Magda sa femme est à la maternité d’Hyères et ça y est, elle nous fabrique des jumeaux. Java n’en doute pas, les Warski s’entendent en besogne, il n’y avait qu’à voir la Magda bâtie sur le devant. Warski fait le tour de l’île, des femmes s’affairent à ourler des langes, tu verras le tam-tam, deux Franco-Javanais tout neufs, nous les ferons naturaliser à la mairie de Vaugelas, c’est Lehoux qui sera content. Il ne faut désespérer de rien, Henri Lehoux ne sera plus le seul Français de France à Java et Hilary Hodge l’Américain mettra peut-être ses vernis. De quoi se plaint-on ? »
La gouaille argotique et railleuse m’a paru plus dans la veine de Lerouge que de Céline, et l'ironie davantage dans le ton de Jiri Weil ou Gogol que de Rabelais.« Ritals, Ruthènes, Bulgares, Turcos, allez, tous des norafs pas de chez nous. D’accord, sont nés d’une femme eux aussi, faut bien, mais au bord de la route comme qui dirait, d’où que c’est des races sans papiers ni rien. Notez, on ne leur cherche pas noise, même pas, à preuve qu’on est hospitalier et tout, sauf que moi, les Polaques-Bosniaques-Macaques, confessez que nous en avons notre claque.
Je confessons, je confessons. Dix ans ce Valaque a été manœuvre d’usine ; dix ans de métro, de bifteck frites, d’église orthodoxe, jusqu’à tant que par une sainte nuit de Noël il se pisse un coup contre un lampadaire – et malotru d’étranger ! flagrant délit d’exhibitionnisme, violon, raclée, correctionnelle, un an avec sursis, expulsion, affaire suivante. »
Aussi un témoignage indirect sur la mine avant-guerre et dans le Sud, avec une forte impression de vécu remanié par le romancier.
Et rien dans ce que j’ai lu ne me semble permettre une récupération politique, de quelque bord que ce soit (même par Trotski, auteur d'une postface autrement bien sentie).
_________________
« Nous causâmes aussi de l’univers, de sa création et de sa future destruction ; de la grande idée du siècle, c’est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et, en général, de toutes les formes de l’infatuation humaine. »

Tristram- Messages : 15926
Date d'inscription : 09/12/2016
Age : 68
Localisation : Guyane
 Re: Jean Malaquais
Re: Jean Malaquais
_________________
“Lire et aimer le roman d'un salaud n'est pas lui donner une quelconque absolution, partager ses convictions ou devenir son complice, c'est reconnaître son talent, pas sa moralité ou son idéal.”
― Le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guenassia
[/i]
"Il n'y a pas de mauvais livres. Ce qui est mauvais c'est de les craindre." L'homme de Kiev Malamud

Bédoulène- Messages : 21639
Date d'inscription : 02/12/2016
Age : 79
Localisation : En Provence
 Re: Jean Malaquais
Re: Jean Malaquais

Deux intéressantes préfaces à ce livre de Jean Malaquais réédité par Phébus, de Jean-Pierre Sicre (éditeur) et d’un autre ami, Norman Mailer.
Le premier écrit :
Jean Malaquais, d’après Norman Mailer :« Il s’en attristait, convaincu de toujours qu’on ne construit rien de bon sur l’oubli, matériau beaucoup trop instable pour assurer à quelque édifice que ce soit des fondations sûres : faute de se persuader de cela, rappelait-il, on court le risque de voir revenir par les souterrains quelques déplaisants fantômes que l’on avait crus, un peu vite, enterrés pour jamais. »
« À ceux qui s’étonnaient de le voir envisager si froidement le pire, Malaquais répondait en citant Schopenhauer, selon qui le pire est toujours sûr, est même notre seule certitude. Il était très net là-dessus : un homme qui oublie de se préparer au pire, même, si le pire ne doit jamais surgir dans sa vie (mais qui est sûr de cela ?) dira forcément oui à la lâcheté lorsqu’une occasion commode se présentera – c’est-à-dire lorsque personne ne sera là pour le regarder faire. »
Le Vieux-Port de Marseille est devenu, en 1942, la nasse cosmopolite où règnent le claquement des semelles de bois, le rationnement, le marché noir et « l’épicerie ersatz », comme la crotte de Sucror (pâte de dattes et de marrons enrobée de graines de sésame), et coopérative gauchiste.« – Oh, tu sais, je suis incapable, d’être autre chose qu’un écrivain.
– J’aimerais bien savoir pourquoi.
– Parce que le seul moyen que j’ai de savoir si une chose est vraie, c’est, de la sentir bouger à la pointe de ma plume. »
Vichy :« Tout se traficotait dans la France maréchalesque, en premier lieu tout ce qui rappelait la bouffe – pain malaxé d’argile, fromage de tête à base d’herbe à chat, saucisse de Francfort en arêtes de poisson moulues, poivre en grains de psillium, glands de chêne en guise de café… »
Dans cette faune où se côtoient rescapés, profiteurs, délateurs et agents du nouveau pouvoir, le journaliste Aldous J. Smith, de l’Emergency Rescue Committee, s’emploie à exfiltrer les fugitifs du régime hitlérien, surtout des intellectuels, y compris juifs, avec le tant convoité « visa américain ».« Un, il y avait la zone interdite ; deux, la zone occupée ; trois, la zone libre ; quatre, la zone italienne ; puis cinq, Vichy-État, comme avait dit ce garçon de café. »
Le lecteur suit particulièrement le Colonel, vieux lettré qui consulte souvent sa montre et hume plus souvent encore ses phalanges :« Hirsch n’entendait pas un mot, mais à mesure que la litanie des malédictions gagnait en ampleur, une grimace de haine déformait ses traits. C’était à cause de ce yid et de ses pareils que la France avait perdu son âme. Hirsch n’était pas antisémite, comment le serait-il, il ne mettait jamais les pieds dans une synagogue, et d’ailleurs les antisémites étaient à ses yeux des dégueulasses à la petite semaine, trop heureux de piétiner un juif à terre pour se venger de leurs bisbilles domestiques, de leurs cocuages conjugaux, de leurs existences crasseuses en somme. Reste que la seule vue de ses coreligionnaires polaques, hassidim la veille, Brummels aujourd’hui, lui faisait monter la moutarde au nez. Il leur en voulait d’avoir envahi l’Occident ; cet Occident où l’on vivait pépère depuis que Napoléon, en 1805… Il connaissait son histoire de France, Hirsch. Avant eux, avant l’invasion de ces Orientaux, il n’avait jamais entendu le mot juif, sauf peut-être en relation avec une certaine affaire Dreyfus. Soit, le monde n’était pas à court de victimaires toujours prêts à rallumer les vieux bûchers, mais on en avait connaissance par ouï-dire, comme de cannibales ou de mangeurs de nids d’hirondelle. Il en voulait à ce Krantz blondasse comme un nazi, qui essuyait la morve au nez de ses rejetons ; lui en voulait d’avoir femme et fils, d’être là, d’être tout court. Si au lieu de faire les avocats à Berlin, les docteurs à Paris, les commerçants n’importe où et les bolchevistes sous toutes les latitudes, ces Krantz étaient restés dans leurs Ukraines, leur Bukovines, le phylactère au front et la barbe dans la Thora, les Hirsch de France n’en seraient pas à courir comme des lapins de garenne avec du plomb au cul. Toute l’Europe était devenue une sorte de Bukovine, toute la terre une sorte d’Ukraine, et des juifs à chaque pas, avec le pogrom au ventre. Huit lettres. Huit lettres il confiait à la brave Mme Haenschel, le foutu neveu de rabbin. London City, Batavia City, Citycity… Le malheur, avec ces cousins bibliques, c’est qu’ils n’y allaient pas de main morte. Rouges, ils se mettaient en soviet ; conservateurs, il leur fallait des présidences de conseil, voilà comment ils te vous flanquent dans le pétrin. On ne connaît pas, nous autres, le sens de la mesure. Il faillit avaler de travers, conscient tout à trac de penser on, de penser nous autres, comme si lui aussi relevait du phylactère, du pogrom. Rien de plus tordu que ses colères, son antijudaïsme ; tordu comme une blague dans un cortège funèbre. Le vrai de vrai c’est qu’il avait peur, et peur d’avoir peur. C’était sa déveine, sa verrue indéracinable. Il n’y pouvait rien. »
Suite à la rafle des juifs, le chef d’îlot Ignace Matthieu a enfin « le pied à l’étrier » : il est promu commandant du camp de regroupement de Milles, grâce à sa bêtise, par « M. le comte Adrien de Pontillac, chef régional de la Légion et grand personnage à la préfecture des Bouches-du-Rhône ».« Faut-il que la vie fasse peur pour la tuer sans relâche – balle dans la nuque balle dans la face, de Paris à Pékin, de Londres aux îles de la Sonde, balle dans le poumon balle dans l’œil, sans reprendre haleine. »
« Il pensait à ce philosophe phalangiste qui, savourant sa coupe de jerez, disait nous autres Espagnols sommes fiers d’avoir rallumé la torche de la Sainte Inquisition. Ô Attila, ô Torquemada, comment vous sentez-vous ? Il pensait que franquistes et nazis et staliniens et nippons n’étaient pas les seuls à haïr la vie, il y avait eu les Turcs prompts à égorger des Arméniens et les puritains à saigner des Peaux-Rouges et les papistes à occire des parpaillots et autres cathares, tous et chacun au nom du Père miséricordieux, lequel, ô bonté divine, livra son fils rédempteur au gibet et son peuple élu au couteau. »
« Le Colonel se retrouva dans les rues atones de la ville naguère pétant de vie. Il avait connu Nankin, Guernica, d’autres villes avec le squelette debout de leurs murailles calcinées, de leurs clochers miraculeusement suspendus au ciel, alors que cette cité-ci, intacte encore, en attente encore de son chapelet de bombes, suintait la rafle par la bouche de ses égouts. Était-ce parce que tout voulait s’épanouir à outrance dans ce Marseille, le soleil et le mistral, le farniente et les coups tordus, et de même que la galéjade y résonnait démesurément, que la hâblerie y faisait prime, une rafle s’y donnerait à cœur joie ? »
« Terres perdues et conquises s’il en fut, terres cultivées au long des siècles, que chaque coup de bêche, chaque morsure de herse ont remuées, redonnant jour à mille milliards de bactéries tétaniques, de bactéries fécales, de germes pyogènes qui se jouent, à jamais immortels, de son arsenal de bistouris. Terres de merde et de chiasse, terres ancestrales de bran nourricier de l’homme. Entouré de ses aides aux doigts raidis de sang coagulé, à l’haleine de qui a oublié le goût du sommeil, entouré d’eux et de l’incessant aboi des obus, il charcute et ficelle et replâtre des paquets de chair qui palpite et claque sous sa main, qui claquera en route vers les postes de barrière où pas plus qu’en première ligne on n’a de catgut ni d’hémostases ni de cautères pour colmater les mille et une veines qui giclent leur réserve de vie. »
Steven Audry, écrivain, vu par le Colonel :
« Bien qu’il paraisse quelquefois viser à l’effet, il est le contraire d’un faiseur, dit le Colonel. Quand il nous aura conviés à prendre place sous une tonnelle ou en quelque sombre encoignure de son jardin, ce sera qu’il s’apprête à évoquer un événement qui le réduit à quia. Sans doute savez-vous qu’il n’a jamais consenti à parler en public, ayant affirmé plus d’une fois qu’il n’avait rien à publier que l’on ne puisse trouver dans ses écrits, ce qui fait dire aux bonnes gens que s’il n’est pas de l’Académie ce n’est point qu’il ait toujours refusé d’y postuler, c’est que, incapable de tourner son discours de récipiendaire, il n’afficherait une opinion dédaigneuse à l’endroit de la vénérable Compagnie que pour mieux cacher son dépit de n’en pas être. La vérité est tout autre : dès lors qu’il se sent point de mire, il perd son latin. À moins qu’il ne s’agisse d’une conversation courante, il ne sait tout simplement plus construire sa phrase, ni même la lire ; il ne sait plus narrer – monologuer devrais-je dire – dans son style si particulier, qui semble osciller entre l’invention un peu laborieuse et le raffinement un peu voulu. Il n’est pas précisément un Démosthène, sa parole ne coule pas avec aisance, mais ce qui en fait le prix à mes yeux, c’est que notre homme dit comme s’il mettait l’objet de sa narration dans la main de qui l’écoute et lui en faisait éprouver la matière. Il y a une vertu tactile dans son art de conter, et une mordacité très particulière, qui pourtant ne tient pas de la médisance. Reste qu’il n’aime pas parler. En vérité, il n’aime pas. Au point qu’il m’arrive de me demander s’il ne s’est pas laissé prendre à cette légende dont il est lui-même l’artisan, à savoir qu’il est malhabile à l’usage du verbe. »
Dans la seconde moitié du livre, le récit se concentre sur les mésaventures de quelques personnages, essentiellement plus politiques, dans la région parisienne : Marianne Davy au nez qui bouge et parle de façon décousue, un « parler tout en brisures », Marc Laverne, le révolutionnaire socialiste à l’origine de Sucror (un des fils directeurs du livre) et de bien d’autres choses, Stépanoff père et fils (le dostoïevskien Youra), marxistes révolutionnaires, le commissaire Étienne Espinasse, l’armée allemande et la Gestapo, et j’omets encore beaucoup d’autres protagonistes, figures caractéristiques de cette société peu ragoûtante, souvent odieuse et lâche, mais avec aussi de poignants "Justes".« Luttant de vitesse avec le matin qui hissait au ciel sa grand-voile, le train entamait la zone parisienne. Criblée d’orbites géantes, cariée de suie, la face noire de la banlieue se rejetait en arrière des deux côtés de la voie, puis lentement se redressait sur le rempart du jour grandissant. »
« Je suis toutefois certain que ces feuillets seront lus. Les nazis ne les détruiront pas. Pas même pour faire mentir mon assurance. Les bureaucraties ne détruisent rien qui ressemble à des pages couvertes d’écriture. Elles ont la crainte et le respect mystiques du papier. Le papier est l’attribut distinctif des bureaucraties totalitaires. Elles brûlent les livres et en falsifient les textes, mais conservent les originaux dans des coffres indestructibles. Le moindre feuillet volant qui porte quelque trace de la lutte de l’Opposition contre la bureaucratie stalinienne est religieusement conservé dans les sous-sols du Kremlin. J’envie l’historien à venir, qui y aura accès. »
Le ton est parfois rageur, le ton vengeur, voire revanchard, surtout en ce qui concerne la police et la bureaucratie du régime du Maréchal, tel que le sort du sordide Jean-Baptiste Mélodie, le « SOL » (Service d'ordre légionnaire), archétype du nervi opportunément porté par les circonstances.
Mais rien n’est jamais simple, ni les personnages univoques :
Le dernier chapitre constitue un point d’orgue existentiel et humaniste, qui réunit notamment le Colonel et Smith (ainsi que Hirsch, comptable de Sucror et fugitif broyé par les évènements) alors que Marseille est envahie par les Allemands et que la déportation est en marche.« Les grands salauds ont toujours leurs petites bontés, et les grands bonshommes ont toujours leurs petites saloperies du dimanche. »
Les destins des personnages se croisent, s’intriquent dans cette fresque d’une France peu glorieuse, souvent haineuse et imbécile. Il paraît que ce roman a été peu lu, on y trouve pourtant une vaste collection de tout ce que nous avons entendu sur l’Occupation (et la collaboration en zone "libre"), qui paraîtrait autant de poncifs caricaturaux s’il ne s’agissait de l’ouvrage d’un témoin, voire d’un participant.
Le récit est réaliste, avec des passages lyriques qui s’adonnent volontiers au grotesque, et use d’une palette de registres qui vont du dialogue au journal personnel. Le style est travaillé (Malaquais précise 1942-1947, 1998-1999 comme dates de rédaction), surtout dans les parlers populaires (on sent particulièrement là ce qui perdure chez lui de ses lectures céliniennes) ; il vaut pour beaucoup au parti pris de l’auteur de se positionner à l’intérieur des protagonistes, chacun de ceux-ci avec sa propre diction, et ses propres introspections.
\Mots-clés : #antisémitisme #deuxiemeguerre #historique #politique #temoignage #xxesiecle
_________________
« Nous causâmes aussi de l’univers, de sa création et de sa future destruction ; de la grande idée du siècle, c’est-à-dire du progrès et de la perfectibilité, et, en général, de toutes les formes de l’infatuation humaine. »

Tristram- Messages : 15926
Date d'inscription : 09/12/2016
Age : 68
Localisation : Guyane
 Re: Jean Malaquais
Re: Jean Malaquais
_________________
“Lire et aimer le roman d'un salaud n'est pas lui donner une quelconque absolution, partager ses convictions ou devenir son complice, c'est reconnaître son talent, pas sa moralité ou son idéal.”
― Le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guenassia
[/i]
"Il n'y a pas de mauvais livres. Ce qui est mauvais c'est de les craindre." L'homme de Kiev Malamud

Bédoulène- Messages : 21639
Date d'inscription : 02/12/2016
Age : 79
Localisation : En Provence
Page 2 sur 2 •  1, 2
1, 2
Des Choses à lire :: Lectures par auteurs :: Écrivains européens francophones


 Nouveaux messages
Nouveaux messages

