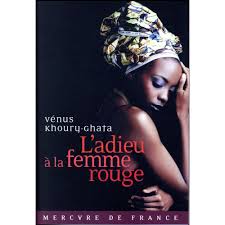La date/heure actuelle est Jeu 9 Mai - 21:32
30 résultats trouvés pour misere
Maurice Raphaël
La Croque au sel
André Breton ne s’y était pas trompé : il y a chez Maurice Raphaël une vraie patte d’écrivain, certes pas encore totalement aboutie, encore trop démarquée de Céline, mais l’essentiel est présent.
L’histoire est celle d’une famille du genre affreux, sales et méchants : les parents, Graine qui marche avec une béquille et qui vient de perdre son dernier emploi de ménage, son mari Poro, invalide depuis longtemps et qui va du lit au fauteuil et du fauteuil au lit, les deux fils, Voves employé d’usine en grève et qui chasse la nuit les chats pour nourrir la famille, Ponce qui est en prison, Kromme son compagnon de cellule tout juste libéré. Il y a encore la plus jeune, Cachou, qui se console avec le chien Albert et enfin la belle Nacre, femme de Ponce et devant laquelle bavent tous les mâles de la famille.
Cette belle brochette d’individus loge dans une HBM (habitation à bon marché) ; occasion pour Maurice Raphaël de fustiger ces constructions et les architectes qui les conçoivent
« Chaque tribu son alvéole. Foyers sans âtre. Tables vides, vides buffets. Corps vides qui se propulsaient dans leur cage avec de lentes grâces d’insectes aveugles. Familles entassées, comprimées, condensées, mises en conserve dans leurs deux pièces si bon marché. Pêle-mêle, les couples et leur portée, vioques et lardons, le bidet, la vaisselle et la lessive en train de sécher sur une corde tendue de long en large dans la salle à manger. Les langes, les dessous, les bas, les cotons, les tampons, les serviettes, girandole dégoulinante de drapeaux loqueteux. Grand pavois de la misère. La misère à même le corps, celle qui s’auréole sous les bras d’arcs en ciel douteux, qui transpire des pieds, pue de toute sa peau dans des hardes raidies. On lave son linge sale en famille. On le lave à l’eau froide et sans savon. Et l’hiver, il n’en finit pas de sécher. »
« D’une cellule à l’autre, d’étage à étage, ça fermentait dur, jour et nuit. Le beau bouillon de culture. Des centaines et des centaines de vibrions en piste, chicanant, ahanant, cancanant, crachant, crottant, se grimpant les uns sur les autres, acharnés à se disputer tout morceau de chair à se mettre sous la dent, emportés par un incessant remous les précipitant têtes contre ventres, cuisses et bras mêlés, tripes enlacées et agglutinant par grappes des corps convulsés de désir, de désespoir et de rage. Bien sûr, c’était dans la norme qu’ils finissent par tous chercher à s’entretuer. »
Autour de ces immeubles c’est un peu un no man’s land de boue et neige fondue, tout du moins jusqu’au Boulevard qui marque une frontière :
« Le boulevard, c’était la frontière entre ceux qui crevaient de faim et ceux qui crevaient de peur. De la peur de ceux qui crevaient de faim. Mais ils étaient assez communément installés dans leur peur, depuis des générations qu’ils se léguaient leur colique de père en fils. Ca les empêchait pas de vivre. Le tout était d’avoir du papier hygiénique assez fin à leur portée. Ils avaient toute une presse et des journalistes bien stylés à cet effet. Ils en avaient les moyens. C’était, somme toute, une peur confortable et bien nourrie. Elle se manifestait en surface, assez naïvement par des verrous de sûreté, des pièges à loup, des tessons sur les murs et de fréquentes rondes d’agents cyclistes. »
L’époque est mal définie, les files devant les commerces, la difficulté pour se chauffer et se nourrir font penser à l’Occupation, mais ce pourrait être aussi l’immédiat après-guerre :
« Une foule se tient facilement debout. C’est tout simple. Une construction aisée et fragile à la fois, comme un château de cartes. Et, il suffisait également d’un rien pour voir la file se disloquer et chacune d’entre les femmes s’en retourner de son côté. Les jambes se retrouvaient par paires, toutes semblables, des jambes uniformes avec leurs varices bleuâtres et leurs pieds que les engelures transformaient en plantes obscènes. Et leurs pas étaient bien pareils et laissaient les mêmes empreintes léchées dans la neige des rues et des terrains vagues. »
« Cela faisait à travers le quartier de longs cortèges funèbres immobiles où l’œil cherchait instinctivement au premier regard la place du corbillard et ne trouvait qu’un pas de porte. Pour ajouter à cette impression, des conversations chuchotées émanait cette sorte de bourdonnement feutré, bordé de deuil, qui accompagne les enterrements. Mais ici le bruit croupissait sur place et les mots, les mêmes mots toujours, repris et abandonnés, se tassaient au creux de chaque bouche et lui pourrissaient les dents lentement. Graine avait des dents noires, très espacées, qui peignaient l’air avec un soin cruel. Et les visages se lançaient les uns aux autres des bouffées de buée, au travers desquelles ils apparaissaient flous et inconsistants. »
L’image d’enfants mourant de malnutrition et de maladies revient fréquemment :
« Graine avait la tête bruissante d’une danse de tout petits cadavres qui avaient des sourires rouges de viande de boucherie et des jambes grêles ratatinées comme des radicelles sous des ventres démesurés aux nombrils proéminents. Ils flottaient à l’intérieur de son crâne empli d’un liquide qui pesait un poids énorme, plus lourd que tout le reste de son corps, et lui faisait craquer les tempes et la nuque. A en hurler. »
Des paragraphes sur la prison sentent le vécu !
« - Le mitard, c’est le cachot. La prison dans la prison. Quelque chose de soigné. L’isolement total, une cellule sans fenêtre. La nuit toute la journée et une gamelle tous les quatre jours. De la flotte avec des épluchures de patates et des fanes de carottes. Tous les quatre jours. Les droits de l’homme.
Et le froid. On te donne des habits de singe pour la cérémonie et chaque soir on te retire les fringues pour la nuit. Si j’ai pas crevé.
Le mitard. Parce qu’à la fin, même en taule, on pourrait arriver à se croire libre en oubliant le reste. Le dehors. Ce serait trop beau. Ils ont trouvé le moyen de créer une super taule, à l’intérieur de l’autre, une plus perfectionnée. Ce que c’est que la civilisation. Les vaches. »
« Mais il avait une très longue habitude des pas-perdus et des itinéraires sans but. Cela ne faisait jamais que quelques pas de plus qui s’ajouteraient aux millions de pas dont il avait tracé le dédale à travers les cellules qui l’avaient détenu. Un voyage au très long cours. Qui continuait. Ne pouvait plus avoir de terme. Il faudrait maintenant l’assommer à coups de merlin pour interrompre sa route. Mais déjà on lui préparait des terminus. Des crosses de mousqueton de garde mobile, des sifflets à faire valser les escargots et des machines à secouer le paletot très perfectionnées l’attendaient au prochain tournant. Tant il est vrai que peut être inquiétante pour l’ordre public et attentatoire à la sûreté de l’Etat, la marche d’hommes qui ne vont nulle part. »
« Je te le dis, accepter l’idée qu’on peut être matraqué, c’est déjà se reconnaître coupable. Vous ne faites riens, d’accord. Vous êtes immobile, les mains en l’air. Vous ne les rabaisserez que pour vous laisser passer les menottes. »
Mots-clés : #captivite #misere #social
- le Ven 15 Oct - 11:18
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Maurice Raphaël
- Réponses: 3
- Vues: 455
Albert Cossery
Les Fainéants dans la vallée fertile
Un père et ses trois fils vivent ensemble, ou plutôt dorment de concert. Serag, le dernier, rêve d’une émancipation qu’il appelle « travailler », même si le concept de travail paraît biaisé dans son milieu et alors qu'une brève promenade l’épuise, le laissant hébété et ressentant douloureusement un manque, celui de l’activité, de l’ardeur. Rafik, le second, est un paresseux remué par la malveillance, qui a « étudié à l’école des ingénieurs » et renoncé par souci de sa quiétude à épouser Imtissal, prostituée spécialisée dans les étudiants, tandis que l’aîné, Galal, parvient difficilement à se lever pour manger.
« J’avais peur de tout ce qui n’était pas notre maison. De tout ce qui bouge et se démène vainement dans la vie. Quand je ne suis pas dans mon lit, il me semble qu’un tas de choses funestes peuvent m’arriver. Je ne suis vraiment tranquille que couché. C’est pourtant facile à comprendre. Fais un effort. »
Le vieil Hafez, qui a recueilli Mustapha son frère ruiné, réside seul à l’étage de leur maison ; quoique affligé d’une grotesque hernie, il a décidé de se remarier par l'intermédiaire de l’entremetteuse Haga Zohra, afin de réaffirmer sa tyrannique autorité sur ces fils dont le repos risque d’être perturbé par ce changement. Hoda, la jeune serve plus que servante, insultée et violentée, amoureuse de Serag, complète la maisonnée en veillant aux tâches nécessaires parmi les dormeurs.
Ce livre est hallucinant : c’est une description très précise de la fainéantise avec ses variantes, paresse érigée en système du rien faire « – la volonté du moindre effort – » comme « philosophie de vie ». L’exposé de ce comportement est si minutieux qu’on a l’impression d’une étude sur le vif de cette sorte d’irrépressive apathie, genre d’anémie morbide et généralisée. Certes l’humour donne le sourire, mais le sordide de cette condition ne permet pas d’y voir autre chose qu’une satire – en tout cas pas un éloge de l’oisiveté. Seul un Égyptien pouvait dresser un tel portrait sans s’attirer des accusations de paternalisme et de mépris pour le petit peuple du Nil : Cossery donne vie au préjugé le plus réactionnaire qu’un lecteur, surtout occidental, puisse avoir sur cette population. Évidemment il force le trait et il serait stupide de généraliser son point de vue, mais il y a sans doute un fond de vérité dans cette accablante dénonciation d'une malédiction familiale, d'un certain fatalisme oriental. À noter que Cossery voit un travers systémique, national, dans cette fascination du sommeil :
« Ils n’avaient par l’air harassé, mais plutôt triste. Eux aussi devaient dormir dans leurs bureaux poussiéreux au fond de quelque ministère. Ce qui les tracassait surtout, c’était de ne pouvoir dormir chez eux. Il fallait qu’ils se déplacent pour aller dormir ailleurs, et donner ainsi l’impression qu’ils accomplissaient de hautes besognes. »
Mimi l’artiste inverti, Abou Zeid le misérable marchand de cacahuètes, Antar l’énergique enfant vagabond sont d’autres protagonistes gravitant autour de la famille, mais le thème central est bien la turpitude des membres de cette dernière. Leurs rares velléités d’action, généralement motivées par le vague ressentiment qui les habite, n’aboutissent qu’à un épuisement résigné qui semble atavique. Ils émanent la torpeur, retombent sempiternellement dans un stérile abattement.
Serag, ayant renoncé à la perspective de travailler dans une usine dont la construction est abandonnée, décide d’aller en ville ; je ne peux m’empêcher de voir dans ce personnage poignant l’image dramatique d’une jeunesse qui ne rêve que d’aventure, de partir dans une fuite polarisée par un projet plus ou moins chimérique, ce qu’est souvent l’émigration.
Petit livre déroutant, donc recommandable !
\Mots-clés : #Famille #misere
- le Sam 25 Sep - 20:39
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Albert Cossery
- Réponses: 59
- Vues: 5969
Lyonel Trouillot
Yanvalou pour Charlie
Le yanvalou est une des danses principales du vodou haïtien, prière adressée à un loa (esprit).
À propos de vocabulaire, « bigailles » désigne, d’après mon Grand Robert (terme vieux, familier, venu du latin "coq" par le provençal "bigarrure") un insecte volant (notamment chez Hugo), avant de signifier menu fretin (et, dans la marine, les plus jeunes membres de l'équipage, qui ne sont pas encore matelots ; l'ensemble des mousses et des novices), puis menue monnaie en argot.
Mathurin D. Saint-Fort (le "D." correspond à Dieutor, un prénom faisant très « campagnard ») est un jeune avocat ayant fui son village pour prendre l’ascenseur social à Port-au-Prince. Son passé occulté le rattrape sous la forme de Charlie, un adolescent originaire du même village, qui s'en réclame et dont le franc-parler le déroute. C’est l’occasion d’explorer la misère de cette population, l’exode rural drainant les campagnes déshéritées vers les bidonvilles, et la jeunesse vivant en marge de lois qu’on suppose exister. Charlie, enfant abandonné à la rue, a été recueilli dans un centre d’accueil où il s’est constitué en bande avec des amis, Gino, Filidor et surtout Nathanaël. Ce dernier fréquente sa sœur aînée, qui se révèle être sa mère (à seize ans) d’un père qui l’a balafrée lorsqu’elle a décidé de conserver leur enfant. Mathurin-Dieutor se retrouve impliqué dans un drame sordide, et son passé le rejoint encore sous les traits d’Anne, l’amie qu’il a quittée avec ses origines, et qui est restée au village pour faire l'école aux enfants.
C’est avec une écriture bien maîtrisée que Lyonel Trouillot nous présente cette société haïtienne si désolante, et au-delà la nôtre.
« C’est une chose de comprendre que, dans une ancienne colonie, il est de bon ton d’avoir des amitiés et des amants mulâtres. C’est une autre chose de croire sincèrement que la couleur de sa peau confère au mâle une qualité. »
« Nos clients ont tous des frères qui brassent des affaires aux quatre coins du monde et accumulent les nationalités. C’est une tactique courante chez les entrepreneurs. Un frère sur deux est haïtien, dirige officiellement l’entreprise familiale et obéit aux lois locales, l’autre est un citoyen du monde qui investit ailleurs les profits générés ici. Le capital, c’est une toile. Nous sommes payés pour la coudre en toute légalité avec des fils et des doublures aussi invisibles qu’efficaces. »
« Le monde est fait de ces choses qu’on ignore en sachant qu’elles existent. »
« Lors d’une visite d’inspection du ministre des Affaires sociales, une voiture officielle renversa un enfant sur la route nationale. Ce fut la seule action concrète qui résulta de cette visite. »
On est loin de la joie de vivre de Depestre, dans la dramatique réalité sociale d’Haïti, mais Dieutor a gardé l’habitude de jouer pour lui-même de la guitare (apportée du village, offerte par un ancien, de la famille de Charlie).
\Mots-clés : #misere #social
- le Sam 19 Juin - 18:15
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Lyonel Trouillot
- Réponses: 6
- Vues: 780
Nicolas Bokov
Dans la rue, à Paris
Fin des années 80, Nicolas Bokov, « au tournant de la cinquantaine », est exilé d’URSS, et SDF à Paris. De plus, il s’est converti au christianisme, et cette vocation tardive imprègne son récit.
Ce sont mes récentes lectures de Giraud et Clébert sur le parcours des rues de Paris qui m’ont incité à celle-ci, avec l’intention de les croiser ; en fait, c’est Les naufragés, de Patrick Declerck, qui se rapproche le plus de ce qui est évoqué. J’avais bien sûr en tête les sans-logis actuels, à titre d’approche comparative : cet antique préjugé qui laisse soupçonner un Mozart (ou au moins un philosophe de valeur) chez l’indigent croisé dans la rue…
Pas d’alcool, de la douleur (une fille handicapée), des nuits inquiètes dans le froid, mais aussi une sorte de transport humble et mystique, l’asile des églises, les lectures hagiographiques et l’étude de la Bible.
« Voilà pourquoi, sans doute, on lutte pour la première place. On lutte aussi, bien sûr, pour la quantité : "Je veux encore davantage – de tout, de tout." Mais il y a une motivation secrète et complexe : pour ne pas se perdre. Ne pas se noyer dans la mer humaine. »
Des observations qui sentent le vécu :
« Celui qui vit dans la rue éprouve un véritable besoin de se trouver à l’intérieur. À présent, il me suffit d’entrer dans un local quelconque pour éprouver du plaisir. Presque une jouissance. »
« À présent, quand je me sens angoissé, je vais dans un coin isolé, je sors de mon sac à dos une deuxième paire de pantalons et encore un pull, ou même deux, et j’enfile tout cela sur le champ. Un tel épaississement de l’enveloppe apporte immédiatement du réconfort et du courage. »
« Je suis stupéfait : combien de fois dans des situations de ce genre, j’ai vu un premier mouvement pour se lever, puis un regard rapide, jugeant instantanément ma position sociale et matérielle, et l’homme restait assis. »
\Mots-clés : #biographie #contemporain #misere #spiritualité #temoignage
- le Lun 31 Mai - 14:35
- Rechercher dans: Écrivains Russes
- Sujet: Nicolas Bokov
- Réponses: 20
- Vues: 3444
Jean-Paul Clébert
Paris insolite
À propos de ces flâneries urbaines, impossible de ne pas évoquer les deux Robert, Giraud et Doisneau (qui apparaissent d’ailleurs dans ce livre qui leur est dédié), et inutile de préciser que la connaissance géographique de Paris est conseillée. Ce texte est plus encore peut-être un témoignage sur les lieux et l’époque, tant sont nombreux les portraits et tableaux précis, comme les Halles, la Villette, ou l’ancienne ligne des fortifications où erre ce « rôdeur de barrières ».
« Mais en haut, face au Canon de Bicêtre et le long des fortifs, c’est pas beau. Envie de s’asseoir et d’en finir, à condition que ça puisse finir un jour. Une brocanteuse en rade ayant piqué la place d’un ancien, et rangeaillé ses mignardises en stuc et toc sur un coin d’herbe, il s’ensuit une bagarre lamentable. L’autre balance tout. Volent au vent, tas de détritus, morceaux de porcelaine qui trouvent encore moyen de casser. Et ça gueule. Argot hétérogène, yiddish, polak, bas allemand, berbère, kabyle, gitan et même slang, comme celui de ce grand vieil Américain là-bas, couvert d’une peau de bique à trois étages comme un berger des Pyrénées et que personne ne comprend, si ce n’est peut-être l’Isaac du coin qui cligne de l’œil… »
Clébert se signale également par son intense curiosité, surtout pour les gens, mais aussi esthétique, historique, sociale.
« Et Martin, surtout, peut-être le seul type qui à Paris puisse se vanter d’exercer la profession de porteur d’eau, allant chaque matin chercher à la fontaine la flotte à tout faire de dix ou quinze habitants, muni de brocs en faïence bleue et d’arrosoirs en tôle bosselée, faisant les corvées, les courses, au tabac, chez le boulanger, à l’épicerie, là-bas en ville, de l’autre côté de la caserne, se faisant payer la plupart du temps en nature, cigarettes, verres de vin ou de café, bols de soupe qu’il réclame d’un ton péremptoire, n’ayant pas la langue dans sa poche et lorgnant instinctivement le comptoir, n’acceptant d’aller quérir les ingrédients que si son godet est plein à ras bord, d’avance et posé bien en évidence ; menant une vie de château, couchant dans une cahute plus ou moins abritée dont il est le légal propriétaire, se couchant tôt et se levant tard, n’arrivant chez Francis que vers dix heures, au désespoir de Mme Jeanne qui n’a rien pour tremper la soupe, et saluant la compagnie, se collant les mitaines aux flancs du poêle, s’approchant du patron qui petit-déjeune en rentier d’un saladier de café au lait et de tranches de pain beurré, et lui déclarant l’œil égrillard et la voix théâtrale : Ah ! Comme votre café me fait plaisir ! »
Il n’omet pas de courir les filles − affichant une certaine misogynie peut-être ?
« La Catherine fait dans les cent quatre-vingts livres et baise à croupetons. Grasses et boudinées, elles ne sont plus de toute première fraîcheur, mais les clients ne manquent pas : bouchers et tripiers du coin habitués à malaxer la viande mollasse et la bidoche violette. »
La misère pendant la guerre et le long après-guerre de reconstruction passent peu à peu, avec les petits métiers depuis disparus.
« …] les biffins qui (tôt arrivés, à trois-quatre-cinq heures de la nuit d’hiver, pour avoir la meilleure place qu’ils marquent de ficelles, de pavés, de journaux, tandis qu’ils vont boire un jus mauvais) viennent vendre leur camelote, ces objets hétéroclites dont échappe à première vue la valeur marchande, morceaux de tissus et de vêtements, godasses dépareillées, soucoupes ébréchées, réveille-matin sans aiguilles et vides probablement, jeux de clés, poignées de clous, cartes postales, journaux maculés, jusqu’à des morceaux de planches coupées et assemblées en margotins. »
Les bistrots évidemment, tous aussi singuliers que chaque individu, dans un livre cependant moins aviné que Le Vin des rues ; pourtant les mêmes rues et quartiers de Paris… Et surtout la vadrouille heureuse :
« Itinéraires parisiens, dédales, détours, raccourcis, volteface, retours, montées, descentes, calme plat des rues abandonnées, dont le charme est si grand que fatigué déjà d’un long piétinement dans la zone sud, aux confins de Montrouge, je n’hésitais pas à regagner ma tanière des Halles par le chemin des écoliers, quittant le boulevard Kellermann pour remonter sur la place des Peupliers et longer la rue Charles-Fourier (où dès cinq heures des dizaines de copains cloches stationnent devant la porte de cave du sordide bâtiment de la Mie de Pain, faisant la queue de façon organisée, ne voulant pas perdre une place, car les tickets, rouges pour une soupe et un lit, blancs pour une soupe seule et le droit de dormir sur les bancs, et sans couleur distincte pour celui de s’allonger sur le ciment, sont distribués par ordre d’arrivée). »
« Mais un cul-de-sac dans la ville est une chose rare, presque un miracle. Car Paris-la-nuit est un dédale, les rues y sont interminables, n’en finissent jamais, se multiplient, se poursuivent, se prolongent, s’emboîtent les unes aux autres comme des canalisations, se rétrécissent ou s’élargissent comme des bouts de lorgnettes, ou en équerre, ou à angles droits, vaste treillage, échafaudage enchevêtré de tubulures de fer posé à même le sol. Paris-la-nuit est un labyrinthe où chaque rue débouche dans une autre, ou dans un boulevard qu’ils appellent justement une artère, où je progresse lentement par soubresauts comme un caillot de sang, hoquetant, suivant la plus grande pente, poussé derrière moi par les étranglements, aspiré devant par le vide. Et j’avance, je marche, je coule, je fleuve, j’espère me jeter dans la mer, havre de paix et d’insouciance. Mais c’est impossible, il n’y a jamais autre chose que des embranchements, des carrefours, des bifurcations, partout des affluents à droite à gauche en amont en aval, partout des rives identiques encaissées indifférentes, insensibles à l’égratignement du cours des rues. »
« Vagabondage. Mon plus long voyage, un bon mois, fut le parcours du quatrième arrondissement, le centre vital de Paris, le plexus, d’une diversité stupéfiante, propre à l’évocation d’un exotisme de pas-de-porte. »
« Mains au creux des fentes pantalonnières, le mégot basculant, l’œil plissé sous la fumée, un pied chassant l’autre, on se tape un gueuleton visuel, gratuit, pour soi seul. »
Les différentes « chroniques », manifestement écrites à différentes dates, sont vaguement regroupées par thèmes ou lieux. L’expression est originale, et vigoureuse. Savoureuse, même si ce n’est pas toujours drôle.
« C’est en son honneur et sur sa demande que j’avais fait le sacrifice d’un paquet de bougies, dont il aimait comme moi la lumière vacillante tellement plus vivante que celle d’une lampe électrique dont la source est anonyme et canalisée, vivante dans ses mouvements de hanches, dans la variation de sa vivacité, une cosmie d’éclats et d’éclipses, vivante parce qu’éphémère, dont la lueur apaisante ne choquait pas les paupières des endormis, les veillait, s’animant à leur souffle. J’en avais enculé trois bouteilles. »
« Rien n’est plus épouvantable que le repêchage en Seine de cadavres qui s’en vont à vau-l’eau couler des jours meilleurs dans un autre univers, gosses maltraités et incompris, filles engrossées et abandonnées, chômeurs inadaptables, follingues obsédés, tous ces types de roman-feuilleton qui ont la vogue des lectures populaires et dont le spectacle cramponne les badauds comme des insectes scatophiles sur des merdes neuves. »
La crasse et la faim, les Arabes et les juifs, les cloches et les mendigots, les chiffonniers et les chômeurs, les vieillards et les putains, les repris de justice et un avaleur de grenouilles, Clébert est avide de s’initier à tous les milieux et corporations, de connaître de façon approfondie tout un réseau de repaires, terriers, planques et caches secrètes, ficelles, tuyaux et combines partagées entre copains.
Le vrai de cette vie, c’est le goût de la liberté, un choix assumé de cette indépendance que lui envient les inconnus qui lui prêtent leur logement pour une matinée :
« Nombre relativement étonnant (qui suffit à remplir la longueur d’un calendrier) des types ayant encore le sens de l’hospitalité et du dépannage gratuit. »
Sans paraître politisé, Clébert n’aime pas les personnes aisées qui méprisent les nécessiteux, guère les religieux (mais son point de vue sur eux est intéressant) et nettement moins encore les touristes et la fausse bohème ; il fait preuve de passéisme (regret des vieilles rues et du bon temps qui disparaissent) :
« La lumière bouffe tout. La nuit dans la ville se réduit à une poignée d’heures. »
Saisissante évocation également, celle des indigents qui meurent seuls : tout le passage mériterait d’être cité.
« On imagine assez peu le nombre de ces êtres humains, à bout de ressources et de souffle, qui s’éteignent en cachette, se terrent dans leur trou pour se voir mourir. »
Le « Paris Vécu », les marches nocturnes, le peuple quand ce terme n’était pas encore trop entaché de connotations – une page devenue légendaire.
Une belle découverte que celle de ce livre, due à maître ArenSor, que j'en remercie !
\Mots-clés : #lieu #misere #social #temoignage #urbanité #xxesiecle
- le Mer 19 Mai - 0:27
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jean-Paul Clébert
- Réponses: 6
- Vues: 601
Charles Dickens
Cantique de Noël
Voici, dans un conte de cinq « couplets », Ebenezer Scrooge (quels noms de personnages, comme celui de son commis, Bob Cratchit !), un homme d’affaires âpre au gain ayant survécu à son associé, Jacob Marley, dont le spectre lui apparaît un soir de Noël typiquement londonien.
« Scrooge reprit le chemin de son lit et se mit à penser, à repenser, à penser encore à tout cela, toujours et toujours et toujours, sans rien y comprendre. Plus il pensait, plus il était embarrassé ; et plus il s’efforçait de ne pas penser, plus il pensait. Le spectre de Marley le troublait excessivement. Chaque fois qu’après un mûr examen il décidait, au-dedans de lui-même, que tout cela était un songe, son esprit, comme un ressort qui cesse d’être comprimé, retournait en hâte à sa première position et lui présentait le même problème à résoudre : "était-ce ou n’était-ce pas un songe ?" »
Odieux avare endurci, trois esprits successifs (passé, présent et avenir) l’amènent à repentance au spectacle de la misère humaine qui fête malgré tout gaiement Noël en compagnie. L’acariâtre nanti découvre l’amour et la bonne humeur familiale. Après cette leçon nocturne, il rit et répand le bonheur.
C’est pathétique (la mort du petit Tiny Tim, les bons sentiments), d’une époque où cela était encore possible en littérature – encore neuf.
Dickens excelle tant dans la forme brève que dans ses longs feuilletons, et son œuvre appartient au fond commun des lettres. L'histoire fameuse de Scrooge fait partie de ses créations devenues légendaires outre-manche. J’ai moi-même l’impression de l’avoir déjà lu – ce qui n’est pas impossible…
\Mots-clés : #contemythe #fantastique #misere #social #xixesiecle
- le Mer 3 Mar - 0:02
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Charles Dickens
- Réponses: 11
- Vues: 853
Vénus Khoury-Ghata
Quelque part en Afrique sub-saharienne (en Érythrée apprendrons-nous au fil du roman), une jeune femme suit, de gré, un photographe aux cheveux jaunes qui la mitraille de son appareil photo.
Son mari et ses enfants la recherchent jusqu'en Andalousie (Séville), où elle trône sur les affiches publicitaires. Puis elle quitte le photographe pour un écrivain, et sa truculente femme de ménage Amalia.
S'ensuit une histoire complètement hallucinante, dans laquelle les enfants, aidés d'un géant noir nommé Baobab, habillent la nuit les affiches dénudées montrant leur mère, tandis que le père se fond dans la masse plus ou moins ingénieuse des clandestins et autres sans-papiers pour gagner sa vie.
Après bien des péripéties, les top-models de couleur noire s'avèrent ne plus être à la mode, laquelle s'est reportée sur les slaves éthéreés...
Livre non dénué de tendresse, ni d'amour, ni d'humour.
Vénus Khoury-Ghata en mode foutraque a décidé de s'amuser, bien que le thème soit de première lourdeur, et, tour de force, sans escamotage, sans galvauder la profondeur du sujet; à titre personnel je lui en sais gré.
Un style imagé, servi par une écriture maîtrisée à la technique éprouvée (l'avantage de ces auteurs qu'on dit avancés en âge, sans doute...?), des touches réellement poétiques, une peinture des âmes dites simples, un rendu d'ensemble très facile et coulé au service d'une cocasserie qui rend léger ce petit ouvrage, lequel avait pourtant tout pour ne pas l'être:
S'il l'on confiait le sujet douloureux et les protagonistes fragiles à toute autre plume, n'obtiendrions-nous pas un mélo dans neuf productions sur dix ?
Marcher sur la pointe des pieds pour ne pas alerter le maître qui n'aime pas les enfants, dormir le plus souvent possible, sortir de la chambre et manger quand il dort.
Zina et Zeit hochent la tête pour dire qu'ils ont compris.
Mais la secouent lorsque la mère leur annonce qu'ils iront dans peu de temps dans un pensionnat.
"C'est quoi un pensionnat ?
- Une école où on dort et mange trois fois par jour.
- Dormir trois fois par jour ?"
Autant leur dire que la lune a mangé toutes les étoiles du ciel et roté leurs arêtes sur le désert.
De sa voix brutale, la mère énumère les exigences d'admission en pensionnat.
Des enfants propres, des habits propres. Des cahiers et des chaussures propres, un crayon à papier taillé et surtout pas de poux dans la tête.
Zina et Zeit sont d'accord pour le spoux, les cahiers, les crayons et les chaussures mais à condition de ne pas s'éloigner de la mère. Ils ont eu tant de mal pour la retrouver.
Et pourquoi le pensionnat ?
Ils sont assez grands pour remplir trois cahiers avec les mots qu'ils ont appris depuis leur arrivée dans le pays.
Conocer, no conocer, bono, no bono. Auxquels il faudra ajouter gracia Señor el filosofo appliqué au maître des lieux.
Dire qu'ils le prenaient pour un escritor.
"Un gran escritor, précise Amalia dans sa cuisine, son crayon est si long qu'il touche le plafond."
\Mots-clés : #enfance #exil #famille #immigration #misere #social
- le Dim 14 Fév - 16:25
- Rechercher dans: Écrivains du Proche et Moyen Orient
- Sujet: Vénus Khoury-Ghata
- Réponses: 27
- Vues: 6901
Albert Cossery
La Maison de la mort certaine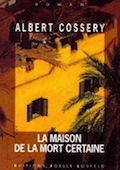
Une vieille bâtisse sordide menace ruine au sommet d’une venelle des quartiers populaires du Caire ; y cohabitent plusieurs familles démunies.
« Alors, ils se disaient avec sagesse qu’un malheur qu’on connaît vaut sans doute mieux qu’un malheur sournois et qui se cache. »
Cette résignation me paraît typique de la mentalité égyptienne (mais aussi fort répandue ailleurs en Afrique et en Orient), marque d’un certain fatalisme. Un des locataires est Abdel Al le charretier, aussi famélique que les autres, mais révolté et cherchant la cause leur misère, qui va comprendre que la solidarité seule peut leur rendre justice.
« Abdel Al ne cessait jamais de secouer la torpeur de ses compagnons d’infortune. Il les rabrouait continuellement. Leur nonchalance de pauvres animaux apathiques le navrait. Indifférents aux véritables raisons de leur misère, ils ne savaient que vivre honteusement en exhalant des plaintes. Ils menaient une vie amère et pleine de tristesse. Abdel Al leur en voulait de cette immonde résignation. Il eût voulu les voir rejeter ce destin trop lourd par des actes audacieux, ou simplement tenter d’en connaître la source intarissable. Il est vrai que lui-même n’avait qu’une connaissance très vague des origines de son abjecte condition sociale. Mais cet éveil imperceptible de sa conscience suffisait à lui faire sentir sa supériorité sur les autres. Il ignorait encore l’inextricable enchevêtrement de l’économie, pour pouvoir résoudre les problèmes qui le hantaient. Il en était encore à la simplicité primitive de la raison. Ce n’était encore, chez lui, que des idées imprécises, voilées, comme une aube d’hiver. Il était souvent la proie d’intuitions, de lucidités éphémères. Une force magique le poussait à comprendre et à saisir les causes secrètes de sa misérable destinée. »
Les autres habitants déclinent la pauvreté sous toutes ses formes, paresse, bêtise, y compris la désolation.
« Chéhata, le menuisier, abandonnant son travail, fixait le sol avec une obstination stupide d’aveugle. Il semblait pétrifié depuis des siècles. À quoi pensait-il ? Un jour, peut-être, on le saura. Il faudra bien qu’il dise un jour tout l’inconnu de sa souffrance. On ne pourra plus jamais le faire taire. Il criera si fort sa grande faim que personne, après, ne pourra plus dormir. »
Quant au propriétaire, les « marchands de sommeil » ne datent pas d’hier :
« Si Khalil, c’était un propriétaire de la pire espèce. Tout d’abord, sa miteuse fortune, il la devait à des spéculations franchement criminelles. Après des années de recherches sordides, il avait découvert un merveilleux filon. Muni d’un petit capital, il s’était lancé dans l’achat de certaines maisons croulantes, d’innommables ruines que leurs propriétaires – trop heureux de s’en débarrasser quelques heures peut-être avant leur complet effondrement – lui abandonnaient pour un morceau de pain. Pour repérer ces effroyables taudis, il avait acquis un flair de chien policier. Sa capacité dans la reconnaissance et l’évaluation des futures ruines de la ville était presque légendaire. À l’heure actuelle, il possédait une dizaine de ces avalanches en suspens, éparpillées dans différentes venelles des quartiers indigènes. Cependant, c’était là un jeu de hasard auquel se livrait Si Khalil, car ces maisons pouvaient très bien s’écrouler avant d’avoir jamais rien rapporté. Mais Si Khalil avait foi en sa chance. Ce qui ne l’empêchait pas d’avoir quelques meurtres collectifs sur la conscience, par suite de certains hasards malheureux. Toutefois ces catastrophes n’étaient pas faites pour le décourager dans sa tentative d’être un homme respectable et fortuné. »
Les pronostics allant bon train sur le moment où le taudis s’effondrera sur ses occupants, ceux-ci chargent Ahmed Safa le hachâche (consommateur de hachich) d’écrire une lettre de plainte au gouvernement (bien qu’ils se défient des autorités).
« Les enfants aiment beaucoup Ahmed Safa. Il les charme par des récits fantastiques. Comme eux, il vit en enfant. Il n’a pas les soucis des adultes ; ces soucis, lourds et puants. Le hachâche n’a pas honte de sa misère. Il n’a pas cette dignité idiote qu’ont les autres, lorsqu’il s’agit de mendier. Car le plus terrible ce n’est pas d’être pauvre, c’est d’avoir honte de l’être. »
« ‒ Quelle est l’adresse du gouvernement ? dit-il.
Cette adresse allait compromettre toute l’affaire.
Personne ne savait l’adresse du gouvernement.
‒ Le gouvernement, dit Rachwan Kassem, n’a pas d’adresse. Personne ne sait où il habite et personne ne l’a jamais vu.
‒ Pourtant il existe, dit Abdel Al.
‒ Qui le saura jamais ? dit Ahmed Safa. On n’est sûr de rien, en ce monde. »
« ‒ Peut-être que le gouvernement ne sait pas lire, mon fils, dit-il comme en se parlant à lui-même. »
Un passage saisissant de cette novella, l’épisode où le vieux Kawa est "séduit" par une gamine étique qui convoite son orange pourrie…
Pour avoir vécu au Caire, je peux confirmer que, comme à Marseille, il est trop fréquent qu’un immeuble s’écroule ; le savoir-faire des bâtisseurs des pyramides n’est pas en cause, mais plutôt la corruption et l’incurie (permis de construire pour un étage, et on en monte deux-trois par-dessus…) Ça et le goût pour les encorbellements (balcons et autres moucharabiehs) dans une région où l’activité sismique n’est pas négligeable… J’ai en mémoire un bâtiment qui s’est effondré dans mon quartier, loin d’ailleurs d’être des plus miséreux : pour agrandir au rez-de-chaussée, on avait supprimé des piliers, évidemment porteurs…
La venelle, ou ruelle, c’est la hara cairote, lieu caractéristique qu’évoquent tous les romanciers de la ville.
« Jusqu’au soir, ils discutèrent de la situation, accroupis dans la cour. Ils n’avaient plus envie de se lever ni de faire le moindre geste. Ils se sentaient emprisonnés dans leur destinée et à jamais bannis du reste du monde. La maison pouvait s’écrouler, elle les trouverait prêts au suprême sacrifice. À quoi bon bouger, si tout doit finalement retomber dans le néant de la mort ? »
\Mots-clés : #lieu #misère #viequotidienne
- le Sam 9 Jan - 14:49
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Albert Cossery
- Réponses: 59
- Vues: 5969
Flannery O'Connor
Et ce sont les violents qui l'emportent
Tarwater a quatorze ans lorsque meurt son grand-oncle, avec qui il vivait seul, à l’écart de la ville. Le vieillard l’a enlevé à sa naissance (ses parents ayant disparu dans un accident) pour l’éduquer afin d’en faire le continuateur de sa mission prophétique ; il avait déjà tenté de ravir son neveu, Rayber, devenu maître d'école et père de Bishop, enfant idiot que Tarwater a le devoir de baptiser. Ce dernier, après avoir incendié leur maison (métaphore du feu mystique), rejoint Rayber en ville ; plein de méfiance, dialoguant avec soi-même sous la forme d’un étranger (puis un ami) qui lui parle, il oscille entre l’emprise du vieillard qui l’a conditionné et la révolte contre celle-ci.
D’entrée, les scènes de la mort et l’enterrement du vieux prophète donnent le ton : il est féroce, puissant, impitoyable, d’une noirceur sans échappatoire.
« Ou s’il n’était pas exactement fou, ça revenait au même, mais d’une façon différente : il n’avait qu’une chose en tête. C’était l’homme d’une seule idée. Jésus. Jésus ceci, Jésus cela. »
« Ce n’est pas Jésus ou le diable, c’est Jésus ou toi. »
« Les prophètes, c’est bon qu’à ça – à trouver que les gens sont des ânes ou des putains. »
« Quand il en avait plein le dos du Seigneur, il se soûlait, prophète ou pas prophète. »
L’incarnation des personnages est impressionnante, et pour cela aussi j’ai pensé à Steinbeck.
Sur quatre générations, les quatre membres de cette famille se voient les uns dans les autres comme dans un miroir ‒ avec haine, comme des monstres répugnants ‒ la malédiction de la folie dans leur sang.
Ce roman (1960) reprend la dénonciation de La Sagesse dans le sang (1952) à propos des fanatiques, faux prophètes et illuminés qui imposent leurs convictions religieuses (fondamentalistes, bibliques, évangélistes) dans un prosélytisme abusif, exploitant jusqu’aux enfants ‒ en fait, Flannery O’Connor défend ou illustre moins un point de vue qu’elle semble être emportée par une vision, à l’instar de Faulkner ; à l’opposé de toute démonstration, elle présente sans explication jusqu’aux menues incohérences et confusions qui caractérisent l’existence.
Laïque et même athée, le maître d’école, qui à sept ans a été subjugué par les « yeux fous de poisson mort » de son oncle le vieux prophète et l’a rejeté à quatorze ans, qui adulte se débat avec l’amour et veut aider, sauver, guérir, surveiller son neveu (ainsi que l’étudier), est aussi un porteur de certitude à sa manière, mais qui ne peut agir.
« La malédiction des enfants, c’est qu’ils croient. »
« La grande dignité de l’homme, dit l’oncle, c’est qu’il peut dire : Je suis né une fois et ça suffit. Ce que je peux voir et faire pour moi et pour mon prochain dans cette vie, ça ne regarde que moi et je m’en contente. C’est bien suffisant pour un homme. »
Le baptême d’eau qui est nouvelle naissance constitue la trame du récit comme l’augure du drame que le lecteur regarde survenir.
\Mots-clés : #famille #misère #religion
- le Sam 2 Jan - 23:45
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Flannery O'Connor
- Réponses: 55
- Vues: 4267
Flannery O'Connor
La Sagesse dans le sang
Hazel Motes est un jeune déboussolé, passé d’une enfance cadrée par une éducation évangélique à quatre années dans l’armée (Seconde Guerre mondiale). Il croise le pitoyable Enoch Emery, plus jeune et plus déséquilibré encore, attardé à qui personne ne s’intéresse (et lui aussi traumatisé rescapé d’un milieu dévot).
Le piquant est que Flannery O’Connor est une fervente catholique, qui dénonce ici, dans son premier roman, les évangélistes, prédicateurs itinérants et autres faux prophètes nombreux dans le Sud des États-Unis.
J’ai pu observer personnellement les ravages de ce type de rackett en Afrique subsaharienne, et ne peux que soutenir la dénonciation de cette exploitation des élans de foi. J’ai vu de pauvres ouvriers se priver (eux et leurs enfants) pour payer la dîme (10% des revenus, voire plus) à une église personnifiée par un escroc qui roule en 4x4 ; je sais, l’idéal peut requérir des sacrifices, chacun est libre de se faire abuser, tout le monde a le droit d’être dupe…
Bien souvent c’est une liturgie foutraque, basée sur des lectures mal assimilées, qui réduit ces prêcheurs auto-proclamés à une caricature : il n’y a pas que des malfaiteurs, mais aussi des simples d’esprit dans les rangs sacerdotaux.
« Qu’est-ce que le pécheur espérait donc gagner ? Il finirait toujours par être la proie de Jésus. »
Et cela va plus loin : les deux illuminés vivent dans un délire, Hazel par rejet d’une éducation mensongère (qu’il ne peut fuir, pénitent qui réfute le péché comme la rédemption), Enoch par imprégnation déformée de l’image paternelle (son « sang » où se tient la sagesse) :
« ‒ L’Église du Christ ! répéta Hazel, eh bien, moi, j’prêche l’Église Sans Christ… J’suis membre et pasteur de cette Église où les aveugles ne voient pas, où les paralytiques ne marchent pas, et où ce qui est mort reste mort. Demandez-moi ce que c’est que cette Église et j’vous dirai que c’est l’Église que le sang de Jésus n’vient pas salir avec Sa Rédemption. »
« J’prêcherai qu’il n’y a pas eu de Chute parce qu’il n’y a jamais eu d’endroit d’où on pouvait tomber, et pas de Rédemption parce qu’il n’y a jamais eu de Chute, et pas de Jugement parce qu’il n’y a jamais eu ni Chute ni Rédemption. Jésus était un menteur, y a que ça d’important. »
« Moi, j’crois en un nouveau genre de Jésus, un Jésus qui n’donne pas son sang pour racheter le monde, parce qu’il est homme, et pas autre chose, parce qu’il n’a pas de Dieu en lui. Mon Église est l’Église Sans Christ. »
« Regardez-moi, hurla Hazel avec un déchirement dans la gorge, et vous verrez un homme en paix. En paix, parce que mon sang m’a rendu libre. Prenez conseil de votre sang et entrez dans le sein de l’Église Sans Christ, et peut-être quelqu’un nous apportera-t-il un nouveau jésus, et sa vue nous sauvera tous. »
« Pas de vérité derrière toutes ces vérités : voilà ce que je prêche dans mon Église. L’endroit d’où vous venez n’existe plus, celui où vous pensiez aller un jour n’a jamais existé, et celui où vous êtes ne vaut quelque chose que si vous pouvez en partir. Où donc se trouve-t-il l’endroit où vous pourrez vous arrêter ? Nulle part. »
« Ensuite, pendant une huitaine de jours, son sang [Enoch] eut avec soi-même des entretiens secrets et quotidiens, ne s’arrêtant de temps à autre que pour lui intimer un ordre. »
Humour noir :
« Il dit qu’il était pasteur.
La femme le regarda attentivement, puis regarda l’automobile derrière lui :
"De quelle Église ?" demanda-t-elle.
Il dit : "L’Église Sans Christ.
‒ Protestante ? demanda-t-elle, soupçonneuse, ou quelque chose d’étranger ?"
Il dit : "Non, madame, une Église protestante." »
Les deux personnages sont des abîmés de l’existence, plombée par leur formation ratée. Pour eux, la femme n’est qu’affaire de voyeurisme ou de bordel :
« Quand il eut terminé, il ressemblait à quelque chose que la mer aurait rejeté sur elle, et elle avait émis à son propos des commentaires obscènes auxquels il repensa, de temps à autre, au cours de la journée. »
Le bon goût règne à Taulkinham, petite ville du Tennessee :
« Le comptoir était fait d’un linoléum marbré, rose et vert. Une serveuse rousse se tenait derrière, revêtue d’un uniforme vert citron à tablier rose. Ses yeux verts, enchâssés de rose, ressemblaient à une réclame de Lime Cherry Surprise qui était pendue derrière elle. »
À mentionner, entr’autres scènes frappantes, la rencontre d’Enoch avec un « gorille », burlesque et noire guignolade qui révèle toute sa misère de gamin qui n’a pas eu d’enfance.
D’autres personnages bien campés sont de rencontre, tels Hawks le faux pasteur aveugle et sa fille la piètre Sabbath, ou Mrs Flood la logeuse :
« Elle avait le sentiment que les sommes qu’elle déboursait pour ses impôts tombaient dans les poches de tous les bons à rien de la terre, que non seulement le gouvernement les distribuait à des nègres étrangers, à des Arabes, mais les dépensait inutilement à domicile pour des crétins d’aveugles, pour le premier idiot venu, moyennant qu’il pût signer son nom sur une carte. Elle considérait que c’était parfaitement son droit d’en reprendre le plus possible. Elle considérait que c’était parfaitement son droit de reprendre n’importe quoi, argent ou autre chose, tout comme si elle eût été propriétaire d’un monde dont on l’avait dépossédée. Elle ne pouvait rien regarder avec attention sans le désirer aussitôt, et rien ne l’irritait davantage que la pensée qu’il aurait pu y avoir, caché près d’elle, quelque chose ayant de la valeur, quelque chose qu’elle ne pouvait pas voir. »
Dans ce roman, cette ville, cette Amérique, tout le monde est méchant, même « avec Jésus dans la cervelle en guise d’aiguillon »…
J’ai pu penser à John Steinbeck, peut-être à cause d’une certaine tendresse pour ses personnages malgré la farce burlesque à la fois choquante et dramatique, à la limite de l'absurde.
C’est un étonnant livre tragi-comique, à l’écriture très forte, tournant autour du thème de l’aveuglement (et bien sûr des dangers du fanatisme religieux pour soi comme pour les autres).
Mots-clés : #misère #religion
- le Dim 26 Juil - 14:31
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Flannery O'Connor
- Réponses: 55
- Vues: 4267
Page 2 sur 2 •  1, 2
1, 2


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages