La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 12:56
180 résultats trouvés pour lieu
Nicolas Mathieu
Leurs enfants après eux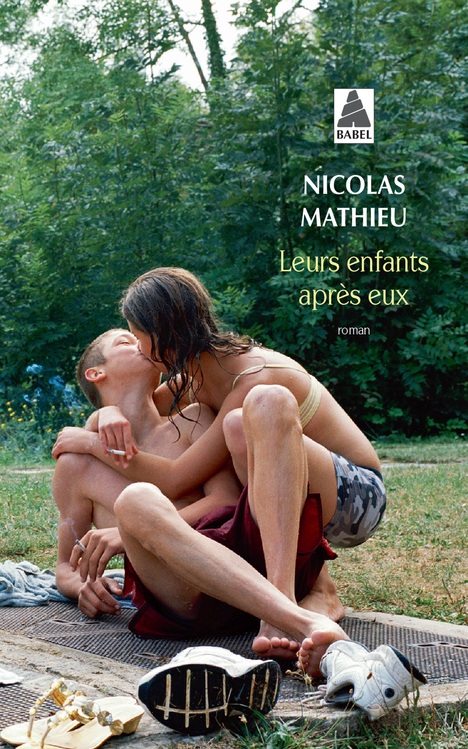
Lecture d'abord assez ennuyeuse, congrue à son sujet (donc c’est plutôt positif comme constat). C’est minable, les gens, les choses, l’époque : industrialisation puis désindustrialisation, et ce que ça donne socialement ; l’enfance, l’adolescence : c’est pas Bosco, pas celle dont curieusement les adultes disent se souvenir, mais la vraie, ce vaste ennui des jeunes tordus par les hormones de croissance, et leurs parents avant eux. « Le plus beau cul d’Heillange », qui mène Hélène à son fils Anthony, le personnage principal (suivi de quatorze à vingt ans). Et c’est finalement un panorama français (daté d’un quart de siècle), qui ne peut être réjouissant.
« Il sentit s’abattre sur lui ce malaise flou, encore une fois, l’envie de rien, le sentiment que ça ne finirait jamais, la sujétion, l’enfance, les comptes à rendre. Par moments, il se sentait tellement mal qu’il lui venait des idées expéditives. Dans les films, les gens avaient des têtes symétriques, des fringues à leur taille, des moyens de locomotion bien souvent. Lui se contentait de vivre par défaut, nul au bahut, piéton, infoutu de se sortir une meuf, même pas capable d’aller bien. »
(J’ai conservé des extraits qu’ArenSor avait déjà cités.)
« Il n’y a pas si longtemps, il lui suffisait de se taper des popcorn devant un bon film pour être content. La vie se justifiait toute seule alors, dans son recommencement même. Il se levait le matin, allait au bahut, il y avait le rythme des cours, les copains, tout s’enchaînait avec une déconcertante facilité, la détresse maximale advenant quand tombait une interro surprise. Et puis maintenant, ça, ce sentiment de boue, cette prison des jours. »
Patrick est le père d’Anthony, et ici occasion d’analyse sociétale du changement des valeurs :
« Depuis, Patrick entretenait avec ce couvre-chef des relations d’opérette. Il le portait, se croyait observé, le piétinait, l’oubliait dans son C15, le perdait régulièrement. Au volant, sur un site, au bistrot, au bureau, au garage, il se posait cette question : devait-il porter sa casquette ? Autrefois, les mecs n’avaient pas besoin de se déguiser. Ou alors les liftiers, les portiers, les domestiques. Voilà que tout le monde se retrouvait plus ou moins larbin, à présent. La silicose et le coup de grisou ne faisaient plus partie des risques du métier. On mourait maintenant à feu doux, d’humiliation, de servitudes minuscules, d’être mesquinement surveillé à chaque stade de sa journée ; et de l’amiante aussi. Depuis que les usines avaient mis la clef sous la porte, les travailleurs n’étaient plus que du confetti. Foin des masses et des collectifs. L’heure, désormais, était à l’individu, à l’intérimaire, à l’isolat. Et toutes ces miettes d’emplois satellitaient sans fin dans le grand vide du travail où se multipliaient une ribambelle d’espaces divisés, plastiques et transparents : bulles, box, cloisons, vitrophanies.
Là-dedans, la climatisation tempérait les humeurs. Bippers et téléphones éloignaient les comparses, réfrigéraient les liens. Des solidarités centenaires se dissolvaient dans le grand bain des forces concurrentielles. Partout, de nouveaux petits jobs ingrats, mal payés, de courbettes et d’acquiescement, se substituaient aux éreintements partagés d’autrefois. Les productions ne faisaient plus sens. On parlait de relationnel, de qualité de service, de stratégie de com, de satisfaction client. Tout était devenu petit, isolé, nébuleux, pédé dans l’âme. Patrick ne comprenait pas ce monde sans copain, ni cette discipline qui s’était étendue des gestes aux mots, des corps aux âmes. On n’attendait plus seulement de vous une disponibilité ponctuelle, une force de travail monnayable. Il fallait désormais y croire, répercuter partout un esprit, employer un vocabulaire estampillé, venu d’en haut, tournant à vide, et qui avait cet effet stupéfiant de rendre les résistances illégales et vos intérêts indéfendables. Il fallait porter une casquette. »
Les personnages féminins sont de même approfondis :
« Depuis le temps qu’elle trompait son attente, se préparait. Ainsi, ces derniers jours, elle avait pris soin d’ingurgiter ses deux bouteilles de Contrex quotidiennes. Elle s’était mise au soleil, mais pas trop, une heure maxi, se nappant avec patience, couche après couche, jusqu’à obtenir le rendu parfait, un hâle savant, onctueux, une peau en or et de jolies marques claires qui dessinaient sur sa nudité le souvenir de son maillot deux pièces. Au saut du lit, elle montait sur la balance avec une inquiétude sourde. Elle était gourmande, fêtarde. Elle aimait se coucher tard et avait tendance à picoler pas mal. Alors elle s’était surveillée au gramme près, mesurant son sommeil, ce qu’elle mangeait, faisant mais alors extrêmement gaffe à ce corps qui selon les moments, la lumière, les fatigues et les rations de nourriture connaissait d’extraordinaires mues. Elle avait poli ses ongles, maquillé ses yeux, prodigué à ses cheveux un shampoing aux algues, un autre aux œufs. Elle avait fait un peeling et s’était frottée sous la douche avec du marc de café. Elle avait confié ses jambes et son sexe à l’esthéticienne. Elle était ravie, appétissante, millimétrée. Elle portait un débardeur tout neuf, un truc Petit Bateau à rayures. »
Les clés de la réussite sociale n’ont finalement guère changé de mains…
« Les décideurs authentiques passaient par des classes préparatoires et des écoles réservées. La société tamisait ainsi ses enfants dès l’école primaire pour choisir ses meilleurs sujets, les mieux capables de faire renfort à l’état des choses. De cet orpaillage systématique, il résultait un prodigieux étayage des puissances en place. Chaque génération apportait son lot de bonnes têtes, vite convaincues, dûment récompensées, qui venaient conforter les héritages, vivifier les dynasties, consolider l’architecture monstre de la pyramide hexagonale. Le “mérite” ne s’opposait finalement pas aux lois de la naissance et du sang, comme l’avaient rêvé des juristes, des penseurs, les diables de 89, ou les hussards noirs de la République. Il recouvrait en fait une immense opération de tri, une extraordinaire puissance d’agglomération, un projet de replâtrage continuel des hiérarchies en place. C’était bien fichu. »
… même si certains parviennent à prendre l’ascenseur social.
« Car ces pères restaient suspendus, entre deux langues, deux rives, mal payés, peu considérés, déracinés, sans héritage à transmettre. Leurs fils en concevaient un incurable dépit. Dès lors, pour eux, bien bosser à l’école, réussir, faire carrière, jouer le jeu, devenait presque impossible. Dans ce pays qui traitait leur famille comme un fait de société, le moindre mouvement de bonne volonté ressemblait à un fait de collaboration.
Cela dit, Hacine avait aussi plein d’anciens copains de classe qui se trouvaient en BTS, faisaient une fac de socio, de la mécanique, Tech de co ou même médecine. Finalement, il était difficile de faire la part des circonstances, des paresses personnelles et de l’oppression générale. Pour sa part, il était tenté de privilégier les explications qui le dédouanaient et justifiaient les libertés qu’il prenait avec la loi. »
Les classes moyennes, pourtant financièrement précaires, alimentent allègrement la société de consommation :
« Avec Coralie, ils s’étaient d’ailleurs rendus chez Mr Bricolage et Leroy Merlin, mais ils étaient chaque fois rentrés bredouilles. Hacine n’y connaissait rien en bricolage, et il avait peur de se faire arnaquer, ça le rendait méfiant, il refusait de parler aux vendeurs. Heureusement, il y avait juste à côté d’autres enseignes pour acheter de la déco, des vêtements, des jeux vidéo, du matos hi-fi, du mobilier exotique et puis manger un morceau. C’était la beauté de ces zones commerciales du pourtour, qui permettaient de dériver des journées entières, sans se poser de question, en claquant du blé qu’on n’avait pas, pour s’égayer la vie. À la fin, ils étaient même allés chez King Jouet et avaient parcouru les allées, un sourire aux lèvres, en pensant à tout le plaisir qu’ils auraient eu étant gosses, s’ils avaient pu s’offrir tout ça. Résultat, l’appart était rempli de bougies, de loupiotes en plastique, de plaids en laine polaire, de bibelots d’inspiration bouddhique. Coralie avait également craqué pour deux fauteuils en rotin garnis de coussins blancs. Avec le yucca et les plantes vertes dans les coins, c’est vrai que l’ensemble avait pris un certain cachet. Ce serait encore mieux quand Hacine se serait décidé à planter un clou pour accrocher la photo du Brooklyn Bridge qui attendait au pied du mur. »
Culmination avec la fresque du 14 juillet :
« Ils étaient donc là, peut-être pas tous, mais nombreux, les Français.
Des vieux, des chômeurs, des huiles, des jeunes en mob, et les Arabes de la ZUP, les électeurs déçus et les familles monoparentales, les poussettes et les propriétaires de Renault Espace, les commerçants et les cadres en Lacoste, les derniers ouvriers, les vendeurs de frites, les bombasses en short, les gominés, et venus de plus loin, les rustiques, les grosses têtes, et bien sûr quelques bidasses pour faire bonne mesure. »
C’est la ruralité, alors il faut deux ou quatre roues pour se déplacer, pas seulement pour la frime.
Il y a plusieurs incohérences ou erreurs, qu’une relecture sérieuse aurait corrigé.
Le suspense est habilement entretenu dans le déroulement de ces quelques vies caractéristiques, avec pour ressort les rapports tendus d’Anthony et Hacine.
Après une première partie plutôt rebutante, je me félicite d’avoir poursuivi l’effort de lecture de ce roman en fait très consistant, qui traite de la jeunesse, de la désindustrialisation, de l’immigration, des « cassos », des drogues et de la délinquance en notre pays (principalement les années 1990). Plus proche de l’observation sociologique (avec effectivement les pertinentes « analyses récapitulatives » évoquées par Topocl ; j’ai aussi pensé à Daewoo, de François Bon) que de l’"ouvrage d'imagination", il a quand même obtenu le prix Goncourt. Ce dernier peut se révéler décevant, mais a permis cette fois de faire valoir un romancier contemporain qui mérite d’être lu.
\Mots-clés : #immigration #lieu #mondedutravail #relationdecouple #relationenfantparent #ruralité #sexualité #xxesiecle
- le Jeu 4 Avr - 12:23
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Nicolas Mathieu
- Réponses: 35
- Vues: 1577
Hubert Haddad
Le Peintre d'éventail
Xu Hi-han, le narrateur (mais pas toujours le seul), raconte comme, dans la pension de dame Hison, une sorte de refuge à l’écart entre mer et montagne, son maître Matabei Reien rencontra le vieux jardinier et peintre d’éventail, Osaki Tanako.
Matabei est venu là oublier son passé : peintre prometteur, il a tué une jeune fille dans un accident de circulation, peu avant le séisme de Kobe.
Chez dame Hison, ancienne courtisane, il y a quelques habitués : Anna et Ken, un couple de jeunes amants clandestins, monsieur Ho, « un bon vivant négociant en thé et grand buveur », et Aé-cha, « l’éternelle vieille fille à demeure, coréenne d’origine ».
À la mort d’Osaki, Matabei, qui est devenu l’amant de dame Hison, le remplace. Xu est le jeune suppléant qui aide la vieille servante de la pension, et dont Matabei devient le mentor. Survient Enjo, une jeune femme dont le regard rappelle à Matabei celui de sa victime involontaire. Elle devient son amante, et Xu, qui l’aimait, part.
« Peindre un éventail, n’était-ce pas ramener sagement l’art à du vent ? »
« Comme au moins cent millions d’humains à cette seconde, tout se précipite, hanches contre hanches, peaux et souffles mêlés, chute de l’un dans l’autre au milieu des morsures et des glissements. Au plus fort de l’étreinte, l’ancienne courtisane considérait d’un autre monde cette sensation somme toute banale d’union intime et d’absence du fond même de la jouissance. C’était pour elle une évidence qu’on pût ressentir et ne pas ressentir les choses. Depuis une certaine nuit à Kyoto, elle avait appris à se détacher de la douleur ou de la volupté, sans rien pourtant en perdre. […]
Les complications burlesques de l’usage du sexe l’avaient effarée toute jeune, au moment des premiers rapports, ce goût de la honte et de la flétrissure, ces prétentions, ces hilarités imbéciles, et puis elle avait compris une fois enceinte l’exception bouffonne de cet acte, et sa monstruosité en accouchant avant terme. Dans les humeurs et la fièvre, chaque coït tentait de ranimer quelque chose de mort-né. »
Le jardin est central dans le récit, avec son harmonie qui répond à la nature fort présente (« la loi d’asymétrie et le juste équilibre comme un art de vivre »), et les lavis et haïkus du vieux maître en participent.
« Pourtant, une inquiétude avait sourdi au fil des saisons : pouvait-on repiquer, transplanter, tuteurer, bouturer, diviser, aérer, buter, attacher, éclaircir, pincer, pailler, et même arroser, sans perdre insensiblement la juste mesure et l’harmonie, ne fût-ce que de l’expression de tel angle facial, d’un détail répété des linéaments, de l’aménité indéfinissable des parties à l’ensemble ? Il avait beau se dire qu’un visage doit avoir le mérite de vieillir en beauté, que l’impermanence touchait toute chose de la nature, la sensation de trahir son vieux maître en cendres s’accusait avec l’automatisme de certains gestes. Chaque coup de cisaille devait être un acte conscient, en rapport avec les mille pousses et rejets, dans l’héritage des lunaisons et la confiance des soleils. Un jardin rassemblait la nature entière, le haut et le bas, ses contrastes et ses lointaines perspectives ; on y corrigeait à des fins exclusives, comme par compensation, les erreurs manifestes des hommes, avec le souci de ne rien tronquer du sentiment natif des plantes et des éléments. »
« Chaque saison est la pensée de celle qui la précède. L’été vérifie les gestes du printemps. »
« Toujours en décalage, hors de tout centrage selon le principe d’asymétrie, mais avec des répétitions convenues comme ces dispositions de rochers et d’arbres aux savantes distorsions et ces diagonales en vol d’oies des baliveaux, le spectacle changeant du jardin accompagnait le regard en se jouant des mouvements naturels de l’œil par à-coups et balayages, ce qui l’égarait dans sa quête d’unité par une manière d’enchantement continu ourdi de surprises et de distractions. »
« — Jardiner, c’est renaître avec chaque fleur… »
« La nature n’a besoin de personne, avait-il déclaré, le temps est son jardinier et elle laisse chacun libre. »
« La révélation qu’eut Matabei, un matin radieux de fin d’automne où les arbres en partie dépouillés semblaient faire connaissance, c’est qu’il devait s’agir pour le vieux sage d’une création simultanée et indissociable. Les lavis et l’arrangement paysager allaient de pair, comme l’esprit et l’esprit, les uns préservant les secrets de l’autre, en double moitié d’un rêve d’excellence dont il aurait été le concepteur obnubilé. »
Un tremblement de terre puis un tsunami suivi d'un accident nucléaire ravagent la région, où Matabei demeure solitaire dans un ermitage abandonné. Il y recompose les lavis délavés des éventails du maître, son « jardin de pensée ». Xu, qui est devenu un lettré et vient de se marier avec Enjo, le retrouve à temps pour sauver son œuvre. Clausule :
« La vie est un chemin de rosée dont la mémoire se perd, comme un rêve de jardin. Mais le jardin renaîtra, un matin de printemps, c’est bien la seule chose qui importe. Il s’épanouira dans une palpitation insensée d’éventails. »
Haddad use cette fois d’un ton poétique, onirique, parfaitement congru à cette histoire, parfaitement nippone, de contemplation de l’impermanence du monde.
« Bec et plumes
l’encre est à peine sèche
qu’il s’envole déjà »
\Mots-clés : #catastrophenaturelle #creationartistique #initiatique #lieu #nature #peinture #poésie #traditions
- le Dim 31 Mar - 11:30
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 20
- Vues: 923
Nickolas Butler
Nickolas Butler, né le 2 octobre 1979 à Allentown en Pennsylvanie, est un écrivain américain. Il vit aujourd'hui à Eau Claire dans le Wisconsin et étudie à l'Université du Wisconsin à Madison.
Il participe à un atelier d'écriture de l'Université de l'Iowa. Il fait des petits travaux : employé chez Burger King, tuteur, télévendeur, vendeur de hot-dogs, aubergiste, cueilleur de pommes, vendangeurs, Il écrit. Il vit avec son épouse et leurs deux enfants à la campagne, dans le Wisconsin.
Ses nouvelles sont publiées dans les magazines comme Ploughshares (en), The Kenyon Review Online, The Lumberyard, The Christian Science Monitor, Narrative et Sixth Finch, et dans d'autres publications.
En 2014, son premier roman est publié.
Butler a reçu diverses bourses et récompenses de la part de fondations régionales de prix littéraires. Il a remporté le prestigieux prix PAGE America en France, le prix Great Great Great Reads 2014, le prix Midwest Independent Booksellers 2014, le prix littéraire 2015 de la Wisconsin Library Association, le prix littéraire régional 2015 du chancelier UW-Whitewater, et est finaliste pour le prix Flaherty Dunnan 2014 du premier roman et de la sélection pour le prix FNAC en France, selon son site personnel.
Sources wikipedia
Bibliographie
Romans
Retour à Little Wing, Autrement, 2014 ((en) Shotgun Lovesongs, 2014)
Des hommes de peu de foi, Autrement, 2016 ((en) The Hearts of Men, 2017)
Le Petit-Fils, Stock, 2020 ((en) Little Faith, 2019)
La Maison dans les nuages, Stock, 2023
Recueil de nouvelles
Rendez-vous à Crawfish Creek, Autrement, 2015
Tronçonneuse party (The Chainsaw Soirée)
Un goût de nuage (Rainwater)
Sven & Lily
Rendez-vous à Crawfish Creek (In Western countries)
Sous le feu de joie (Benneath the bonfire)
Brut aromatique (Sweet Light Crude)
Les restes (Leftovers)
Morilles (Morels)
Lenteur ferroviaire (Train people move slow)
Pommes (Apples)
========================================
"Cette maison allait changer leur fortune. Ils le sentaient. »
Cole, Bart et Teddy sont associés d’une petite entreprise de construction à Jackson, dans le Wyoming. Lorsque Gretchen Connors, une richissime avocate californienne, leur propose de terminer de bâtir une sublime maison au cœur des montagnes voisines, le trio aperçoit une porte de sortie, loin de leur quotidien banal. Cette maison serait un bijou architectural, la plus belle de toute la région, leur chef-d’œuvre.
Un seul problème : ils doivent terminer le chantier en quatre mois, ce qui signifie travailler jour et nuit. Et pourquoi le précédent entrepreneur a-t-il jeté l’éponge ?Mais l’appât du gain est trop fort. Ils acceptent.Alors qu’un hiver glacial s’installe, que le chantier se met en difficilement en branle, Cole doit aussi gérer son divorce malheureux, Teddy ses quatre filles et Bart son addiction à la méthadone. Cette maison qui semblait être un petit coin de paradis, ne deviendrait-elle pas leur pire cauchemar ?
Portrait d’une Amérique orpheline de ses rêves, coincée entre le mirage du bien-être et un capitalisme implacable, La Maison dans les nuages est un roman noir à couper le souffle. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Mireille Vignol
Ce livre est inspiré de faits réels.
Butler a trouvé le sujet assez intéressant pour en faire un roman, tu m'étonnes Nicko !
Il y a temps à dire sur l'individualisme du nanti richissime, tant à écrire sur la société américaine décomplexée, indécente et concupiscente.
Et j'y suis rentrée dans le Wyoming
accrochée dans le pickup avec Cole, Bart et Teddy, j'ai longé les ravins et les canyons délaissés peu de temps auparavant alors embarquée avec les Cowboys lors de la ruée vers l'or, accompagnée de Dorothy Marie Johnson, sous la colline des potences et m'y revoilà près de 70 ans plus tard, dans une Amérique toujours plus libéraliste, toujours plus capitaliste.
On troque le scalp des indiens contre celui bien plus sournois des nababs qui n'hésitent pas à dépouiller son prochain et ce à tous les étages d' une société consumériste.
L' Amérique de tous les possibles, de tous les rêves, chacun veut son lot, à commencer par l'opportunité de vivre décemment, se fixer ou s'orienter, puis surtout, à terme, se faire un tas de pognon, le leitmotiv majeur, vecteur autorisant toutes les manières d'y arriver.
Alors pourquoi pas accepter la construction de cette maison dans les nuages, dans les hauteurs des canyons, à 80 bornes de la ville, projet aussi incroyable que dément, sans doute parce que terminée à temps, le bonus est colossal pour nos trois amis.
Le présent c'est maintenant, action !
Prenons le challenge, nous, Cole, Bart et Teddy, les prolos, potes d'enfance et chefs d'une petite d'entreprise de construction de quartier, à peine connus, à peine certains de terminer ce chantier extravagant destiné en général à des entreprises calibrées avec pignon sur rue, à des hommes d'affaires aux dents longues rayant le parquet à peine posé.
4 mois de délai en plein hiver, à peine entendable (voire réalisable) et pourtant, ils s'y collent, prenant avec les exigences d'une propriétaire à laquelle on ne dit pas non et peu importe finalement les questionnements legitimes sur le pourquoi de leur embauche...
Et on les comprend, il faut dire qu'on s'y attache à ces trois là, Nickolas Butler, avec ce talent que je découvre, nous les rend proches, dresse des portraits intimistes qui font que la proximité s'installe.
Elle s'établit tellement qu'on se marre, stresse, souffre avec eux, on attend l'accident de chantier en sachant que la populace aux states n'a majoritairement pas les moyens de se payer une assurance , mais youpi, peut-être l'Obamacare sera bénéfique...
on suit la construction, un chantier soumis à un climat capricieux et déplorable à cette période de l'année et peu importe les conditions pour le ou la millionnaire, un délai et un délai, d'ailleurs, que vaut la vie d'un ouvrier ?
" c'est la nature des choses avec t'il raisonné, ça se passe peut-être ainsi depuis des temps immémoriaux. À cette heure même, des hommes s'affairaient pour ériger ce palais contemporain, ce projet "phare" destiné à une personne d'une richesse inconcevable.
Des milliers d'années auparavant l'histoire était la même, sauf qu'une main d'oeuvre multipliée par plusieurs centaines avait bâti une pyramide pour un type quelconque qui se prenait pour un dieu.
Il y avait ceux qui faisaient construire et ceux qui construisaient. Tout comme il y avait ceux qui se retroussaient les manches et les autres. "
Et je les ai presque retroussées mes manches, même si mes connaissances en matière de travaux sont presqu'aussi désastreuses que ma defense criarde pour faire fuir un grizzli.
Je les ai vus se tuer à la tâche, avaler les heures jour après jour comme des forcenés, j'ai observé l'arrivée de la meth comme palliatif et carburant, assisté aux pertes de repères et à tout bon sens, perçu l'inévitable... au nom de l'argent, de l'appât du gain qui s'ancre au plus profond des exploités ne rêvant que d'évasion , de se libérer d'une vie contrariée, d'offrir une vie meilleure à une famille d'invisibles.
Ils sont si proches de cette entreprise, nos associés.
Si loin, pourtant, du monde qui leur donne la becquée, quelques miettes à l'orée d'une frontière dorée hors d'atteinte...
Un roman noir qui ne manque pas de panache. Doté d'un style acéré et d'un regard critique, Nickolas Butler met en lumière les dérives d'une partie de l'Amérique désespérée et désemparée.
Derrière le suspense qui monte en puissance, c'est un cri silencieux que l'on entend, celui de tous les imperceptibles, des oubliés , cahotés, chahutés, maltraités, dominés et opprimés.
C'est le monde du bas, celui que l'on monnaie, puisque tout s' achète, même la mort.
Un roman percutant et éloquent.
\Mots-clés : #addiction #amitié #lieu #nature #reve
- le Jeu 15 Fév - 7:51
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Nickolas Butler
- Réponses: 1
- Vues: 298
Fabio Andina
Jours à Leontica
« Nous avions parlé un moment puis je lui avais demandé s’il serait d’accord que je le suive dans ses journées. Histoire de vivre un peu comme lui. »
Le narrateur accompagne donc le Felice, ancien maçon de « nonante ans », à la « gouille » (point d’eau) où il se baigne chaque petit matin (on est fin novembre, à mille quatre cents mètres d’altitude).
« Le plus souvent, Felice ne marche pas pour se déplacer mais pour passer le temps. »
« Le Felice n’a pas la télévision, ni la radio, ou le téléphone. Il n’a même pas de boîte aux lettres. Le peu de courrier qu’il reçoit, la factrice Alfonsa le lui remet en mains propres, ou alors elle le laisse sur le banc avec une pierre par-dessus, et s’il pleut elle le pose sur la table de la cuisine, de toute façon la porte est toujours ouverte. »
« C’était nous, les enfants, qui allions dans les bois les ramasser avec nos paniers, parce qu’à l’époque c’était ou patates ou châtaignes, ou châtaignes ou patates, si tu veux savoir. Ou grillées ou cuites. Ou cuites ou grillées, les châtaignes. C’était soit l’un soit l’autre. C’était pas comme les patates, qu’elle savait préparer de mille et une façons, alors on pouvait pas dire qu’on mangeait tout le temps la même chose. Non, on mangeait des gnocchis, de la purée, des patates cuites au four avec du romarin ou dans les braises. On mangeait la soupe de patates, les patates avec des oignons, ou juste cuites à l’eau avec un peu de sel, et j’en passe. »
À Leontica, village des Alpes tessinoises avec ses baite (chalets) couvertes de piole (lauzes, pierres plates), il y a aussi le Floro dit le Ramoneur, le Sosto et le Brenno, la Vittorina, la Sabina, la Candida, la Muette, le Pep, l’Emilio…
« À ses bestioles il donne un fourrage fait d’herbes triées sur le volet qu’il ramasse en se promenant à travers champs. Un jour je lui avais apporté un plein sac d’herbe de mon jardin, mais il m’avait dit que ses lapins n’y toucheraient pas, parce que je l’avais coupée à la débroussailleuse et qu’ils le sentent quand ça pue les gaz d’échappement. »
Et les chiens, les chats, et la nature.
« Des lames de lumière froide percent la pinède. Les rayons obliques illuminent les plumes bleues des ailes de deux geais qui se pourchassent en jasant entre les sapins. Hors de la pinède, au bord de l’étroit chemin de terre, sur le tronçon qui relie les deux ponts, un écureuil fourrage dans les taillis. Il nous aperçoit, bondit sur un grand tronc et disparaît dans une cavité, une châtaigne entre les dents. Ses dernières provisions avant l’hiver. »
« L’Adula, avec son glacier en lutte contre le réchauffement climatique, contraint jour après jour de laisser dévaler des pans entiers de notre histoire. Ses souvenirs toujours plus étriqués, comme un vieillard devenant sénile. »
Il y a aussi quelques points mystérieux : le Felice semble lire les pensées, à été en Russie, prépare l’arrivée de quelqu’un.
« Puis j’entends encore ses mots, ses histoires, celle de sa mère qui cuisinait des gnocchis le dimanche, celle de la gouille en Russie et de la vache tuée pendant son service militaire et que le monde est rempli de crétins qui se font plumer comme des pigeons, que le monde est aux mains des plus grands margoulins de cette terre. Et au fait qu’il ne croyait qu’au respect réciproque et rien d’autre. »
Sorte de chronique testimoniale, à valeur quasiment historique voire ethnologique (avec notamment le recours judicieux au vocabulaire local), sur un terroir, et une personne sensible à son environnement. La paisible routine du hameau, élevage de la volaille à la vache, potager, troc, entraide (et pourtant indépendance respectée), une certaine sobriété (mais pas toujours en ce qui concerne l’alcool et le tabac), une qualité de silence, de lenteur (pas toujours non plus), et beaucoup de routine, parties de scopa au bar et l’essentielle Sarina (fourneau à bois). Une communauté avec aussi ses drames, dans un passé prégnant.
Merci @Topocl, j'ai aimé !
\Mots-clés : #amitié #lieu #nature #nostalgie #ruralité #solidarite #vieillesse #viequotidienne
- le Jeu 1 Fév - 11:30
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Fabio Andina
- Réponses: 16
- Vues: 615
Joseph Roth
Hôtel Savoy
Gabriel Dan, soldat austro-hongrois dans la Première Guerre mondiale et prisonnier en Sibérie, revient de trois ans de captivité à Łódź, où il loge à l'avant-dernier étage de l’hôtel Savoy, tenu par le mystérieux Kalegouropoulos. Pour continuer sa fuite vers l’Ouest, il espère une aide de son riche oncle Phébus Böhlaug.
« — Et tu n’y étais pas mal, n’est-ce pas ? Tous les gens disent qu’on est bien en captivité. »
« Je l’essaye dans la chambre d’Alexandre, devant la grande glace murale – il me va. Je me rends compte, mais oui, je me rends bien compte de la nécessité d’un costume bleu, « comme neuf », de la nécessité de cravates mouchetées de brun, d’un gilet marron, et, l’après-midi, je repars avec un carton à la main. Je reviendrai. Je me berce encore du léger espoir d’obtenir de l’argent pour le voyage.
— Maintenant, vois-tu, je l’ai équipé, dit Phébus à Régine. »
« J’avais été longtemps seul parmi des milliers. Maintenant, il y a des milliers de choses que je peux partager : la vue d’un pignon aux lignes courbes, un nid d’hirondelles dans les W.-C. de l’Hôtel Savoy, le regard irritant et les yeux couleur de bière du vieux garçon d’ascenseur, l’amertume qui règne au septième étage, l’étrangeté inquiétante d’un nom grec, d’une notion grammaticale brusquement rendue vivante, le triste rappel d’un aoriste plein de traîtrises, le souvenir de l’étroitesse de la maison paternelle, les ridicules de ce lourdaud de Phébus Böhlaug et Alex sauvé par le train des équipages. Les choses vivantes en devenaient plus vivantes, plus haïssables celles que tous condamnaient, plus proche le ciel et le monde asservi. »
« — Non, dis-je, je ne sais pas ce que je suis. Autrefois, je voulais devenir écrivain, mais je suis parti pour la guerre, et je crois qu’il ne sert à rien d’écrire. Je suis un homme solitaire et je ne peux pas écrire pour tous. »
Puis Gabriel, le narrateur, rencontre ses voisins dans le microcosme de l’hôtel, la danseuse Stasie, le clown Vladimir Santschin (qui meurt vite), Hirsch Fisch le vendeur de billets de loterie, Abel Glanz, l’étrange souffleur qui survit de change de devises, Taddeus Montag, le caricaturiste, et les autres pauvres de la ville (sale et d’apparence assez sinistre), comme les Juifs qui y errent. Alex, le fils de Phébus, épris de Stasie, lui propose de payer son voyage pour Paris en échange de sa chambre, mais il reste après avoir tergiversé. Les ouvriers de l’industriel Neuner sont en grève, on craint la révolution. Gabriel héberge Zwonimir Pansin, son frère d’armes, trublion, et même agitateur.
« L’auteur de l’article expliquait que tout le mal venait des prisonniers qui rentraient, car ils introduisaient « le bacille de la révolution » dans un pays sain. L’auteur était un pauvre type, il lançait de l’encre contre des avalanches, il construisait des digues de papier contre des raz de marée. »
Arrive l’Américain Bloomfield (Blumenfeld) (puis son coiffeur, Christophe Colomb), attendu par tous comme une manne financière, et Gabriel devient un de ses secrétaires, jusqu’à l’insurrection et l’incendie de l’hôtel Savoy.
« Douloureux est le sort des hommes, et leur souffrance élève devant eux un grand, un gigantesque mur. Pris dans la toile gris poussière de leurs soucis, ils se débattent comme des mouches prisonnières. Celui-ci manque de pain et celui-là le mange avec amertume. Celui-ci veut être rassasié et celui-là être libre. Là, un autre agite ses bras et croit que ce sont des ailes, croit qu’il va s’élever l’instant ou le mois, ou l’année d’après, au-dessus des bas-fonds de ce monde.
Douloureux était le sort des hommes. Leur destin, ils le préparaient eux-mêmes et croyaient qu’il venait de Dieu. Ils étaient prisonniers des traditions, leur cœur était retenu par des milliers de fils et leurs mains tissaient elles-mêmes ces fils. Sur toutes les voies de leur vie se dressaient les tables de la loi de leur Dieu, de leur police, de leurs rois, de leur classe. Ici, il était défendu d’aller plus loin et là de s’attarder. Et, après s’être ainsi débattus durant quelques décennies, après avoir erré, être restés désemparés, ils mouraient dans leur lit et léguaient leur misère à leurs descendants. »
À la fois désolé et teinté d’humour, ce roman rend subtilement le délitement de l’empire austro-hongrois et de la Mitteleuropa.
Et il s’ajoute en bonne place sur l’étagère des hôtels légendaires en littérature, comme le Lutetia de Pierre Assouline, qu’il m’a ramentu.
\Mots-clés : #exil #historique #lieu #premiereguerre #xxesiecle
- le Mar 26 Déc - 10:50
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: Joseph Roth
- Réponses: 31
- Vues: 4011
David Grann
La Cité perdue de Z – Une expédition légendaire au cœur de l’Amazonie
Le colonel Percy Harrison Fawcett est disparu en 1925 lors d’une expédition amazonienne, parti à la recherche d’une cité perdue. Il avait déjà, en 1906-1907, établi une cartographie de la frontière entre le Brésil et la Bolivie pour la Société royale de géographie. Intrépide et apparemment invincible, il multiplie les explorations du proverbial « enfer vert » – finalement l’image ne me paraît pas totalement erronée, surtout vécue dans les conditions de l’époque. Quoique empêtré dans ses convictions victoriennes élitistes et racistes, il ne se borne pas à suivre les principaux cours d’eau mais s’enfonce à pied en forêt, et approche ainsi des tribus indiennes inconnues, dont il reconnaît la culture et le savoir-faire (en bref des civilisés) dans une approche qui annonce l’anthropologie moderne.
Mais c’est le mythique El Dorado des conquistadors qui obsède surtout Fawcett, qu’il appelle la cité perdue de Z.
En 1911, Hiram Bingham découvre les ruines incas de Machu Picchu. En 1913/1914, l’ex-président Théodore Roosevelt et Cândido Rondon, orphelin d’origine indienne devenu le colonel brésilien qui fondera le Service de protection des Indiens, explorent la rivière du Doute.
Pour son ultime expédition, Fawcett a été approché par le colonel T. E. Lawrence, mais préfère emmener son fils Jack et l’ami de ce dernier, Raleigh ; il manque de fonds, est devenu adepte du spiritisme et craint d’être devancé, cependant ils parviennent à partir dans le Mato Grosso. Fawcett emporte une idole de pierre, cadeau de Henry Rider Haggard (auteur de Les Mines du roi Salomon et She)…
David Grann, journaliste néophyte en la matière, raconte comment il suit ses traces en 2004 pour enquêter sur le terrain (comme tant d’autres, dont des dizaines ne revinrent jamais) ; il expose comme les dernières recherches archéologiques rendent compte d’une société qui a su se développer dans ce milieu avant d’être éradiquée par les maladies importées.
Brian, le fils cadet de Fawcett, présente les carnets de route et journaux intimes de son père dans Le continent perdu. Sir Arthur Conan Doyle, ami de Fawcett, fait de son histoire le cadre de son roman Le Monde perdu. J’ai eu une pensée pour Les Maufrais (père et fils). Autant de livres qui alimentèrent mon imaginaire depuis l’adolescence...
\Mots-clés : #amérindiens #aventure #biographie #contemythe #historique #lieu #nature #portrait #voyage
- le Mar 5 Déc - 11:36
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: David Grann
- Réponses: 15
- Vues: 1733
João Guimarães Rosa
Diadorim
Le titre original est Grande Sertão : veredas. Le sertão désigne les vastes régions semi-arides de l’intérieur du Brésil, où une population clairsemée vit surtout de l’élevage ; les chapadas, plateaux désertiques, sont parsemées de veredas, verdoyantes dépressions où l’eau se concentre, et donc la vie.
Riobaldo, surnommé Tatarana, ancien jagunço devenu fazendeiro (propriétaire d’une fazenda, ou vaste ferme), évoque devant le narrateur sa vie passée dans le sertão (les jagunços sont les hommes de main des fazendeiros, vivant en bandes armées et se livrant au brigandage, aussi considérés comme des preux).
« Vous le savez : le sertão c’est là où est le plus fort, à force d’astuces, fait la loi. Dieu lui-même, quand il s’amènera, qu’il s’amène armé. Et une balle est un tout petit bout de métal. »
« J’ai ramé une vie libre. Le sertão : ces vides qu’il est. »
« Le sertão est bon. Tout ici se perd ; tout ici se retrouve… disait le sieur Ornelas. Le sertão c’est la confusion dans un grand calme démesuré. »
Le sertão est hostile, mais a ses beautés, et les descriptions qui en sont données constituent un intérêt supplémentaire. À ce propos, l’emblématique buruti, c’est le palmier-bâche qui vit les pieds dans l’eau, le bem-te-vi, c’est le quiquivi, oiseau également fréquent en Guyane.
Riobaldo, comme beaucoup, ne connaît pas son père (en fait, à la mort de sa mère, il est recueilli par son parrain, qui serait son géniteur).
« L’homme voyage, il fait halte, repart : il change d’endroit, de femme – ce qui perdure c’est un enfant. »
Riobaldo parle de ses pensées qui l’obsèdent à propos du démon (qui a d’innombrables noms, dont « celui-qui-n’existe-pas ») : peut-on faire pacte avec lui ? Il parle aussi de Diadorim, son ami et amour, et des femmes qu’il aime. Il digresse, reprend le fil de son monologue : il évoque leur lieutenant, Medeiro Vaz, qui brûla sa fazenda, éparpilla les pierres de la tombe de sa mère pour aller mener une guerre de justice dans les hautes-terres, et leurs ennemis, les deux Judas félons (Hermὀgenes, protégé des enfers, et Ricardo) qui ont tué Joca Ramiro (père de Diadorim), et les soldats qui les combattent, et Zé Bebelo, stratège enjoué qui rêve de batailles et d’être député, puis remplace Medeiro Vaz à sa mort (et de qui Riobaldo fut percepteur, avant d’être dans le camp adverse, ce qui le tourmente). Car ce dernier narre dorénavant son existence depuis son enfance : comment il rencontra Reinaldo et fut séduit (ses amours sont plus généralement féminines, notamment la belle Otacilia, ou encore Norinha), Reinaldo qui lui confie s’appeler Diadorim.
À propos de la sensualité féminine, un passage qui rappelle Jorge Amado dans ses bonnes pages :
« L’une d’elles – Maria-des-Lumières – était brune : haute d’un huitième de cannelier. La chevelure énorme, noire, épaisse comme la fourrure d’un animal – elle lui cachait presque toute la figure, à cette petite mauresque. Mais la bouche était le bouton éclos, et elle s’offrait rouge charnue. Elle souriait les lèvres retroussées et avait le menton fin et délicat. Et les yeux eau-et-miel, avec des langueurs vertes, à me faire croire que j’étais à Goïas… Elle avait beaucoup de savoir-faire. Elle s’occupa aussitôt de moi. Ce n’était pas qu’une petite péronnelle.
L’autre, Hortense, une très gentille oiselle de taille moyenne, c’était Gelée-Blanche ce surnom parce qu’elle avait le corps si blanc ravissant, que c’était comme étreindre la froide blancheur de l’aube… Elle était elle-même jusqu’au parfum de ses aisselles. Et la ligne des reins, courbes ondulantes d’un ruisseau de montagne, confondait. De sorte que sa longueur exacte, vous n’arriviez jamais à la mesurer. Entre elles deux à la fois, je découvris que mon corps aussi avait ses tendretés et ses duretés. J’étais là, pour ce que je sais, comme le crocodile. »
Ce qui vaut surtout, c’est le monologue noté par son auditeur :
« Nous vivons en répétant, et bon, en une minime minute le répété dérape, et nous voilà déjà projetés sur une autre branche. »
Son récit décousu se commente lui-même, et sans doute l’auteur s’exprime-t-il lui-même par moments :
« Je sais que je raconte mal, je survole. Sans rectifier. Mais ce n’est pas pour donner le change, n’allez pas croire. […] Raconter à la suite, en enfilade, ce n’est vraiment que pour les choses de peu d’importance. De chaque vécu que j’ai réellement passé, de joie forte ou de peine, je vois aujourd’hui que j’étais chaque fois comme s’il s’agissait de personnes différentes. Se succédant incontrôlées. Tel je pense, tel je raconte. […] Et ce que je raconte n’est pas une vie d’homme du sertão, aurait-il été jagunço, mais la matière qui déborde. »
Riobaldo n’a jamais connu la peur, mais…
« Je sentis un goût de fiel sur le bout de ma langue. La peur. La peur qui vous coince. Qui me rattrapa au tournant. Un bananier prend le vent par tous les bords. L’homme ? C’est une chose qui tremble. Mon cheval me menait sans échéance. Les mulets et les ânes de la caravane, Dieu sait si je les enviais… Il y a plusieurs inventions de peur, je sais, et vous le savez. La pire de toutes est celle-ci : qui d’abord vous étourdit, et ensuite vous vide. Une peur qui commence d’emblée par une grande fatigue. Là où naissent nos énergies, je sentis qu’une de mes sueurs se glaçait. La peur de ce qui peut toujours arriver et qui n’est pas encore là. Vous me comprenez : le dos du monde. […] Je n’y arrivais pas, je ne pensais pas distinctement. La peur ne permettait pas. J’avais la cervelle embrumée, la tête me tournait. Je bus jusqu’à la lie le passage de la peur : je traversais un grand vide. »
« La peur manifeste provoque la colère qui châtie ; c’est bien tout ce à quoi elle sert. »
Le ton est celui du langage populaire, volontiers proverbial, traversé de fulgurances condensées voire lapidaires, très inventives et souvent poétiques, à l’encontre d’une rédaction rationnelle et claire. Allers-retours dans le temps de la remémoration (étonnamment riche, précise et détaillée), à l’instar des chevauchées et contre-marches de la troupe.
« Veuillez m’excuser, je sais que je parle trop, des à-côtés. Je dérape. C’est le fait de la vieillesse. Mais aussi, qu’est-ce qui vaut et qu’est-ce qui ne vaut pas ? Tout. Voyez plutôt : savez-vous pourquoi le remords ne me lâche pas ? Je crois que ce qui ne le permet pas c’est la bonne mémoire que j’ai. »
« Ah, mais je parle faux. Vous le sentez ? Si je démens ? Je démens. Raconter est très, très laborieux. Non à cause des années, passées depuis beau temps. Mais à cause de l’habileté qu’ont certaines choses passées – à faire le balancier, à ne pas rester en place. Ce que j’ai dit était-il exact ? Ça l’était. Mais ce qui était exact a-t-il été dit ? Aujourd’hui je crois que non. Ce sont tant d’heures passées avec les gens, tant de choses arrivées en tant de temps, tout se découpant par le menu. »
« Non, nenni. Je n’avais aucun regret. Ce que j’aurais voulu, c’était redevenir enfant, mais là, dans l’instant, si j’avais pu. J’en avais déjà plus qu’assez de leurs égarements à tous. C’est qu’à cette époque je trouvais déjà que la vie des gens va à vau-l’eau, comme un récit sans queue ni tête, par manque de joie et de jugement. La vie devrait être comme dans une salle de théâtre, et que chacun joue son rôle avec un bel entrain du début à la fin, qu’il s’en acquitte. C’était ce que je trouve, c’est ce que je trouvais. »
« Nous sommes des hommes d’armes, pour le risque de chaque jour et toutes les menues choses de l’air. »
« Mais les chemins sont ce qui gît partout sur la terre, et toujours les uns contre les autres ; il me revient que les formes les plus fausses du démon se reproduisent. Plus vous allez m’entendre, plus vous allez me comprendre. »
« On ne se met pas en colère contre le boa. Le boa étranglavale, mais il n’a pas de venin. Et il accomplissait son destin, tout réduire à un contenu. »
« La vie en invente ! On commence les choses, à l’obscur de savoir pourquoi, et dès lors le pouvoir de les continuer, on le perd – parce que la vie est le boulot de tous, triturée, assaisonnée par tous. »
« Tout cela pour vous, mon cher monsieur, ne tient pas debout, n’éclaire rien. Je suis là, à tout répéter par le menu, à vivre ce qui me manquait. Des choses minuscules, je sais. La lune est morte ? Mais je suis fait de ce que j’ai éprouvé et reperdu. De l’oublié. Je vais errant. Et se succédèrent nombre de petits faits. »
« Je sais : qui aime est toujours très esclave, mais ne se soumet jamais vraiment. »
« Qui le sait vraiment ce qu’est une personne ? Compte tenu avant tout : qu’un jugement est toujours défectueux, parce que ce qu’on juge c’est le passé. Eh, bé. Mais pour l’écriture de la vie, juger on ne peut s’en dispenser ; il le faut ? C’est ce que font seuls certains poissons, qui nagent en remontant le courant, depuis l’embouchure vers les sources. La loi est la loi ? Mensonge ! Qui juge, est déjà mort. Vivre est très dangereux, vraiment. »
La dernière phrase revient comme un leitmotiv dans le récit de Riobaldo :
« Vivre est très dangereux, je vous l’ai déjà dit. »
Apprécié en tant que bon tireur, Riobaldo parcourt donc le sertão qu’il aime, malgré les vicissitudes de cette existence itinérante, chevauchant de peines en batailles. Il médite sans cesse, sur la vie, l’amour, et par un curieux défi, dans sa haine d’Hermὀgenes qui aurait signé un pacte avec « l’Autre », décide d’en faire un lui aussi, bien qu’il ne croie ni à cette puissance maléfique, ni même à l’âme. Le démon ne se présente pas à la « croisée des chemins de Veredas-Mortes ».
« Alors, je ne sais ou non si j’ai vendu ? Je vous le dis : ma peur c’est ça. Tous la vendent, non ? Je vous le dis : de diable il n’y en a pas, le diable n’existe pas, et l’âme je la lui ai vendue… Ma peur, c’est ça. À qui l’ai-je vendue ? C’est ça, monsieur, ma peur : l’âme, on la vend, c’est tout, sans qu’il y ait acheteur… »
Cependant Riobaldo change. Lui, pour qui il n’était pas question de commander, devient le chef, Crotale-Blanc. Il reprend avec succès la traversée du Plan de Suçuarão, où avait échoué Medeiro Vaz, pour prendre à revers la fazenda d’Hermὀgenes.
Il y a encore les « pacants », rustres paysans croupissant dans la misère, victimes d’épidémies et des fazendeiros obnubilés par le profit, ou Siruiz, le jagunço poète, dont Riobaldo donne le nom à son cheval, ou encore le compère Quelémém, de bon conseil, évidemment Diadorim qu'il aime, et nombre d'autres personnages.
Ce livre-monde aux différentes strates-facettes (allégorie de la condition humaine, roman d’amour, épopée donquichottesque, geste initiatique – alchimique et/ou mythologique –, combat occulte du bien et du mal, cheminement du souvenir, témoignage ethnographique, récit de campagnes guerrières, etc.) est incessamment parcouru d’un souffle génial qui ramentoit Faust, mais aussi Ulysse (les deux).
Il est encore dans la ligne du fameux Hautes Terres (Os Sertões) d’Euclides da Cunha, par la démesure de la contrée comme de ceux qui y errent. L’esprit épique m’a aussi ramentu Borges et son exaltation des brigands de la pampa.
Sans chapitres, ce récit est un fleuve formidable dont le cours parfois s’accélère dans les péripéties de l’action, parfois s’alentit dans les interrogations du conteur : flot de parole, fil de pensée, flux de conscience. Et il vaut beaucoup pour la narration de Riobaldo ou, autrement dit, pour le style (c’est la façon de dire) rosien.
Le texte m’a paru excellemment rendu par la traductrice (autant qu’on puisse en juger sans avoir recours à l’original) ; cependant, il semble être difficilement réductible à une traduction, compte tenu de la langue créée par Rosa, inspirée du parler local et fort inventive.
\Mots-clés : #amour #aventure #contemythe #criminalite #ecriture #guerre #historique #initiatique #lieu #mort #nature #philosophique #portrait #ruralité #spiritualité #voyage
- le Ven 22 Sep - 13:06
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: João Guimarães Rosa
- Réponses: 26
- Vues: 1529
Hubert Haddad
Géométrie d'un rêve
Un vieil écrivain solitaire s’est installé dans le Finistère ; toujours marqué vingt ans plus tard par son amour pour Fedora, une soprano, ce narrateur décide d’écrire son journal, et sa propre vérité.
« Mais je n’ai d’autre alternative aujourd’hui que le mutisme ou la confession. Et me taire serait une sorte de noyade. Glissant en aval du temps qui me reste, je commence avec ces pages un exercice inédit et quelque peu saugrenu : tenter de garder la tête hors des eaux mortes du quotidien, bien autrement que par la fiction. »
Il note donc réflexions, méditations, souvenirs, scénarios d’œuvres de fiction, citations littéraires et philosophiques, ses rêves et son quotidien.
Sa mère morte juste après sa naissance, rejeté par son père gendarme, il fut élevé par Elzaïde, sa grand-mère maternelle, conteuse aussi imaginative qu’analphabète qui lui inculqua « les vertus conjuguées de la fable et de la métaphore » ; mais ce qui le hante surtout, c’est Fedora, sa maîtresse pendant des années, dont il ne partagea que des jours, jamais les nuits.
« L’absence initiale de mère, de cette lumière penchée qui vous sauve de l’ordinaire indifférence des choses, aurait pu m’écarter de l’espèce humaine, faire de moi une sorte de monstre, si deux ou trois substituts femelles n’avaient parié sur la félicité de l’orphelin. »
« Je n’ignore pas quelle fonction compensatoire ont pour moi ces pages. Pouvoir écrire cent fois le nom de Fedora est une manière de l’invoquer, comme le derviche qui se remplit des cent appellations d’une divinité absente. En moi sont inscrites et foliotées toutes nos rencontres, seule lecture d’inestimable valeur dans une existence livrière. Pourtant notre relation se détache de la pleine mémoire et dérive entre des banquises d’oubli, sur fond d’énigme. »
Fedora fut une femme sensuelle, passionnée et secrète, que son portrait range avec les grandes héroïnes de la littérature.
« Elle s’enroula contre moi pour m’avaler dans les sucs de la plus violente séduction. Je repris le dessus au fond d’une ottomane drapée de satin à motifs géométriques. Les seins de la cantatrice, splendides fuseaux oscillants comme des têtes de cobra, furent ma première découverte. Une gorge dénudée peut changer un visage : le masque de Fedora tomba sur cette morphologie éclatante de sphinge peinte par Franz von Stuck. Outre les épaules et la roseur poivrée des aisselles, je ne vis rien d’autre de son corps, trop aveuglément perdu en elle ce jour-là, trop effrayé par mon propre désir. Ses doigts avaient délacé tous les linges et mis crûment en jonction chairs et organes. Elle haletait et râlait, la tête renversée, les mamelons tendus sous mes lèvres. À ce moment de douceur paroxystique, j’aurais sans doute pu la tuer si elle me l’avait demandé dans une langue intelligible. Cambrée à se rompre, battant ma face de sa chevelure, elle gémissait des paroles sans suite, elle les criait. Ses yeux fixaient le plafond, égarés, puis revenaient à moi dans un éclair d’imploration ou de fureur. Fedora perdait prise au point de ne plus m’identifier. Il n’y avait plus de distance pour elle entre possession et douleur, folie et sommeil. Jamais n’aurais-je imaginé que l’amour physique puisse être une pareille culbute dans le néant. »
Par petites touches, on apprend qu’il a vécu à Kyoto où il fut l’amant d’Amaya, fille tatouée d’un yakusa, qu’il a connu la prison, fut marqué par une expérience d’asphyxie aux gaz d’échappement dans son enfance, et qu’il se sent fort proche d’Emily Dickinson. Son seul succès éditorial aura été Tallboy, l’histoire de Ludwig, jeune Allemand seul dans un blockhaus de la côte normande en 1944, qui « ne connaît rien de son histoire que les poètes et les musiciens ». Il est aussi fasciné par le destin du Maître de Lassis, mystérieux artiste peintre vivant retiré au voisin château de Fortbrune avec sa fille Aurore et une servante, morts brûlés par les nazis ainsi que toute son œuvre. Il fréquente un peu le vieux père Adamar, organiste dont le frère fut un « malgré-nous » de l’Alsace-Lorraine annexée (incorporé de force dans la Waffen-SS – et devenu un héros nazi).
À propos de Lavinia, la bibliothécaire du proche village de Meurtouldu, qui possède son livre, la Verseuse du matin (et bel échantillon du style de Haddad dans ce roman) :
« Elle parlait avec une liberté d’intonation très musicale, en sopraniste du chuchotement. J’avais remarqué sur la lande le feu intense de ses prunelles. Il me semblait découvrir ses traits après cet éblouissement, et la courbe opaline d’une nuque cernée de flammèches d’un blond cendré. Une telle grâce émanait d’elle que je me sentis transporté vingt ans en arrière, dans la cité des Doges, en plein hiver. Le sujet de la nouvelle-titre m’avait été en effet inspiré par une rencontre des plus énigmatiques, retour de la piazza San Marco, sur le pont des Déchaussés où les masques du carnaval rentraient par cohortes trébuchantes, aux premières lueurs de l’aube. J’étais revenu trois mois plus tôt du Japon avec une nostalgie de jade et de laque dont j’espérais guérir à Venise, la plus nippone des cités d’Europe. L’amour, cette religion de la volupté, m’avait rendu quelque peu mécréant, mais je rêvais d’union fidèle comme tous les jeunes gens qui suivent le premier jupon. Perdu dans la ville en fête, sans autre masque que ma mine de pierrot lunaire, j’avais longtemps erré d’un pont l’autre entre les canaux et les palais illuminés qui mêlaient leurs feux dans le remous. Cette mosaïque d’architectures flottantes, mirage sur la lagune, avec ses stylites à tête de lion et ses temples barbares, n’évoquait rien pour moi du grand art de Véronèse ou de Titien. Sans affinité pour cette vie adorablement futile, je déambulais en exclu des vertus attractives qui, selon Chateaubriand, "s’exhalent de ces vestiges de grandeur", quand, au petit jour, depuis le pont des Déchaussés, je la vis sur le quai du Grand Canal : accroupie sur une marche qui touchait la vague, les jupes relevées au-dessus des genoux, elle remplissait un récipient de verre, vase ou carafe, aussitôt reversé dans l’eau noire. Le soleil venait de se lever sur les dômes et les campaniles, laissant encore dans la pénombre les embarcadères ou la robe des ponts. Le carnaval s’était vite essoufflé dans ce quartier populaire et seuls quelques vagabonds traînaient le long des appontements. Je mis peu de temps à rebrousser chemin pour descendre sur le quai. La jeune femme reversait toujours l’eau du canal, la tête penchée, avec une grâce presque terrifiante. Le soleil inonda bientôt ses belles mains et ce fut une révélation : c’était elle, la Verseuse du matin ! Je sentis pour la première fois en moi l’exaltation un peu vaine de l’inspiration, pure émotivité projetée dans l’inconnu. La Vénitienne était probablement folle, et reconnue pour telle par les riverains, mais elle restera pour moi cette prêtresse des eaux qui me fait irrésistiblement penser, quoique à l’opposite, dans l’effroi d’une naissance matutinale, à l’allégorie des Mémoires d’outre-tombe : "Venise est là, assise sur le rivage de la mer, comme une belle femme qui va s’éteindre avec le jour ; le vent du soir soulève ses cheveux embaumés ; elle meurt saluée par toutes les grâces et les sourires de la nature." »
Il y a aussi « l’ami Jean » de son enfance au bord de la Marne, Else, sa belle-mère allemande, qui lui donna ses premiers émois sexuels, une certaine Blandine Feuillure de La Gourancière, sa « lectrice cannibale » qui enquête sur les sources biographiques de son écriture, Vauganet, autre piètre écrivain, ses personnages qui vivent toujours en lui, et surtout ses songes, ses insomnies et ses paralysie du sommeil.
Quelques extraits caractéristiques :
« Dans sa très vibrante aphasie, la musique peut être cette forme autistique d’expression qui sauve par manière d’indicible repli. »
« À chaque fois que je prends la plume, je repense à l’inconnue du canal Saint-Martin : nous ne faisons rien d’autre, écrivant, que de vider les étangs pourrissants de la mémoire dans l’espoir de mettre à nu un destin perdu. »
« Je me récrée sacrément, en romancier repenti, de la totale liberté formelle que permet le journal intime : aucune obligation de chronologie, pas de descriptions intempestives ni d’usage industrieux de la psychologie. La vérité flottante de ma vie, succession de bouts d’errances et de paralysies, m’apparaît comme un cercle de figures plus ou moins floues qui avancent et se dérobent, avec l’air d’une foule déchaînée en mal de lapidation ou, tout au contraire, l’aspect plutôt aimable d’une ronde agreste. »
« En vérité, mon émotion de cardiaque ressemble fort à un coup de foudre. Celle-ci ne peut tomber qu’au même endroit de la mémoire, réveillant sans fin d’autres émois. Mon regard traverse le voile charnel du vivant et appelle l’ombre qu’il dissimule – folle incantation ! »
« Je me disais en l’observant que la critique universitaire est l’exercice le plus ingrat d’appropriation et de subordination de la liberté humaine. Nous écrivons des romans pour échapper aux aliénistes du langage comme à toute forme de réduction savante. »
« La vie est une succession de figures fractales qui s’ordonnent en destinée. »
Érudition et imaginaire, existentiel et songe, c'est toute une mémoire qui tente de se perpétuer. Une belle œuvre, où des signes semblent s’organiser en échos pour faire sens (l’Allemagne, la musique, l’amour, etc.), et où tout ne sera pas élucidé.
\Mots-clés : #amour #creationartistique #deuxiemeguerre #journal #lieu #musique #reve #solitude
- le Ven 15 Sep - 12:48
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 20
- Vues: 923
Julien Gracq
La Forme d’une ville
Sous les auspices de Baudelaire, Rimbaud, Poe, Apollinaire, Breton et Verne, avec son admirable élocution si souple et léchée, Gracq évoque la géographie, mais aussi l’histoire de Nantes, avec notamment une étude de la ville et de sa campagne à leurs limites ou lisières. Lieu d’où s’envole l’imaginaire et, depuis, des images d’autres cités visitées, c’est d’une ville à la fois "formatrice" et en perpétuel changement qu’il se remémore.
« Un jeu de cartes postales, même « personnalisé », rien qu’en mettant à plat la masse, le volume émouvant et indivisible qu’est d’abord, pour le sentiment que nous en avons, une ville, la déshumanise, la dévitalise, plus qu’il ne la fait resurgir. Il est curieux que pour moi ces vues intérieures que je garde de Nantes vont jusqu’à revêtir un caractère résolument passéiste : elles refusent de prendre en compte les transformations opérées dans la ville depuis un demi-siècle ; elles constituent des documents d’archives intimes, classées et répertoriées, plutôt que de vrais souvenirs. »
Le lycée (entre jésuite et militaire) dans les années vingt :
« J’y ai fait de solides études, et je ne doute guère que le rendement scolaire de cette dure et brutale machine ait été, en fin de compte, pour mes camarades, et pour moi, supérieur d’assez loin, à temps égal, à ce qu’il est aujourd’hui. Mais le prix à payer était élevé. »
Fortement implanté dans la ville de Nantes (où j’ai séjourné, il y a quelques décennies), ce livre vaut sans doute surtout pour le familier des lieux, qui y retrouverait ses marques comme Gracq les siennes alors qu’il était jeune. Mais pas un mot sur le gros-plant, à peine sur le muscadet ; pourtant un vif souvenir de mes pérégrinations dans les cafés à l’époque…
\Mots-clés : #autobiographie #enfance #jeunesse #lieu #xxesiecle
- le Jeu 7 Sep - 12:02
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Julien Gracq
- Réponses: 97
- Vues: 7396
David Lodge
Nouvelles du paradis
Bernard Walsh, prêtre défroqué et théologien (et aussi le narrateur, notamment lorsqu’il tient un journal, mais pas toujours), emmène son père de Rummidge (le Birmingham de Lodge – à rapprocher de celui de Coe ?) à Honolulu pour y rencontrer Ursula, la sœur de son père, avec qui ce dernier est en froid depuis son départ aux USA, suite à son mariage avec un GI : elle se meurt d’un cancer. À peine arrivés, « papa », individu assez pénible par ailleurs, se casse la hanche, renversé par la voiture de Yolande Miller alors qu’il traversait en regardant à gauche (travers britannique).
C’est l’occasion d’observer les voyages en avion (livre paru en 1991, et ça ne s’est pas amélioré) et le tourisme (là aussi c’est devenu pire), vu comme un rituel remplaçant la religion dans la quête du paradis selon Roger Sheldrake, un anthropologue qui se rend aux îles Hawaï afin de poursuivre ses recherches. C’est de nouveau Un tout petit monde, le microcosme des clients de Travelwise Tours à Waikiki (une jolie collection de personnages vus avec un œil satirique, comme la fille qui cherche tout au long de ses vacances « le Mec Bien »). Il y a aussi un point de vue anglais sur le système américain (carence des assurances sociales pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent, pratique répandue des poursuites en justice par cupidité).
« Les Américains ont l’air d’adorer manger en marchant, comme les troupeaux qui pâturent. »
C’est encore l’opportunité de parler de ces îles loin de tout.
« Le paradis est ennuyeux, mais vous n’avez pas le droit de le dire. »
« L’histoire d’Hawaii est l’histoire d’une perte.
— Le paradis perdu ? ai-je demandé.
— Le paradis volé. Le paradis violé. Le paradis pourri. Le paradis acheté, développé, mis en paquets, le paradis vendu. »
« Les visiteurs défilaient le long des avenues Kalakaua et Kuhio en un va-et-vient incessant avec leurs T-shirts fantaisie, leurs bermudas et leurs petites poches de marsupiaux ; le soleil brillait et les palmiers se balançaient au gré des alizés, les notes nasillardes des guitares hawaiiennes s’échappaient des boutiques, et les visages avaient l’air assez sereins, mais, dans les yeux de chacun, on semblait lire cette question à demi formulée : bon, tout cela est charmant, mais c’est tout ce qu’il y a ? C’est vraiment tout ? »
Il est surtout question d’aborder la foi (et sa perte).
« On cesse de croire à une idée qui nous est chère bien avant de l’admettre au fond de soi. Certains ne l’admettent jamais. »
« Point n’est besoin d’aller très loin dans la philosophie de la religion pour découvrir qu’il est impossible de prouver qu’une proposition religieuse est juste ou fausse. Pour les rationalistes, les matérialistes, les positivistes, etc., c’est une raison suffisante pour refuser de considérer sérieusement le sujet dans sa totalité. Mais pour les croyants, un Dieu dont il n’est pas possible de prouver l’existence vaut bien un Dieu dont l’existence est avérée et vaut manifestement mieux que l’absence totale de Dieu, puisque sans Dieu il n’y a aucune réponse satisfaisante aux sempiternels problèmes du mal, du malheur, de la mort. La circularité du discours théologique qui utilise la révélation pour appréhender un Dieu dont on ne dispose d’aucune preuve de l’existence en dehors de la révélation (que Saint-Thomas d’Aquin repose en paix !) ne dérange pas le croyant, car le fait de croire n’entre pas en ligne de compte dans le jeu théologique, c’est l’arène dans laquelle se joue le jeu théologique. »
« La Bonne Nouvelle est celle qui annonce la vie éternelle, le paradis. Pour mes paroissiens, j’étais une sorte d’agent de voyages qui distribuait des billets, des contrats d’assurances, des brochures et leur garantissait le bonheur ultime. »
Le point de vue de Bernard permet à Lodge de présenter l’évolution au sein du christianisme, qui abandonne la croyance en la vie éternelle au paradis (ou en enfer) pour laisser la place à une sorte d’humanisme sur terre.
« Bien sûr, il y a encore beaucoup de chrétiens qui croient avec ferveur, même avec fanatisme, en un au-delà anthropomorphique, et il y en a encore beaucoup d’autres qui aimeraient y croire. Et il ne manque pas de pasteurs chrétiens pour les encourager dans ce sens avec chaleur, parfois avec sincérité, parfois aussi, comme les télévangélistes américains, pour des motifs plus douteux. Le fondamentalisme a profité précisément pour se développer du scepticisme eschatologique que véhiculait la théologie instituée, si bien que les formes du christianisme qui sont de nos jours les plus actives et les plus populaires sont aussi les plus indigentes sur le plan intellectuel. Cela semble être vrai pour d’autres grandes religions du monde. »
Ce roman mêle donc des aspects sociologique, géographique, historique, religieux, métaphysique, tout cela relevé d’humour et d'intertextualité (renvois notamment à des artistes anglais, comme W.B. Yeats).
\Mots-clés : #contemporain #fratrie #lieu #relationenfantparent #religion #social #spiritualité #voyage #xxesiecle
- le Mer 30 Aoû - 15:59
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: David Lodge
- Réponses: 20
- Vues: 3064
Keigo Higashino
La Maison où je suis mort autrefois
(Je sors mon ancien commentaire du purgatoire Le One-shot des paresseux - Page 12, 23 février 2022)
Sayaka, l’ex-petite amie du narrateur, lui demande de venir visiter avec elle une mystérieuse maison dont elle a trouvé la clef et le plan d’accès à la mort de son père. La villa semble abandonnée depuis vingt-trois ans, et les horloges, arrêtées, indiquent onze heures dix. Lui est encore amoureux d’elle, qui entretemps s’est mariée et a eu une petite fille, pour qui elle avoue ne rien ressentir, jusqu’à la maltraiter. Dans la demeure abandonnée, ils trouvent le journal de Yusuke, un garçon qui vivait là avec ses parents, jusqu’à la disparition de son père, et l’apparition de « l’autre ».
« Surtout le passage qui dit que l’expérience de l’enfance de la mère pouvait avoir une influence déterminante dans de nombreux cas. »
Leur enquête progresse très graduellement ; l’énigme est fort habilement ourdie, et l’atmosphère est surtout empreinte d’angoisse.
Je relirai de cet auteur, qui promet dans ce premier roman.
\Mots-clés : #lieu #polar
- le Sam 5 Aoû - 12:28
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: Keigo Higashino
- Réponses: 3
- Vues: 183
William Faulkner
Descends, Moïse
Sept récits paraissant indépendants de prime abord, qui mettent en scène des personnages du Sud des USA, blancs, nègres (et Indiens ; je respecte, comme j’ai coutume de le faire, l’orthographe de mon édition, exactitude encore permise je pense). Plus précisément, c’est la lignée des Mac Caslin, qui mêle blancs et noirs sur la terre qu’elle a conquise (les premiers émancipant les seconds). Oppositions raciale, mais aussi genrée sur un siècle, plus de quatre générations dans le Mississipi.
Le titre fait référence à des injonctions du Seigneur à Moïse sur le Sinaï, notamment dans l’Exode. Ce roman est dédicacé à la mammy de Faulkner enfant, née esclave.
Autre temps : apparition de Isaac Mac Caslin, « oncle Ike », et la poursuite burlesque d’un nègre enfui.
Le Feu et le Foyer : affrontement de Lucas Beauchamp et Edmonds, fils de Mac Caslin, qui a pris la femme du premier :
« – Ramasse ton rasoir, dit Edmonds.
– Quel rasoir ? » fit Lucas. Il leva la main, regarda le rasoir comme s’il ne savait pas qu’il l’avait, comme s’il ne l’avait encore jamais vu, et, d’un seul geste, il le jeta vers la fenêtre ouverte, la lame nue tournoyant avant de disparaître, presque couleur de sang dans le premier rayon cuivré du soleil. « J’ai point besoin de rasoir. Mes mains toutes seules suffiront. Maintenant, prenez le revolver sous votre oreiller. » »
« Alors Lucas fut près du lit. Il ne se rappela pas s’être déplacé. II était à genoux, leurs mains enlacées, se regardant face à face par-dessus le lit et le revolver : l’homme qu’il connaissait depuis sa petite enfance, avec lequel il avait vécu jusqu’à ce qu’ils fussent devenus grands, presque comme vivent deux frères. Ils avaient péché et chassé ensemble, appris à nager dans la même eau, mangé à la même table dans la cuisine du petit blanc et dans la case de la mère du petit nègre ; ils avaient dormi sous la même couverture devant le feu dans les bois. »
Péripéties autour d’alambics de whisky de contrebande, et de la recherche d’un trésor. Lucas, bien que noir, a plus de sang de la famille que Roth Edmonds, le blanc, que sa mère a élevé avec lui dès sa naissance. Le même schéma se reproduit de père en fils, si bien qu’on s’y perd, et qu’un arbre généalogique de la famille avec tous les protagonistes serait utile au lecteur (quoique ce flou entre générations soit vraisemblablement prémédité par Faulkner, de même que le doute sur la "couleur" de certains personnages, sans parler des phrases contorsionnées).
« Lucas n’était pas seulement le plus ancien des habitants du domaine, plus âgé même que ne l’aurait été le père d’Edmonds, il y avait ce quart de parenté, non seulement de sang blanc ni même du sang d’Edmonds, mais du vieux Carothers Mac Caslin lui-même de qui Lucas descendait non seulement en ligne masculine, mais aussi à la seconde génération, tandis qu’Edmonds descendait en ligne féminine et remontait à cinq générations ; même tout gamin, il remarquait que Lucas appelait toujours son père M. Edmonds, jamais Mister Zack comme le faisaient les autres nègres, et qu’il évitait avec une froide et délibérée préméditation de donner à un blanc quelque titre que ce fût en s’adressant à lui. »
« Ce n’était pas toutefois que Lucas tirât parti de son sang blanc ou même de son sang Mac Caslin, tout au contraire. On l’eût dit non seulement imperméable à ce sang, mais indifférent. Il n’avait pas même besoin de lutter contre lui. Il ne lui fallait pas même se donner le mal de le braver. Il lui résistait par le simple fait d’être le mélange des deux races qui l’avaient engendré, par le seul fait qu’il possédait ce sang. Au lieu d’être à la fois le champ de bataille et la victime de deux lignées, il était l’éprouvette permanente, anonyme, aseptique, dans laquelle toxines et antitoxines s’annulaient mutuellement, à froid et sans bruit, à l’air libre. Ils avaient été trois autrefois : James, puis une sœur nommée Fonsiba, puis Lucas, enfants de Tomey’ Turl, fils du vieux Carothers Mac Caslin et de Tennie Beauchamp, que le grand-oncle d’Edmonds, Amédée Mac Caslin, avait gagnée au poker à un voisin en 1859. »
« Il ressemble plus au vieux Carothers que nous tous réunis, y compris le vieux Carothers. Il est à la fois l’héritier et le prototype de toute la géographie, le climat, la biologie, qui ont engendré le vieux Carothers, nous tous et notre race, infinie, innombrable, sans visage, sans nom même, sauf lui qui s’est engendré lui-même, entier, parfait, dédaigneux, comme le vieux Carothers a dû l’être, de toute race, noire, blanche, jaune ou rouge, y compris la sienne propre. »
Bouffonnerie noire : Rider, un colosse noir, enterre sa femme et tue un blanc.
Gens de jadis : Sam Fathers, fils d’un chef indien et d’une esclave quarteronne, vendu avec sa mère par son père à Carothers Mac Caslin ; septuagénaire, il enseigne d’année en année la chasse à un jeune garçon, Isaac (Ike).
« L’enfant ne le questionnait jamais ; Sam ne répondait pas aux questions. Il se contentait d’attendre et d’écouter, et Sam se mettait à parler. Il parlait des anciens jours et de la famille qu’il n’avait jamais eu le temps de connaître et dont, par conséquent, il ne pouvait se souvenir (il ne se rappelait pas avoir jamais aperçu le visage de son père), et à la place de qui l’autre race à laquelle s’était heurtée la sienne pourvoyait à ses besoins sans se faire remplacer.
Et, lorsqu’il lui parlait de cet ancien temps et de ces gens, morts et disparus, d’une race différente des deux seules que connaissait l’enfant, peu à peu, pour celui-ci, cet autrefois cessait d’être l’autrefois et faisait partie de son présent à lui, non seulement comme si c’était arrivé hier, mais comme si cela n’avait jamais cessé d’arriver, les hommes qui l’avaient traversé continuaient, en vérité, de marcher, de respirer dans l’air, de projeter une ombre réelle sur la terre qu’ils n’avaient pas quittée. Et, qui plus est, comme si certains de ces événements ne s’étaient pas encore produits mais devaient se produire demain, au point que l’enfant finissait par avoir lui-même l’impression qu’il n’avait pas encore commencé d’exister, que personne de sa race ni de l’autre race sujette, qu’avaient introduite avec eux sur ces terres les gens de sa famille, n’y était encore arrivé, que, bien qu’elles eussent appartenu à son grand-père, puis à son père et à son oncle, qu’elles appartinssent à présent à son cousin et qu’elles dussent être un jour ses terres à lui, sur lesquelles ils chasseraient, Sam et lui, leur possession actuelle était pour ainsi dire anonyme et sans réalité, comme l’inscription ancienne et décolorée, dans le registre du cadastre de Jefferson, qui les leur avaient concédées, et que c’était lui, l’enfant, qui était en ces lieux l’invité, et la voix de Sam Fathers l’interprète de l’hôte qui l’y accueillait.
Jusqu’à il y avait trois ans de cela, ils avaient été deux, l’autre, un Chickasaw pur sang, encore plus incroyablement isolé dans un sens que Sam Fathers. Il se nommait Jobaker, comme si c’eût été un seul mot. Personne ne connaissait son histoire. C’était un ermite, il vivait dans une sordide petite cabane au tournant de la rivière, à cinq milles de la plantation et presque aussi loin de toute autre habitation. C’était un chasseur et un pêcheur consommé ; il ne fréquentait personne, blanc ou noir ; aucun nègre ne traversait même le sentier qui menait à sa demeure, et personne, excepté Sam, n’osait approcher de sa hutte. »
Jobaker décédé, Sam se retire au Grand Fond, et prépare l’enfant à son premier cerf :
« …] l’inoubliable impression qu’avaient faite sur lui les grands bois – non point le sentiment d’un danger, d’une hostilité particulière, mais de quelque chose de profond, de sensible, de gigantesque et de rêveur, au milieu de quoi il lui avait été permis de circuler en tous sens à son gré, impunément, sans qu’il sache pourquoi, mais comme un nain, et, jusqu’à ce qu’il eût versé honorablement un sang qui fût digne d’être versé, un étranger. »
« …] la brousse […] semblait se pencher, se baisser légèrement, les regarder, les écouter, non pas véritablement hostile, parce qu’ils étaient trop petits, même ceux comme Walter, le major de Spain et le vieux général Compson, qui avaient tué beaucoup de daims et d’ours, leur séjour trop bref et trop inoffensif pour l’y inciter, mais simplement pensive, secrète, énorme, presque indifférente. »
L’ours :
« Cette fois, il y avait un homme et aussi un chien. Deux bêtes, en comptant le vieux Ben, l’ours, et deux hommes, en comptant Boon Hogganbeck, dans les veines de qui coulait un peu du même sang que dans celles de Sam Fathers, bien que celui de Boon en fût une déviation plébéienne et que seul celui du vieux Ben et de Lion, le chien bâtard, fût sans tache et sans souillure. »
Cet incipit railleur de Faulkner dénote les conceptions de l’époque sur les races et la pureté du sang.
Ce récit et le précédent, dont il constitue une variante, une reprise et/ou une extension, sont un peu dans la même veine que London. Ils m’ont impressionné par la façon fort juste dont sont évoqués le wild, la wilderness, la forêt sauvage (la « brousse »), « la masse compacte quoique fluide qui les entourait, somnolente, sourde, presque obscure ». Ben, le vieil ours qui « s’était fait un nom » et qui est traqué, Sam et « le grand chien bleu » laisseront la vie dans l’ultime scène dramatique.
Puis Ike, devenu un chasseur et un homme, refuse la terre héritée de ses ancêtres, achetée comme les esclaves (depuis affranchis) ; se basant sur les registres familiaux, il discourt sur la malédiction divine marquant le pays.
Automne dans le Delta : Ike participe une fois encore à la traditionnelle partie de chasse de novembre dans la « brousse », qui a reculé avec le progrès états-unien, et il se confirme que Faulkner est, aussi, un grand auteur de nature writing.
« …] rivières Tallahatchie ou Sunflower, dont la réunion formait le Yazoo, la Rivière du Mort des anciens Choctaws – les eaux épaisses, lentes, noires, sans soleil, presque sans courant, qui, une fois l’an, cessaient complètement de couler, remontaient alors leur cours, s’étalant, noyant la terre fertile, puis se retiraient la laissant plus fertile encore. »
« Car c’était sa terre, bien qu’il n’en eût jamais possédé un pied carré. Il ne l’avait jamais désiré, pas même après avoir vu clairement son suprême destin, la regardant reculer d’année en année devant l’attaque de la hache, de la scie, des chemins de fer forestiers, de la dynamite et des charrues à tracteur, car elle n’appartenait à personne. Elle appartenait à tous : on devait seulement en user avec sagesse, humblement, fièrement. »
La chasse est centrale, avec son ancrage ancestral, son initiation, son folklore, son narratif, et son éthique (c’est le vieil Ike qui parle) :
« Le seul combat, en quelque lieu que ce soit, qui ait jamais eu quelque bénédiction divine, ça a été quand les hommes ont combattu pour protéger les biches et les faons. »
Descends, Moïse : mort d’un des derniers Beauchamp.
Les personnages fort typés mis en scène dans ce recueil se rattachent à la formidable galerie des figures faulknériennes ; ainsi apparaissent des Sartoris, des Compson, et même Sutpen d’Absalon ! Absalon !.
Ces épisodes d’apparence indépendants me semblent former, plus qu’un puzzle, un archipel des évènements émergents d’un sang dans la durée.
\Mots-clés : #colonisation #discrimination #esclavage #famille #identite #initiatique #lieu #nature #portrait #racisme #religion #ruralité #social #violence
- le Mer 2 Aoû - 13:36
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William Faulkner
- Réponses: 103
- Vues: 12115
Gerald Basil Edwards
Le livre d'Ebenezer Le Page
Le narrateur, le vieil Ebenezer Le Page, présente d’abord ses antécédents.
« Il est dit dans la Bible : « Regarde la pierre dans laquelle tu as été sculpté et le puits dont tu fus extrait. » Eh bien, ces gens sont la pierre dans laquelle j’ai été sculpté et le puits dont j’ai été extrait. Je n’ai pas parlé de mes cousins, ou des cousins de mes cousins, mais il faut dire que la moitié des gens de l’île sont mes cousins, ou les cousins de mes cousins. »
« C’est ça l’ennui, dans le fait d’écrire la vraie histoire de ma famille, ou la mienne, d’ailleurs. Je n’en connais ni le commencement ni la fin. »
Et c’est, plus qu’un roman et/ou autobiographie (ou plutôt une autofiction ?), une histoire de famille autant qu’une chronique de Guernesey (Sarnia en latin) de la fin du XIXe siècle au début des années 1960, tant la parentèle est importante dans ce milieu insulaire. De même, c’est toute l’époque qui est revisitée.
Souvenirs précis rapportés en détail par un vieillard évidemment nostalgique, manifestement doué d’un caractère entier. Simple pêcheur et producteur de légumes en serre, Ebenezer est observateur, et n’aime pas le changement dans l’île qu’il n’a guère quittée pendant près d’un siècle :
« Dieu a doté cette île d’un bon sol et d’un bon climat, particulièrement propres à faire pousser des fruits, des légumes et des fleurs, et à engendrer deux sortes de créatures : les vaches de Guernesey et les gens de Guernesey. J’aurais cru que les États tiendraient à protéger ces espèces, mais il n’y a visiblement plus de place pour elles. »
Sa mère avec qui il vit jusqu’à sa mort (puis avec Tabitha sa sœur), Jim son ami qui mourra à la Première Guerre, et Liza, une de ses petites amies mais son seul amour et jamais accompli, se distinguent dans la foule de personnages qui sont décrits, sans plus nuire à la compréhension que les personnes inconnues évoquées dans une conversation agréable. Remarquables sont également ses deux tantes, la Hetty et la Prissy, mariées à Harold et Percy Martel (des constructeurs dans le bâtiment), et leurs fils Raymond (qui prendra une grande place dans ses affections) et Horace, dans les maisons voisines de Wallaballoo et Tombouctou : elles sont souvent aux prises l’une avec l’autre, entre chicanes et brouilles.
L’opinion d’Ebenezer (et d’autres Guernesiais) sur les femmes et le mariage explique au moins en partie qu’il soit demeuré célibataire.
« J’ai commis une grave erreur dans ma jeunesse. Je pensais à ce moment-là que les filles étaient des êtres humains comme nous, mais c’est faux. Elles sont toujours en quête de quelque chose, de votre corps, de votre argent, ou d’un père pour leurs enfants, et si ce n’est pas le cas, elles veulent quand même que vous deveniez quelqu’un ou que vous fassiez quelque chose qui leur apportera la gloire. Ça ne leur suffit jamais de vous laisser vivre et de vivre avec vous.
– Tu sais, j’ai répliqué, les hommes aussi en ont toujours après quelque chose. »
L’île est protestante, de diverses obédiences (surtout méthodistes et anglicans, mais aussi quelques catholiques ou « papistes »).
« Je dois reconnaître que dans la famille de ma mère, ils ne passaient pas leur temps à essayer de convertir tout le monde. Ils savaient qu’ils étaient dans le vrai et si les autres ne l’étaient pas, c’était leur problème. »
« Je ne sais pas ce que c’est qu’un païen, j’ai répondu, je ne peux donc pas dire si je le suis ou pas, mais je ne sais pas non plus ce qu’est un chrétien. Il y en a des milliers de toutes sortes sur cette île. Ce ne sont peut-être pas tous des dévergondés, du moins pas ouvertement, mais ils partent à la guerre et tuent d’autres gens, et en temps de paix, ils gagnent autant d’argent qu’ils le peuvent sur le dos les uns des autres et ils n’aiment pas plus leur prochain que moi. »
« La religion de ma mère est de loin la plus terrifiante dont j’ai jamais entendu parler. […] Le plus effroyable, c’est que l’endroit où l’on finirait était décidé avant même notre naissance, et qu’il n’y avait rien à y faire. »
Raymond s’est toujours senti la vocation de pasteur, mais sa conception de l’amour divin l’écarte du sacerdoce ; son destin assez dramatique en fait un personnage central, juste après Ebenezer.
« Comme je l’ai déjà dit, je n’aime pas les prêcheurs. Ils se hissent sur un piédestal et prétendent être le porte-parole de la volonté divine en vous assurant que toute autre opinion est le fruit du Diable. J’aime quand les gens disent carrément ce qu’ils pensent sur le moment et se fichent pas mal d’avoir tort ou raison. »
« « Après tout, disais-je, il y a quand même eu des progrès, tu sais. Le monde s’améliore lentement, du moins on peut l’espérer. » C’était le genre d’idée qui le mettait en rage. « Le monde s’est-il amélioré de ton temps ? demandait-il [Raymond]. – Eh bien, je ne sais pas, peut-être pas au point qu’on le remarque, je répondais. – Non, pas plus que du temps de n’importe qui d’autre ! Ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre. Le progrès, c’est la carotte pendue devant l’âne pour le faire tourner en rond. »
Relativement nombreux sont les insulaires tentés par l’émigration. La Première Guerre mondiale ne touche pas directement l’île, mais décime sa jeunesse envoyée au combat. Pendant la Seconde, c’est l’Occupation allemande, famine, et collaboration de certains.
« C’est la seule fois où il [Raymond] ait un peu parlé de la guerre. « Hitler, c’est l’Ancien Testament qui recommence, a-t-il dit. Pas étonnant qu’il déteste les Juifs. » Je ne l’ai pas compris alors, et un tas d’autres réflexions qu’il lâchait brusquement de temps à autre m’échappaient. Cette fois-là, je lui ai demandé ce qu’il entendait par là.
« Méfie-toi de ceux qui se prétendent désignés par l’Histoire ou par Dieu. Ils se sont désignés eux-mêmes. Il n’y a pas de Peuple Élu, a-t-il déclaré. – Ce n’était pas l’avis de ma mère. Elle y croyait, elle, aux Élus de Dieu. – Les communistes aussi, a-t-il rétorqué. C’est ce qu’ils appellent le Prolétariat. Les nazis les appellent les Aryens. Ça revient au même. L’État totalitaire. Rien n’est plus faux. La véritable totalité est inaccessible au cœur et à l’esprit des hommes. Au mieux, nous ne faisons que l’entrevoir. – Ça, je l’ignore, ai-je dit. Je n’en ai même jamais eu le moindre aperçu. – Ça vaut mieux que de s’imaginer qu’on sait tout, a-t-il répliqué. Dieu merci, je suis un îlien, et je ne serai jamais rien de plus. » Je me demande ce qu’il penserait s’il était encore en vie aujourd’hui. Guernesey devient chaque jour de plus en plus un État totalitaire. J’ai l’impression que c’est Hitler qui a gagné la guerre. »
« Quant à moi, je ne me sortirai pas de la tête qu’après la Libération, nous avons eu une chance unique de repartir à zéro. Mais pour je ne sais quelle raison, Guernesey a pris un mauvais tournant, même si elle n’a pas dégringolé la pente aussi vite et aussi volontiers que Jersey. La routine reprenait ses droits, mais en pire. Le chien retournait à son vomi et la truie se vautrait dans la fange. [Pierre] Il y avait sûrement autre chose à faire. Je ne sais pas quoi exactement. Je n’ai aucun droit de critiquer. Je me souviens trop bien comment, dans les pires moments, je me fichais pas mal de tout et de tout le monde, à part moi. Et je n’étais pas le seul. Si c’est bien là la vérité, alors mieux vaut encore ne pas la connaître. C’est peut-être la seule leçon qu’on ait tirée de l’Occupation, sauf que ça n’était pas la bonne. »
C’est aussi l’occasion de quelques scènes cocasses, comme les fouilles archéologiques de vestiges proches des Moulins, où Ebenezer demeure. Malgré ses nombreuses préventions de casanier misanthrope, Ebenezer noue étonnamment des liens d’amitié avec des « ennemis », un Jersiais catholique, un occupant allemand : c’est apparemment la personne qui compte pour lui, pas son appartenance.
« Se battre, forniquer et gagner de l’argent sont les choses les plus faciles au monde. Ayant moi-même pratiqué les trois, je sais de quoi je parle. Je continue à gagner de l’argent comme je peux. Quand on a commencé, on ne peut plus s’arrêter. Cet argent m’en rapporterait lui-même encore plus si je l’avais mis à la banque et touchais les intérêts tous les ans. « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l’abondance mais à celui qui n’a pas, on ôtera même ce qu’il a. » [Matthieu] L’ennui, maintenant que je l’ai, c’est que je ne sais pas quoi en faire. Je ne vivrai pas éternellement et il faut bien que je le lègue à quelqu’un. J’ai dû parcourir plusieurs centaines de kilomètres ces dernières années pour rendre visite à des parents plus ou moins éloignés à la recherche d’un héritier valable. »
Ebenezer parvient finalement à se trouver un digne héritier, Neville Falla, qui plus jeune avait cassé des vitres de sa serre, a gardé une réputation de voyou et est devenu un peintre enthousiaste.
« Je me suis dit que c’était lui l’ancêtre et moi le jeune, car de nos jours les enfants naissent déjà vieux et c’est à nous, les anciens, de leur apprendre à retrouver leur jeunesse. »
« De nos jours, quand on discute avec les gens, rien n’existe à moins que la télé en ait parlé. Elle donne aux gens l’impression d’avoir tout vu et de tout savoir, alors qu’ils n’ont jamais rien vu et ne savent rien. C’est la drogue la plus nocive au monde. Les gens poussent de grands cris indignés quand les jeunes fument de l’herbe. Mais la télévision est l’herbe de millions de drogués qui, les yeux ronds, la regardent tous les soirs. »
J’ai lu sans ennui ces quelques 600 pages, et sans doute leur charme tient aux grandes justesse et humanité dans le rendu, à tel point que le lecteur peine à croire à une fiction. Style conventionnel, jusqu’au relatif happy end en passant par un respect global de la chronologie. Mention spéciale pour les trop rares expressions en guernesiais, proche du normand.
\Mots-clés : #historique #identite #insularite #lieu #religion #ruralité #temoignage #vieillesse #xxesiecle
- le Mer 31 Mai - 13:32
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Gerald Basil Edwards
- Réponses: 3
- Vues: 284
Joe Wilkins
La Montagne et les Pères
Souvenirs d’enfance à la ferme retirée dans le Big Dry, dans l’est du Montana, du côté de Melstone dans le comté de Musselshell, une contrée où la vie est dure.
« Les serpents compliquent et présagent, ils se déplacent comme un vent rampant, ils se cachent à découvert. »
Élevage ou chasse, « Dans le Big Dry, il fallait tuer pour vivre »…
Le grand-père maternel et ses histoires (qui auront un rôle déterminant dans son existence : les « fragments du corps de mon grand-père ») ; sa mère, indépendante et engagée, démocrate (on est principalement républicain dans la région, et profondément croyant).
« Chaque année, songe-t-elle, un peu plus vieille, un peu plus moi-même. »
Et son père, ce roc mourant d’un cancer quand il a neuf ans.
Les amis paternels, pêcheurs et chasseurs, puis sa grand-tante, lithographe à Billings, ensuite le professeur qui un temps comble son besoin de père. Un autre enseignant marquant, et les livres ; et les rêves d’ailleurs.
Sécheresse, inondation, incendie, sauterelles… Alcool, armes à feu… Le ranch du grand-père, que seul son père aurait su gérer, est vendu. Beaucoup de fermiers perdent leurs terres.
« La terre du Big Dry était mauvaise, mais nous faisions de notre mieux pour la rendre fertile.
Nous canalisions la rivière pour irriguer, nous abattions les peupliers et labourions jusqu’au lit de la rivière, nous disposions des bidons usagés d’huile à moteur pour piéger les sauterelles. Nous aspergions les champs pour éliminer les centaurées et les graminées, nous fertilisions et irriguions et arrosions de désherbant le chiendent. Nous passions des nuits entières dans la bergerie à extraire des agneaux en siège, nous vermifugions et vaccinions et écornions, nous donnions à manger des tonnes et des tonnes de maïs. Et quand rien de tout cela ne fonctionnait, quand les foins brûlaient toujours au soleil et que les sauterelles s’abattaient sur les cultures tel le septième sceau de l’Apocalypse, et que les moutons n’avaient plus que la peau sur les os sous le ciel brûlant, quand ces mauvaises terres prenaient malgré tout le dessus sur nous, alors nous priions. Et quand les prières étaient inefficaces, nous blasphémions. Puis nous jetions les cadavres dans la fosse à ossements et retentions notre chance – plus sérieusement encore, cette fois, nos rouages graissés par une nouvelle dose de bile.
Même si c’était bien fait, on ne pouvait pas appeler ça gagner sa vie ; ce n’était qu’une série d’agonies ritualisées. Et ce n’est pas pour dénigrer un mode d’existence. C’est simplement pour dire les choses telles qu’elles sont. Vivre de la terre, n’importe quelle terre, est difficile. Vivre de ces mauvaises terres, cette partie de plaines d’altitude le long des contreforts orientaux des Rocheuses qu’on appelait jadis le Grand Désert Américain, était presque impossible. Surtout quand les lois agricoles ont changé sous Nixon et Reagan, quand nous sommes passés d’un élevage de moutons, de vaches et de poules, d’une culture de blé, de froment et d’avoine et d’un peu tout, à l’élevage de vaches et la culture de maïs, point final. C’est environ à cette époque aussi que les étés se sont faits plus longs et les hivers plus courts, que les torrents printaniers qui alimentaient autrefois les ravines se sont asséchés. Et même à ce moment-là, nous n’avons rien cherché à changer. Nous ne nous sommes pas défendus ni instruits. Nous nous sommes contentés de plier et de nous endurcir, de travailler davantage – davantage d’emprunts à la banque, davantage d’hectares pâturés jusqu’à la terre nue, davantage de produits chimiques dispersés à travers la région. »
« C’était une violence lente et psychologique. Et la plupart d’entre eux retournèrent cette violence contre eux-mêmes. »
« À la télévision, les politiciens évoquaient ce projet-ci ou celui-là, afin de venir en aide à l’Amérique rurale, mais quelqu’un avait parfaitement compris de quoi il retournait : on mit en service une permanence téléphonique contre le suicide dédiée spécifiquement aux fermiers et aux exploitants ruinés, obligés de vendre, qui se trouvaient soudain piégés dans un monde qu’ils ne reconnaissaient pas. »
« Reprenons donc : comment tout débute avec les caprices du vent et de la nécessité, ou peut-être juste dans un bref instant de stupidité ; comment l’échec et la honte, en l’espace d’une seconde, deviennent si impossiblement lourds, un sac de pierres qu’il faut hisser sur son épaule ; comme ils se muent en peur ; et comme la peur éclate un jour en vous – une lente implosion, une détonation à vous briser la nuque.
Ce n’est pourtant pas ainsi que doivent forcément se passer les choses. Nous échouerons, nous continuerons à agir parfois sans raison valable, nous porterons à jamais le fardeau de l’échec et de la honte – mais c’est là, me semble-t-il, que tout peut changer : il existe une sorte de fascination terrible et facile, proche de la peur mais qui n’est pas de la peur. C’est le fait de comprendre le sang qui sèche sur nos mains, le paquet de viande emballée par nos soins qu’on sort du congélateur. C’est accepter la beauté habituelle de nos journées, c’est respecter le labeur de subsistance. C’est comprendre qu’il n’est pas nécessaire de posséder la terre pour être issus de la terre, c’est admettre que nous vivons tous sur ces terres et que nous assumons la responsabilité de cette violence infligée au sol par nos simples existences. C’est reconnaître combien les histoires nous trompent, combien les histoires nous sauvent. C’est d’avoir entendu les deux versions et, dans nos instants d’intenses difficultés, c’est de conter l’histoire qui nous sauvera. »
« Loin dans la prairie, la malchance et les mauvais choix ne faisaient qu’un, l’échec était l’unique péché impardonnable, car nous devions avoir une foi inébranlable en notre capacité à vivre de ces terres ingrates. Nous devions croire que c’était possible, que ce n’était pas de la folie. […]
Nous tournions donc le dos à toute forme d’échec, nous n’accusions ni le projet, ni le vent, ni les nécessités, mais la personnalité des participants. »
D’où le refus de toute forme d’assistance gouvernementale.
À mi-chemin de l’autobiographie et du témoignage, Joe Wilkins rapporte une à une, grosso modo chronologiquement, des scènes qui lui restent, parfois de brefs instantanés. Vers la fin du livre, il développe ses réflexions sur ses difficultés d’intégration et surtout celles de la région.
\Mots-clés : #autobiographie #enfance #famille #lieu #nature #ruralité #viequotidienne #xxesiecle
- le Dim 28 Mai - 13:49
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Joe Wilkins
- Réponses: 9
- Vues: 451
Panait Istrati
Les Chardons du Baragan
Incipit :
« Quand arrive septembre les vastes plaines incultes de la Valachie danubienne se mettent à vivre, pendant un mois, leur existence millénaire. »
C’est le baragan, plaine continentale roumaine, « ogre amoureux d’immensité inhabitable » et « assoiffé de solitude », désert où ne poussait que les chardons, qui secs étaient emmenés par le Crivatz (vent froid), comme les virevoltants ou tumbleweeds des westerns.
À neuf ans, le narrateur y part avec son père, dans l’objectif de vendre le poisson qui abonde chez eux, et manque ailleurs.
« Bon pays, mauvaise organisation :
Sacré nom d’un règlement !
C’était cela : un pays riche, mal organisé et mal gouverné ; ma mère le savait comme tout paysan roumain. »
Mais l’expédition est un échec, la mère décède, et à quatorze ans Mataké se sépare de son père pour partir à l’aventure derrière les « petites meules de broussaille » avec son ami Brèche-Dent : il réalise le rêve de tous les enfants, s’évader « à la découverte du monde », « quitter la maison et s’en aller par le monde ».
Ils sont recueillis comme argats [« Valets de ferme »] dans une famille paysanne miséreuse (peut-être les cojans, terme récurrent mais non explicité, comme trop d’autres).
« Sous un ciel si terreux qu’on eût dit la fin du monde, on voyait les chars avancer comme des tortues, sur des champs, sur des routes, sur une terre que Dieu maudissait de toute sa haine. Chars informes ; bêtes rabougries ; hommes méconnaissables ; fourrage boueux ; et aucune pitié nulle part, ni au ciel ni sur la terre ! Nous avions pourtant besoin de pitié divine autant que de pitié humaine, car les chars s’embourbaient ou se renversaient ; car les bêtes tombaient à genoux et nous demandaient grâce ; car les hommes battaient les bêtes et se battaient entre eux ; car les ciocani [« Tiges de maïs, dont les feuilles servent de fourrage et le déchet de combustible »] pourrissaient dans les mares et il fallait en transporter les gerbes à dos d’homme, à dos de femme, à dos d’enfant, et ces hommes, ces femmes, ces enfants n’étaient plus que des tas de hardes imbibées de boue, de grosses mottes de terre pantelante sous l’action de cœurs inutiles.
Tels étaient les paysans roumains, à l’automne de 1906. »
Mataké est tombé amoureux de Toudoritza, ma belle demoiselle éconduite par son amoureux à cause du boyard. Grand nettoyage (deux fois par an, pour Pâques et Noël) :
« Nous vidâmes deux pièces, en entassant les meubles dans une troisième. Au milieu de la tinda, trois brouettes de glaise jaune comme le safran et une brouette de crottin de cheval furent versées avec de l’eau chaude par-dessus, et je fus chargé de piétiner le lut sur le sol des chambres dont Toudoritza badigeonnait les murs en chantant à tue-tête. Elle s’était affublée de vieux vêtements de sa mère ; complètement enfouie, chevelure et visage, sous une grande basma qui ne laissait voir que ses beaux yeux, et armée d’une brosse à long manche, elle couvrait murs et plafond de cette couche de chaux bleuâtre qui fait la joie et la santé du paysan roumain et que connaissent seuls les villages balkaniques. Le badigeonnage fini, ce fut le tour du sol. Le temps de fumer une pipe, il se fit aussi lisse qu’une table, sous les mains adroites de Toudoritza qui le nivelait en marchant à reculons.
Une semaine durant, nous vécûmes une vie de rescapés, couchant un soir ici, le lendemain là, comme ça se trouvait, et mangeant sur le pouce, dans une atmosphère de salle de bain turc dont la vapeur, sentant la chaux et la bouse, nous piquait le nez. »
Mais une mauvaise récolte suscite une famine qui désespère les paysans.
« Soudain, une nouvelle tomba dans le village, comme l’éclair d’une explosion. En Moldavie, les paysans avaient brûlé le konak du grand fermier juif Ficher ! C’est M. Cristea qui nous lut cette nouvelle, dans un journal. Et ce journal concluait : « Cela apprendra aux Juifs à exploiter les paysans jusqu’au sang. À bas, à bas les Juifs ! »
Les cojans qui écoutaient se regardèrent les uns les autres :
– Quels Juifs ? Dans notre département il n’y en a pas ! Et même ailleurs, ils n’ont pas le droit d’être propriétaires ruraux. Or, les fautifs, ce sont les propriétaires, non les fermiers.
À ces paroles, toutes les faces se tournèrent du côté du konak. »
Et les villageois révoltés brûlent le konak. (Un konak est un palais, une grande résidence en Turquie ottomane ; il doit en être de même ici, à propos de la demeure du boyard.) La bourgade est bombardée par l’armée, c’est un massacre.
Outre le témoignage sur une Roumanie rurale misérable et l’insurrection de 1907, ainsi que ses charmes de conte, ce roman offre un éclairage original sur le goût du départ et l’émigration.
\Mots-clés : #historique #lieu #misere #ruralité #temoignage
- le Ven 17 Fév - 12:24
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Panait Istrati
- Réponses: 20
- Vues: 1364
Jules Romains
Les Hommes de bonne volonté« Les Hommes de bonne volonté », c’est 27 livres, 779 chapitres, des milliers de pages mettant en scène des dizaines de personnages pendant une génération, précisément du 6 octobre 1908 au 6 octobre 1923.
Par cette vaste fresque romanesque qui se place dans la continuité des entreprises de Balzac et de Zola, Jules Romains a tenté de dresser un panorama de la France de la Belle Epoque à l’entre-deux-guerres. Son entreprise est toutefois différente de celle de ses illustres prédécesseurs par un plan d’ensemble rigoureusement construit avec interaction entre eux des personnages dans les différents ouvrages.
A la différence de Proust, il ne faut pas chercher chez Romains une analyse psychologique poussée des personnages qui illustrent plutôt des types sociaux. Plus que la psychologie, c’est l’histoire qui intéresse l’auteur. De même, l’individu n’est plus au centre de la narration qui est constituée d’un conglomérat de différents points de vue en un temps donné, ceci afin de rendre compte au mieux de la diversité du monde réel. Tout ceci se résume dans une théorie à caractère spiritualiste, l’unanimisme, la croyance en une entité supérieure collective dans laquelle viendrait se fondre les différentes individualités. Ainsi, les hommes de bonne volonté pourraient infléchir le cours de l’Histoire.
Ces conceptions ont aujourd’hui un peu vieilli. N’empêche, « Les Hommes de bonne volonté » constitue un passionnant tableau de la société pendant le premier quart du XXe siècle.
Il s’agit pour moi d’une relecture.
Les Hommes de bonne volonté
1 - Le 6 octobre

Ce premier volume se passe à Paris dans la seule journée du 6 octobre 1908. Du matin au soir, nous faisons connaissance avec quelques personnages qui vont occuper le devant de la scène : les Saint-Papoul, noblesse traditionnelle dans leur hôtel particulier du faubourg Saint-Germain, le député Gruau prévoyant d’interpeller la Chambre sur les concussions des pétroliers, ignorant que sa compagne spécule sur le sucre. Nous croisons l’instituteur Clanricart, soucieux des risques de guerre, l’inquiétant relieur Quinette chez qui vient se refugier un homme maculé de sang. Dans un très beau chapitre, nous suivons le petit Léon Bastide courant avec son cerceau dans les rues de Montmartre.
Le véritable héros du livre c’est Paris. Il y a un vrai amour de la capitale que Jules Romains décrit avec lyrisme.
Quelques extraits pour mieux en rendre compte :
« Les gens s’en vont, marchent droit devant eux avec une assurance merveilleuse. Ils ne semblent pas douter un instant de ce qu’ils ont à faire. L’autobus qui passe est plein de visages non pas joyeux, sans doute, ni même paisibles, mais, comment dire ? justifiés. Oui, qui ont une justification toute prête. Pourquoi êtes-vous ici, à cette heure-ci ? Ils sauront répondre. »
« L’enduit de la muraille est très ancien. Il a pris la couleur qui est celle des vieilles maisons de la Butte, et que les yeux d’un enfant de Montmartre ne peuvent regarder sans être assaillis de toutes les poésies qui ont formé son cœur. Un couleur qui contient un peu de soleil champêtre, un peu d’humidité provinciale, d’ombre de basilique, de vent qui a traversé la grande plaine du Nord, de fumées de Paris, de reflets de jardin, d’émanation de gazon, de lilas et de rosiers."
« Puis la trêve de l’Exposition Universelle, avec des bruits de danses, et des coudoiements de nations, curieuses les unes des autres, mais sans amitié, comme des estivants qui se rencontrent sur une plage. L’aurore du siècle, trop attendue, fatiguée d’avance, trop brillante, traversée de lueurs fausses, et que les formidables stries de la guerre, dans les premières heures d’après, étaient venues charger. »
« Alors, les lycéens, dans les salles d’étude, mordillant leur porte-plume ou fourrageant leurs cheveux, suivaient les derniers reflets du jour chassés par la lumière du gaz sur la courbure miroitante des grandes cartes de géographie. Ils voyaient la France toute entière ; Paris posé comme une grosse goutte visqueuse sur la quarante-huitième parallèle, et le faisant fléchir sous son poids : ils voyaient Paris bizarrement accroché à son fleuve, arrêté par une boucle, coincé comme une perle sur un fil tordu. On avait envie de détordre le fil, de faire glisser Paris en amont jusqu’au confluent de la Marne, ou en aval, aussi loin que possible vers la mer. »
« Il y avait la ligne de la richesse qui courait comme une frontière mouvante et douteuse, souvent avancée ou reculée, sans cesse longée ou traversée par un va-et-vient de neutres et de transfuges, entre les deux moitiés de Paris dont chacune s’oriente vers son pôle propre ; le pôle de la richesse qui depuis un siècle remonte lentement de la Madeleine vers l’Etoile ; le pôle de la pauvreté, dont les pâles effluves, les aurores vertes et glacées oscillaient alors de la rue Rébaval à la rue Julien-Lacroix. Il y avait la ligne des affaires qui ressemblait à une poche contournée, à un estomac de ruminant accroché à l’enceinte du Nord-Est, et pendant jusqu’au contact du fleuve. C’est dans cette poche que les forces de trafic et de la spéculation venaient se tasser, se chauffer, fermenter l’une contre l’autre. Il y avait la ligne de l’amour charnel, qui ne séparait pas, comme la ligne de la richesse, deux moitiés de Paris de signe contraire ; qui ne dessinait pas, non plus, comme la ligne des affaires, les contours et les renflements d’un sac. Elle formait plutôt une sorte de traînée ; elle marquait le chemin phosphorescent de l’amour charnel à travers Paris, avec des ramifications, ça et là, des aigrettes ou de larges épanchements stagnants. Elle ressemblait à une voie lactée.
Il y avait la ligne du travail la ligne de la pensée, la ligne du plaisir… »
\Mots-clés : #historique #lieu #social
- le Jeu 29 Déc - 18:13
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jules Romains
- Réponses: 2
- Vues: 143
Mia Couto
L'Accordeur de silences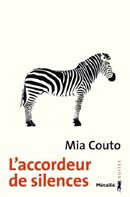
À trois ans, à la mort de sa mère, Mwanito, le narrateur, fut emmené avec son frère aîné Ntunzi par son père, Silvestre Vitalício, à Jésusalem, ainsi qu’il baptise cette concession de chasse abandonnée (au Mozambique). Assez dément, utopique voire mystique et surtout fort autoritaire, le vieux prêche qu’ils sont les derniers survivants du monde disparu, « les uniques et derniers hommes » avec le domestique et ancien militaire Zacaria Kalash, du corps duquel ressortent les balles (l’écho de la guerre demeure constamment), et en périphérie Oncle Aproximado, le boiteux.
« Un jour, Dieu viendra nous demander pardon. »
« Des attentes. Voilà ce que ramène la route. Et ce sont les attentes qui font vieillir. »
Mwanito, qui n’a pas le droit de lire et d’écrire, est l’accordeur de silences.
« J’écris bien, silences, au pluriel. Oui, car il n’est pas de silence unique. Et chaque silence est une musique à l’état de gestation. »
Ntunzi, qui a gardé des souvenirs du monde et de Dordalma leur mère, rêve de fuite et se révolte contre le père, qu’il accuse de l’assassinat de cette dernière, père qui pourtant l’encourage « dans l’art de raconter des histoires ».
« Silvestre pensait qu’une bonne histoire était une arme plus puissante qu’un fusil ou un couteau. »
Saudade, lyrisme onirique et poétique, folie qui rappellent fortement le réalisme magique latino-américain, notamment dans sa proximité avec les morts toujours présents. Fantastique funèbre : il était impossible de creuser la tombe de Dordalma, que le vent remblayait sans cesse. Mais ce roman me ramentoit aussi, hélas, le salmigondis inspiré de Paolo Coelho…
« Les femmes sont comme des îles : toujours lointaines mais éclipsant toute la mer alentour. »
(Le statut de la femme est questionné, souvent maternelle ou vue comme « pute ».)
Jezibela, l’ânesse qu’aime (physiquement) Silvestre, donne le jour à un anon-zèbre, que ce dernier étouffera à la naissance.
Dans la grande maison, anciennement celle de l’administration et interdite d’accès depuis leur arrivée, survient un soir d’orage une Portugaise, Marta, sur les traces de son amour disparu en Afrique, son mari Marcelo ; c’est ce qu’apprend Mwanito en lisant son journal intime, pour qui c’est la première femme rencontrée. Elle l’attire comme une mère, et Ntunzi en tant que femme.
« Et il me raconta ce que disait notre oncle. Que dans ces pays on n’avait même pas besoin de travailler : les richesses étaient à disposition, il suffisait juste de remplir les bons formulaires.
– Je vais circuler en Europe, bras dessus bras dessous avec la femme blanche. »
« Tout cela, je le dois à ton père, Silvestre Vitalício. Je l’ai condamné pour vous avoir traîné dans un désert. Pourtant, la vérité, c’est qu’il a instauré son propre territoire. Ntunzi dirait que Jésusalem se fondait sur une supercherie créée par un malade. Oui, c’était un mensonge. Cependant, puisque nous devons vivre dans le mensonge, que ce soit dans notre propre mensonge. Finalement, le vieux Silvestre ne mentait pas tant que ça dans sa vision apocalyptique. Parce qu’il avait raison : le monde prend fin quand on n’est plus capable de l’aimer.
Et la folie n’est pas toujours une maladie. Parfois, c’est un acte de courage. Ton père, cher Mwanito, a eu ce courage qui nous manque. Quand tout était perdu, il a tout recommencé à nouveau. Quand bien même ce tout ne représentait rien pour les autres.
Voilà la leçon que j’ai apprise à Jésusalem : la vie n’a pas été faite pour être petite et brève. Et le monde pour être mesuré. »
Suivent divers rebondissements, dont l’apparition du personnage de Noci, amante de Marcello puis d’Aproximado (et enfin de Mwanito), ainsi que le départ de Jésusalem pour un retour en ville. Est révélée la fin de Dordalma, qui s’était enfuie le temps d’être victime d’un viol collectif et, ramenée par Silvestre, de se pendre ; Ntunzi, « ombre », est le fils de Zacaria.
« À la maison, Dordalma n’était jamais plus que de la cendre, éteinte et froide. Les années de solitude et de manque de confiance l’habilitèrent à n’être personne, simple indigène du silence. Infiniment de fois, cependant, elle se vengeait face au miroir. Et là, devant la coiffeuse, elle se gonflait d’apparences. On aurait dit, je ne sais pas, un cube de glace dans un verre. Disputant la surface, trônant à la première place jusqu’au moment de retourner à l’eau. »
Drame, absence, exil et culpabilité, passé et oubli, déni ou fuite, cet étrange et dense roman me laisse partagé quant à ses prodiges et son ton baroque.
\Mots-clés : #culpabilité #initiatique #lieu #mort #religion
- le Lun 21 Nov - 10:22
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Mia Couto
- Réponses: 11
- Vues: 1856
Edwin Abbott Abbott
Flatland
Dans ce monde à deux dimensions, toutes les figures géométriques se résument "de profil" à une ligne. Les habitants (à part les femmes qui ne sont que des « Lignes Droites ») sont des figures qui s’hiérarchisent des anguleux triangles irréguliers au cercle en passant par les polygones.
« Si les Triangles extrêmement pointus de nos Soldats sont redoutables, on n'aura aucune peine à en déduire que nos Femmes sont plus terribles encore. Car si le Soldat est un coin à fendre, la Femme étant, pour ainsi dire, toute en pointe, du moins aux deux extrémités, est un aiguillon. Ajoutez à cela le pouvoir de se rendre pratiquement invisible à volonté, et vous en conclurez qu'à Flatland une Femelle est une créature avec laquelle il ne fait pas bon plaisanter. »
« Dans certains États, une Loi complémentaire interdit aux Femmes, sous peine de mort, de se tenir ou de marcher dans un lieu public sans remuer constamment de droite à gauche la partie postérieure de leur individu afin d'avertir de leur présence ceux qui se trouvent derrière elles ; d'autres obligent les Femmes, quand elles voyagent, à se faire suivre d'un de leurs fils, d'un domestique ou de leur mari ; d'autres encore leur imposent une réclusion totale à l'intérieur de leur foyer, sauf à l'occasion des fêtes religieuses. »
« Il ne faut donc évidemment pas irriter une Femme tant qu'elle est en état de se retourner. Quand on la tient dans ses appartements, qui sont conçus de façon à lui ôter cette faculté, on peut dire et faire ce qu'on veut ; car elle est alors réduite à une totale impuissance et ne se rappellera plus dans quelques minutes l'incident au sujet duquel elle vous menace actuellement de mort, ni les promesses que vous aurez peut-être jugé nécessaire de lui faire pour apaiser sa furie. »
« Au moins pouvons-nous, cependant, admirer cette sage disposition qui, en interdisant tout espoir aux Femmes, les a également privées de mémoire pour se rappeler et de pensée pour prévoir les chagrins et les humiliations qui sont à la fois une nécessité de leur existence et la base de notre constitution à Flatland. »
Si la femme est l’être au bas de l’échelle, elle est suivie par le soldat.
« …] et un grand nombre d'entre eux, n'ayant même pas assez d'intelligence pour être employés à faire la guerre, sont consacrés par les États au service de l'éducation. »
Les classes inférieures se reconnaissent par le « Toucher » des angles, les supérieures par « l'art de la Connaissance Visuelle », une subtile reconnaissance des variations d’ombre et de lumière ; « L'Irrégularité de Figure » est anormale, et les déviants qui ne peuvent être soignés sont généralement exterminés, quoiqu’elle suscite parfois le génie.
Le narrateur, un Carré, nous raconte comment eut lieu une « Sédition Chromatique » ou révolte des Couleurs, au cours de laquelle les classes inférieures tentèrent d’imposer une coloration des individus selon leur forme, puis nous entretient des « Cercles ou Prêtres » qui les dirigent selon la doctrine que « quelque déviation par rapport à la Régularité parfaite » est déficiente ou faute, basée sur le principe « la Configuration fait l'homme ».
« …] ne faisant rien eux-mêmes, ils sont la Cause de tout ce qui vaut la peine d'être fait et qui est fait par les autres. »
Dans la seconde partie, Autres mondes, il rêve de « Lineland, le Pays de la Ligne », « les Petites Lignes étant des Hommes et les Points des Femmes » ; la reproduction y est assurée par le biais de l’ouïe, grâce aux voix, celle de la bouche et celle de derrière.
« Hors de son Monde, ou de sa Ligne, tout se réduisait à un vide absolu ; non pas même à un vide, car le vide sous-entend l'Espace ; disons plutôt que rien n'existait. »
Puis il reçoit la visite d’un Étranger de l’Espace, c'est-à-dire du Pays des Trois Dimensions, qui met le doigt sur le paradoxe de Flatland :
« Mais le fait même qu'une Ligne soit visible implique qu'elle possède encore une autre Dimension ? »
C’est une Sphère, un solide, qui tente de lui expliquer, puis l’emmène dans Spaceland – où, à peine rencontré un Cube, le Carré s’enquiert de la Quatrième Dimension…
Il découvre aussi « Pointland, le Pays du Point où il n'y a pas du tout de Dimensions », où le seul résident jouit comme un Dieu « dans l'ignorance de son omniprésence et de son omniscience ».
Puis, emprisonné pour avoir voulu répandre l’Évangile de la Troisième Dimension en Flatland, il rédige ce récit.
\Mots-clés : #absurde #lieu #politique #religion #satirique #science #social
- le Jeu 17 Nov - 11:30
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Edwin Abbott Abbott
- Réponses: 2
- Vues: 283
Mark Twain
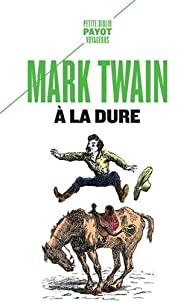
A la dure
J'aurais mis le temps pour revenir partager quelques mots sur ce livre, et si je vais faire court ce sera néanmoins de bon coeur.
Pour faire injsutement synthétique qu'ai je trouvé dans ce livre :
- une lecture divertissante, pleine d'humour
- un mélange de récit de voyage et d'aventure
- un stupéfiant panorama d'images des mythes américains
De la ruée vers l'or à Hawaii, San Francisco, de galeries de personnages en péripéties improbables, c'est baignés de bonne humeur que l'on voyage au fil de ce journal. Et les images fortes que l'on parcourt sont d'étonnants échos à nos visions de films si ce n'est d'actualités et d'étrangetés d'outre atlantique.
Le ton y est pour beaucoup mais la matière vaut le détour. Super lecture avec des moments incroyables !
Mots-clés : #aventure #humour #lieu #voyage #xixesiecle
- le Dim 9 Oct - 13:04
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Mark Twain
- Réponses: 34
- Vues: 3097
Barbara Kingsolver

Résumé :
Nathan Price, pasteur baptiste américain au fanatisme redoutable, part en mission au Congo belge en 1959 avec sa femme et ses quatre filles. Ils arrivent de Géorgie dans un pays qui rêve d'autonomie, et de libertés. Tour à tour, la mère et les quatre filles racontent la ruine tragique de leur famille qui, même avec sa bonne volonté et ses croyances de fer, ne résiste à rien, ni à la détresse, ni aux fourmis, ni aux orages... ni aux Saintes Écritures.
Un roman absolument magnifique, fabuleux, tragique, ambitieux, émouvant, avec des pointes d'humour cependant....et extrêmement intéressant sur la colonisation et ses dérives....tout ceci se passe au Congo Belge....devenu la RDC. Juste au moment de l'indépendance et de ses conséquences tant pour cette famille nouvellement installée que pour les congolais pris entre deux clans avec des conséquences terribles.
La vie mouvementée de cette famille transportée de Géorgie dans un village perdu du Congo à seule fin de convertir un maximum de ces âmes perdues selon Nathan Price, le Pasteur, époux de Orléanna, et père de quatre filles : Rachel, l'aînée, Adah et Leah deux soeurs jumelles et Ruth la petite dernière. Toutes subissent son emprise, sa main de fer, il n'hésite pas à les frapper... totalement obsédé par sa "mission de sauveur".
L'histoire qui se déroule est contée par les voix d'Orleanna, de Rachel, d'Adah, de Leah et de Ruth May tour à tour...
Quelques extraits pris au hasard :
Adah :
Il fallut moins d'un mois à notre maisonnée pour sombrer dans le chaos le plus complet. Nous dûmes supporter la rage montante de Père quand, de retour à la maison, il constatait que le dîner n'en était encore qu'au stade de la discussion : celui de savoir si oui ou non il y avait des asticots dans la farine, voire de la farine tout court. Son mécontentement ayant atteint un point de non-retour, nous pansâmes toutes trois nos blessures et nous nous convoquâmes mutuellement à un genre de sommet féminin. A la grande table de bois sur laquelle nous avions passé tant d'heures fastidieuses à étudier l'algèbre et le Saint-Empire romain, nous étions maintenant installées afin de déterminer nos priorités.
"La première chose, c'est de faire bouillir l'eau, quelles que soient les circonstances, annonça Rachel, notre aînée. Tu notes, Adah. Parce que si nous ne la faisons pas bouillir pendant trente minutes, nous allons attraper des plébiscites ou je ne sais quoi encore."
Dûment noté.
Ruth May
Voici ce que je vois : d’abord, la forêt. Des arbres tels des bêtes musculeuses grandies au-delà de toute raison. Des lianes qui étranglent leurs semblables dans leur lutte pour le soleil. Le glissement d’un ventre de serpent sur une branche. Un chœur de jeunes plants inclinant leurs cols surgis de souches d’arbres décomposées, aspirant la vie de la mort. Je suis la conscience de la forêt, mais souviens-toi, la forêt se dévore elle-même et vit éternellement.
Adah
Miss Betty m'a mise au coin jusqu'à la fin de l'heure afin de prier pour mon salut, à genoux sur des grains de riz secs. Quand je me suis enfin relevée, avec des grains durs enfoncés dans les genoux, j'ai découvert, à ma grande surprise, que je ne croyais plus en Dieu.
Ruth May
Je m'appelle Ruth May et je déteste le diable. Pendant très longtemps, j'ai cru que je m'appelais "Poussin". Maman dit toujours comme ça. Poussin, viens ici une minute. Poussin, s'il te plaît, je fais pas ça.
Orleanna
Je ne savais jamais si nous devions considérer la religion comme une police d'assurance-vie ou comme une condamnation à perpétuité.
Rachel
Oh mon Dieu, mon Dieu, alors ça y est, il va falloir y passer ? Ai-je pensé du Congo dès l'instant où nous y avons posé le pied. On est censés reprendre les affaires en main ici, mais moi je n'ai pas l'impression qu'on va être responsables de quoi que ce soit, ne serait-ce que de nous-mêmes.
Leah
Au début, mes soeurs s'affairaient à l'intérieur, jouant les assistantes de Mère, avec plus d'enthousiasme qu'elles n'en avaient jamais manifesté pour les travaux ménagers depuis leur naissance. Pour l'unique raison qu'elles avaient peur de mettre le nez hors de la maison. Ruth May se figurait curieusement que les voisins voulaient la manger. Quant à Rachel, elle voyait partout des serpents imaginaires pour peu qu'on l'y incite et disait : "Horreur d'horreur" en roulant des yeux et qu'elle prévoyait de passer les douze mois à venir au lit.
Voilà, un superbe roman que je recommande vivement, j'ai adoré

\Mots-clés : #colonisation #famille #lieu #religion
- le Ven 30 Sep - 9:05
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Barbara Kingsolver
- Réponses: 8
- Vues: 353
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages

