La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 23:13
69 résultats trouvés pour ecriture
Pierre Bergounioux
Carnet de notes 1980-1990
Journal commencé à la trentaine, où Bergounioux note pour s’en souvenir les faits saillants de sa vie quotidienne (y compris la météo, à laquelle il est très sensible, étant plus rural qu’urbain) entre la Corrèze et la région parisienne, minéralogie, entomologie, pêche (à la truite), peinture, modelage, travail du bois puis de la ferraille, piano, archéologie préhistorique, descriptions (paysages, oiseaux), rêves nocturnes, ennuis de santé (lui et ses proches), famille et amis, son travail d’enseignant, et surtout ses copieuses lectures (et sa bibliophilie !), ses études qu’il prolonge ainsi, et ses souvenirs d’enfance (sa « vie antérieure », jusque dix-sept ans).
« Sur les zinnias voletaient Flambés et Machaons, ainsi que l’insaisissable Morosphinx. Jamais il ne se posait. Il oscillait dans l’air au-dessus du calice des fleurs, dans lequel il plongeait sa longue et fine trompe noire. Je n’ai jamais réussi, alors, à m’en emparer. J’en étais venu à le regarder comme une créature des rêves. Je percevais avec perplexité, avec dépit, l’existence de deux ordres, l’un que nos désirs édifient spontanément, l’autre, décevant, des choses effectivement accessibles, et l’impossibilité de franchir sans dommage ni perte la frontière. Est-ce que je m’en suis ouvert à quelqu’un ? Ai-je demandé des éclaircissements à ce sujet ? Peut-être. Papa aime à répéter, sardoniquement, que je fatiguais déjà tout le monde de questions. Mais je ne garde pas souvenir d’avoir obtenu la réponse. »
« Laver, nourrir, habiller les petits nous prend un temps infini. Comme la génération qui se forme pèse sur l’âge intermédiaire où nous sommes entrés, entre la dépendance à laquelle on est réduit, quand on commence, et celle où l’on va retomber avant de finir. »
« Ensuite, je peins – approches de la ville, avec, au premier plan, un canal, puis, sans l’avoir voulu, la façade de quelque château, flanqué de masures. À l’origine, c’était un pont sur l’eau à quoi j’ai fait faire un quart de tour. Quelque chose est apparu. Je ne parviens jamais de façon concertée à un résultat. Ce qui résulte d’un dessein arrêté est d’une banalité sans remède. C’est dans un angle mort, une dimension négligée, d’abord, d’un geste involontaire, que naissent la demeure des songes, la rive inconnue, la fête mystérieuse. »
« Toujours des soulèvements d’inquiétude, des éclairs d’angoisse, la crainte soudaine, panique, que le sursis qui me tient lieu de vie va prendre fin, que l’heure a sonné. Et ma réaction immédiate, indignée : qu’il est bien tôt, que j’ai beaucoup à faire, encore, qu’il me reste à connaître, à expérimenter, à aimer. »
« Tenté, au retour, de faire des essais de drapé avec du plâtre coulé dans un sac poubelle. J’avais été frappé, en avril, lors de la construction de la terrasse, des plis et volutes du ciment tombé, frais, dans la toile plastique froissée. Le résultat est décevant. Comment pourrait-il en aller autrement, au premier essai ? Et puis il faut que je revienne à ma lecture. Si j’excepte cette occupation dévorante, infinie, j’aurais bâclé ma vie, désireux que j’étais de répondre à l’appel de mille choses et conscient, tragiquement, qu’elle est trop brève pour pouvoir m’attarder plus qu’un court instant auprès de chacune d’elles. Comment étudier, pêcher, traquer les bêtes, chercher les pierres, les fossiles, peindre, modeler, menuiser, fondre, forger, rêver, respirer, regarder de tous ses yeux, être époux et père, professeur, fils et camarade, apprendre, avancer, ne pas oublier, ne jamais céder quand je suis sous la menace chronique d’être pris à la gorge sans rémission ? »
Début 1983, Bergounioux commence à écrire de la littérature.
« Malgré la fatigue, je reprends mon récit au commencement. J’essaie de le purger des approximations, des gaucheries. Je fais des phrases trop longues. C’est un de mes vices. Je me crois tenu, par mimétisme, d’envelopper une chose dans une seule et unique coulée syntaxique alors que, justement, le registre symbolique est autonome, relativement. »
Sa vie est partagée entre deux pôles, le travail dans l’Île-de-France, la nature pendant les vacances scolaires dans le Midi – et aussi le travail professionnel versus son « bureau » où il s’échine.
Ses phares sont Flaubert, Faulkner, Beckett, mais pas les seuls auteurs appréciés.
« Je lis les Chroniques italiennes de Stendhal avec un grand bonheur. Mais il a un âcre revers. Tout ce que je pourrais écrire s’en trouve terni. »
« Ensuite, j’extrais mes dernières lectures. Mais j’ai peu de preuves à présenter au tribunal qui siège en moi et me somme, le soir, d’expliquer, si je peux, ce que j’ai fait de ma journée. »
« Dans la même nuit, nous avons brisé le sortilège qui nous condamne à l’exil aux portes de Paris, traversé quatre cents kilomètres de ténèbres et de pluie, atteint le seuil de la seule existence que je sache, du seul monde qui lui fasse écho. »
« Je ne saurais lire puisque je suis parmi les choses. »
« Je regarde une émission de la série Histoires naturelles consacrée à la pêche au sandre. Les images du bord de l’eau, la lente marche du fleuve m’exaltent et m’accablent. J’aurais pu, moi aussi, passer des jours sur la rivière, dans l’oubli miséricordieux de tout. J’ai connu ce bonheur sans soupçonner qu’il me serait retiré bientôt. J’ai eu de ces heures, sur la Dordogne, et puis j’ai découvert, à dix-sept ans, qu’il semblait permis de comprendre ce qui nous arrivait, que cela se pouvait, et j’ai cessé de vivre. »
« J’esquisse un plan, jette, dirait-on, des grains de sable dans le vide, autour desquels pourraient se former des concrétions. Il me manque toujours l’arête. Je m’en remets sur l’avancée d’apporter ses propres rails, d’engendrer sa substance. Les mots, en revanche, tombent d’eux-mêmes, épousent la vision. »
« Je n’ai toujours pas pris mon parti de ne plus m’appartenir. »
« Paris excède la mesure de l’homme, la mienne, du moins. »
« La question est de savoir s’il est préférable de vivre ou de se retirer de la vie pour tenter d’y comprendre quelque chose, qui est encore une façon de vivre, mais combien désolée, amère, celle-ci. »
« Et comme je travaille de mes mains, et que je suis ici [les Bordes, en Corrèze], mes vieux compagnons, le noir souci, la contrariété, le désespoir chronique m’ont oublié. »
« Je songe aux profonds échos que la disparition de Mamie a soulevés, aux grandes profondeurs cachées sous la chatoyante et fragile surface des jours. J’y pensais, hier matin, dans la nuit noire, quand tout dormait, et j’y pense encore. Et c’est cela, peut-être, qu’il faudrait essayer de porter au jour. C’est le moment. Les figures tutélaires de mon enfance s’en vont, sans avoir seulement soupçonné, je suppose, ce qui s’est passé et les concernait, pourtant, au suprême degré. J’ai atteint l’âge où l’on peut tenter de comprendre, de porter dans l’ordre second, distinct, de l’écrit ce qu’on a confusément senti : la vie saisie à des moments successifs qui s’éclairent l’un l’autre, à l’occasion de ces subites et brutales retrouvailles que les naissances, les décès, surtout les décès, provoquent de loin en loin, les grandes permanences et le changement, l’œuvre fatidique, effrayante du temps. »
« Je reste un très long moment à me demander si j’ai bien de quoi remplir six autres chapitres, songe à croiser les voix, donc à modifier le poids, l’importance, le sens des choses qui commandent, à leur insu, parfois, mais parfois en conscience, les agissements des générations successives, la destinée unique, reprise par trois fois, de l’individu générique, supra-individuel auquel, sous le rapport de la longue durée, s’apparente celui, périssable, en qui nous consistons. »
« C’est à la faveur de ces instants limitrophes que m’apparaissent la hâte folle, la fureur concentrée qui m’emportent depuis ma dix-septième année et m’arrachent aux instants, aux lieux, aux êtres parmi lesquels nous aurons vécu, respiré. Toujours hors de moi, la tête ailleurs, l’esprit occupé de choses qui ne sont que dans les livres, ou alors du passé ou encore des éventualités redoutables, sans doute insurmontables, qui peuplent l’avenir. Et le seul bien véritable, le présent, ses authentiques et charmants habitants, je n’en aurai pas connu le goût, la douceur, la simple réalité. »
Bergounioux s’acharne, se force à écrire chaque jour – quand il en a le loisir.
« Je lance lessive sur lessive, range tout ce qui traîne partout, descends faire quelques achats, conduis Jean à sa dernière leçon de piano de l’année. Comment travailler ? Il ne me semble pas tant faire ce qu’il paraît, les courses, de la cuisine, prendre soin des petits, enseigner, etc. que combattre l’envahissement chronique de la vie, du métier, du chagrin, de tout, afin d’avoir un peu de temps pour la table de travail, méditer, endurer les affres sans nom de la réflexion, de l’explicitation. C’est un souci de chaque instant, une hantise vieille de vingt-deux ans et qui me ronge comme au premier jour. »
« Enfoncé dans la tâche d’écrire dont j’ai retrouvé, reconnu la rudesse, l’âpreté, le tempo – la facilité toute relative du matin, les lenteurs et les pesanteurs de l’après-midi, l’hébétude où je finis. C’est d’entrée de jeu qu’il faut emporter le morceau, arracher au vide rebelle, à l’opposition de la vie au retour réflexif, le sens de ce qui a eu lieu, le chiffre des heures passées. La violence du geste inaugural, et en vérité de cette occupation contre nature, dépasse de beaucoup celle que je mobilise, à l’atelier, contre les bois durs, l’acier. Que je relâche si peu que ce soit la pression à laquelle il faut soumettre la vapeur du souvenir, l’impalpable matière de la pensée, et la plume cesse de courir, le fil rompt. Je réussis à couvrir la deuxième page vers trois heures de l’après-midi après avoir douté, à chaque mot, d’extorquer le suivant, et un autre, encore, à l’inexpiable ennemi. C’est pur hasard, me semble-t-il, s’il a cédé. L’espoir s’est évanoui. On recommence, pourtant, puisque là est le chemin, et c’est ainsi qu’un autre terme vient, qu’on s’empresse, incrédule, d’ajouter au précédent. Et c’est à ce régime que je vais me trouver réduit pour des mois. »
« Je ne suis pas encore sorti de la voiture qu’un type à l’air malheureux, misérable, vient me demander une pièce. Il se passe des choses graves, que les rues soient pleines de gens qui mendient, qu’on soit partout et continuellement sollicité. »
« Les petits qui tournicotent sans rien faire m’irritent beaucoup. Mais c’est – j’essaie de me le rappeler – le privilège de l’âge où ils sont encore de n’avoir pas à compter, de dilapider les heures, les jours en petit nombre qui nous sont alloués. J’en ai usé, moi aussi, à leur âge, en très grand seigneur avant de me faire épicier. »
« Je me lève à six heures. Il s’agit de mordre sur le nouveau chapitre. Les premières lignes me coûtent mille maux. Je passe par toutes les couleurs de la désespérance. Partout, la muraille ou le puits, comme dans le conte d’Edgar Poe. Il doit être neuf heures lorsque les premiers mots apparaissent sur la page. Les mots d’Helvétius sur le malheur d’être et la fatigue de penser me reviennent. Dans l’intervalle, un jour clair et tiède s’est levé. C’est l’été de la Saint-Martin. Je m’acharne, gagne deux mots, trois autres un peu plus tard. À midi, j’aurai progressé d’une page. »
« La difficulté d’écrire se dresse, intacte, malgré les années. Je devine le grouillement obscur des possibles, l’enchevêtrement des thèmes, la confusion première, foncière, peut-être définitive de l’esprit aussi longtemps qu’il n’a pas fait retour sur lui-même, passé outre à l’interdit qui lui défend de se connaître, de porter en lui-même ordre et clarté. »
« Je lis La Psychologie des sentiments de Th. Ribot. Ce qu’il dit du sentiment esthétique est étrangement conforme à ce que j’ai toujours éprouvé, sous ce chef : un besoin aussi impérieux que la soif et la faim, plus impérieux, en vérité, plus violent, ab origine. »
« Je reprendrai plus tard la fin, qui est très insatisfaisante. Je reviens au début pour la première passe de rabotage. Il est deux heures et demie de l’après-midi lorsque j’ai grossièrement élagué le premier chapitre. La dialectique abstruse du deuxième m’arrête net et j’ai un accès de détresse. Jamais je ne serai content. Toujours mon esprit revient buter sur son insuffisance essentielle, son incurable infirmité. »
C’est une figure opiniâtre qui se dégage de ce journal, avec en filigrane un grand élan vers l’authenticité.
J’ai lu avec plaisir ces carnets, comme une histoire, tant le propos est bien énoncé, l’écriture agréable, la syntaxe soignée et riche le vocabulaire. Bien sûr cette lecture est laborieuse, puisqu’il s’agit d’un journal, donc non structuré, où abondent les récurrences des évocations de peines diverses ; mais les préoccupations de Bergounioux, les soucis qu’il consigne plus volontiers que les satisfactions, recoupent souvent les nôtres.
\Mots-clés : #autobiographie #creationartistique #ecriture #education #enfance #famille #journal #mort #nature #relationenfantparent #ruralité #urbanité #viequotidienne #xxesiecle
- le Jeu 14 Mar 2024 - 11:20
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Pierre Bergounioux
- Réponses: 40
- Vues: 4316
Philip Roth
Tromperie
C’est le film du même titre, d’Arnaud Desplechin avec Léa Seydoux et Denis Podalydès, qui m’a amené à cette lecture. Il s’agit de dialogues (qu’on retrouve dans le film) entre « Philip » et sa maîtresse, mais aussi son épouse et quelques autres femmes (notamment de Mitteleuropa). Lors des rencontres entre les deux amants dans son studio d’écrivain à Londres, confidences, questionnements, conversations (portant notamment sur leurs couples respectifs, leur sexualité, les juifs, l’Angleterre), placent cette liaison qui semble être inscrite dans la durée au centre du roman.
Réponse à un biographe après sa mort :
« – “Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. J'ai écrit les deux derniers et demi. Et même ces notes qu'il a ajoutées de sa main l'ont été sous ma dictée.” »
Le regard de l'amante (anglaise) sur le narrateur est prépondérant :
« – Certains hommes écoutent patiemment, cela fait partie de la séduction qui mène à la baise. C'est pourquoi en général les hommes parlent aux femmes – pour les fourrer dans leur lit. Toi tu les fourres au lit pour leur parler. Certains hommes les laissent commencer leur histoire, puis quand ils pensent leur avoir prêté suffisamment d'attention, ils plaquent doucement la bouche en mouvement sur l'érection. Olina m'a tout raconté sur toi. Elle me l'a répété une ou deux fois. Elle a dit : “Pourquoi s'obstine-t-il à poser toutes ces questions irritantes ? Du point de vue affectif, il est déplacé de poser tant de questions ? Tous les Américains font-ils ainsi ?” »
« Tu ne participes à la vie que pour entretenir la conversation. Même le sexe est en réalité marginal. Tu n'es pas poussé par ta libido – tu n'es poussé par rien. Sinon par cette curiosité puérile. Sinon par cette désarmante naïveté. Voici des gens – des femmes – qui ne vivent pas la vie comme quelque chose de matériel, mais la vivent sur le plan de l'émotion. Et pour toi, plus c'est émotif mieux ça vaut. Ce qui te plaît le plus, c'est quand, encore dans un état de choc post-traumatique, elles s'efforcent de récupérer leurs vies, comme Olina à son arrivée de Prague. Ce qui te plaît le plus, c'est quand ces femmes émotives ne parviennent pas réellement à se raconter mais luttent pour intégrer leur histoire. C'est ça que toi, tu trouves érotique. Exotique aussi. Chaque femme est une baiseuse, chaque baiseuse une Schéhérazade. Elles n'ont pas été capables d'intégrer leur histoire et, dans le fait de raconter leur histoire, il y a comme une incitation à parfaire la vie – ce qui implique beaucoup de pathétique. Bien sûr c'est émouvant : le simple flux et reflux de leur voix, ce timbre de conversation intime, pour toi c'est émouvant. Ce qui est émouvant n'est pas nécessairement dans les histoires, mais dans leur désir ardent de fabriquer les histoires. L'inachevé, le spontané, ce qui est simplement latent, voilà la réalité, tu as raison. La vie avant que le récit ne prenne le relais est la vie. Elles essaient de combler par leurs mots l'énorme gouffre entre l'acte lui-même et la “narrativisation” de l'acte. Et toi tu écoutes et te précipites pour tout mettre par écrit, puis tu le détruis par ta maudite “fictionalisation”. »
À propos du personnage et alter ego de Roth, Nathan Zuckerman, lui aussi avec son biographe :
« Ce qui l'intéresse, c'est l'affreuse ambiguïté du “je”, la façon dont un écrivain fait un mythe de sa propre personne et, notamment, pourquoi. »
Vient cette fameuse scène où il répond devant la justice de cette accusation : « Pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous haïssez les femmes ? » Dans un livre paru en 1990, c’est assez prémonitoire :
« Vous êtes accusé de sexisme, de misogynie, d'insultes aux femmes, de calomnie à l'encontre des femmes, de dénigrement des femmes, de diffamation des femmes, et de séduction cruelle, délits qui tous font l'objet de peines extrêmement sévères. »
Il est notamment accusé d’avoir, professeur d'université, eu des rapports sexuels avec trois étudiantes (dont celle qu’il retrouve à l’asile, atteinte d’un cancer).
À propos de Kafka :
« Le temps qu'un romancier de talent atteigne trente-six ans, il a renoncé à traduire l'expérience en fiction – il impose sa fiction à l'expérience. »
Bribes de dialogues notées dans un carnet de notes – qui tomberait sous les yeux de sa femme, à laquelle il mentirait.
« L'une est une silhouette esquissée dans un carnet au fil de conversations, l'autre est un personnage très important empêtré dans l'intrigue d'un livre complexe. Je me suis imaginé, extérieur à mon roman, en train de vivre une aventure avec un personnage à l'intérieur de mon roman. »
« J'écris de la fiction, on me dit que c'est de l'autobiographie, j'écris de l'autobiographie, on me dit que c'est de la fiction, aussi puisque je suis tellement crétin et qu'ils sont tellement intelligents, qu'ils décident donc eux ce que c'est ou n'est pas. »
« – Écoute, je ne peux pas vivre et je ne vis pas dans un monde de retenue, pas en tant qu'écrivain, en tout cas. Je préférerais, je t'assure – la vie en serait plus facile. Mais la retenue, malheureusement, n'est pas faite pour les romanciers. Pas plus que la honte. Éprouver de la honte est automatique en moi, inéluctable, peut-être est-ce bon ; le crime grave, c'est de céder à la honte. »
« J'écris ce que j'écris de la façon dont je l'écris, et si cela devait jamais arriver, je publierais ce que je publie comme j'entends le publier, et il n'est pas question qu'à ce stade avancé je commence à me demander ce que les gens comprennent de travers ou ne comprennent pas.
– Ou comprennent bien.
– Nous parlons d'un carnet, d'une épure, d'un diagramme, et non d'êtres humains !
– Mais tu es un être humain, que cela te plaise ou non ! Et moi aussi ! Et elle aussi !
– Pas elle, non, elle n'est que des mots – j'ai beau essayer, je ne suis pas capable de baiser des mots ! »
« – Mais tu ne peux pas... Tu ne peux pas avoir ainsi simultanément une vie imaginaire et une vie réelle. Et c'était probablement la vie imaginaire que tu avais avec moi et la vie réelle que tu avais avec elle. Écoute, il est impossible de noter de cette façon tout ce que dit quelqu'un.
– Mais je le faisais. Je le fais. »
J'ai trouvé fort intéressant ce roman (et film) retors, qui ramentoit L’Homme qui aimait les femmes de François Truffaut. Provocant, malicieux, jouant avec le politiquement correct et la morale, cette sorte d’antiroman brouille un peu plus encore les rapports entre confidence autobiographique et fiction dans un éblouissant, fallacieux jeu de miroirs.
\Mots-clés : #autobiographie #autofiction #ecriture #entretiens #intimiste #relationdecouple #sexualité
- le Mer 28 Fév 2024 - 10:22
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Philip Roth
- Réponses: 111
- Vues: 11800
W.G. Sebald
Campo Santo
D’abord quatre « petites proses » sur la Corse.
Intéressante réflexion, dans le texte éponyme du recueil, sur l’idée que la multitude de l’humanité actuelle n’a plus de place pour les défunts, le passé.
Les Alpes dans la mer évoque les hautes futaies qui couvraient encore la Corse au XIXe ; la faune aussi a disparu en grande partie, mais pas les chasseurs, apparemment revêches.
Suivent de brefs essais.
Dans L’étranger, intégration et crise, à propos de Gaspard Hauser, de Peter Handke :
« Car les choses n’ont-elles pas seulement un nom pour qu’on puisse mieux s’en emparer, un peu comme si les espaces laissés en blanc sur notre atlas du monde réel devaient disparaître à seule fin que l’esprit étende son empire colonial ? »
Entre histoire et histoire naturelle – Sur la description littéraire de la destruction totale préfigure De la destruction comme élément de l'histoire naturelle (thème de la destruction des villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, aussi abordé dans Les Anneaux de Saturne).
Dans Constructions du deuil – Günter Grass et Wolfgang Hildesheimer, Sebald prolonge cette réflexion sur les « carences de la littérature d’après-guerre » en Allemagne, le « deuil impossible ».
Le cœur mortifié – Souvenir et cruauté dans l’œuvre de Peter Weiss évoque une œuvre apparemment terrifiante.
Avec les yeux de l’oiseau de nuit – Sur Jean Améry semble prolonger ce qu’en disait Sebald dans Amère patrie (et m’incite davantage à découvrir cet auteur).
« Dans la pratique de la persécution, de la torture et de l’extermination d’un ennemi désigné arbitrairement, il ne voit pas un accident regrettable du pouvoir totalitaire mais, sans la moindre restriction, l’expression de son essence. Il rappelle “leurs visages (…) recueillis et concentrés sur une autoréalisation meurtrière” et précise : “C’est de toute leur âme qu’ils menaient leur affaire et celle-ci s’appelait puissance, domination sur l’esprit et la chair, auto-expansion démesurée que rien ne venait brider.” Le monde imaginé et réalisé par le fascisme allemand était pour Améry “l’univers de la torture où l’homme n’existe que du fait même qu’il brise l’autre”. Dans sa démarche Améry se réfère à Georges Bataille. La position radicale qu’il adopte ainsi exclut tout compromis avec l’histoire. C’est ce qui fait la spécificité de son travail, notamment en ce qui concerne la confrontation littéraire avec le passé allemand, laquelle, d’une manière ou d’une autre, présentait toujours une certaine tendance au compromis. […]
Et Améry est ainsi resté le seul à avoir dénoncé l’obscénité d’une société psychiquement et socialement dénaturée, ainsi que le fait, scandaleux, que l’histoire ait pu ensuite reprendre son cours pratiquement sans heurts, comme si tout cela n’avait pas existé. »
Textures de rêve – Note sur Nabokov.
« C’est à la fin d’Autres rivages, et c’est le récit d’une scène qui se produit assez souvent à Vyra : vers midi en général, quand les Nabokov étaient assis à table dans leur salle à manger du rez-de-chaussée, les paysans venaient devant la maison de maître pour présenter une requête quelconque. Si l’affaire pouvait se régler à la satisfaction de la délégation, la coutume voulait que de toutes ses forces réunies on lançât trois fois en l’air M. Vladimir Dimitrievitch, qui s’était levé de table et était sorti auprès des solliciteurs afin d’écouter leur requête, pour le rattraper quand il redescendait. “De ma place à table, je voyais soudain à travers l’une des fenêtres à l’ouest un merveilleux cas de lévitation. Là, durant un instant apparaissait la silhouette de mon père, dans son costume d’été blanc que le vent faisait onduler glorieusement étendu de tout son long, les membres dans une posture curieusement nonchalante, son beau visage imperturbable tourné vers le ciel. Trois fois, au puissant «oh hisse !» de ses invisibles lanceurs, il s’élevait de cette façon, et la deuxième fois il allait plus haut que la première, pour enfin, dans son dernier et plus haut envol, reposer, comme pour de bon, sur le fond cobalt d’un midi d’été, tel un de ces personnages paradisiaques que l’on voit planer confortablement, avec un tel luxe de plis à leurs vêtements, sur le plafond en voûte d’une église, tandis qu’au-dessous, un par un, les cierges de cire tenus par des mains mortelles s’allument et forment un essaim de flammes menues au milieu de l’encens, et que le prêtre psalmodie les chants du repos éternel, et que les lis funéraires cachent le visage de celui qui gît là, parmi les lumières flottantes, dans cette bière ouverte.” »
Inégales miscellanées, où on peut trouver de quoi approfondir les pensées de Sebald en histoire et en littérature.
\Mots-clés : #ecriture #essai
- le Lun 19 Fév 2024 - 11:20
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: W.G. Sebald
- Réponses: 74
- Vues: 8388
Fédor Dostoïevski
Les Pauvres Gens
Le (premier) roman de Dostoïevski est l’échange de lettres entre deux personnages : le vieux Makar Alexéïévitch Dévouchkine est venu loger en face de chez Varvara Alexéïevna Dobrossiolova, une parente éloignée qu’il chérit.
« Nous, les vieux, je veux dire les gens d’un certain âge, nous nous faisons aux vieilles choses comme si elles avaient toujours été à nous. Mon logement, vous savez, il était si douillet ; avec ses murs… oui, à quoi bon en parler ! – il y avait des murs, comme n’importe quels murs, il ne s’agit pas des murs, et, de me souvenir de tout ça, de tout mon passé, ça me rend mélancolique… Une chose étrange – c’est dur, mais, les souvenirs, c’est comme s’ils étaient doux. Même ce qui était mal, ce qui me faisait rager parfois, dans les souvenirs, c’est comme si ça se nettoyait du mal, et ça se présente à mon imagination sous un air attrayant. »
Son logement est surpeuplé, et assez misérable ; il se sacrifie pour elle, et tous deux minimisent leurs ennuis. Varvara lui envoie un journal tenu alors qu’elle était plus heureuse. Enfant, elle vivait à la campagne, où son père était intendant, mais il leur fallut partir à Pétersbourg. À la mort de son père, une parente éloignée, Anna Fiodorovna, les recueillit, elle et sa mère. Là, elle eut comme voisin et précepteur le pauvre et maladif étudiant Pokrovski ; ils se rapprochèrent comme elle devenait une jeune fille, et découvrait les livres.
« Oh, ce fut un temps triste et joyeux à la fois – tout ensemble ; aujourd’hui encore, je me sens triste et joyeuse quand je m’en souviens. Les souvenirs, qu’ils soient joyeux, qu’ils soient amers, ils vous torturent toujours ; moi, du moins, c’est ainsi ; mais cette torture est douce. »
Lui est copiste, qui regrette de ne savoir composer (ce scribe a un côté bartlebyen, et fait directement référence à Le Manteau de Gogol, paru l’année précédente).
« Parce que, c’est vrai, à la fin, qu’est-ce que ça peut donc faire, que je recopie ? C’est un péché, de recopier, ou quoi ? “Non, mais, il recopie !” “Ce rat, n’est-ce pas, de fonctionnaire, il recopie !” Qu’est-ce qu’il y a là-dedans de tellement malhonnête ? Mon écriture, elle est nette, belle, elle fait plaisir à voir, et Son Excellence est satisfait ; c’est pour lui que je recopie des papiers des plus importants. Bon, je n’ai pas le style, je le sais très bien, que je ne l’ai pas, le satané style ; c’est bien pour ça que je n’ai pas monté dans ma carrière, et, maintenant, là, ma bonne amie, je vous écris tout simplement, comme ça me vient, comme l’idée m’en vient au cœur… Tout ça, je le sais bien ; mais, n’empêche, si tout le monde se mettait à composer, qui est-ce qui resterait, pour recopier ? »
« Parce que, c’est vrai, au fond, ça vous passe, quelquefois, par la tête… et si, moi, j’écrivais quelque chose, qu’est-ce qui arriverait ? »
Makar se ruine pour aider Varvara qui l’apprend ; il a honte, craint les ragots, alors qu’elle lui a gardé son amitié.
« Vous aviez honte de m’obliger à avouer que j’étais la cause de votre situation désespérée, et maintenant, vous avez doublé mon malheur avec votre conduite. Tout cela m’a stupéfiée, Makar Alexéïévitch. Ah, mon ami ! le malheur est une maladie contagieuse ! Les malheureux et les pauvres devraient s’éviter les uns les autres, pour ne pas se contaminer encore plus. »
Tous deux en mauvaise santé et en piètre situation, ils accusent le destin avec résignation. Rataziaïev, colocataire de Makar, est un écrivain qu’il admirait, et qu’il pense maintenant au nombre de ses persécuteurs, lui qui voudrait le mettre dans un de ses livres (délire paranoïaque à comparer à Varvara qui se dit être poursuivie par la haine d’Anna, et qui me paraît comparable à celui de Rousseau dans Les Rêveries).
Finalement, Varvara accepte d’épouser Bykov, relation d’Anna, propriétaire foncier assez rustre, qui l’emmène dans la steppe. Explicit :
« Mais non enfin, moi, j’écrirai, et, vous, aussi, écrivez, enfin… Parce que, moi, maintenant, j’ai le style qui se forme… Ah, mon amie, c’est quoi, le style ! Mais, moi, maintenant, là, je ne sais même plus ce que j’écris, et je ne corrige pas le style, j’écris juste pour écrire, juste pour en écrire un petit plus… Ma petite colombe, mon amie, oh, vous, mon âme à moi ! »
Ce qui m’a frappé, chez ces "petits", ce n’est pas tant qu’ils souffrent de la pauvreté, mais plutôt de la malveillance, et de ne pouvoir révéler les qualités de leur âme, leurs humbles compassion (« pitié ») et dignité (« honneur », « réputation »). Il me semble que Dostoïevski parvient à échapper au pathos, ou à le dépasser par son empathie.
Par ailleurs, son dessein d’écrivain est marqué par les références littéraires, et surtout par les préoccupations de style chez Makar.
\Mots-clés : #correspondances #ecriture #misere
- le Ven 26 Jan 2024 - 10:41
- Rechercher dans: Écrivains Russes
- Sujet: Fédor Dostoïevski
- Réponses: 80
- Vues: 6835
Marco Lodoli
Les Prétendants – La Nuit – Le Vent – Les Fleurs
Trilogie romanesque :
La Nuit
« L’histoire est à son commencement et elle a déjà un pied dans la tombe ; entre les deux, cela flotte incertain, l’être cherche, s’égare et, en attendant, fait un pas en avant. »
Costantino rêve d’amour (ou, plus exactement, désire toujours), et s’active à livrer en mobylette dans Rome les lettres et colis clandestins ordonnés par le Fou (un mystérieux "maître" qui joue de la trompette), sous la surveillance de Fedele et Ottavio, prénoms invariables même lorsque l’un d’eux meurt en service.
« Parfois le jeune Costantino s’extirpait de la grande pelote urbaine, il s’asseyait sur un muret en haut d’une colline et, comme s’il était sur le bord d’une assiette monumentale, il comparait vaguement amusé les trajectoires entre les êtres à des fils de spaghettis, enchevêtrés au milieu d’une sauce aussi écarlate que le sang, cuisinés al dente ou trop cuits, et sur le point d’être dévorés. »
Puis, ayant fauté (il cherche à comprendre le sens de l’existence), Costantino est muté comme jardinier d’un jardin écarté. Enfin, il s’éprend de Serena, une sorte de sirène carnivore captive d’une piscine ; tous deux seront tués par les Fedele et Ottavio, et flottent au fil du Tibre.
« Et ton existence ne change pas parce que tu redoutes que le temps triomphe de tout. »
« La vie s’enroule, comme une bande de gaze sur une plaie sanglante. »
Dans ce texte aux allures de parabole (avec évidemment le jardin d’Éden), j’ai pensé pêle-mêle à Paul Auster, Boris Vian, Tabucchi et Calvino – mais de cette palette est issue une œuvre originale.
Le Vent
« C’est lui, enfin, je l’aperçois, je soupçonnais sa présence depuis pas mal temps : ce n’est qu’une pâle enseigne dans la nuit, le vague chuchotement d’une fable, une silhouette nébuleuse. »
La narrateur-auteur imagine Luca qui fait le taxi entre Rome et l’aéroport avec sa Fiat 850 décapotable, et a recueilli un Martien agonisant venu de la Lune. Il rêve qu’avec les autres personnages ils sont élèves travaillant à un devoir à l’école. Un de ses clients :
« Quelqu’un, quelque chose, faisait l’expérience de la vie à travers lui. »
Et enfin il comprend :
« Cela faisait des pages et des pages qu’il soupçonnait ma présence, me redoutait, et enfin maintenant il m’aperçoit derrière ses paupières, tels une pâle enseigne dans la nuit, le vague chuchotement d’une fable, une silhouette nébuleuse. »
… Et rend visite à Marco Lodoli. Il plaide contre la mort du Martien, et tous deux rejoignent les autres personnages pour lutter contre la mort – qu’ils emmènent sous les traits d’une jeune fille.
« Il vous a certainement exposé sa théorie, il soutient que l’univers est un commerce, que les choses changent d’endroit et de valeur dans un continuel mouvement de troc, que Dieu lui-même est un marchand : le plus roublard. Moi qui suis veilleur de nuit, j’ai pas mal de temps libre, alors je me suis penché sur la question et j’ai fini par simplifier le concept de Tibullo : l’univers est un perpétuel pillage et Dieu est un voleur. »
Ce deuxième roman, fantaisie oniro-métaphysique où les pigeons morts tombent du ciel, m’a un temps lassé par ce qui m’a paru être des longueurs, jusqu’au thème pirandellien des quémandages des « créatures de papier » de l’écrivain.
Les Fleurs
Tito, un ancien employé de poste, a quitté son village pour être poète à Rome, ayant été contacté par un mystérieux éditeur d’une revue littéraire disparue, La Tanière. Il y rencontre Aurelio, un unijambiste qui s’attache à lui (comme de nombreux chiens errants), puis Morella, qui dit l’avenir (sans grand succès).
« La revue était entièrement écrite par la même personne, ça je m’en souviens bien. Elle était en italien, mais on avait l’impression que c’était une autre langue, l’impression de quelqu’un qui s’adresse à toi en rêve et dont tu ne saisis pas les mots, alors tu dis, parle plus fort, je ne comprends pas, plus fort, mais il n’y a rien à faire, tu entends les mots, ils te sont destinés, mais tu es incapable de les mettre dans le bon ordre pour les rendre intelligibles, et la peur te réveille en sursaut. »
« Parfois pourtant j’avais le sentiment que cela défilait de toute éternité à l’intérieur d’une lanterne magique, que les images se répétaient en boucle, se transformant juste ce qu’il fallait pour ne pas dévoiler l’illusion ; que les jardins, les marbres, l’effervescence, les corps des fontaines et des êtres le long des rues dissimulaient quelque chose d’irréel, comme si la brillance de leurs contours émanait d’une lumière artificielle, et que le vide fût leur substance.
Mes pensées se répétaient elles aussi dans la lanterne, l’une après l’autre, analogues et en dehors de ma volonté, avec toujours ces mêmes questions qui revenaient : qu’est-ce qui m’a conduit jusqu’ici ? Qu’est-ce qu’il y a à apprendre, et qui me l’enseignera ? Qu’est ce que je dois écrire, et pourquoi ? La vie est-elle belle, ou absurde ? Et surtout : qui suis-je désormais, et jusqu’à quand devrai-je péniblement m’interroger ? »
Petits boulots en attendant, Tito (qui a été un chien) est un temps employé des pompes funèbres (assez étranges) ; il se marie avec Morella, qui en devient folle.
« Mais ma vie a pris malgré moi un tour différent, elle répond, semble-t-il, à quelque chose, mais j’ignore encore la question. »
« Mon alliance, je ne l’avais plus, elle avait glissé Dieu sait quand. Elles devraient faire du bruit nos affaires quand nous les perdons, émettre une plainte, agiter une clochette, ne pas se laisser ensevelir par le monde comme des feuilles mortes. Elles devraient pouvoir dire : ramasse-moi, l’ami, je t’en prie, ne m’abandonne pas de la sorte. En revanche elles disparaissent sans crier gare, on les avait et on ne les a plus, et l’on reste là à se dire qu’on les retrouvera plus tard, que tout à l’heure on finira bien par mettre la main dessus. J’imagine une pièce où elles sont toutes réunies, amicalement, l’une à côté de l’autre : le stylo, l’alliance, l’écharpe, les clefs, et il y a là aussi des pensées et des noms oubliés, les phrases que j’ai eues des années durant dans la tête et puis qui se sont volatilisées.
Voilà ce que je me disais, tandis que le vent ébouriffait les cheveux de Morella, aussi courts et légers que du duvet.
Mais peut-être est-ce faux, je n’ai pas perdu les choses par inadvertance, par simple distraction, peut-être ai-je été forcé de m’en défaire une à une, et ce n’est pas de la nostalgie que j’éprouve, ce n’est pas du regret, mais un délicat sentiment de culpabilité pour les histoires que je n’ai pu porter avec moi jusqu’au bout. Aujourd’hui, avec les années, j’ai appris que pour comprendre il faut savoir renoncer à tout, même aux porte-bonheur et aux souvenirs, à l’enfance et aux émotions les plus douces, et aux désirs qui ne sont jamais en paix, et à l’amour qui n’offre jamais de paix, les laisser libres – et c’est peut-être le monde, l’endroit où toutes les choses égarées vivent amicalement en attendant d’être sauvées. »
Raconté par épisodes, certains felliniens, ce récit fantasque, polarisé par la mort et le destin aussi inéluctable qu’impénétrable, semble avoir été écrit au fil de la plume, quoique sans tirer à la ligne, et aurait éventuellement gagné à être resserré, un peu plus condensé. Je suis le premier à reconnaître le bien-fondé d’un lent développement, mais le risque de lasser le lecteur aurait pu être évité, alors que de nombreux passages méritent amplement la lecture.
Ce sont donc trois paraboles (un peu comme chez Calvino) sur les "prétentions" (à l’amour, à l’abolition de la mort, à l’accomplissement littéraire), c'est-à-dire une recherche de sens dans le rêve éveillé de l’existence temporelle (les songes y tiennent une grande place). La finitude humaine est perpétuellement rappelée tel un memento mori, et l’interrogation sur un être suprême manipulant et observant les hommes m’a paradoxalement ramentu l'aspect métaphysique des romans de Philip K. Dick.
\Mots-clés : #ecriture
- le Mar 2 Jan 2024 - 11:20
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Marco Lodoli
- Réponses: 10
- Vues: 1437
W.G. Sebald
Amère patrie − À propos de la littérature autrichienne
Ces essais constituent une sorte de suite, ou plutôt un pendant, à La Description du malheur, d’ailleurs aussi sous-titré À propos de la littérature autrichienne. Cette fois, il s’agit dans cette « tradition d’écriture » de ce qui tourne autour du concept de Heimat, la « (petite) patrie », « qui s’était imposée dans l’Autriche des années 1930 ».
« Ce qu’on essayait d’accomplir à l’époque, c’était de gommer la moindre différence, d’ériger l’étroitesse de vue en programme et la délation en morale publique. »
Il s’agit des auteurs du XIXe (et début XXe), et sont notamment évoqués les Juifs, l’exil, les migrations, la disparition culturelle, la perte et le passé.
Intéressante découverte de Peter Altenberg, le poète bohème et flâneur viennois (rapproché de Baudelaire).
Comme pour le précédent essai, une connaissance approfondie de l’histoire et de la littérature autrichiennes serait fortement souhaitable. De même, je n’ai pas été en mesure d’apprécier vraiment la validité de la « dimension messianique » juive attribuée au Château de Kafka.
Concernant Joseph Roth, sa conscience de la destruction à venir d’un monde où les Juifs avaient leur place est significative de l’élaboration fasciste qu’il dénonce dès 1927.
« Dans le domaine de l’esthétique, il en va toujours en dernier ressort de problèmes éthiques. »
Suit un article (fort) critique sur Hermann Broch.
« Le kitsch est le pendant concret de la désensibilisation esthétique ; ce qui se manifeste en lui est le résultat d’une erreur de programmation de l’utopie, une erreur de programmation qui mène à une nouvelle ère où les substituts et les succédanés prennent la place de ce qui a été un jour le réel, y compris dans le domaine de la nature et de l’évolution naturelle. »
Je ne connaissais pas Jean Améry :
« …] le jour de l’Anschluss ne sonnait pas seulement le glas de sa patrie, de son enfance et de sa jeunesse, mais aussi, de jure, celui de sa personne [… »
« Améry endossa ce qu’on a un jour appelé le vice du peuple juif, l’être ailleurs [en français dans le texte], et devint un “apatride de métier”. »
L’essai s’achève en évoquant Peter Handle :
« Si l’idée de Heimat s’est développée au XIXe siècle à l’épreuve de plus en plus inévitable de l’étranger, l’idéologisation de la Heimat, inspirée de la même façon par l’angoisse de la perte, conduit au XXe siècle à vouloir l’expansion la plus grande possible de cette Heimat, si nécessaire par la violence et aux dépens des autres patries. »
Et si je suis loin d’avoir tout saisi, certains passages trouvent une résonance…
« À partir des mythes indiens, Lévi-Strauss a montré que leurs inventeurs ne craignaient rien tant que l’infection de la nature par l’homme. La compréhension du monde qui en résulte a pour précepte central que rien n’est plus important que d’effacer les traces de notre présence. C’est une leçon de modestie diamétralement opposée à celle que notre culture s’est proposé d’appliquer. »
\Mots-clés : #biographie #communautejuive #ecriture #essai #exil #historique #nostalgie
- le Ven 22 Déc 2023 - 11:06
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: W.G. Sebald
- Réponses: 74
- Vues: 8388
Mathias Enard
L'Alcool et la Nostalgie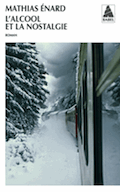
Dans cette novella, « Mathias » retourne à Moscou retrouver Jeanne (de France, peut-être celle du transsibérien de Cendrars) à l’annonce de la mort de Vladimir (de qui son amante Jeanne s’est éprise : les « trois matriochki » ont vécu là ensemble pendant un an, de littérature russe, d’alcool et de drogue). Il accompagne la dépouille de ce dernier en Sibérie, tous les deux seuls dans un compartiment de train avec la vodka, la nostalgie et des souvenirs historiques et littéraires de la Russie.
« …] les livres qui sont bien plus dangereux pour un adolescent que les armes, puisqu’ils avaient creusé en moi des désirs impossibles à combler. Kerouac, Cendrars ou Conrad me donnaient envie d’un infini départ, d’amitiés à la vie à la mort au fil de la route et de substances interdites pour nous y amener, pour partager ces instants extraordinaires sur le chemin, pour brûler dans le monde, nous n’avions plus de révolution, il nous restait l’illusion du voyage, de l’écriture et de la drogue. »
\Mots-clés : #addiction #amitié #amour #ecriture #jeunesse #nostalgie
- le Mer 20 Déc 2023 - 16:12
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Mathias Enard
- Réponses: 103
- Vues: 7954
William H. Gass
Sonate cartésienne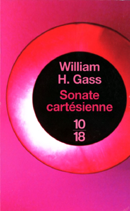
Le texte éponyme :
« Ceci est l’histoire d’Ella Bend Hess, de la façon dont elle est devenue extralucide, et de ce qu’elle a pu voir. »
Dans la première partie, un auteur phrase et divague oisivement, notamment sur l’écriture, et la description de ses personnages.
« …] traçant un des secrets de sa vie sur le mur ou dans la lunette des cabinets, pas toujours quelque chose de bas ou de vulgaire, d’ailleurs, car après tout c’est la forme et non le contenu qui importe [… »
« Sauf quand j’aurai mal, ceci sera votre histoire. Alors, bien que les qualités physiques d’une dame, disons une dame pour le moment, existent en tant qu’unité et apparaissent pour l’essentiel de la même façon, sa description, dans la mesure où elle doit former une séquence de mots, dispose ces qualités pour la compréhension du lecteur, de sorte qu’elle apparaît au regard à la manière d’un navire lointain, petit bout par petit bout. Sa description peut être dessinée avec des lignes droites ou des zigzags, des courbes ou un nuage de petits points discrets mais, quelle que soit la géométrie, l’auteur, pour autant qu’il comprend la nature de son art et en a la capacité, composera une image à partir des inflexions fournies à notre attention qui non seulement seront aussi passionnantes qu’une aventure narrée par le détail, mais constitueront aussi, lorsque le lecteur saisit l’ensemble comme il saisit un thème musical, un drame du passage de l’esprit, son début, son milieu et sa fin y compris, reconnaissance et renversement inclus, l’art de l’auteur l’exigerait-il ; et ce qui peut être vrai de la description physique d’une dame peut être vrai de l’arrangement de n’importe quel ensemble de mots, même si le but de cet arrangement peut être plus difficile à discerner, les liens plus subtilement établis. […]
Ce sont précisément des considérations de cette sorte qui distinguent l’attitude de l’artiste envers le langage de celle des autres ; c’est l’intensité de son souci qui est la mesure de son engagement, leur multiplication qui révèle la grandeur de sa vision ; et c’est l’effet de pareils scrupules, lorsqu’ils réussissent à prendre corps, que ce soit avec la facilité d’un génie débordant ou au prix des douleurs d’un talent allié à l’ambition, que de faire s’élever une fiction, ou toute autre œuvre de création, de ce qui serait sous tous autres rapports un lieu commun, à la hauteur du beau. »
« Quand Dieu écrivit sur le mur de Belschatsar, le critique Daniel décida que les mots énigmatiques signifiaient « compté compté pesé et divisé », et qu’ils voulaient dire que le règne du roi avait été jugé insatisfaisant, et que sa terre devait être divisée. Mais ici, plutôt que d’un jugement, il s’agit d’une injonction : écrivain lecteur, pesez deux fois chaque chose, veillez à ce que tout compte, et séparez-vous de votre écriture lecture à la manière dont un serpent se débarrasse de sa peau, en gardant également à l’esprit qui vous êtes, écrivain lecteur – vous êtes la mue, et le texte qui vous est commun est le serpent luisant et rusé. »
Dans la seconde partie, Ella elle-même rend compte d’une sorte d’hyperesthésie de l'ouïe, et d’une métamorphose tératologique.
« L’espace n’était pas de l’espace pour Ella, c’était des signaux. Tout émettait quelque chose : une fleur son parfum, une chauve-souris son bip, une lime sa rugosité, un citron son acidité, une fille sa magnificence, une rue d’été sa chaleur d’été, chaque muscle son mouvement ; l’espace fait plus de vagues que l’océan : rayons X, transmissions radiophoniques et télévisuelles, conversations sur walkie-talkie, messages de téléphone de voiture, ultraviolets, micro-ondes, cosmitudes en tous genres, gosses qui se causent avec des boîtes de conserve, radiations des lignes à haute tension, boîtes à signaux, transistors et transformateurs, infinillions de pièces électroniques suintant l’information, tremblements de la terre, avions à réaction, autres sillages, autres vents ; mais au-delà de tout ça, et de surcroît, l’odeur dit sucre, le bip dit victime, le rugueux émet un avertissement râpeux, l’amertume stimule la salivation, cette magnificence mérite turgescence, ou au moins d’éveiller l’intérêt, la chaleur est sa propre menace, et le mouvement témoigne d’une volonté ; pendant ce temps l’odeur qui voulait dire sucre pour l’abeille lui enduit le flanc de pollen, chaque victime que mange la chauve-souris signifie que moins d’insectes mordront cette cuisse tant admirée ; il est de plus écrit qu’on n’évite une bagarre que pour tomber dans une autre, que le citron fait passer la salade dans une bouche qui mâche jusque dans un estomac où les vitamines sont diffusées comme des informations ou des messages publicitaires, le pénis qui a eu son plaisir, à supposer un tel résultat, peut causer une grossesse inattendue – peut-être, dans ce cas précis, s’agit-il d’un déséquilibre entre cause et conséquence –, des pieds échauffés recherchent l’ombre là où l’herbe qui pointe tant bien que mal se fait piétiner, et la volonté frustrée s’acharne péniblement à atteindre une fois de plus un but remis à plus tard ; de sorte que parfum, surface, acidité, son, vision, sexe, la chaleur du monde, la volonté des hommes ne sont que médiocre crincrin de violoniste des rues parmi tous ces messages, une fête riquiqui sous pareille avalanche de confettis ; car chaque petite alvéole d’un morceau de métal alvéolé hurle, et les plantes s’imprègnent doucement de leurs propres jus jusqu’à la musique, et le duvet des oiseaux murmure dans un autre registre ce que l’oiseau recèle en son cœur. »
Dans la troisième et dernière partie bartlebyennement intitulée J’aimerais autant pas), son mari, l’auteur, parle d’elle avec rancœur.
Avec le compte rendu de ces états d’âme et flux de conscience, ce texte me paraît être une prolongation de l’Ulysse de Joyce, ne dédaignant pas la vulgarité, riche en innovation formelle et notamment lexicale.
Chambres d’hôtes
C’est cette fois de Walt Riff (Walter Riffaterre), comptable itinérant (et véreux), dont on suit le monologue tandis qu’il examine de vieux livres dans sa « chambre de motel ringarde », et songe à « maman », à certaines Eleanor et Kim, et à son ancienne secrétaire Miz Biz. Le lendemain, sa chambre d’hôtes est totalement différente, un havre bourré de souvenirs familiaux, précieusement décoré et kitsch, qu’il ne se résigne pas à quitter.
« La télé, s’il l’allumait, lui proposerait des images pareilles à de la tourte sous cellophane, l’appareil se souciant aussi peu de sa fonction que le dessert s’intéresse au comptoir de Formica sur lequel il attend le client. »
« Une lumière conçue dans des globes gravés et peints traversait en dansant le plissé des voilages pour baigner de confort la pièce et tous ses aménagements. Le tapis de cheviotte bleu pâle semblait la boire. Il existait un nom pour ce genre de tapis, mais Riff n’arrivait pas à le retrouver. C’était là tout un univers auquel il était étranger. »
« Il éprouvait ce besoin de noms. Son œil, une fois qu’il s’était mis enfin à regarder les choses, s’était fait littéral. »
Même procédé que dans le texte précédent, avec plaisanteries intimes, recherche du mot juste, description minutieuse des lieux (qui m’a ramentu le Nouveau Roman).
Emma s’introduit dans une phrase d’Élizabeth Bishop
Emma Bishop est une maigre vieille fille qui se ressouvient de sa misérable enfance (son père la dénigrait physiquement), au cours de laquelle elle lisait sous son frêne (qui va être abattu) ; elle évoque la vie et l’œuvre d’Elizabeth Bishop et Marianne Moore, poètes (et amantes), mais aussi Edith Sitwell et Emily Dickinson. Solitaire dans sa ruralité, vivant à peine, elle tue les mouches, crée des babioles pour exister. Peu à peu elle se détache du monde, voire de la poésie, de façon de plus en plus bizarre et dramatique.
« Comme les autres Emmas avant moi, je lisais sur l’amour à la lumière d’une demi-vie, et l’ombre de sa moitié absente donne de la profondeur à la page. »
Poétique et avec de nouveau beaucoup d’inventivité formelle, ce texte m’a cette fois remis en mémoire Virginia Woolf.
Le maître des vengeances secrètes
Luther Penner cultive de discrètes et mesquines vengeances depuis un âge puéril, et en fait un système théologique inspiré de la loi du talion, développant une rhétorique basée sur l’histoire de l’antiquité au cinéma nord-américain en passant par la Bible et Shakespeare (entr’autres auteurs).
« Il nous faut écarter, avec le plus grand respect, naturellement, la vision exagérément linéaire qu’a Descartes de l’explication rationnelle, parce que les révélations résultent rarement de l’escalade d’une échelle par l’esprit, chaque barreau bien net et bien placé gravi par un pied puis par l’autre comme un pompier en opération de sauvetage ; elles s’accomplissent plutôt à la manière indirecte dont la crème remonte à la surface d’un carton de lait : le petit-lait coule partout vers le fond alors que dans le même temps d’innombrables globules de graisse se libèrent et glissent vers le haut, chacun seul de son côté, aussi indépendant des autres que les monades de Leibniz, jusqu’à ce que, progressivement, presque sans qu’on s’en aperçoive, les globules en question forment une masse qui submerge le lait bleu alors que la crème douce couronne la surface, qui attend qu’on l’écrème. »
« C’est peut-être à cause de la façon dont on les élève, mais il semble que les gosses, dans notre société, on s’attende à ce qu’ils déçoivent leurs parents en ne réussissant pas à « concrétiser » telle ou telle attente, en prenant une orientation qu’on ne voulait pas leur voir prendre, ou en embrassant des valeurs et des opinions parfaitement insupportables. »
« Je pense que nous nous traitons mutuellement comme des imbéciles parce que nous avons acquis, à force d’entraînement, la parfaite compétence qui nous permet à la fois d’être des imbéciles et de traiter les autres comme tels, de sorte que nous méritons les insultes qui nous grêlent sur la tête. »
« Donc : les vengeances secrètes sont secrètes dès lors qu’elles ne sont pas perçues comme représailles par leur victime, qui vit avec une claudication qu’elle apprend à considérer comme normale ; et elles deviennent transcendantales lorsque même celui qui les inflige est ignorant de la nature de son acte. La transmission d’idées stupides, par exemple. Ou la création d’illusions absolues avec une parfaite sincérité, lorsqu’il ne s’agit plus de mensonges mais de notions fallacieuses servies sur des plats de porcelaine et mangées avec des couverts en argent. »
« Je pense plutôt que Luther Penner nous a apporté une métaphysique, caustique, assurément, mais magnifique : la vie perçue non pas simplement comme si elle était vécue dans un tourbillon de mythes en conflit et en concurrence, mais comme si elle était habillée d’illusions délibérément conçues par ceux qui, ayant été précédemment égarés, prennent ainsi leur revanche comme seuls peuvent secrètement le faire des ennemis secrets. Combien, dans notre propre maison ou notre propre quartier – pour ne considérer qu’un échantillon réduit –, ont-ils été trahis par des ismes et des logies d’une espèce ou d’une autre, ont donné de l’argent pour des causes démentes, et gaspillé une énorme partie du temps précieux de leur vie en vaines quêtes spirituelles ? »
Sur le mode humoristique, parfois d’une causticité politiquement incorrecte, toujours avec des comparaisons percutantes, c’est une belle analyse de l’esprit tordu, voire du complotiste parano, des dérives évangéliques et de l’avènement de l’ère post-vérité, éclairés fort tôt avant leurs récents développements, d’abord états-uniens.
Quatre nouvelles (voire novellas) qui démontrent (au minimum) une façon d’écrire assez expérimentale (mais restant fort lisible), c'est-à-dire hors de l’ornière ordinaire.
\Mots-clés : #contemporain #creationartistique #ecriture #nouvelle #portrait
- le Ven 15 Déc 2023 - 11:03
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William H. Gass
- Réponses: 4
- Vues: 402
Javier Cercas
L'imposteur
Cercas détaille comme, troublé par l'histoire d’Enric Marco, « le grand imposteur et le grand maudit » qui s'est fait passer pour un survivant des camps de concentration et est devenu une célébrité espagnole de la mémoire historique des horreurs nazies, il s’est finalement résolu à écrire ce roman non fictionnel. « Comprendre, est-ce justifier ? » N’est-il pas lui-même un imposteur ?
« La pensée et l’art, me disais-je, essaient d’explorer ce que nous sommes, ils révèlent notre infinie variété, ambiguë et contradictoire, ils cartographient ainsi notre nature : Shakespeare et Dostoïevski, me disais-je, éclairent les labyrinthes de la morale jusque dans leurs derniers recoins, ils démontrent que l’amour est capable de conduire à l’assassinat ou au suicide et ils réussissent à nous faire ressentir de la compassion pour les psychopathes et les scélérats ; c’est leur devoir, me disais-je, parce que le devoir de l’art (ou de la pensée) consiste à nous montrer la complexité de l’existence, afin de nous rendre plus complexes, à analyser les ressorts du mal pour pouvoir s’en éloigner, et même du bien, pour pouvoir peut-être l’apprendre. »
« Un génie ou presque. Car il est bien sûr difficile de se départir de l’idée que certaines faiblesses collectives ont rendu possible le triomphe de la bouffonnerie de Marco. Celui-ci, tout d’abord, a été le produit de deux prestiges parallèles et indépassables : le prestige de la victime et le prestige du témoin ; personne n’ose mettre en doute l’autorité de la victime, personne n’ose mettre en doute l’autorité du témoin : le retrait pusillanime devant cette double subornation – la première d’ordre moral, la seconde d’ordre intellectuel – a fait le lit de l’escroquerie de Marco. »
« Depuis un certain temps, la psychologie insiste sur le fait qu’on peut à peine vivre sans mentir, que l’homme est un animal qui ment : la vie en société exige cette dose de mensonge qu’on appelle éducation (et que seuls les hypocrites confondent avec l’hypocrisie) ; Marco a amplifié et a perverti monstrueusement cette nécessité humaine. En ce sens, il ressemble à Don Quichotte ou à Emma Bovary, deux autres grands menteurs qui, comme Marco, ne se sont pas résignés à la grisaille de leur vie réelle et qui se sont inventés et qui ont vécu une vie héroïque fictive ; en ce sens, il y a quelque chose dans le destin de Marco, comme dans celui de Don Quichotte et d’Emma Bovary, qui nous concerne profondément tous : nous jouons tous un rôle ; nous sommes tous qui nous ne sommes pas ; d’une certaine façon, nous sommes tous Enric Marco. »
Simultanément s’entrelace l’histoire de Marco depuis l’enfance, retiré nourrisson à sa mère enfermée à l’asile psychiatrique ; il aurait été maltraité par sa marâtre et ignoré par son père ouvrier libertaire, puis ballotté d’un foyer à l’autre, marqué par les évènements de la tentative d’indépendance catalane d’octobre 1934, juste avant que le putsch et la guerre civile éclatent. Cercas a longuement interviewé Marco, un vieillard fort dynamique, bavard et imbu de lui-même, criant à l’injustice parce qu’il aurait combattu pour une juste cause.
D’après Tzvetan Todorov :
« [Les victimes] n’ont pas à essayer de comprendre leurs bourreaux, disait Todorov, parce que la compréhension implique une identification avec eux, si partielle et provisoire qu’elle soit, et cela peut entraîner l’anéantissement de soi-même. Mais nous, les autres, nous ne pouvons pas faire l’économie de l’effort consistant à comprendre le mal, surtout le mal extrême, parce que, et c’était la conclusion de Todorov, “comprendre le mal ne signifie pas le justifier mais se doter des moyens pour empêcher son retour”. »
Militant anarcho-syndicaliste, Marco aurait combattu dans les rangs de la République, et Cercas analyse le « processus d’invention rétrospective de sa biographie glorieuse » chez ce dernier.
« Et je me suis dit, encore une fois, que tout grand mensonge se fabrique avec de petites vérités, en est pétri. Mais j’ai aussi pensé que, malgré la vérité documentée et imprévue qui venait de surgir, la plus grande partie de l’aventure guerrière de Marco était un mensonge, une invention de plus de son égocentrisme et de son insatiable désir de notoriété. »
Cercas ne ménage pas les redites, procédé (didactique ?) un peu lassant.
« Parce que le passé ne passe jamais, il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit ; le passé n’est qu’une dimension du présent. »
« Mais nous savons déjà qu’on n’arrive pas à dépasser le passé ou qu’il est très difficile de le faire, que le passé ne passe jamais, qu’il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit –, qu’il n’est qu’une dimension du présent. »
« La raison essentielle a été sa découverte du pouvoir du passé : il a découvert que le passé ne passe jamais ou que, du moins, son passé à lui et celui de son pays n’étaient pas passés, et il a découvert que celui qui a la maîtrise du passé a celle du présent et celle de l’avenir ; ainsi, en plus de changer de nouveau et radicalement tout ce qu’il avait changé pendant sa première grande réinvention (son métier, sa ville, sa femme, sa famille, jusqu’à son nom), il a également décidé de changer son passé. »
Cercas évoque De sang-froid de Truman Capote et L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, deux « chefs-d’œuvre » du « roman sans fiction » dont il juge le premier auteur atteint de « turpitude » pour avoir laissé espérer tout en souhaitant leur exécution les deux meurtriers condamnés à mort, et doute du procédé du second, présent à la première personne dans son récit peut-être pour se donner une légitimité morale fallacieuse.
Intéressantes questions du kitch du narcissique, et du mensonge (peut-il être légitime ? un roman est-il mensonge ?)
« Il y a deux mille quatre cents ans, Gorgias, cité par Plutarque, l’a dit de façon indépassable : “La poésie [c’est-à-dire, la fiction] est une tromperie où celui qui trompe est plus honnête que celui qui ne trompe pas et où celui qui se laisse tromper est plus sage que celui qui ne se laisse pas tromper.” »
En fait de déportation, Marco a été travailleur volontaire en Allemagne fin 1941, et emprisonné au bout de trois mois comme « volontaire communiste ». Revenu en Espagne, il a effectivement connu « les prisons franquistes, non comme prisonnier politique mais comme détenu de droit commun. » Il abandonne ses premiers femme et enfants, change de nom pour refaire sa vie (grand lecteur autodidacte, il suit des cours universitaires d’histoire) – et devenir le secrétaire général de la CNT, le syndicat anarchiste, puis président de l’Amicale de Mauthausen, l’association des anciens déportés espagnols. Il a toujours été un séducteur, un amuseur, un bouffon qui veut plus que tout qu’on l’aime et qu’on l’admire.
« …] de même, certaines qualités personnelles l’ont beaucoup aidé : ses dons exceptionnels d’orateur, son activisme frénétique, ses talents extraordinaires de comédien et son manque de convictions politiques sérieuses – en réalité, l’objectif principal de Marco était de faire la une et satisfaire ainsi sa médiapathie, son besoin d’être aimé et admiré et son désir d’être en toute occasion la vedette – de sorte qu’un jour il pouvait dire une chose et le lendemain son contraire, et surtout il pouvait dire aux uns et aux autres ce qu’ils voulaient entendre. »
« Le résultat du mélange d’une vérité et d’un mensonge est toujours un mensonge, sauf dans les romans où c’est une vérité. »
« Marco a fait un roman de sa vie. C’est pourquoi il nous paraît horrible : parce qu’il n’a pas accepté d’être ce qu’il était et qu’il a eu l’audace et l’insolence de s’inventer à coups de mensonges ; parce que les mensonges ne conviennent pas du tout à la vie, même s’ils conviennent très bien aux romans. Dans tous les romans, bien entendu, sauf dans un roman sans fiction ou dans un récit réel. Dans tous les livres, sauf dans celui-ci. »
Après la Transition de la dictature franquiste à la démocratie, la génération qui n’avait pas connu la guerre civile a plébiscité le concept de “mémoire historique”, qui devait reconnaître le statut des victimes.
« La démocratie espagnole s’est construite sur un grand mensonge, ou plutôt sur une longue série de petits mensonges individuels, parce que, et Marco le savait mieux que quiconque, dans la transition de la dictature à la démocratie, énormément de gens se sont construit un passé fictif, mentant sur le passé véritable ou le maquillant ou l’embellissant [… »
Cercas raconte ensuite comment l’historien Benito Bermejo a découvert l’imposture de Marco, alors devenu un héros national, et s’est résolu à la rendre publique (c’est loin d’être la seule du même genre). Marco tente depuis de se justifier par son réel travail de défense de la cause mémorielle. Cercas décrit ses rapports avec Marco partagé entre le désir d’être le personnage de son livre, et le dépit de ne pas pouvoir contrôler ce dernier.
« — S’il te plaît, laisse-moi quelque chose. »
Opiniâtre quant à la recherche de la vérité, outre ses pensées Cercas détaille son ressenti, qui va du dégoût initial à une certaine sympathie ; "donquichottesque", il pense même un temps à sauver Marco non pas en le réhabilitant, mais en le plaçant devant la vérité…
Manifestement basée sur une abondante documentation, cette étude approfondie, fouillée dans toutes ses ramifications tant historiques que psychologiques ou morales, évoque aussi le rôle de la fiction comme expression de la vérité.
\Mots-clés : #biographie #campsconcentration #devoirdememoire #ecriture #guerredespagne #historique #politique #psychologique #xxesiecle
- le Mar 17 Oct 2023 - 12:34
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Javier Cercas
- Réponses: 96
- Vues: 12461
Carlo Emilio Gadda
L'Affreuse Embrouille de via Merulana
Incipit :
« Tous l’appelaient désormais don Ciccio. C’était le dottor Francesco Ingravallo détaché à la garde mobile [… »
Ingravallo est molisan (du territoire du Molise, en Italie du sud), et enquête (avec son supérieur le dottor Fumi, mais aussi les agents l’Grand-Blond et l’Chippeur, et ensuite le brigadier Pestalozzi, à motocyclette) à Rome sur le vol à main armée subi par madame Menegazzi chez elle, deux cent dix-neuf via Merulana, puis sur le meurtre de sa voisine, madame Liliana Balducci, qui lui succède de peu.
Ingravallo est d’entrée convaincu de la complexité des causes :
« Il soutenait, entre autres choses, que les catastrophes inopinées ne sont jamais la conséquence ou l’effet, si l’on préfère, d’un motif unique, d’une cause au singulier : mais elles sont comme un tourbillon, un point de dépression cyclonique dans la conscience du monde, vers lequel ont conspiré toute une multiplicité de mobiles convergents. Il disait aussi nœud ou enchevêtrement, ou grabuge, ou gnommero, embrouille, qui en dialecte veut dire pelote. Mais le terme juridique « les mobiles, le mobile » s’échappait de préférence de sa bouche : presque contre son gré, semblait-il. »
C’est d’abord le personnage de Liliana, très croyante et fort déçue de ne pas avoir d’enfant, qui est approfondi, avec de longues considérations psychologiques et de genre, déjà amorcées avec madame Menegazzi :
« La longue attente de l’agression à domicile, pensa Ingravallo, était devenue une contrainte : non tant pour elle et ses actes et pensées, de victime déjà hypothéquée, que de contrainte pour le destin, pour le « champ de forces » du destin. »
Giuliano Valdarena, jeune séducteur cousin de Liliana, qui découvrit le corps, est d’abord suspect. Toutes les formes de parenté (consanguinité par cognation, agnation) sont décortiquées. Plus généralement, le roman est très ancré dans l’Italie, son histoire, la mythologie romaine, ses arts (l’iconographie, la littérature) et surtout son peuple.
Mais l’enquête est secondaire, la prose descriptive (et digressive) primordiale. Grandes scènes : parmi les bijoux volés, une topaze ; les gros orteils de Pierre et Paul ; les poules (chez Zamira ou au passage du train). C’est un délire d’embrouillaminis à tous les niveaux, mais soigneusement ourdi, fouillé, approfondi, passant de la physiognomonie aux rappels de Kant et de la « capillotomie dialectique » dans un acharnement des baroque et grotesque.
« À Marino, y avait aut’chose que st’ambroisie ! à la cave de don Pippo y avait l’un blanc assez méchant : un p’tit filou d’quatr’ans, dans quéqu’ bouteilles, que cinq ans plus tôt l’aurait pu l’électriser le ministère Facta [« chef du gouvernement en 1922, au moment de la Marche sur Rome, incapable de la contenir ; en réalité collaborationniste, deux ans plus tard, en 1924, il fut nommé sénateur à vie par Mussolini. »], si le Facta factorum eût été en mesure d’en soupçonner l’existence. Il faisait l’effet du café, sur ses nerfs molisans : et lui offrait par ailleurs tout le bouquet et toutes les nuances d’un vin de classe : les témoignages et les constatations modulées linguatico-palato-pharyngo-œsophagiques d’une introduction dionysiaque. Avec l’un ou deux de sté verres dans l’gosier, va savoir. »
« Et joignant en tulipe les cinq doigts de sa main droite, il fit osciller cette fleur dans l’hypotypose digito-interrogative si en usage chez les Apuliens [de la région des Pouilles]. »
« …] la mort apparut, à don Ciccio, une décomposition extrême des possibles, un détraquement d’idées interdépendantes, harmonisées jadis en la personne. Comme la dissolution d’une unité qui n’arrive plus à être et à œuvrer en tant que telle, dans la chute soudaine de ses rapports, de tout rapport avec la réalité organisatrice. »
« Il s’efforça de rassembler les évidences, si disjointes : de rapprocher les moments, les moments épuisés de l’enchaînement, du temps déchiré, mort. »
« Ce furent des allusions (et mieux que des allusions) « de caractère intime » lâchées par Balducci : en partie spontanément, comme en glissant, le chasseur-voyageur s’abandonnant à cette logorrhée spéciale à laquelle s’adonnent vaincues certaines âmes en peine, ou vaguement repenties sans doute de leurs écarts, dès que survient la phase de radoucissement, comme les bleus surviennent habituellement après les coups : par cicatrisation post-traumatique : alors qu’elles sentent, entre-temps, que le pardon les atteint, et du Christ et des hommes : en partie extraites de sa bouche, au contraire, avec la plus suave des ficelles par des argumentations courtoises, par une péroraison passionnée, par de vivaces clignements d’yeux, par une maïeutique irrésistible et par le charitable alanguissement du pavot et de l’héroïne venant tant du parler que du geste napolitains, du Golfe et du Vòmero : avec une action flatteuse en même temps que persuasive, tatràc ! d’arracheur de dents du genre aimable. »
« Elle savait inculquer, monnayant une honnête récompense, un quantum c’est-à-dire un tantinet d’énergie cinétique aux indécis, aux incertains : les conforter dans la pratique, les fortifier dans l’action. Avec dix lires, on achetait son médicament pour la faculté de vouloir. Avec dix lires supplémentaires, celle de pouvoir. Elle dékierkegaardisait les petits voyous de province en les canalisant pour qu’ils aillent « travailler » en ville, l’Urbe, après leur avoir détergé l’âme des dernières perplexités : ou des derniers scrupules. Elle indiquait le chemin aux audacieux, en leur montrant que les faibles créatures du sexe n’attendaient pas mieux, en ces années-là, que de s’appuyer sur quelqu’un, s’accrocher à quelque chose, qui fût apte à partager avec elles un orgasme sans mémoire, la douce peine de la vie : elle les catéchisait à la protection de la jeune fille, en concurrence avec l’association homonyme. Et les catéchumènes la tenaient pour leur institutrice, tout en la qualifiant entre un verre et l’autre de salope, quand ils pensaient qu’elle n’entendait pas, bien entendu, et de vieille savate et sorcière : étant donné la légèreté du siècle et leur grossièreté personnelle : et peut-être même la qualifiaient-ils de grosse cochonne, une Zamira Pàcori ! et de vieille maquerelle, tiens donc, une couturière comme elle ! une magicienne orientale avec diplôme de première classe ! Belle reconnaissance. Et qu’ils s’avaient mêm’ l’sacré culot d’en dire que les Deux-Saints… l’étaient… ‘ne paire de « j’sais pas si tu vois », accompagnant l’assertion d’une manucaptation-prolation impudente de la paire elle-même, quoique enveloppée dans l’« cheval », dans l’entrejambe : impudente, oh que si, mais assez fréquente, alors, dans les usages du peuple. Calomnies. Mauvaises langues. Pègre de paysans, qui la nuit va voler volailles. »
« La déception le réveilla d’un coup. Le temps dans lequel, dirions-nous, les rêves s’étendent a, au contraire, la rapidité diaphragmante d’un déclic de Leica, il se mesure en fulgurants tempuscules, en infinitésimaux du quatrième degré sur le temps orbital de la Terre, dit communément solaire, temps de César et de Grégoire. »
« Il essayait, il essayait de faire le bilan en raisonnant : de tirer les fils, pourrait-on dire, de l’inerte marionnette du probable. »
L’action se passe en 1927, et Gadda conspue régulièrement les fascistes, surtout Mussolini (et Hitler), ce qui n’est pas forcément manifeste dans une lecture superficielle.
J’ai déjà lu L’Affreux Pastis de la rue des Merles, traduction de Louis Bonalumi du même livre, mais il y a trop longtemps pour pouvoir comparer avec la présente traduction de Manganaro ; en tout cas j’ai retrouvé la même jubilation dans le rendu populaire, et plus généralement dans le bouillonnement stylistique, quelque chose entre Rabelais, Joyce et Céline.
\Mots-clés : #écriture #polar
- le Dim 15 Oct 2023 - 16:13
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Carlo Emilio Gadda
- Réponses: 34
- Vues: 3077
João Guimarães Rosa
Diadorim
Le titre original est Grande Sertão : veredas. Le sertão désigne les vastes régions semi-arides de l’intérieur du Brésil, où une population clairsemée vit surtout de l’élevage ; les chapadas, plateaux désertiques, sont parsemées de veredas, verdoyantes dépressions où l’eau se concentre, et donc la vie.
Riobaldo, surnommé Tatarana, ancien jagunço devenu fazendeiro (propriétaire d’une fazenda, ou vaste ferme), évoque devant le narrateur sa vie passée dans le sertão (les jagunços sont les hommes de main des fazendeiros, vivant en bandes armées et se livrant au brigandage, aussi considérés comme des preux).
« Vous le savez : le sertão c’est là où est le plus fort, à force d’astuces, fait la loi. Dieu lui-même, quand il s’amènera, qu’il s’amène armé. Et une balle est un tout petit bout de métal. »
« J’ai ramé une vie libre. Le sertão : ces vides qu’il est. »
« Le sertão est bon. Tout ici se perd ; tout ici se retrouve… disait le sieur Ornelas. Le sertão c’est la confusion dans un grand calme démesuré. »
Le sertão est hostile, mais a ses beautés, et les descriptions qui en sont données constituent un intérêt supplémentaire. À ce propos, l’emblématique buruti, c’est le palmier-bâche qui vit les pieds dans l’eau, le bem-te-vi, c’est le quiquivi, oiseau également fréquent en Guyane.
Riobaldo, comme beaucoup, ne connaît pas son père (en fait, à la mort de sa mère, il est recueilli par son parrain, qui serait son géniteur).
« L’homme voyage, il fait halte, repart : il change d’endroit, de femme – ce qui perdure c’est un enfant. »
Riobaldo parle de ses pensées qui l’obsèdent à propos du démon (qui a d’innombrables noms, dont « celui-qui-n’existe-pas ») : peut-on faire pacte avec lui ? Il parle aussi de Diadorim, son ami et amour, et des femmes qu’il aime. Il digresse, reprend le fil de son monologue : il évoque leur lieutenant, Medeiro Vaz, qui brûla sa fazenda, éparpilla les pierres de la tombe de sa mère pour aller mener une guerre de justice dans les hautes-terres, et leurs ennemis, les deux Judas félons (Hermὀgenes, protégé des enfers, et Ricardo) qui ont tué Joca Ramiro (père de Diadorim), et les soldats qui les combattent, et Zé Bebelo, stratège enjoué qui rêve de batailles et d’être député, puis remplace Medeiro Vaz à sa mort (et de qui Riobaldo fut percepteur, avant d’être dans le camp adverse, ce qui le tourmente). Car ce dernier narre dorénavant son existence depuis son enfance : comment il rencontra Reinaldo et fut séduit (ses amours sont plus généralement féminines, notamment la belle Otacilia, ou encore Norinha), Reinaldo qui lui confie s’appeler Diadorim.
À propos de la sensualité féminine, un passage qui rappelle Jorge Amado dans ses bonnes pages :
« L’une d’elles – Maria-des-Lumières – était brune : haute d’un huitième de cannelier. La chevelure énorme, noire, épaisse comme la fourrure d’un animal – elle lui cachait presque toute la figure, à cette petite mauresque. Mais la bouche était le bouton éclos, et elle s’offrait rouge charnue. Elle souriait les lèvres retroussées et avait le menton fin et délicat. Et les yeux eau-et-miel, avec des langueurs vertes, à me faire croire que j’étais à Goïas… Elle avait beaucoup de savoir-faire. Elle s’occupa aussitôt de moi. Ce n’était pas qu’une petite péronnelle.
L’autre, Hortense, une très gentille oiselle de taille moyenne, c’était Gelée-Blanche ce surnom parce qu’elle avait le corps si blanc ravissant, que c’était comme étreindre la froide blancheur de l’aube… Elle était elle-même jusqu’au parfum de ses aisselles. Et la ligne des reins, courbes ondulantes d’un ruisseau de montagne, confondait. De sorte que sa longueur exacte, vous n’arriviez jamais à la mesurer. Entre elles deux à la fois, je découvris que mon corps aussi avait ses tendretés et ses duretés. J’étais là, pour ce que je sais, comme le crocodile. »
Ce qui vaut surtout, c’est le monologue noté par son auditeur :
« Nous vivons en répétant, et bon, en une minime minute le répété dérape, et nous voilà déjà projetés sur une autre branche. »
Son récit décousu se commente lui-même, et sans doute l’auteur s’exprime-t-il lui-même par moments :
« Je sais que je raconte mal, je survole. Sans rectifier. Mais ce n’est pas pour donner le change, n’allez pas croire. […] Raconter à la suite, en enfilade, ce n’est vraiment que pour les choses de peu d’importance. De chaque vécu que j’ai réellement passé, de joie forte ou de peine, je vois aujourd’hui que j’étais chaque fois comme s’il s’agissait de personnes différentes. Se succédant incontrôlées. Tel je pense, tel je raconte. […] Et ce que je raconte n’est pas une vie d’homme du sertão, aurait-il été jagunço, mais la matière qui déborde. »
Riobaldo n’a jamais connu la peur, mais…
« Je sentis un goût de fiel sur le bout de ma langue. La peur. La peur qui vous coince. Qui me rattrapa au tournant. Un bananier prend le vent par tous les bords. L’homme ? C’est une chose qui tremble. Mon cheval me menait sans échéance. Les mulets et les ânes de la caravane, Dieu sait si je les enviais… Il y a plusieurs inventions de peur, je sais, et vous le savez. La pire de toutes est celle-ci : qui d’abord vous étourdit, et ensuite vous vide. Une peur qui commence d’emblée par une grande fatigue. Là où naissent nos énergies, je sentis qu’une de mes sueurs se glaçait. La peur de ce qui peut toujours arriver et qui n’est pas encore là. Vous me comprenez : le dos du monde. […] Je n’y arrivais pas, je ne pensais pas distinctement. La peur ne permettait pas. J’avais la cervelle embrumée, la tête me tournait. Je bus jusqu’à la lie le passage de la peur : je traversais un grand vide. »
« La peur manifeste provoque la colère qui châtie ; c’est bien tout ce à quoi elle sert. »
Le ton est celui du langage populaire, volontiers proverbial, traversé de fulgurances condensées voire lapidaires, très inventives et souvent poétiques, à l’encontre d’une rédaction rationnelle et claire. Allers-retours dans le temps de la remémoration (étonnamment riche, précise et détaillée), à l’instar des chevauchées et contre-marches de la troupe.
« Veuillez m’excuser, je sais que je parle trop, des à-côtés. Je dérape. C’est le fait de la vieillesse. Mais aussi, qu’est-ce qui vaut et qu’est-ce qui ne vaut pas ? Tout. Voyez plutôt : savez-vous pourquoi le remords ne me lâche pas ? Je crois que ce qui ne le permet pas c’est la bonne mémoire que j’ai. »
« Ah, mais je parle faux. Vous le sentez ? Si je démens ? Je démens. Raconter est très, très laborieux. Non à cause des années, passées depuis beau temps. Mais à cause de l’habileté qu’ont certaines choses passées – à faire le balancier, à ne pas rester en place. Ce que j’ai dit était-il exact ? Ça l’était. Mais ce qui était exact a-t-il été dit ? Aujourd’hui je crois que non. Ce sont tant d’heures passées avec les gens, tant de choses arrivées en tant de temps, tout se découpant par le menu. »
« Non, nenni. Je n’avais aucun regret. Ce que j’aurais voulu, c’était redevenir enfant, mais là, dans l’instant, si j’avais pu. J’en avais déjà plus qu’assez de leurs égarements à tous. C’est qu’à cette époque je trouvais déjà que la vie des gens va à vau-l’eau, comme un récit sans queue ni tête, par manque de joie et de jugement. La vie devrait être comme dans une salle de théâtre, et que chacun joue son rôle avec un bel entrain du début à la fin, qu’il s’en acquitte. C’était ce que je trouve, c’est ce que je trouvais. »
« Nous sommes des hommes d’armes, pour le risque de chaque jour et toutes les menues choses de l’air. »
« Mais les chemins sont ce qui gît partout sur la terre, et toujours les uns contre les autres ; il me revient que les formes les plus fausses du démon se reproduisent. Plus vous allez m’entendre, plus vous allez me comprendre. »
« On ne se met pas en colère contre le boa. Le boa étranglavale, mais il n’a pas de venin. Et il accomplissait son destin, tout réduire à un contenu. »
« La vie en invente ! On commence les choses, à l’obscur de savoir pourquoi, et dès lors le pouvoir de les continuer, on le perd – parce que la vie est le boulot de tous, triturée, assaisonnée par tous. »
« Tout cela pour vous, mon cher monsieur, ne tient pas debout, n’éclaire rien. Je suis là, à tout répéter par le menu, à vivre ce qui me manquait. Des choses minuscules, je sais. La lune est morte ? Mais je suis fait de ce que j’ai éprouvé et reperdu. De l’oublié. Je vais errant. Et se succédèrent nombre de petits faits. »
« Je sais : qui aime est toujours très esclave, mais ne se soumet jamais vraiment. »
« Qui le sait vraiment ce qu’est une personne ? Compte tenu avant tout : qu’un jugement est toujours défectueux, parce que ce qu’on juge c’est le passé. Eh, bé. Mais pour l’écriture de la vie, juger on ne peut s’en dispenser ; il le faut ? C’est ce que font seuls certains poissons, qui nagent en remontant le courant, depuis l’embouchure vers les sources. La loi est la loi ? Mensonge ! Qui juge, est déjà mort. Vivre est très dangereux, vraiment. »
La dernière phrase revient comme un leitmotiv dans le récit de Riobaldo :
« Vivre est très dangereux, je vous l’ai déjà dit. »
Apprécié en tant que bon tireur, Riobaldo parcourt donc le sertão qu’il aime, malgré les vicissitudes de cette existence itinérante, chevauchant de peines en batailles. Il médite sans cesse, sur la vie, l’amour, et par un curieux défi, dans sa haine d’Hermὀgenes qui aurait signé un pacte avec « l’Autre », décide d’en faire un lui aussi, bien qu’il ne croie ni à cette puissance maléfique, ni même à l’âme. Le démon ne se présente pas à la « croisée des chemins de Veredas-Mortes ».
« Alors, je ne sais ou non si j’ai vendu ? Je vous le dis : ma peur c’est ça. Tous la vendent, non ? Je vous le dis : de diable il n’y en a pas, le diable n’existe pas, et l’âme je la lui ai vendue… Ma peur, c’est ça. À qui l’ai-je vendue ? C’est ça, monsieur, ma peur : l’âme, on la vend, c’est tout, sans qu’il y ait acheteur… »
Cependant Riobaldo change. Lui, pour qui il n’était pas question de commander, devient le chef, Crotale-Blanc. Il reprend avec succès la traversée du Plan de Suçuarão, où avait échoué Medeiro Vaz, pour prendre à revers la fazenda d’Hermὀgenes.
Il y a encore les « pacants », rustres paysans croupissant dans la misère, victimes d’épidémies et des fazendeiros obnubilés par le profit, ou Siruiz, le jagunço poète, dont Riobaldo donne le nom à son cheval, ou encore le compère Quelémém, de bon conseil, évidemment Diadorim qu'il aime, et nombre d'autres personnages.
Ce livre-monde aux différentes strates-facettes (allégorie de la condition humaine, roman d’amour, épopée donquichottesque, geste initiatique – alchimique et/ou mythologique –, combat occulte du bien et du mal, cheminement du souvenir, témoignage ethnographique, récit de campagnes guerrières, etc.) est incessamment parcouru d’un souffle génial qui ramentoit Faust, mais aussi Ulysse (les deux).
Il est encore dans la ligne du fameux Hautes Terres (Os Sertões) d’Euclides da Cunha, par la démesure de la contrée comme de ceux qui y errent. L’esprit épique m’a aussi ramentu Borges et son exaltation des brigands de la pampa.
Sans chapitres, ce récit est un fleuve formidable dont le cours parfois s’accélère dans les péripéties de l’action, parfois s’alentit dans les interrogations du conteur : flot de parole, fil de pensée, flux de conscience. Et il vaut beaucoup pour la narration de Riobaldo ou, autrement dit, pour le style (c’est la façon de dire) rosien.
Le texte m’a paru excellemment rendu par la traductrice (autant qu’on puisse en juger sans avoir recours à l’original) ; cependant, il semble être difficilement réductible à une traduction, compte tenu de la langue créée par Rosa, inspirée du parler local et fort inventive.
\Mots-clés : #amour #aventure #contemythe #criminalite #ecriture #guerre #historique #initiatique #lieu #mort #nature #philosophique #portrait #ruralité #spiritualité #voyage
- le Ven 22 Sep 2023 - 13:06
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: João Guimarães Rosa
- Réponses: 26
- Vues: 1529
Junichiro TANIZAKI
Noir sur blanc
Mizuno, un écrivain reclus et cynique, dans la quarantaine et divorcé, à la réputation « démoniaque » (aujourd’hui nous dirions peut-être pervers), doute de sa santé mentale. En accoutumant progressivement sa conscience morale, il serait devenu capable de commettre un crime gratuit, et de le perpétrer sur la personne de Kojima, un type « enquiquinant » qu’il connaît à peine, au « teint vaguement bistre comme le cuir d’une vieille godasse » (modèle de Kodama dans le roman qu’il écrit à ce propos). Mais le crime (imaginaire) n’est pas si parfait : à cause des indices qui lui ont échappé, l’identité de son modèle n’est-il pas trop évidente ? Un malveillant inconnu ne pourrait-il pas commettre ce crime pour le faire condamner ?
Étant maladroitement intervenu auprès de la revue qui l’édite, Mizuno entreprend l’écriture d’une seconde partie qui reprend ce scénario, afin de se dédouaner.
« L’homme ne contrôle pas son esprit, son cerveau n’est que l’appareil de projection de son cinématographe intérieur ; un projecteur automatique pour tout dire, d’où jaillissent les monstres des films délirants qu’il a décidé de visionner et qu’il s’oblige à regarder. »
« Il n’avait pour ainsi dire écrit jusqu’ici que des romans criminels. Et le meurtrier était toujours peu ou prou inspiré de lui-même. Combien de gens avait-il tués au total dans ses romans ? Les victimes étaient toujours inspirées d’une personne réelle, elles aussi, même si la ressemblance n’était pas toujours aussi proche que cette fois-ci. Mais ceux qui connaissaient sa vie privée pouvaient deviner qui lui avait servi de modèle dans tel ou tel livre. D’ailleurs, si son épouse l’avait quitté, c’était bien parce qu’il en avait écrit trois ou quatre coup sur coup où le meurtrier assassinait sa propre femme. À l’époque, elle avait reçu plusieurs lettres de sympathie de la part de lecteurs. « Madame, votre mari est vraiment un monstre ! Quand j’imagine ce qu’ont dû être vos pensées en lisant ce livre… » Même les critiques professionnels préféraient déblatérer sur le nombre de fois qu’il avait trucidé son épouse plutôt que de faire de vraies critiques littéraires de ses livres. »
« Regretter la minute suivante son action de la minute précédente, voilà toute sa vie. Il aurait dû réfléchir avant de passer à l’acte, mais il se laissait toujours emporter par la pulsion du moment. »
Harcelé par son éditeur, Mizuno, qui mène une vie de bohème, se révèle à la fois impécunieux, pingre et dépensier, infatué, paresseux, assez retors et amateur de femmes ; il rencontre justement la « Fräulein Hindenburg », une jeune femme portée sur l’alcool, qui aurait vécu en Allemagne et lui propose un contrat de maîtresse à temps partiel. Elle l’entraîne trois jours dans une vie ensorcelante qui l’épuise, au terme de laquelle il apprend que Kojima a été tué. L’inspecteur Watanabe l’arrête.
Sorte d’autoportrait malicieux, c’est aussi l’exposé d’un délire paranoïaque à la frontière entre fiction et réalité, où entre beaucoup d’humour. J’ai particulièrement apprécié le début, ce méta-roman noir qui s’autoréférence en abyme.
Il y a aussi un regard d’époque sur l’Occident, notamment celui de Fräulein :
« Les Occidentaux trouvent normal que leur épouse dépense mille yens par mois. C’est pour cela qu’en Occident, on ne peut pas se marier si on n’est pas riche. Les Japonais, eux, se marient même s’ils n’ont pas un rond, et laissent leur femme déguenillée. C’est monstrueux, je trouve. Même si c’est aussi la faute des femmes puisqu’elles acceptent ce genre de mariage. »
\Mots-clés : #autofiction #ecriture
- le Mer 13 Sep 2023 - 12:30
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: Junichiro TANIZAKI
- Réponses: 77
- Vues: 9380
QIU Xiaolong
Il était une fois l'inspecteur Chen
Dans son préambule, Qiu Xiaolong rappelle qu’au début de la Révolution culturelle, dans les années cinquante, la « critique révolutionnaire de masse des ennemis de classe » du peuple caractérisait la dictature du prolétariat, et raconte comme son propre père, considéré comme un capitaliste, fut alors victime des Gardes rouges (récit de dégradation impitoyable qui à lui seul vaut la lecture).
Le roman lui-même commence comme Chen Cao, étudiant juste après la fin de la Révolution culturelle (et encore dans l’ombre de sa famille « noire »), prépare un mémoire sur Eliot (comme Xiaolong) dans la bibliothèque de Pékin, où travaille la ravissante Ling. Puis il devient policier, un peu par hasard, et s’engage dans sa première enquête, qui le replonge dans son passé (et la cité de la Poussière Rouge à Shanghai). Cette enquête, qui réunit les principales caractéristiques des romans de Xiaolong (la société chinoise contemporaine, la cuisine et la poésie chinoises), est plus un support (presque un prétexte) à évoquer les séquelles de la Révolution culturelle et ses iniques aberrations discriminatoires. C’est certes un polar, mais aussi et peut-être surtout un témoignage, à la fois historique et personnel.
« Monsieur » Fu a été assassiné ; Chen se renseigne, notamment lors des « conversations du soir » au quartier. L’homme fut accusé de capitalisme pour avoir ouvert un petit commerce de fruits de mer avant la campagne d’éradication des « Quatre Vieilleries » (« Vieilles idées, vieille culture, vieilles coutumes et vieilles habitudes »), et sa femme mourut à cause des bijoux où le couple avait placé ses gains :
« « Ensuite, elle a dû rester debout dans la rue, un tableau noir autour du cou avec son nom barré au-dessus de la phrase : Pour ma résistance contre la Révolution culturelle, je mérite de mourir des milliers de morts. Plus tard dans la nuit, pendant son supplice, elle est tombée et s’est cogné la tête contre l’évier commun. Elle ne s’est jamais réveillée. »
Fu, qui était délaissé de tous y compris ses enfants, reçut de l’État une compensation financière pour ces spoliations (après la réforme du camarade Deng Xiaoping), qui le rendit riche. Il prit une bonne, Meihua, qui lui concoctait de bons petits plats.
Cette affaire résolue, plusieurs autres sont rapidement narrées, autant d’étapes dans la carrière de l’intègre inspecteur. Autant de nouvelles aussi, qui illustrent la corruption dans une société qui combat officiellement la décadence et l’indécence dans une politique hostile à l’étranger, aux intellectuels. Également des souvenirs de jeunesse de Xiaolong (sans surprise, grand appétit pour la gastronomie et les livres, notamment occidentaux et à l’index), avec son amitié pour Lu le Chinois d’outre-mer, devenu un de ses personnages récurrents.
Cet ouvrage constitue un prequel des enquêtes de l’inspecteur Chen publiées auparavant, narrant sa jeunesse en la rapprochant de l’histoire de son auteur et de son pays d'origine. Il peut difficilement être lu uniquement comme un polar, et je comprends qu’Armor ait été déçue à sa lecture.
\Mots-clés : #autobiographie #discrimination #ecriture #historique #polar #politique #regimeautoritaire #revolutionculturelle #temoignage
- le Sam 12 Aoû 2023 - 13:03
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: QIU Xiaolong
- Réponses: 25
- Vues: 2800
Herve guibert
Je viens de terminer ce récit, dit d'autofiction, mais peu importe le flacon...
Où il est question de maladie et d'une mort annoncée, mais aussi d'un espoir fou de vivre, envers et contre tous, même contre soi...
1J'ai eu le sida pendant trois mois. Plus exactement, j'ai cru pendant trois mois que j'étais condamné par cette maladie mortelle qu'on appelle le sida. Or je ne me faisais pas d'idées, j'étais réellement atteint, le test qui s'était avéré positif en témoignait, ainsi que des analyses qui avaient démontré que mon sang amorçait un processus de faillite. Mais, au bout de trois mois, un hasard extraordinaire me fit croire, et me donna quasiment l'assurance que je pourrais échapper à cette maladie que tout le monde donnait encore pour incurable. De même que je n'avais avoué à personne, sauf aux amis qui se comptent sur les doigts d'une main, que j'étais condamné, je n'avouai à personne, sauf à ces quelques amis, que j'allais m'en tirer, que je serais, par ce hasard extraordinaire, un des premiers survivants au monde de cette maladie inexorable.
Où il est question d'une amitié trahie, de peur et de honte mais aussi d'une tentative, poignante et déterminée, de rachat par l'écriture...
34
(…) De quel droit écrivais-je tout cela ? De quel droit faisais-je de telles entailles à l’amitié? Et vis-à-vis de quelqu’un que j'adorais de tout mon cœur ? Je ressentis alors, c'étais inouï, une sorte de vision, ou de vertige, qui m'en donnait les pleins pouvoirs, qui me déléguait à ces transcriptions ignobles et les légitimaient et m’annonçant, c'était donc ce qu'on appelle une prémonition, un pressentiment puissant, que j'y étais pleinement habilité car ce n'était pas tant l'agonie de mon ami que j'étais en train de décrire que l'agonie qui m'attendait, et qui serait identique, c'était désormais une certitude qu'en plus de l'amitié nous étions liés par un sort thanatologique commun.
\Mots-clés : #autobiographie #ecriture #identitesexuelle #pathologie
- le Ven 28 Juil 2023 - 23:38
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Herve guibert
- Réponses: 2
- Vues: 220
W.G. Sebald
La Description du malheur − À propos de la littérature autrichienne
Dix essais portant sur Stifter, Schnitzler, Hofmannsthal, Kafka, Canetti, Thomas Bernhard, Peter Handke, Ernst Herbeck et Gerhard Roth (et aussi Walter Benjamin, voire Baudelaire).
Je suis toujours étonné de trouver des idées apparemment si actuelles, comme ici concernant l’environnement (Les Cartons est paru en 1841, et le recueil d'essais de Sebald en 1985) :
« Si, inspirées par une philosophie de la nature qui déplore la déperdition dont la vie organique souffre dans sa substance et sa diversité, les grandes nouvelles de Stifter ont pris la forme de mémoires conservateurs et nostalgiques, cela relève moins d’une politique réactionnaire que d’un engagement paracelsien qui s’oppose à une démarche se bornant à mesurer, à quantifier et à exploiter la nature. Avec Les Cartons de mon arrière-grand-père, Stifter a établi un code qui définit une pratique visant à octroyer les mêmes droits à l’homme et à la nature, mais qui, il est vrai, arrive déjà trop tard à la grande époque du capitalisme. »
Sebald se place ouvertement sous l’autorité de Freud, et ses analyses basées sur la sexualité sont parfois outrancières, en tout cas discutables :
« Il est de notoriété qu’un talent prononcé pour la pédagogie va la plupart du temps de pair avec des désirs pédophiles non assouvis. »
« Les lignes de séparation – le chiffre d’or que le regard fétichiste applique au corps féminin – procurent plaisir et souffrance et mènent pour finir, conformément au principe voulant que seule la nature segmentée livre son secret, à la salle d’anatomie ou à la pornographie. »
« La culture bourgeoise, depuis qu’elle s’est propagée, a inscrit à son programme, concernant aussi bien ceux qui écrivent que ceux qui lisent, un strict refoulement de l’intérêt pour les sujets érotiques. Paradoxalement, il se trouve que de concert, l’exploration de l’interdit est devenue la principale source d’inspiration de l’imaginaire littéraire. La tabouisation de l’érotisme a entraîné ce besoin impératif d’explicite qui, dans la littérature française, sous la houlette du Divin Marquis, donne accès au vaste champ des diverses obsessions. De Chateaubriand à Huysmans en passant par Baudelaire et Flaubert se développe sur fond d’orthodoxie bourgeoise une science hérétique qui trouve son bonheur dans l’identification et la description de ce qui est réprouvé et met en œuvre la théorie de l’excès conçue par Sade. »
« Mais ce sont précisément ces innocents tâtonnements de l’enfance, ainsi que Freud le souligne toujours, qui portent en germe toutes les perversions. »
Hormis cette psychanalyse douteuse, m’a desservi dans ma lecture le peu de présence à l’esprit des œuvres de ces auteurs (lorsque j’en ai lu au moins une partie) ; à lire donc en postface de ces livres. Reste que cette « grille interprétative ou psychologique » m’a profondément rebuté.
\Mots-clés : #ecriture #essai
- le Lun 8 Mai 2023 - 12:43
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: W.G. Sebald
- Réponses: 74
- Vues: 8388
Salman Rushdie
Quichotte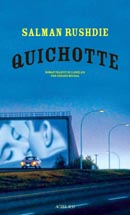
M. Ismail Smile, vieil États-unien originaire de Bombay et voyageur de commerce, est si addict aux « programmes télévisés ineptes » qu’il a glissé dans cette « réalité irréelle », suite à un mystérieux « Événement Intérieur ».
« Des acteurs qui jouaient des rôles de président pouvaient devenir présidents. L’eau pouvait venir à manquer. Une femme pouvait être enceinte d’un enfant qui se révélait être un dieu revenant sur terre. Des mots pouvaient perdre leur sens et en acquérir de nouveaux. »
« À l’ère du Tout-Peut-Arriver », sous le pseudonyme de Quichotte il se lance dans la quête amoureuse d’une vedette de télé, Miss Salma R., elle aussi d'origine indienne.
Quichotte se crée un « petit Sancho », un fils né de Salma dans le futur, inspiré du garçon rondouillard qu’il fut avant de devenir un adulte grand et mince
Ce premier chapitre a été écrit par l’écrivain Sam DuChamp, dit Brother, auteur de romans d’espionnage aux tendances paranoïaques, qui trouve en Quichotte une grande similitude avec sa propre situation.
« Ils étaient à peu près du même âge, l’âge auquel pratiquement tout un chacun est orphelin et leur génération qui avait fait de la planète un formidable chaos était sur le point de tirer sa révérence. »
Situation des immigrants indiens :
« Puis, en 1965, un nouvel Immigration and Nationality Act ouvrit les frontières. Après quoi, retournement inattendu, il s’avéra que les Indiens n’allaient pas, après tout, devenir une cible majeure du racisme américain. Cet honneur continua à être réservé à la communauté afro-américaine et les immigrants indiens, dont beaucoup étaient habitués au racisme des Blancs britanniques en Afrique du Sud et en Afrique de l’Est tout comme en Inde et en Grande-Bretagne, se sentaient presque embarrassés de se retrouver exonérés de la violence et des attaques raciales, et embarqués dans un devenir de citoyens modèles. »
Dans ce roman, Rushdie met en scène (de nouveau) l’état du monde, politique, culturel, en faisant des allers-retours des sociétés d’Asie du Sud à celles d’Occident.
« Une remarque, au passage, cher lecteur, si vous le permettez : on pourrait défendre l’idée que les récits ne devraient pas s’étaler de la sorte, qu’ils devraient s’enraciner dans un endroit ou dans un autre, y enfoncer leurs racines et fleurir sur ce terreau particulier, mais beaucoup de récits contemporains sont, et doivent être, pluriels, à la manière des plantes vivaces rampantes, en raison d’une espèce de fission nucléaire qui s’est produite dans la vie et les relations humaines et qui a séparé les familles, fait voyager des millions et des millions d’entre nous aux quatre coins du globe (dont tout le monde admet qu’il est sphérique et n’a donc pas de coins), soit par nécessité soit par choix. De telles familles brisées pourraient bien être les meilleures lunettes pour observer notre monde brisé. Et, au sein de ces familles brisées, il y a des êtres brisés, par la défaite, la pauvreté, les mauvais traitements, les échecs, l’âge, la maladie, la souffrance et la haine, et qui s’efforcent pourtant, envers et contre tout, de se raccrocher à l’espoir et à l’amour, et il se pourrait bien que ces gens brisés – nous, le peuple brisé ! – soient les plus fidèles miroirs de notre époque, brillants éclats reflétant la vérité, quel que soit l’endroit où nous voyageons, échouons, vivons. Car nous autres, les immigrants, nous sommes devenus telles les spores emportées dans les airs et regardez, la brise nous entraîne où elle veut jusqu’à ce que nous nous installions sur un sol étranger où, très souvent, comme c’est le cas par exemple à présent en Angleterre avec sa violente nostalgie d’un âge d’or imaginaire où toutes les attitudes étaient anglo-saxonnes et où tous les Anglais avaient la peau blanche, on nous fait sentir que nous ne sommes pas les bienvenus, quelle que soit la beauté des fruits que portent les branches des vergers de fruitiers que nous sommes devenus. »
À Londres, Sister (sœur de… Brother avec qui elle est brouillée), est une coléreuse « avocate réputée, s’intéressant tout particulièrement aux questions des droits civiques et aux droits de l’homme ».
« Sister était idéaliste. Elle pensait que l’État de droit était l’un des deux fondements d’une société libre, au même titre que la liberté d’expression. »
Le Dr R. K. Smile, riche industriel pharmaceutique cousin et employeur d’Ismail, se révèle être un escroc, distribuant fort largement ses produits opiacés.
Sancho Smile est une créature au second degré (imaginé par Quichotte imaginé par Brother) qui s’interroge sur son identité.
« Il y a un nom pour cela. Pour la personne qui est derrière l’histoire. Le vieux bonhomme, papa, dispose de plein d’éléments sur cette question. Il n’a pas l’air de croire en une telle entité, n’a pas l’air de sentir sa présence comme moi mais sa tête est tout de même remplie de pensées sur cette entité. Sa tête et par conséquent la mienne aussi. Il faut que je réfléchisse à cela dès maintenant. Je vais le dire ouvertement : Dieu. Peut-être lui et moi, Dieu et moi, pouvons-nous nous comprendre ? Peut-être pourrions-nous avoir une bonne discussion ensemble, puisque, vous savez, nous sommes tous deux imaginaires. »
« C’est simplement lui, papa, qui se dédouble en un écho de lui-même. C’est tout. Je vais me contenter de cela. Au-delà, on ne peut que sombrer dans la folie, autrement dit devenir croyant. »
« Il y a trois crimes que l’on peut commettre dans un pensionnat anglais. Être étranger, c’est le premier. Être intelligent, c’est le deuxième. Être mauvais en sports, c’est le troisième coup, vous êtes éliminé. On peut s’en sortir avec deux des trois défauts mais pas avec les trois à la fois. »
« Il y a des gens qui ont besoin de donner par la force une forme au caractère informe de la vie. Pour eux, l’histoire d’une quête est toujours très attirante. Elle les empêche de souffrir les affres de la sensation, comment dit-on, d’incohérence. »
Sancho est aussi un personnage (fictif) qui rêve d’émancipation, ombre de Quichotte et qui ne veut plus en être esclave. Tout ce chapitre 6 où il parle forme un morceau d’anthologie sur le sens de l’existence et de la littérature, via l’intertextualité. Ainsi, en référence à Pinocchio :
« “Grillo Parlante, à ton service, dit le criquet. C’est vrai, je suis d’origine italienne. Mais tu peux m’appeler Jiminy si tu veux. […]
Je suis une projection de ton esprit, exactement comme tu as commencé toi-même par être une projection du sien. Il semble que tu devrais bientôt avoir une insula. »
Salma, bipolaire issue d’une lignée féminine de belles vedettes devenues folles, est dorénavant superstar dans son talk-show (en référence assumée à Oprah Winfrey) ; elle s’adonne à « l’automédication » avec des « opiacés récréatifs ».
« Elle était une femme privilégiée qui se plaignait de soucis mineurs. Une femme dont la vie se déroulait à la surface des choses et qui, ayant choisi le superficiel, n’avait pas le droit de se plaindre de l’absence de profondeur. »
Road-trip où le confiant, souriant et bavard Quichotte emmène Sancho, qui découvre la réalité, les USA, la télé :
« Nous sommes sous-éduqués et suralimentés. Nous sommes très fiers de qui vous savez. Nous fonçons aux urgences et nous envoyons Grand-Mère nous chercher des armes et des cigarettes. Nous n’avons besoin d’aucun allié pourri parce que nous sommes stupides et vous pouvez bien nous sucer la bite. Nous sommes Beavis et Butt-Head sous stéroïdes. Nous buvons le Roundup directement à la canette. Notre président a l’air d’un jambon de Noël et il parle comme Chucky. C’est nous l’Amérique, bordel. Zap. Les immigrants violent nos femmes tous les jours. Nous avons besoin d’une force spatiale à cause de Daech. Zap. […]
“Le normal ne me paraît pas très normal, lui dis-je.
– C’est normal de penser cela”, répond-il. […]
Chaque émission sur chaque chaîne dit la même chose : d’après une histoire vraie. Mais cela non plus ce n’est pas vrai. La vérité, c’est qu’il n’y a plus d’histoires vraies. Il n’existe plus de vérité sur laquelle tout le monde peut s’accorder. »
… et la vie en motels, qui nous vaut cette belle énumération d’images :
« Ce qu’il y a, surtout, ce sont des ronflements. La musique des narines américaines a de quoi vous impressionner. La mitrailleuse, le pivert, le lion de la MGM, le solo de batterie, l’aboiement du chien, le jappement du chien, le sifflet, le moteur de voiture au ralenti, le turbo d’une voiture de course, le hoquet, les grognements en forme de SOS, trois courts, trois longs, trois courts, le long grondement de la vague, le fracas plus menaçant des roulements de tonnerre, la brève explosion d’un éternuement en plein sommeil, le grognement sur deux tons du joueur de tennis, la simple inspiration/expiration ordinaire ou ronflement classique, le ronflement irrégulier, toujours surprenant, avec, de temps en temps, des pauses imprévisibles, la moto, la tondeuse à gazon, le marteau-piqueur, la poêle grésillante, le feu de bois, le stand de tir, la zone de guerre, le coq matinal, le rossignol, le feu d’artifice, le tunnel à l’heure de pointe, l’embouteillage, Alban Berg, Schoenberg, Webern, Philip Glass, Steve Reich, le retour en boucle de l’écho, le bruit d’une radio mal réglée, le serpent à sonnette, le râle d’agonie, les castagnettes, la planche à laver musicale, le bourdonnement. »
« En fait, voilà : quand je m’éveille le matin et que j’ouvre la porte de la chambre, je ne sais pas quelle ville je vais découvrir dehors, ni quel jour de la semaine, du mois ou de l’année on sera. Je ne sais même pas dans quel État nous allons nous trouver, même si cela me met dans tous mes états, merci bien. C’est comme si nous demeurions immobiles et que le monde nous dépassait. À moins que le monde ne soit une sorte de télévision, mais je ne sais pas qui détient la télécommande. Et s’il y avait un Dieu ? Serait-ce la troisième personne présente ? Un Dieu qui, au demeurant, nous baise, moi, les autres, en changeant arbitrairement les règles ? Et moi qui croyais qu’il y avait des règles pour changer les règles. Je pensais, même si j’accepte l’idée que quelqu’un virgule quelque chose a créé tout ceci, ce quelque chose virgule ce quelqu’un n’est-il, virgule ou n’est-elle, pas lié.e par les lois de la création une fois qu’il, ou elle, l’a achevée ? Ou peut-il virgule, peut-elle hausser les épaules et déclarer finie la gravité, et adieu, et nous voici flottant tous dans le vide ? Et si cette entité, appelons-la Dieu, pourquoi pas, c’est la tradition, peut réellement changer les règles tout simplement parce qu’elle est d’humeur à le faire, essayons de comprendre précisément quelle est la règle qui est changée en l’occurrence. »
Ils arrivent à New-York.
« Il y a deux villes, dit Quichotte. Celle que tu vois, les trottoirs défoncés de la ville ancienne et les squelettes d’acier de la nouvelle, des lumières dans le ciel, des ordures dans les caniveaux, la musique des sirènes et des marteaux-piqueurs, un vieil homme qui fait la manche en dansant des claquettes, dont les pieds disent, j’ai été quelqu’un, dans le temps, mais dont les yeux disent, c’est fini, mon gars, bien fini. La circulation sur les avenues et les rues embouteillées. Une souris qui fait de la voile sur une mare dans le parc. Un type avec une crête d’Iroquois qui hurle en direction d’un taxi jaune. Des mafieux affranchis avec une serviette coincée sous le menton dans une gargote italienne de Harlem. Des gars de Wall Street qui ont tombé la veste et se commandent des bouteilles d’alcool dans des night-clubs ou se prennent des shots de tequila et se jettent sur les femmes comme sur des billets de banque. De grandes femmes et de petits gars chauves, des restaurants à steaks et des boîtes de strip-tease. Des vitrines vides, des soldes définitifs, tout-doit-disparaître, un sourire auquel manquent quelques-unes de ses meilleures dents. Des travaux partout mais les conduites de vapeur continuent à exploser. Des hommes qui portent des anglaises avec un million de dollars en diamants dans la poche de leur long manteau noir. Ferronnerie. Grès rouge. Musique. Nourriture. Drogues. Sans-abris. Chasse-neige, baseball, véhicules de police labellisés CPR – courtoisie, professionnalisme, respect –, que-voulez-vous-que-je-vous-dise, ils-ne-manquent-pas-d’humour. Toutes les langues de la Terre, le russe, le panjabi, le taishanais, le créole, le yiddish, le kru. Et sans oublier le cœur battant de l’industrie de la télévision, Colbert au Ed Sullivan Theater, Noah dans Hell’s Kitchen, The View, The Chew, Seth Meyers, Fallon, tout le monde. Des avocats souriants sur les chaînes du câble qui promettent de vous faire gagner une fortune s’il vous arrive un accident. Rock Center, CNN, Fox. L’entrepôt du centre-ville où est tourné le show Salma. Les rues où elle marche, la voiture qu’elle prend pour rentrer chez elle, l’ascenseur vers son appartement en terrasse, les restaurants d’où elle fait venir ses repas, les endroits qu’elle connaît, ceux qu’elle fréquente, les gens qui ont son numéro de téléphone, les choses qu’elle aime. La ville tout entière belle et laide, belle dans sa laideur, jolie-laide, c’est français, comme la statue dans le port. Tout ce qu’on peut voir ici.
– Et l’autre ville ? demanda Sancho, sourcils froncés. Parce que ça fait déjà pas mal, tout ça.
– L’autre ville est invisible, répondit Quichotte, c’est la cité interdite, avec ses hauts murs menaçants bâtis de richesse et de pouvoir, et c’est là que se trouve la réalité. Ils sont très peu à détenir la clef qui permet d’accéder à cet espace sacré. »
Après avoir « renoncé à la croyance, à l’incroyance, à la raison et à la connaissance », ils doivent parvenir dans la « quatrième vallée » au détachement, là où « ce qu’on appelle communément « la réalité », qui est en réalité l’irréel, comme nous le montre la télévision, cessera d’exister. »
Quichotte envoie des lettres à Salma, puis sa photo, qui rappelle à celle-ci Babajan, son « grand-père pédophile ».
« Ma chère Miss Salma,
Dans une histoire que j’ai lue, enfant, et que, par une chance inespérée, vous pouvez voir aujourd’hui portée à l’écran sur Amazon Prime, un monastère tibétain fait l’acquisition du super-ordinateur le plus puissant du monde parce que les moines sont convaincus que la mission de leur ordre est de dresser la liste des neuf milliards de noms de Dieu et que l’ordinateur pourrait les aider à y parvenir rapidement et avec précision. Mais apparemment, il ne relevait pas de la seule mission de leur ordre d’accomplir cet acte héroïque d’énumération. La mission relevait également de l’univers lui-même, si bien que, lorsque l’ordinateur eut accompli sa tâche, les étoiles, tout doucement et sans tapage aucun, se mirent à disparaître. Mes sentiments à votre égard sont tels que je suis persuadé que tout l’objectif de l’univers jusqu’à présent a été de faire advenir cet instant où nous serons, vous et moi, réunis dans les délices éternelles et que, quand nous y serons parvenus, le cosmos, ayant atteint son but, cessera paisiblement d’exister et que, ensemble, nous entamerons alors notre ascension au-delà de l’annihilation pour pénétrer dans la sphère de l’Intemporel. »
« Autrefois, les gens croyaient vivre dans de petites boîtes, des boîtes qui contenaient la totalité de leur histoire et ils jugeaient inutile de se préoccuper de ce que faisaient les autres dans leurs autres petites boîtes, qu’elles soient proches ou lointaines. Les histoires des autres n’avaient rien à voir avec les leurs. Mais le monde a rétréci et toutes les boîtes se sont trouvées bousculées les unes contre les autres et elles se sont ouvertes et à présent que toutes les boîtes sont reliées les unes aux autres il nous faut admettre que nous devons comprendre ce qui se passe dans les boîtes où nous ne sommes pas, faute de quoi nous ne comprenons plus la raison de ce qui se passe dans nos propres boîtes. Tout est connecté. »
Quichotte a (comme Brother) une demi-sœur, « Trampoline », avec qui il s’est brouillé en l’accusant de détournement de leur héritage, devenue une défenderesse des démunis, et dont il voudrait maintenant se faire pardonner.
« Il n’accordait guère de temps aux chaînes d’actualités et d’informations, mais quand il les regardait distraitement il voyait bien qu’elles aussi imposaient un sens au tourbillon des événements et cela le réconfortait. »
Son, le fils de Brother, s’est aussi éloigné de ce dernier depuis des années, « passant tout son temps, jour et nuit, perdu quelque part dans son ordinateur, à s’immerger dans des vidéos musicales, jouer aux échecs en ligne ou mater du porno, ou Dieu sait quoi. »
Un agent secret (nippo-américain) apprend à Brother que son fils serait le mystérieux Marcel DuChamp, cyberterroriste qui porte le masque de L’Homme de la Manche, et l’engage à le convertir à servir les USA dans cette « Troisième Guerre mondiale ».
« Je ne suis pas critique littéraire mais je pense que vous expliquez au lecteur que le surréel, voire l’absurde, sont potentiellement devenus la meilleure façon de décrire la vraie vie. Le message est intéressant même s’il exige parfois, pour y adhérer, un considérable renoncement à l’incrédulité. »
Le destin d’Ignatius Sancho, esclave devenu abolitionniste, écrivain et compositeur en Grande-Bretagne, est évoqué à propos.
« Les réseaux sociaux n’ont pas de mémoire. Aujourd’hui, le scandale se suffisait à lui-même. L’engagement de Sister, toute une vie durant, contre le racisme, c’était comme s’il n’avait jamais existé. Différentes personnes qui se posaient en chefs de la communauté étaient prêtes à la dénoncer, comme si faire de la musique à fond tard le soir était une caractéristique indéniable de la culture afro-caribéenne et que toute critique à son égard ne pouvait relever que du préjugé, comme si personne n’avait pris la peine de remarquer que la grande majorité des jeunes buveurs nocturnes, ceux qui faisaient du scandale ou déclenchaient des bagarres, étaient blancs et aisés. »
« Mais aujourd’hui c’était le règne de la discontinuité. Hier ne signifiait plus rien et ne pouvait pas nous aider à comprendre demain. La vie était devenue une suite de clichés disparaissant les uns après les autres, un nouveau posté chaque jour et remplaçant le précédent. On n’avait plus d’histoire. Les personnages, le récit, l’histoire, tout cela avait disparu. Seule demeurait la plate caricature de l’instant et c’est là-dessus qu’on était jugé. Avoir vécu assez longtemps pour assister au remplacement, par sa simple surface, de la profonde culture du monde qu’elle s’était choisi était une bien triste chose. »
Trampoline est passée par un cancer qui lui a valu une double mastectomie, et elle recouvrit confiance en elle grâce à Evel Cent (Evil Scent, « mauvaise odeur » – Elon Musk !), un techno-milliardaire qui prétend sauver l’humanité en lui faisant quitter notre planète dans un monde en voie de désintégration ; Quichotte la brouilla avec lui, actuellement invité de Salma dans son talk-show. Trampoline révèle à Sancho que son « Événement Intérieur » fut une attaque cérébrale, et Quichotte obtient le pardon de ses offenses envers elle, rétablissant ainsi l’harmonie, prêt pour la sixième vallée, celle de l’Émerveillement.
« La mort de Don Quichotte ressemblait à l’extinction, en chacun d’entre nous, d’une forme particulière de folie magnifique, une grandeur innocente, une chose qui n’a plus sa place ici-bas, mais qu’on pourrait appeler l’humanité. Le marginal, l’homme dont on ridiculise la déconnexion d’avec la réalité, le décalage radical et l’incontestable démence, se révèle, au moment de sa mort, être l’homme le plus précieux d’entre tous et celui dont il faut déplorer la perte le plus profondément. Retenez bien cela. Gardez-le à l’esprit plus que tout. »
Brother retrouve Sister à Londres, qui se meurt d’un cancer (elle aussi), pour présenter ses excuses alors qu’il n’a pas souvenir de ses torts. Elle lui apprend que leur père avait abusé d’elle.
« C’était déconcertant à un âge aussi avancé de découvrir que votre récit familial, celui que vous aviez porté en vous, celui dans lequel, dans un sens, vous aviez vécu, était faux, ou, à tout le moins, que vous en aviez ignoré la vérité la plus essentielle, qu’elle vous avait été cachée. Si l’on ne vous dit pas toute la vérité, et Sister avec son expérience de la justice le savait parfaitement bien, c’est comme si on vous racontait un mensonge. Ce mensonge avait constitué sa vérité à lui. C’était peut-être cela la condition humaine : vivre dans des fictions créées par des contre-vérités ou par la dissimulation des vérités réelles. Peut-être la vie humaine était-elle dans ce sens véritablement fictive, car ceux qui la vivaient ne savaient pas qu’elle était irréelle.
Et puis il avait écrit sur une gamine imaginaire dans une famille imaginaire et il l’avait dotée d’un destin très proche de celui de sa sœur, sans même savoir à quel point il s’était approché de la vérité. Avait-il, quand il était enfant, soupçonné quelque chose, puis, effrayé de ce qu’il avait deviné, avait-il enfoui cette intuition si profondément qu’il n’en gardait aucun souvenir ? Et est-ce que les livres, certains livres, pouvaient accéder à ces chambres secrètes et faire usage de ce qu’ils y trouvaient ? Il était assis au chevet de Sister rendu sourd par l’écho entre la fiction qu’il avait inventée et celle dans laquelle on l’avait fait vivre. »
Sister et son mari (un juge qui aime s’habiller en robe de soirée) se suicident ensemble avec le « spray InSmileTM » qu’il a apporté à sa demande. Le Dr R. K. Smile charge Quichotte d’une livraison du même produit pour… Salma !
« …] elle passait à la télévision, sur le mode agressif, son monologue introductif portant le titre de “Errorisme en Amérique” ce qui lui permettait à elle et à son équipe de scénaristes de s’en prendre à tous les ennemis de la réalité contemporaine : les adversaires de la vaccination, les fondus du changement climatique, les nouveaux paranoïaques, les spécialistes des soucoupes volantes, le président, les fanatiques religieux, ceux qui affirment que Barack Obama n’est pas né en Amérique, ceux qui soutiennent que la Terre est plate, les jeunes prêts à tout censurer, les vieux cupides, les trolls, les clochards bouddhistes, les négationnistes, les fumeurs d’herbe, les amoureux des chiens (elle détestait qu’on domestique les animaux) et la chaîne Fox. “La vérité, déclamait-elle, est toujours là, elle respire encore, ensevelie sous les gravats des bombes de la bêtise. »
Des troubles visuels et d’autres signes rappellent la théorie de l’effilochement de la réalité dans un cosmos en amorce de désagrégation.
Le nouveau Galaad rencontre Salma pour lui remettre cette « potion » qui devait la rendre amoureuse de lui ; son message d’amour ne passe pas, et Salma fait une overdose avec le produit du Dr R. K. Smile, qui est arrêté pour trafic de stupéfiants (bizarrement, se greffe un chef d’inculpation portant sur son comportement incorrect avec les femmes…).
Maintenant, la télévision s’adresse directement à Quichotte, et son pistolet lui conseille de tuer Salma, sortie de l’hôpital mais dorénavant inatteignable. Sancho, qui lui aussi s’est trouvé une dulcinée et s’émancipe de plus en plus, agresse sa tante pour la voler ; il a changé depuis qu’il a été victime d’une agression raciste.
« Depuis qu’il avait été passé à tabac dans le parc, Sancho avait eu l’impression que quelque chose n’allait pas en lui, rien de physique, plutôt un trouble d’ordre existentiel. Quand vous avez été sévèrement battu, la part essentielle de vous-même, celle qui fait de vous un être humain, peut se détacher du monde comme si le moi était un petit bateau et que l’amarre le rattachant au quai avait glissé de son taquet laissant le canot dériver inéluctablement vers le milieu du plan d’eau, ou comme si un grand bateau, un navire marchand, par exemple, se mettait, sous l’effet d’un courant puissant, à chasser sur son ancre et courait le risque d’entrer en collision avec d’autres navires ou de s’échouer de manière désastreuse. Il comprenait à présent que ce relâchement n’était peut-être pas seulement d’ordre physique mais aussi éthique, que, lorsqu’on soumettait quelqu’un à la violence, la violence entrait dans la catégorie de ce que cette personne, jusque-là pacifique et respectueuse des lois, allait inclure ensuite dans l’éventail des possibilités. La violence devenait une option. »
Des « ruptures dans le réel » et autres « trous dans l’espace-temps » signalent de plus en plus l’imminente fin du monde.
Dans des propos tenus à son fils Son, « l’Auteur » met en abyme dans la fiction le projet de l’auteur.
« “Tant de grands écrivains m’ont guidé dans cette voie”, dit-il ; et il cita aussi Cervantès et Arthur C. Clarke. “C’est normal de faire ça ? demanda Son, ce genre d’emprunt ?” Il avait répondu en citant Newton, lequel avait déclaré que s’il avait été capable de voir plus loin c’était parce qu’il s’était tenu sur les épaules de géants. »
« Il essaya de lui expliquer la tradition picaresque, son fonctionnement par épisodes, et comment les épisodes d’une œuvre de ce genre pouvaient adopter des styles divers, relevé ou ordinaire, imaginatif ou banal, comment elle pouvait être à la fois parodique et originale et ainsi, au moyen de ses métamorphoses impertinentes, mettre en évidence et englober la diversité de la vie humaine. »
« Je pense qu’il est légitime pour une œuvre d’art contemporaine de dire que nous sommes paralysés par la culture que nous avons produite, surtout par ses éléments les plus populaires, répondit-il. Et par la stupidité, l’ignorance et le sectarisme, oui. »
Dans la septième vallée, celle de l’annihilation d’un monde apocalyptique livré aux vides, Quichotte (et son pistolet) convainc Salma d’aller avec lui au portail d’Evel Cent en Californie pour fuir dans la Terre voisine : celle de l’Auteur.
C’est excellemment conté, plutôt foutraque et avec humour, mais en jouant de tous les registres de la poésie au polar en passant par le picaresque ; relativement facile à suivre, quoique les références, notamment au show business, soient parfois difficiles à saisir pour un lecteur français. Beaucoup de personnages et d’imbroglios dans cette illustration de la complexité du monde. De nombreuses mises en abîme farfelues, comme l’histoire des mastodontes (dont certains se tenant sur les pattes arrière et portant un costume vert), perturbent chacun des deux fils parallèles en miroir (celui de Quichotte et celui de Brother), tout en les enrichissant. Récurrences (jeu d’échec, etc.), intertextualité (le « flétan », qui rappelle Günter Grass, etc.). J’ai aussi pensé à Umberto Eco, Philip K. Dick.
\Mots-clés : #Contemporain #ecriture #famille #Identite #immigration #initiatique #Mondialisation #racisme #sciencefiction #XXeSiecle
- le Sam 4 Mar 2023 - 12:51
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Salman Rushdie
- Réponses: 18
- Vues: 1485
Guéorgui Gospodinov
Un roman naturel
Un écrivain avec ses fauteuil à bascule, pipe et tabac, qui divorce et en voie de clochardisation (à moins que ce ne soit un autre !) : thème incessamment repris avec autant d’amorces de romans et de registres différents, dans ce qui semble un fourre-tout de réflexions lâchement cousu. Au chapitre 3, le rédacteur-auteur explicite son projet :
« Flaubert rêvait d’écrire « un livre sur rien », un livre sans aucune intrigue extérieure, « qui se tiendrait de lui-même, par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air ». Proust a réalisé ce rêve jusqu’à un certain point, en s’appuyant sur la mémoire involontaire. Mais lui non plus n’a pu échapper à la tentation de recourir à l’intrigue. J’ai le désir immodeste de bâtir un roman uniquement à partir de débuts. Un roman qui parte sans cesse, promette quelque chose, atteigne la dix-septième page et recommence depuis le début. L’idée, ou plutôt le principe originel d’un tel roman, je l’ai découverte dans la philosophie antique, surtout chez la Trinité de la philosophie de la nature : Empédocle, Anaxagore, Démocrite. Le roman des débuts reposerait sur ces trois baleines. Empédocle tient à un nombre restreint de principes originels et ajoute aux quatre éléments fondamentaux (la terre, l’air, le feu et l’eau) l’Amour et la Haine qui les meuvent et réalisent leurs combinaisons. C’est Anaxagore qui se montrait le plus étroitement associé à mon roman. L’idée de panspermies, ou semences des choses (plus tard, Aristote les nomme homéoméries, mais ce mot a une résonance bien plus froide et impersonnelle) pouvait se transformer en puissance fécondante de ce roman. Un roman créé à partir d’un nombre infini de particules, de substances premières, bref de débuts, qui entrent dans des combinaisons illimitées. Puisque Anaxagore affirme que toute chose concrète est constituée de petites particules semblables à elle, alors le roman pourrait être édifié uniquement sur des débuts. C’est ce que j’ai décidé de tenter, à partir de débuts de romans devenus des classiques. Je pourrais aussi les appeler « atomes » pour rendre hommage à Démocrite. Un roman atomiste, fait de débuts flottant dans le vide. »
Sont cités ensuite les incipit de plusieurs romans, supposés interagir intertextuellement.
« Le monde est une chose et le roman est ce qui l’assemble. Les débuts sont donnés, les combinaisons innombrables. »
Aussi une histoire des W.-C., des souvenirs apparemment autobiographiques, des rêves, une histoire des mouches, se rattachant peu ou prou à la littérature.
« Un roman à facettes, évoquant la vue de la mouche. »
Aussi beaucoup de réflexions sur le(s) verbe(s), la langue, la création : ainsi, les Notes du naturaliste, fabuleuse histoire mise en abyme de l’allégorie du déséquilibre foucaldien « qui se creuse entre le nom des choses et les choses elles-mêmes. »
« Je dois avoir recours à une autre langue. J’essaie avec le jardinage. Le dire dans la langue des plantes, utiliser leur langue silencieuse, qui ne parle qu’avec des formes. »
« J’ai compris que c’était dans les livres, et pas dans tous, seulement dans les romans, et encore pas tous, dans quelques-uns soigneusement choisis (je les ai mais je ne dirai jamais leur nom), que se cachent les mots-mères, prêts à s’envoler et à essaimer ce que je ne sais nommer. Comment ai-je pu, jusqu’à présent, garder ces livres parmi les autres, les laisser effleurer de leur couverture contagieuse celle des livres innocents ? »
Le roman tourne en quelque sorte en rond, ayant des difficultés à trouver une fin, toujours fluidement lisible et captivant. C’est surtout un prodigieux imaginaire rabelaisien, une pépinière d'inventions romanesques auxquels j’ai été fort sensible. Il fait référence notamment aux philosophes présocratiques, à Linné, Eliot et Salinger ; on pourra penser à Si par une nuit d'hiver un voyageur de Calvino, et bien sûr à toute la fécondité oulipienne.
\Mots-clés : #creationartistique #ecriture #universdulivre
- le Mar 28 Fév 2023 - 12:02
- Rechercher dans: Écrivains d'Europe centrale et orientale
- Sujet: Guéorgui Gospodinov
- Réponses: 19
- Vues: 778
Carlos Liscano
Le lecteur inconstant suivi de Vie du corbeau blanc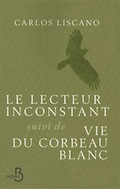
Directement dans le prolongement de L'Écrivain et l'autre, et dans une sorte de journal intime à la campagne où il vit avec son chien, Liscano médite sur l’écriture. À l’isolement en prison il s’est inventé écrivain, délire et reconstruction à la fois, il a continué à incarner ce personnage, ce nouveau Liscano à sa sortie (et il réclame pour qu’on lui rende ses papiers confisqués en détention voilà un quart de siècle).
« Le contraire de la patience n’est pas l’impatience mais l’inquiétude. » 3
« Si le langage crée l’individu, l’écriture crée l’écrivain, puisqu’il n’existe qu’en écrivant. » 5
« L’indicible est à l’origine, c’est la raison de l’écriture, et il en sera toujours ainsi. Personne ne peut se proposer de dire l’indicible. On rôde autour, c’est la seule chose qu’on puisse faire. En tournant autour, on parvient à signaler sa présence. Il sera signalé, mais il restera toujours non dit. » 8
« Hier soir, j’ai rêvé d’un texte qui suivait l’ordre de la nature. Il était comme l’herbe, il poussait sans prétention, il était plein de détails, de ramifications. Des accidents survenaient, une brindille volait et changeait l’aspect d’un endroit qui avait déjà son ordre. Le vent faisait de petites vagues dans une flaque laissée par la pluie. Le texte poussait, telle une maille très fine, très délicate, il avançait, couvrait l’espace. Il ne se proposait rien, ne voulait rien démontrer, seulement pousser et s’étendre. Je le vois maintenant : le texte, c’était moi, qui me proposais seulement d’être là, plutôt que d’être tout court. » 16
« On écrit parce qu’il manque un livre. Parce qu’on croit qu’il manque un livre. Ça, je ne le savais pas quand j’ai commencé à écrire. La notion de "livre qui manque" est indispensable pour se mettre à écrire. Car si on ne croit pas que quelqu’un doit écrire ce livre qui n’existe pas, à quoi bon l’écrire ? » 16
Malgré son impuissance à écrire de la fiction depuis son retour de Suède voilà dix ans, il projette « le corbeau ».
« Juillet 2007. J’ai lu il y a quelques jours une petite fable de Tolstoï qui m’a fait rire. Je me suis tout de suite mis à la réécrire de différentes façons. Depuis, je continue. Le personnage (le mien) est un corbeau menteur qui raconte, comme s’il les avait vécues lui-même, des histoires qui ne lui sont jamais arrivées. Je prends des histoires écrites par d’autres et je les réécris. Une apologie du plagiat, en quelque sorte. Je trouve ça tellement bizarre de travailler sur un personnage non humain que ce seul fait me pousse à continuer. » 18
Liscano parle de son attirance pour le travail manuel (créatif ou pas).
« Pendant que je jouais avec mes mains, ma réflexion était toujours la même : comment faire pour raconter et se raconter ? C’est la seule chose que j’aie voulu faire depuis que je me connais. […]
Il n’y a rien au-delà du langage. Là finit la réflexion. Toute tentative de franchir la limite aboutit à l’incompréhensible, à la tâche sans signification, au silence. Mais la tâche et le silence s’intègrent au long récit qui me définit. Je suis toujours là où j’ai été ces trente dernières années, dans les mêmes questions. Je n’ai pas avancé. Avancer est une illusion. Celui que je serai demain est dans celui que je suis aujourd’hui.
L’écriture est un ordre qui traite de l’ordre du monde. Il faut créer un monde parallèle, complet, total, qui inclue tout ce que contient le monde, mais en dehors du monde. Il doit donc aussi m’inclure, moi. Je suis parce que je m’écris.
Ce devrait être la même chose avec le dessin : dessiner un monde qui soit aussi complet que le monde. Il faudrait tout dessiner, le monde et chaque chose du monde, les formes existantes et les formes imaginées, tous les triangles et l’idée de triangle, toute la Terre et chaque chose de la Terre, les plantes, les arbres, les animaux, les enfants, les femmes, les hommes, les vivants, les morts, les vêtements, les outils, les choses utiles et les choses inutiles, l’escalier, le hamac, le chemin empierré, la voiture, la cheminée, le bruit de l’extracteur de fumée qui tourne dans la cheminée, le soleil de cinq heures du matin et celui de trois heures de l’après-midi, l’accablement du soleil de trois heures de l’après-midi et le coucher du soleil sur le fleuve, le fleuve et les poissons du fleuve, les pêcheurs au bord du fleuve, la canne à pêche, la fumée de la cigarette du pêcheur, le poisson dans la poêle et le poisson avec du riz dans l’assiette, tous les nombres naturels et toutes les pendules à toutes les heures, les nombres entiers, les irrationnels, les réels, les imaginaires, les transfinis, tous les théorèmes et le désert, la mer et l’idée de l’eau, l’eau, la sensation de soif et le réservoir d’où je tire l’eau, toutes les victimes, tous les bourreaux, tous les innocents et tous les coupables, le chien qui dort, le chien quand il court dans la campagne et la fidélité du chien, la chaise sur laquelle je suis assis et l’atelier où se trouve la chaise, le jour que nous sommes et l’année 2008, le vent d’été qui n’apaise pas et la sécheresse, l’hiver et le givre sur la campagne, les pommes sur l’arbre et chaque arbre dans le champ de pommiers, les objets qui sont sur la table, la poussière sur les objets, le livre sur Matisse que personne n’ouvre et toutes les reproductions de Matisse qu’il y a dans le livre, un jour très lointain de l’enfance et demain, le matin et l’odeur du café du matin, le tango qui passe à la radio et le désir irréalisable d’écrire des paroles de tango, tout, absolument tout dessiné, sans passion, sans objet, faire que chaque chose qui existe soit fixée sur le papier. Ensuite, quand tout y sera, se dessiner soi-même. Alors chaque chose sera à sa place et le repos sera possible. » 21
Quelle belle liste !
« Raconter, c’est se mettre un masque. C’est créer celui qui va raconter. La vérité dépend de la façon dont on la raconte, elle dépend de la parole. Il faudrait être plus responsable avec la parole. » 49
« S’immerger dans le silence, seule façon d’essayer d’être. Partir du fait qu’on ne sait pas. Et même si à la fin on n’en sait pas plus qu’au commencement, il restera la trace de la tentative, de l’excursion vers le chaos des mots, vers l’obscurité. » 49
« Devenir écrivain, c’est développer l’art de la ventriloquie. C’est inventer une voix qui, en principe, pourra tout dire. Elle n’y réussit jamais mais, une fois trouvée, la voix assure la création de l’œuvre littéraire. » 51
« L’écriture est une façon de réfléchir. » 65
J’ai été frappé par le rapprochement que Liscano fait entre l’écriture et une patiente atteinte de logorrhée, côtoyée lorsqu’il a travaillé dans un hôpital psychiatrique, cette autre prison, à son arrivée à Stockholm après sa libération.
Curieux comme la Topocl de 2016 a été enchantée de cette lecture, alors que celle de 2022, lisant L'Écrivain et l'autre, pourtant le texte précédant celui-ci dans le même esprit, ait été lassée…
Le Lecteur inconstant est suivi de Vie du corbeau blanc, œuvre de fiction évoquée dans le premier, qui est un peu un essai : ce sont donc deux ouvrages à la fois différents et liés.
L’histoire est celle d’un jeune corbeau famélique qui a quitté sa patrie. Il est d’abord présenté comme s’étant peint en blanc pour tenter de se joindre aux pigeons ; rejeté, il le fut aussi par les siens à son retour (tel une sorte d’émigré économique en exil).
« Il ne ressemblait plus à un corbeau et n’arrivait pas à ressembler à un pigeon. C’est pourquoi personne ne voulait de lui. Depuis lors, le corbeau erre par le monde. Certains tirent une morale de cette histoire, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse ici. »
Différentes versions sont proposées (expérience de pensée) dans ce récit loufoque : le corbeau parcourt le monde, subsistant comme chanteur de tango, bourrelier ou coiffeur, racontant son histoire dans des contes de plus en plus fabuleux. Ces avatars renvoient à nombre d’œuvres littéraires (on croise Beckett à Paris, etc.). « Le corbeau voyageur » se dit ami « du Grand Corbeau blanc, le justicier ». Chasse en Alaska, parodie de l’Odyssée, aventures farfelues, digressions et archaïsmes, « les énumérations géniales et la condamnation sans circonstances atténuantes des énumérations géniales », le prince qui chevaucha des années sans parvenir aux limites de son royaume… Moby Dick est revisité ; Manuscrit trouvé dans une bouteille, de Poe, y est mis en abyme, et la baleine blanche s’appelle « Vita Valen » (du suédois) … Totó, le (corbeau) Taché, tient une place centrale dans chaque histoire. Avec un épisode japonais où apparaît un Mishima au katana, il commence à évoquer ses doutes de conteur, de menteur.
Dans Le Lecteur inconstant, Liscano dit avoir relu « Balzac, José Mármol, Goethe, Poe, Darío, Borges, le journal de Christophe Colomb, Kafka, Dante, Kleist, José Eustasio Rivera, Acevedo Díaz et Rodó », « Akutagawa, Euclides da Cunha, Swift », ainsi que Calvino pour documenter ce texte, où il est aussi fait référence à « Moby Dick, Les Contes de l’Alhambra [Washington Irving], Le Dernier des Mohicans, les œuvres complètes de Poe, La Tempête », les poèmes de Walt Whitman, Wakefield et La Lettre écarlate de Hawthorne ; il s’agit bien de "relectures" dans son procédé de "réécriture" :
« Tout est déjà raconté. Ce qui est intéressant, c’est de reprendre les histoires connues. »
C’est un peu la même démarche que Coetzee et Robinson Crusoé.
Après une évocation de La Comédie humaine, c’est Peteco, c'est-à-dire Tarzan qui tient la vedette (mâtiné de Baron perché, de Hemingway et Maigret). Là aussi, on sent que Liscano jubile à composer ce mélodrame à la psychologie de vaudeville.
« C’était un visage très séduisant, l’archétype parfait de la vigueur masculine, non contaminé par la dissipation ni par de brutales passions dégradantes. Car même si Peteco tuait des hommes et des animaux, il le faisait comme le chasseur abat ses pièces, sans passion. Sauf dans les rares occasions où il avait tué par haine, mais point toutefois par cette haine récalcitrante et malveillante qui imprime son exécrable marque sur les traits de celui qui l’éprouve. La plupart du temps, quand il tuait, il le faisait avec le sourire. Et le sourire est la base de la beauté. »
\Mots-clés : #ecriture #essai
- le Ven 27 Jan 2023 - 12:26
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Carlos Liscano
- Réponses: 45
- Vues: 3155
Javier Cercas
Le point aveugle
Recueil de cinq conférences de Cercas sur le roman, d’un point de vue expliqué dans son prologue :
« …] de même que le cerveau couvre le point aveugle de l’œil et parvient ainsi à voir là où de fait il ne voit pas, le lecteur couvre le point aveugle du roman et réussit à connaître ce que de fait il ne connaît pas, à arriver là où, seul, le roman ne pourrait jamais arriver.
Les réponses des romans du point aveugle – ces réponses sans réponse ou sans réponse claire – sont pour moi les seules réponses véritablement littéraires, ou pour le moins les seules que proposent les bons romans. Le roman n’est pas un genre responsif mais interrogatif : écrire un roman consiste à se poser une question complexe et à la formuler de la manière la plus complexe possible, et ce, non pour y répondre ou pour y répondre de manière claire et certaine ; écrire un roman consiste à plonger dans une énigme pour la rendre insoluble, non pour la déchiffrer (à moins que la rendre insoluble soit, précisément, la seule manière de la déchiffrer). Cette énigme, c’est le point aveugle, et le meilleur que ces romans ont à dire, ils le disent à travers elle : à travers ce silence pléthorique de sens, cette cécité visionnaire, cette obscurité radiante, cette ambiguïté sans solution. Ce point aveugle, c’est ce que nous sommes. »
Se basant sur certains de ses propres romans et sur les plus marquants depuis et y compris Don Quichotte, passant par Borges, Kundera, Melville, Henry James, Vargas Llosa, Lampedusa, Carrère et Coetzee entr’autres, Cercas développe de façon claire et éclairante une analyse du genre qui m’a paru fort pertinente, formulant ce que le lecteur contemporain peut pressentir sans toujours l’expliciter.
« …] un écrivain en général – et un romancier en particulier – est avant tout quelqu’un concerné par la forme, quelqu’un qui sent que, dans la littérature, la forme est le fond et que c’est uniquement par la forme – par la réécriture et la réélaboration virtuellement infinie des phrases et de la structure d’un livre – qu’on parvient à accéder à une vérité qui à défaut resterait inaccessible. » I, 6
Le roman est un questionnement qui reste ouvert, comme aurait peut-être dit Umberto Eco : il ne tranche pas, mais crée le doute.
« …] la réponse à la question est qu’il n’y a pas de réponse ; c’est-à-dire que la réponse est la recherche même d’une réponse, la question même, le livre même. » I, 6
« En somme : s’il est possible de définir le roman comme un genre qui persiste à protéger les questions des réponses, autrement dit, comme un genre qui fuit les réponses claires, imposées et certaines et qui n’accepte de formuler que des questions auxquelles il n’y a pas de réponse ou bien des questions appelant des réponses ambiguës, complexes et plurielles, essentiellement ironiques [… » I, 6
Cercas donne une définition caractéristique de la littérature qui l’intéresse, par rapport aux prédécesseurs.
« Quoi qu’il en soit, l’objectif d’Anatomie d’un instant est celui qui, de façon consciente ou inconsciente, anime les romans que j’ai mentionnés, ou simplement tout roman sérieux : contribuer à étendre le champ d’action du genre en colonisant de nouveaux territoires ou en achevant de coloniser ceux découverts par Cervantès, essayer de dévoiler ou de développer de nouvelles possibilités pour le roman, le renouveler ou le refonder, provoquer la énième transformation de ce genre omnivore et mutant, satisfaire, en définitive, l’ambition insensée de tout romancier, qui consiste à porter le roman à un niveau que le genre ne connaissait pas avant lui, le dotant d’une forme nouvelle, qui diffère de celle dont le romancier a hérité. » I, 8
« …] le roman n’est pas un divertissement (ou il n’est pas que cela) ; il est avant tout un outil de recherche existentielle, un outil de connaissance de la nature humaine. » I, 9
« La découverte de Kafka n’annule pas celle de Cervantès, comme la découverte de l’Australie n’annule pas celle de l’Amérique : celle-ci complète la carte du monde ; celle-là, la carte de l’homme. » I, 9
« ...] la nouveauté se trouve dans l’ancien et écrire consiste à relire constamment le vieux à la recherche du nouveau. » Épilogue
On comprend mieux comment le renouvellement de la forme est essentiel dans l’histoire du roman.
« …] de même, utilisant de vieilles formes, le roman est condamné à dire de vieilles choses ; c’est seulement en s’appropriant de nouvelles formes qu’il pourra dire de nouvelles choses. D’où l’impératif d’innovation formelle. » I, 9
« Le roman a besoin de changer, de revêtir un aspect qu’il n’a jamais revêtu, d’être là où il n’a jamais été, de conquérir des territoires vierges, afin de dire ce que personne n’a encore dit et ce que personne à part lui ne peut dire. C’est un mensonge, je le répète, que de prétendre que les romans servent seulement à passer un moment, à tuer le temps ; au contraire : ils servent à faire vivre le temps, pour le rendre plus intense et moins trivial. Mais surtout, ils servent à changer la perception du monde ; c’est-à-dire qu’ils servent à changer le monde. Le roman a besoin de se renouveler pour dire des vérités nouvelles ; il a besoin de changer pour nous changer : pour nous rendre tels que nous n’avons jamais été. » I, 9
Cercas précise le « point aveugle » des romans qui en possèdent un, c'est-à-dire les romans "expérimentaux" en quelque sorte, non réalistes.
« Don Quichotte est-il fou, oui ou non ? Nous ne le savons pas ; ou, si l’on veut, don Quichotte est à la fois fou et ne l’est pas : cette contradiction, cette ironie, cette ambiguïté fondamentale, irréductible, constituent le point aveugle du Quichotte. » II
Cercas rappelle le rôle fondamental du lecteur.
« Un livre n’existe pas par lui-même, mais uniquement dans la mesure où quelqu’un le lit ; un livre sans lecteurs n’est qu’un tas de lettres mortes et c’est quand nous autres lecteurs l’ouvrons et commençons à le lire qu’une magie perpétuelle s’opère et que la lettre ressuscite, dotée d’une vie nouvelle. Nouvelle et, bien entendu, à chaque fois différente. Un livre n’est, en somme, qu’une partition que chacun interprète à sa manière : plus la partition est réussie, plus elle autorise et suscite de brillantes et multiples interprétations ; c’est pourquoi il y a, virtuellement, autant de Quichotte que de lecteurs du Quichotte. En définitive, c’est le lecteur, et pas seulement l’écrivain, qui crée le livre. » II
Le roman comme « arme » :
« Tout cela me semble recevable, mais ne suffit pas à expliquer la méfiance et le désir d’interdiction et de contrôle qui ont poursuivi le roman au long de son histoire. La principale raison est ailleurs : les ambiguïtés, les ironies, les équivoques et les certitudes fuyantes et contradictoires qui constituent le nerf des romans – et surtout des romans du point aveugle, qui leur sont entièrement dédiés – agacent et déconcertent les dogmatiques et les révoltent parce qu’ils sentent ou ont à juste titre l’impression qu’ils représentent une offensive en règle contre les certitudes sans faille et les vérités éternelles qui leur permettent de maintenir leur statut. » Épilogue
Le terme « polyédrique » est souvent employé ; je suppose qu’il signifie "ayant plusieurs facettes" (on trouve « polyfacétique » dans la traduction de son discours de lauréat du prix du Livre européen 2016).
Il y a beaucoup de vérité dans cette théorie, mais mon reproche serait qu’elle est trop univoque ; il y a tant d’autres choses dans les œuvres littéraires !
\Mots-clés : #ecriture #essai
- le Mer 4 Jan 2023 - 12:02
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Javier Cercas
- Réponses: 96
- Vues: 12461
Carlos Liscano
L'Écrivain et l'autre
La narrateur (Liscano lui-même, la cinquantaine) s’interroge sur son impossibilité à écrire actuellement, alors qu’il le faisait depuis vingt ans.
Si certains écrivains conçoivent leur texte comme la démonstration d’une thèse, Liscano est de ceux qui écrivent pour découvrir quelque chose qui n’est pas préconçu, et nous donne ici le propos du livre actuel (mais le projet romanesque n’aura pas vraiment de suite).
« J’écris deux choses à la fois, j’essaie de les réunir. Peut-être que le roman, ce genre qui accepte tout, pourra déglutir ce texte. Serai-je capable de raconter et de dire quelque chose sur le métier de raconter ? Où mène ce que je suis en train de faire ? Si je savais où ça mène, je ne l’écrirais pas. Parce que, écrire, c’est ça : partir sans savoir où on va arriver. Sans même savoir si on arrivera quelque part. Écrire est un art immobile, me dis-je. Et je ne sais même pas ce que ça veut dire. »
« J’ai commencé mon roman en visant très haut, beaucoup d’ironie. Le personnage qui se construit lui-même sous les yeux du lecteur. L’histoire habituelle : un individu ordinaire qui veut juste avoir une vie ordinaire, et l’Autre, qui le travaille de l’intérieur, qui le maintient hors de la vie, comme observateur. À la fin ils sont inséparables, même si chacun rejette son associé. Mais je ne suis pas capable de trouver une suite à cette histoire. L’excès d’ironie depuis le début rend tout développement impossible. Du moins ne suis-je pas capable de faire en sorte que l’histoire continue. »
« C’est dans ce sens que la littérature domine ma vie. Pas dans le sens où j’aurais des choses à dire, mais parce que sans la littérature la vie manquerait de sens, de matière, de lieu pour exister. »
« C’est le moment où j’aimerais être un autre, et que j’ai si souvent essayé d’écrire. Ne pas être moi, être un autre. Et alors il y a la condamnation de celui qui ne peut être que lui-même, et être lui-même signifie réaliser le désir de cet enfant sans livres qui croyait que rien n’était plus important dans la vie que lire des livres, et ensuite en écrire. »
« Si j’enlève la lointaine impression d’avoir voulu être écrivain dès l’âge de douze ans, si j’enlève les lectures pour le devenir, si j’enlève les heures passées à écrire et à réfléchir sur le fait d’écrire, si j’enlève ce que j’ai écrit, il ne reste rien de moi. »
Liscano a beaucoup vécu en marge, en étranger (armée, prison, exil en Suède). L’écrivain est « un personnage que j’ai inventé », il l’a créé et est devenu son « serviteur ». Cette vision d’un « autre » m’a évidemment ramentu Borges et moi, dans L’Auteur de Borges.
« Tout écrivain est une invention. Il y a un individu qui est un, et un jour il invente un écrivain dont il devient le serviteur ; dès lors il vit comme s’il était deux. »
« L’inventé c’est ça : un style, une façon de raconter qui permet de voir la vie comme on ne la voit pas à première vue. »
Outre cette dualité, Liscano évoque ses modèles en littérature, et son œuvre personnelle, sa solitude.
« L’inventé écrit pour ses maîtres, pour leur ressembler, pour s’en différencier, même s’il sait qu’il ne pourra jamais les égaler. »
« L’écriture apprend à parler avec soi-même. Je ne suis pas sûr qu’elle apprenne à parler avec les autres. »
« La littérature est une tentative de mettre de l’ordre dans l’expérience de la vie, qui est chaotique. L’écrivain donne aux choses un centre, leur centre, et sent qu’il pourrait peut-être vaincre celle qui, il le sait, viendra le chercher. S’il réussit à établir ce centre, il a l’illusion, la vanité de croire que quelque chose de lui survivra, restera après sa mort. C’est, ou ce serait, la victoire.
Mais en un instant tout redevient précaire, privé de signification, futile. Si je ne fais pas attention je retrouve la sensation de froid, de sommeil, je sens de nouveau que tout ce que je veux, tout ce dont j’ai vraiment besoin, sans personnage, sans littérature, que ce qu’il y a de plus élémentaire et de plus nécessaire, c’est dormir à l’abri, dormir hors du temps, sans l’obligation de me réveiller. Me coucher et savoir que je n’aurai pas froid et que je ne me réveillerai plus. »
Le ton est celui de notes prises sur le vif, un peu aussi celui de mémoires ; on perçoit une progression dans l’ouvrage, et son centre (le livre), bien qu’alternent ruminations moroses, souvenirs et observations du quotidien.
Est inséré Vaincre le temps, un texte qui prolonge la dissociation caractéristique de Liscano en "lui" et "l’écrivain" (qu’il est), le « cultivateur », le « chercheur d’infini » qui cultive solitude et néant, mort, temps, en soi-même, contre la vie, le monde.
« Écrire, c’est créer une voix, un style qui donne forme au monde. Un style n’a pas à être élégant ou cultivé. Il doit être personnel. Voir le monde depuis son propre style est une invention parallèle à celle de l’écrivain. Le style et l’écrivain sont la même invention. Inventé le style, inventé l’écrivain. Même si ça ne suffit pas. Parce que l’écrivain est plus que le style. »
L’écrivain qui parle de l’écriture est devenu un topos (et pas que dans les ateliers d’écriture). Mais c’est aussi une fin en soi, l’être humain étant en définitive l’utilisateur du langage, et aussi son créateur.
\Mots-clés : #autobiographie #ecriture #universdulivre
- le Mer 2 Nov 2022 - 12:25
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Carlos Liscano
- Réponses: 45
- Vues: 3155
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages
