La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 11:25
135 résultats trouvés pour guerre
Mathias Enard
Déserter
Deux récits racontés alternativement, sans jamais vraiment se rejoindre :
D’une part, un homme déserte le camp des vainqueurs lors d’une guerre civile (en Yougoslavie ?), et regagne la masure écartée de son père ; il est reconnu comme ancien voisin par une jeune femme, qui fuit elle aussi, et sera foudroyée avec son âne.
« Il observe la catastrophe, elle sent peut-être ses yeux sur son corps, il se rappelle si bien la violence qu’il a fait subir qu’aucune surprise ne déforme son visage, aucune pitié, aucune compassion, il voit la jambe brisée et noire, il voit le bois enfoncé dans la chair, il voit l’immense ecchymose sur les côtes, la chemise déchirée, la peau blanche zébrée de peine [… »
D'autre part, Irina, historienne des mathématiques, évoque (notamment la veille d’un colloque commémoratif à Berlin le 10 septembre 2001) la vie de ses parents, Paul Heudeber et Maja Scharnhorst, respectivement mathématicien communiste célèbre en Allemagne de l’Est, ancien résistant antifasciste qui a été déporté à Buchenwald (« le camp sur l’Ettersberg », là où se promenaient Goethe et Schiller) et elle femme politique de l’Ouest, militante des droits des femmes, également ancienne résistante ; pas mariés, ils vécurent généralement éloignés l’un de l’autre, l’un en RDA, l’autre en RFA, séparés par le Mur.
« Pour lui les mathématiques étaient un sens, au même titre que la vue ou l’ouïe, et donc une façon de percevoir la nature. »
« Après 1991, il ne cachait plus son désespoir politique. La fin de la RDA, mais aussi l’explosion yougoslave le rendaient fou de douleur. L’humanité me semble, en gagnant le capitalisme, avoir perdu l’humanité. Partout dans le monde, disait-il. Guerre, violence et injustice. »
Le déserteur secourt la femme et l’emmène dans la montagne, vers la frontière au nord, dans la forteresse en ruine de la Roche Noire ; on apprend qu’elle a été victime de sévices de la part des troupes auxquelles le déserteur appartenait. Lui, tortionnaire croyant, est las de la guerre.
Paul a été rendu célèbre par Les Conjectures de Buchenwald :
« Robert Kant soutenait que l’originalité du texte de Paul, outre son côté indiscutablement littéraire, ses considérations sur la Révolution, ses passages obscurs, sa poésie si sombre, provient de sa radicalité scientifique : de ce croisement, au fond du XXe siècle, du désespoir historique avec l’espérance mathématique. »
À Weimar, Irina consulte le dossier établi par la Stasi sur sa mère, tandis que la Russie bombarde l’Ukraine.
« En 1942 le directeur des Musées de Weimar, en accord avec le maire, décide d’organiser la protection des collections prestigieuses des différents lieux de souvenir de la ville, en cas de bombardement aérien. Musée d’archéologie, Musée des Beaux-Arts, Maisons de Goethe et de Schiller. Il a l’idée de commander des caisses en bois au camp de concentration de Buchenwald, là-haut dans la forêt, qui possède un atelier de menuiserie et toute une hêtraie à disposition. Quarante grandes malles de bois pour emballer des meubles et des livres de la Maison de Schiller, de la Maison de Goethe et des collections du Musée d’histoire ancienne.
Le directeur souhaite aussi passer commande à Buchenwald des copies des meubles de la chambre du dernier étage de la Maison de Schiller : le lit de mort de Schiller, le bureau sur lequel il écrivait, l’épinette sur laquelle il jouait des danses de Haydn, ainsi qu’un fauteuil par étage. Tous ces meubles furent chargés dans un camion et confiés aux SS pour qu’ils en établissent des copies. Le bureau de Schiller et les danses de Haydn furent donc enfermés à Buchenwald et des détenus se mirent au travail pour les copier. Il fallut trouver des prisonniers non seulement ébénistes, mais aussi un facteur de piano pour l’épinette – il y avait le monde entier à Buchenwald, et les copies furent parfaites. »
Un intellectuel utopiste, un jeune rural qui fuit la guerre, avec peut-être pour point commun d’avoir été trompés dans leurs engagements…
Érudition certes (en Histoire, voire en mathématiques : Nasiruddin Tusi, etc.), mais bien amenée, et servie par un style exigeant (avec un peu trop de pathos à mes yeux). Des réflexions aussi, parfois surprenantes, comme en politique.
\Mots-clés : #guerre #historique #politique #science #violence #xxesiecle
- le Mar 23 Avr - 12:13
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Mathias Enard
- Réponses: 103
- Vues: 7966
Hubert Haddad
Opium Poppy
Camir, Centre d’accueil des mineurs isolés et réfugiés : Alam l’Afghan de onze-douze ans est parmi les autres (dont Diwani, rescapée tutsie), et doit apprendre une nouvelle langue, une société autre.
« Grands et petits, ceux du Mali et du Congo, ceux du Pakistan, les Kurdes d’Anatolie, les réfugiés blêmes du Caucase, tous les élèves se dressent d’un seul bond, comme affranchis d’une chape d’indignité, et recouvrent dans les couloirs les allures flottantes du désarroi. »
Kandahar :
« Mais elles voulaient apprendre à lire et à calculer. Chaque jour, elles repartaient gaiement au lycée. Un matin, des garçons en moto leur ont coupé le chemin. Ils ont soulevé leurs voiles. Avec des pistolets à eau, comme pour jouer, ils ont arrosé leurs visages. Alam griffe la purée de sa fourchette. Il soupçonne avec effroi un vague lien entre son assiette et les dérives de son esprit. Les belles jeunes filles, il les imagine tête nue, les cheveux brûlés, la face sanguinolente et déformée comme un derrière de singe. Le vitriol efface d’un coup la rosée miraculeuse des visages. Il n’y a plus personne dans la maison du souvenir… »
Alam est en fait l’Évanoui (Alam le Borgne est son frère aîné) ; il a vécu au village de montagne, puis en ville.
« Sa vie jusque-là s’était partagée entre les maigres pâtures, les champs de pavots et son village à l’aspect de ruines exhumées ; tant que les insurgés se terraient dans leurs repaires, l’appel du muezzin et la traite des brebis suffisaient à rythmer les jours. »
Parvenu en France, il s’évade du Camir dans Paris, et côtoie les divers sans-abris et migrants.
« On part découragé, en lâche ou en héros, dans l’illusion d’une autre vie, mais il n’y a pas d’issue. L’exil est une prison. »
Une belle description des ruines urbaines de la zone des Vignes où se réfugient les marginaux, souvent délinquants.
« Une glaciale impression de déshérence s’étend sur cette zone où le piéton ne s’aventure qu’une fois fourvoyé, croyant couper les distances entre le canal de l’Ourcq, les gares à jamais hantées de Drancy et de Bobigny, et l’immense champ de morts de Pantin où les allées ont des noms d’arbre. Nulle part, serait-ce dans les pires îlots de La Courneuve ou de Clichy, la solitude n’arbore un tel aspect de coupe-gorge sans issue. »
Retour sur son enfance (récit alterné entre l’Afghanistan et la France, ses passé et présent), qui a lieu après la première prise de pouvoir des talibans.
Son frère ainé a rejoint le Djihad ; l’Évanoui le retrouvera par hasard, deviendra enfant-soldat, et le tuera comme on l’en enjoint car il aurait trahi, et parce qu’il lui apprend être de ceux qui ont vitriolé Malalaï, sa voisine qui fréquentait l’école et son seul rayon de bonheur.
« On égorgeait et massacrait sans haine, comme les moutons de l’Aïd el-Kebir, par sacrifice de soumission à la loi. Dieu se chargeait de remplacer les fils des hommes morts à la guerre par des béliers et des chèvres couchés sur le flanc gauche aux portes du paradis, dans la gloire de l’au-delà. »
Les talibans ont entraîné l’Évanoui au combat et au martyre.
« Ce dernier était plutôt disposé au sacrifice. Lorsque les balles remplacent les mots, l’instinct de vie s’étiole avec l’espérance. Le spectacle continu des corps en souffrance, des amputés, des exécutés pour l’exemple tourne vite à la farce. »
« Rien n’échappe à la violence ; le monde n’existe plus. On égorge l’agneau et l’enfant d’un même geste. Dès qu’une femme rit trop fort ou danse avec un autre, on l’attache et l’assomme de pierres aiguës. Chaque homme est trahi par son ombre. Une hallucination guide des somnambules aux mains sanglantes d’un cœur arraché à l’autre. »
Gravement blessé, l’Évanoui a été pris en charge par la coalition occidentale et le Croissant rouge dans un camp de réfugiés dont il s’enfuit. Au terme d’un périple via l’Iran, la Turquie puis la Bulgarie ou la Macédoine et l’Italie, il atteint Paris où il est plus ou moins recueilli par Yuko le Kosovar, caïd des trafics de drogue et d’armes du squat, qui le protège plus ou moins, ainsi que Poppy la junkie.
Rendu saisissant de l’existence de réfugiés en France, et dans leur pays d’origine, ainsi que d’une jeunesse "perdue".
\Mots-clés : #contemporain #enfance #exil #guerre #immigration #jeunesse #social #terrorisme #traditions #xxesiecle
- le Lun 5 Fév - 10:19
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 20
- Vues: 923
Henri Barbusse
Le Feu – Journal d’une escouade
Témoignage sur l’existence des poilus pendant la Première Guerre mondiale, basé sur le carnet de guerre tenu vingt-deux mois de 1914 à 1915 par Henri Barbusse sur le front. L’auteur est le narrateur de ce récit paru en 1916, et il rapporte les propos de quelques compagnons d’escouade, dont certains suivis jusqu’à leur mort.
« Ils sont des hommes, des bonshommes quelconques arrachés brusquement à la vie. Comme des hommes quelconques pris dans la masse, ils sont ignorants, peu emballés, à vue bornée, pleins d’un gros bon sens, qui, parfois, déraille ; enclins à se laisser conduire et à faire ce qu’on leur dit de faire, résistants à la peine, capables de souffrir longtemps.
Ce sont de simples hommes qu’on a simplifiés encore, et dont, par la force des choses, les seuls instincts primordiaux s’accentuent : instinct de la conservation, égoïsme, espoir tenace de survivre toujours, joie de manger, de boire et de dormir. Par intermittences, des cris d’humanité, des frissons profonds, sortent du noir et du silence de leurs grandes âmes humaines. »
Barbusse reproduit le parler de ses camarades venus de diverses régions de France, et ce recueil d’argot populaire n’est pas le moindre intérêt du livre.
« – C’est aux oreilles. Une marmite — et un macavoué, mon ieux — qui a pété comme qui dirait là. Ma tête a passé, j’peux dire, entre les éclats, mais tout juste, rasibus, et les esgourdes ont pris.
– Si tu voyais ça, dit Fouillade, c’est dégueulasse, ces deux oreilles qui pend. On avait nos deux paquets de pansement et les brancos nous en ont encore balancé z’un. Ça fait trois pansements qu’il a enroulés autour de la bouillotte. »
C’est « la bonne blessure » (en fait elle ne sera pas suffisante) :
« – On va m’attacher une étiquette rouge à la capote, y a pas d’erreur, et m’ mener à l’arrière. J’ s’rai conduit, à c’ coup, par un type bien poli qui m’ dira : « C’est par ici, pis tourne par là. . . Na !. . . mon pauv’ ieux. » Pis l’ambulance, pis l’train sanitaire avec des chatteries des dames de la Croix-Rouge tout le long du chemin comme elles ont fait à Crapelet Jules, pis l’hôpitau de l’intérieur. Des lits avec des draps blancs, un poêle qui ronfle au milieu des hommes, des gens qui sont faits pour s’occuper de nous et qu’on regarde y faire, des savates réglementaires, mon ieux, et une table de nuit : du meuble ! Et dans les grands hôpitals, c’est là qu’on est bien logé comme nourriture ! J’y prendrai des bons repas, j’y prendrai des bains ; j’y prendrai tout c’que j’trouverai. Et des douceurs sans qu’on soit obligé pour en profiter, de s’battre avec les autres et de s’démerder jusqu’au sang. J’aurai sur le drap mes deux mains qui n’ficheront rien, comme des choses de luxe — comme des joujoux, quoi ! — et, d’ssous l’drap, les pattes chauffées à blanc du haut en bas et les arpions élargis en bouquets de violettes... »
Une semaine de répit à l’arrière :
« Après plusieurs haltes où on se laisse tomber sur son sac, au pied des faisceaux — qu’on forme, au coup de sifflet, avec une hâte fiévreuse et une lenteur désespérante à cause de l’aveuglement, dans l’atmosphère d’encre — l’aube s’indique, se délaie, s’empare de l’espace. Les murs de l’ombre, confusément, croulent. Une fois de plus nous subissons le grandiose spectacle de l’ouverture du jour sur la horde éternellement errante que nous sommes.
On sort enfin de cette nuit de marche, à travers, semble-t-il, des cycles concentriques, d’ombre moins intense, puis de pénombre, puis de lueur morne. Les jambes ont une raideur ligneuse, les dos sont engourdis, les épaules meurtries. Les figures demeurent grises et noires : on dirait qu’on s’arrache mal de la nuit ; on n’arrive plus jamais maintenant à s’en défaire tout à fait. »
Il y a un côté didactique dans le roman qui s’organise par thèmes (« embarquement », « permission », etc.), aidé en cela par le Cocon, un familier des chiffres. Ainsi l’amer dépit vis-à-vis de ceux de l’arrière.
« – Dis donc, petit, viens un peu ici, dit Cocon, en prenant le bambin entre ses genoux. Écoute bien. Ton papa i’ dit, n’est-ce pas : « Pourvu que la guerre continue ! » hé ?
– Pour sûr, dit l’enfant en hochant la tête, parce qu’on devient riche. Il a dit qu’à la fin d’mai on aura gagné cinquante mille francs.
– Cinquante mille francs ! C’est pas vrai !
– Si, si ! trépigne l’enfant. Il a dit ça avec maman. Papa voudrait qu’ça soit toujours comme ça. Maman, des fois, elle ne sait pas, parce que mon frère Adolphe est au front. Mais on va le faire mettre à l’arrière et, comme ça, la guerre pourra continuer. »
Barbusse dépeint avec vigueur scènes et figures, et pas que les tranchées, les combats et les cadavres :
« Dans un coin de cette sale petite maison encombrée de vieilleries, de débris poussiéreux de l’autre saison, emplie par la cendre de tant de soleils éteints, il y a, à côté des meubles et des ustensiles, quelque chose qui remue : un vieux bonhomme, muni d’un long cou pelé, raboteux et rose qui fait penser au cou d’une volaille déplumée par la maladie. Il a également un profil de poule : pas de menton et un long nez ; une plaque grise de barbe feutre sa joue rentrée, et on voit monter et descendre de grosses paupières rondes et cornées, comme des couvercles sur la verroterie dépolie de ses yeux. »
Puanteur, crasse, pluie, froid, atrocités, souffrances sont décrits "de l’intérieur", et avec puissance. Je ne m’étends pas sur les nombreuses scènes d’horreur naturalistes (qui ramentoivent parfois Curzio Malaparte)…
« Un nuage de pestilence commence à se balancer sur les restes de ces créatures avec lesquelles on a si étroitement vécu, si longtemps souffert. »
Les avis sur la guerre sont imprégnés de l’antimilitarisme pacifiste de Barbusse, sans plus occulter l’égoïsme que la solidarité qui règnent dans les rangs.
« Mais les conversations sur ce sujet se terminent toujours par un haussement d’épaules : on n’avertit jamais le soldat de ce qu’on va faire de lui ; on lui met sur les yeux un bandeau qu’on n’enlève qu’au dernier moment. Alors :
– On voira bien.
– Y a qu’à attendre ! »
L’attention est surtout portée au peuple, la chair à canon.
« Chacun sait qu’il va apporter sa tête, sa poitrine, son ventre, son corps tout entier, tout nu, aux fusils braqués d’avance, aux obus, aux grenades accumulées et prêtes, et surtout à la méthodique et presque infaillible mitrailleuse — à tout ce qui attend et se tait effroyablement là-bas — avant de trouver les autres soldats qu’il faudra tuer. Ils ne sont pas insouciants de leur vie comme des bandits, aveuglés de colère comme des sauvages. Malgré la propagande dont on les travaille, ils ne sont pas excités. Ils sont au-dessus de tout emportement instinctif. Ils ne sont pas ivres, ni matériellement, ni moralement. C’est en pleine conscience, comme en pleine force et en pleine santé, qu’ils se massent là, pour se jeter une fois de plus dans cette espèce de rôle de fou imposé à tout homme par la folie du genre humain. On voit ce qu’il y a de songe et de peur, et d’adieu dans leur silence, leur immobilité, dans le masque de calme qui leur étreint surhumainement le visage. Ce ne sont pas le genre de héros qu’on croit, mais leur sacrifice a plus de valeur que ceux qui ne les ont pas vus ne seront jamais capables de le comprendre. »
Un aperçu quand même du massacre, lissé déjà par le temps passé :
« En bas, parmi la multitude des immobiles, voici, reconnaissables à leur usure et leur effacement, des zouaves, des tirailleurs et des légionnaires de l’attaque de mai. L’extrême bord de nos lignes se trouvait alors au bois de Berthonval, à cinq ou six kilomètres d’ici. Dans cet assaut, qui a été un des plus formidables de la guerre et de toutes les guerres, ils étaient parvenus d’un seul élan, en courant, jusqu’ici. Ils formaient alors un point trop avancé sur l’onde d’attaque et ils ont été pris de flanc par les mitrailleuses qui se trouvaient à droite et à gauche des lignes dépassées. Il y a des mois que la mort leur a crevé les yeux et dévoré les joues — mais même dans leurs restes disséminés, dispersés par les intempéries et déjà presque en cendres, on reconnait les ravages des mitrailleuses qui les ont détruits, leur trouant le dos et les reins, les hachant en deux par le milieu. À côté de têtes noires et cireuses de momies égyptiennes, grumeleuses de larves et de débris d’insectes, où des blancheurs de dents pointent dans des creux ; à côté de pauvres moignons assombris qui pullulent là, comme un champ de racines dénudées, on découvre des crânes nettoyés, jaunes, coiffés de chéchias de drap rouge dont la housse grise s’effrite comme du papyrus. Des fémurs sortent d’amas de loques agglutinées par de la boue rougeâtre, ou bien, d’un trou d’étoffes effilochées et enduites d’une sorte de goudron, émerge un fragment de colonne vertébrale. Des côtes parsèment le sol comme de vieilles cages cassées, et, auprès, surnagent des cuirs mâchurés, des quarts et des gamelles transpercés et aplatis. Autour d’un sac haché, posé sur des ossements et sur une touffe de morceaux de drap et d’équipements, des points blancs sont régulièrement semés : en se baissant, on voit que ce sont les phalanges de ce qui, là, fut un cadavre. »
Cette fresque sans concession aide à saisir ce que fut cette boucherie de la Grande Guerre, et à mon sens ce récit participe pleinement au devoir de mémoire nécessaire pour ne pas oublier la Der des Ders…
\Mots-clés : #autobiographie #devoirdememoire #guerre #historique #mort #premiereguerre #violence #xxesiecle
- le Mar 31 Oct - 11:21
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Henri Barbusse
- Réponses: 7
- Vues: 436
Cecil Scott Forester
Aspirant de marine
Premier volume du cycle Horatio Hornblower selon la chronologie du héros, et non la date de publication.
Horatio, âgé de dix-sept ans, embarque un temps sur le Justinian (juste le temps de montrer son courage de timide qui est bon en mathématiques et a le mal de mer), puis sur l’Indefatigable, une frégate qui donne la chasse aux navires français dans le golfe de Gascogne. L’action se situe peu après la Révolution française : l’Angleterre est en guerre avec la France. Assez vite aussi, il quitte la frégate pour prendre le commandement de l’équipage de prise de la Marie-Galante, brick français qui coule peu après. Ayant quitté le bord sur le canot, ils sont pris par le Pique, un corsaire français, auquel Horatio met le feu comme apparaît l’Indefatigable, qu’il regagne. Il participe activement à la prise du Papillon, corvette mouillée dans l’estuaire de la Gironde. Ils passent à l’abordage d’un autre navire français, tandis qu’Horatio sert un pierrier sur la hune du mat d’artimon, qui est fauché par des boulets. À bord de la Sophia, au départ de Plymouth, il est interprète dans le convoi d’une armée française royaliste partant en expédition en Bretagne, dont la tentative échoue. Dans une escarmouche avec des galères espagnoles (l’Espagne s’est ralliée aux Républicains français), Horatio en capture une en l’assaillant avec le canot qu’il commande. Puis il parvient à échouer un brûlot espagnol qui menaçait la rade de Gibraltar. Ensuite, il ramène d’Oran surprise par la peste une cargaison d’orge et de cheptel sur le brick-transport la Caroline, afin de ravitailler la flotte rationnée à cause du blocus européen – non sans capturer un lougre, garde-côte espagnol. Il ramène à Gibraltar le Rêve, un sloop capturé, dont il doit assurer le commandement pour le ramener en Angleterre – avec la duchesse de Wharfedale ; celle-ci est en fait une actrice, mais lui est fait prisonnier des Espagnols – et promu lieutenant pendant sa captivité (il a dix-huit ans) ; plus fort, il sauve des marins espagnols, ce qui lui vaudra sa libération. Ces dernières péripéties constituent le point d’orgue de ce palpitant roman d’aventures.
Succession rapide d’épisodes d’action, qui n’empêche pas un aperçu de la vie sur les bâtiments de ligne au XVIIIe siècle (avec le vocabulaire de la marine à voile). Le personnage d’Horatio est attachant, jeune homme s’efforçant sans cesse de se maîtriser et d’apprendre en respectant ses propres valeurs de courage et de rigueur.
« Il était de ce type d’homme qui eût continué à observer et à s’instruire sur son lit de mort. »
\Mots-clés : #aventure #guerre #historique #merlacriviere
- le Mar 3 Oct - 12:28
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Cecil Scott Forester
- Réponses: 5
- Vues: 323
João Guimarães Rosa
Diadorim
Le titre original est Grande Sertão : veredas. Le sertão désigne les vastes régions semi-arides de l’intérieur du Brésil, où une population clairsemée vit surtout de l’élevage ; les chapadas, plateaux désertiques, sont parsemées de veredas, verdoyantes dépressions où l’eau se concentre, et donc la vie.
Riobaldo, surnommé Tatarana, ancien jagunço devenu fazendeiro (propriétaire d’une fazenda, ou vaste ferme), évoque devant le narrateur sa vie passée dans le sertão (les jagunços sont les hommes de main des fazendeiros, vivant en bandes armées et se livrant au brigandage, aussi considérés comme des preux).
« Vous le savez : le sertão c’est là où est le plus fort, à force d’astuces, fait la loi. Dieu lui-même, quand il s’amènera, qu’il s’amène armé. Et une balle est un tout petit bout de métal. »
« J’ai ramé une vie libre. Le sertão : ces vides qu’il est. »
« Le sertão est bon. Tout ici se perd ; tout ici se retrouve… disait le sieur Ornelas. Le sertão c’est la confusion dans un grand calme démesuré. »
Le sertão est hostile, mais a ses beautés, et les descriptions qui en sont données constituent un intérêt supplémentaire. À ce propos, l’emblématique buruti, c’est le palmier-bâche qui vit les pieds dans l’eau, le bem-te-vi, c’est le quiquivi, oiseau également fréquent en Guyane.
Riobaldo, comme beaucoup, ne connaît pas son père (en fait, à la mort de sa mère, il est recueilli par son parrain, qui serait son géniteur).
« L’homme voyage, il fait halte, repart : il change d’endroit, de femme – ce qui perdure c’est un enfant. »
Riobaldo parle de ses pensées qui l’obsèdent à propos du démon (qui a d’innombrables noms, dont « celui-qui-n’existe-pas ») : peut-on faire pacte avec lui ? Il parle aussi de Diadorim, son ami et amour, et des femmes qu’il aime. Il digresse, reprend le fil de son monologue : il évoque leur lieutenant, Medeiro Vaz, qui brûla sa fazenda, éparpilla les pierres de la tombe de sa mère pour aller mener une guerre de justice dans les hautes-terres, et leurs ennemis, les deux Judas félons (Hermὀgenes, protégé des enfers, et Ricardo) qui ont tué Joca Ramiro (père de Diadorim), et les soldats qui les combattent, et Zé Bebelo, stratège enjoué qui rêve de batailles et d’être député, puis remplace Medeiro Vaz à sa mort (et de qui Riobaldo fut percepteur, avant d’être dans le camp adverse, ce qui le tourmente). Car ce dernier narre dorénavant son existence depuis son enfance : comment il rencontra Reinaldo et fut séduit (ses amours sont plus généralement féminines, notamment la belle Otacilia, ou encore Norinha), Reinaldo qui lui confie s’appeler Diadorim.
À propos de la sensualité féminine, un passage qui rappelle Jorge Amado dans ses bonnes pages :
« L’une d’elles – Maria-des-Lumières – était brune : haute d’un huitième de cannelier. La chevelure énorme, noire, épaisse comme la fourrure d’un animal – elle lui cachait presque toute la figure, à cette petite mauresque. Mais la bouche était le bouton éclos, et elle s’offrait rouge charnue. Elle souriait les lèvres retroussées et avait le menton fin et délicat. Et les yeux eau-et-miel, avec des langueurs vertes, à me faire croire que j’étais à Goïas… Elle avait beaucoup de savoir-faire. Elle s’occupa aussitôt de moi. Ce n’était pas qu’une petite péronnelle.
L’autre, Hortense, une très gentille oiselle de taille moyenne, c’était Gelée-Blanche ce surnom parce qu’elle avait le corps si blanc ravissant, que c’était comme étreindre la froide blancheur de l’aube… Elle était elle-même jusqu’au parfum de ses aisselles. Et la ligne des reins, courbes ondulantes d’un ruisseau de montagne, confondait. De sorte que sa longueur exacte, vous n’arriviez jamais à la mesurer. Entre elles deux à la fois, je découvris que mon corps aussi avait ses tendretés et ses duretés. J’étais là, pour ce que je sais, comme le crocodile. »
Ce qui vaut surtout, c’est le monologue noté par son auditeur :
« Nous vivons en répétant, et bon, en une minime minute le répété dérape, et nous voilà déjà projetés sur une autre branche. »
Son récit décousu se commente lui-même, et sans doute l’auteur s’exprime-t-il lui-même par moments :
« Je sais que je raconte mal, je survole. Sans rectifier. Mais ce n’est pas pour donner le change, n’allez pas croire. […] Raconter à la suite, en enfilade, ce n’est vraiment que pour les choses de peu d’importance. De chaque vécu que j’ai réellement passé, de joie forte ou de peine, je vois aujourd’hui que j’étais chaque fois comme s’il s’agissait de personnes différentes. Se succédant incontrôlées. Tel je pense, tel je raconte. […] Et ce que je raconte n’est pas une vie d’homme du sertão, aurait-il été jagunço, mais la matière qui déborde. »
Riobaldo n’a jamais connu la peur, mais…
« Je sentis un goût de fiel sur le bout de ma langue. La peur. La peur qui vous coince. Qui me rattrapa au tournant. Un bananier prend le vent par tous les bords. L’homme ? C’est une chose qui tremble. Mon cheval me menait sans échéance. Les mulets et les ânes de la caravane, Dieu sait si je les enviais… Il y a plusieurs inventions de peur, je sais, et vous le savez. La pire de toutes est celle-ci : qui d’abord vous étourdit, et ensuite vous vide. Une peur qui commence d’emblée par une grande fatigue. Là où naissent nos énergies, je sentis qu’une de mes sueurs se glaçait. La peur de ce qui peut toujours arriver et qui n’est pas encore là. Vous me comprenez : le dos du monde. […] Je n’y arrivais pas, je ne pensais pas distinctement. La peur ne permettait pas. J’avais la cervelle embrumée, la tête me tournait. Je bus jusqu’à la lie le passage de la peur : je traversais un grand vide. »
« La peur manifeste provoque la colère qui châtie ; c’est bien tout ce à quoi elle sert. »
Le ton est celui du langage populaire, volontiers proverbial, traversé de fulgurances condensées voire lapidaires, très inventives et souvent poétiques, à l’encontre d’une rédaction rationnelle et claire. Allers-retours dans le temps de la remémoration (étonnamment riche, précise et détaillée), à l’instar des chevauchées et contre-marches de la troupe.
« Veuillez m’excuser, je sais que je parle trop, des à-côtés. Je dérape. C’est le fait de la vieillesse. Mais aussi, qu’est-ce qui vaut et qu’est-ce qui ne vaut pas ? Tout. Voyez plutôt : savez-vous pourquoi le remords ne me lâche pas ? Je crois que ce qui ne le permet pas c’est la bonne mémoire que j’ai. »
« Ah, mais je parle faux. Vous le sentez ? Si je démens ? Je démens. Raconter est très, très laborieux. Non à cause des années, passées depuis beau temps. Mais à cause de l’habileté qu’ont certaines choses passées – à faire le balancier, à ne pas rester en place. Ce que j’ai dit était-il exact ? Ça l’était. Mais ce qui était exact a-t-il été dit ? Aujourd’hui je crois que non. Ce sont tant d’heures passées avec les gens, tant de choses arrivées en tant de temps, tout se découpant par le menu. »
« Non, nenni. Je n’avais aucun regret. Ce que j’aurais voulu, c’était redevenir enfant, mais là, dans l’instant, si j’avais pu. J’en avais déjà plus qu’assez de leurs égarements à tous. C’est qu’à cette époque je trouvais déjà que la vie des gens va à vau-l’eau, comme un récit sans queue ni tête, par manque de joie et de jugement. La vie devrait être comme dans une salle de théâtre, et que chacun joue son rôle avec un bel entrain du début à la fin, qu’il s’en acquitte. C’était ce que je trouve, c’est ce que je trouvais. »
« Nous sommes des hommes d’armes, pour le risque de chaque jour et toutes les menues choses de l’air. »
« Mais les chemins sont ce qui gît partout sur la terre, et toujours les uns contre les autres ; il me revient que les formes les plus fausses du démon se reproduisent. Plus vous allez m’entendre, plus vous allez me comprendre. »
« On ne se met pas en colère contre le boa. Le boa étranglavale, mais il n’a pas de venin. Et il accomplissait son destin, tout réduire à un contenu. »
« La vie en invente ! On commence les choses, à l’obscur de savoir pourquoi, et dès lors le pouvoir de les continuer, on le perd – parce que la vie est le boulot de tous, triturée, assaisonnée par tous. »
« Tout cela pour vous, mon cher monsieur, ne tient pas debout, n’éclaire rien. Je suis là, à tout répéter par le menu, à vivre ce qui me manquait. Des choses minuscules, je sais. La lune est morte ? Mais je suis fait de ce que j’ai éprouvé et reperdu. De l’oublié. Je vais errant. Et se succédèrent nombre de petits faits. »
« Je sais : qui aime est toujours très esclave, mais ne se soumet jamais vraiment. »
« Qui le sait vraiment ce qu’est une personne ? Compte tenu avant tout : qu’un jugement est toujours défectueux, parce que ce qu’on juge c’est le passé. Eh, bé. Mais pour l’écriture de la vie, juger on ne peut s’en dispenser ; il le faut ? C’est ce que font seuls certains poissons, qui nagent en remontant le courant, depuis l’embouchure vers les sources. La loi est la loi ? Mensonge ! Qui juge, est déjà mort. Vivre est très dangereux, vraiment. »
La dernière phrase revient comme un leitmotiv dans le récit de Riobaldo :
« Vivre est très dangereux, je vous l’ai déjà dit. »
Apprécié en tant que bon tireur, Riobaldo parcourt donc le sertão qu’il aime, malgré les vicissitudes de cette existence itinérante, chevauchant de peines en batailles. Il médite sans cesse, sur la vie, l’amour, et par un curieux défi, dans sa haine d’Hermὀgenes qui aurait signé un pacte avec « l’Autre », décide d’en faire un lui aussi, bien qu’il ne croie ni à cette puissance maléfique, ni même à l’âme. Le démon ne se présente pas à la « croisée des chemins de Veredas-Mortes ».
« Alors, je ne sais ou non si j’ai vendu ? Je vous le dis : ma peur c’est ça. Tous la vendent, non ? Je vous le dis : de diable il n’y en a pas, le diable n’existe pas, et l’âme je la lui ai vendue… Ma peur, c’est ça. À qui l’ai-je vendue ? C’est ça, monsieur, ma peur : l’âme, on la vend, c’est tout, sans qu’il y ait acheteur… »
Cependant Riobaldo change. Lui, pour qui il n’était pas question de commander, devient le chef, Crotale-Blanc. Il reprend avec succès la traversée du Plan de Suçuarão, où avait échoué Medeiro Vaz, pour prendre à revers la fazenda d’Hermὀgenes.
Il y a encore les « pacants », rustres paysans croupissant dans la misère, victimes d’épidémies et des fazendeiros obnubilés par le profit, ou Siruiz, le jagunço poète, dont Riobaldo donne le nom à son cheval, ou encore le compère Quelémém, de bon conseil, évidemment Diadorim qu'il aime, et nombre d'autres personnages.
Ce livre-monde aux différentes strates-facettes (allégorie de la condition humaine, roman d’amour, épopée donquichottesque, geste initiatique – alchimique et/ou mythologique –, combat occulte du bien et du mal, cheminement du souvenir, témoignage ethnographique, récit de campagnes guerrières, etc.) est incessamment parcouru d’un souffle génial qui ramentoit Faust, mais aussi Ulysse (les deux).
Il est encore dans la ligne du fameux Hautes Terres (Os Sertões) d’Euclides da Cunha, par la démesure de la contrée comme de ceux qui y errent. L’esprit épique m’a aussi ramentu Borges et son exaltation des brigands de la pampa.
Sans chapitres, ce récit est un fleuve formidable dont le cours parfois s’accélère dans les péripéties de l’action, parfois s’alentit dans les interrogations du conteur : flot de parole, fil de pensée, flux de conscience. Et il vaut beaucoup pour la narration de Riobaldo ou, autrement dit, pour le style (c’est la façon de dire) rosien.
Le texte m’a paru excellemment rendu par la traductrice (autant qu’on puisse en juger sans avoir recours à l’original) ; cependant, il semble être difficilement réductible à une traduction, compte tenu de la langue créée par Rosa, inspirée du parler local et fort inventive.
\Mots-clés : #amour #aventure #contemythe #criminalite #ecriture #guerre #historique #initiatique #lieu #mort #nature #philosophique #portrait #ruralité #spiritualité #voyage
- le Ven 22 Sep - 13:06
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: João Guimarães Rosa
- Réponses: 26
- Vues: 1529
Philip Roth
Indignation
Étudiant pendant la guerre de Corée, le narrateur, Marcus Messner, a du mal à tenir à distance son père, un boucher kasher qui s’inquiète pour lui alors qu’il est sage et bûcheur : il quitte Newark pour l’Ohio. Motivé pour quitter la boucherie, il l’est aussi par le spectre de la conscription.
Il a dix-huit ans, et mourra à dix-neuf ; pour le moment, il découvre le sexe :
« Même maintenant (si « maintenant » peut encore vouloir dire quelque chose), au-delà de l’existence corporelle, vivant comme je le suis ici (si « ici » ou « je » veulent dire quelque chose), n’étant rien d’autre que mémoire (si « mémoire », à proprement parler, est ce milieu qui englobe tout et d’où mon « moi » tire sa subsistance), je continue à m’interroger sur les actions d’Olivia. Est-ce à cela que ça sert, l’éternité, à ruminer les menus détails de toute une vie ? Qui aurait pu imaginer qu’il faudrait se souvenir à jamais de chaque moment de sa vie jusque dans les moindres particularités ? Ou se peut-il que ce soit seulement le cas pour cette vie dans l’au-delà qui est la mienne, et que, tout comme chaque vie est unique, chaque vie dans l’au-delà le soit également, chacune étant comme l’empreinte digitale impérissable d’une vie dans l’au-delà différente de toutes les autres ? Je n’ai aucun moyen de le dire. Comme dans la vie, je connais seulement ce qui est et, dans la mort, ce qui est équivaut à ce qui fut. »
Olivia, de parents divorcés, a déjà tenté de se suicider, et paraît instable. Sans surprise, Roth dépeint sans fard le désarroi libidinal des jeunes gens soumis à la continence.
Juif athée, il est indigné par les sermons chrétiens assénés d’office « au cœur de l’Amérique profonde » (le Middle West, très traditionnel). Il est recadré par le doyen (intégriste) pour son manque d’intégration (lors d’un entretien où il cite Bertrand Russell).
Son père, de plus en plus catastrophiste (voire paranoïaque), est devenu irascible, et sa mère veut divorcer ; mais cette femme forte revient sur sa décision, si Marcus renonce à Olivia.
Rapprochement de l’abattage kasher des poulets et de la tentative de suicide d’Olivia :
« Ce que je veux dire, c’est ceci : que c’est cela qu’Olivia avait cherché à faire, se tuer selon les prescriptions kasher, en se vidant de son sang. Si elle avait réussi, si elle avait habilement mené sa tâche à bien d’un seul coup tranchant de la lame, elle se serait rendue kasher conformément à la loi rabbinique. La cicatrice révélatrice d’Olivia venait de sa tentative de meurtre rituel appliqué à elle-même. »
Olivia s’en va, victime de dépression ; Marcus, qui avait accepté d’être subrepticement remplacé aux offices obligatoires, sera renvoyé et perdra définitivement conscience dans le bain de sang coréen. Ce jeune homme qui avait et faisait tout pour réussir aura ce destin absurde pour n’avoir pas su « fermer sa grande gueule ».
Ce bref roman magistralement écrit est aussi parfaitement athée et anticlérical.
\Mots-clés : #guerre #jeunesse #relationenfantparent #religion #sexualité #social #xxesiecle
- le Mer 23 Aoû - 12:17
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Philip Roth
- Réponses: 111
- Vues: 11807
Philip Kerr
Une douce flamme
« Le navire était le SS Giovanni, ce qui semblait tout à fait approprié puisque trois au moins de ses passagers, moi y compris, avaient appartenu à la SS. »
Avec cet incipit, Bernhard (Bernie) Gunther, alias Doktor Carlos Hausner, nous apprend qu’il rejoint l’Argentine avec Herbert Kuhlmann et… Adolf Eichmann…
Nous sommes à Buenos Aires en 1950, et le roman s’y passe (ainsi qu’à Tucumán), mais aussi à Berlin en 1932, quand Gunther y vivait la chute de la République de Weimar avec son sergent Heinrich Grund. Ce dernier est alors un fervent partisan du parti national-socialiste, qui s’oppose au SPD, « Front de fer », le parti social-démocrate, et prend le pouvoir.
L’Argentine est le salut de nombre de « vieux camarades » dans l’après-guerre, quoique…
« À Buenos Aires, il vaut mieux tout savoir qu’en savoir trop »
Le Troisième Reich s’est effondré, mais ses rescapés survivent en exil et s’organisent sous le régime de Juan (et Evita) Perón, continuant à perpétrer leurs crimes, même s’ils ne sont plus de guerre.
« — Tous les journaux sont fascistes par nature, Bernie. Quel que soit le pays. Tous les rédacteurs en chef sont des dictateurs. Tout journalisme est autoritaire. Voilà pourquoi les gens s’en servent pour tapisser les cages à oiseaux. »
« Qu’est-ce que prétend Hitler ? demandai-je. Que la force réside non dans la défense mais dans l’attaque ? »
Gunther est recruté par le SIDE, les services de renseignement péronistes, et enquête sur la mort de jeunes adolescentes auxquelles on a enlevé l’appareil génital. Il rapproche ces crimes d’une affaire similaire non élucidée en 1932 ; il apparaît qu’ils furent perpétrés pour dissimuler des avortements ratés par des psychopathes ayant profité de l’aubaine constituée par le nazisme ; Bernie retrouvera notamment le Dr Hans Kammler (ingénieur responsable « de tous les grands projets de construction SS pendant la guerre », et Herr Doktor Mengele…
« Pour être un grand détective, il faut être aussi un protagoniste. Un personnage dynamique qui provoque les événements rien qu’en étant lui-même. Et je pense que vous appartenez à cette catégorie, Gunther. »
Il se confie aussi, bourrelé par sa mauvaise conscience, à Anna, son amante juive.
« Tous les Allemands portent en eux l’image d’Adolf Hitler, dis-je. Même ceux qui, comme moi, le haïssaient, lui et tout ce qu’il représentait. Ce visage, avec ses cheveux ébouriffés et sa moustache en timbre-poste, continue de nous hanter, aujourd’hui encore et à jamais, et, telle une douce flamme impossible à éteindre, brûle dans nos âmes. Les nazis parlaient d’un Reich de mille ans. Mais, parfois, je me dis qu’à cause de ce que nous avons fait, le nom de l’Allemagne et les Allemands sont couverts d’infamie pour mille ans. Qu’il faudra au reste du monde mille ans pour oublier. Vivrais-je un millier d’années que jamais je n’oublierais certaines des choses que j’ai vues. Et certaines de celles que j’ai commises. »
« J’en veux aux communistes d’avoir appelé en novembre 1932 à la grève générale qui a précipité la tenue d’élections. J’en veux à Hindenburg d’avoir été trop vieux pour se débarrasser de Hitler. J’en veux aux six millions de chômeurs – un tiers de la population active – d’avoir désiré un emploi à n’importe quel prix, même au prix d’Adolf Hitler. J’en veux à l’armée de ne pas avoir mis fin aux violences dans les rues pendant la République de Weimar et d’avoir soutenu Hitler en 1933. J’en veux aux Français. J’en veux à Schleicher. J’en veux aux Britanniques. J’en veux à Gœbbels et à tous ces hommes d’affaires bourrés de fric qui ont financé les nazis. J’en veux à Papen et à Rathenau, à Ebert et à Scheidemann, à Liebknecht et à Rosa Luxemburg. J’en veux aux spartakistes et aux Freikorps. J’en veux à la Grande Guerre d’avoir ôté toute valeur à la vie humaine. J’en veux à l’inflation, au Bauhaus, à Dada et à Max Reinhardt. J’en veux à Himmler, à Gœring, à Hitler et à la SS, à Weimar, aux putains et aux maquereaux. Mais, par-dessus tout, je m’en veux à moi-même. Je m’en veux de n’avoir rien fait. Ce qui est moins que ce que j’aurais dû faire. Ce qui est tout ce dont le nazisme avait besoin pour l’emporter. Je suis coupable, moi aussi. J’ai mis ma survie au-dessus de toute autre considération. C’est une évidence. Si j’étais vraiment innocent, je serais mort, Anna. Ce qui n’est pas le cas. »
« — Mon ange, s’il y a bien une chose qu’a montrée la dernière guerre, c’est que n’importe qui peut tuer n’importe qui. Tout ce qu’il faut, c’est un motif. Et une arme.
— Je n’y crois pas.
— Il n’y a pas de tueurs. Seulement des plombiers, des commerçants, et aussi des avocats. Chacun est parfaitement normal jusqu’à ce qu’il appuie sur la détente. Il n’en faut pas plus pour livrer une guerre. Des tas de gens ordinaires pour tuer des tas d’autres gens ordinaires. Rien de plus facile. »
Entr’autres lieux communs, on fera une petite virée au-dessus du Rio de la Plata avec des opposants de Perón, et on retrouvera même les ruines d’un camp d’extermination de Juifs dans la pampa, mais cette approche d’une Histoire si difficile à comprendre ne m’a pas paru vaine, même si elle peut sembler oiseuse, ou simpliste. Kerr donne quelques éclaircissements sur ses sources en fin d’ouvrage.
\Mots-clés : #antisémitisme #communautejuive #criminalite #culpabilité #deuxiemeguerre #exil #guerre #historique #politique #xxesiecle
- le Lun 31 Juil - 15:06
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Philip Kerr
- Réponses: 12
- Vues: 1241
Chris Kraus
Christopher "Chris" Johannes Kraus, né à Göttingen (alors en Allemagne de l'Ouest) en 1963, est un auteur et réalisateur allemand.
Réalisateur, scénariste, écrivain, Chris Kraus a notamment étudié à l'Académie allemande du film et de la télévision de Berlin. Il est l’auteur de plusieurs œuvres cinématographiques qui lui ont valu de nombreux prix, parmi d'autres 22 nominations aux Oscars allemands.
Son long-métrage Quatre Minutes (2006) a été couronné de succès dans le monde entier. Ce drame carcéral a obtenu un grand succès critique et commercial en France et a été adapté au théâtre (Théatre La Bruyère, Paris, 2014).
En 2011, l'actrice Paula Beer, alors âgée de 14 ans, a commencé sa carrière internationale avec le drame historique Poll.
En 2017, la comédie The Bloom of Yesterday (Die Blumen von gestern), plusieurs fois primée, est sortie en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Pour sa performance, l'actrice française Adèle Haenel a reçu une nomination pour la meilleure actrice pour le Prix du film autrichien 2018.
Outre des fictions, Chris Kraus a également coréalisé un documentaire sur l’écrivain et réalisateur Rosa von Praunheim, Rosakinder (2012).
Chris Kraus est par ailleurs l’auteur de quatre romans, dont Das kalte Blut (2017), son ouvrage le plus connu, paru en Belgique et en France en 2019 sous le titre La Fabrique des salauds.
Ouvrage traduit en français :
La fabrique des salauds
--------------------------------------------------------
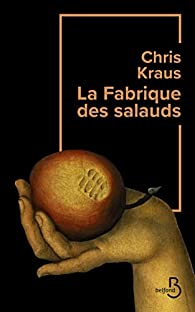
L'histoire commence dans un hôpital : deux hommes partagent la même chambre, l'un atteint d'une fracture du crâne, avec en permanence une « soupape » pour drainer le liquide céphalorachidien pour éviter l'hypertension intracrânienne, hippie tout en cheveux, et l'autre, Koja, guère mieux loti car il a une balle dans le crâne impossible à extraire.
Koja va raconter sa vie et celle de sa famille : épopée qui commence en 1905 pour s'achever autour de 1974.
On découvre ainsi la famille Solm, originaire de Riga. Lors des soulèvements de 1905, les bolchéviks s'en prennent à Großpaping le grand-père paternel, qui défend son église et périra noyé, assassiné par eux. Il a un fils artiste peintre qui a épousé la baronne won Schilling, qui a côtoyé le Tsar Nicolas II, au caractère bien trempé. Par opposition, le grand-père maternel est appelé Opapabaron.
De cette union naît Hubert, alias, Hub ou Hubsi pour les intimes, favorisé dès le départ : il est né le jour de l'assassinat de Großpaping donc béni des Dieux, surtout de sa mère. Ensuite vient Konstantin alias Koja .
Enfin, Eva alias Ev' une petite fille fait son entrée, dans la famille Solm. Ses parents sont morts pendant les premières émeutes ou échauffourées de Riga. Elle est confiée, via la nounou, à la famille Solm qui finira par l'adopter sans savoir qu'elle est juive.
Le décor est planté pour la famille que l'on va suivre de Riga, ville où alternent les règnes passagers des populistes de tout bord. de persécutant on devient persécuté et le cycle recommence.
Evidemment, c'est préférable si on a quelques connaissances historiques sur l'époque....on peut mieux remettre tout en situation.
Je dois dire que je me suis un peu perdue dans les diverses fonctions de Koja, agent simple, double, triple....
Lui, l'ancien nazi qui se fait circoncire pour mieux infiltrer le Mossad....le personnage trouble d'Ev qui se révélera (évidemment) juive d'origine...mariée à un SS ça fait désordre...qui se partage entre les deux frères...à l'insu de l'un d'eux (ça va de soi)...une petite fille naît, destin tragique (je m'y attendais) .... On découvrira tardivement l'histoire abracadabrante de la balle logée dans le crâne de ce sinistre Koja....
Bref, je n'ai pas aimé, la transformation d'hommes ordinaires en criminels de guerre....etc...seule la partie historique est intéressante..du moins c'est mon avis.... surtout l'après-guerre d'ailleurs.
La seule particularité qui est assez amusante, si je puis dire, est l'acharnement de Koja a vider son sac dans la malheureuse tête fracassée de ce hippie qui est contraint de l'écouter à son grand désespoir...
Voilà, 1000 pages, de tours et détours des vilains garçons pour parodier le titre d'un roman de Mario Vargas Liosa...mais le thème était beaucoup plus léger évidemment.
Assez éprouvant à lire comme tous les récits qui ont trait à cet épisode tragique de la guerre de 40...le massacre des juifs et pas que...
\Mots-clés : #antisémitisme #famille #guerre
- le Mer 5 Juil - 6:22
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: Chris Kraus
- Réponses: 1
- Vues: 218
Hubert Haddad
Palestine
Par un concours de circonstances imprévues, un soldat israélien est capturé par un commando palestinien à l’insu de Tsahal et survit (et en prime il a perdu la mémoire). Il est recueilli par Asmahane, une aveugle, et sa fille Falastìn ; il ressemble au fils et frère disparu, et elles le font passer pour lui.
Devenu Nessim, il erre dans Hébron et alentour, vivant l’abjecte oppression israélienne, ce qui donne un panorama assez approfondi de la condition palestinienne, avec des points de vue arabes mais aussi juifs (et un rejet assez consensuel des « internationaux »). Une étrange attirance mutuelle lie Nessim et Falastìn. Recueilli dans une faction combattante, grâce à un passeport israélien (le sien !) Nessim-Cham se rend à Jérusalem, où il est muni d’une ceinture explosive.
« Tu détisses chaque nuit le temps passé pour garder l’âge de ton amour, tu es comme la reine qui défait son métier. Personne ne reviendra, mais tu restes pareille à ton souvenir. Tes yeux usés de larmes ne voient plus que l’image ancienne… »
« Dans la lumière verticale, les champs d’oliviers ont un tremblement argenté évoquant une source répandue à l’infini. L’ombre manque à midi, sauf sous les arbres séculaires aux petites feuilles d’émeraude et d’argent, innombrables clochettes de lumière au vent soudain et qui tamisent le soleil mieux qu’une ombrelle de lin. À l’est d’Hébron, du côté des colonies et au sommet des collines, ils ont presque tous été arrachés, par milliers, mis en pièces ou confisqués, sous prétexte d’expropriation, de travaux, de châtiment. »
« C’est écrit, ma fille. L’occupant se retirera dans un proche avenir pour ne pas être occupé à son tour. Simple question de démographie. »
Ayant un peu fréquenté Israël, Cisjordanie et bande de Gaza, j’ai retrouvé dans ce livre cette Histoire en marche de nos jours, une colonisation qui ne cache même pas son nom. Et le destin de Nessim-Cham souligne peut-être le déchirement de peuples pourtant si proches, où la répression humiliante mène à la haine qui conduit aux pires extrémités.
\Mots-clés : #actualité #colonisation #conflitisraelopalestinien #contemporain #guerre #politique #segregation #terrorisme #violence #xxesiecle
- le Ven 26 Mai - 12:48
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 20
- Vues: 923
Paul Auster
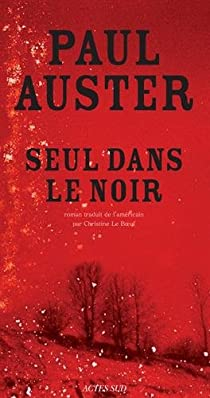
Contraint à l’immobilité par un accident de voiture, August Brill, critique littéraire à la retraite, s’est installé dans le Vermont chez sa fille Miriam, qui ne se remet pas d’un divorce vieux de cinq ans.
Elle vient de recueillir sa propre fille, Katya, anéantie par la mort en Irak d’un jeune homme parti pour Bagdad juste après leur rupture…
Pour échapper aux inquiétudes du présent et au poids des souvenirs peu glorieux qui l’assaillent, Brill se réfugie dans des fictions diverses dont il agrémente ses innombrables insomnies.
Cette nuit-là, il met en scène un monde parallèle où le 11 Septembre n’aurait pas eu lieu et où l’Amérique ne serait pas en guerre contre l’Irak mais en proie à une impitoyable guerre civile. Tandis que la nuit avance, imagination et réalité en viennent peu à peu à s’interpénétrer, comme pour interroger la responsabilité de l’individu vis-à-vis de sa propre existence et vis-à-vis de l’Histoire.
Allégorie puissante et inspirée, Seul dans le noir établit un lien entre les désarrois de la conscience américaine contemporaine et le questionnement de Paul Auster quant à l’étrangeté des chemins qu’emprunte l’invention romanesque.
source Babelio
En résumé, trois âmes en peine cohabitant dans la maison familiale du Vermont. Trois générations qui chacune et ensemble mêlent leur peine et leur espoir.
Le grand-père, August Brill, a perdu Sonia, la femme de sa vie ? Il passe de longues nuits, seul dans le noir, à s'inventer des histoires, à créer des mondes parallèles où des événements tragiques n'auraient pas eu lieu...l'attentat du 11 septembre 2001, ni de guerre en Irak, mais une drôle de guerre civile entre Etats... dans laquelle le héros, dont il n'est que le double, s'enlise, qu'il ne comprend pas (moi non plus) et chargé d'une étrange mission ...(invraisemblable).

Myriam, sa fille, semble s'être retirée du monde après un divorce dont elle ne se remet pas. L'écriture, peut-être, la sauvera...
Katya, la petite-fille, passionnée de cinéma, la plus meurtrie peut-être; ayant rompu avec son ami, Titus, celui-ci est parti pour Bagdad...tout en étant farouchement opposé à cette guerre, mais l'opportunité de gagner une somme d'argent considérable en conduisant un camion de transport aura raison de ses scrupules....et autre but avoué : acquérir de l'expérience afin d'écrire...il connaîtra malheureusement une fin aussi prématurée que violente, très, très violente...
Accablée de culpabilité, Katya se rapproche de son grand-père au cours de leurs longues nuits d'insomnies partagées.
Bill qui est donc contraint de rester couché suite à un grave accident de voiture, une jambe fracassée, regarde avec Katya des films à la chaîne ... s'en suit d'ailleurs une intéressante interprétation sur la signification des objets dans certains films.... .
Bref, on le voit se lamenter sur son sort, Sonia, pourquoi m'as-tu abandonné ? Sonia son ex femme avec laquelle il a repris la vie commune au bout d'une dizaine d'années et qui vient de mourir d'un cancer....On apprend au cours de l'histoire qu'il l'avait lui-même quittée pour une femme plus jeune avec laquelle il avait vécu de nombreuses années avant qu'elle-même le quitte pour un homme plus riche .... discuter avec sa petite-fille de sa vie passée avec Sonia...avec quelques annotations sexuelles..on se demande ce que ça vient faire là....car qui parlerait de sa vie très très privée à sa petite-fille ? " Le corps possède un nombre limité d'orifices. Contentons-nous de dire que nous les avons tous explorés".
« Comme tout cela va vite. Hier enfant, aujourd'hui vieillard, et d'alors à maintenant, combien de battements de coeur, combien de respirations, combien de mots prononcés et entendus ? Touchez-moi, quelqu'un. Posez la main sur mon visage et parlez-moi... »
Voilà....très bien écrit, c'est quand même Paul Auster, mais je n'ai pas accroché une seconde...passant de la fiction à la réalité sans arrêt, laborieux...pas passionnant...
Je déconseille formellement à tous ceux qui sont limite dépressifs....
Au final, pas très bien saisi ce qu'il voulait prouver, le désarroi d'une certaine classe bourgeoise américaine sans doute, c'est dur la réalité, ça fait (parfois) très mal.
Me laissera pas un souvenir impérissable...
\Mots-clés : #famille #guerre
- le Ven 12 Mai - 1:49
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Paul Auster
- Réponses: 127
- Vues: 12743
Antonio Lobo Antunes
L'Ordre naturel des choses
Livre premier, Douces odeurs, doux morts
Un cinquantenaire (on apprendra plus tard qu’il se prénomme Alfredo) vivant avec une jeune diabétique, Iolanda, amoureux d’elle et l’entretenant avec sa famille, soliloque sur cet amour (il la dégoûte) et son enfance.
Portas, membre de la Police politique sous la dictature mis à l’écart par la Révolution, qui vit misérablement de cours d'hypnotisme par correspondance (ses élèves, portant un turban avec un rubis, déplaçant leurs proches par lévitation), poursuivi par les tourterelles et épris de Lucilia, une prostituée mulâtre, louchonne et battue, Portas retrouve cet homme (on apprend qu’il s’appelle « Saramago ») à la demande de son « ami écrivain ». Ces deux récits alternent par chapitres, dérivant souvent dans le délire halluciné d’un flux de conscience onirique, hantés par le fascisme et sa peur des communistes, les défunts de la morgue, l’odeur de chrysanthème, de jacinthe ou de dahlia du diabète. Lisbonne et le Tage sont omniprésents, entre sordidité et tristesse.
Livre Deux, Les Argonautes
Le père de Iolanda est un ancien mineur : « À Johannesburg, en 1936, je volais sous terre, extrayant de l'or » ; revenu au Portugal, il creuse l’asphalte jusqu’à crever une canalisation, provoquant un débordement d'excréments. Il est convaincu d’avoir laissé sa femme folle en Afrique, alors qu’elle est morte du diabète à la naissance de Iolanda. Orquídea, sa sœur qui vit aves eux, souffre de monstrueux calculs rénaux qui passionnent son médecin.
« Je venais de décider de m'embarquer pour retourner à Johannesburg car je n'aime pas le Portugal, je n'aime pas Lisbonne, je n'aime pas Alcântara, je n'aime pas la Quinta do Jacinto ["la fermes des jacinthes", son quartier à Lisbonne], je n'aime pas cette absence de galeries et de buvettes, cette absence de wagonnets de minerai, de m'embarquer pour retourner à Johannesburg parce que Solange [sa métisse sénégalaise] me manque, ainsi que la lampe à huile qui agrandissait son visage, qui embrouillait mes rêves et prolongeait jusqu'à l'aube les gestes de tendresse, quand on a sonné à la porte et un homme avec un magnétophone en bandoulière, incapable de voler, m'a dit sur le paillasson J'ai été agent de la Police politique, monsieur Oliveira, j'ai à peine une demi-douzaine de questions à vous poser à propos de votre fille et de votre gendre et je cesse de vous embêter. »
Livre Trois, Le voyage en Chine
Le major Jorge Valadas, qui a couché avec la fille du commodore Capelo, est arrêté pour conspiration démocratique sous Salazar, et torturé.
« Quand on m'a fourré pour la première fois dans l'ambulance, après m'avoir arrêté, et que j'ai demandé où nous allions, on m'a répondu En Chine, mon garçon, et il faut un bon bout de temps pour arriver là-bas, or depuis ce temps-là j'ai navigué d'un côté et de l'autre avant de jeter l'ancre à Tavira, dans la caserne près de la mer d'où je ne vois pas la mer, où j'entends les vagues mais où je ne les vois pas, où j'entends les oiseaux mais où je ne les vois pas, de sorte que j'ai compris qu'on m'avait menti, que je ne suis pas à Tavira, que je ne suis pas dans une caserne, que je ne suis pas dans l'Algarve, qu'on m'avait fait traverser sans que je m'en rende compte une masse de pays et de fleuves, une masse de continents, et qu'on m'avait largué ici, non pas au Portugal mais près de la frontière avec la Chine, dans un pays semblable aux assiettes orientales de ma grand-mère, avec des femmes tenant des éventails, avec des pagodes ressemblant à des kiosques à journaux et des arbustes penchés au-dessus de lacs bordés d'hibiscus, aux berges reliées par des ponts délicats comme des sourcils arqués par la surprise. J'ai compris que j'habite non pas une prison mais une soupière de faïence rangée dans une armoire entre des cuillers en porcelaine ornées de dragons qui tirent la langue le long du manche. »
Sa sœur Julieta vit enfermée au grenier parce qu’elle est d’un autre père, puis enceinte du fils de la couturière. Son frère Fernando, « le stupide » de la famille, a épousé Conceiçao, une bonne :
« …] monsieur Esteves qui t'avait amenée de Beja quand il était devenu veuf
(le froid de Beja l'hiver, les moissons brûlées par la gelée, le vent roulant dans la plaine comme un train hurlant)
afin que tu travailles pour lui, que tu lui réchauffes son dîner, que tu lui nettoies son appartement de la rue Conde de Valbom et que tu occupes sur le matelas le côté que la défunte avait troqué pour une dalle funéraire dans une allée des Prazeres,
monsieur Esteves dont j'ai fait la connaissance quand je t'ai accompagnée pour que tu prennes ta valise au rez-de-chaussée où tu habitais, avec la photo de la défunte sur un ovale en crochet,
monsieur Esteves, pas rasé, qui n'avait personne en dehors de toi, serrant dans ses poings la frange de la couverture,
un homme plus âgé que je ne le suis à présent, au cou fait de rouleaux de peau qui disparaissaient dans sa veste comme une tortue se recroqueville dans sa carapace,
monsieur Esteves avec les moitiés mal ajustées de son visage, semblables à des pièces de puzzle emboîtées de force, [… »
(C’est sans doute la partie la plus satirique et grinçante du roman.)
Livre Quatre, La vie avec toi
Cette fois nous écoutons Iolanda, et Alfredo, qui parle de son oncle, le prophète biblique qui annonce le Déluge, maintenant enfermé à l’asile.
« – Tu en connais des histoires qui ne sont pas idiotes, Iolanda ? »
« …] je refuse d'être comme eux, Iolanda, mais je serai comme eux, un jour je m'approcherai de la glace, j'observerai mon visage et je vivrai du passé comme d'une pension de retraite et j'aurai pitié de moi [… »
Livre Cinq, La représentation hallucinatoire du désir
Vieillie, Orquídea se meurt d’un cancer en revisitant son enfance, mêlant celle des autres personnages ; Julieta qui chassait les poulets retrouve son père, vieilli.
« …] et avec moi mourront les personnages de ce livre qu'on appellera roman et que j'ai écrit dans ma tête habitée d'une épouvante dont je ne parle pas et que quelqu'un, une année ou une autre, répétera pour moi, suivant en cela l'ordre naturel des choses [… »
Un cousin éloigné vend la vieille maison familiale où vit Julieta, seule survivante et sans identité connue – et celle-ci va rejoindre la mer, et Jorge.
Portas l’enquêteur réapparaît souvent, de même que le cirque, et les morts (et les cistes, et un renard en cage).
Ce roman est une sorte de polyphonie des personnages tous liés entr’eux, évoquant leurs destinées individuelles et, au-delà, les hantises et attentes, souvenirs et rêves, misères et sordidités, vérités inavouées et culpabilités historiques d’un Portugal fratricide et colonial coincé entre passé et présent.
\Mots-clés : #famille #guerre #pathologie #regimeautoritaire #romanchoral #vieillesse #xxesiecle
- le Sam 6 Mai - 12:55
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Antonio Lobo Antunes
- Réponses: 41
- Vues: 6281
Christian Salmon
Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits
Dès l’introduction, le livre est rattrapé par l’actualité, voire dépassé par le phénomène dont il constate la naissance dans les années 90 :
« La clé du leadership américain et le secret du succès présidentiel résident, dans une grande mesure, dans le storytelling », écrivait en 2004 Evan Cornog, professeur de journalisme à l'université de Columbia, dans The Power and the Story, un essai qui réexamine l'histoire des présidences américaines de George Washington à George W. Bush à travers le prisme du storytelling : « Depuis les origines de la république américaine jusqu'à nos jours, écrit-il, ceux qui ont cherché à conquérir la plus haute charge ont dû raconter à ceux qui avaient le pouvoir de les élire des histoires convaincantes, sur la nation, ses problèmes et, avant tout, sur eux-mêmes. Une fois élu, la capacité du nouveau président à raconter la bonne histoire et à en changer chaque fois que c'est nécessaire est une qualité déterminante pour le succès de son administration. Et quand il a quitté le pouvoir, après une défaite ou à la fin de son mandat, il occupe souvent les années suivantes à s'assurer que sa version de sa présidence est bien celle qui sera retenue par l'Histoire. Sans une bonne histoire, il n'y a ni pouvoir ni gloire. »
Notre perception de l'histoire des États-Unis n'a-t-elle d'ailleurs pas le plus grand mal à démêler le vrai du faux, le réel de la fiction ? Qu'on se souvienne du président Ronald Reagan, qui évoquait parfois un épisode d'un vieux film de guerre comme s'il appartenait à l'histoire réelle des États-Unis… N'est-elle pas encombrée de fictions et de légendes, comme en atteste la réplique souvent citée du film de John Ford, Qui a tué Liberty Valance ? : « Lorsque la légende devient un fait établi, on imprime la légende. »
Dans Des logos à la story, Salmon nous montre comme le « marketing viral » des entreprises prospères les fait passer de la production des marchandises à celle des marques, puis des histoires.
« La publicité telle que nous la connaissons est morte, déclarait enfin en 2002 Sergio Zyman, ex-directeur marketing de Coca-Cola, dans son livre Les Derniers Jours de la publicité : Cela ne marche plus. C'est un colossal gaspillage d'argent, et, si vous n'y prenez garde, cela finira par détruire votre société… et votre marque. »
« Le paradoxe du marketing moderne est en effet qu'il doit fidéliser des comportements d'achat devenus changeants, labiles, imprévisibles. Ramener le consommateur volage au bercail de la marque et l'inciter à s'engager dans une relation durable et émotionnelle. »
« La consommation comme seul rapport au monde. On attribue aux marques les pouvoirs qu'on cherchait jadis dans les mythes ou la drogue : passer la limite, faire l'expérience d'un soi sans pesanteur, voler, planer ; c'était hier Icare ou le LSD, c'est aujourd'hui Nike ou Adidas. […] Les marques sont les vecteurs d'un « univers » : elles ouvrent la voie à un récit fictif, un monde scénarisé et développé par les agences de « marketing expérientiel », dont l'ambition n'est plus de répondre à des besoins ni même de les créer, mais de faire converger des « visions du monde ». »
Dans L’invention du storytelling management, c’est l’histoire des gourous qui ont révolutionné l’entreprise. L’idée est de motiver par l’émotion, et la rhétorique.
« Les gourous sont des pourvoyeurs de modes managériales. La popularité de leurs idées va et vient selon des cycles d'invention (quand l'idée est créée), de dissémination (quand l'idée est portée à l'attention d'un public ciblé), d'adhésion (quand l'idée est acceptée), de désenchantement (quand les évaluations négatives et les frustrations liées à cette idée commencent à émerger), puis de déclin ou d'abandon de l'idée… »
« De nombreux auteurs décrivent les gourous du management comme des experts en persuasion, qui cherchent à formater leur public par le biais de discours efficaces, à tel point que certains ont comparé leur puissance oratoire à celle des prédicateurs évangéliques. »
« « Les gens ne veulent plus d'informations, écrit Annette Simmons, auteure d'un des best-sellers du storytelling. Ils veulent croire – en vous, en vos buts, en votre succès, dans l'histoire que vous racontez. C'est la foi qui fait bouger les montagnes et non les faits. Les faits ne donnent pas naissance à la foi. La foi a besoin d'une histoire pour la soutenir – une histoire signifiante qui soit crédible et qui donne foi en vous. » D'où l'importance des pratiques d'autolégitimation et d'autovalidation, puisque la source unique de la performance d'un gourou, c'est sa personne même : c'est lui la source des récits utiles et de leurs effets mystérieux, c'est en lui que se concentrent les compétences narratives. Il est l'agent et le médiateur, le passeur et le message. Il doit vous convaincre que tout est en ordre, conforme au bon sens, au droit naturel. Il ne vous enseigne pas un savoir technique, il transmet une sagesse proverbiale, qui cultive le bon sens populaire, fait appel aux lois de la nature et convoque un ordre mythique. »
Dans La nouvelle « économie fiction » sont évoqués les (nombreux) employés des call centers du « nouveau rêve indien », à Bombay, qui se font passer pour des États-Uniens et sont déshumanisés et acculturés dans le formatage identitaire de la globalisation au travers de cette délocalisation virtuelle.
« Depuis le début des années 1980, la figure du cadre a ainsi cédé la place à celle du manager, puis au leader et au coach, et finalement au storyteller, dont les récits parlent au cœur des hommes et non seulement à leur raison, en leur proposant des visions de l'entreprise et des fictions qui les aident à fonctionner [… »
Le néomanagement impose une fiction de processus de groupe ou équipe dans l’entreprise (ce qui m’a ramentu mes doutes lors d’un MOOC sur le digital).
« L'autorité d'un récit – celui du « changement » – a pris sa place [à l’autorité]. Un récit écrit par le marché sous ses nombreux pseudonymes, aussi nombreux que les hétéronymes de Pessoa : la mondialisation, la globalisation, le progrès technique, la concurrence… »
Renvois à la créativité, à l’authenticité…
« Les techniques du management s'apparentent de plus en plus à celles de la mise en scène, les partenaires doivent s'ajuster le mieux possible à leurs rôles, de façon à rendre le récit crédible aux yeux d'un public de consommateurs et d'investisseurs. »
Dans Joueurs de Don DeLillo, une entreprise préfigure les sociétés de services à la personne.
« L'ironie de DeLillo, qui prenait pour cible la tendance des sociétés capitalistes à transformer toute émotion en marchandise, y compris les sentiments les plus intimes, comme le deuil, le remords ou la dépression, pouvait paraître excessive en 1977. »
« La nouvelle idéologie du capitalisme privilégie le changement à la continuité, la mobilité à la stabilité, la tension à l'équilibre et propose un nouveau paradigme organisationnel : l'entreprise sans frontières, décentralisée et nomade, libérée des lois et des emplois, légère, agile, furtive, qui ne se reconnaît d'autre loi que le récit qu'elle se donne, d'autre réalité que les fictions qu'elle répand dans le monde. »
« « Légèreté, rapidité, exactitude, visibilité, multiplicité et consistance » : cela pourrait constituer un bon résumé des valeurs du nouveau management. Il n'en est rien. Ce sont les titres de six conférences que devait prononcer l'écrivain italien Italo Calvino en 1985-1986 aux États-Unis. Il avait choisi six valeurs essentielles à ses yeux, qui devaient constituer l'épistémè du XXIe siècle. Il rédigea les cinq premières, qui furent publiées à titre posthume sous le titre Leçons américaines. »
Les entreprises mutantes du nouvel âge du capitalisme : ou « créer un mythe collectif contraignant » et enfumer tout le monde, en interne comme à l’extérieur de l’entreprise.
« Les applications du storytelling en entreprise accompagnent le mouvement par lequel chacun est mis en demeure de raconter sa vie et son travail, de transmettre son savoir-faire, de mobiliser ses énergies et d'accepter un changement. »
« Le récit y [dans les storytelling organisations] est en effet considéré tout à la fois comme un facteur d'innovation et de changement, un vecteur d'apprentissage et un outil de communication. Il constitue une réponse à la crise du sens dans les organisations et une méthode pour construire une identité d'entreprise. Il structure et formate la communication, à l'intention des consommateurs comme des actionnaires. »
Cas d’école de dérégulation :
« Enron était devenu un véritable mirage financier, producteur d'illusions non seulement pour ses salariés intéressés à la croyance, mais aussi pour les plus grandes banques du monde, les analystes financiers, les experts comptables et les actionnaires de Wall Street. »
« Plus le monde de la finance s'éloignait des estimations rationnelles et des performances économiques, plus la cosmétique d'entreprise consistant à rendre une entreprise belle et désirable pour les investisseurs a pris de l'importance dans la gestion des nouvelles organisations. […] Dans un monde rationnel, ce fiasco exemplaire aurait signé la mort du storytelling et de ses vertus hypnotiques. Et pourtant, près de dix ans plus tard, il reste plus que jamais la bible des « gourous du management ». »
La « mise en histoires » de la politique :
L’exploitation émotionnelle de l’histoire « évangélique » d’une fille d'une victime du 11 septembre réconfortée par le président dans la campagne de George W. Bush en 2004 : le rôle du « conseiller en communication », ou spin doctor (depuis Reagan), le récit du héros contre des méchants (simple et reprenant la forme narrative des mythes anciens).
« Si l'exercice du pouvoir présidentiel tend à s'identifier à une sorte de campagne électorale ininterrompue, les critères d'une bonne communication politique obéissent de plus en plus à une rhétorique performative (les discours fabriquent des faits ou des situations) qui n'a plus pour objectif de transmettre des informations ni d'éclairer des décisions, mais d'agir sur les émotions et les états d'âme des électeurs, considérés de plus en plus comme le public d'un spectacle. Et pour cela de proposer non plus un argumentaire et des programmes, mais des personnages et des récits, la mise en scène de la démocratie plutôt que son exercice.
La capacité à structurer une vision politique non pas avec des arguments rationnels, mais en racontant des histoires, est devenue la clé de la conquête du pouvoir et de son exercice dans des sociétés hypermédiatisées, parcourues par des flux continuels de rumeurs, de fausses nouvelles, de manipulations. »
Storytelling de guerre
Les centres de simulation du Pentagone deviennent, avec l’aide d’Hollywood, des théâtres de réalité virtuelle privilégiant des situations expérientielles plutôt que cognitives. Le recrutement militaire se fait via la vidéo, comme le traitement psychologique des états de stress posttraumatique.
« L'invention d'un modèle de société dans lequel les agents fédéraux, réels ou fictifs, doivent disposer d'une autonomie d'action suffisante pour protéger efficacement la population n'est rien d'autre que l'instauration d'un état d'exception permanent qui, ne trouvant plus sa légitimité dans le droit et la Constitution, la cherche et la trouve dans la fiction. »
« …] la puissance de l'entreprise américaine de mise en fiction du réel permet le triomphe des préjugés sur la morale la plus élémentaire, la négation du réel par la toute-puissance des représentations qui prétendent le transformer. »
L'empire de la propagande
Le gouvernement George W. Bush, juste avant la guerre en Irak :
« Nous sommes un empire maintenant, poursuivit-il, et, lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. »
« …] les dirigeants de la première puissance mondiale se détournent non seulement de la realpolitik, mais du simple réalisme, pour devenir créateurs de leur propre réalité, maîtres des apparences, revendiquant ce qu'on pourrait appeler une realpolitik de la fiction. »
Ron Susking, journaliste d’investigation (2004) :
« Il ne nous restera plus ainsi qu'une culture et un débat public fondés sur l'affirmation plutôt que sur la vérité, sur les opinions et non sur les faits. Parce que, lorsque vous en êtes là, vous êtes contraint de vous fier à la perception du pouvoir. »
Renouvellement de la propagande en infotainment type Fox News, aux contenus dictés par le gouvernement républicain, les fake news, dès 2004, manipulation de l'information marquée d’un obscurantisme émanant de la droite fondamentaliste chrétienne et opposé aux réalistes. C’est la droite chrétienne conservatrice contre la connaissance objective, la foi contre la raison.
Conclusion – Le nouvel ordre narratif : en France aussi, depuis le rôle de Henri Guaino dans la campagne de 2007.
« Don Quichotte lui aussi voulait changer le monde en racontant une histoire… Comme l'écrivait Michel Foucault : « À lui de refaire l'épopée, mais en sens inverse : celle-ci racontait […] des exploits réels, promis à la mémoire ; Don Quichotte, lui, doit combler de réalité les signes sans contenus du récit. » »
« Les « campagnes marketing » de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal signent donc une profonde évolution — et peut-être une vraie rupture — dans la culture politique française. Formatés par leurs conseillers experts en storytelling, réduits à leurs talents respectifs pour appliquer les consignes de « mise en scène » - et Sarkozy l'a nettement emporté sur ce terrain -, les deux candidats ont de concert contribué à délégitimer la politique : s'adressant aux individus comme à une « audience », évitant l'adversaire, contournant les partis, ils ont substitué au débat public la captation des émotions et des désirs. Ce faisant, ils ont inauguré une ère nouvelle de la démocratie, que l'on pourrait qualifier de « postpolitique ». »
Postface à l'édition de 2008 : en prolongement de l’analyse précédente du storytelling sarkozien, Salmon évoque la réaction au contrôle gouvernemental de l'agenda médiatique du décryptage par la presse. Puis pointe le « nouvel ordre narratif » :
« Ce qui est en jeu aujourd'hui, à tous ces niveaux à la fois, c'est l'apparition d'une même raison régulatrice qui consiste à réduire et à contrôler, par le storytelling et les machines de fiction, les conduites individuelles. »
Cet essai est proprement époustouflant lorsqu’on le lit en ayant connu l’ère Trump ; même autrement, il explique nombre de curieuses constatations qu’on a pu faire en observant notre société.
\Mots-clés : #actualité #contemporain #essai #guerre #historique #medias #politique #psychologique #social #xxesiecle
- le Sam 15 Avr - 17:09
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Christian Salmon
- Réponses: 3
- Vues: 320
Georges Duby
Le Dimanche de Bouvines (27 juillet 1214)
Un livre d’histoire (« grand public ») qui… fit date !
« Les événements sont comme l'écume de l'histoire, des bulles, grosses ou menues, qui crèvent en surface, et dont l'éclatement suscite des remous qui plus ou moins loin se propagent. Celui-ci a laissé des traces très durables : elles ne sont pas aujourd'hui tout à fait effacées. Ces traces seules lui confèrent existence. En dehors d'elles, l'événement n'est rien. Donc c'est d'elles, essentiellement, que ce livre entend parler. »
« C'est la raison qui me conduit à regarder cette bataille et la mémoire qu'elle a laissée en anthropologue, autrement dit à tenter de les bien voir, toutes deux, comme enveloppées dans un ensemble culturel différent de celui qui gouverne aujourd'hui notre rapport au monde. »
Duby nous dit que vers l’an mil, la guerre ne fut plus considérée comme bonne par l’Église, et que la paix lui fut préférée, avec un rôle d’échange dorénavant dévolu au négoce ; c’est ainsi qu’elle en vint « à tolérer le lucre, à l'absoudre ». Ensuite l’Église travaille à instaurer la paix (armée) de Dieu, que le roi (consacré) va diriger personnellement. Le dimanche est chômé à la guerre, qui est toujours affaire de la chevalerie, comme la prière celle du clergé, et le labeur celle des roturiers, selon les trois ordres hiérarchisés de la société. L’essor de la monnaie va permettre celui des mercenaires, et aussi des tournois, joute équestre, jeu d'argent, « combats de plaisance » où la jeunesse exalte prouesse et largesse.
Et justement la bataille de Bouvines ressort à ce type d’exploit (quasiment "sportif", avec ses champions, son rituel, etc.). J’ai naturellement pensé au Désastre de Pavie de Giono – d’autant que Duby le cite comme source d’inspiration de son livre, de ton plus libre qu’un texte érudit !
Le code d’honneur reste prégnant, et tuer n’est pas le but.
« Parce que la guerre est une chasse, menée par des gens expérimentés, maîtres d'eux-mêmes, solidement protégés, qui ne rêvent pas d'exterminer leur ennemi, s'il est bon chrétien, mais de le saisir. Pour le rançonner. Encore une fois : pour gagner. »
« Quand, au début de l'engagement, Eustache de Malenghin se met à crier : « À mort les Français », tous ceux qui l'entendent sont écœurés, révoltés d'une telle inconvenance. Aussitôt les chevaliers de Picardie empoignent l'impertinent, ils le saignent. C'est le seul chevalier dont il est dit qu'il trouva la mort sur le champ de Bouvines. Avec Etienne de Longchamp, atteint lui, accidentellement, d'un couteau, par l'œillère du heaume. Tous les autres cadavres, ce fut le bas peuple qui les fournit. »
La conséquence légendaire de cette bataille est la naissance d’une nation, dans la lignée de Charlemagne et opposée à l’Allemagne, « mythe de la nation et de la royauté réunies ».
Déconstruit finement toute la complexité des ressorts de l’événement (y compris économiques). Captivant !
\Mots-clés : #contemythe #guerre #historique #moyenage #politique #religion #social #traditions
- le Mar 15 Nov - 11:36
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Georges Duby
- Réponses: 3
- Vues: 494
Umberto Eco
Construire l’ennemi et autres textes occasionnels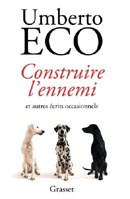
Dans Construire l’ennemi, Eco documente la stigmatisation de l’étranger, du laid, du juif, de l’hérétique, de la femme (notamment sorcière), du lépreux à travers les temps, en produisant nombre d’extraits édifiants (sans omettre les auteurs religieux).
« Il semble qu’il soit impossible de se passer de l’ennemi. La figure de l’ennemi ne peut être abolie par les procès de civilisation. Le besoin est inné même chez l’homme doux et ami de la paix. Simplement, dans ces cas, on déplace l’image de l’ennemi, d’un objet humain à une force naturelle ou sociale qui, peu ou prou, nous menace et doit être combattue, que ce soit l’exploitation du capitalisme, la faim dans le monde ou la pollution environnementale. Mais, même si ce sont là des cas « vertueux », Brecht nous rappelle que la haine de l’injustice déforme elle aussi le visage. »
« Essayer de comprendre l’autre, signifie détruire son cliché, sans nier ou effacer son altérité. »
Mention particulière à La paix indésirable ? Rapport sur l’utilité des guerres, effarante justification états-unienne (et orwellienne) de la nécessité de l’ennemi, notamment pour des raisons économiques (anonyme, préfacé par J. K. Galbraith).
Absolu et relatif nous entraîne dans un débat philosophique qui revient rapidement au problème de notre conception de la vérité (atteignable ou pas).
La flamme est belle est une réflexion sur le feu, qui n’oublie pas Bachelard, entr’autres.
« Les amis pleins de sollicitude brûlent, pour des raisons de moralité et de santé mentale, la bibliothèque romanesque de Don Quichotte. On brûle la bibliothèque d’Auto da fé d’Elias Canetti, en un bûcher qui rappelle le sacrifice d’Empédocle (« quand les flammes l’atteignent enfin, il rit à pleine voix comme il n’avait jamais ri de sa vie »). »
Délices fermentées est consacré à Piero Camporesi, auteur de L’Officine des sens et « gourmet de listes ».
« Hugo, hélas ! » La poétique de l’excès :
« Le goût de l’excès le conduit à décrire en procédant par énumérations interminables [… »
« La beauté n’a qu’un type, la laideur en a mille. »
Cela m’a ramentu cette phrase (souvenir scolaire – on a beau dire du mal de l’école…) :
« Si le poète doit choisir dans les choses (et il le doit), ce n’est pas le beau, mais le caractéristique. »
Astronomies imaginaires (mais pas astrologie, croyance ou tromperie).
Je suis Edmond Dantès ! sur le roman-feuilleton, et « l’agnition ou reconnaissance » (d’un lien de parenté entre personnages) ; le texte commence ainsi :
« Certains infortunés se sont initiés à la lecture en lisant, par exemple, du Robbe-Grillet. Illisible si l’on n’a pas compris les structures ancestrales de la narration, qu’il détourne. Pour savourer les inventions et déformations lexicales de Gadda, il faut connaître les règles de la langue italienne et s’être familiarisé au bon toscan avec Pinocchio. »
Il ne manquait plus qu’Ulysse. Époustouflant patchwork de critiques du livre de Joyce, où la bêtise le dispute à l’antisémitisme.
Pourquoi l’île n’est jamais trouvée. Incipit :
« Les pays de l’Utopie se trouvent (à de rares exceptions près, comme le royaume du Prêtre Jean) sur une île. »
Texte passionnant sur l’histoire de la (non-)découverte d’îles plus ou moins fabuleuses.
« C’est parce que, jusqu’au XVIIIe siècle, date à laquelle on a pu déterminer les longitudes, on pouvait découvrir une île par hasard et, à l’instar d’Ulysse, on pouvait même s’en échapper mais il était impossible de la retrouver. »
C’est l’argument de L’Île du jour d’avant, mais on découvre aussi l’« Ile Perdue, Insula Perdita », île des Bienheureux de saint Brendan, et même un décryptage de La Ballade de la mer salée d’Hugo Pratt.
Réflexions sur WikiLeaks
« Sur le plan des contenus, WikiLeaks s’est révélé être un scandale apparent, alors que sur le plan de la forme, il a été et sera quelque chose de plus, il a inauguré une nouvelle époque historique.
Un scandale est apparent quand il rend publique une chose que tout le monde savait en privé, et dont on parlait à mi-voix par pure hypocrisie (cf. les ragots sur un adultère). »
« Et cela ne fait que confirmer une autre chose que l’on sait pertinemment : chaque dossier élaboré pour un service secret (de quelque nation que ce soit) est constitué exclusivement de matériel qui est déjà dans le domaine public. Par exemple : dans une librairie consacrée à l’ésotérisme, on s’aperçoit que chaque nouvel ouvrage redit (sur le Graal, le mystère de Rennes-le-Château, les Templiers ou les Rose-Croix) exactement ce qui figurait dans les livres précédents. Et ce n’est pas que l’auteur de textes occultistes s’interdise de faire des recherches inédites (ou ignore comment chercher des informations sur l’inexistant), mais parce que les occultistes ne croient qu’à ce qu’ils savent déjà, et qui reconfirme ce qu’ils avaient déjà appris. C’est d’ailleurs là le mécanisme du succès de Dan Brown.
Idem pour les dossiers secrets. L’informateur est paresseux tout comme est paresseux, ou d’esprit limité, le chef des services secrets, qui ne croit que ce qu’il reconnaît.
Par conséquent, puisque, dans tous les pays, les services secrets ne servent pas à prévoir des cas comme l’attaque des Twins Towers et qu’ils n’archivent que ce qui est déjà connu de tous, il vaudrait mieux les éliminer. Mais, par les temps qui courent, supprimer encore des emplois serait vraiment insensé.
Si les États continuent à confier leurs communications et leurs archives confidentielles à Internet ou d’autres formes de mémoire électronique, aucun gouvernement au monde ne pourra plus nourrir des zones de secret, et pas seulement les États-Unis, mais même pas la République de Saint-Marin ou la principauté de Monaco (peut-être que seule Andorre sera épargnée). »
« Et même si la grande masse des citoyens n’est pas en mesure d’examiner et d’évaluer la quantité de matériel que le hacker capture et diffuse, la presse joue désormais un nouveau rôle (elle a déjà commencé à l’interpréter) : au lieu de relayer les nouvelles vraiment importantes – jadis, c’étaient les gouvernements qui décidaient des nouvelles vraiment importantes, en déclarant une guerre, en dévaluant une monnaie, en signant une alliance –, aujourd’hui c’est elle qui décide en toute autonomie des nouvelles qui doivent devenir importantes et de celles qui peuvent être passées sous silence, allant jusqu’à pactiser (cela est arrivé) avec le pouvoir politique pour savoir quels « secrets » dévoilés il convenait de révéler et ceux qu’il fallait taire.
Puisque tous les rapports secrets qui alimentent haines et amitiés d’un gouvernement proviennent d’articles publiés ou de confidences de journalistes à un attaché d’ambassade, la presse prend une autre fonction : jadis, elle épiait le monde des ambassades étrangères pour en connaître les trames occultes, désormais ce sont les ambassades qui épient la presse pour y apprendre des manifestations connues de tous. »
Tout le bref texte devrait être cité !
Et c’est toujours aussi délectable de se régaler de l’esprit d’Umberto Eco…
\Mots-clés : #complotisme #contemporain #discrimination #ecriture #espionnage #essai #guerre #humour #medias #philosophique #politique #social #universdulivre #xxesiecle
- le Lun 24 Oct - 13:57
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Umberto Eco
- Réponses: 69
- Vues: 8737
Avrom Moshé Fuchs
Vienne et plus précisément le Prater ; la guerre Autriche/Hongrie contre la Russie est déclarée, les soldats partent dans les trains qui passent sur le pont, les prostituées cherchent les rares clients.
Parmi les prostituées il y a la belle Mitzi surveillée par son mari Max (comme elle Juif) qui déteste Karl (chrétien) ancien compagnon de Mitzi.
« Karl se dégagea lentement des mains de Max.
– Il faut toujours qu’il me salisse mon smoking, ce youpin, dit-il en s’époussetant soigneusement la manche du bout des doigts.
– Youpin ? Tu m’insultes ? T’as pas intérêt à m’insulter, t’entends ? Je vais te montrer, youpin ! Attends un peu !
Sa grosse tête disproportionnée surmontée de sa petite casquette à pompon, pareille à l’anse d’un couvercle de marmite, penchée de côté, tel le museau d’un taureau furieux devant qui on brandit un tissu rouge, Max marcha sur son adversaire, le repoussant de son torse. Un œil plissé, minuscule fente à peine visible, l’autre, l’œil de verre, fixe et écarquillé, comme vivant, un peu rougi, il jaugea son ennemi avec une rage froide :
– Tu m’as entendu, espèce de porc ?
– Max, laisse-le tranquille, tu recommences ! s’écria Mitzi, et, de toutes ses forces, elle le tira en arrière.
– Mais oui, battez-vous un peu, dit la vieille Horvatzka, de toute façon, il n’y a pas de clients. »
Karl veut épater Mitzi
« puis il déroula un papier jaune dont il tira un doigt bagué, coupé, dit-il, en guise de souvenir, de la main d’un ennemi tué. Mitzi toucha le doigt avec dégoût et ôta sa main, comme s’il s’agissait d’un ver de terre, mais la curiosité l’emporta et elle essaya d’en retirer la bague.
– Impossible, lui dit Karl, même avec une hache !
– Je pourrais y arriver, lui répondit Mitzi, c’est un anneau de mariage, il suffirait de le tremper dans du vinaigre et il s’enlèverait.
Elle tapa sur la table avec le doigt mort et dans ses beaux yeux verts un peu égarés par l’ivresse chatoyait toute sa cruauté de femme qui cherchait à écraser la volonté de l’homme.
– Donne-le-moi en souvenir, murmura-t-elle, enjôleuse, en se pendant des deux bras au cou de Karl. »
[/color]
Max est réformé, il lui manque un pouce et il a un œil de verre.
« T’auras beau les aimer ou les détester, tous les hommes sont enrôlés pour la guerre. On les prend tous. Tous ceux qui sont bons pour le service. Mais toi, tu n’es bon à rien… T’es un éclopé… Il te manque un pouce et t’as un œil de verre, lui assène sa femme.
Avec l’indifférence et la brutalité des ménagères qui enfoncent les doigts dans les yeux du poisson avant de le débiter en morceaux avec le couteau, Mitzi enfonça deux doigts dans l’œil de verre de Max, le retirant et le montrant aux femmes autour d’elle avant de le remettre en place dans l’orbite vide.
– Il est un peu trop gros, notre Max, dit Ermine la noiraude, en lui posant la main sur les fesses.
Les prostituées, en expertes, le tâtent de tous côtés telles des bouchères examinant une génisse. »
Max voient les juifs qui ont fuient la Galicie arriver au Prater, vu leurs tenues et leur comportement il se demande si leur Dieu est le même que le sien, celui qui a une synagogue étriquée où lui et Mitzi se sont mariés.
Des Russes passent dans les rues, les magasins sont vides, les saltimbanques étrangers qui jouaient sur la place ont été arrêtés, certains relâchés rejoignent le café. Max lui joue aux cartes.
Mitzi tombe malade, elle ne peut plus « travailler », l’argent manque à la maison, la vieille mère de Mitzi critique Max, il doit trouver leur pitance, elle est handicapée.
Tout est triste, sale même l’automne a éteint ses couleurs. Les soldats ne supportent plus le mépris des officiers, ils arrachent les étoiles et tout ce qui évoque la brutalité et la mort. Des manifestants remplissent les rues aux cris de « vive la république, à bas le Kaiser.
De nouvelles prostitués arrivent, les soldats russes rentrent chez eux.
La vieille prostituée Horvatzka, il y a file devant chez elle.
« On ne trouve pas de viande en ce moment, mais ce que je vous offre vaut mieux que la viande de porc, messieurs, mes petits chiens, engraissés et goûteux.
Et elle apporte à intervalles réguliers de petits chiens rôtis, étalés sur un plat, tout entiers, tête comprise, les petites pattes en l’air, dégageant une odeur âcre et sucrée. Ce sont les mêmes petits chiens qu’elle gardait dans son hôpital pour les soigner, qu’elle aimait, de tout son amour chrétien, leur préparant leur nourriture et les faisant dormir dans le même lit qu’elle. La viande est dévorée par des bouches avides aussitôt et elle va en chercher d’autres. Dans le coin cuisine sombre et puant les chiffons absorbent les odeurs et on entend un gémissement :
– Maman, donne-moi quelque chose à manger.
C’est le fils de la vieille, Anton, rentré de l’hôpital. La peau sur les os qui pointent comme ceux d’un squelette, une jambe entièrement amputée, l’autre de moitié. Il reste, dans les ténèbres gluantes et putrides, couché là, un monceau d’os, une vivante tache noire qui remue, sombre et effrayante. »
Mitzi est morte.
« – Max, alors, tu vas le dire ce kaddish ?
Max a l’impression de voir sa femme debout dans ses bas noirs, perchée sur ses talons hauts devant le miroir couvert d’un châle sombre, une cigarette à la bouche, soufflant la fumée par le nez en deux volutes égales. Il soulève son menton de peur. Soudain il ne voit plus rien et se sent libéré d’un énorme poids qui quitte son dos pour toujours.
– Je ne sais pas prier, la vieille. J’ai oublié. Je ne sais pas ce qu’il faut dire.
– Tu ne sais pas ? Et qu’est-ce que tu sais, par exemple ? J’aimerais bien que tu me dises ce que tu sais. En voilà un vrai Juif ! Les Juifs d’aujourd’hui… Malheur à moi, ça crève le cœur. »
C’est triste, sale, misérable, c’est la vie de ces Juifs dans ce faubourg proche du Prater. C’est la vie des prostituées et de leurs « fiancés », ainsi nommés les proxénètes. La guerre est perdue, eux aussi.
La nuit
Leïb le noir est employé par le Seigneur, il doit amener les bovins à la boucherie chrétienne, mais ce soir il n’a pas envie. Il rentre à la maison où se trouvent sa femme et ses deux filles Rivké et Rokhl et le fils Boroukh.
Leïb questionne durement sa fille Rivké :
- – Quand est-ce que c’est arrivé, Rivkè, hein ? Qu’est-ce que t’en dis ? Raconte…
- Comme sous les coups d’une scie émoussée, tous les corps furent parcourus d’un frisson. C’était le grincement des dents de Leïb. Soudain il saisit le bras pendant de Rivkè de ses doigts avec la force d’une pince de fer, il le tira comme s’il voulait l’arracher telle une branche cassée et le jeter. Un sourd gémissement étiré se fit entendre :
- – Ouille, ouille, papa, aïe, aïe…
- – Tu as mal ? Hein ?
- – Oui, oui…
- – Est-ce qu’il t’a battue ?
- – Il m’a tordu le bras.
Leïb questionne sa femme et lui demande qui c’est ; elle dit un étranger un commandant. Leïb demande à sa femme d’aller chercher un grand sac au grenier.
« Il n’avait honte devant personne, pas même devant ses propres filles, pour exercer sa brutalité têtue. Autant lui était un taiseux obstiné, autant sa femme était une criarde déchaînée. Sa bouche, telle une cloche, résonnait d’imprécations. Leïb tenait à ce que sa femme lui obéisse, et sa femme s’y refusait. Les cris de la maison traversaient portes et fenêtres, des cris sourds et lourds, comme des coups d’un tambour rugissant au milieu d’un orchestre en folie.
Pareille à une chatte après les coups, Shprintsè les subissait et les oubliait, se sentant confortée d’y avoir résisté. Les joues empourprées après cette agitation et ce tumulte, elle tira la toque de Leïb sur ses yeux, criant toujours de sa voix tonitruante :
– Malheur à celles qui n’ont pas un mari costaud comme un taureau, longue vie à lui. Un tel pourvoyeur, un tel maître de maison ! On aurait beau traverser toute la Pologne, on ne trouverait pas un lion pareil ! Qu’en penses-tu, Leïb ?
Ce n’était pas de la flagornerie et cela arrachait au sombre Leïb un demi-sourire pour ces paroles flatteuses, malgré son humeur massacrante, un sourire, telle une étincelle dans une cheminée, qui passait comme un éclair sur son visage barbu.
Comme d’habitude après les coups, elle remit de l’ordre dans ses cheveux, repoussant les mèches sous son châle. Elle alluma vite la lampe à pétrole.
Les ombres s’animèrent sous la lumière rouge et elle monta rapidement l’échelle déglinguée jusqu’au grenier et descendit le grand sac. »
Leïb gagne le village il voit le commandant des soldats ruthènes sortir d’une maison.
« Il était perché sur le toit comme un oiseau noir, il examina d’un long regard le commandant. Soudain il l’interpella très fort :
– Monsieur le commandant, vous, monsieur le commandant !
Celui-ci s’approcha, ne sachant pas ce qu’on lui voulait, et, étonné, leva la tête vers le toit :
– Qu’est-ce que tu veux, youpin ? Qu’est-ce que tu fais là-haut ? »
« – Monsieur le commandant, est-ce que vous voulez que je vous chante une chansonnette juive ? Vous voulez, monsieur le commandant ?
Il se mit à fredonner, puis s’écria :
– Dis donc, face de porc, ça te plaît ?
Et il agita sa hache étincelante.
Le commandant se dit alors que le Juif sur le toit était un fou, il eut un méchant rire moqueur, saisit son pistolet et tira en direction du toit. Lorsque le coup finit de retentir et que le petit nuage bleu se dissipa, il vit le visage grimaçant et la barbe hirsute, le regard plein de haine qui le transperça de son hostilité noire.
– Un fou de youpin, marmonna-t-il en crachant par terre, et il s’en fut. »
Leïb est connu dans la région :
« Toute l’affaire était menaçante, effrayante. On se demandait quel malheur ce Juif allait attirer sur tout le monde. Leïb le Noir n’était pas n’importe qui. Ses voisins avaient depuis toujours peur de lui, évitaient d’avoir une dispute avec lui. C’était un homme querelleur, coléreux, violent, il était capable de s’emparer d’un couteau »
Leïb reçoit des réponse à ses questions par son neveu Yosl.
« – Alors quoi de neuf en ville, fiston ?
– Rien. Stepnik s’est emparé du traîneau et du cheval de Zaïnl. Il a arraché la barbe à l’oncle Leïzer. Il a giflé Srol-Eliè. Hier soir, Stepnik avait entraîné chez lui la fille de Shmulik, la petite Bronia, et a abusé d’elle… La femme de Shmulik pleure et se lamente.
– Vous entendez, oncle Leïb, insista Yosl, ses longues dents de travers. Il n’y a pas longtemps, Havrilek, le gardien, s’est emparé chez Mikhl, le menuisier, de tous les outils de son atelier. Pour rien. « Les Juifs n’ont plus le droit de travailler dans son métier », a dit ce chien. Qu’est-ce que je fais alors ? La nuit je me rends dans la grand-rue, à la maison de Havrilek, et je lui fous deux gifles et je reprends la boîte à outils, bref…
– Juste une gifle, l’interrompit la femme de Menakhem, jetant un regard moqueur sur son fils.
– Oui, la gifle il l’a bien reçue, tu me connais ! C’était une claque retentissante, tu sais ? Maman, il a craché deux dents, ce chien !
– Eh bien, tu peux rendre grâce à l’Éternel, Yosl, si les soldats t’avaient attrapé, ils t’auraient, à Dieu ne plaise, tué. On a jeté un mauvais sort à nos voisins goys ou quoi ? Tu t’es caché ? J’en perds l’âme et le cœur de peur. Les boutons d’uniforme dirigent le monde, et les Juifs se trouvent à neuf coudées sous terre. On craint tout simplement pour sa vie. Quels temps pourris ! »
La belle-sœur de Leïb le reconnait dans la nuit :
« Dans la clarté bleutée, tout semble se dérouler comme sur un fleuve pris dans la glace, tout se détache avec netteté, difforme. Voici une ruine de maison chaulée tel un visage blessé, grimaçant de douleur. Un balcon noirci par un incendie monte en biais vers le firmament pareil à un abîme. La synagogue en pierre au toit incendié, comme décapitée, s’élève plus haut que les maisons, enveloppée d’un silence énigmatique, comme d’une toile de deuil. Leyè sent un froid glacial lui couper le souffle. Elle pourrait rebrousser chemin et rentrer chez elle en courant. Mais elle a les jambes sciées par la peur. Elle enfonce son visage davantage dans son châle, telle une poule qui protège sa tête sous son aile. Cependant sa curiosité devant cette rencontre inopinée et terrifiante est plus forte que la peur. Elle jette un coup d’œil furtif au-dessus de son châle et croit voir Leïb lever les pieds et baisser la tête. Il penche la nuque comme s’il voulait épier les vitres jaunes des fenêtres pointues et givrées, seulement il a l’air de regarder non par les fenêtres, mais par les cheminées. Elle est prise d’un fou rire. »
Leïb apprend que le commandant doit partir demain. Il doit en tenir compte s’il veut accomplir la vengeance pour le déshonneur fait à sa fille Rivké. Leïb pénètre par le toit dans la chambre du commandant Stepnik.
« Leïb se tient tout droit, les épaules larges, le sac plié sous le bras, le poing serré. Stepnik sent maintenant le regard muet et affûté comme une lance. L’homme en face de lui est celui qu’il avait vu sur le toit. L’effroi le dessaoule en un clin d’œil. Il saisit le pistolet sur la table de nuit, mais Leïb lui assène sur la main un coup de poing qui fait tomber l’arme. Il s’empare d’un couteau que Leïb lui arrache aussitôt avec une adresse surprenante. Leurs yeux se croisent, regards du dernier combat mortel. La mort et la vie sont sur les plateaux de la balance, le fléau oscille. Deux corps massifs s’empoignent, s’étreignent, par la nuque, par les bras, comme s’ils voulaient s’embrasser. La colère fait grimacer les visages. La respiration courte souffle entre les dents serrées, la bave coule de leur bouche. Une brève bagarre. Un corps tombe lourdement à terre, telle une montagne qui s’effondre. Stepnik gît visage contre terre, sa poitrine se gonfle comme un ballon. Leïb se tient au-dessus de lui et essuie de sa manche le sang qui coule de son front.
– Lève-toi, dit Leïb à son ennemi vaincu. »
Il l’emmène sous la menace :
« – Bon, il faut en finir, la nuit avance. Tu ne tueras plus de Juifs, tu ne violeras plus personne.
Leïb ouvre subitement son grand sac noir et le passe sur la tête de son ennemi assis, fait un nœud avec la corde et, avec la force d’un taureau, il le soulève, le jette sur son épaule, comme les paysans portant un porc au marché.
Leïb part du lourd pas de ses bottes ferrées, le poids du mort sur le dos, à travers les champs enneigés vers la montagne de Krilivits. Il grimpe sur des rochers, descend dans des ravins de plus en plus bas. Là s’ouvre une grotte sombre comme une tombe maudite. Les paysans de la région y jettent les cadavres de leurs chiens et de leur bétail. »
***
La synagogue témoigne des pogroms (Polonais dans les quartiers Juifs)qui se sont déroulés dans la région lors de la guerre Polono/Ukrainienne.
L’attitude du commandant la haine des soldats et des ruthènes vis-à-vis des Juifs, hommes, femmes, enfants.
La porte en chêne
La maison de Leïb est attaquée en pleine nuit.
« – Ouvrez vite, salauds de youpins, que le diable vous emporte ! On va vous fusiller ! Tous ! Ouvrez !
Les coups et les cris résonnaient de plus en plus forts, faisant trembler les murs en torchis, les fenêtres frémissaient, encore un dernier coup et la maison allait s’effondrer et ensevelir les habitants sous ses décombres. »
Tous les membres de la famille se saisit d’une arme, qui un couteau, une hâche, un bâton. Leïb a confiance en la porte en chêne .
« Il commença par tâter la porte en chêne de cette maison en torchis, son héritage. Elle était abîmée et gauchie par l’âge, mais le bois restait solide, un verrou en métal et de grosses solives la renforçaient dans sa largeur. Leïb retenait son souffle. »
Qui sont les agresseurs, des soldats, des voisins ? Qu’est-ce qu’on lui veut ?
« Il est un homme qui vit dans la misère, un journalier employé à charger du bois et du blé dans les trains. Il lui incombe de gagner sa vie, de pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants, d’entretenir sa pauvre maisonnée. Et tous les jours, un autre souci, un autre malheur le frappent qu’il a toutes les peines du monde à surmonter. »
Les insultes pleuvent, les coups. Shprintsè demande à Leïb de rentrer.
« Sur son chemin de retour du front italien, à la fin de la guerre, il était arrivé à Lemberg un jour après le pogrome. Il avait vu la vieille synagogue calcinée, les maisons brûlées dans les rues juives. Il était allé à l’enterrement au champ de repos des soixante-douze victimes juives, enfants, femmes, hommes, tués par les soldats polonais. Il avait vu les cadavres allongés côte à côte, couverts de châles de prière ensanglantés. Il avait encore dans l’oreille le chant déchirant du kaddish « Dieu de miséricorde », entonné par tout le monde, les lamentations des femmes et des enfants qui s’élevaient jusqu’au ciel. Après, pendant six jours et six nuits, le fusil à l’épaule, il avait pris part à la bataille dans les rangs de l’autodéfense juive contre les assassins polonais. Ils en avaient tué quelques-uns, puis les avaient chassés de la ville et le calme était revenu. Et maintenant, ce malheur s’est invité chez lui, dans sa maison, et il est prêt à défendre sa famille au prix de sa vie. »
Leïb ordonne à sa femme et ses enfants de se cacher et de ranger ce qu’ils peuvent. Tandis que lui supporte la porte de tout son corps pour empêcher les attaquants d’entrer, mais à force la porte s’abat sur lui. Sa famille le pense mort, les autres volent ce qu’ils peuvent avant de s’en aller. Les enfants et Shprintsè tentent de soulever la porte, mais elle est vraiment trop lourde. Mais Leïb, de toute sa force et sa colère est parvenu à se soustraire de dessous la porte de l’autre côté. Ils sont tous contents de le revoir vivant, mais Shprintsè se rend compte que les hommes ont volé le portefeuille de Leïb.
« Boroukh trouva dans un coin le sac avec le châle de prière et les phylactères de son père et les remit à leur place habituelle. Puis il rassembla les pages déchirées du Pentateuque, de la Haggadah de Pessah, de la Bible en yiddish de sa mère, du rituel et d’un livre de prières. Il déposa un baiser sur les saintes pages profanées et les remit sur l’étagère à côté de la lampe de Hanoukka en étain et de l’image charbonneuse du Mur des lamentations.
Sur le même mur chaulé se trouvaient des taches de sang sur lesquelles adhéraient des plumes de literie. Il s’en dégageait une ancienne tristesse et la douleur de générations disparues.
Leïb retourna au vestibule et Boroukh tint la lampe à pétrole pour l’éclairer.
– Papa, c’était une porte solide, elle datait de grand-père. Mais les assassins l’ont cassée, quel dommage ! Qu’est-ce qu’on va faire ?
– Oui, elle a servi bien longtemps, répond Leïb, en posant une main sur l’épaule du garçon.
Le regard préoccupé, le front labouré de profondes rides, il examine la porte en chêne, tachée de son sang, affalée dans le vestibule sombre sous la lueur rouge de la lampe, dans la nuit mystérieuse, engloutie dans les ténèbres. »
Une attaque par des voisins – soldats ou pas – qui rappelle les mauvaises heures des pogroms.
Dans le verger
Reb Zelig est associé à ses fils et beaux-fils, eux vendent, lui récolte dans son verger, en location auprès du Seigneur local.
Reb Zelig a engagé Reb Lipé pour surveiller le verger. Or ce jour là ce dernier lui dit avoir attrapé un voleur.
« J’ai bien surveillé le verger toute la journée et j’ai attrapé un voleur, un gosse, crie Lipè dans l’oreille dressée pour bien se faire entendre. Vous entendez ? En bas, dans le verger, j’ai mis la main sur un voleur qui arrachait des pommes à pleines poignées, se remplissant les poches. Regardez, j’ai attrapé sa casquette.
Reb Zelig, furieux, s’empare en silence de la casquette trouée du gamin, la tâte doucement, la retourne dans tous les sens, regarde la doublure et remarque en secouant sa barbe rouge :
– Ça vaut deux groschen en tout et pour tout ! En voilà une affaire… »
Reb Zelig part avec sa charrette livrer les fruits à la ville. Il reviendra ce soir. Zelig empêche les filles qui ramassent les fruits sur les arbres de les voler.
A la ville :
« La carriole se trouve prise d’assaut par une foule de femmes agitées, les fichus attachés sous le menton. Elles crient, elles tendent les mains, elles marchandent, elles goûtent. Des paniers, des tabliers se relèvent et s’emparent de petites pommes que Reb Zelig distribue entre les têtes serrées. Coléreux, il trône au-dessus de ses sacs, prend l’argent et grogne :
– Trois pommes toutes fraîches font une livre, les femmes…
Les petits-fils des clientes, pieds nus, la morve au nez, grimpent sur les roues, et les yeux avides mendient :
– Grand-père, une petite pomme…
Mais le grand-père ne donne rien.
– À la maison, garnements ! Pas de pommes pour vous ! »
Il déjeune chez lui avant de repartir au verger.
« En un clin d’œil, son regard fait le tour de tous ses biens : le jardin, la clôture défoncée, le toit de chaume noir, couvert de mousse verte, les poules. Il remarque, mécontent, qu’il manque à l’échelle de la mansarde un barreau.
– Qu’est-ce que tu as rapporté, Zelig ? lui demande sa femme en tendant son tablier.
Sans un mot, Zelig tire des oignons de son gousset, des maïs, des radis de sous le pan de sa veste et des poches de son caftan des herbes odorantes. Il les déverse dans le tablier de sa femme.
– Garde-les bien.
Il reste ensuite à Reb Zelig à se disputer avec les femmes, ses brus et ses filles, femmes obèses aux robes rapiécées, une pièce sur l’autre. Il doit leur rendre les sacs à nourriture et les marmites qu’il avait emportés. Il fait semblant de ne pas savoir que les récipients sont remplis des plus belles pommes et poires, celles qu’il apporte à sa femme.
Alors seulement Reb Zelig fait sa prière. Son talith crasseux posé sur la tête, le phylactère cubique, en cuir renforcé, pointant sur son front, telle une marmite en fonte. Il se tient penché devant la fenêtre, sautant des passages, comme un couturier pressé avec une aiguille démesurée. »
Reb Lipé est un petit malin, qui raconte toujours des histoires. Après un orage ils s’endorment dans la cabanne et à son réveil Reb Zelig s’aperçoit qu’il n’a plus dans sa botte l’argent de la vente.
Zelig fait semblant de partir à la ville, après avoir discrètement rebrousser chemin il découvre Reb Lipé allongé sous les arbres et dans sa main la bourse volée.
« De sous un arbre, à la hauteur de sa tête, apparaît soudain Reb Zelig, le fouet à la main. Il se redresse, calme, il prend tranquillement la bourse de la main de Reb Lipè, recompte placidement entre ses doigts deux fois le nombre de pièces : trois, sept, douze, dix-huit. Il fourre la bourse dans sa botte et soupire :
– Grâce au Nom Béni.
Les deux hommes ne se regardent pas, ne disent pas un mot. »
Le gamin retenu par Lipé est toujours là, Lipé comme si rien ne c’était passé, essaie de raconter à Zelig une histoire et une leçon de morale ? il ne veut pas perdre sa place.
« Hé, toi ! Tu m’entends ? s’écrie Reb Lipè en russe, se sentant soudain tout ragaillardi – il arrache la toque de sa tête et en redresse la pointe. Vous voyez, Reb Zelig ? Le garnement est là, il attend sa casquette. Vous entendez ? C’est le garçon de Semkè. Je lui ai pris aujourd’hui sa casquette, il faut la lui rendre. Il faut avoir pitié même d’un Chrétien. Il ne volera plus. Quand on n’a pas de chance, que peut-on se dire ? Un pauvre petit paysan…
Reb Zelig le regarde, l’air mécontent, fronçant ses épais sourcils :
– On est bien généreux avec l’argent d’autrui ! Est-ce qu’on peut tirer quelque chose de cette casquette ?
– En voilà une belle affaire, une vieille loque vaut peut-être deux groschen… Croyez-moi, Reb Zelig, ça n’en vaut pas la peine, croyez-moi, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, vouloir avaler le monde entier…
Il va chercher la casquette dans la cabane, s’approche doucement du gamin, lui pose gentiment la casquette sur la tête, lui fourre une pomme dans la poche à l’insu de Reb Zelig.
– Sauve-toi maintenant, rentre chez toi ! »
Travail, pas de confiance, mais c’est la pauvreté, la faim, et l’envie qui fait les voleurs.
Le vieux loup
Leizer un paysan déplore que son fils Chaïké soit un mécgréant, c’est-à-dire qu’il ne dit pas les bénédictions, il ne porte pas les phylactères. Un jour que Chaké n’était pas allé au heder Leïzer l’avait battu avec la ceinture et Chaïké avait reçu la correction en silence. La femme de Leïzer lui fait remarqué que leur fils est grand et qu’il a été soldat dans l’armée autrichienne, il est revenu avec un insigne de caporal et des médailles de récompense .
Chaïké participe parfois à la contrebande nocturne et aux bagarres avec les douaniers et les petits voyous ruthènes.
Il travaille dans les forêts pour un patron.
« Mais maintenant la timidité devant les gens et la peur de son père avaient quitté Chaïkè. Il ne prêtait plus la moindre attention à la colère de son père. Tous les matins avant d’aller au travail dans la forêt, il s’arrêtait dehors, sur la dalle, posait son pied botté sur la meule dans la cour pour aiguiser sa hache, faisait voler des étincelles dans toutes les directions. Pour s’assurer du tranchant de sa hache il le passait ensuite sur son pouce pour l’éprouver. Leïzer, fâché, voûté, tournait autour de lui lentement et à distance, l’épiant comme un matou autour d’un oiseau.
– Bonjour, papa, tu as fait ta prière ? lui demande Chaïkè en riant à pleine bouche, découvrant ses dents blanches.
Leïzer ressent la moquerie de son fils comme un coup de poignard au cœur et il détourne vite la tête. Voilà qui il a élevé ! Un goy, un apostat. Toutes ces années à dépenser son dernier sou pour payer la redevance du heder, pour faire apprendre à son fils à lire en langue sacrée une section du Pentateuque, à dire les bénédictions, à prier, bref, à être un Juif, comme il se doit.
– Oï, Chaïkè tu te gausses de Dieu, n’oublie pas qu’on ne se gausse pas de Dieu impunément, marmonnait Leïzer dans sa barbe. »
Chaïké raconte à son père qu’il a vu le loup dans la forêt, quelques jours après il s’avère que l’animal a égorgé six brebis chez un voisin. Plusieurs autres attaques.
Leïzer montre son épaule qu’à l’époque le loup lui avait déchirée. Il dit à son fils de se méfier ; ce vieux loup est un démon.
Chaïké est mal considéré par les paysans.
« Les paysans regardent de travers le jeune Juif qui marche le long de leurs palissades et lui opposent leurs dos hostiles. Chaïkè rencontre parfois un grand échalas, portant fièrement l’uniforme de l’armée ukrainienne aux boutons de cuivre, avec des rubans rouges. Ils se souviennent de leur enfance, de leurs bagarres aux poings, leurs nez en sang, leurs visages écorchés par les ongles, s’envoyant des pierres les uns aux autres, échangeant des insultes : youpin galopin, oreille de porc, voleur, fils de chienne. Maintenant leurs regards pleins de haine se percent mutuellement et ils se jaugent, furieux, de haut en bas et de bas en haut. Chaïkè d’un geste habile porte sa main droite sur le manche de sa hache dans son ceinturon, tel un soldat tenant son arme. En un instant ils jugent avec une prudence toute paysanne leur force respective, crachent par terre et détournent la tête. »
Nouvelle rencontre avec le loup
« Chaïkè au milieu de son chant assène un grand coup de sa cognée et se tait. Il lève les yeux et voit un peu plus loin, dans le brouillard dense entre les arbres, un loup immobile qui le regarde avec le feu de ses yeux verts. Un grand loup gris, la gueule ouverte, les crocs blancs et acérés, le guette. Chaïkè lui lance son bâton et le loup déguerpit. »
« Plus tard le loup s’habitua au feu et cessa de fuir. Quand il allumait un brasier, Chaïkè le voyait passer en courant, silencieux, entre les troncs, bondissant joyeusement tantôt tout près tantôt plus loin, hop, hop, sa langue rouge pendante, regardant calmement le feu.
Chaïkè s’était aussi habitué à la présence du fauve. Lorsqu’il s’asseyait tous les jours sur une souche pour manger avec appétit son déjeuner sorti de sa musette, frottant le pain d’ail et l’accompagnant d’un oignon juteux, il jetait des miettes aux corneilles et cherchait le loup des yeux. Dans son amour de toutes les créatures de Dieu, il éprouvait de la pitié à leur égard, pensant à la faim du loup, connaissant bien depuis l’âge de raison ce goût amer de la faim qui étreint les boyaux comme par une corde, provoque des crampes d’estomac, assombrit la vue, transforme la langue en un bout d’écorce sèche. Il se disait que dans la grande forêt sombre et épaisse de Seredits, qui s’étend sur des milles et des milles, au-delà même de Tarnopol, il y avait suffisamment d’animaux pour assouvir la faim des loups : cerfs, biches, lièvres, chiens sauvages. »
Une nuit des paysans voisins vinrent toquer à la porte de Leïzer, ils disent partir à la chasse au loup. Chaïké participe car Leïzer est trop âgé.
Dans la forêt le loup cerné saute sur Chaïké, il le mord profondément à l’épaule mais Chaïké parvient à le tuer, au contentement de tous.
« Chaïkè marchait à l’écart du groupe des paysans. Il jetait des coups d’œil au loup mort porté sur l’épieu. L’animal était tout rabougri, les pattes liées en haut, la tête et la queue pendantes, les crocs enfoncés dans la langue, un triste cadavre. Chaïkè sentit son cœur se serrer. Malgré la brûlure de son épaule blessée, il éprouvait la fierté de la vengeance. »
Quand les paysans ont besoin de l’aide d’un Juif pour traquer le loup ils n’ont pas de scrupule.
******************
Dans toutes presque toutes ces nouvelles, c’est la misère, la noirceur des âmes et des cœurs, la tristesse de l’ambiance et l’environnement.
La religion est présente, qu’elle soit suivie ou oubliée.
C’est surtout la haine des Juifs. Le rappel des pogroms, des guerres.
Les mots de l’auteur sont bruts, ce qui est, est vu, décrit avec fidélité, la vérité, c’est tout.
Une belle découverte pour moi.
c'est nettement mieux que le peu que j'en dis, mais trooop chaud !
\Mots-clés : #antisémitisme #guerre
- le Jeu 14 Juil - 9:43
- Rechercher dans: Écrivains du Proche et Moyen Orient
- Sujet: Avrom Moshé Fuchs
- Réponses: 4
- Vues: 1326
Louis-Ferdinand Céline
Guerre
Premier jet, qui a bénéficié de quelques reprises, d’un roman situé dans la bi(bli)ographie de Céline entre Voyage au bout de la nuit (ou Casse-pipe) et Guignol’s Band (en fait avant Londres, un autre manuscrit retrouvé) ; il vient de publier le premier et aurait mis de côté ce manuscrit-ci pour se consacrer à l’écriture de Mort à crédit. Autobiographie, ou autofiction d’une vie (et d’une œuvre) qui rôde autour de la haine de la guerre et de l’humanité en général.
Le brigadier Ferdinand Destouches, seul rescapé d’une compagnie anéantie pendant la première guerre mondiale, reprend conscience dans la douleur sur la ligne de front, puis regagne l’arrière où il sera soigné dans des hôpitaux de campagne.
« J’ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête. »
« De penser, même un bout, fallait que je m’y reprenne à plusieurs fois comme quand on se parle sur le quai d’une gare quand un train passe. Un bout de pensée très fort à la fois, l’un après l’autre. C’est un exercice je vous assure qui fatigue. À présent je suis entraîné. Vingt ans, on apprend. J’ai l’âme plus dure, comme un biceps. Je crois plus aux facilités. J’ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon et, vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d’horreur arrachés au bruit qui n’en finira jamais. Passons. »
« Ma torture de tête je l’entendais bien fort dans la campagne si grande et si vide. Je me faisais presque peur à m’écouter. Je croyais que j’allais réveiller la bataille tellement que je faisais du bruit dedans. Je faisais à l’intérieur plus de bruit qu’une bataille. »
« Deux jours ont dû passer, avec plus de douleurs encore, d’énormes bruits dans ma grosse tête, que de vie véritable. C’est drôle que je me souviens de ce moment-là. C’est pas tant que j’ai dégusté que je me rappelle, que d’être plus responsable de rien du tout comme un con, plus même de ma bidoche. C’était plus qu’abominable, c’était une honte. C’était toute la personne qu’on vous donne et qu’on a défendue, le passé incertain, atroce, déjà tout dur, qu’était ridicule dans ces moments, en train de se déglinguer et de courir après ses morceaux. Je la regardais moi la vie, presque en train de me torturer. Quand elle me fera l’agonie pour de bon, je lui cracherai dans la gueule comme ça. Elle est tout con à partir d’un certain moment, faut pas me bluffer, je la connais bien. Je l’ai vue. On se retrouvera. On a un compte ensemble. Je l’emmerde. »
« C’est l’instinct qui trompe pas contre la mocherie des hommes. »
« C’est écœurant quand on a vu pendant des mois les convois d’hommes et de tous les uniformes défiler dans les rues comme des bancs de saucisses, kakis, réserves, horizons, vert pomme, soutenus par les roulettes qui poussent tout le hachis vers le gros pilon pour con. »
Tandis qu’alentour on agonise, Ferdinand tombe sous la coupe de l’infirmière L’Espinasse, qui le sonde et le branle, mais aussi le protège. Lui qui exècre tout le monde (y compris ses parents), sympathise avec Bébert/Cascade le petit proxénète parisien, qui devient pour lui une sorte de modèle d’« affranchi », jusqu’à ce qu’il fasse venir sa femme (et soit fusillé pour automutilation).
« La voilà donc ici débarquée son Angèle sans avertir un matin dans la salle Saint-Gonzef. Il m’avait pas menti, elle était bandatoire de naissance. Elle vous portait le feu dans la bite au premier regard, au premier geste. Ça allait même d’emblée bien plus profond, jusqu’au cœur pour ainsi dire, et même encore jusqu’au véritable chez lui qui n’est plus au fond du tout, puisqu’il est à peine séparé de la mort par trois pelures de vie tremblantes, mais alors qui tremblent si bien, si intense et si fort qu’on ne s’empêche plus de dire oui, oui. »
La libido tient une grande place dans l’histoire, peut-être une réaction à la mort si proche.
« Ça m’était dur à cause de mon bras qui me faisait presque hurler quand je serrais fort et mon oreille qui se remplissait de bruit à en exploser quand je me congestionnais la physionomie. Quand même je bandais, c’était le principal. »
Et bien sûr le cynisme.
« C’est le canon, vers juillet 15 il s’est rapproché de plus en plus, qu’était devenu gênant. Fallait parler souvent très fort dans la carrée, tout fort pour s’entendre, répéter les cartes. »
Quant à la vision misogyne et raciste (Céline emploie le terme « bicot »), à la surabondance des injures, il ne faut pas avoir connu (au moins voici quelques décennies) une chambrée à l’armée pour s’en étonner. Je préfère souligner l’autoportrait de l’homme aux incessants bourdonnements dans la tête (Céline n’a pas reçu une balle dans l’oreille, mais a effectivement été médaillé et déclaré handicapé à 70%).
« Y avait d’énervant que les oiseaux dont les cris ressemblent tant aux balles. »
Sans doute trop inachevé pour atteindre la puissance d’autres de ses livres, demeure l’expression de la rage d’un blessé de l’existence.
\Mots-clés : #autobiographie #guerre #premiereguerre
- le Mer 1 Juin - 12:37
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Louis-Ferdinand Céline
- Réponses: 163
- Vues: 11804
Doug Peacock
Une guerre dans la tête
Doug Peacock évoque sans relâche son « vieil ami, l’écrivain anarchiste Edward Abbey », mentor paternel qu’il fréquenta vingt ans, jusqu’à sa mort comprise, et auteur de Le Gang de la Clef à Molette où Doug apparaît sous les traits de Hayduke.
Voilà un texte assez décousu qui mêle marches souvent solitaires dans différents paysages, évidemment les zones arides états-uniennes, mais aussi, en alternance, le Dhaulagiri au Thibet (sur les traces de la panthère des neiges, où il a une hémorragie dans la gorge, comme Abbey mortellement malade). Revient également de façon récurrente le souvenir traumatique du Vietnam, le vécu de son syndrome du vétéran, l’impression laissée par le massacre de My Lai. Toujours partagé entre son foyer et ses « moyens primitifs d’introspection – la marche, la solitude, le contact avec la nature − », Peacock se reconnaît (et est officiellement reconnu comme) asocial.
« Cela me convenait parfaitement : un paysage désert est un antidote au désespoir. »
« J’avais toujours vu dans la chasse la clef de voûte de l’évolution humaine. »
« Je crois que pour moi, les hélicoptères représentent le Mal en personne. Au Vietnam, ils semaient la mort à tout vent dans le ciel, en toute impunité. »
« D’avoir lâché prise, d’avoir chuté, m’avait calmé. La mort n’est pas l’adversaire de la vie, me dis-je, l’ennemie, c’est la peur d’appréhender la vérité, la crainte d’une véritable introspection. Ed m’avait appris cela, et ce soir-là j’éprouvai avec humilité la vérité de ses paroles. En fin de compte, il fallait lâcher prise, laisser aller la colère, le désir de possession et les attachements, laisser aller jusqu’au désir. »
« Je frôlai un genévrier et m’arrêtai soudain ; je sentais une odeur âcre de sécrétions félines, trop puissante pour provenir d’un simple chat sauvage. Je le savais d’expérience, car j’étais depuis longtemps familier de l’odeur des lynx, et j’avais un jour eu la bonne fortune de pouvoir sentir l’odeur fraîche d’un jaguar dans la Sierra Madré et, chose encore plus rare, celle d’un tigre de Sibérie, sur la rive d’un fleuve de l’Extrême-Orient russe. Cette région n’était pas une zone de jaguars, l’odeur provenait donc d’un couguar. La piste était toute fraîche. »
« La guerre est elle aussi un voyage initiatique. »
Considérations sur les vestiges indiens : les kivas (chambres cérémonielles des Indiens Pueblos, généralement de forme circulaire), les peintures rupestres avec Kokopelli, le joueur de flûte mythique ; évidemment rencontres avec des grizzlis ; fantasmes de félins.
On perçoit le désarroi de Peacock, où sourd aussi, parmi de déchirantes contradictions, une sorte d’élan mystique, ou plutôt un sens du sacré.
\Mots-clés : #amérindiens #ecologie #guerre #guerreduvietnam #initiatique #mort #nature
- le Jeu 21 Avr - 12:31
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Doug Peacock
- Réponses: 25
- Vues: 1425
Akiyuki Nosaka
La Tombe des lucioles et Les Algues d’Amérique
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’agonie de Seita, un adolescent livré à lui-même, sans ressources après les bombes incendiaires qui tuèrent sa mère (et sans nouvelle de son père parti au combat). Un moment recueillis par de la famille éloignée où ils sont mal reçus, il s’occupa de sa petite sœur, Setsuko, puis réfugiés dans une sombre cave avec la seule compagnie de lucioles, jusqu’à ce qu’elle meure de malnutrition, malgré ses rapines dans les champs de paysans peu partageurs. Les lucioles reviennent souvent en contrepoint d’un vécu douloureux mais relaté avec mesure, jusque dans cette nuit où Seita incinère Setsuko.
Bref récit sans pathos où on devine une grande part d’autobiographie, quasiment un témoignage.
« Badaboum ! À cet instant une bombe incendiaire, couleur bleue, cinq centimètres de diamètre, soixante de longueur, dévala du toit et, telle une chenille arpenteuse, sautilla sur la rue, jetant tout autour ses giclées d’huile ; ventre à terre, Seita se précipita alors vers l’entrée, mais une fumée noire commençant peu à peu à envahir la maison, il ressortit ; dehors, la file imperturbable des maisons, sans une âme qui vive, seulement un balai à feu et une échelle, dressés contre le muret d’en face ; du reste il fallait retrouver maman à l’abri, et il se mit en route, la petite Setsuko sur son dos toute secouée par les sanglots, quand à l’angle de la rue une fenêtre au premier étage se mit à vomir une fumée noire, puis d’un seul coup, comme si le mot de passe avait été donné, une bombe incendiaire qui couvait sans doute dans les combles embrasa tout, les arbres du jardin crépitèrent, le feu se rua le long de l’avant-toit, disloquant les volets qui dégringolèrent en flammes, devant ses yeux tout s’assombrit, l’atmosphère devint brûlante, et Seita, littéralement éjecté, détala à toutes jambes ; [… »
Les Algues d’Amérique est plus léger ; c’est l’après-guerre et ses privations, et le Japon est passé du militarisme nationaliste à une fascination pour l’occupant, de « Anglo-Saxons = Démons assoiffés de sang » à « Kyoû » (thank you).
Toshio reçoit, avec réserve, des Américains que sa femme Kyôko et leur fils Kei.ichi ont rencontrés en vacances à Hawaï ; il s’agira d’un complexe d’infériorité lié à la guerre, traité avec humour.
« À raison de cinquante paquets de cinq plaquettes de chewing-gum dans chaque boîte, sept jours de rations pour nous trois, ça en faisait neuf en tout, qui pesaient sur mes bras, en me communiquant une sensation d’abondance certaine tout au long du chemin [… »
\Mots-clés : #deuxiemeguerre #guerre
- le Mar 22 Fév - 11:50
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: Akiyuki Nosaka
- Réponses: 28
- Vues: 1903
Ernst Jünger
Feu et sang − Bref épisode d'une grande bataille
« Feu et sang », le déluge de feu d’acier de la « préparation d’artillerie » d’une part, et de l’autre l’avancée de l’infanterie qui lui succède dans une percée du front tenu par les Britanniques dans les Hauts de France lors de la guerre de quatorze.
C’est un témoignage saisissant de violence des affrontements, dans un lyrisme exalté qui révèle un enthousiasme martial, viril et troublant.
L’aspect machinal et inhumain de la guerre est souligné.
« Ici, l’époque dont nous sommes issus abat ses cartes. La domination de la machine sur l’homme, du valet sur le maître devient évidente, et un déchirement profond qui commençait déjà en temps de paix à ébranler l’ordre économique et social se manifeste aussi de façon mortelle dans les batailles. Ici se dévoile le style d’une génération matérialiste et la technique fête son triomphe sanglant. »
Jünger rapporte « la volonté de combat », « la volonté de victoire » et « la fureur de combattre » ; il évoque même une sorte de démesure qui transcende l’homme.
« Je remarque aussitôt que la résolution que j’avais prise : ne jamais perdre la tête, est ici absolument inapplicable. Chacun devient par nécessité une partie vivante d’une force supérieure. Ici, on ne peut que se laisser manipuler et former par l’action de l’esprit du monde en personne. L’histoire est vécue en son foyer central. »
\Mots-clés : #guerre #premiereguerre
- le Mer 16 Fév - 10:35
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: Ernst Jünger
- Réponses: 18
- Vues: 2616
Umberto Eco
Cinq questions de morale
- Penser la guerre (un texte à propos du Koweït, d’avril 1991, et un autre à propos du Kosovo, d’avril 1999).
« C'est un devoir intellectuel de proclamer l'impossibilité de la guerre. Même s'il n'y avait pas de solution alternative. Tout au plus, de rappeler que notre siècle a connu une excellente alternative à la guerre, c'est-à-dire la guerre "froide". Occasion d'horreurs, d'injustices, d'intolérances, de conflits locaux, de terreur diffuse, l'histoire devra finir par admettre que ce fut là une solution très humaine et proportionnellement bénigne, qui a même connu des vainqueurs et des vaincus. Mais il ne relève pas de la fonction intellectuelle de déclarer des guerres froides.
Ce que certains ont vu comme le silence des intellectuels sur la guerre a peut-être été la peur d'en parler à chaud dans les médias, pour la simple raison que ces derniers font partie de la guerre et de ses instruments, et qu'il est donc dangereux de les tenir pour un territoire neutre. De plus, les médias ont des temps différents de ceux de la réflexion. La fonction intellectuelle s'exerce toujours en avance (sur ce qui pourrait advenir) ou en retard (sur ce qui est advenu) ; rarement sur ce qui est en train d'advenir, pour des raisons de rythme, parce que les événements sont de plus en plus rapides et plus pressants que la réflexion sur les événements. C'est pourquoi le baron de Calvino s'était perché sur les arbres : non pour échapper au devoir intellectuel de comprendre son temps et d'y participer, mais pour le comprendre et y participer mieux encore. »
- Le fascisme éternel. Eco dégage les archétypes du fascisme, de « l’Ur-fascisme » (le préfixe Ur exprime l’ancienneté originelle, primitive) : c’est un syncrétisme qui tolère les contradictions, un irrationalisme ; il promeut le culte de l'action pour l'action, la suspicion envers le monde intellectuel, et rejette toute critique ;
« Pour l'Ur-fascisme, le désaccord est trahison. »
Il est bien sûr raciste, nationaliste ;
« L'Ur-fascisme naît de la frustration individuelle ou sociale. Aussi, l'une des caractéristiques typiques des fascismes historiques est-elle l'appel aux classes moyennes frustrées, défavorisées par une crise économique ou une humiliation politique, épouvantée par la pression de groupes sociaux inférieurs. »
Il a l'obsession du complot, promeut l'élitisme populaire.
« Chaque fois qu'un politicien émet des doutes quant à la légitimité du parlement parce qu'il ne représente plus la Voix du Peuple, on flaire l'odeur de l'Ur-fascisme. »
« Le héros Ur-fasciste est impatient de mourir. Entre nous soit dit, dans son impatience, il lui arrive plus souvent de faire mourir les autres. »
- Sur la presse (rapport présenté en janvier 1995 au Sénat italien, en présence de représentants de la presse).
« La fonction du quatrième pouvoir consiste à contrôler et à critiquer les trois autres pouvoirs traditionnels (ainsi que celui de l'économie, des partis et des syndicats), mais cela est possible, dans un pays libre, parce que sa critique n'a aucune fonction répressive : les mass media ne peuvent influencer la vie politique d'un pays qu'en créant de l'opinion. Mais les pouvoirs traditionnels ne peuvent contrôler et critiquer les médias, si ce n'est à travers les médias ; sinon, leur intervention devient sanction, soit exécutive, soit législative, soit judiciaire – ce qui n'arrive que si les médias se mettent hors la loi ou présentent des situations de déséquilibre politique et institutionnel. Cela dit, comme les médias – la presse, en l'occurrence – ne peuvent échapper aux critiques, c'est une condition de bonne santé d'un pays démocratique que sa presse sache se remettre elle-même en question. »
Eco évoque notamment les quotidiens qui « s'hebdomadairisent de plus en plus, contraints d'inventer de l'information, de transformer en information ce qui n'en est pas. »
Il expose ensuite les rapports presse-télévision et presse-monde politique :
« En Italie, le monde politique fixe l'agenda des priorités journalistiques en affirmant quelque chose à la télé (ou même en annonçant qu'il l'affirmera), et la presse, le lendemain, ne parle pas de ce qui s'est passé dans le pays mais de ce qui en a été dit ou de ce qui aurait pu en être dit à la télévision. Et encore, s'il ne s'agissait que de cela, car désormais la petite phrase assassine d'un homme politique à la télévision tient lieu de communiqué de presse formel. »
Un travers de plus en plus répandu :
« Quand elle ne parle pas de télévision, la presse parle d'elle-même ; elle a appris cela de la télévision, qui parle essentiellement de télévision. Au lieu de susciter une indignation inquiète, cette situation anormale fait le jeu des hommes politiques, satisfaits de voir que chacune de leurs déclarations à un seul média est reprise en écho par la caisse de résonance de tous les autres médias réunis. Ainsi, les médias, de fenêtre sur le monde, se sont transformés en miroir, les téléspectateurs et les lecteurs regardent un monde politique qui s'admire lui-même, comme la reine de Blanche-Neige. »
Étonnante anticipation du net et des réseaux sociaux en tant qu'amplificateurs du biais de confirmation que les bulles engendrent :
« Le danger du journal home made, c'est qu'il ne parle que de ce qui intéresse l'usager, le tenant ainsi écarté d'un flux d'informations, de jugements ou de cris d'alarme qui pourraient le solliciter ; il lui ôterait la possibilité de recevoir, en feuilletant le reste du journal, une nouvelle inattendue, non désirée. Nous aurions une élite d'usagers très informés, sachant où et quand chercher les informations, et une masse de sous-prolétaires de l'information, satisfaits d'apprendre la naissance d'un veau à deux têtes dans la région, mais ignorants du reste du monde. »
- Quand l'autre entre en scène (extrait de Croire en quoi ? ).
- Les migrations, la tolérance et l'intolérable. La partie la plus intéressante du recueil : Eco fait d’abord un distinguo entre immigration et migration :
« On n'a "immigration" que lorsque les immigrés (admis sur décisions politiques) acceptent en grande partie les coutumes du pays où ils immigrent, on a "migration" lorsque les migrants (que personne ne peut arrêter aux frontières) transforment radicalement la culture du territoire où ils migrent. »
Il explicite les notions de fondamentalisme et d’intégrisme, de politically correct et de racisme, notamment pseudo-scientifique, puis d’intolérance « pour le différent ou l'inconnu », une pulsion élémentaire, d’abord « sauvage », contre laquelle l’éducation est nécessaire, ensuite « doctrinale » (la trahison des clercs), alors devenue irrépressible. À propos du nazisme et de l’Holocauste, il dégage ce qui change par rapport aux antécédents :
« Le nouvel intolérable n'est pas seulement le génocide, mais sa théorisation. »
L'exposé est limpide, et conforte la conviction que j’ai toujours eue que reprocher son racisme inné à quelqu’un est aussi vain que de l’incriminer parce qu’il est congénitalement malade.
\Mots-clés : #essai #guerre #politique #racisme
- le Ven 17 Déc - 12:31
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Umberto Eco
- Réponses: 69
- Vues: 8737
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
|
|
|


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages

