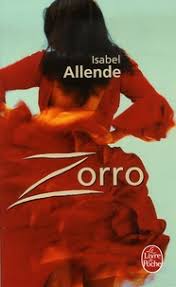La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 10:37
43 résultats trouvés pour discrimination
Dennis Lehane
Un dernier verre avant la guerre
À Dorchester, quartier de Boston (USA), Pat (Patrick Kenzie), le narrateur, s’occupe de recherche de personnes disparues avec Angie (Angela Gennaro), sa meilleure amie, amoureuse de son mari Phil, qui la tabasse (et lui le tabasse à l’occasion). Pat est le fils du « Héros », un pompier célèbre, mais violent à la maison. L’enquête porte sur Jenna Angeline, une femme de ménage noire qui serait disparue avec des documents confidentiels du sénateur Sterling Mulkern, relatifs à un projet de loi contre le terrorisme de rue.
« Les gens comme Mulkern ont l’habitude de créer les faits par eux-mêmes, puis de mettre les autres, à savoir nous, au courant. »
Pat est en photo dans le journal, comme son père jadis, quand Jenna est abattue dans ses bras. Puis c’est la guerre des gangs entre le mari de Jenna (qui l’a fait tuer) et son fils.
« Nous avons traversé South Boston – Southie pour quiconque n’est ni un touriste ni un présentateur de journal – en longeant des chapelets de petits immeubles à deux étages miteux, serrés comme une rangée de toilettes chimiques à un concert rock. Southie me sidère. Une bonne portion en est pauvre, surpeuplée, implacablement négligée. Les cités de D Street craignent autant que tout ce qu’on peut trouver dans le Bronx : sales, mal éclairées, grouillant de loubards en colère, les cheveux en brosse, qui traînent dans les rues avec une soif de sang et des battes de baseball. Il y a quelques années, pendant un défilé de la Saint-Patrick, un môme très irlandais avec un trèfle sur son teeshirt s’y est hasardé. Il est tombé sur une bande d’autres mômes irlandais qui avaient eux aussi des trèfles sur leurs teeshirts. La seule différence entre son teeshirt et les leurs, c’est que le sien disait « Dorchester » en vert au-dessus du trèfle, et les leurs disaient « Southie ». Les mômes de D Street ont supprimé la différence en balançant le môme d’un toit. »
Polar musculeux, typiquement états-unien dans sa fascination pour la violence, mais traitant du racisme avec des aperçus intéressants sur sa prégnance et ses subtiles ramifications. Reste que c'est assez pâle, surtout après une lecture de Faulkner.
\Mots-clés : #corruption #criminalite #discrimination #polar #racisme #social #violence
- le Mer 10 Avr - 12:40
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Dennis Lehane
- Réponses: 31
- Vues: 1500
William Faulkner
Lumière d'août
Lena Grove, enceinte, arrive d’Alabama à Jefferson à pied, croyant y retrouver à la scierie le père de l’enfant, Lucas Burch. De cette scierie Joe Christmas et Joe Brown (Lucas Burch) sont partis, bootleggers installés près de la maison de Joanna Burden, descendante d’une famille yankee abolitionniste. Lena ne trouve là que Byron Bunch, qu’elle pensait être son promis, et qui tombe amoureux d’elle ; dans le même temps, un incendie ravage la maison Burden : voilà comment Faulkner noue adroitement les destins.
Byron est la seule personne en contact avec le révérend Gail Hightower, presbytérien devenu un paria à cause du scandale de sa femme adultère et suicidée (et de sa fascination pour son grand-père confédéré mort à la guerre). Byron est aussi la voix de remarquables observations :
« L'homme sait si peu de chose sur son prochain. À nos yeux, hommes et femmes agissent toujours pour les mêmes motifs qui nous pousseraient nous-mêmes si nous étions assez fous pour agir comme eux. »
« Car la ville croyait que les dames savaient la vérité, car elle croyait aussi que, si les femmes coupables peuvent se laisser tromper en matière de péché, parce qu'elles passent une partie de leur temps à s'efforcer de n'être pas suspectes, les honnêtes femmes, au contraire, ne peuvent pas se tromper, car, étant honnêtes elles-mêmes, elles n'ont pas à s'inquiéter de leur propre honnêteté ni de celle des autres et, par suite, elles ont tout le temps de flairer le péché. C'est pourquoi, pensait-on, le bien peut les tromper presque toujours en leur faisant croire qu'il est le mal, mais le mal lui-même ne peut point les tromper. […]
Et la ville regretta alors d'être satisfaite, de même que les gens plaignent parfois ceux qu'ils ont forcé à faire ce qu'ils voulaient. »
« Mais, maintenant, je comprends la raison, pense Byron. C'est parce qu'un homme craint davantage ce qui pourrait lui arriver que les ennuis qu'il a déjà soufferts. Il se cramponne aux ennuis qu'il a déjà soufferts plutôt que de risquer un changement. Oui. Un homme parlera de son désir d'échapper aux vivants. Mais, ce sont les morts qui sont dangereux. C'est aux morts qu'il ne peut échapper, aux morts qui gisent tranquilles quelque part et n'essaient pas de le retenir. »
Brown dénonce Christmas : il a du sang noir, et c’est lui qui tua Miss Burden, avec qui il couchait.
On suit ensuite Christmas, avant le drame :
« Puis il se reconnut. Il ne s'était pas aperçu que la rue s'était mise à descendre et, brusquement, il se trouva dans Freedman Town, enveloppé par les odeurs d'été, les voix d'été de nègres invisibles. Elles semblaient l'enserrer comme des voix sans corps, chuchotant, parlant, riant dans un langage qui n'était pas le sien. Comme du fond noir d'un puits, il se vit enserré par des silhouettes de cases, vagues, éclairées au pétrole. Les réverbères eux-mêmes semblaient s'être espacés comme si la vie noire, le souffle noir composaient la substance respirable, de sorte que, non seulement les voix, mais les corps animés, la lumière elle-même semblaient s'être fluidifiés, agrégés lentement, particule par particule, avec la nuit maintenant pondérable, inséparable et une.
Immobile, debout, haletant, il regardait de tous côtés. Grâce à la lueur vague et fumeuse des lampes à pétrole, les cases, autour de lui, se détachaient sur les ténèbres. De tous côtés, même en lui-même, murmuraient les voix incorporelles, fécondes et moelleuses des femmes noires. C'était comme si lui-même et toute la vie mâle autour de lui étaient rentrés dans les ténèbres chaudes, les ténèbres humides de la Femelle originelle. […]
Il pouvait voir la rue par laquelle il était venu, et l'autre rue, celle qui l'avait presque trahi, et, plus loin, à angle droit, le rempart lointain et brillant de la ville elle-même, et, dans l'intervalle angulaire, le creux noir d'où il avait fui, le cœur battant et les lèvres en feu. Aucune lumière n'en venait, nul souffle, nulle odeur. Le creux était là, tout simplement, noir, impénétrable dans sa guirlande frissonnante de lumières d'août. On aurait pu prendre ce trou pour la carrière originelle, l'abîme même du néant. […]
Cependant, son sang se mit de nouveau à parler, parler. Il marchait vite, sur le même rythme. Avant même qu'ils se fussent détachés vaguement sur la poussière mourante, il semblait avoir compris que le groupe était formé de nègres, bien qu'il n'ait pu les distinguer ni les entendre. Ils étaient cinq ou six, égaillés et pourtant plus ou moins deux par deux ; et, de nouveau, dominant le bruit de son propre sang, il perçut le chaud murmure de voix féminines. »
Puis c’est l’enfance de Christmas qui est déroulée, de l’orphelinat pour enfants trouvés à la famille d’adoption, un presbytérien fort strict et rigide ; sa femme est bonne pour lui, mais il s’en défie. Puis c’est Bobbie, la serveuse avec qui il a une liaison, qui s’avère être une prostituée qui part lorsqu’il assomme son père adoptif et vole l’argent de sa mère adoptive ; il part à son tour pendant quinze ans, fuyant son sang noir, jusqu’à sa liaison ambigüe, une sorte de duel, avec Miss Burden. Celle-ci a un lourd passé (son grand-père et son demi-frère furent tué par le colonel Sartoris, esclavagiste), où la religion pèse aussi.
« De tout temps j'avais vu, j'avais connu des nègres. Pour moi, ils étaient quelque chose comme la pluie, les meubles, la nourriture, le sommeil. Mais, après cela, il me sembla les voir pour la première fois, non comme des gens, mais comme une chose, une ombre, dans laquelle je vivais, dans laquelle nous vivions, nous, les blancs, et tout le monde. Je pensais à tous les enfants qui venaient au monde, enfants blancs, menacés par cette ombre noire avant même qu'ils aient commencé à respirer. Et il me semblait voir l'ombre noire prendre la forme d'une croix. Et il me semblait voir les bébés des blancs lutter, avant même d'avoir pu respirer, lutter pour échapper à l'ombre qui était non seulement sur eux, mais sous eux, étendue comme l'étaient leurs bras, comme s'ils étaient cloués à la croix. Je voyais tous les petits enfants de ce monde, même ceux qui n'étaient pas encore nés, en longue file, les bras ouverts sur les croix noires. Je ne pouvais dire alors si je les voyais ou si je les rêvais, mais cela me terrifiait. Je criais la nuit. Je finis par le dire, par essayer de le dire à mon père. Je voulais lui dire que je mourrais si je ne pouvais échapper, sortir de dessous cette ombre. "C'est impossible, dit-il. Il faut lutter, s'élever. Mais tu ne peux t'élever qu'en élevant l'ombre avec toi. Et tu ne pourras jamais l'élever à ton niveau. Je vois cela maintenant. Je ne l'avais pas vu avant de venir ici. Mais, échapper, tu ne le pourras pas. La malédiction de la race noire vient de Dieu. Mais la malédiction de la race blanche c'est le noir qui, éternellement, sera l'élu de Dieu parce qu'un jour II l'a maudit." »
Beaucoup de phrases attribuées à Christmas peuvent, sorties de leur contexte, induire en erreur sur ce que pense profondément ou pas l’auteur (et même le personnage).
« Il savait par expérience que, faute d'un autre homme, les femmes finissent toujours par revenir. »
« Car Christmas savait qu'entre les mains d'un homme judicieux, un lâche peut, dans les limites de ses facultés, rendre parfois des services appréciables à tous, sauf à lui-même. »
Faulkner était-il misogyne, raciste ? Pas plus que misanthrope, et cette question me paraît susciter un mauvais débat (je n’ai pas vu de conviction énoncée en tant que telle chez lui). Les personnalités dépeintes sont assez particulières et fantasmagoriques, tout en étant frappantes, pour ne pas porter un message univoque et être incontestablement typifiées. Miss Burden et Christmas forment de grandes figures de caractère, où la psychologie et les convictions n’expliquent pas leur démesure. Leurs fanatisme, orgueil, perversité, violence, folie, fatalité, malédiction, sont shakespeariens, dostoïevskiens aussi. Leurs tares sont héréditaires, même semble-t-il le péché et la bigoterie puritaine.
Miss Burden se prétend enceinte, puis veut persuader Christmas de se consacrer aux noirs, de la remplacer auprès d’eux. Il l’égorge avec son rasoir, son seul bagage comme il s’enfuit. Entretemps, Byron a installé Lena dans sa case. Brown se démène afin de toucher la prime pour l’arrestation de son ancien compagnon.
Les vieux Hines vivent à Mottstown ; lui est un fanatique batailleur et un peu fou qui prêche aux noirs la supériorité blanche, et veut lyncher le « nègre blanc » qu’on vient d’arrêter.
« Du reste, ce qu'elle [la ville de Mottstown] pardonnait n'était peut-être pas le dévouement de l'homme au salut des noirs, mais l'ignorance publique du fait qu'il recevait la charité de la main des nègres, car une des plus heureuses facultés de l'esprit est de pouvoir rejeter ce que la conscience refuse d'assimiler.
Ainsi, pendant vingt-cinq ans, le vieux couple avait semblé n'avoir aucun moyen de subsistance. La ville fermait son œil collectif sur les négresses, leurs plats et leurs casseroles couvertes, d'autant plus que, vraisemblablement, beaucoup de ces plats et de ces casseroles arrivaient intacts des cuisines blanches où ces femmes étaient cuisinières. Peut-être était-ce là une partie de ce que l'esprit rejetait. Bref, la ville ne regardait pas, et il y avait vingt-cinq ans que tous les deux vivaient dans l'eau dormante de leur isolement solitaire, comme s'ils avaient été deux bisons musqués du Pôle Nord ou deux animaux égarés, restes attardés, antérieurs à la période glaciaire. »
Hightower revit l’office du dimanche soir :
« Les ondes de l'orgue s'élèvent, riches, sonores dans la nuit d'été. Dans l'entrelacs de leurs sonorités, il y a quelque chose d'abject et de sublime, comme si les voix elles-mêmes, libérées, prenaient la forme, l'attitude de crucifixions extatiques, solennelles et profondes, à mesure que s'enflent les crescendos. Et pourtant, même alors, la musique, comme toute musique protestante, garde toujours quelque chose de sévère, d'implacable, de déterminé. Les ondes sonores, avec moins de passion que d'immolation, demandent, implorent le refus de l'amour, le refus de la vie, les défendent aux autres, réclament la mort, comme si la mort était le plus grand des bienfaits. On eût dit que, ayant été façonnés par cela même que la musique louait et symbolisait, ceux qui l'acceptaient et en chantaient la louange, se servaient de cette louange elle-même pour se venger sur ce qui les avait fait ce qu'ils étaient. En écoutant, il lui semble percevoir l'apothéose de sa propre histoire, de son propre pays, de son propre sang : ces gens dont il est issu et parmi lesquels il vit et qui ne peuvent jamais goûter un plaisir ou souffrir une catastrophe, ni les éviter non plus, sans se mettre à en discuter. Plaisir, extase, ils semblent incapables de supporter cela. Pour s'en évader, ils ne connaissent que la violence, l'ivresse, les batailles, la prière. De même pour les catastrophes : une violence identique, et apparemment inévitable. Et, dans ces conditions, pourquoi leur religion ne les pousserait-elle pas à se crucifier eux-mêmes, à se crucifier mutuellement ? pense-t-il. »
Byron lui amène les Hines, qui sont les grands-parents de Christmas : lui a tué le prétendu Mexicain qui a engrossé sa fille, qu’il a laissé mourir en couches, puis, instrument choisi par Dieu, a surveillé pendant des années l’enfant de « l'abomination divine de la chair de femme ». Hightower refuse de prétendre que Christmas était chez lui lors du meurtre. C’est lui qui assiste Lena lorsqu’elle accouche.
Brown-Burch, un de ces exécrables personnages dont Faulkner a le secret (stupide, cupide, menteur, lâche, prétentieux) s’enfuit lorsqu’il est confronté à Lena et son fils.
Déchiré entre son sang noir et son sang blanc, Christmas tente de s’enfuir.
« Mais son sang ne voulait pas se taire, ne voulait pas être sauvé. Il ne voulait ni l'un ni l'autre, ni laisser le corps se sauver lui-même. »
Réfugié chez Hightower, il est abattu par Percy Grimm, un jeune patriote suprémaciste qui l’émascule. Percy avait organisé une milice pour faire respecter la loi, mais un « Joueur » l’a manipulé (le diable, ou Dieu ?)
Comme à chaque coucher de soleil, Hightower revoit sa vie marquée par le racisme, la guerre, la foi, d’échec, son grand-père abattu alors qu’il volait des poules après un combat, sa fascination pour Jefferson, son sentiment de culpabilité.
« Déjà, voici qu'il peut sentir que les instants vont entrer en contact : celui qui résume toute sa vie, qui se renouvelle chaque jour entre le crépuscule et la nuit noire, et la minute en suspens d'où va maintenant sortir le bientôt. »
Un homme raconte à sa femme comment il prit en auto-stop Lena et Byron partis à la recherche de Brown – mais peut-être Lena est-elle proche d’accepter la proposition de mariage de Byron.
On trouve sur Wikipédia un article détaillé sur ce roman riche en action, rebondissements et surprises ; le résumé n’est pas exempt d’erreurs, mais le livre aussi : de menues variations dans les détails rapportés semblent rendre le flou des témoignages, ce qui doit avoir été voulu par Faulkner quand on mesure sa cohérence structurale.
Langages parlés, narrativité, allusions symboliques (au moins deux Joseph (Joe), mais un seul Christ ?), dimensions existentielle et destinale : un chef-d’œuvre de plus, que seul Faulkner pouvait nouer ainsi.
\Mots-clés : #culpabilité #discrimination #esclavage #racisme #religion #ruralité #segregation #violence
- le Lun 8 Avr - 12:14
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William Faulkner
- Réponses: 103
- Vues: 12115
Ernest Gaines
Colère en Louisiane
Beau Boutan, un Cajun (les Cajuns ou Cadiens sont à l’origine les descendants des Acadiens déportés du Canada, des créoles francophones, certains étant devenus des planteurs esclavagistes), vient d’être abattu par Mathu, un vieux Noir, parce qu’il poursuivait chez lui Charlie (dont il est le Parrain) avec un fusil.
Candy Marshall, la propriétaire de la plantation, qui a été élevée par Miss Merle (une Blanche) et Mathu à la mort de ses parents, fait venir tous les vieux nègres et sang-mêlés des environs pour se déclarer coupables avec elle (A Gathering of Old Men, le titre originel). Le shérif Mapes a compris la situation, mais ne sait que faire : ce qu’il craint, comme tous les autres d’ailleurs, c’est que Fix, le père de Beau, ne rallie ses proches pour venir lyncher Mathu. Fix, déjà âgé, dépassé par le progrès social qui donne une place aux personnes de couleur dans une Louisiane conservatrice, rejette toute forme de justice officielle au nom de l’intérêt de sa famille, mais renonce finalement à aller dans les quartiers de la plantation.
« Protéger le nom et la terre. »
Mais les extrémistes du Klan se regroupent pour rendre leur justice par la violence…
Dans ce roman, Gaines fait parler quelques-uns des témoins et participants pour narrer le déroulement des faits. La prise directe sur l’action au présent, en plus du suspense intense, constitue une inspiration évidente pour le cinéma. Au-delà d’un certain hiératisme dramatique (et très beau), ce récit relativement bref expose une palette fort riche de personnages et de situations divers : c’est magistralement composé, du chœur polyphonique aux "héros" tragiques.
Le nœud est bien sûr le racisme, décliné tous azimuts, dans toutes les nuances du blanc au noir (mulâtre, créole, etc.), et la ségrégation conséquente, et la spoliation des descendants d’esclaves, mais aussi la solidarité de vieillards qui courageusement, dignement, relèvent la tête pour la première fois.
\Mots-clés : #discrimination #esclavage #justice #racisme #romanchoral #segregation #vengeance #violence #xxesiecle
- le Jeu 26 Oct - 17:10
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Ernest Gaines
- Réponses: 18
- Vues: 1646
René Maran
Batouala
Début XXe, dans l’Oubangui-Chari (Centrafrique) : Maran nous fait assister au réveil de Batouala, grand mokoundji (chef) d’une tribu m’bi du groupe banda, près du poste de Grimari, entre les rivières Bamba et Pombo. Grand chasseur et guerrier, il est curieusement présenté d’entrée comme un fainéant, et les animaux de sa maisonnée le sont avec plus d’affection ; ses neuf femmes sont à peine évoquées, peut-être parce qu’elles dorment dans leur case personnelle, sauf sa favorite, Yassigui’nda.
Après celle de la basse-cour et du chien Djouma, belle observation d’une tempête de pluie :
« Tintements de sonnailles, chocs de pilons, cliquetis de sagaies, vomissements incoercibles, – discrets ou clairs, criards ou rauques, les coassements de toutes les sortes de crapauds et de toutes les espèces de grenouilles font « yangba » [la fête]. »
Batouala a organisé une yangba avec ses voisins. Tous se plaignent de l’impôt, des travaux d’exploitation du caoutchouc et du portage, imposés par les boundjous (les blancs), qu’ils ne comprennent pas et détestent.
« Et d’abord, non contents de s’appliquer à supprimer nos plus chères coutumes, ils n’ont eu de cesse qu’ils ne nous aient imposé les leurs. Ils n’y ont, à la longue, que trop bien réussi. Résultat : la plus morne tristesse règne, désormais, par tout le pays noir. Les blancs sont ainsi faits, que la joie de vivre disparaît des lieux où ils prennent quartiers.
Depuis que nous les subissons, plus le droit de jouer quelque argent que ce soit au « patara ». Plus le droit non plus de nous enivrer. Nos danses et nos chants troublent leur sommeil. Les danses et les chants sont pourtant toute notre vie. »
Puis sont décrites les danses, la cérémonie des ga’nzas (circoncisions et excisions des jeunes initiés), enfin la danse de l’amour, qui se termine par une orgie collective.
« Ivresse sexuelle, doublée d’ivresse alcoolique. Immense joie de brutes, exonérée de tout contrôle. Des injures retentirent. Du sang jaillit. Vainement. Le seul désir était maître. »
Le père de Batouala s’est éteint pendant la fête, et ses funérailles sont rapportées avec un souci quasi-ethnographique (exposition du corps pendant huit jours, avant qu’il ne soit « planté » dans une double fosse et que ses biens personnels ne soient détruits, sa case décapitée, son phallus totémique brisé). Est soulignée l’importance de la coutume, qui reflète la sagesse des anciens. De même, la mythologie est abordée, avec notamment Ipeu, la lune, qui chaque jour fait fuir Lolo, le soleil.
C’est la saison sèche, celle de la chasse aux filets, et des feux de brousse :
« Le grondement que produit le tam-tam sur la double enflure des li’nghas, l’appel des olifants ou des trompes, certains cris qui imitent à s’y méprendre ceux de certains oiseaux, les signaux de feu qu’on fait de hauteurs à hauteurs, l’herbe allongée au beau milieu du chemin, deux termitières placées l’une sur l’autre suivant une coutume invariable, des touffes de feuilles tressées d’une certaine manière, le morceau de bois que traverse un autre de part en part, – sonore, lumineux ou immobile, – voilà un langage vivant, d’une richesse innombrable ! »
Le jeune et beau Bissibi’ngui convoite Yassigui’nda (et réciproquement) ; Batouala a des soupçons, et se trament des projets d’assassinat du rival par empoisonnement ou par les armes (couteaux de jet, sagaie)…
D’une manière générale, ce roman vaut plus pour la description de la société indigène et de la brousse que par ses moments lyriques.
« Toucan », « caïman » (pour calao et crocodile), quelques inexactitudes, zoologiques notamment, trahissent les origines de Maran. À ce propos, je suis déconcerté par ce destin d’un homme vraisemblablement issu d’Afrique via l’esclavage (séculaire dans cette zone d’Afrique), qui retourne en quelque sorte à ses origines, dans les rangs des colonisateurs.
Est paru peu après le Voyage au Congo, carnet de route d’André Gide en cette même Afrique-Équatoriale française https://deschosesalire.forumactif.com/t1498-andre-gide#69983 ; de même que Batouala, ce livre ne remet pas en cause le colonialisme, mais ses excès.
Dans l’édition que j’ai lue, le roman est suivi par un conte animalier, Youmba, la mangouste.
« Il est des moments, dans la vie, où il faut suivre son nez où il a envie de vous conduire. Le monde ne révèle en général ses secrets qu’aux chercheurs. Toute connaissance se fonde peu ou prou sur la curiosité. Celle-ci constitue par ailleurs, en bien des cas, un des plus sûrs moyens de défense préventive dont on puisse disposer. Chercher à voir, c’est chercher à savoir, et, dans une certaine mesure, à prévoir. »
\Mots-clés : #colonisation #discrimination #traditions #xxesiecle
- le Jeu 5 Oct - 22:43
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: René Maran
- Réponses: 4
- Vues: 179
Louise Erdrich
Love Medicine
Comme dans tout roman choral, il est difficile au lecteur de mémoriser les nombreux personnages (et ce malgré la présence d’une sorte d’arbre généalogique assez peu clair) – et encore plus difficile d’en rendre compte. De plus, il y a deux Nector, deux King, deux Henry… Mais ce mixte chaotique et profus d’enfants et de liaisons de parenté (avec ou sans mariage, catholique ou pas) est certainement volontaire chez Louise Erdrich.
À travers les interactions des membres de deux (ou trois) familles ayant des racines remontant jusqu’à six générations, c’est l’existence des Indiens de nos jours dans une réserve du Dakota du Nord qui est exposée, avec les drames de l’alcoolisme, du chômage, de la misère, de la prison, de la guerre du Vietnam, du désarroi entre Dieu, le Très-bas et les Manitous (Marie Lazarre Kashpaw) et la pure superstition (Lipsha Morrissey). C’est également une grande diversité d’attitudes individuelles, épisodes marquants de la vie des personnages présentés par eux-mêmes (tout en restant profondément rattachés à leurs histoires familiales et tribales). "Galerie de portraits hauts en couleur", ce poncif caractérise pourtant excellemment cette "fresque pittoresque"…
Ainsi, Moses Pillager, qui était nourrisson lors d’une épidémie :
« Ne voulant pas perdre son fils, elle décida de tromper les esprits en prétendant que Moses était déjà mort, un fantôme. Elle chanta son chant funèbre, bâtit sa tombe, déposa sur le sol la nourriture destinée aux esprits, lui enfila ses habits à l’envers. Sa famille parlait par-dessus sa tête. Personne ne prononçait jamais son vrai nom. Personne ne le voyait. Il était invisible, et il survécut. »
Moses devint windigo, se retira seul sur une île avec des chats, portant toujours ses habits à l’envers et marchant à reculons…
La joyeuse et vorace Lulu Nanapush Lamartine, qu’on pourrait désigner comme une femme facile, qui fait entrer « la beauté du monde » en elle avec constance et élève une ribambelle d’enfants, forme comme un pendant de Marie, opposition en miroir, et ces deux fortes personnalités font une image des femmes globalement plus puissante que celle des hommes.
« Elle déplia une courtepointe coupée et cousue dans des vêtements de laine trop déchirés pour être raccommodés. Chaque carré était maintenu en place avec un bout de fil noué. La courtepointe était marron, jaune moutarde, de tous les tons de vert. En la regardant, Marie reconnut le premier manteau qu’elle avait acheté à Gordie, une tache pâle, gris dur, et la couverture qu’il avait rapportée de l’armée. Il y avait l’écossais de la veste de son mari. Une grosse chemise. Une couverture de bébé à demi réduite en dentelle par les mites. Deux vieilles jambes de pantalon bleues. »
La situation tragique d’un peuple vaincu et en voie de déculturation reste bien sûr le thème nodal de ces destins croisés.
« Pour commencer, ils vous donnaient des terres qui ne valaient rien et puis ils vous les retiraient de sous les pieds. Ils vous prenaient vos gosses et leur fourraient la langue anglaise dans la bouche. Ils envoyaient votre frère en enfer, et vous le réexpédiaient totalement frit. Ils vous vendaient de la gnôle en échange de fourrures, et puis vous disaient de ne pas picoler. »
Dès ce premier roman, Louise Erdrich maîtrise l’art de la narration, tant en composition que dans le style, riche d’aperçus métaphoriques comme descriptifs. La traduction m’a paru bancale par endroits.
\Mots-clés : #amérindiens #discrimination #famille #identite #minoriteethnique #relationenfantparent #romanchoral #ruralité #social #temoignage #traditions #xxesiecle
- le Mer 20 Sep - 12:12
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Louise Erdrich
- Réponses: 37
- Vues: 2878
Kent Nerburn
Ni loup ni chien
Grâce à ses précédents ouvrages sur les Indiens, Kent Nerburn est pressenti par Dan, un vieux Lakota, pour devenir son porte-parole.
« …] Indiens. Je n’avais jamais autant apprécié un peuple ni trouvé ailleurs un tel sens de l’humour et une telle modestie. En outre, j’avais ressenti chez eux une paix et une simplicité qui dépassaient les stéréotypes de sagesse et d’alcoolisme. Ils étaient tout simplement les personnes les plus terre à terre que j’avais rencontrées, dans le bon et le mauvais sens de la chose. Ils étaient différents des Blancs, des Noirs, différents de l’image qu’on m’en avait inculquée, différents de tout ce que j’avais croisé. Je me sentais heureux en leur compagnie, et honoré d’être à leur côté. »
Il le rejoint dans sa réserve des Grandes Plaines. Ils feront une « virée » en Buick avec Grover, l’ami de Dan, tandis qu’il enregistre les « petits discours » de ce dernier.
« Voilà ce qu’il y avait derrière cette idée d’Amérique comme nouveau pays de l’autre côté de l’océan : devenir propriétaire. […] Nous ne savions pas cela. Nous ne savions même pas ce que cela signifiait. Nous appartenions à la terre. Eux voulaient la posséder. »
« Un point important selon moi : votre religion ne venait pas de la terre, elle pouvait être transportée avec vous. Vous ne pouviez pas comprendre ce que ça signifiait pour nous que d’avoir notre religion ancrée dans la terre. Votre religion existait dans une coupelle et un morceau de pain, et elle pouvait être trimballée dans une boîte. Vos prêtres pouvaient sacraliser n’importe où. Vous ne pouviez pas comprendre que, pour nous, ce qui était sacré se trouvait là où nous vivions, parce que c’est là que les choses saintes s’étaient produites et que les esprits nous parlaient. »
« Pendant de nombreuses années, l’Amérique voulait simplement nous détruire. Aujourd’hui, tout d’un coup, on est le seul groupe que les gens essaient d’intégrer. Et pourquoi d’après toi ? […]
– Je pense, reprit-il, que c’est parce que les Blancs savent qu’on avait quelque chose de véritable, qu’on vivait de la manière dont le Créateur voulait que les humains vivent sur cette terre. Ils désirent ça. Ils savent que les Blancs font n’importe quoi. S’ils disent qu’ils sont en partie indiens, c’est pour faire partie de ce que nous avons. »
« Nos aînés nous ont appris que c’était la meilleure façon de faire avec les Blancs : sois silencieux jusqu’à ce qu’ils deviennent nerveux, et ils commenceront à parler. Ils continueront de parler, et si tu restes silencieux, ils en diront trop. Alors tu seras capable de voir dans leur cœur et de savoir ce qu’ils veulent vraiment. Et tu sauras quoi faire. »
« Si tu commences à parler, je ne t’interromps pas. Je t’écoute. Peut-être que j’arrête d’écouter si je n’aime pas ce que tu dis. Mais je ne t’interromps pas. Quand t’as fini, je prends ma décision sur ce que tu as dit, mais je ne t’expose pas mon désaccord, à moins que ça soit important. Autrement, je me tais et je m’en vais simplement. Tu m’as dit ce que j’avais besoin de savoir. Il n’y a rien de plus à ajouter. »
Des épaves de voiture jonchent la réserve :
« J’avais toujours été interloqué par l’acceptation des gens à vivre dans la saleté, quand un simple petit effort aurait suffi à rendre les choses propres. À la longue, j’en étais venu à accepter le vieux bobard sociologique qui racontait que cela reflétait un manque d’estime de soi et un certain accablement.
Mais, au fond de moi, je savais que c’était trop facile, une supposition trop médiocre. C’était cependant certainement préférable aux explications précédentes, selon lesquelles les gens qui vivaient comme cela étaient simplement paresseux ou apathiques. »
« Pour nous, chaque chose avait son utilité, puis retournait à la terre. On avait des bols et des coupelles en bois, ou des objets fabriqués en argile. On montait à cheval ou on marchait. On fabriquait des choses à partir de choses de la terre. Puis quand on n’en avait plus besoin, on les laissait y retourner.
Aujourd’hui, les choses ne retournent pas à la terre. Nos enfants jettent des canettes. On abandonne des vieilles voitures. Avant, ça aurait été des cuillères en os ou des tasses en corne, et les vieilles voitures auraient été des squelettes de chevaux ou de bisons. On aurait pu les brûler ou les laisser là, et elles seraient retournées à la terre. Maintenant, on ne peut plus.
On vit de la même manière, mais avec des choses différentes. On apprend vos manières, mais, tu vois, vous n’apprenez rien. Tout ce dont vous vous souciez vraiment, c’est de garder les choses propres. Vous ne vous souciez pas de ce qu’elles sont réellement, tant qu’elles sont propres. Quand vous voyez une canette au bord d’un chemin, vous trouvez ça pire qu’une énorme autoroute goudronnée qui est maintenue propre. Vous vous énervez davantage devant un sac-poubelle dans une forêt que devant un gros centre commercial tout impeccable et balayé. »
Une autre vision sociale :
« On n’évaluait pas les gens par la richesse ou la pauvreté. On ne savait pas faire cela. Quand les temps étaient bons, tout le monde était riche. Quand les temps étaient durs, tout le monde était pauvre. On évaluait les gens sur leur capacité à partager. »
Les wannabes, qui croient avoir une grand-mère cherokee, portent queue de cheval et bijoux indiens en turquoise et argent, sont particulièrement insupportables ; au cinéma :
« Peuvent plus mettre de sauvages, maintenant. Aujourd’hui, c’est l’Indien sage – tu sais, celui qui ne fait qu’un avec la terre et tout, et qui rend le Blanc meilleur en lui apprenant à vivre à l’indienne, pour qu’il ajoute des valeurs indiennes à sa blanchitude. »
« Nous savons que les Blancs ont une faim infinie. Ils veulent tout consommer et tout englober. Quand ils ne possèdent pas physiquement, ils veulent posséder spirituellement. C’est ce qui est en train de se passer avec les Indiens, aujourd’hui. Les Blancs veulent nous posséder spirituellement. Vous voulez nous avaler pour pouvoir dire que vous êtes nous. C’est quelque chose de nouveau. Avant, vous vouliez qu’on soit comme vous. Mais aujourd’hui, vous êtes malheureux avec vous-mêmes, donc vous voulez vous transformer en nous. Vous voulez nos cérémonies et nos façons de faire pour pouvoir dire que vous êtes spirituels. Vous essayez de devenir des Indiens blancs. »
La leçon tirée des traités non honorés :
« Écoute-moi. Nous, les Indiens, parlons peu au peuple blanc. Il en a toujours été ainsi. Il y a une raison. Les Blancs ne nous ont jamais écoutés quand nous avons pris la parole. Ils ont seulement entendu ce qu’ils voulaient entendre. Parfois ils prétendaient avoir entendu et faisaient des promesses. Puis ils les brisaient. Il n’y avait plus pour nous de raison de parler. Donc nous avons arrêté. Même aujourd’hui, nous disons à nos enfants : “Fais gaffe quand tu parles aux wasichus [hommes blancs en lakota]. Ils utiliseront tes mots contre toi.” »
Le regard de Dan est particulièrement aigu en ce qui concerne la société occidentale.
« Le monde blanc met tout le pouvoir au sommet, Nerburn. Lorsqu’une personne arrive au sommet, elle a le pouvoir de prendre ta liberté. Au début, quand les Blancs sont arrivés ici, c’était pour fuir ces personnes au sommet. Mais ils ont continué de raisonner de cette façon et très vite, il y a eu de nouvelles personnes au sommet dans ce nouveau pays. Parce que c’est comme ça qu’on vous a appris à penser.
Dans vos églises, il y a quelqu’un au sommet. Dans vos écoles aussi. Dans votre gouvernement. Dans vos métiers. Il y a toujours quelqu’un au sommet, et cette personne a le droit de dire si tu es bon ou mauvais.
Elle te possède.
Pas étonnant que les Américains se soucient autant de la liberté. Vous en avez quasiment aucune. Si vous la protégez pas, quelqu’un vous la prendra. Vous devez la surveiller à chaque seconde, comme un chien garde un os. »
« Quand vous êtes arrivés parmi nous, vous ne pouviez pas comprendre notre façon d’être. Vous vouliez trouver la personne au sommet. Vous vouliez trouver les barrières qui nous entouraient – jusqu’où notre terre allait, jusqu’où notre gouvernement allait. Votre monde était fait de cages et vous pensiez que le nôtre aussi. Quand bien même vous détestiez vos cages, vous croyiez en elles. Elles définissaient votre monde et vous aviez besoin d’elles pour définir le nôtre.
Nos anciens ont remarqué ça dès le début. Ils disaient que l’homme blanc vivait dans un monde de cages et que si nous ne nous méfiions pas, ils nous feraient aussi vivre dans un monde de cages.
Donc nous avons commencé à y prêter attention. Tout chez vous ressemblait à des cages. Vos habits se portaient comme des cages. Vos maisons ressemblaient à des cages. Vous mettiez des clôtures autour de vos jardins pour qu’ils ressemblent à des cages. Tout était une cage. Vous avez transformé la terre en cages. En petits carrés.
Puis, une fois que vous avez eu toutes ces cages, vous avez fait un gouvernement pour les protéger. Et ce gouvernement n’était que cages. Uniquement des lois sur ce qu’on ne pouvait pas faire. La seule liberté que vous aviez se trouvait dans votre cage. Puis vous vous êtes demandé pourquoi vous n’étiez pas heureux et pourquoi vous ne vous sentiez pas libres. Vous aviez créé toutes ces cages, puis vous vous êtes demandé pourquoi vous ne vous sentiez pas libres.
Nous les Indiens n’avons jamais pensé de cette façon. Tout le monde était libre. Nous ne faisions pas de cages, de lois, ni de pays. Nous croyions en l’honneur. Pour nous, l’homme blanc ressemblait à un homme aveugle en train de marcher, qui ne comprenait qu’il était sur le mauvais chemin que quand il butait contre les barreaux d’une des cages. Notre guide à nous était à l’intérieur, pas à l’extérieur. C’était l’honneur. Il était plus important pour nous de savoir ce qui était bien que de savoir ce qui était mauvais.
Nous regardions les animaux et voyions ce qui était bien. Nous voyions comment le cerf trompait les animaux les plus puissants et comment l’ours rendait ses enfants forts en les élevant sans pitié. Nous voyions comment le bison se tenait et observait jusqu’à ce qu’il comprenne. Nous voyions comment chaque animal était sage et nous essayions d’apprendre cette sagesse. Nous les regardions pour comprendre comment ils cohabitaient et comment ils élevaient leurs petits. Puis nous faisions comme eux. Nous ne cherchions pas ce qui était mauvais. Non, nous tendions toujours vers ce qui était bien. »
Dan livre ses convictions sur les meneurs « à l’indienne », comment Jésus fut imposé aux Indiens, puis comme l’espoir du messie leur fut refusé ; il développe les différences d’appréciation de l’histoire entre eux et les Blancs…
« Avant, je pensais que vous agissiez comme ça parce que vous étiez avides. Plus maintenant. Maintenant, je pense que ça fait juste partie de qui vous êtes et de ce que vous faites, tout comme écouter la terre fait partie de qui nous sommes et de ce que nous faisons. »
Les femmes, au travers de Dannie, petite-fille de Dan :
« C’est ce que je veux dire quand je dis que c’est notre tour à nous, les femmes indiennes. On a toujours été au centre. La famille indienne était comme un cercle, et la femme était au centre. […] On n’a pas besoin de se libérer. On a besoin de libérer nos hommes. »
Les métis :
« Tout ce qui comptait pour nous, c’était la façon dont ils étaient élevés et les personnes qu’ils devenaient. Vous, vous examiniez la couleur de leur peau et la couleur de leurs cheveux, et essayiez de calculer le pourcentage de blancheur qu’ils avaient à l’intérieur d’eux. Vous les appeliez des métis. Vous ne les laissiez être ni blancs ni indiens. »
Puis ils arrivent à Wounded Knee, là où, comme dans nombre d’autres lieux, enfants et vieillards furent massacrés – tout un peuple.
Outre des faits connus des familiers de lectures sur les Amérindiens, ce livre-témoignage développe une pensée originale (il s’agit de réflexions de Dan, plus que de révélations), qui permet aussi d’approfondir l’appréhension de la conception du monde chez les « Américains natifs ». Et c’est encore (et surtout ?) un récit profondément sensible, plein de colère et de douleur, également d’humour malicieux – humain.
J'ai beaucoup cité, mais il y a bien d'autres choses à retenir de ce livre qui sort de l'ordinaire sur le sujet.
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #culpabilité #discrimination #documentaire #identite #initiatique #racisme #segregation #spiritualité #temoignage #traditions
- le Lun 28 Aoû - 14:39
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Kent Nerburn
- Réponses: 2
- Vues: 253
QIU Xiaolong
Il était une fois l'inspecteur Chen
Dans son préambule, Qiu Xiaolong rappelle qu’au début de la Révolution culturelle, dans les années cinquante, la « critique révolutionnaire de masse des ennemis de classe » du peuple caractérisait la dictature du prolétariat, et raconte comme son propre père, considéré comme un capitaliste, fut alors victime des Gardes rouges (récit de dégradation impitoyable qui à lui seul vaut la lecture).
Le roman lui-même commence comme Chen Cao, étudiant juste après la fin de la Révolution culturelle (et encore dans l’ombre de sa famille « noire »), prépare un mémoire sur Eliot (comme Xiaolong) dans la bibliothèque de Pékin, où travaille la ravissante Ling. Puis il devient policier, un peu par hasard, et s’engage dans sa première enquête, qui le replonge dans son passé (et la cité de la Poussière Rouge à Shanghai). Cette enquête, qui réunit les principales caractéristiques des romans de Xiaolong (la société chinoise contemporaine, la cuisine et la poésie chinoises), est plus un support (presque un prétexte) à évoquer les séquelles de la Révolution culturelle et ses iniques aberrations discriminatoires. C’est certes un polar, mais aussi et peut-être surtout un témoignage, à la fois historique et personnel.
« Monsieur » Fu a été assassiné ; Chen se renseigne, notamment lors des « conversations du soir » au quartier. L’homme fut accusé de capitalisme pour avoir ouvert un petit commerce de fruits de mer avant la campagne d’éradication des « Quatre Vieilleries » (« Vieilles idées, vieille culture, vieilles coutumes et vieilles habitudes »), et sa femme mourut à cause des bijoux où le couple avait placé ses gains :
« « Ensuite, elle a dû rester debout dans la rue, un tableau noir autour du cou avec son nom barré au-dessus de la phrase : Pour ma résistance contre la Révolution culturelle, je mérite de mourir des milliers de morts. Plus tard dans la nuit, pendant son supplice, elle est tombée et s’est cogné la tête contre l’évier commun. Elle ne s’est jamais réveillée. »
Fu, qui était délaissé de tous y compris ses enfants, reçut de l’État une compensation financière pour ces spoliations (après la réforme du camarade Deng Xiaoping), qui le rendit riche. Il prit une bonne, Meihua, qui lui concoctait de bons petits plats.
Cette affaire résolue, plusieurs autres sont rapidement narrées, autant d’étapes dans la carrière de l’intègre inspecteur. Autant de nouvelles aussi, qui illustrent la corruption dans une société qui combat officiellement la décadence et l’indécence dans une politique hostile à l’étranger, aux intellectuels. Également des souvenirs de jeunesse de Xiaolong (sans surprise, grand appétit pour la gastronomie et les livres, notamment occidentaux et à l’index), avec son amitié pour Lu le Chinois d’outre-mer, devenu un de ses personnages récurrents.
Cet ouvrage constitue un prequel des enquêtes de l’inspecteur Chen publiées auparavant, narrant sa jeunesse en la rapprochant de l’histoire de son auteur et de son pays d'origine. Il peut difficilement être lu uniquement comme un polar, et je comprends qu’Armor ait été déçue à sa lecture.
\Mots-clés : #autobiographie #discrimination #ecriture #historique #polar #politique #regimeautoritaire #revolutionculturelle #temoignage
- le Sam 12 Aoû - 13:03
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: QIU Xiaolong
- Réponses: 25
- Vues: 2800
William Faulkner
Descends, Moïse
Sept récits paraissant indépendants de prime abord, qui mettent en scène des personnages du Sud des USA, blancs, nègres (et Indiens ; je respecte, comme j’ai coutume de le faire, l’orthographe de mon édition, exactitude encore permise je pense). Plus précisément, c’est la lignée des Mac Caslin, qui mêle blancs et noirs sur la terre qu’elle a conquise (les premiers émancipant les seconds). Oppositions raciale, mais aussi genrée sur un siècle, plus de quatre générations dans le Mississipi.
Le titre fait référence à des injonctions du Seigneur à Moïse sur le Sinaï, notamment dans l’Exode. Ce roman est dédicacé à la mammy de Faulkner enfant, née esclave.
Autre temps : apparition de Isaac Mac Caslin, « oncle Ike », et la poursuite burlesque d’un nègre enfui.
Le Feu et le Foyer : affrontement de Lucas Beauchamp et Edmonds, fils de Mac Caslin, qui a pris la femme du premier :
« – Ramasse ton rasoir, dit Edmonds.
– Quel rasoir ? » fit Lucas. Il leva la main, regarda le rasoir comme s’il ne savait pas qu’il l’avait, comme s’il ne l’avait encore jamais vu, et, d’un seul geste, il le jeta vers la fenêtre ouverte, la lame nue tournoyant avant de disparaître, presque couleur de sang dans le premier rayon cuivré du soleil. « J’ai point besoin de rasoir. Mes mains toutes seules suffiront. Maintenant, prenez le revolver sous votre oreiller. » »
« Alors Lucas fut près du lit. Il ne se rappela pas s’être déplacé. II était à genoux, leurs mains enlacées, se regardant face à face par-dessus le lit et le revolver : l’homme qu’il connaissait depuis sa petite enfance, avec lequel il avait vécu jusqu’à ce qu’ils fussent devenus grands, presque comme vivent deux frères. Ils avaient péché et chassé ensemble, appris à nager dans la même eau, mangé à la même table dans la cuisine du petit blanc et dans la case de la mère du petit nègre ; ils avaient dormi sous la même couverture devant le feu dans les bois. »
Péripéties autour d’alambics de whisky de contrebande, et de la recherche d’un trésor. Lucas, bien que noir, a plus de sang de la famille que Roth Edmonds, le blanc, que sa mère a élevé avec lui dès sa naissance. Le même schéma se reproduit de père en fils, si bien qu’on s’y perd, et qu’un arbre généalogique de la famille avec tous les protagonistes serait utile au lecteur (quoique ce flou entre générations soit vraisemblablement prémédité par Faulkner, de même que le doute sur la "couleur" de certains personnages, sans parler des phrases contorsionnées).
« Lucas n’était pas seulement le plus ancien des habitants du domaine, plus âgé même que ne l’aurait été le père d’Edmonds, il y avait ce quart de parenté, non seulement de sang blanc ni même du sang d’Edmonds, mais du vieux Carothers Mac Caslin lui-même de qui Lucas descendait non seulement en ligne masculine, mais aussi à la seconde génération, tandis qu’Edmonds descendait en ligne féminine et remontait à cinq générations ; même tout gamin, il remarquait que Lucas appelait toujours son père M. Edmonds, jamais Mister Zack comme le faisaient les autres nègres, et qu’il évitait avec une froide et délibérée préméditation de donner à un blanc quelque titre que ce fût en s’adressant à lui. »
« Ce n’était pas toutefois que Lucas tirât parti de son sang blanc ou même de son sang Mac Caslin, tout au contraire. On l’eût dit non seulement imperméable à ce sang, mais indifférent. Il n’avait pas même besoin de lutter contre lui. Il ne lui fallait pas même se donner le mal de le braver. Il lui résistait par le simple fait d’être le mélange des deux races qui l’avaient engendré, par le seul fait qu’il possédait ce sang. Au lieu d’être à la fois le champ de bataille et la victime de deux lignées, il était l’éprouvette permanente, anonyme, aseptique, dans laquelle toxines et antitoxines s’annulaient mutuellement, à froid et sans bruit, à l’air libre. Ils avaient été trois autrefois : James, puis une sœur nommée Fonsiba, puis Lucas, enfants de Tomey’ Turl, fils du vieux Carothers Mac Caslin et de Tennie Beauchamp, que le grand-oncle d’Edmonds, Amédée Mac Caslin, avait gagnée au poker à un voisin en 1859. »
« Il ressemble plus au vieux Carothers que nous tous réunis, y compris le vieux Carothers. Il est à la fois l’héritier et le prototype de toute la géographie, le climat, la biologie, qui ont engendré le vieux Carothers, nous tous et notre race, infinie, innombrable, sans visage, sans nom même, sauf lui qui s’est engendré lui-même, entier, parfait, dédaigneux, comme le vieux Carothers a dû l’être, de toute race, noire, blanche, jaune ou rouge, y compris la sienne propre. »
Bouffonnerie noire : Rider, un colosse noir, enterre sa femme et tue un blanc.
Gens de jadis : Sam Fathers, fils d’un chef indien et d’une esclave quarteronne, vendu avec sa mère par son père à Carothers Mac Caslin ; septuagénaire, il enseigne d’année en année la chasse à un jeune garçon, Isaac (Ike).
« L’enfant ne le questionnait jamais ; Sam ne répondait pas aux questions. Il se contentait d’attendre et d’écouter, et Sam se mettait à parler. Il parlait des anciens jours et de la famille qu’il n’avait jamais eu le temps de connaître et dont, par conséquent, il ne pouvait se souvenir (il ne se rappelait pas avoir jamais aperçu le visage de son père), et à la place de qui l’autre race à laquelle s’était heurtée la sienne pourvoyait à ses besoins sans se faire remplacer.
Et, lorsqu’il lui parlait de cet ancien temps et de ces gens, morts et disparus, d’une race différente des deux seules que connaissait l’enfant, peu à peu, pour celui-ci, cet autrefois cessait d’être l’autrefois et faisait partie de son présent à lui, non seulement comme si c’était arrivé hier, mais comme si cela n’avait jamais cessé d’arriver, les hommes qui l’avaient traversé continuaient, en vérité, de marcher, de respirer dans l’air, de projeter une ombre réelle sur la terre qu’ils n’avaient pas quittée. Et, qui plus est, comme si certains de ces événements ne s’étaient pas encore produits mais devaient se produire demain, au point que l’enfant finissait par avoir lui-même l’impression qu’il n’avait pas encore commencé d’exister, que personne de sa race ni de l’autre race sujette, qu’avaient introduite avec eux sur ces terres les gens de sa famille, n’y était encore arrivé, que, bien qu’elles eussent appartenu à son grand-père, puis à son père et à son oncle, qu’elles appartinssent à présent à son cousin et qu’elles dussent être un jour ses terres à lui, sur lesquelles ils chasseraient, Sam et lui, leur possession actuelle était pour ainsi dire anonyme et sans réalité, comme l’inscription ancienne et décolorée, dans le registre du cadastre de Jefferson, qui les leur avaient concédées, et que c’était lui, l’enfant, qui était en ces lieux l’invité, et la voix de Sam Fathers l’interprète de l’hôte qui l’y accueillait.
Jusqu’à il y avait trois ans de cela, ils avaient été deux, l’autre, un Chickasaw pur sang, encore plus incroyablement isolé dans un sens que Sam Fathers. Il se nommait Jobaker, comme si c’eût été un seul mot. Personne ne connaissait son histoire. C’était un ermite, il vivait dans une sordide petite cabane au tournant de la rivière, à cinq milles de la plantation et presque aussi loin de toute autre habitation. C’était un chasseur et un pêcheur consommé ; il ne fréquentait personne, blanc ou noir ; aucun nègre ne traversait même le sentier qui menait à sa demeure, et personne, excepté Sam, n’osait approcher de sa hutte. »
Jobaker décédé, Sam se retire au Grand Fond, et prépare l’enfant à son premier cerf :
« …] l’inoubliable impression qu’avaient faite sur lui les grands bois – non point le sentiment d’un danger, d’une hostilité particulière, mais de quelque chose de profond, de sensible, de gigantesque et de rêveur, au milieu de quoi il lui avait été permis de circuler en tous sens à son gré, impunément, sans qu’il sache pourquoi, mais comme un nain, et, jusqu’à ce qu’il eût versé honorablement un sang qui fût digne d’être versé, un étranger. »
« …] la brousse […] semblait se pencher, se baisser légèrement, les regarder, les écouter, non pas véritablement hostile, parce qu’ils étaient trop petits, même ceux comme Walter, le major de Spain et le vieux général Compson, qui avaient tué beaucoup de daims et d’ours, leur séjour trop bref et trop inoffensif pour l’y inciter, mais simplement pensive, secrète, énorme, presque indifférente. »
L’ours :
« Cette fois, il y avait un homme et aussi un chien. Deux bêtes, en comptant le vieux Ben, l’ours, et deux hommes, en comptant Boon Hogganbeck, dans les veines de qui coulait un peu du même sang que dans celles de Sam Fathers, bien que celui de Boon en fût une déviation plébéienne et que seul celui du vieux Ben et de Lion, le chien bâtard, fût sans tache et sans souillure. »
Cet incipit railleur de Faulkner dénote les conceptions de l’époque sur les races et la pureté du sang.
Ce récit et le précédent, dont il constitue une variante, une reprise et/ou une extension, sont un peu dans la même veine que London. Ils m’ont impressionné par la façon fort juste dont sont évoqués le wild, la wilderness, la forêt sauvage (la « brousse »), « la masse compacte quoique fluide qui les entourait, somnolente, sourde, presque obscure ». Ben, le vieil ours qui « s’était fait un nom » et qui est traqué, Sam et « le grand chien bleu » laisseront la vie dans l’ultime scène dramatique.
Puis Ike, devenu un chasseur et un homme, refuse la terre héritée de ses ancêtres, achetée comme les esclaves (depuis affranchis) ; se basant sur les registres familiaux, il discourt sur la malédiction divine marquant le pays.
Automne dans le Delta : Ike participe une fois encore à la traditionnelle partie de chasse de novembre dans la « brousse », qui a reculé avec le progrès états-unien, et il se confirme que Faulkner est, aussi, un grand auteur de nature writing.
« …] rivières Tallahatchie ou Sunflower, dont la réunion formait le Yazoo, la Rivière du Mort des anciens Choctaws – les eaux épaisses, lentes, noires, sans soleil, presque sans courant, qui, une fois l’an, cessaient complètement de couler, remontaient alors leur cours, s’étalant, noyant la terre fertile, puis se retiraient la laissant plus fertile encore. »
« Car c’était sa terre, bien qu’il n’en eût jamais possédé un pied carré. Il ne l’avait jamais désiré, pas même après avoir vu clairement son suprême destin, la regardant reculer d’année en année devant l’attaque de la hache, de la scie, des chemins de fer forestiers, de la dynamite et des charrues à tracteur, car elle n’appartenait à personne. Elle appartenait à tous : on devait seulement en user avec sagesse, humblement, fièrement. »
La chasse est centrale, avec son ancrage ancestral, son initiation, son folklore, son narratif, et son éthique (c’est le vieil Ike qui parle) :
« Le seul combat, en quelque lieu que ce soit, qui ait jamais eu quelque bénédiction divine, ça a été quand les hommes ont combattu pour protéger les biches et les faons. »
Descends, Moïse : mort d’un des derniers Beauchamp.
Les personnages fort typés mis en scène dans ce recueil se rattachent à la formidable galerie des figures faulknériennes ; ainsi apparaissent des Sartoris, des Compson, et même Sutpen d’Absalon ! Absalon !.
Ces épisodes d’apparence indépendants me semblent former, plus qu’un puzzle, un archipel des évènements émergents d’un sang dans la durée.
\Mots-clés : #colonisation #discrimination #esclavage #famille #identite #initiatique #lieu #nature #portrait #racisme #religion #ruralité #social #violence
- le Mer 2 Aoû - 13:36
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: William Faulkner
- Réponses: 103
- Vues: 12115
Romain Gary
Les Mangeurs d'étoiles
« Le vol fut agréablement dépourvu d'intérêt. C'était la première fois que le Dr Horwat s'aventurait sur un avion d'une ligne non américaine, et il était obligé de reconnaître que, pour peu qu'on les aidât, ces gens-là apprenaient vite. »
Dans cet incipit qui donne le ton, c’est un pasteur évangélique, prédicateur à succès, qui se rend à l’invitation du général José Almayo, lider maximo d’un petit pays sous-développé d'Amérique centrale, avec l’intention d’y combattre le Démon (« le Mal »).
« La Vérité n'était-elle pas un produit de première nécessité et fallait-il hésiter à utiliser les méthodes modernes pour assurer sa diffusion ? Certes, il n'était pas question de comparer la conquête des âmes à celle des marchés, mais il eût été aberrant que, dans un monde où la concurrence était impitoyable, Dieu se privât des conseils des experts passés maîtres dans le maniement des foules. »
Avec Charlie Kuhn, un illassable prospecteur de talents de music-hall, Mr John Sheldon, avocat s'occupant des intérêts d’Almayo aux États-Unis, un superman cubain (performeur porno), M. Antoine, un jongleur marseillais avide d’excellence, Agge Olsen, un ventriloque danois et son pantin, M. Manulesco, un pathétique violoniste classique prodige roumain qui joue sur la tête, déguisé en clown blanc, afin d’être reconnu pour son talent, la mère abêtie par les « étoiles » des drogues locales et la « fiancée » américaine (comprendre nord-américaine) du dictateur, ils vont être fusillés par le capitaine Garcia, afin de faire porter la responsabilité de leur mort aux insurgés d’une soudaine insurrection. Histrions d’un vrai cirque !
Otto Radetzky, aventurier cynique, ancien nazi et conseiller militaire du dictateur, est presque parvenu à comprendre ce dernier, un Indien « cujon » avec un peu de sang espagnol, ancien élève des Jésuites qui, soutenu par un gros corrompu, tenta de devenir torero, et pense avoir trouvé comment favoriser sa chance, protección qu’il croit allouée par le Diable, le vrai Maître du monde, El Señor par euphémisme.
« Radetzky avait connu quelques-uns des plus grands aventuriers de son temps : leur foi profonde dans la puissance du mal et dans la violence l'avait toujours beaucoup amusé. Il fallait une bonne dose de naïveté pour imaginer que les massacres, la cruauté et le « pouvoir » pouvaient vous mener quelque part. Au fond, ils étaient des croyants et manquaient totalement de scepticisme. »
« Dieu est bon, dit-il [Almayo], le monde est mauvais. Le gouvernement, les politiciens, les soldats, les riches, ceux qui possèdent la terre sont des... fientas. Dieu n'a rien à voir avec eux. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe d'eux, qui est leur patron. Dieu est seulement au paradis. La terre, c'est pas à Lui. »
La progression d’Almayo est retracée depuis son enfance, avec ses efforts incessants pour être élu par le Mal.
« Quand on est né indien, si on veut en sortir, il faut le talent, ou il faut se battre. Il faut être torero, boxeur ou pistolero. Sinon, on n'arrive nulle part. Ils ne vous laissent pas passer. Vous n'avez aucune chance de vous frayer un chemin. Tout est fermé, pas moyen de passer. Ils gardent tout ça pour eux-mêmes. Ils se sont arrangés entre eux. Mais si on a le talent, même si on n'est qu'un Cujon, ils vous laissent passer. Ça leur est égal, parce qu'il n'y en a qu'un sur des millions, et puis ils vous prennent en main, et ça leur rapporte. Ils vous laissent passer, ils vous laissent monter, vous pouvez avoir toutes les bonnes choses. Même leurs femmes, elles ouvrent les cuisses, et on peut vivre comme un roi. Seulement, il faut avoir le talent. Sans ça, ils vous laissent pourrir dans votre merde d'Indien. Il n'y a rien à faire. J'ai ça en moi, je le sais. Le talent, je l'ai, je le sens là, dans mes cojones... »
Entre le ressentiment d’une misère séculaire et l’éducation catholique inculquée par les frates de l’Inquisition venus avec les conquistadores, les Indiens, qui regrettent leurs anciens dieux sanguinaires, se tournèrent vers le Diable. La « señora Almayo » à l’évangéliste :
« En fait, tout était mal, il n'y avait de bien que la résignation, la soumission, l'acceptation silencieuse de leur sort et la prière pour le repos de l'âme de leurs enfants morts de sous-alimentation ou d'absence totale d'hygiène, de médecins ou de médicaments. Tout ce qu'ils avaient envie de faire, les Indiens : forniquer, travailler un peu moins, tuer leurs maîtres et leur prendre la terre, tout cela était très mauvais, non ? Le Diable rôdait derrière ces idées, on leur expliquait ça sans arrêt. Alors, il y en a qui ont fini par comprendre et qui se sont mis à croire très sérieusement au Diable, comme vous le leur conseillez. »
« …] les bons hériteront le ciel, et les méchants hériteront la terre. »
Almayo est fasciné par les saltimbanques et charlatans, dans l’espoir que l’un d’eux lui permettra par son talent d’accéder au pouvoir : il acquiert dès que possible la boîte de nuit El Señor.
« Il fallait être prudent avec ces Indiens primitifs et superstitieux. Ils étaient tous croyants. Seulement, on leur avait pris leurs dieux anciens, et le nouveau Dieu qu'on leur avait enfoncé dans la gorge à coups de fouet et de massacres, ils ne le comprenaient pas. On leur avait dit que c'était un Dieu de bonté, de générosité et de pitié, mais pourtant ils continuaient à crever dans la faim, l'ordure et la servitude malgré toutes leurs prières. Ils gardaient donc la nostalgie de leurs dieux anciens, un besoin profond et douloureux de quelque manifestation surnaturelle, ce qui faisait d'eux le meilleur public du monde, le plus facile à impressionner et le plus crédule. Dans toute l'Amérique centrale et en Amérique du Sud, il s'était toujours efforcé de choisir un Indien comme sujet. Pour un hypnotiseur, ils étaient vraiment du pain bénit. »
Les hommes de pouvoir sud-américains inspirent Almayo : Batista, Trujillo, Jimenez, Duvalier (Hitler est aussi un modèle fort inspirant).
« Il continuait à se rendre de temps en temps dans le petit magasin d'archives historiques derrière la place du Libérateur, pour nourrir ses yeux respectueux et graves de documents photographiques, portraits de toutes les grandes figures nationales, politiciens, généraux, qui s'étaient rendus célèbres par leur cruauté et leur avidité, et qui avaient réussi. Il était décidé à devenir un grand homme. »
Les communistes confortent Almayo dans sa conviction :
« Il se mit à prêter une grande attention à la propagande anti-yankee qui déferlait sur le pays et commença à être vivement impressionné par les États-Unis. Il s'arrêtait toujours pour écouter les agitateurs politiques sur les marchés, qui expliquaient aux Indiens combien il était puéril et stupide de croire que le Diable avait des cornes et des pieds fourchus : non, il conduisait une Cadillac, fumait le cigare, c'était un gros homme d'affaires américain, un impérialiste qui possédait la terre même sur laquelle les paysans trimaient, et qui essayait toujours d'acheter à coups de dollars l'âme et la conscience des gens, leur sueur et leur sang, comme l'American Fruit Company qui avait le monopole des bananes dans le pays et les achetait pour rien. »
Sa liaison avec une Américaine relativement cultivée, membre du Peace Corps de Kennedy, lui est opportune pour asseoir son ascension sociale. La jeune idéaliste est transportée par son aspiration à participer au progrès social du pays. Empêtrée dans ses troubles psychologiques, elle s’adonne progressivement à l’alcool, passe même par l’héroïne ; aveuglée par sa conception d’une moralité différente selon les pays, elle admet le maintien des « mangeurs d’étoiles », cette culture qui soulagerait les misères populaires et enrichit son trafiquant de compagnon, quant à lui fourvoyé dans sa vision faustienne du monde, ce « déversoir des surplus américains ».
« Il avait besoin d'elle et lorsque vous trouvez enfin quelqu'un qui a besoin de vous, une bonne partie de vos problèmes sont résolus. Vous cessez d'être aliénée... d'errer à la recherche d'une identité, d'une place dans le monde, d'un but qui vous permettrait de vous libérer de vous-même, de choisir, de vous engager...
– Vous pouvez enfin vous justifier... C'était très important pour moi. »
Elle rêve d’épouser enfin Almayo, quoique assumant, à cause de l'antiaméricanisme de rigueur, de n’être qu’une de ses maîtresses (sans compter les dernières starlettes du « firmament de Hollywood » qu’il couvre d’étincelants bijoux) tandis qu’il devient l’homme fort du pays – lui qui craint son influence bénéfique de « propre » sainte destinée au Paradis. Elle le décide à installer un réseau téléphonique moderne, un grand Centre culturel et une nouvelle Université dans ce pays d’une insondable misère, « où quatre-vingt-quinze pour cent de la population ne savaient pas lire ».
« Elle avait toujours cru que l'art et l'architecture, la grande musique aussi pouvaient transformer radicalement les conditions de vie d'un peuple. Dès que de grands ensembles architecturaux conçus par des hommes comme Niemeyer couvriraient le pays, la solution des problèmes sociaux et économiques suivrait automatiquement comme une sorte de sous-produit de la beauté. »
Il y a bien sûr des soubresauts populaires malgré la grande "popularité" du despote, comme lorsqu’il doit condamner le ministre de l'Éducation pour détournement de l’aide nord-américaine afin de construire la nouvelle Université et la Maison de la Culture :
« Le ministre fut condamné à mort pour sabotage et détournement de fonds, mais, sur l'intervention de l'Alliance des États interaméricains, il ne fut pas fusillé mais simplement envoyé comme ambassadeur à Paris. »
Le pantin d’Agge Olsen, à propos de « l'illusion du pouvoir surnaturel » :
« Personne n'a encore jamais réussi à vendre son âme, mon bon monsieur. Il n'y a pas preneur. […]
Car la vérité sur l'affaire Faust et sur nous tous, qui nous donnons tant de mal et qui faisons, si je puis dire, des pieds et des mains pour trouver preneur, c'est qu'il n'y a hélas ! pas de Diable pour acheter notre âme... Rien que des charlatans. Une succession d'escrocs, d'imposteurs, de combinards, de tricheurs et de petits margoulins. Ils promettent, ils promettent toujours, mais ils ne livrent jamais. Il n'y a pas de vrai et de grand talent auquel on pourrait s'adresser. Il n'y a pas d'acheteur pour notre pauvre petite camelote. Pas de suprême talent, pas de maîtrise absolue. C'est là toute ma tragédie en tant qu'artiste, mon bon monsieur, et cela brise mon petit cœur. »
Le castriste Rafael Gomez, provocateur manipulé par Almayo, se retourne contre lui et le chasse du pouvoir. Le Cujon et son « cabinet d'ombres » (dont Radetzky) se réfugient à l’ambassade d’Uruguay, et c’est une nouvelle scène de guignol. Ils prennent la fuite en emmenant la fille de l’ambassadeur en otage.
« Une révolution qui hésite devant le sang des femmes et des enfants est vouée à l'échec. C'est une révolution qui manque d'idéal. »
« Depuis qu'ils avaient quitté l'ambassade, elle n'avait pas manifesté la moindre trace d'inquiétude et avait conservé cet air d'indifférence un peu hautaine qui n'était peut-être que l'effet de sa beauté. […]
Il n'y avait pas de mystère, et c'était bien pour cela que les hommes se contentaient de beauté. »
Radetzky se révèle être un journaliste suédois infiltré pour enquêter sur Almayo (un des nombreux personnages à peine esquissés par Gary, comme le mystérieux Jack).
Descendant de bandits des montagnes, Garcia n’a pas exécuté les otages, et les a emmenés dans la Sierra, escomptant négocier son exfiltration. Bien sûr les deux groupes se rencontrent, ce qui occasionne une cascade de rebondissements.
« Car, après tout, il n'existait pas d'autre authenticité accessible à l'homme que de mimer jusqu'au bout son rôle et de demeurer fidèle jusqu'à la mort à la comédie et au personnage qu'il avait choisis. C'est ainsi que les hommes faisaient l'Histoire, leur seule authenticité véritable et posthume. »
« Les généraux à la peau noire ou jaune dans leurs blindés, dans leurs palais ou derrière leurs mitrailleuses, allaient suivre pendant longtemps encore la leçon que leurs maîtres leur avaient apprise. Du Congo au Vietnam, ils allaient continuer fidèlement les rites les plus obscurs des civilisés : pendre, torturer et opprimer au nom de la liberté, du progrès et de la foi. Il fallait bien autre chose que l'« indépendance » pour tirer les « primitifs » des pattes des colonisateurs. »
Cette analyse des ressorts du despotisme et de ses dérives, assurément basée sur les observations d’un Gary bien placé pour les faire, est marquée d’un regard qu’on pourrait juger réactionnaire de nos jours ; mais j’y ai trouvé des vues pertinentes, si je me base sur ce que je sais des dictateurs (rencontrés dans la littérature) et des sphères du pouvoir (surtout en Afrique). Cette approche est à contre-courant du mouvement actuel d’adulation un peu béate de tout ce qui est autochtone, rejetant peut-être un peu trop vite toute idée de superstition obscurantiste. Le rôle prépondérant des États-Unis, vus d’une part comme puissant empire du Mal et de l’autre comme dispensateur d’une importante aide financière (détournée), également marché pour l'écoulement de la drogue, me paraît bien exposé.
Cette farce tragi-comique, assez cinématographique, est malheureusement desservie par des longueurs et redites, et des lourdeurs de traduction mal relue. Me reste à lire le deuxième tome de La Comédie américaine, Adieu Gary Cooper.
\Mots-clés : #amérindiens #discrimination #misere #politique #portrait #regimeautoritaire #religion #social
- le Dim 4 Juin - 14:06
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Romain Gary
- Réponses: 111
- Vues: 9663
Jean-Claude Charles
Manhattan Blues
Revenu à New York pour essayer de faire monter son film et d'écrire, Ferdinand, le narrateur (et auteur ?) raconte son séjour avec une certaine mélancolie.
« Répétitions, par retours de mémoire, d’images, de sons, le présent vécu comme un songe. »
Il loge chez son ancienne compagne, Jenny, et rencontre Fran. Celle-ci est une traductrice du français qui vient de se séparer de Bill et se retrouve sans logement ni travail.
« Elle avait les yeux pers, les cheveux d’un noir de jais, taillés en brosse, et de loin on voyait les yeux. Elle les lançait dans le demi-jour comme on lance un cerf-volant. Avec cette force sans violence, d’avance accordée à la force et à la direction du vent, invisible mais ça se sent sur la peau des mains, sur le visage, sur tout le corps, le vent. Ça va vers le nord ou ça va vers le sud. Son regard, ça va doucement à hauteur d’homme, il suffit de jeter les yeux, alors elle les jette. Sur moi. »
Cela ne se passe pas aussi bien qu’il l’aurait voulu entre les deux femmes… Et surtout, le principe suivant ne fonctionne pas tout à fait :
« Rien de tel qu’une femme pour vous faire oublier une autre femme. »
Racisme :
« Le type qui n’aime pas voir un couple mixte, encore moins s’ils ont l’air heureux, c’est un regard plein de haine. […]
Le racisme d’un regard est le plus perfide qui soit, il ne parle pas, il ne frappe pas, il n’émet pas d’insultes audibles, il est là, son destinataire ne saurait s’y tromper. C’est une sensation qu’aucune personne non victime de discrimination ne peut connaître, parce que ça ne fait pas partie de son expérience du monde. Ça n’est prévu dans aucune analyse, ça n’est pas disséqué, il n’y a pas de loi et il est souhaitable qu’il n’y en ait pas contre ça. Il ne s’agit pas de paranoïa. D’habitude ou bien je ne fais pas attention, ou bien je m’en contrefiche.
J’imagine que des femmes ont pu ressentir cette chose innommable dans certaines circonstances. Ou des Arabes en France. Ou des Juifs. Ou n’importe qui susceptible d’être violé, lynché, tabassé, gazé. On ne peut jamais dire monsieur, madame, votre regard porte atteinte à. Il n’y a pas de code sûr en la matière. C’est une affaire de peau, si j’ose dire. Une affaire de tripes. Le regard d’un raciste saisi par les tripes. »
« Mais j’ai une sainte horreur des négrophiles. Qu’on m’aime ou me déteste en tant que Noir, ça me fout en rogne. Qu’on m’aime pour mon talent ou qu’on me déteste parce que je suis un con, d’accord. Pas de cadeau pour ma couleur. Ça cache généralement trop de choses inavouables. J’ai la malchance d’avoir grandi dans une idéologie de glorification de la race noire qui se compte en centaines de milliers de cadavres. Le premier qui profane la mémoire de ces cadavres en les retournant pour une vérification d’identité, je lui crache dans la gueule. »
Fran l’emmène à son corps défendant sur les lieux de son enfance, à Brooklyn, chez ses parents absents. Curieusement, les tours jumelles du World Trade Center sont toujours dans le panorama. Errances urbaines :
« Froid, sec, ensoleillé. Un temps à faire des détours inutiles. Nous faisons des détours inutiles. »
Les idéaux révolutionnaires de sa jeunesse persistent difficultueusement.
« Mike dit qu’il voit ses amis tomber un à un. Il faudrait encore croire au héros pour pouvoir résister. Nous ne croyons plus au héros. Les plus vicelards c’est encore les anciens camarades de campus. Ils ont encore à la bouche le discours de la libération plus ou moins actualisé. Ils ont accédé progressivement à des positions stratégiques. Ils ont les moyens de te baiser la gueule. La seule façon de ne pas avoir affaire à eux serait d’être eux.
Tu en baves. Tu regrettes les bons vieux réacs classiques. Là où les choses avaient l’avantage de la clarté. Les nouveaux sont plus méchants. Ils ont cette méchanceté décuplée par la honte d’avoir trahi. Ils consacrent une partie de leur temps à guetter le moindre de tes faux pas. Là où les vieilles peaux t’ignoraient les nouveaux te connaissent. C’est ton premier point faible. Le deuxième c’est que t’as beau te forcer t’as même pas envie d’être méchant. »
Fête chez Mike, un ami peintre :
« La jungle était peuplée. Toutes races, toutes classes, tous sexes confondus. Peuplée de rêveurs, de pêcheurs de lune, de singes hurleurs, tout une faune cosmopolite, frappée, qui baragouinait au moins deux langues en plus de la maternelle, qui était née du bon ou du mauvais côté du pouvoir et des barrières sociales et de toute façon s’en foutait, suicidaire ou accrochée comme des morpions à la vie, crispée sur des désirs élémentaires de bonheur, lucide ou aveugle sur les limites de l’Amérique, solidaire du Nicaragua révolutionnaire juste pour penser à côté de papa maman ou sachant à peine situer le Nicaragua sur une carte, jeunesse d’entre dix-sept et cinquante ans ou pas d’âge, naufragés de tous les rêves, rescapés de tous les cauchemars, mélangeurs de tout et de rien du tout, révolutionnaires sans cause et apolitiques redoutablement subversifs, innocents et coupables de rien, hommes lesbiens et femmes pédés, hétéromachos féministes et sectateurs du culte de la chasteté au service du travail, artistes sans œuvre et gymnastes du vertige, fossoyeurs d’un abîme à venir où je vois heureusement le tombeau d’une certaine Amérique, dans l’utopie provisoire de la fête chez Mike. »
Ferdinand et Fran s’aiment (au moins sexuellement) ; lui a décidé de retourner en France, elle décide d’y aller aussi ; Jenny et Bill les hantent ; au terme de ces quatre jours, chacun retournera à son ancien amour, pour le meilleur ou pour le pire.
Dans cette évocation de New York et des mœurs de ses jeunes habitants, Charles utilise divers registres, mais son humour gouailleur ne m’a pas trop séduit :
« Je te f’rai un dessin quand tu s’ras grande, je lui dis. Et encore si t’es sage. »
\Mots-clés : #amour #contemporain #discrimination #jeunesse #racisme #revolutionculturelle
- le Mer 30 Nov - 10:23
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Jean-Claude Charles
- Réponses: 13
- Vues: 401
Abdulrazak Gurnah
Paradis
Yusuf, douze ans, est rehani, c'est-à-dire mis en gage par son père pour payer ses dettes au seyyid ("seigneur", titre honorifique des notables musulmans) Aziz, un important marchand (et trafiquant). Le jeune Mswahili de l’hinterland tanzanien est emmené par son « Oncle » sur la côte, où il travaille avec Khalil, son aîné dans la même situation ; il est attiré par le jardin clos de son maître.
Emmené dans une expédition commerciale chez les « sauvages », Yusuf, qui est beau et a dorénavant seize ans, échappe à Mohammed Abdalla, le mnyapara wa safari, guide « sodomite », en étant laissé chez le marchand Hamid, qui l’emmène dans la montagne (apparemment chez les Masaïs). L’année suivante, Yusuf est de l’expédition qui traverse le lac Tanganyika jusqu’aux Manyema (des Bantous du Congo), une sorte d’enfer aux « portes de flammes », et l’éprouvant voyage (initiatique) tourne au désastre ; il se révèle courageux, quoique hanté par des cauchemars.
De retour, il rencontre la Maîtresse, marquée par une tache sur le visage dont elle croit Yusuf, « béni », capable de l’en débarrasser ; elle est mentalement dérangée, et entreprenante ; il tombe amoureux de sa jeune servante, Amina, la sœur de Khalil (en fait une enfant raptée recueillie par son père et la seconde épouse d’Aziz, une rehani elle aussi). Il suivra finalement les askaris allemands comme la guerre éclate contre l’Angleterre.
L’esclavage existe depuis les premières incursions arabes, et même avant ; il est subi partout. Mzi Hamdani, le vieux jardinier taciturne plongé dans ses prières, est un esclave libéré par la Maîtresse lorsque la loi interdit l’esclavage, mais qui resta à son service ; il considère que personne n’a le pouvoir de prendre la liberté de quelqu’un d’autre, et donc de la lui rendre.
Le colonialisme européen constitue une toile de fond omniprésente, et croissante.
« Nous sommes des animaux pour eux, et il nous faudra longtemps pour les faire changer d’avis. Vous savez pourquoi ils sont si forts ? Parce que, depuis des siècles, ils exploitent le monde entier. »
« Nous allons tout perdre, et aussi notre manière de vivre. Les jeunes seront les grands perdants : il viendra un jour où les Européens les feront cracher sur tout ce que nous savons, et les obligeront à réciter leurs lois et leur histoire du monde comme si c’était la Parole sacrée. Quand, un jour, ils écriront sur nous, que diront-ils ? Que nous avions des esclaves… »
Ce qui m’a frappé, c’est le melting pot, Indiens, Arabes, Européens, sans compter les gens du cru, et les différentes ethnies de l’intérieur ; de même le pot-pourri des croyances. Syncrétisme ou opportunisme, l’islam est mêlé dans les affaires et les salamalecs, les rapports à l’alcool et l’herbe, derrière les plaisanteries scabreuses et les cruautés ; par contre, Hussein « l’ermite de Zanzibar » et même Aziz (personnage difficile à cerner) apparaissent comme des musulmans sincères, humains – et sagaces. La Bible semble constituer un socle commun (sur un fond de superstitions antérieures toujours vives) ; l’islam est abrahamique, et même un Sikh (pourquoi la majuscule ?) évoque (un) Noé. Gog et Magog reviennent souvent (désignant apparemment les païens, infidèles et autres chiens poilus), et Yusuf renvoie au Joseph tant hébraïque que coranique, vendu en esclavage. L’évocation du jardin d’Éden se présente fréquemment.
Le style est simple et rend la lecture fort aisée ; par ailleurs les péripéties de l’existence de Yusuf sont passionnantes.
N’étant pas familier de l’Afrique de l’Est et en l’absence de notes explicatives j’ai eu des difficultés à me retrouver entre les termes non traduits et l’histoire-géographie (présence coloniale omanaise, allemande, anglaise) ; c’est dommage, d’autant que les renseignements sont peu accessibles en ligne tant sur le livre que sur la région ; ainsi, l’aigle allemande, mais encore ? :
« À la gare, Yusuf vit qu’en plus du drapeau jaune orné du redoutable oiseau noir, il y en avait un autre où figurait une croix noire bordée d’argent. »
Abandon, exil, servitude, toute une misère humaine, intriquée en situations sociales inextricables, selon les lois du commerce.
\Mots-clés : #aventure #colonisation #discrimination #esclavage #exil #famille #initiatique #misere #religion #segregation #voyage
- le Ven 18 Nov - 13:40
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Abdulrazak Gurnah
- Réponses: 11
- Vues: 674
Umberto Eco
Construire l’ennemi et autres textes occasionnels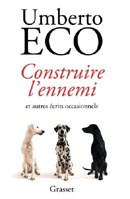
Dans Construire l’ennemi, Eco documente la stigmatisation de l’étranger, du laid, du juif, de l’hérétique, de la femme (notamment sorcière), du lépreux à travers les temps, en produisant nombre d’extraits édifiants (sans omettre les auteurs religieux).
« Il semble qu’il soit impossible de se passer de l’ennemi. La figure de l’ennemi ne peut être abolie par les procès de civilisation. Le besoin est inné même chez l’homme doux et ami de la paix. Simplement, dans ces cas, on déplace l’image de l’ennemi, d’un objet humain à une force naturelle ou sociale qui, peu ou prou, nous menace et doit être combattue, que ce soit l’exploitation du capitalisme, la faim dans le monde ou la pollution environnementale. Mais, même si ce sont là des cas « vertueux », Brecht nous rappelle que la haine de l’injustice déforme elle aussi le visage. »
« Essayer de comprendre l’autre, signifie détruire son cliché, sans nier ou effacer son altérité. »
Mention particulière à La paix indésirable ? Rapport sur l’utilité des guerres, effarante justification états-unienne (et orwellienne) de la nécessité de l’ennemi, notamment pour des raisons économiques (anonyme, préfacé par J. K. Galbraith).
Absolu et relatif nous entraîne dans un débat philosophique qui revient rapidement au problème de notre conception de la vérité (atteignable ou pas).
La flamme est belle est une réflexion sur le feu, qui n’oublie pas Bachelard, entr’autres.
« Les amis pleins de sollicitude brûlent, pour des raisons de moralité et de santé mentale, la bibliothèque romanesque de Don Quichotte. On brûle la bibliothèque d’Auto da fé d’Elias Canetti, en un bûcher qui rappelle le sacrifice d’Empédocle (« quand les flammes l’atteignent enfin, il rit à pleine voix comme il n’avait jamais ri de sa vie »). »
Délices fermentées est consacré à Piero Camporesi, auteur de L’Officine des sens et « gourmet de listes ».
« Hugo, hélas ! » La poétique de l’excès :
« Le goût de l’excès le conduit à décrire en procédant par énumérations interminables [… »
« La beauté n’a qu’un type, la laideur en a mille. »
Cela m’a ramentu cette phrase (souvenir scolaire – on a beau dire du mal de l’école…) :
« Si le poète doit choisir dans les choses (et il le doit), ce n’est pas le beau, mais le caractéristique. »
Astronomies imaginaires (mais pas astrologie, croyance ou tromperie).
Je suis Edmond Dantès ! sur le roman-feuilleton, et « l’agnition ou reconnaissance » (d’un lien de parenté entre personnages) ; le texte commence ainsi :
« Certains infortunés se sont initiés à la lecture en lisant, par exemple, du Robbe-Grillet. Illisible si l’on n’a pas compris les structures ancestrales de la narration, qu’il détourne. Pour savourer les inventions et déformations lexicales de Gadda, il faut connaître les règles de la langue italienne et s’être familiarisé au bon toscan avec Pinocchio. »
Il ne manquait plus qu’Ulysse. Époustouflant patchwork de critiques du livre de Joyce, où la bêtise le dispute à l’antisémitisme.
Pourquoi l’île n’est jamais trouvée. Incipit :
« Les pays de l’Utopie se trouvent (à de rares exceptions près, comme le royaume du Prêtre Jean) sur une île. »
Texte passionnant sur l’histoire de la (non-)découverte d’îles plus ou moins fabuleuses.
« C’est parce que, jusqu’au XVIIIe siècle, date à laquelle on a pu déterminer les longitudes, on pouvait découvrir une île par hasard et, à l’instar d’Ulysse, on pouvait même s’en échapper mais il était impossible de la retrouver. »
C’est l’argument de L’Île du jour d’avant, mais on découvre aussi l’« Ile Perdue, Insula Perdita », île des Bienheureux de saint Brendan, et même un décryptage de La Ballade de la mer salée d’Hugo Pratt.
Réflexions sur WikiLeaks
« Sur le plan des contenus, WikiLeaks s’est révélé être un scandale apparent, alors que sur le plan de la forme, il a été et sera quelque chose de plus, il a inauguré une nouvelle époque historique.
Un scandale est apparent quand il rend publique une chose que tout le monde savait en privé, et dont on parlait à mi-voix par pure hypocrisie (cf. les ragots sur un adultère). »
« Et cela ne fait que confirmer une autre chose que l’on sait pertinemment : chaque dossier élaboré pour un service secret (de quelque nation que ce soit) est constitué exclusivement de matériel qui est déjà dans le domaine public. Par exemple : dans une librairie consacrée à l’ésotérisme, on s’aperçoit que chaque nouvel ouvrage redit (sur le Graal, le mystère de Rennes-le-Château, les Templiers ou les Rose-Croix) exactement ce qui figurait dans les livres précédents. Et ce n’est pas que l’auteur de textes occultistes s’interdise de faire des recherches inédites (ou ignore comment chercher des informations sur l’inexistant), mais parce que les occultistes ne croient qu’à ce qu’ils savent déjà, et qui reconfirme ce qu’ils avaient déjà appris. C’est d’ailleurs là le mécanisme du succès de Dan Brown.
Idem pour les dossiers secrets. L’informateur est paresseux tout comme est paresseux, ou d’esprit limité, le chef des services secrets, qui ne croit que ce qu’il reconnaît.
Par conséquent, puisque, dans tous les pays, les services secrets ne servent pas à prévoir des cas comme l’attaque des Twins Towers et qu’ils n’archivent que ce qui est déjà connu de tous, il vaudrait mieux les éliminer. Mais, par les temps qui courent, supprimer encore des emplois serait vraiment insensé.
Si les États continuent à confier leurs communications et leurs archives confidentielles à Internet ou d’autres formes de mémoire électronique, aucun gouvernement au monde ne pourra plus nourrir des zones de secret, et pas seulement les États-Unis, mais même pas la République de Saint-Marin ou la principauté de Monaco (peut-être que seule Andorre sera épargnée). »
« Et même si la grande masse des citoyens n’est pas en mesure d’examiner et d’évaluer la quantité de matériel que le hacker capture et diffuse, la presse joue désormais un nouveau rôle (elle a déjà commencé à l’interpréter) : au lieu de relayer les nouvelles vraiment importantes – jadis, c’étaient les gouvernements qui décidaient des nouvelles vraiment importantes, en déclarant une guerre, en dévaluant une monnaie, en signant une alliance –, aujourd’hui c’est elle qui décide en toute autonomie des nouvelles qui doivent devenir importantes et de celles qui peuvent être passées sous silence, allant jusqu’à pactiser (cela est arrivé) avec le pouvoir politique pour savoir quels « secrets » dévoilés il convenait de révéler et ceux qu’il fallait taire.
Puisque tous les rapports secrets qui alimentent haines et amitiés d’un gouvernement proviennent d’articles publiés ou de confidences de journalistes à un attaché d’ambassade, la presse prend une autre fonction : jadis, elle épiait le monde des ambassades étrangères pour en connaître les trames occultes, désormais ce sont les ambassades qui épient la presse pour y apprendre des manifestations connues de tous. »
Tout le bref texte devrait être cité !
Et c’est toujours aussi délectable de se régaler de l’esprit d’Umberto Eco…
\Mots-clés : #complotisme #contemporain #discrimination #ecriture #espionnage #essai #guerre #humour #medias #philosophique #politique #social #universdulivre #xxesiecle
- le Lun 24 Oct - 13:57
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Umberto Eco
- Réponses: 69
- Vues: 8737
John Le Carré
Un homme très recherché
Peu après le 11 septembre, Issa Karpov, le mystérieux fils tchétchène d’un colonel de l’Armée rouge décédé, arrive clandestinement à Hambourg (port cosmopolite qui abrita une cellule islamiste impliquée dans l’attentat) ; il a été torturé en Russie et en Turquie, et prétend étudier la médecine, envoyé par Allah. Annabel Richter, une jeune avocate idéaliste de gauche, le met en rapport avec Tommy Brue, un banquier dont le père a créé un compte d’argent blanchi pour son père, associé à la mafia et au massacre des musulmans russes ; les services secrets s’intéressent à lui.
« En fac de droit, on discutait beaucoup de la primauté de la loi sur la vie. C’est un principe fondamental qui traverse toute l’histoire de l’Allemagne : la loi n’est pas faite pour protéger la vie, mais pour l’étouffer. Nous l’avons appliqué aux Juifs. Adapté à l’Amérique d’aujourd’hui, ce même principe autorise la torture et l’enlèvement politique. »
À son habitude, Le Carré dépeint de beaux portraits de ses personnages (notamment des agents secrets), ainsi qu'un contexte géopolitique international occulte, et crédible.
« S’il existe en ce monde des gens prédestinés à l’espionnage, Bachmann était de ceux-là. Rejeton polyglotte d’une extravagante Germano-Ukrainienne ayant contracté une série de mariages mixtes, unique officier de son service censé n’avoir rien réussi à l’école si ce n’est se faire renvoyer définitivement du lycée, avant l’âge de trente ans Bachmann avait bourlingué sur toutes les mers du globe, fait du trekking dans l’Hindou Kouch et de la prison en Colombie, et écrit un roman impubliable d’un millier de pages.
Pourtant, au fil de ces expériences invraisemblables, il avait découvert son patriotisme et sa vraie vocation, d’abord en tant qu’auxiliaire irrégulier d’un lointain avant-poste allemand, puis en tant qu’agent expatrié sans couverture diplomatique à Varsovie pour sa connaissance du polonais, à Aden, Beyrouth, Bagdad et Mogadiscio pour son arabe, et enfin à Berlin pour ses péchés, condamné à y végéter après avoir engendré un scandale quasi épique dont seuls quelques détails avaient atteint le moulin à ragots : un excès de zèle, dirent les rumeurs, une tentative de chantage malavisée, un suicide, un ambassadeur allemand rappelé en hâte. »
Sont particulièrement intéressants les discours manipulateurs des agents de renseignement et surtout des officiers traitants.
« Pas étonnant qu’elle n’arrive pas à dormir. Il lui suffisait de poser la tête sur l’oreiller pour revivre avec un réalisme criant ses nombreuses et diverses prestations de la journée. Ai-je outré mon intérêt pour le bébé malade de la standardiste du Sanctuaire ? Quelle image ai-je projetée quand Ursula a suggéré qu’il était temps pour moi de prendre des vacances ? Et pourquoi l’a-t-elle suggéré d’ailleurs, alors que je me terre derrière ma porte close pour donner l’impression que je remplis diligemment mes fonctions ? Et pourquoi en suis-je venue à me considérer comme le légendaire papillon d’Australie dont le battement d’ailes peut déclencher un tremblement de terre à l’autre bout de la planète ? »
« …] malgré tous les fabuleux joujoux d’espions high-tech qu’ils avaient en magasin, malgré tous les codes magiques qu’ils décryptaient et toutes les conversations suspectes qu’ils interceptaient et toutes les déductions brillantes qu’ils sortaient d’une pochette-surprise concernant les structures organisationnelles de l’ennemi ou l’absence desdites, malgré toutes les luttes intestines qu’ils se livraient, malgré tous les journalistes soumis qui se disputaient l’honneur d’échanger leurs scoops douteux contre des fuites calculées et un peu d’argent de poche, au bout du compte, ce sont toujours l’imam humilié, le messager secret malheureux en amour, le vénal chercheur travaillant pour la Défense pakistanaise, l’officier subalterne iranien oublié dans la promotion, l’agent dormant solitaire fatigué de dormir seul, qui à eux tous fournissent les renseignements concrets sans lesquels tout le reste n’est que du grain à moudre pour les manipulateurs de vérité, idéologues et politopathes qui mènent le monde à sa perte. »
« Nous ne sommes pas des policiers, nous sommes des espions. Nous n’arrêtons pas nos cibles. Nous les travaillons et nous les redirigeons contre des cibles plus importantes. Quand nous identifions un réseau, nous l’observons, nous l’écoutons, nous le pénétrons et nous en prenons peu à peu le contrôle. Les arrestations ont un impact négatif. Elles détruisent des acquis précieux. Elles nous renvoient à la case départ, elles nous obligent à chercher un autre réseau qui serait même deux fois moins bien que celui qu’on vient de foutre en l’air. »
Le Dr Abdullah est un érudit installé en Allemagne qui « représente beaucoup de grandes organisations caritatives musulmanes », et il est pressenti pour répartir pieusement l’argent « impur » de l’héritage d’Issa, car c’est un homme de bien – mais peut-être y a-t-il chez lui ne serait-ce que 5 % de mal ?
Cette histoire fait intervenir les services secrets allemands, anglais et américains, avec leurs guerres intestines, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamique, jusqu'au triomphe final des États-Unis et de leur puissant système de non-droit.
Le suspense m’est paru particulièrement bien mené. Je renvoie aux subtils commentaires de Marie et Shanidar.
\Mots-clés : #contemporain #discrimination #espionnage #immigration #justice #minoriteethnique #politique #psychologique #religion #terrorisme #xxesiecle
- le Ven 21 Oct - 13:04
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: John Le Carré
- Réponses: 33
- Vues: 2609
Carson McCullers
La Ballade du café triste et autres nouvelles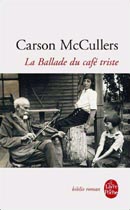
La novella éponyme du recueil est racontée par un narrateur omniscient et moraliste, et s’apparente à un conte.
Le magasin de Miss Amelia Evans devint un café dans cette petite ville désolée. Elle est solitaire, d’apparence masculine, avec un léger strabisme, aime à faire des procès et à soigner gratuitement ; étonnamment, elle accueille Cousin Lymon, un bossu apparemment apparenté, et qui aime à attiser la discorde. Elle fut mariée à un tisserand nommé Marvin Macy, beau gars « hardi, intrépide et cruel », étrangement tombé amoureux d’elle et qui devint un bandit lorsqu’elle le chassa.
« Son mariage n’avait duré que dix jours. Et la ville éprouva cette satisfaction particulière qu’éprouvent les gens lorsqu’ils voient quelqu’un terrassé d’une abominable manière. »
Sorti de prison, Macy revient et la supplante dans l’esprit de Lymon, jusqu’à l’affrontement final. Ces personnages principaux sont ambivalents, avec des réactions inattendues, paradoxales et contradictoires, et ces amours bancals finissent mal.
« Ils attendaient, simplement, en silence, sans savoir eux-mêmes ce qu’ils attendaient. C’est exactement ce qui se passe à chaque période de tension, quand un grand événement se prépare : les hommes se rassemblent et attendent. Au bout d’un temps plus ou moins long, ils se mettent à agir tous ensemble. Sans qu’intervienne la réflexion ou la volonté de l’un d’entre eux. Comme si leurs instincts s’étaient fondus en un tout. La décision finale n’appartient plus alors à un seul, mais au groupe lui-même. À cet instant-là, plus personne n’hésite. Que cette action commune aboutisse au pillage, à la violence, au meurtre, c’est affaire de destin. »
« Celui qui est aimé ne sert souvent qu’à réveiller une immense force d’amour qui dormait jusque-là au fond du cœur de celui qui aime. En général, celui qui aime en est conscient. Il sait que son amour restera solitaire. Qu’il l’entraînera peu à peu vers une solitude nouvelle, plus étrange encore, et de le savoir le déchire. Aussi celui qui aime n’a-t-il qu’une chose à faire : dissimuler son amour aussi complètement et profondément que possible. Se construire un univers intérieur totalement neuf. Un étrange univers de passion, qui se suffira à lui-même. »
« La valeur, la qualité de l’amour, quel qu’il soit, dépend uniquement de celui qui aime. C’est pourquoi la plupart d’entre nous préfèrent aimer plutôt qu’être aimés. La plupart d’entre nous préfèrent être celui qui aime. Car, la stricte vérité, c’est que, d’une façon profondément secrète, pour la plupart d’entre nous, être aimé est insupportable. Celui qui est aimé a toutes les raisons de craindre et de haïr celui qui aime. Car celui qui aime est tellement affamé du moindre contact avec l’objet de son amour qu’il n’a de cesse de l’avoir dépouillé, dût-il n’y trouver que douleur. »
« Mais ce n’est pas seulement la chaleur, la gaieté, les divers ornements qui donnaient au café une importance si particulière et le rendaient si cher aux habitants de la ville. Il y avait une raison plus profonde – raison liée à un certain orgueil inconnu jusque-là dans le pays. Pour comprendre cet orgueil tout neuf, il faut avoir présent à l’esprit le manque de valeur de la vie humaine [« the cheapness of human life »]. Une foule de gens se rassemblait toujours autour d’une filature. Mais il était rare que chaque famille ait assez de nourriture, de vêtements et d’économies pour faire la fête. La vie devenait donc une lutte longue et confuse pour le strict nécessaire. Tout se complique alors : les choses nécessaires pour vivre ont toutes une valeur précise, il faut toutes les acheter contre de l’argent, car le monde est ainsi fait. Or vous connaissez, sans avoir besoin de le demander, le prix d’une balle de coton ou d’un litre de mélasse. Mais la vie humaine n’a pas de valeur précise. Elle nous est offerte sans rien payer, reprise sans rien payer. Quel est son prix ? Regardez autour de vous. Il risque de vous paraître dérisoire, peut-être nul. Alors, après beaucoup d’efforts et de sueur, et vu que rien ne change, vous sentez naître au fond de votre âme le sentiment que vous ne valez pas grand-chose. »
D’autres textes plus courts témoignent aussi chez Carson McCullers de son souci des plus faibles et déshérités (les Noirs, les Juifs, les enfants, les éclopés, les handicapés, les différents, etc.), de son sens des détails, et de ses connaissances de musicienne. Ce dernier point est notamment valable pour deux textes où s’ébauche Le cœur est un chasseur solitaire : Les Étrangers, histoire d’un Juif ayant fui l’Allemagne où montait le nazisme qui voyage en bus vers le Sud où il espère recréer un foyer pour lui et sa famille :
« Un chagrin de cet ordre (car le Juif était musicien) ressemble plutôt à un thème secondaire qui court avec insistance tout au long d’une partition d’orchestre – un thème qui revient toujours, à travers toutes les variations possibles de rythme, de structure sonore et de couleur tonale, nerveux parfois sous le léger pizzicato des cordes, mélancolique d’autres fois derrière la rêverie pastorale du cor anglais, éclatant soudain dans l’agressivité haletante et suraiguë des cuivres. Et ce thème reste le plus souvent indéchiffrable derrière tant de masques subtils, mais son insistance est si forte qu’il finit par avoir, sur l’ensemble de la partition, une influence beaucoup plus importante que la ligne de chant principale. Il arrive même qu’à un signal donné, ce thème trop longtemps contenu jaillisse tel un volcan en plein cœur de la partition, faisant voler en éclats les autres inventions musicales, et obligeant l’orchestre au grand complet à reprendre dans toute sa violence ce qui demeurait jusque-là étouffé. »
… et Histoire sans titre, où un jeune revient à sa famille après être parti trois ans plus tôt :
« Son passé, les dix-sept années qu’il avait passées chez lui, se tenaient devant lui comme une sombre et confuse arabesque. Le dessin en était incompréhensible au premier regard, semblable à un thème musical qui se développe en contrepoint, voix après voix, et qui ne devient clair qu’à l’instant où il se répète. »
« Tout le monde, un jour ou l’autre, a envie de s’en aller – et ça n’a rien à voir avec le fait qu’on s’entende ou qu’on ne s’entende pas avec sa famille. On éprouve le besoin de partir, poussé par quelque chose qu’on doit faire, ou qu’on a envie de faire, et certains même partent sans savoir exactement pourquoi. C’est comme une faim lancinante qui vous commande d’aller à la recherche de quelque chose. »
\Mots-clés : #amour #discrimination #famille #nouvelle #psychologique #social #solitude
- le Dim 16 Oct - 13:23
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Carson McCullers
- Réponses: 29
- Vues: 2371
Howard Fast
La Dernière Frontière
1878, les guerres indiennes sont déjà du passé, ainsi que les grands troupeaux de bisons. Les diverses tribus indiennes, vaincues par l’armée états-unienne, sont regroupées dans une zone aride de ce qui deviendra l'Oklahoma. L’agent John Miles, un quaker, dirige l’agence civile de Darlington en Territoire indien, épaulé par la garnison de Fort Reno. Affamée, la tribu (ou village) cheyenne des deux vieux chefs Dull Knife et Little Wolf, environ 300 personnes dont 85 à 90 guerriers (les redoutés Dog Soldiers), décide de retourner sur son ancien territoire, les Black Hills, à 1600 km au Nord, en traversant l’immense Prairie.
« Les plaines qu’ils voulaient traverser n’étaient plus les plaines de leurs pères et de leurs aïeux. Elles étaient coupées de clôtures, ponctuées de fermes. Il y avait des routes, des lignes télégraphiques et, surtout, trois voies ferrées d’est en ouest enserraient d’une triple ceinture de fer le pays tout entier. »
Le capitaine Murray, homme irascible mais prudent (et personnage inventé par Fast), part à leur poursuite avec deux compagnies de cavalerie.
« Mais ce peuple qui tenait tête à des événements plus forts que lui, qui se battait inlassablement, même contre tout espoir, le stupéfiait. Murray n’arrivait pas à croire que ces Indiens avaient un idéal de liberté et d’indépendance semblable à celui des Blancs. Il attribuait leur résistance à un entêtement primitif, à une volonté de suicide racial, et il se jugeait un peu responsable de leur attitude. »
Les Cheyennes affrontent et bernent la cavalerie de Murray, un détachement d’infanterie montée (sur des mules), l’impulsive milice de Dodge City. Sur leur route, aussi des cow-boys, des chasseurs de bisons (seulement pour la peau).
« Pendant des kilomètres et des kilomètres, sur les plaines flottait l’odeur de charnier que dégageait la viande pourrie ; les coyotes eux-mêmes, gorgés de nourriture, dédaignaient cette proie. L’Amérique n’avait jamais été le théâtre d’un tel massacre ; et il n’est pas sûr que dans toute l’histoire de l’humanité on eût jamais vu pourrir ainsi sous le soleil brûlant tant de milliers de tonnes de viande. Les bisons étaient extraordinairement nombreux, mais à force de massacres on finit par en venir à bout. Lorsque les chemins de fer commencèrent à sillonner le continent, les trains attendaient parfois un jour entier qu’un troupeau eût traversé les voies. Cinq ans plus tard, les bisons étaient rares. Dix ans après, ils avaient pratiquement disparu, il n’en restait que le souvenir : un million de squelettes blanchis. »
Les Indiens des Plaines dépendaient de la chasse au bison.
« Certains sont morts de faim, d’autres de malaria, d’autres encore sont partis chasser le bison là où il n’y a plus de bisons. Mais que pouvais-je faire ? Les Indiens chrétiens, ceux qui n’étaient même qu’à demi civilisés, j’ai dû les favoriser… »
Ils sont donc traqués par des centaines d’hommes, mais passent entre les mailles du filet des télégraphistes « aux fronts surmontés de visières vertes » et des lignes de chemin de fer qui transportent les troupes militaires.
Fast rapporte les réactions et atermoiements de l’état-major et de Washington ; les journalistes de tous les États-Unis en font une affaire retentissante, et sans lendemain. Globalement, les Indiens sont considérés comme des sauvages à exterminer, à la fois insondables et dangereux. Mais ils sont aussi dignes et déterminés.
« Le Kansas recouvra son sang-froid et découvrit qu’il n’existait pas un cas, pas un seul et unique cas, d’un citoyen assassiné ou molesté par les Cheyennes, pas une seule maison incendiée : des chevaux avaient été enlevés, du bétail abattu, rien de plus. »
La tribu se sépare en deux : une moitié qui sera épuisée par le froid, la faim, le manque d’eau, et finalement massacrée ; l’autre qui parviendra aux Black Hills.
Dans ce « requiem d’une race condamnée », expression sans outrance puisque d’une part les Cheyennes chantent leur chant de mort quand ils comprennent qu’ils vont périr, et que d’autre part leur peuple est indubitablement condamné, tout dialogue est impossible et c’est l’incompréhension réciproque qui prévaut.
« − Ils sont déjà morts, traduisit le Sioux. Ils vont chez eux, chez eux, chez eux, s’en vont… Sont morts, s’en vont. »
M’a gêné le côté exploit surhumain, peut-être un peu d’exagération dans ce qui paraît constituer un exposé assez factuel d’une épopée sans issue.
Je pense que Bix connaissait ce livre, en tout cas il l’aurait passionné.
« Le mot freedom – liberté –, savez-vous d’où il vient ? Du vieux saxon, free (libre), et doom (mort). Alors, songeons à ce qu’il a signifié : le droit pour tout homme de choisir la mort plutôt que la servitude. Ainsi aucun homme ne pouvait être réduit en esclavage, puisque le pouvoir de mourir demeurait entre les mains de chacun. Même si on lui confisquait tout le reste, il restait maître de son destin. »
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #discrimination #historique #minoriteethnique
- le Lun 16 Mai - 12:31
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Howard Fast
- Réponses: 18
- Vues: 1871
Le One-shot des paresseux
Nicolas Bourcier, Les Amazoniens, en sursis
D’abord une petite déception, les témoignages et reportages datent du début du siècle, au moins au début.
Des interviews documentent le sort des Indiens (mais aussi des caboclos et quilombolas), abandonnés par l’État, qui poursuit une politique d’exploitation productiviste de la forêt (quel que soit le régime politique), aux exactions des garimpeiros et de leurs pistoleros, des trafiquants, des fazendeiros et autre agrobusiness qui suivent. La pression des Blancs tend à les sédentariser pour les réduire (gouvernement, congrégations religieuses) : c’est aussi l’histoire de nomades malvenus dans notre société. En plus de la pression économique, il y a également les maladies contagieuses, la pollution au mercure, l’exclusion et la discrimination, la bureaucratie, l’exode et l’acculturation, etc. Mais, dorénavant, la population indienne augmente, ainsi que la réaffirmation de l’identité ethnique traditionnelle.
« Les besoins en matière de santé et d’éducation restent considérables. »
Malgré la reconnaissance des droits des Indiens par la constitution, le gouvernement de Lula a déçu les espoirs, et afin de favoriser le développement les forces politiques se coordonnent pour saper toute cohésion des réclamations sociales et foncières.
« Juridiquement, l’Amazonie a connu la reconnaissance des droits des indigènes en 1988, la reconnaissance de la démarcation des terres trois ans plus tard et une succession de grignotages de ces droits par la suite… »
Face à l’extinction des derniers Indiens isolés, les sertanistes (qui protègent leurs terres), ont fait passer le paradigme de l’intégration (ou de l’éradication) à la suppression quasi intégrale des contacts. L’un d’eux, Sydney Possuelo :
« Darcy Ribeiro, qui contribua à la classification légale de l’Indien, comptait trois types : l’Indien isolé, l’Indien en contact mais de façon intermittente (comme les Yanomami et tous ces groupes vivant entre deux mondes), et l’Indien intégré. De ces trois groupes, je n’en vois que deux : l’isolé et l’intermittent. L’intégré n’existe pas. Il n’y a pas d’ethnie qui vive harmonieusement avec la société brésilienne. L’Indien respecté et intégré dans notre société est une invention. »
« Pour résumer, si on ne fait rien, les fronts pionniers tuent les Indiens isolés ; si on entre en contact, voilà qu’ils disparaissent sous l’effet des maladies. La seule option possible est donc de savoir où ils se trouvent et de délimiter leur territoire. C’est ensuite qu’il faut mettre en place des équipes autour de ce territoire pour en bloquer les accès. Pourquoi ne pouvons-nous pas délimiter une zone où vivent des personnes depuis des temps immémoriaux et empêcher qu’elle ne soit envahie ? »
Qu’on soit intéressé de près ou de loin par le sujet, une lecture qui interpelle.
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #contemporain #discrimination #documentaire #ecologie #genocide #identite #minoriteethnique #nature #racisme #ruralité #temoignage #traditions #xxesiecle
- le Mer 22 Déc - 12:14
- Rechercher dans: Nos lectures
- Sujet: Le One-shot des paresseux
- Réponses: 287
- Vues: 21771
Shantabai Kamble - Baby Kamble
Le livre qui suit regroupe les deux récits de Baby Kamble et Shantabai Kamble, qui furent parmi les toutes premières femmes intouchables à rédiger leur autobiographie. Je précise que, malgré leur homonymie, elles ne sont a priori pas de la même famille.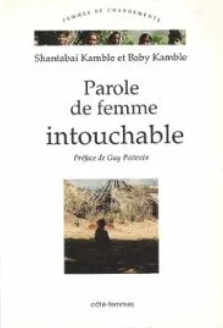
Parole de femme intouchable
Des siècles durant, les intouchables, en Inde, ne furent que des ombres destinées aux tâches impures, dont on disait que le seul contact vous souillait… Des êtres à la fierté sans cesse piétinée, vivant dans la misère, se nourrissant de restes rassis et vêtus d’une seule et même guenille sans cesse rapiécée et grouillante de poux. Les femmes souffraient doublement : parce que femmes, parce qu’intouchables. Des vies de labeur, de sévices, de faim dévorante. Des vies niées.
Puis, un jour, un homme est arrivé : B. R. Ambedkar. Lui aussi intouchable, lui aussi de la caste des Mahâr dont sont issues les deux auteures. Le maharaja de Baroda lui paya des études : Ambedkar devint avocat. Plus tard, il fut le principal rédacteur de la constitution indienne et l’instigateur de quotas permettant aux personnes des basses castes d’accéder aux études. Dans les années 30, on n’en était pas encore là. Mais, par son aura et sa force de conviction, il insuffla à toute une communauté le courage de refuser la fatalité et l’asservissement. Surtout, il parvint à convaincre les parents que leur salut viendrait de la scolarisation des enfants.
Baby Kamble et Shantabai Kamble furent des pionnières, parmi les toutes premières fillettes intouchables scolarisées. Et elles tinrent bon malgré les épreuves. Baby devint commerçante, Shantabai institutrice. Bien des années plus tard, chacune prit la plume pour raconter son histoire.
Grâce à elles, la réalité de l’existence des Mahâr dans la campagne indienne devient tangible. Et c’est atterrant… Leurs deux témoignages font part d’une même réalité : l’indigence, la stigmatisation permanente, puis l’électrochoc Ambedkar et l’amélioration de leur vie d’adulte grâce à l’éducation. Néanmoins, si le fond est proche, la forme diffère considérablement d’un récit à l’autre. A la pondération de Shantabai Kamble succède la fougue et le franc parler de Baby Kamble, qui n’édulcore rien et n’hésite pas à apostropher les oppresseurs comme les piètres successeurs d’Ambedkar, empêtrés dans leurs egos et leurs contradictions.
J’ai beaucoup appris durant cette lecture. Bien sûr, je connaissais Ambedkar. Mais, jusque là, je n’avais pas réalisé à quel point il fut pour les intouchables cet homme providentiel si souvent espéré par les peuples, et pourtant si rarement rencontré. Je ne dirais pas, par contre, que ces récits de vie soient faciles à suivre. Le lecteur est parfois un peu perdu par les nombreux allers et retours temporels de ces écrits au fil de la plume, et par la foultitude de rites et coutumes dont certains aspects lui échappent malgré les notes de Guy Poitevin. Mais ces textes, par leur rareté, le témoignage historique unique qu’ils constituent, et par leur indéniable valeur ethnologique, valent largement la peine qu’on fasse un petit effort.
Je suis ressortie de cette lecture admirative, et quelque peu estourbie. Il faudra encore beaucoup d’Ambedkar, de Baby et de Shantabai avant que l’intouchabilité ne soit plus qu’un mauvais souvenir en Inde. Mais grâce à ces pionniers, l’espoir d’un autre avenir est désormais permis...
Mots-clés : #conditionfeminine #discrimination #education #enfance
- le Mar 1 Sep - 1:10
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Shantabai Kamble - Baby Kamble
- Réponses: 7
- Vues: 713
Joseph Conrad
Un paria des îles
Titre original: An Outcast of the Islands, roman, 310 pages environ, 1896.
Gunung Batur et le fleuve Berau (Sambir et Pantaï dans les romans), où se déroulent les actions de La folie Almayer et d'Un paria des îles, photo de 1901.
Il peut être lu en version originale ici.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quelques personnages de La folie Almayer sont utilisés à nouveau dans cette tragédie, qui se situe dans l'antériorité par rapport à La folie....
En premier lieu Almayer lui-même, et sa fille Nina, mais qui n'a alors que cinq ans. Mme Almayer est extrêmement effacée dans ce roman-là, tandis que le Rajah Laut, le Seigneur des Mers, le capitaine Lingard, a en revanche un rôle tout à fait prépondérant. Idem le petit gouvernement de Sambir, l'intrigant mini-homme d'état Babalatchi et son Rajah de pacotille, Lakamba, Abdulla, le commerçant-armateur arabe, Jim-Eng, le voisin chinois opiomane, Ali, serviteur-contremaître d'Almayer, Hudig, le grand négociant et son bras droit Vink, etc...
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Peter Willems est un jeune homme brillant en affaires, devenu le bras droit du négociant Hudig, qui l'avait recruté chez Lingard, où, de mousse, il s'était hissé à la position de second. Il épouse (un peu à main forcée) la fille naturelle de Hudig sans connaître ce lien filial, et ont un garçon.
Crâneur, m'as-tu-vu avec ses pairs et la populace, égotique, plus que désagréable envers sa femme mais généreux -quoique méprisant- envers la large famille de celle-ci, il commet un jour un impair en piquant dans la caisse de Hudig afin de renflouer des affaires personnelles ayant mal tourné.
Alors qu'il est en train de finir de rembourser discrètement les sommes, ni vu ni connu, cette blâmable incartade est découverte par Hudig et Vink, et il se fait congédier illico.
Puis son épouse le flanque dehors, et, à la rue, il est rattrapé de justesse par Lingard au bout de la jetée d'un port. S'ensuit une explication musclée, virant au pugilat, entre l'ex-protégé de Lingard et ce dernier.
Lingard lui offre une issue, le débarquer quelques semaines dans un port inconnu, pour ainsi dire sa chasse gardée commerciale, nul autre négociant ou trafiquant que lui ne s'y aventurant jamais, bien que nombreux (dont Abdulla) soient ceux qui pistent le navire de Lingard afin de découvrir ce havre dans lequel Lingard a tout monopole.
Il s'agit bien sûr de Sambir, sur le fleuve Pantaï, dont le Rajah (Patalolo) est sous la coupe réglée de Lingard.
Logé chez l'autre protégé de Lingard, Almayer (qui, lui, a épousé par intérêt la fille adoptive de Lingard, voir La folie Almayer ), les deux hommes ne s'entendent pas du tout, atteignent même des sommets d'exécration.
Las d'inaction, Willems se promène aux alentours, et tombe ainsi éperdument amoureux d'une beauté, Aïssa, fille d'Omar, ancien chef pirate (de Babalatchi en particulier), devenu aveugle.
Le roué Babalatchi utilise alors Willems pour mettre en route un vieux plan qu'il caressait, jusqu'alors irréalisable: faire venir Abdulla à Sambir, afin qu'un autre négociant d'envergure coupe l'herbe sous le pied de Lingard, déposer le vieux Rajah Patalolo en place et faire reconnaître son propre petit maître Lakamba comme seigneur des lieux, lequel en rêve depuis qu'il a pour ainsi dire échoué sur cette terre-là.
Comme seul Willems connaît les passes et les traquenards de la navigation sur le fleuve à bord d'un navire de fort tonnage, c'est sur lui que compte Babalatchi, qui a averti discrètement Abdulla, mais pour cela il faut l'affaiblir, le rendre dépendant, en faire son pantin et être capable de s'en défaire définitivement ensuite...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Opus bien plus charpenté que La folie Almayer, ce Paria...atteint parfois aux grandeurs tragiques antiques.
Judicieusement bâti donc, d'une scénographie exceptionnelle (si l'on peut parler, du moins je le crois, de scénographie pour un roman ?), servi par des descriptions toujours fortes, d'une poésie lourde, touffue, suante et prégnante -magnifique-, et des caractères, des psychologies fouillées...
Toutefois, à l'instar de Conrad lui-même dont ce n'était pas le roman préféré de sa production, peut-être parce que celui-ci lui a beaucoup coûté d'efforts, d'affres et de difficulté à mener à bon port (un comble pour un tel marin) cette histoire-là, je le range dans les totalement indispensables, entendez remarquable à plus d'un titre et à vivement conseiller, mais pas forcément parmi ceux d'entre les écrits de Conrad qui m'ont le plus transporté, sans que ce soit mon dernier mot: peut-être, en y repensant, quand je l'aurai bien digéré....
Mots-clés : #aventure #colonisation #conditionfeminine #culpabilité #discrimination #esclavage #insularite #minoriteethnique #solitude #trahison #vengeance #xixesiecle
- le Dim 24 Mai - 18:33
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Joseph Conrad
- Réponses: 95
- Vues: 13316
Isabel Allende
Zorro
Roman, 525 pages environ, 2005. Titre original: El Zorro: Comienza la leyenda.
Parti pour voir si c'était compatible pour une lecture par mes garçons (ça l'est, juste une petite interrogation sur la distance, qui passe les 500 pages), et puis je me suis laissé prendre à ce bouquin, somme toute pas mal déconfinant; puis, parti pour poster un petit message sur le fil one-shot, je me retrouve à ouvrir un fil d'auteur dont je n'avais jamais rien lu...
Roman de cape et d'épée, donc genre littéraire regardé comme plutôt mineur, mais casse-figure tout de même:
Tout le monde n'est pas Dumas père ou encore Théophile Gautier (Le Capitaine Fracasse), ni même Roger Nimier (D'Artagnan amoureux).
Le sujet (voir le titre en langue originale) est l'enfance et la jeunesse de Don Diego/Zorro, en d'autres termes la genèse de Zorro.
Mme Allende s'en sort fort bien, portée par une documentation qu'on pressent solide (sur Barcelone aux temps de l'occupation française -napoléonienne-, les amérindiens, la Californie colonie de la couronne espagnole au XIXème naissant, les mœurs des gitans en Espagne, ceux des Gentilshommes de fortune du démocratique "royaume de Barataria" de Jean Lafitte, le vaudou à cette époque, l'administration royale et coloniale, etc, etc.).
Portée aussi par un sens narratif, ou peut-être un talent éprouvé de conteuse (?) ainsi que sa biblio incite à le supposer.
Peut-être une plume qui possède déjà, en 2005, beaucoup d'expérience, est-ce de l'ordre du flair, je ne sais pas, je découvre l'écriture d'Isabel Allende (mon impression est que l'excellence dans le domaine du sens narratif, il arrive qu'elle procède d'une articulation constructive sans faille - style Flaubert dans Salammbô si vous voulez - ou bien d'un flair, d'une intuition -à la Stevenson, même s'il y a sûrement beaucoup de boulot derrière l'apparente facilité, et sans doute le plus souvent d'un alliage intuition/colossale charge de travail).
Je lui sais gré que son Zorro soit un héros et non un super-héros, avec ses vulnérabilités, son romantisme, ses à-côtés, la sympathie qui va avec le personnage, antithétique du justicier froid.
Toisième Partie, Barcelone 1812-1814 a écrit:Il n'avait pas eu clairement conscience jusqu'à cet instant de sa double personnalité: d'un côté Diego de La Vega, élégant, minaudier, hypocondriaque, de l'autre Zorro, audacieux, insolent, joueur. Il supposait que son véritable caractère se situait quelque part entre ces deux extrêmes [...].
La dualité entre le personnage un peu gandin, frivole et peu signifiant de Diego et le héros Zorro est d'autant mieux exploitée qu'elle se double d'une dualité quasi gémellaire entre Bernardo et Diego, frères de lait, communiquant par gestes et télépathie, avec la part indienne de Zorro révélée (Bernardo est indien, dans ce Zorro-là).
Il m'est difficile pourtant, en lisant, de ne pas imaginer Zorro Le Renard sous les traits de Guy Williams, or j'ai toujours détesté cette intrusion dans mon imaginaire des aspects physiques de personnages que le cinéma ou les séries parviennent à imposer: je le prends toujours pour faiblesse, ou méforme, de ma part.
Il y a du burlesque, du gymnique, du fer croisé, des méchants, des veules, des passages secrets, des exploits et toutes sortes de prouesses, des coups du sort, des traîtrises, des torts à redresser, de l'imprévu, le camp du bien, celui du mal, etc...(vous n'en doutez évidemment pas !).
Un tout léger petit regret ?
Dommage toutefois que Mme Allende ait escamoté toutes les possibilités de littérature équestre qu'offre un sujet aussi en or que Zorro: mais enfin l'opus pèse son pavé, on peut lui fournir une excuse...
Extrait:
Première Partie, Californie 1790-1810 a écrit:Bientôt il se trouva perdu dans l'immensité des montagnes. Il tomba sur une source et en profita pour boire et se laver, puis il s'alimenta de fruits inconnus cueillis aux arbres.
Trois corbeaux, oiseaux vénérés par la tribu de sa mère, passèrent en volant plusieurs fois au-dessus de sa tête; il y vit un signe de bon augure et cela lui donna le courage de continuer.
À la tombée de la nuit, il découvrit un trou protégé par deux rochers, alluma un feu, s'enveloppa dans sa couverture et s'endormit à l'instant, priant sa bonne étoile de ne pas l'abandonner - cette étoile qui, d'après Bernardo, l'éclairait toujours -, car ce ne serait vraiment pas drôle d'être arrivé si loin pour mourir entre les griffes d'un puma.
Il se réveilla en pleine nuit avec le reflux acide des fruits qu'il avait mangés et le hurlement des coyotes tout proches. Du feu il ne restait que de timides braises, qu'il alimenta avec quelques branches, songeant que cette ridicule flambée ne suffirait pas à tenir les fauves à distance.
Il se souvint que les jours précédents il avait vu plusieurs sortes d'animaux, qui les entouraient sans les attaquer, et il fit une prière pour qu'ils ne le fassent pas maintenant qu'il se trouvait seul. À ce moment il vit clairement, à la lueur des flammes, des yeux rouges qui l'observaient avec une fixité spectrale. Il empoigna son couteau, croyant que c'était un loup, mais en se redressant il le vit mieux et s'aperçut qu'il s'agissait d'un renard. Il lui parut curieux qu'il reste immobile, on aurait dit un chat se réchauffant aux braises du feu.
Il l'appela, mais l'animal ne s'approcha pas, et lorsque lui-même voulut le faire, il recula avec prudence, maintenant toujours la même distance entre eux. Pendant un moment Diego s'occupa du feu, puis il se rendormit, malgré les hurlements insistants des lointains coyotes.
À chaque instant il se réveillait en sursaut, ne sachant où il se trouvait, et il voyait l'étrange renard toujours à la même place, comme un esprit vigilant. La nuit lui parut interminable, jusqu'à ce que les premières lueurs du jour révèlent enfin le profil des montagnes. Le renard n'était plus là.
Au cours de jours suivants, il ne se passa rien que Diego puisse interpréter comme une vision, excepté la présence du renard, qui arrivait à la tombée de la nuit et restait avec lui jusqu'au petit matin, toujours calme et attentif.
Le troisième jour, las et défaillant de faim, il essaya de trouver le chemin du retour, mais fut incapable de se situer.
Mots-clés : #amérindiens #corruption #discrimination #esclavage #initiatique #litteraturejeunesse #segregation #social
- le Lun 20 Avr - 18:34
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Isabel Allende
- Réponses: 4
- Vues: 684
Siri Hustvedt
L'avant-propos fictif constitue peut-être mon seul regret quant à ce livre, qu'il enclôt tout entier, qu'il résume quoique d'une manière toute allusive et énigmatique, et que l'on peut isoler de lui comme un chef d'œuvre de la nouvelle digne de celles de Borges. Ce texte, rédigé par l'universitaire I.V. Hess, raconte sa découverte de l'artiste Harriet Burden et de son projet artistique prométhéen à travers un article scientifique puis par le biais de ses vingt-quatre journaux intimes, qui forment une œuvre colossale, tentaculaire, érudite et d'une vitalité hors-normes. Rejetée, selon ses mots, par le milieu artistique new-yorkais pour des raisons extérieures à l'art (une femme, immense et sculpturale, d'une culture sans bornes et dépourvue des notions élémentaires du tact, autant de critères apparemment disqualifiants), elle conçoit une expérience par laquelle, ayant conquis l'accès à la reconnaissance qu'on lui refusait jusque alors, elle exhiberait et les mettrait à mal les différents préjugés de race, de genre, de préférences sexuelles et de notoriété à travers lesquels est appréhendée toute œuvre d'art. Pour cela, elle décide d'exposer trois œuvres dont la paternité est confiée à trois hommes, Anton Tish, Phineas Q. Eldridge et Rune, qui deviennent ce qu'elle appelle ses masques. Ces trois expositions deviennent donc l'œuvre d'une entité hybride, et ces masques, en tant que "personnalités poétisées" de Burden (l'idée lui vient de Kierkegaard), deviennent une composante fondamentale de l'œuvre exposée (ce que le public ignore). I.V. Hess, professeur d'esthétique dont les travaux sont proches de la pensée de Burden, décide d'écrire un livre centré sur cette expérience tripartite et sur la controverse qui l'entoure, qui est celui que le lecteur s'apprête à lire.
Au terme de ce bref avant-propos fictif, il me paraît possible au lecteur de décider de la poursuite ou de l'abandon de sa lecture.
L'une des principales singularités de cette œuvre tient à sa forme, qui amalgame et perturbe de nombreux genres littéraires et artistiques : elle tient de l'étude universitaire qui toutefois ne défend aucune thèse, de l'art du portrait - d'un portrait diffracté par la multiplicité des regards -, du roman de l'artiste (l'une des principales illustrations du roman contemporain); elle est à la fois le récit d'une controverse et l'histoire d'une famille, un roman qui s'auto-interprète sans en confisquer le sens, et pour finir, une invitation à l'analyse. Elle réunit articles savants et comptes rendus d'exposition, journaux intimes, entretiens, témoignages, et brasse des disciplines aussi diverses que l'histoire de l'art, la philosophie, la psychologie, la littérature et les neurosciences. Puisque son personnage est une artiste, Siri Hustvedt se prête elle-même à la création plastique, qui demeure en puissance puisqu'elle n'est que du texte, mais qui prend vigoureusement corps dans l'esprit du lecteur tant elle est rigoureusement et puissamment composée. De même, elle introduit ponctuellement dans son œuvre des créations littéraires extérieures (la nouvelle d'Ethan, les histoires enfantines de Fervidlie) élaborées avec le plus grand soin.
Harriet Burden est une femme tumultueuse, encyclopédique, écorchée vive, prométhéenne à tous égards : elle brûle sans se consumer, elle est la créatrice démiurge d'humanoïdes calorifères, et pour que ceux-ci puissent obtenir un permis d'existence, elle se lance dans un projet secret, interdit, séditieux, porté par elle seule contre le monde des dieux de l'art. Il s'agit d'un projet tantôt militant, tantôt revanchard (selon les témoins qui le qualifient), destiné à confondre ceux qui l'ont méconnue tout en s'élevant à leur rang. Cette expérience se déroule selon trois temps destinés à faire varier les regards sur son œuvre en changeant le masque qui en endosse la paternité. Le premier est un homme blanc, médiocre, psychologiquement fragile; le deuxième, métis et homosexuel, est une figure de la scène underground nocturne de New-York, et le troisième est un artiste célèbre, avatar moderne de Warhol, et manipulateur qui se retourne contre Burden. Ces masques, je l'ai dit, sont destinés à modifier la perception de l'œuvre par le public : ainsi sont-ils (se pensent-ils) créateurs et sont-ils œuvre; ils la créent par ce qu'ils sont et dans le même mouvement sont englobés par elle. L'œuvre comprend également tout article, tout compte rendu, tout livre qui la prend pour objet (y compris le livre que nous sommes en train de lire), en ce qu'ils révèlent le biais de perception qu'empruntent public et critiques. Par ces ajouts qu'elle appelle "proliférations", au nombre potentiellement infini, Burden crée une œuvre ouverte qui subvertit et phagocyte la critique spécialisée, prise au piège et non plus seulement prescriptive. Ainsi aboutit-on au paradoxe suivant :
J'appelle A l'ouvrage appelé Un monde flamboyant, B l'expérience de Harriet Burden. A contient B (cela tombe sous le sens), et comme on vient de le voir, B contient A. Donc A=B. Et pourtant, B contient tout ce qui s'intéresse à l'expérience y compris ce qui se trouve hors de A (mon compte rendu, par exemple). L'expérience contenue dans ce livre non seulement le contient mais est plus vaste que lui.
Inversement, les divers personnages interrogés ne peuvent s'empêcher de parler d'eux-mêmes, ce qui n'entretient de relation avec l'expérience de Burden que dans la mesure où ils expriment quelque chose de leur individualité, c'est-à-dire quelques uns des facteurs de biais dans la perception d'une œuvre d'art. Mais il s'agit également de créer des caractères complexes qui se révèlent à travers des langages propres à chacun, ce que Siri Hustvedt réussit merveilleusement. Ainsi, chaque personnage devient à l'autrice un masque qui lui permet d'exprimer dans un dialogue permanent et tourmenté avec ses autres masques ce qu'elle n'a pu dire qu'avec celui-ci (comme le faisaient Harriet Burden dans son journal, et sa maîtresse à penser, Margaret Cavendish, dans son ouvrage intitulé Le monde flamboyant, faute de trouver pour leurs joutes de partenaires suffisamment talentueux ou assez peu condescendants).
Or ces personnages ne proviennent pas tous du luxueux microcosme de l'art new-yorkais. Le personnage d'Harriet Burden relie entre eux de riches collectionneurs, des scientifiques, des clochards, des artistes millionnaires, des marginaux parmi lesquels des fous et des artistes, ainsi que l'un des personnages les plus humains qu'il m'ait été donné de connaître, celui d'une jeune voyante à moitié allumée mais parfaitement lucide. C'est ainsi que Siri Hustvedt, bien loin du "pur esprit" dans sa tour d'ivoire, élabore une véritable comédie humaine qui suppose une intime compréhension des gens. De même, c'est par honnêteté intellectuelle qu'elle multiplie les points de vue sur cette controverse dans laquelle de vrais salauds tiennent leur rôle. En réalité, et c'en est le principal moteur, c'est à la destruction des catégories et à la dissolution de toute cloison que nous assistons dans ce roman. Sexe, genre, orientation sexuelle, origine biologique et origine sociale, différence psychologique, c'est toute norme qui affecte notre perception de l'art et notre regard sur la vie que par l'art Harriet Burden, partant Siri Hustvedt, nous révèle et condamne. C'est précisément, mais au sein de l'art, à la même notion stérilisante de catégorie normative que s'attaque Siri Hustvedt, en amalgamant dans ce livre hybride la multitude des genres littéraires et artistiques que j'ai déjà évoqués et qui la font imploser.
L'universitaire I.V. Hess découvre l'existence de Harriet Burden dans une revue spécialisée, lorsque celle-ci publie un texte d'un certain Richard Brickman résumant et commentant une longue lettre que lui a envoyé l'artiste. Richard Brickman (qui n'est autre qu'un pseudonyme de Burden elle-même) parle tantôt avec admiration, tantôt avec ironie d'Harriet Burden et de ses références. Références parmi lesquelles "une obscure romancière et essayiste, Siri Hustvedt", qualifiée de "cible mouvante".
Il y a là beaucoup de chose.
Premièrement, deux niveaux d'ironie se déploient. Burden dissimulée derrière Brickman se moque d'elle-même (peut-être aussi pour provoquer la sympathie du public). Puis, ce qui est fortement problématique, Brickman qualifie Siri Hustvedt d'obscure. Tant que c'est Brickman qui le fait, cela n'étonne en rien; pas davantage si Burden l'avait fait en son nom propre; en revanche, que Burden cachée derrière Brickman distingue Siri Hustvedt parmi une foule de références en la qualifiant elle seule, entre toutes les autres, d'obscure (ce qu'au passage elle n'est pas du tout), voilà qui est hautement perturbant. Sans doute est-ce là l'extrême pointe du roman par où l'autrice, Hustvedt, affleure et se laisse deviner au travers de ses différents masques.
Enfin, l'expression "cible mouvante" fait référence aux études sur la vision aveugle et le masquage : une cible (stimulus visuel) peut être intégralement masquée par l'interférence d'autres stimuli. Ainsi, sautant de masque en masque, revêtant la personnalité et maniant la parole de ses différents personnages, Siri Hustvedt peut-elle être qualifiée de cible mouvante.
Ce qui nous fournit une chaîne extrêmement complexe : selon Brickman, Burden estime que Siri Hustvedt est une cible mouvante, et suggère qu'elle se déplace de masque en masque. Or Brickman est Burden, qui par ailleurs note l'obscurité de Siri Hustvedt d'une façon extrêmement ambiguë. Tout ceci est rapporté par I.V. Hess, qui est, comme on va le voir, presque l'anagramme de Siri Hustvedt, et qui se superpose à elle en tant que responsable du livre que nous lisons. Par l'intermédiaire de masques successifs, Siri Hustvedt nous révèle le principe même de son livre, qui est le même que celui qui dirige la grande expérience d'Harriet Burden.
À la fin du roman, j'ai soudain remarqué que les lettres composant le nom de I.V. Hess, le grand ordonnateur du recueil, se retrouvent toutes dans le nom de Siri Hustvedt. Ce n'est certainement pas une coïncidence : l'autrice semble affectionner ce genre de cryptage, et sans doute y en a-t-il d'autres que je n'ai pas remarqués. C'est alors que je me suis rendu compte que j'attribuais à I.V. Hess une identité masculine sans que le moindre indice m'y ait incliné; car en réalité, tout indice dans le roman quant à l'identité de I.V. Hess a été soigneusement gommé (dans l'avant-propos, les notes de bas de page attribuées à lui/elle, et les interview menées par lui/elle). Qu'est-ce donc qui m'a conduit à construire une figure masculine, et ce dès les premières lignes ? Voilà une question parfaitement digne de l'expérience de Harriet Burden, qui reproduite sur moi constitue une preuve de l'efficacité concrète de la littérature, et dont la réponse risque fort d'être à charge pour la société dans laquelle on se construit (en plus de remettre en question la construction elle-même).
Si ce roman m'a passionné d'emblée, c'est que les œuvres de Burden (des poupées et des maisons, sortes d'ex voto) correspondent à ce que je préfère dans l'art et qui me vient de ma mère. Lorsque je lui ai fait lire l'avant-propos fictif, elle m'a dit, un peu vexée : "c'est à moi que te fait penser l'artiste, n'est-ce pas ? mais elle est à moitié folle !"
Eh bien folle ou non, là n'est précisément pas la question. C'est un personnage fondamentalement ambigu, et d'une profonde bonté.
Mots-clés : #contemporain #creationartistique #discrimination #famille #identite #insurrection #romanchoral
- le Sam 4 Jan - 18:34
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Siri Hustvedt
- Réponses: 72
- Vues: 6104
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages