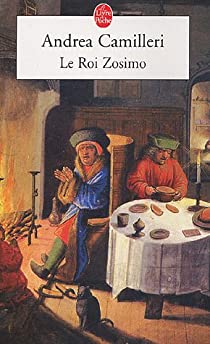La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 11:36
30 résultats trouvés pour misere
Donald Ray Pollock
Knockemstiff
Knockemstiff dans l’Ohio, c’est la ville où l’auteur a grandi et travaillé (dans l’usine à papier) avant de rejoindre l’Université.
La dénomination de cette ville est expliquée par l’un de ses habitants à un visiteur de passage :
Dispute entre deux femmes qui se seraient crêpé le chignon pour un homme, juste devant l’église. Légende ou pas ce nom image la ville.
Knockemstiff est une ville de pauvres dans une Amérique riche. Alors tous ont des rêves d’avenir meilleur mais curieusement peu souhaitent quitter ce lieu et surtout ceux vivant dans le Val.
Combien de violence, physique et/ou verbale ; de tentatives de se sortir de cette vie, par le vol, la drogue, la sexualité. La voiture apparaît souvent comme l’élément de richesse et même si l’on n’arrive pas à payer le loyer, à se nourrir correctement, on emprunte pour se pavaner avec une Mustang, par exemple.
Les enfants voient, subissent et même si dans leur jeunesse ils espèrent, ils se retrouvent adultes dans une désespérante situation, le malheur semble générationnel.
Au fil des années la ville se délabre, comme leur vie, les quelques magasins sont fermés comme l’est leur avenir.
L’écriture sensitive reflète le parler des gens - de la grossièreté, insultes, menaces - ; s'y ajoutent les drogues et l’alcool pour oublier.
Il semble que la « mortadelle » soit très prisée ; à cause du prix accessible ?
Donc tout est sombre, désespérant et malgré le dégout qu'inspirent certains personnages ou situations leur sort est pitoyable.
Des extraits significatifs :
Daniel
le vieux a surpris son monde en sortant le long couteau tout en poussant son fils sur une chaise.
– Tu bouges d’un chouïa, putain, je te scalpe comme un Indien, il lui a dit en saisissant une longue mèche brune dans son poing, avant de se mettre à la scier au ras du crâne
Tout l’été, Daniel avait rêvé de descendre du car de ramassage scolaire après Labor Day 1 avec les cheveux aux épaules. La scène était aussi claire et frappante qu’un film dans sa tête, et maintenant le vieux lui avait pris tout ça.
Chez Théo – Teddy –
À part les capsules noires qu’elle obtenait des fois de sa sœur Wanda, la peur semblait la seule chose qui pouvait réveiller ma mère, la rendre à la vie. Et parce que je voulais tellement la rendre heureuse, j’étais devenu maître dans l’art de lui foutre les foies. Albert DeSalvo était son cinglé préféré, et elle avait sa photo collée au scotch dans son placard de chambre. Des fois, si elle avait eu une vraiment sale journée, j’allais dehors et je fendais un des écrans moustiquaires avec un couteau, ensuite j’entrais chez elle et je lui nouais un nœud savant autour du cou avec un de ses collants, tout en avouant que c’était moi le vrai Boston Strangler.
Frankie le balafré vole l’argent – héritage de sa grand-mère – de Toddy
Sa dernière pensée avant de tourner de l’œil c’était qu’il allait retrouver sa grand-mère. Mais au bout d’un moment il est revenu à lui, couché sur le ventre par terre dans une mare de sang, son jean baissé jusqu’aux chevilles. Il s’est remis sur le dos pour cracher sa dent. Frankie était debout au-dessus de lui, en train de s’essuyer la pine avec un chiffon. En soulevant les hanches pour remonter son pantalon, Todd s’est mis à sourire.
– Qu’est-ce qui te fait sourire comme ça, sale tantouze ? a fait Frankie.
Et il a frappé Todd en plein visage avec le talon de sa chaussure.
Géraldine la fille qui se promène avec dans son sac des poissons panés qu’elle offre.
Del a placé Veena doucement sur le canapé et sorti la dernière couche d’une boîte de Pampers. Là, au fond du carton, se trouvait une petite réserve de poissons panés enveloppés dans une serviette en papier graisseuse. Il regardait les miettes brunes sans y croire. Geraldine n’avait pas touché à un poisson pané depuis qu’il était devenu son tuteur légal ; ça faisait partie de leur arrangement. Il a torché Veena, lui a saupoudré du talc sur les plaques d’irritation qu’elle avait entre ses cuisses dodues. En regardant sa fille, Del a soudain ressenti une grande peine l’assaillir. Il était à genoux, sur le point de demander pardon au bébé, quand il a entendu sa femme débouler dans le couloir et claquer la porte de la chambre. Le boucan a fait sursauter père et fille, l’une encore rose d’innocence, l’autre coupable de mille transgressions.
Bernie
Je ne réponds pas. Les gars dans la Camaro m’ont vu mater la fille, et l’un d’eux se met à imiter Jerry, faisant la grimace et laissant tomber la tête contre sa poitrine. La fille rigole toujours, mais maintenant elle rabaisse son haut. Et j’ai beau savoir qu’il y a deux ans Jerry aurait été avec eux à se moquer du demeuré, je tire le frein à main et j’extirpe mon gros cul de la voiture. Je reste là debout un moment à rabaisser ma chemise par-dessus mon ventre blanc, et à me demander ce que je suis supposé faire maintenant ; mais juste comme je vais me dégonfler, un des gars crie « Porky », et un autre se met à grouiner « Oink, oink ». Je respire un grand coup, marche jusqu’à leur voiture et commence à coller des coups de lattes dans la portière. Croyez-moi, j’ai beau être un gros lard, quand le chauffeur saute de la voiture – un grand serin avec des grandes dents et du fil barbelé tatoué autour de ses bras fluets –, je l’étends d’un seul punch. Je n’ai jamais frappé personne aussi fort de ma vie, même pas Delbert Anderson
Le voleur marié à Dee
Ma tête était en vacances permanentes, mes nerfs, des petits grumeaux de lait moussant. L’Oxy remplissait des trous en moi que j’avais jamais soupçonnés vides. C’était, du moins pour les premiers mois, une façon épatante d’être invalide. Je me sentais béni des dieux.
En réalité, pourtant, ma vie était maintenant sur la pente. Sous l’influence de l’Oxy, j’ai perdu jusqu’à l’ambition de voler le bien des autres. Tex s’est trouvé un autre partenaire, et la banque a repris la Monte Carlo. Heureusement, on avait gardé la Pinto en secours. Une fois ma lune de miel aux opiacés terminée, on s’est retrouvés à louer une caravane qui prenait l’eau et sentait le moisi en bordure de Knockemstiff, le val où j’ai grandi. J’avais beau m’être juré un million de fois de ne jamais y retourner, je n’ai pas tenu ma promesse, comme pour tous les autres serments que j’ai faits avant mon accident.
\Mots-clés : #addiction #misere #nouvelle #social #viequotidienne #violence
- le Mer 27 Mar - 10:09
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Donald Ray Pollock
- Réponses: 6
- Vues: 754
Fédor Dostoïevski
Les Pauvres Gens
Le (premier) roman de Dostoïevski est l’échange de lettres entre deux personnages : le vieux Makar Alexéïévitch Dévouchkine est venu loger en face de chez Varvara Alexéïevna Dobrossiolova, une parente éloignée qu’il chérit.
« Nous, les vieux, je veux dire les gens d’un certain âge, nous nous faisons aux vieilles choses comme si elles avaient toujours été à nous. Mon logement, vous savez, il était si douillet ; avec ses murs… oui, à quoi bon en parler ! – il y avait des murs, comme n’importe quels murs, il ne s’agit pas des murs, et, de me souvenir de tout ça, de tout mon passé, ça me rend mélancolique… Une chose étrange – c’est dur, mais, les souvenirs, c’est comme s’ils étaient doux. Même ce qui était mal, ce qui me faisait rager parfois, dans les souvenirs, c’est comme si ça se nettoyait du mal, et ça se présente à mon imagination sous un air attrayant. »
Son logement est surpeuplé, et assez misérable ; il se sacrifie pour elle, et tous deux minimisent leurs ennuis. Varvara lui envoie un journal tenu alors qu’elle était plus heureuse. Enfant, elle vivait à la campagne, où son père était intendant, mais il leur fallut partir à Pétersbourg. À la mort de son père, une parente éloignée, Anna Fiodorovna, les recueillit, elle et sa mère. Là, elle eut comme voisin et précepteur le pauvre et maladif étudiant Pokrovski ; ils se rapprochèrent comme elle devenait une jeune fille, et découvrait les livres.
« Oh, ce fut un temps triste et joyeux à la fois – tout ensemble ; aujourd’hui encore, je me sens triste et joyeuse quand je m’en souviens. Les souvenirs, qu’ils soient joyeux, qu’ils soient amers, ils vous torturent toujours ; moi, du moins, c’est ainsi ; mais cette torture est douce. »
Lui est copiste, qui regrette de ne savoir composer (ce scribe a un côté bartlebyen, et fait directement référence à Le Manteau de Gogol, paru l’année précédente).
« Parce que, c’est vrai, à la fin, qu’est-ce que ça peut donc faire, que je recopie ? C’est un péché, de recopier, ou quoi ? “Non, mais, il recopie !” “Ce rat, n’est-ce pas, de fonctionnaire, il recopie !” Qu’est-ce qu’il y a là-dedans de tellement malhonnête ? Mon écriture, elle est nette, belle, elle fait plaisir à voir, et Son Excellence est satisfait ; c’est pour lui que je recopie des papiers des plus importants. Bon, je n’ai pas le style, je le sais très bien, que je ne l’ai pas, le satané style ; c’est bien pour ça que je n’ai pas monté dans ma carrière, et, maintenant, là, ma bonne amie, je vous écris tout simplement, comme ça me vient, comme l’idée m’en vient au cœur… Tout ça, je le sais bien ; mais, n’empêche, si tout le monde se mettait à composer, qui est-ce qui resterait, pour recopier ? »
« Parce que, c’est vrai, au fond, ça vous passe, quelquefois, par la tête… et si, moi, j’écrivais quelque chose, qu’est-ce qui arriverait ? »
Makar se ruine pour aider Varvara qui l’apprend ; il a honte, craint les ragots, alors qu’elle lui a gardé son amitié.
« Vous aviez honte de m’obliger à avouer que j’étais la cause de votre situation désespérée, et maintenant, vous avez doublé mon malheur avec votre conduite. Tout cela m’a stupéfiée, Makar Alexéïévitch. Ah, mon ami ! le malheur est une maladie contagieuse ! Les malheureux et les pauvres devraient s’éviter les uns les autres, pour ne pas se contaminer encore plus. »
Tous deux en mauvaise santé et en piètre situation, ils accusent le destin avec résignation. Rataziaïev, colocataire de Makar, est un écrivain qu’il admirait, et qu’il pense maintenant au nombre de ses persécuteurs, lui qui voudrait le mettre dans un de ses livres (délire paranoïaque à comparer à Varvara qui se dit être poursuivie par la haine d’Anna, et qui me paraît comparable à celui de Rousseau dans Les Rêveries).
Finalement, Varvara accepte d’épouser Bykov, relation d’Anna, propriétaire foncier assez rustre, qui l’emmène dans la steppe. Explicit :
« Mais non enfin, moi, j’écrirai, et, vous, aussi, écrivez, enfin… Parce que, moi, maintenant, j’ai le style qui se forme… Ah, mon amie, c’est quoi, le style ! Mais, moi, maintenant, là, je ne sais même plus ce que j’écris, et je ne corrige pas le style, j’écris juste pour écrire, juste pour en écrire un petit plus… Ma petite colombe, mon amie, oh, vous, mon âme à moi ! »
Ce qui m’a frappé, chez ces "petits", ce n’est pas tant qu’ils souffrent de la pauvreté, mais plutôt de la malveillance, et de ne pouvoir révéler les qualités de leur âme, leurs humbles compassion (« pitié ») et dignité (« honneur », « réputation »). Il me semble que Dostoïevski parvient à échapper au pathos, ou à le dépasser par son empathie.
Par ailleurs, son dessein d’écrivain est marqué par les références littéraires, et surtout par les préoccupations de style chez Makar.
\Mots-clés : #correspondances #ecriture #misere
- le Ven 26 Jan - 10:41
- Rechercher dans: Écrivains Russes
- Sujet: Fédor Dostoïevski
- Réponses: 80
- Vues: 6838
Joe Wilkins
Ces montagnes à jamais
Montana, plus précisément dans le comté de Musselshell (cf. La Montagne et les Pères), peu après l’élection d’Obama. Wendell est un travailleur agricole d’origine modeste dans un élevage de bovins, et il recueille en tant que cousin de sa mère en prison Rowdy, un gamin mutique « dans le spectre autistique » (personnage attachant car bien rendu). Joe Wilkins nous fait progressivement (et habilement, car on suit chaque protagoniste séparément et simultanément) découvrir qu’il est le fils de Verl, disparu dans la montagne après avoir tué un loup, puis un garde-chasse.
Gillian, enseignante démocrate (de Rowdy notamment), est la veuve de Kevin, diplômé en foresterie devenu garde-chasse, abattu par Verl.
D’un côté « des gens libéraux, universitaires, pas particulièrement intéressés par les résultats sportifs du lycée ni par la religion », de l’autre « la pauvreté rurale, […] le manque d’instruction, […] le fondamentalisme religieux et les idées politiques réactionnaires, […] la montagne elle-même – et la famille » qui se confrontent (et c’est évidemment la fracture démocrates et républicains).
Gillian :
« Elle s’adressait à Brian, le beau-père du garçon, et à tous ces hommes violents, ignorants et arrogants dans ces montagnes, à ceux qui pensaient que l’est du Montana tout entier leur appartenait et qu’ils pouvaient y agir à leur guise, qui oubliaient avec une facilité déconcertante que leurs arrière-grands-pères avaient reçu ces terres gratuitement, que leurs grands-pères avaient provoqué le Dust Bowl, que leurs grands-pères et leurs pères avaient empoisonné les rivières et presque décimé la population de cerfs, d’antilopes pronghorn et de grouses, et que le gouvernement fédéral était intervenu à chaque fois – de l’installation d’un réseau électrique dans les régions reculées jusqu’aux prêts des terres gouvernementales pour laisser paître le bétail, en passant par les contrats de location très généreux – afin de subventionner ce mode de vie dont ils se vantaient toujours. Elle en avait sa claque. À l’exception de Billings, ce territoire de l’est Montana était un trou noir où s’engouffrait l’argent du contribuable, un tourbillon terrible de dégradation écologique, d’absence d’instruction, d’alcool, de méthamphétamines et de familles brisées. Et les gens comme elle, ceux qui travaillaient vraiment dur, les professeurs d’école et les assistants sociaux et les agents du BLM [Bureau of Land Management, agence américaine faisant partie du département de l’Intérieur des États-Unis et chargée de la gestion des terres publiques], c’était toujours à eux de réparer et de nettoyer. »
« Les bus-nord et ouest arrivèrent en grondant et s’arrêtèrent dans un soupir presque au même instant, l’un derrière l’autre, puis les portes jaunes coulissèrent. Les enfants des Bull Mountains bondirent du bus-nord, souriant et hurlant. Ils s’essuyaient le nez aux manches de leurs manteaux trop fins, et presque aucun ne portait de bonnet, leurs cheveux sales en bataille. Les enfants qui vivaient dans les petits ranchs et les banlieues à mi-chemin de Billings descendirent du bus-ouest, emmitouflés et enjoués, leurs cartables à l’effigie de super-héros et de personnages de dessins animés populaires, les filles arborant des rubans et des barrettes dans les cheveux, les garçons robustes et lumineux, de petites ampoules rouges clignotant autour de leurs semelles de baskets. »
« Gillian avait longtemps méprisé l’influence considérable que les gros fermiers et ranchers exerçaient dans le Montana. Elle n’était pas versée dans la lutte des classes, pas franchement, mais elle n’avait rien reçu en héritage. Non, elle avait payé ses propres études universitaires en travaillant à la bibliothèque pendant l’année scolaire et comme serveuse l’été. Elle avait économisé et acheté seule la maison de Billings, elle avait réussi à économiser pour les futurs frais de scolarité de Maddy et pour sa propre retraite. Mais tous ces ranchers vivaient sur des terres qui avaient été simplement données à leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, et ils pensaient parfois être les seuls à travailler dur, que leur mode de vie était le seul qui importait lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions pour l’État du Montana. »
La nature est centrale, souvent endommagée par l’activité humaine.
« Une terre de pins ravagés par les insectes, d’étés toujours plus longs et d’hivers plus courts et plus secs. »
Maddy, la fille de Gillian, rencontre Wendell sans qu’ils connaissent l’identité de l’autre ; des indépendantistes chasseurs de loups, pour qui Verl est un héros, surgissent…
C’est l’aspect humain (psychologique et social) qui m’a plu, davantage que l’histoire en elle-même (bien que le suspense soit entretenu avec adresse).
\Mots-clés : #misere #politique #psychologique #ruralité
- le Jeu 7 Déc - 11:27
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Joe Wilkins
- Réponses: 9
- Vues: 451
Romain Gary
Les Mangeurs d'étoiles
« Le vol fut agréablement dépourvu d'intérêt. C'était la première fois que le Dr Horwat s'aventurait sur un avion d'une ligne non américaine, et il était obligé de reconnaître que, pour peu qu'on les aidât, ces gens-là apprenaient vite. »
Dans cet incipit qui donne le ton, c’est un pasteur évangélique, prédicateur à succès, qui se rend à l’invitation du général José Almayo, lider maximo d’un petit pays sous-développé d'Amérique centrale, avec l’intention d’y combattre le Démon (« le Mal »).
« La Vérité n'était-elle pas un produit de première nécessité et fallait-il hésiter à utiliser les méthodes modernes pour assurer sa diffusion ? Certes, il n'était pas question de comparer la conquête des âmes à celle des marchés, mais il eût été aberrant que, dans un monde où la concurrence était impitoyable, Dieu se privât des conseils des experts passés maîtres dans le maniement des foules. »
Avec Charlie Kuhn, un illassable prospecteur de talents de music-hall, Mr John Sheldon, avocat s'occupant des intérêts d’Almayo aux États-Unis, un superman cubain (performeur porno), M. Antoine, un jongleur marseillais avide d’excellence, Agge Olsen, un ventriloque danois et son pantin, M. Manulesco, un pathétique violoniste classique prodige roumain qui joue sur la tête, déguisé en clown blanc, afin d’être reconnu pour son talent, la mère abêtie par les « étoiles » des drogues locales et la « fiancée » américaine (comprendre nord-américaine) du dictateur, ils vont être fusillés par le capitaine Garcia, afin de faire porter la responsabilité de leur mort aux insurgés d’une soudaine insurrection. Histrions d’un vrai cirque !
Otto Radetzky, aventurier cynique, ancien nazi et conseiller militaire du dictateur, est presque parvenu à comprendre ce dernier, un Indien « cujon » avec un peu de sang espagnol, ancien élève des Jésuites qui, soutenu par un gros corrompu, tenta de devenir torero, et pense avoir trouvé comment favoriser sa chance, protección qu’il croit allouée par le Diable, le vrai Maître du monde, El Señor par euphémisme.
« Radetzky avait connu quelques-uns des plus grands aventuriers de son temps : leur foi profonde dans la puissance du mal et dans la violence l'avait toujours beaucoup amusé. Il fallait une bonne dose de naïveté pour imaginer que les massacres, la cruauté et le « pouvoir » pouvaient vous mener quelque part. Au fond, ils étaient des croyants et manquaient totalement de scepticisme. »
« Dieu est bon, dit-il [Almayo], le monde est mauvais. Le gouvernement, les politiciens, les soldats, les riches, ceux qui possèdent la terre sont des... fientas. Dieu n'a rien à voir avec eux. C'est quelqu'un d'autre qui s'occupe d'eux, qui est leur patron. Dieu est seulement au paradis. La terre, c'est pas à Lui. »
La progression d’Almayo est retracée depuis son enfance, avec ses efforts incessants pour être élu par le Mal.
« Quand on est né indien, si on veut en sortir, il faut le talent, ou il faut se battre. Il faut être torero, boxeur ou pistolero. Sinon, on n'arrive nulle part. Ils ne vous laissent pas passer. Vous n'avez aucune chance de vous frayer un chemin. Tout est fermé, pas moyen de passer. Ils gardent tout ça pour eux-mêmes. Ils se sont arrangés entre eux. Mais si on a le talent, même si on n'est qu'un Cujon, ils vous laissent passer. Ça leur est égal, parce qu'il n'y en a qu'un sur des millions, et puis ils vous prennent en main, et ça leur rapporte. Ils vous laissent passer, ils vous laissent monter, vous pouvez avoir toutes les bonnes choses. Même leurs femmes, elles ouvrent les cuisses, et on peut vivre comme un roi. Seulement, il faut avoir le talent. Sans ça, ils vous laissent pourrir dans votre merde d'Indien. Il n'y a rien à faire. J'ai ça en moi, je le sais. Le talent, je l'ai, je le sens là, dans mes cojones... »
Entre le ressentiment d’une misère séculaire et l’éducation catholique inculquée par les frates de l’Inquisition venus avec les conquistadores, les Indiens, qui regrettent leurs anciens dieux sanguinaires, se tournèrent vers le Diable. La « señora Almayo » à l’évangéliste :
« En fait, tout était mal, il n'y avait de bien que la résignation, la soumission, l'acceptation silencieuse de leur sort et la prière pour le repos de l'âme de leurs enfants morts de sous-alimentation ou d'absence totale d'hygiène, de médecins ou de médicaments. Tout ce qu'ils avaient envie de faire, les Indiens : forniquer, travailler un peu moins, tuer leurs maîtres et leur prendre la terre, tout cela était très mauvais, non ? Le Diable rôdait derrière ces idées, on leur expliquait ça sans arrêt. Alors, il y en a qui ont fini par comprendre et qui se sont mis à croire très sérieusement au Diable, comme vous le leur conseillez. »
« …] les bons hériteront le ciel, et les méchants hériteront la terre. »
Almayo est fasciné par les saltimbanques et charlatans, dans l’espoir que l’un d’eux lui permettra par son talent d’accéder au pouvoir : il acquiert dès que possible la boîte de nuit El Señor.
« Il fallait être prudent avec ces Indiens primitifs et superstitieux. Ils étaient tous croyants. Seulement, on leur avait pris leurs dieux anciens, et le nouveau Dieu qu'on leur avait enfoncé dans la gorge à coups de fouet et de massacres, ils ne le comprenaient pas. On leur avait dit que c'était un Dieu de bonté, de générosité et de pitié, mais pourtant ils continuaient à crever dans la faim, l'ordure et la servitude malgré toutes leurs prières. Ils gardaient donc la nostalgie de leurs dieux anciens, un besoin profond et douloureux de quelque manifestation surnaturelle, ce qui faisait d'eux le meilleur public du monde, le plus facile à impressionner et le plus crédule. Dans toute l'Amérique centrale et en Amérique du Sud, il s'était toujours efforcé de choisir un Indien comme sujet. Pour un hypnotiseur, ils étaient vraiment du pain bénit. »
Les hommes de pouvoir sud-américains inspirent Almayo : Batista, Trujillo, Jimenez, Duvalier (Hitler est aussi un modèle fort inspirant).
« Il continuait à se rendre de temps en temps dans le petit magasin d'archives historiques derrière la place du Libérateur, pour nourrir ses yeux respectueux et graves de documents photographiques, portraits de toutes les grandes figures nationales, politiciens, généraux, qui s'étaient rendus célèbres par leur cruauté et leur avidité, et qui avaient réussi. Il était décidé à devenir un grand homme. »
Les communistes confortent Almayo dans sa conviction :
« Il se mit à prêter une grande attention à la propagande anti-yankee qui déferlait sur le pays et commença à être vivement impressionné par les États-Unis. Il s'arrêtait toujours pour écouter les agitateurs politiques sur les marchés, qui expliquaient aux Indiens combien il était puéril et stupide de croire que le Diable avait des cornes et des pieds fourchus : non, il conduisait une Cadillac, fumait le cigare, c'était un gros homme d'affaires américain, un impérialiste qui possédait la terre même sur laquelle les paysans trimaient, et qui essayait toujours d'acheter à coups de dollars l'âme et la conscience des gens, leur sueur et leur sang, comme l'American Fruit Company qui avait le monopole des bananes dans le pays et les achetait pour rien. »
Sa liaison avec une Américaine relativement cultivée, membre du Peace Corps de Kennedy, lui est opportune pour asseoir son ascension sociale. La jeune idéaliste est transportée par son aspiration à participer au progrès social du pays. Empêtrée dans ses troubles psychologiques, elle s’adonne progressivement à l’alcool, passe même par l’héroïne ; aveuglée par sa conception d’une moralité différente selon les pays, elle admet le maintien des « mangeurs d’étoiles », cette culture qui soulagerait les misères populaires et enrichit son trafiquant de compagnon, quant à lui fourvoyé dans sa vision faustienne du monde, ce « déversoir des surplus américains ».
« Il avait besoin d'elle et lorsque vous trouvez enfin quelqu'un qui a besoin de vous, une bonne partie de vos problèmes sont résolus. Vous cessez d'être aliénée... d'errer à la recherche d'une identité, d'une place dans le monde, d'un but qui vous permettrait de vous libérer de vous-même, de choisir, de vous engager...
– Vous pouvez enfin vous justifier... C'était très important pour moi. »
Elle rêve d’épouser enfin Almayo, quoique assumant, à cause de l'antiaméricanisme de rigueur, de n’être qu’une de ses maîtresses (sans compter les dernières starlettes du « firmament de Hollywood » qu’il couvre d’étincelants bijoux) tandis qu’il devient l’homme fort du pays – lui qui craint son influence bénéfique de « propre » sainte destinée au Paradis. Elle le décide à installer un réseau téléphonique moderne, un grand Centre culturel et une nouvelle Université dans ce pays d’une insondable misère, « où quatre-vingt-quinze pour cent de la population ne savaient pas lire ».
« Elle avait toujours cru que l'art et l'architecture, la grande musique aussi pouvaient transformer radicalement les conditions de vie d'un peuple. Dès que de grands ensembles architecturaux conçus par des hommes comme Niemeyer couvriraient le pays, la solution des problèmes sociaux et économiques suivrait automatiquement comme une sorte de sous-produit de la beauté. »
Il y a bien sûr des soubresauts populaires malgré la grande "popularité" du despote, comme lorsqu’il doit condamner le ministre de l'Éducation pour détournement de l’aide nord-américaine afin de construire la nouvelle Université et la Maison de la Culture :
« Le ministre fut condamné à mort pour sabotage et détournement de fonds, mais, sur l'intervention de l'Alliance des États interaméricains, il ne fut pas fusillé mais simplement envoyé comme ambassadeur à Paris. »
Le pantin d’Agge Olsen, à propos de « l'illusion du pouvoir surnaturel » :
« Personne n'a encore jamais réussi à vendre son âme, mon bon monsieur. Il n'y a pas preneur. […]
Car la vérité sur l'affaire Faust et sur nous tous, qui nous donnons tant de mal et qui faisons, si je puis dire, des pieds et des mains pour trouver preneur, c'est qu'il n'y a hélas ! pas de Diable pour acheter notre âme... Rien que des charlatans. Une succession d'escrocs, d'imposteurs, de combinards, de tricheurs et de petits margoulins. Ils promettent, ils promettent toujours, mais ils ne livrent jamais. Il n'y a pas de vrai et de grand talent auquel on pourrait s'adresser. Il n'y a pas d'acheteur pour notre pauvre petite camelote. Pas de suprême talent, pas de maîtrise absolue. C'est là toute ma tragédie en tant qu'artiste, mon bon monsieur, et cela brise mon petit cœur. »
Le castriste Rafael Gomez, provocateur manipulé par Almayo, se retourne contre lui et le chasse du pouvoir. Le Cujon et son « cabinet d'ombres » (dont Radetzky) se réfugient à l’ambassade d’Uruguay, et c’est une nouvelle scène de guignol. Ils prennent la fuite en emmenant la fille de l’ambassadeur en otage.
« Une révolution qui hésite devant le sang des femmes et des enfants est vouée à l'échec. C'est une révolution qui manque d'idéal. »
« Depuis qu'ils avaient quitté l'ambassade, elle n'avait pas manifesté la moindre trace d'inquiétude et avait conservé cet air d'indifférence un peu hautaine qui n'était peut-être que l'effet de sa beauté. […]
Il n'y avait pas de mystère, et c'était bien pour cela que les hommes se contentaient de beauté. »
Radetzky se révèle être un journaliste suédois infiltré pour enquêter sur Almayo (un des nombreux personnages à peine esquissés par Gary, comme le mystérieux Jack).
Descendant de bandits des montagnes, Garcia n’a pas exécuté les otages, et les a emmenés dans la Sierra, escomptant négocier son exfiltration. Bien sûr les deux groupes se rencontrent, ce qui occasionne une cascade de rebondissements.
« Car, après tout, il n'existait pas d'autre authenticité accessible à l'homme que de mimer jusqu'au bout son rôle et de demeurer fidèle jusqu'à la mort à la comédie et au personnage qu'il avait choisis. C'est ainsi que les hommes faisaient l'Histoire, leur seule authenticité véritable et posthume. »
« Les généraux à la peau noire ou jaune dans leurs blindés, dans leurs palais ou derrière leurs mitrailleuses, allaient suivre pendant longtemps encore la leçon que leurs maîtres leur avaient apprise. Du Congo au Vietnam, ils allaient continuer fidèlement les rites les plus obscurs des civilisés : pendre, torturer et opprimer au nom de la liberté, du progrès et de la foi. Il fallait bien autre chose que l'« indépendance » pour tirer les « primitifs » des pattes des colonisateurs. »
Cette analyse des ressorts du despotisme et de ses dérives, assurément basée sur les observations d’un Gary bien placé pour les faire, est marquée d’un regard qu’on pourrait juger réactionnaire de nos jours ; mais j’y ai trouvé des vues pertinentes, si je me base sur ce que je sais des dictateurs (rencontrés dans la littérature) et des sphères du pouvoir (surtout en Afrique). Cette approche est à contre-courant du mouvement actuel d’adulation un peu béate de tout ce qui est autochtone, rejetant peut-être un peu trop vite toute idée de superstition obscurantiste. Le rôle prépondérant des États-Unis, vus d’une part comme puissant empire du Mal et de l’autre comme dispensateur d’une importante aide financière (détournée), également marché pour l'écoulement de la drogue, me paraît bien exposé.
Cette farce tragi-comique, assez cinématographique, est malheureusement desservie par des longueurs et redites, et des lourdeurs de traduction mal relue. Me reste à lire le deuxième tome de La Comédie américaine, Adieu Gary Cooper.
\Mots-clés : #amérindiens #discrimination #misere #politique #portrait #regimeautoritaire #religion #social
- le Dim 4 Juin - 14:06
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Romain Gary
- Réponses: 111
- Vues: 9663
Leonardo Sciascia
Les Paroisses de Regalpetra
Dans son Avertissement, Sciascia donne la chronique de cette petite ville fictive qui ressemble à celle de ses origines, Racalmuto, comme à nombre d’autres en Sicile : pressurisation des paysans et les mineurs (soufre, sel), les braccianti, depuis les comtes du XVIIe jusqu’au fascisme, excluant uniquement les fonctionnaires des Bourbons.
Dans Brève chronique d’un régime, c’est l’enfance du narrateur (Sciascia) sous le fascisme.
« À l’exception de quelques petites invectives, je n’entendais dire que du bien de Mussolini et du fascisme. »
En grandissant, s’épuise l’évidence du fascisme et de son embrigadement, de ses guerres en Éthiopie et en Espagne.
« C’est ça, la dictature : un soupçon venimeux, un réseau de trahisons et de tromperies humaines. »
Compte rendu édifiant instructif du Cercle de la Concorde, celui des galantuomini (mais malheureusement il faudrait bien connaître l’histoire et la politique italiennes pour le savourer en détail). Puis Sciascia est instituteur au bourg, avec des élèves affamés, sans autre perspective que la faim ou l’émigration, dont il désigne chaque jour les heureux bénéficiaires de la cantine.
« Si je m’habitue à cette anatomie quotidienne de misère, d’instincts, à ce cruel rapport humain, si je commence à la voir dans sa nécessité et sa fatalité, comme d’un corps qui est ainsi fait et qui ne peut pas être différent, j’aurai perdu ce sentiment, d’espoir et d’autre chose, qui est, je crois, ce que j’ai de meilleur en moi. »
Les ouvriers sauniers : passage qui vaut document sur leur misérable condition.
Journal d’une campagne électorale : celle de 1955, avec une multitude de partis dans une curieuse démocratie, très « pirandellienne ».
La neige, Noël : le froid ajoute à la pauvreté.
« Moi, le jour de Noël, j’ai joué avec mes cousins et mes camarades. J’avais gagné deux cents lires et quand je suis rentré, mon père me les a prises et c’est lui qui s’en est allé s’amuser. »
Sont marquants les ascendants des prêtres et de la mafia ; j'ai été surpris du renoncement impuissant de Sciascia instituteur.
\Mots-clés : #biographie #corruption #historique #misere #politique #ruralité #xxesiecle
- le Mer 17 Mai - 12:40
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Leonardo Sciascia
- Réponses: 14
- Vues: 2235
Albert Cossery
Les Couleurs de l'infamie
Ossama est un adroit voleur professionnel du Caire, à l’éthique de dérision professant que « le seul moteur de l’humanité était le vol et l’escroquerie » ; à ce titre, il vole les riches (voleurs) pour faire circuler l’argent.
« La multitude humaine qui déambulait au rythme nonchalant d’une flânerie estivale sur les trottoirs défoncés de la cité millénaire d’Al Qahira, semblait s’accommoder avec sérénité, et même un certain cynisme, de la dégradation incessante et irréversible de l’environnement. »
Il a trouvé dans le portefeuille volé d’un certain Suleyman, promoteur immobilier véreux, la lettre d’Abdelrazak, frère du ministre des Travaux publics, qui l’implique dans une malversation à propos d’une habitation neuve qui s’est effondrée en tuant cinquante personnes.
Pour faire éclater le scandale, il approche Karamallah, un lettré subversif qui vit dans la Cité des morts, un vaste cimetière urbain squatté par une multitude de démunis.
« Pour Karamallah le choix de cette austère résidence avait pour origine le despotisme d’un gouvernement imperméable à l’humour et férocement hostile à toute information ayant quelque rapport avec la vérité. »
« C’était un principe de sa philosophie que les problèmes se résolvent d’eux-mêmes si on n’y prête pas attention. »
« Il n’y a aucun avenir dans la vérité, tandis que le mensonge est porteur de vastes espérances. »
« Sache que l’honneur est une notion abstraite, inventée comme toujours par la caste des dominateurs pour que le plus pauvre des pauvres puisse s’enorgueillir d’un avoir fantomatique qui ne coûte rien à personne. »
« Atef Suleyman, le promoteur d’anodins génocides urbains, ne portait pas le signe de l’infamie inscrit sur son front, mais cette négligence de la nature n’empêchait pas les innombrables locataires des immeubles construits par sa société immobilière de le maudire à toute heure du jour et de la nuit, sans compter certains extrémistes qui réclamaient sa mort immédiate. Malheureusement ces invectives d’une populace acrimonieuse, dépourvue de toute culture économique pour apprécier les beautés du capitalisme, n’atteignaient jamais leur destinataire. Celui-ci vivait majestueusement dans le quartier résidentiel de Zamalek, distant de plusieurs kilomètres des nouvelles cités conquises sur le désert où il exerçait sa lucrative industrie. Désabusé par la pérennité des monuments pharaoniques, Suleyman se voulait le promoteur de l’ère des constructions éphémères – emblème de la modernité – qui ne léguaient à la postérité que gravats et poussières. En langage clair, des maisons jetables. »
Karamallah décide de faire se rencontrer Ossama et « cet homme [qui] représente toute l’infamie universelle »…
Ce roman est moins abouti que de précédents, mais rend sensiblement Le Caire contemporain et sa population (ainsi que quelques réalités socio-économiques), avec même quelques personnages féminins moins contrefaits, comme Safira la prostituée et Nahed l’étudiante. Ici, j’entends Oum Kalsoum :
« Soudain il s’arrêta pour écouter une voix venue de nulle part, mais qu’il connaissait depuis son enfance. Une radio diffusait les airs adulés de la chanteuse mythique dont la voix accompagnera encore longtemps les hommes dans leurs dérives et leurs amours inassouvis. »
\Mots-clés : #corruption #misere #politique #social #urbanité #xxesiecle
- le Mer 19 Avr - 12:03
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Albert Cossery
- Réponses: 59
- Vues: 5941
Panait Istrati
Les Chardons du Baragan
Incipit :
« Quand arrive septembre les vastes plaines incultes de la Valachie danubienne se mettent à vivre, pendant un mois, leur existence millénaire. »
C’est le baragan, plaine continentale roumaine, « ogre amoureux d’immensité inhabitable » et « assoiffé de solitude », désert où ne poussait que les chardons, qui secs étaient emmenés par le Crivatz (vent froid), comme les virevoltants ou tumbleweeds des westerns.
À neuf ans, le narrateur y part avec son père, dans l’objectif de vendre le poisson qui abonde chez eux, et manque ailleurs.
« Bon pays, mauvaise organisation :
Sacré nom d’un règlement !
C’était cela : un pays riche, mal organisé et mal gouverné ; ma mère le savait comme tout paysan roumain. »
Mais l’expédition est un échec, la mère décède, et à quatorze ans Mataké se sépare de son père pour partir à l’aventure derrière les « petites meules de broussaille » avec son ami Brèche-Dent : il réalise le rêve de tous les enfants, s’évader « à la découverte du monde », « quitter la maison et s’en aller par le monde ».
Ils sont recueillis comme argats [« Valets de ferme »] dans une famille paysanne miséreuse (peut-être les cojans, terme récurrent mais non explicité, comme trop d’autres).
« Sous un ciel si terreux qu’on eût dit la fin du monde, on voyait les chars avancer comme des tortues, sur des champs, sur des routes, sur une terre que Dieu maudissait de toute sa haine. Chars informes ; bêtes rabougries ; hommes méconnaissables ; fourrage boueux ; et aucune pitié nulle part, ni au ciel ni sur la terre ! Nous avions pourtant besoin de pitié divine autant que de pitié humaine, car les chars s’embourbaient ou se renversaient ; car les bêtes tombaient à genoux et nous demandaient grâce ; car les hommes battaient les bêtes et se battaient entre eux ; car les ciocani [« Tiges de maïs, dont les feuilles servent de fourrage et le déchet de combustible »] pourrissaient dans les mares et il fallait en transporter les gerbes à dos d’homme, à dos de femme, à dos d’enfant, et ces hommes, ces femmes, ces enfants n’étaient plus que des tas de hardes imbibées de boue, de grosses mottes de terre pantelante sous l’action de cœurs inutiles.
Tels étaient les paysans roumains, à l’automne de 1906. »
Mataké est tombé amoureux de Toudoritza, ma belle demoiselle éconduite par son amoureux à cause du boyard. Grand nettoyage (deux fois par an, pour Pâques et Noël) :
« Nous vidâmes deux pièces, en entassant les meubles dans une troisième. Au milieu de la tinda, trois brouettes de glaise jaune comme le safran et une brouette de crottin de cheval furent versées avec de l’eau chaude par-dessus, et je fus chargé de piétiner le lut sur le sol des chambres dont Toudoritza badigeonnait les murs en chantant à tue-tête. Elle s’était affublée de vieux vêtements de sa mère ; complètement enfouie, chevelure et visage, sous une grande basma qui ne laissait voir que ses beaux yeux, et armée d’une brosse à long manche, elle couvrait murs et plafond de cette couche de chaux bleuâtre qui fait la joie et la santé du paysan roumain et que connaissent seuls les villages balkaniques. Le badigeonnage fini, ce fut le tour du sol. Le temps de fumer une pipe, il se fit aussi lisse qu’une table, sous les mains adroites de Toudoritza qui le nivelait en marchant à reculons.
Une semaine durant, nous vécûmes une vie de rescapés, couchant un soir ici, le lendemain là, comme ça se trouvait, et mangeant sur le pouce, dans une atmosphère de salle de bain turc dont la vapeur, sentant la chaux et la bouse, nous piquait le nez. »
Mais une mauvaise récolte suscite une famine qui désespère les paysans.
« Soudain, une nouvelle tomba dans le village, comme l’éclair d’une explosion. En Moldavie, les paysans avaient brûlé le konak du grand fermier juif Ficher ! C’est M. Cristea qui nous lut cette nouvelle, dans un journal. Et ce journal concluait : « Cela apprendra aux Juifs à exploiter les paysans jusqu’au sang. À bas, à bas les Juifs ! »
Les cojans qui écoutaient se regardèrent les uns les autres :
– Quels Juifs ? Dans notre département il n’y en a pas ! Et même ailleurs, ils n’ont pas le droit d’être propriétaires ruraux. Or, les fautifs, ce sont les propriétaires, non les fermiers.
À ces paroles, toutes les faces se tournèrent du côté du konak. »
Et les villageois révoltés brûlent le konak. (Un konak est un palais, une grande résidence en Turquie ottomane ; il doit en être de même ici, à propos de la demeure du boyard.) La bourgade est bombardée par l’armée, c’est un massacre.
Outre le témoignage sur une Roumanie rurale misérable et l’insurrection de 1907, ainsi que ses charmes de conte, ce roman offre un éclairage original sur le goût du départ et l’émigration.
\Mots-clés : #historique #lieu #misere #ruralité #temoignage
- le Ven 17 Fév - 12:24
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Panait Istrati
- Réponses: 20
- Vues: 1364
Abdulrazak Gurnah
Paradis
Yusuf, douze ans, est rehani, c'est-à-dire mis en gage par son père pour payer ses dettes au seyyid ("seigneur", titre honorifique des notables musulmans) Aziz, un important marchand (et trafiquant). Le jeune Mswahili de l’hinterland tanzanien est emmené par son « Oncle » sur la côte, où il travaille avec Khalil, son aîné dans la même situation ; il est attiré par le jardin clos de son maître.
Emmené dans une expédition commerciale chez les « sauvages », Yusuf, qui est beau et a dorénavant seize ans, échappe à Mohammed Abdalla, le mnyapara wa safari, guide « sodomite », en étant laissé chez le marchand Hamid, qui l’emmène dans la montagne (apparemment chez les Masaïs). L’année suivante, Yusuf est de l’expédition qui traverse le lac Tanganyika jusqu’aux Manyema (des Bantous du Congo), une sorte d’enfer aux « portes de flammes », et l’éprouvant voyage (initiatique) tourne au désastre ; il se révèle courageux, quoique hanté par des cauchemars.
De retour, il rencontre la Maîtresse, marquée par une tache sur le visage dont elle croit Yusuf, « béni », capable de l’en débarrasser ; elle est mentalement dérangée, et entreprenante ; il tombe amoureux de sa jeune servante, Amina, la sœur de Khalil (en fait une enfant raptée recueillie par son père et la seconde épouse d’Aziz, une rehani elle aussi). Il suivra finalement les askaris allemands comme la guerre éclate contre l’Angleterre.
L’esclavage existe depuis les premières incursions arabes, et même avant ; il est subi partout. Mzi Hamdani, le vieux jardinier taciturne plongé dans ses prières, est un esclave libéré par la Maîtresse lorsque la loi interdit l’esclavage, mais qui resta à son service ; il considère que personne n’a le pouvoir de prendre la liberté de quelqu’un d’autre, et donc de la lui rendre.
Le colonialisme européen constitue une toile de fond omniprésente, et croissante.
« Nous sommes des animaux pour eux, et il nous faudra longtemps pour les faire changer d’avis. Vous savez pourquoi ils sont si forts ? Parce que, depuis des siècles, ils exploitent le monde entier. »
« Nous allons tout perdre, et aussi notre manière de vivre. Les jeunes seront les grands perdants : il viendra un jour où les Européens les feront cracher sur tout ce que nous savons, et les obligeront à réciter leurs lois et leur histoire du monde comme si c’était la Parole sacrée. Quand, un jour, ils écriront sur nous, que diront-ils ? Que nous avions des esclaves… »
Ce qui m’a frappé, c’est le melting pot, Indiens, Arabes, Européens, sans compter les gens du cru, et les différentes ethnies de l’intérieur ; de même le pot-pourri des croyances. Syncrétisme ou opportunisme, l’islam est mêlé dans les affaires et les salamalecs, les rapports à l’alcool et l’herbe, derrière les plaisanteries scabreuses et les cruautés ; par contre, Hussein « l’ermite de Zanzibar » et même Aziz (personnage difficile à cerner) apparaissent comme des musulmans sincères, humains – et sagaces. La Bible semble constituer un socle commun (sur un fond de superstitions antérieures toujours vives) ; l’islam est abrahamique, et même un Sikh (pourquoi la majuscule ?) évoque (un) Noé. Gog et Magog reviennent souvent (désignant apparemment les païens, infidèles et autres chiens poilus), et Yusuf renvoie au Joseph tant hébraïque que coranique, vendu en esclavage. L’évocation du jardin d’Éden se présente fréquemment.
Le style est simple et rend la lecture fort aisée ; par ailleurs les péripéties de l’existence de Yusuf sont passionnantes.
N’étant pas familier de l’Afrique de l’Est et en l’absence de notes explicatives j’ai eu des difficultés à me retrouver entre les termes non traduits et l’histoire-géographie (présence coloniale omanaise, allemande, anglaise) ; c’est dommage, d’autant que les renseignements sont peu accessibles en ligne tant sur le livre que sur la région ; ainsi, l’aigle allemande, mais encore ? :
« À la gare, Yusuf vit qu’en plus du drapeau jaune orné du redoutable oiseau noir, il y en avait un autre où figurait une croix noire bordée d’argent. »
Abandon, exil, servitude, toute une misère humaine, intriquée en situations sociales inextricables, selon les lois du commerce.
\Mots-clés : #aventure #colonisation #discrimination #esclavage #exil #famille #initiatique #misere #religion #segregation #voyage
- le Ven 18 Nov - 13:40
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Abdulrazak Gurnah
- Réponses: 11
- Vues: 674
Annie Ernaux
Les armoires vides
Denise, « Ninise » Lesur, jeune étudiante, subit un avortement clandestin, et évoque son enfance. Une enfance dans un milieu méprisé (a posteriori), en fait assez heureux (parents faisant « tout » pour elle, chère abondante – c’est l’après-guerre), modeste mais relativement privilégié (commerçants) : la misère est en réalité autour (avec notamment l’alcoolisme), même si on baigne dedans (d’autant plus avec la promiscuité).
« Malheurs lointains qui ne m'arriveront jamais parce qu'il y a des gens qui sont faits pour, à qui il vient des maladies, qui achètent pour cinquante francs de pâté seulement, et ma mère en retire, elle a forcé, des vieux qui ont, a, b, c, d, la chandelle au bout du nez en hiver et des croquenots mal fermés. Ce n'est pas leur faute. La nôtre non plus. C'est comme ça, j'étais heureuse. »
Puis l’autre monde, celui de l’école (libre) ; humiliation sociale, et culpabilité (le péché) insinuée par l’aumônier à la « vicieuse » avec son « quat'sous » (son sexe, avec connotation de peu de valeur) ; puis revanche de première de la classe. Et la lecture.
« Ces mots me fascinent, je veux les attraper, les mettre sur moi, dans mon écriture. Je me les appropriais et en même temps, c'était comme si je m'appropriais toutes les choses dont parlaient les livres. Mes rédactions inventaient une Denise Lesur qui voyageait dans toute la France – je n'avais pas été plus loin que Rouen et Le Havre –, qui portait des robes d'organdi, des gants de filoselle, des écharpes mousseuses, parce que j'avais lu tous ces mots. Ce n'était plus pour fermer la gueule des filles que je racontais ces histoires, c'était pour vivre dans un monde plus beau, plus pur, plus riche que le mien. Tout entier en mots. Je les aime les mots des livres, je les apprends tous. »
« Pour moi, l'auteur n'existait pas, il ne faisait que transcrire la vie de personnages réels. J'avais la tête remplie d'une foule de gens libres, riches et heureux ou bien d'une misère noire, superbe, pas de parents, des haillons, des croûtes de pain, pas de milieu. Le rêve, être une autre fille. »
Rejet du moche, du sale, du café-épicerie de la rue Clopart, honte haineuse d’une inculture (pourtant compréhensible), envie aussi de la vie des autres jeunes, de la liberté : l’adolescente veut "s’en sortir".
Premières menstrues, « chasse aux garçons », découverte du plaisir ; avec quand même la crainte confuse de mal tourner, comme redoutent les parents (qui triment pour lui permettre de poursuivre ses études).
« Dans l'ordre, si tout y avait été, une maison accueillante, de la propreté, si je m'étais plu avec eux, chez eux, oui, ce serait peut-être rentré dans l'ordre. »
Dix-sept ans, l’Algérie et mai 68 en toile de fond, et ce besoin (à la fois légitime et choquant) d’être supérieur à sa condition d’origine.
« J'inscris des passages sur un petit carnet réservé, secret. Découvrir que je pense comme ces écrivains, que je sens comme eux, et voir en même temps que les propos de mes parents, c'est de la moralité de vendeuse à l'ardoise, des vieilles conneries séchées. »
« Mais la fête de l'esprit, pour moi, ce n'est pas de découvrir, c'est de sentir que je grimpe encore, que je suis supérieure aux autres, aux paumés, aux connasses des villas sur les hauteurs qui apprennent le cours et ne savent que le dégueuler. »
Étudiante enfin, puis c’est la « dé-fête », elle est enceinte, et avorte clandestinement.
« J'ai été coupée en deux, c'est ça, mes parents, ma famille d'ouvriers agricoles, de manœuvres, et l'école, les bouquins, les Bornin. Le cul entre deux chaises, ça pousse à la haine, il fallait bien choisir. »
Contrairement à ce qui est parfois prétendu, Ernaux a "un style".
« Ça me fait un peu peur, ça saignera, un petit fût de sang, lie bleue, c'est mon père qui purge les barriques et en sort de grandes peaux molles au bout de l'immense rince-bouteilles chevelu. Que je sois récurée de fond en comble, décrochée de tout ce qui m'empêche d'avancer, l'écrabouillage enfin. Malheureuse tout de même, qui est-il, qui est-il... Mou, infiniment mou et lisse. Pas de sang, une très fine brûlure, une saccade qui s'enfonce, ce cercle, ce cerceau d'enfant, ronds de plaisir, tout au fond... Traversée pour la première fois, écartelée entre les sièges de la bagnole. Le cerceau roule, s'élargit, trop tendu, trop sec. La mouillure enfin, à hurler de délivrance, et macérer doucement, crevée, du sang, de l'eau. »
« Le goût de viande crue m'imbibe, les têtes autour de moi se décomposent, tout ce que je vois se transforme en mangeaille, le palais de dame Tartine à l'envers, tout faisande, et moi je suis une poche d'eau de vaisselle, ça sort, ça brouille tout. Le restau en pleine canicule, les filles sont vertes, je mange des choses immondes et molles, mon triomphe est en train de tourner. Et je croyais qu'il s'agissait d'une crise de foie. Couchée sur mon lit, à la Cité, je m'enfilais de grands verres d'hépatoum tout miroitants, une mare sous des ombrages, à peine au bord des lèvres, ça se changeait en égout saumâtre. La bière se dénature, je rêve de saucisson moelleux, de fraises écarlates. Quand j'ai fini d'engloutir le cervelas à l'ail dont j'avais une envie douloureuse, l'eau sale remonte aussitôt, même pas trois secondes de plaisir. J'ai fini par faire un rapprochement avec les serviettes blanches. Une sorte d'empoisonnement. »
Et pour une écriture "blanche" (certes peu métaphorique), j’ai découvert plusieurs mots nouveaux pour moi : décarpillage, cocoler, polard, pouque et mucre (il est vrai cauchois), etc. ; curieusement (pourtant dans l’œuvre d’une écrivaine nobelisée !), je n’ai pas trouvé en ligne la définition de "creback", apparemment une pâtisserie, ni « troume » (peur vraisemblablement).
Dès ce premier roman, Ernaux parvient, avec l'originalité de son écriture, à nous transmettre une expérience commune. C'est peut-être ça qui explique l'oppression ressentie à cette lecture, comme signalée par Chrysta : Ernaux n'est pas une auteure d'évasion, c'est tout le contraire, on est sans cesse durement ramené à la triste réalité.
\Mots-clés : #autobiographie #conditionfeminine #contemporain #enfance #identite #intimiste #Jeunesse #Misère #relationenfantparent #sexualité #social #temoignage #xxesiecle
- le Ven 28 Oct - 11:23
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Annie Ernaux
- Réponses: 136
- Vues: 12236
Léo Malet
Brouillard au pont de Tolbiac
Nestor Burma a reçu l’appel d’un certain Abel Benoit hospitalisé à la Salpêtrière, qui dit le connaître ; lorsqu’il arrive, l’homme est mort de ses blessures, et se révèle être Albert Lenantais, une relation de Nestor adolescent. C’est l’occasion d’une plongée dans le passé de Nestor (et Léo), lorsqu’il était réfugié parmi les libertaires du Foyer végétalien du XIIIe en 1927 (à l’époque, c’étaient les anarchistes qui ne mangeaient que des légumes, et proscrivaient alcool et tabac). Dans l’édition que j’ai lue, ce milieu est documenté par une préface de Francis Lacassin et deux chapitres d’À nous deux, Patrie !, d’André Colomer, « théoricien lyrique de la violence, individualiste exacerbé », journaliste dressé contre Dieu, la guerre, la patrie et la révolution…
Benoit-Lenantais était devenu « un vieux cordonnier-chiffonnier », « Chiftir et bouif », et c’est l’opportunité de pénétrer cette fois dans le milieu de la chiffe, dans ce misérable quartier depuis disparu.
« À ce stade de notre décevante tournée, nous nous trouvions rue des Cinq-Diamants. Le XIIIe arrondissement fourmille de rues aux noms charmants et pittoresques, en général mensongers. Rue des Cinq-Diamants, il n’y a pas de diamants ; rue du Château-des-Rentiers, il y a surtout l’Asile Nicolas-Flamel ; rue des Terres-au-Curé, je n’ai pas vu de prêtre ; et rue Croulebarbe, ne siège pas l’Académie française. Quant à la rue des Reculettes... hum... et celle de l’Espérance... »
Nestor enquête avec Bélita Moralés, sa voisine la belle gitane que Lenantais a soustraite à l’emprise de sa « race » (à l’époque on se défie des « romanos » et autres Arabes).
« − Dans ce quartier, mon vieux, où ça grouille d’Arabes, sans qu’on puisse distinguer lesquels sont pour nous, lesquels contre, on s’occupe plus activement qu’ailleurs des banales agressions nocturnes, surtout commises pour des norafs.
− Ah ! oui ! parce que ça s’agite dans la colonie coloniale ! Fellaghas et compagnie, quoi ?
− Exactement. Un jour, c’est un sidi buveur de pinard qui se fait casser la gueule par un autre sidi respectueux du Coran... »
L’histoire policière proprement dite est assez banale ; les anciens anars et insoumis, sans parler des illégalistes, ont perdu leurs valeurs avec le temps…
\Mots-clés : #misere #polar #politique #social #xxesiecle
- le Mer 5 Oct - 12:22
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Léo Malet
- Réponses: 28
- Vues: 1865
Laurent Gaudé
Le Soleil des Scorta
1875, Luciano Mascalzone, un vaurien qui vient de passer quinze ans en prison, revient au village de Montepuccio dans les Pouilles pour faire l’amour avec Filoména Biscotti. Ceci fait, il est lapidé par les habitants, mais a le temps d’apprendre son erreur : c’est Immacolata qu’il a dépucelée, la sœur de Filoména. Celle-ci donne jour à Rocco, et meurt peu après.
« C'est ainsi que naquit la famille des Mascalzone. D'un homme qui s'était trompé. Et d'une femme qui avait consenti à ce mensonge parce que le désir lui faisait claquer les genoux. »
Le curé confie le bébé dans un village voisin, car ceux de Montepuccio voulaient le sacrifier. Il devient Rocco Scorta Mascalzone, pillard et tueur, terrorisant Montepuccio qui l’admire pour sa richesse, puis épouse une muette et en a Domenico, Giuseppe et Carmela ; enfin il meurt en léguant sa fortune à l’église, déshéritant ses enfants, les vouant à la misère mais exigeant pour ses descendants des enterrements princiers. Domenico, Giuseppe et Carmela émigrent en Amérique, mais cette dernière est refoulée pour raison médicale, et les trois retournent en Italie.
Raffaele, leur seul ami d’enfance, est intégré au clan Scorta lors de l’enterrement hors du cimetière de la Muette, qui avait été inhumée dans la fosse commune. C’est lui qui déshabille le nouveau curé responsable, qui en mourra d’insolation. À l’initiative de Carmela, le clan des « taciturnes » investit dans un bureau de tabac. Ils se réunissent pour un repas historique sur la plateforme du trabucco accroché à la falaise (carrelet, sorte d’engin de pêche installé à demeure). Elia, un des fils de Carmela, vole les médailles de l’idole de San Michele la veille de sa procession. Son frère, Donata, devient contrebandier par esprit de famille (on ne peut que penser à l’esprit mafieux, et sourire de l’éloge familial comme de sa valeur fondamentale de la « sueur » du labeur). Elia a repris le bureau de tabac familial ; amoureux de Maria, fille de notable, et sur conseil du curé du moment, calabrais, il danse la tarentelle, et incendie le commerce.
Les Scorta ont fait vœu de confier chacun le secret de son existence à un descendant avant de mourir, et Carmela qui ne parlait plus raconte sa vie au curé en fil entrecroisé au cours du récit ; finalement, devenue sénile, elle est engloutie par le cimetière dans un tremblement de terre.
L’histoire, ce pays de soleil, pauvre, de superstition et de religiosité mal assimilée – (mauvais) sort et Dieu (ou ses saints) − peuvent emporter le lecteur, mais son style est un frein puissant. Au moyen de courtes phrases à visée percutante, son emphase lyrique et raboteuse en rend piètrement la dimension dramatique, et sonne faux. Simpliste, artificiel, incohérent et outrancier, il aligne les poncifs. C’est bancal et grandiloquent comme un premier jet d’ado qui ne serait pas Rimbaud, un western au hiératisme caricatural et à la psychologie rudimentaire, une parodie de souffle hugolien ou un pastiche de Chevillard.
Les prix littéraires que le livre a reçu (Goncourt, celui du roman populiste [sic], et même… Jean Giono !) me font craindre qu’on baisse la barre bien bas. Il faut certes promouvoir la lecture (et les ventes), mais à ce niveau d’indigence littéraire on songe à un regrettable enterrement.
J’ai eu des impressions de déjà vu dans cette lecture, et retrouvé une note de lecture de 2018 qui portait déjà le même constat ; j’aurais dû poster mon avis à l’époque, mais au moins la preuve est faite que ce n’est pas une lecture impérissable ; j’espère me rappeler dorénavant avoir déjà lu ce livre dont je ne peux sauver aucun extrait.
\Mots-clés : #famille #fratrie #misere
- le Lun 26 Sep - 12:43
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Laurent Gaudé
- Réponses: 49
- Vues: 4334
Nancy Huston
Instruments des ténèbres
Le titre est inspiré de Macbeth, cité en exergue, avec une allusion à la musique dans le terme « instruments ».
Alternance entre Le carnet scordatura (discordance en italien, jeu "désaccordé", dissonance volontaire en musique, « une manière d'accorder les instruments à cordes qui s'écarte de l'accord usuel », Wikipédia) et la Sonate de la Résurrection (d’après l'œuvre d'Heinrich Biber, compositeur baroque de Bohème) ; de fortes correspondances tissent des liens significatifs entre ces deux séries (le work in progress – plutôt coulisses, laboratoire, scriptorium, chambre d’écho − et son résultat).
Dans la première, journal intime tenu sur un an par la narratrice-auteure, Nadia (qui change son prénom en Nada, I étant "je" ; elle nomme son jumeau mort à la naissance Nothin’), États-unienne de quarante-neuf ans, commente son travail, sa documentation historique. Elle expose froidement son mépris pour ce qui est nature et vie, et choisit le diable contre Dieu : elle a pour muse son daimôn (génie, esprit, voix, inspiration) : « l’Autre », avec lequel elle converse parfois comme avec un psychothérapeute, et qui lui dicterait son œuvre. Elle discute avec Stella, violoncelliste et meilleure amie de sa mère Élise, sombrée dans la divagation mentale, et évoque son père Ronald, ivrogne qui engrossait sa femme régulièrement pour l’empêcher de jouer du violon.
« C’est une de mes "images au formol", comme je les appelle : des souvenirs qui ne changent pas, ne bougent ni ne s’évanouissent, mais restent là, alignés sur une étagère dans ma tête, muets et horribles tels les organes humains et animaux du siècle dernier qu’on voit exhibés dans des bocaux au Muséum d’histoire naturelle à Paris. »
Dans la seconde série, c'est-à-dire la fiction de Nadia, c’est le miséreux et superstitieux (et croyant) Berry sous l’Ancien régime : Barbe (née coiffée) et Barnabé sont des jumeaux séparés dès leur naissance, qui fut fatale à leur mère. Elle passe d’une famille d’accueil à l’autre, lui est élevé à Orsan, « prieuré où les femmes commandent et où les hommes obéissent », où il chante et a des visions de sa mère en attendant de devenir moine. Les jumeaux se sont retrouvés et s’aiment ; elle devient servante à l’auberge de Torchay, chez Hélène Denis (une guérisseuse, aussi grosse que Stella). Voix off :
« Je veux l’écrire ici et en avoir le cœur net : j’ai peur que Stella ne meure si je tue Hélène dans ma Sonate de la Résurrection. Ça a l’air insensé, mais c’est vrai. Et je n’oserais l’avouer à aucun être vivant. »
Là Barbe s’éveille.
« Les frontières de son univers reculent chaque jour un peu plus. »
Mais son amie Jeanne est foudroyée, elle est prise pour une sorcière et doit fuir. Elle est recueillie par Marguerite Guersant qui en fera sa servante, trop rebutante pour que son mari, Donat (« c’était un enfant donné, abandonné dès sa naissance »), ne l’engrosse comme les précédentes, par dépit qu’elle n’enfante pas ; mais il abuse quand même Barbe, qui devenue prégnante devra de nouveau s’enfuir, tentera d’avorter et donnera jour à un enfant mort-né (parallèlement, Nadia évoque son avortement, exécuté avec l’aide de sa mère : correspondance de Tom Pouce dans la scordatura et du Petit Poucet dans la Sonate ; alternent désir d’enfant et détestation de la maternité non voulue).
Le thème récurrent est l’injustice du sort (des femmes), sans Jugement, Dieu, « le Témoin », n’existant pas.
« Que, justement en raison du fait que la vie réelle existe, et qu’elle n’a pas de sens, il est indispensable que l’Art, qui tourne autour des inexistants, en ait. »
« Mais depuis que le monde est monde, la plus grande partie des passions humaines a tourné autour de choses inexistantes : Jéhovah, Belzébuth, Shiva, Isis, Damballah, la Vierge Marie, Hercule, Gatsby le Magnifique, Mme Bovary, la Fée bleue, mon frère jumeau, mon ange de fils, Sabina ma plus chère amie, Andrew le fils de Stella et Jack son mari… Ces êtres vivent et vibrent en nous, agissent sur nous, influencent nos gestes, nos pensées, nos états d’âme… Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents… »
L’indifférence pour se protéger du mal, de la violence dans le monde, « la lame froide, l’écart entre moi et le monde » chez Nadia évolue au fil du livre vers une acceptation de ce qui est.
« Je crois aux personnages de mon roman de la même façon que les paysans superstitieux croient aux fantômes, ou les mères en leurs enfants : non parce qu’ils espèrent en tirer quelque chose, mais parce qu’ils sont là : de façon aussi irréfutable que miraculeuse. Le désespoir est exactement aussi débile que l’espoir, ne voyez-vous pas ? La vérité n’est ni la lumière permanente éblouissante, ni la nuit noire éternelle ; mais des éclats d’amour, de beauté et de rire, sur fond d’ombres angoissantes ; mais le scintillement bref des instruments au milieu des ténèbres (oui, car la musique ne se perçoit que grâce au silence, le rythme grâce à l’étendue plane) [… »
Plutôt déconcertante de prime abord, Nancy Huston aime choquer, mais sa provocation n’est pas gratuite : les descriptions obsessionnelles d’accouchements gores mettent en relief le drame inhérent à la destinée féminine. Son écriture névrotique est assez bien décrite par un amant de Nadia :
« …] il ne raffole pas non plus de mes romans, il les trouve trop morbides, trop violents, "philopsychotiques" »
Le découpage en séquences assez courtes aide beaucoup à la lecture.
Ses échappées métaphysiques sont fort originales (même si elle m’a parfois ramentu Olga Tokarscuz).
« − Pourquoi le mot seconde, comme mesure de temps ? demandai-je à Sol.
− Hein ?
− On est dans les secondes, les secondes qui passent, tic tac, tic tac. Mais les premières ? Où sont-elles passées, tu peux me le dire ? On n’arrête pas de courir après les premières, toujours en retard, juste une seconde trop tard. »
\Mots-clés : #conditionfeminine #fratrie #historique #misere #mort #musique
- le Lun 12 Sep - 13:10
- Rechercher dans: Écrivains du Canada
- Sujet: Nancy Huston
- Réponses: 21
- Vues: 2127
Andrea Camilleri
Je pensais que c’était pure fiction avant d’avoir lu le propos de l’auteur en fin de livre ; il s’avère que Zosimo a bien existé, mais cette « biographie » elle, est imagination de l’auteur.Une première partie raconte l’aventure de son père avec un Prince par lui sauvé, et la naissance dans la paille de l’enfant Michele ( que tous appelleront Zosimo) entouré des animaux, non pas un bœuf et l’âne mais une chèvre, des gélines et un chien.
« Tout d’un train, à une poussée plus forte, elle se benouilla entre les jambes, c’étaient les eaux qu’aidaient la tête du bébé à sortir. La douleur était grande et Filònia prit à quincher, de toute façon elle était seule. À ce moment-là, tous leurs animaux approchèrent : un chien errant désormais amaisonné chez eux et que tout le monde appelait, sans trop se tarabuster, « l’chien », une cabre d’Agrigente, une belle bête au long pelage marron, avec deux cornes de licorne et de plantureuses mamelles sombres, et quatre gélines. »
Dès son plus jeune âge Zo se révèle exceptionnel, buvant et mangeant comme un homme à 7 mois, puis à 7 ans, instruit par le Père Uhu, ermite, il sait écrire, lire et connait même le latin, ce qui est rare au 18ème siècle pour un « pagan » un paysan.
Instruit, intelligent, aimable, il sera toute sa vie l’ami, le chef, « le roi » même des paysans qui réclament son couronnement. Ce couronnement sera fait devant toute la foule des paysans, à la barbe des nobles auxquels Zosimo appliquera « ses lois », lesquelles donneront aux paysans exploités ce qui leur est dû.
Malgré son courage, sa volonté, Zosimo sera trahi par les Nobles, arrêté et condamné au gibet.
Sur les marches du gibet se présenteront à lui, les animaux de sa naissance, le Père Uhu et un magicien.
« Et quand ils arrivèrent au point où il fallait gravir le premier des cinq degrés, le capitaine dit en basset :
« Je m’arrête ici. »
Et il le dit en parfait italien, rapport que le moment était ce qu’il était et que quand le moment est ce qu’il est, c’est nécessité de japiller en italien, sinon on dit que vous avez fait votre éducation autour du collège, que vous n’êtes qu’un pauvre riclaire et pas un marquant.
Zosimo s’arrêta et se retourna pour apincher le capitaine.
« Vous ne me tenez pas compagnie jusqu’au bout ?
— Non, il vaut mieux que vous montiez tout seul, comme ça le monde qu’est agrobé sur les toits vous voit mieux.
— Et comment savez-vous qu’il y a du monde sur les toits ?
— Parce que cette nuit mes soldats les ont aidés à y grimper. »
Il tendit la main à Zosimo, Zosimo la lui serra vigoureusement.
« Merci, dit-il. »
« Il remira vers le ciel, ébaffé, et vit son cerf-volant. Le cerf-volant était revenu et se maintenait immobile en hauteur, pile au-dessus de son coqueluchon. Comment avait-il pu revenir ? Et pourquoi était-il revenu ? Puis il comprit et sentit sa poitrine s’élargir : il avait cru perdre son imagination en lâchant la corde du cerf-volant et, en fait, les choses allaient tout autrement. Au moment précis où le capitaine laissait retomber son bras, Zosimo agrappa la corde des deux mains en percevant un arrachement violent, manquablement provoqué par le cerf-volant qui reprenait de la vitesse et de la hauteur Il se mit à grimper lestement à la corde, sans éprouver de fatigue, et il se sentait à chaque mouvement de bras plus léger et plus libre.
Arrivé un moment, il s’arrêta et remira en bas. Il vit la place, les maisons avec le monde qui redescendait des toits et au mitan de la place, il vit aussi une potence avec une chose, une sorte de sac, qui pendait du gibet en dodinant.
Il éclata de rire. Et reprit à grimper »
Ainsi commença et finit la vie de Zosimo dans un éclat de rire.
***********
Une intéressante lecture qui se déroule pendant le règne de Victor-Amédée II de Savoie alors que les Espagnols veulent reprendre la Sicile.
Evocation de la période de la « controverse de Lipari » affrontement entre les Royaume de Sicile et le Saint-Siège, qui a commencé en 1711 d'un petit conflit local entre Évêque de Lipari et deux agents fiscaux dans la même ville (une histoire de taxes sur des poischiches)
Zosimo convainc les paysans, qui n’ont rien à gagner de ce conflit de se garder
« ni le Pape, ni le Roi »
Sage mesure.
Avec l’incarcération du Père Uhu est évoqué aussi « l’inquisition »
Evocation également de la « peste » qui décima la région, de la situation sociale des « pagans ».
L’écriture « buissonnière » j’ai bien aimé.
Cette lecture vaut d’être faite, même si par moment j’ai pensé que c’était un peu trop de mascarades mais il faut se rappeler dans quel siècle se déroule l’histoire.
Merci à ZeBebelo d'avoir conseillé cette lecture.
\Mots-clés : #famille #misere #viequotidienne XVIIIe s
- le Ven 29 Juil - 9:15
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Andrea Camilleri
- Réponses: 25
- Vues: 2530
Alejo Carpentier
Le Royaume de ce monde
Bref roman très dense, chronique menée tambour battant de la sanglante révolte des esclaves de Saint-Domingue, suivie de l'exil des colons à Santiago de Cuba. Suivant Ti Noël, victime de l’époque, Carpentier nous relate le quotidien des plantations, la mutinerie des Noirs menés par le Mandingue Mackandal, manchot rebelle qui marronne et qui, devenu puissance vaudou, empoisonne bétail et gens ; à ces croyances africaines (inspirant le « réalisme magique » de l’auteur) s’opposent celles des propriétaires, chrétiens qui refusent les idées nouvelles d’égalité humaine. Puis c’est Pauline Bonaparte, épouse du général Leclerc, beau-frère de Napoléon, ensuite le règne du roi Henri Christophe dans son palais de Sans-Souci, dans sa forteresse au mortier lié de sang de taureaux sacrifiés, indépendance haïtienne aussi dure pour les petits que la servitude précédente, avant que les mulâtres ne prennent le pouvoir et que la servitude ne se renouvelle. Une page d’histoire, brillamment étudiée et rendue : l’influence de la révolution française dans la région (que Carpentier reprendra dans Le Siècle des lumières) − un éblouissant raccourci du cours de la misère humaine dans les Caraïbes. Avec un vocabulaire fort riche, et des scènes anthologiques (comme l’épidémie, l’ambiance de fin du monde chez les colons, la mort d’Henri Christophe).
« Les pluies obéissaient aux conjurations des sages et lors des fêtes de la circoncision, quand les adolescentes dansaient, les cuisses laquées de sang, on frappait des pierres sonores qui faisaient une musique comme de grandes cascades assagies. »
« Mais avec l'âge M. Lenormand de Mézy était devenu maniaque et buvait. Une érotomanie perpétuelle lui faisait guetter à toute heure les jeunes esclaves, dont l'odeur l'excitait. »
« Soudain, Pauline se mit à marcher par la maison de façon étrange, évitant de mettre les pieds sur l'intersection des dalles qui, c'était notoire, ne formaient des carrés que sur l'instigation impie des francs-maçons désireux de voir les hommes fouler la croix à toute heure du jour. »
« Il fallait épuiser le vin, exténuer la chair, être de retour du plaisir avant qu'une catastrophe eût enlevé toute possibilité de jouissance. »
« Çà et là se dressaient des pans de murs, telles de grosses lettres brisées. »
« Il comprenait à présent que l'homme ne sait jamais pour qui il souffre ou espère. Il souffre, et il espère et il travaille pour des gens qu'il ne connaîtra jamais, qui à leur tour souffriront, espéreront, travailleront pour d'autres qui ne seront pas heureux non plus, car l'homme poursuit toujours un bonheur situé au-delà de ce qui lui est donné en partage. Mais la grandeur de l'homme consiste précisément à vouloir améliorer le monde, à s'imposer des tâches. Dans le royaume des cieux il n'y a pas de grandeur à conquérir, car tout y est hiérarchie établie, existence sans terme, impossibilité de sacrifice, repos, délices. Voilà pourquoi, écrasé par la douleur et les tâches, beau dans sa misère, capable d'amour au milieu des malheurs, l'homme ne peut trouver sa grandeur, sa plus haute mesure que dans le Royaume de ce Monde. »
Avec une pensée pour la terrible histoire d’Haïti, sempiternellement recommencée…
\Mots-clés : #ancienregime #colonisation #esclavage #historique #insurrection #misere #regimeautoritaire
- le Mar 26 Juil - 13:31
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Alejo Carpentier
- Réponses: 16
- Vues: 1726
Vladimir Korolenko
Le Rêve de Makar
Makar le malchanceux est un pauvre hère qui vit au petit village de Tchalgane dans la taïga de Sibérie, chez les « sales iakoutes » et les Tartares.
« Makar travaillait comme un forçat, vivait misérablement, souffrant de la faim et du froid. En dehors du souci de sa galette grossière et de son thé, avait-il d’autres pensées ? Oui, il en avait. »
Quand il est ivre de mauvaise vodka, il s’apitoie sur son triste sort et rêve d’une montagne éloignée de tous, où il pourrait « sauver son âme ».
Il meurt, est rejoint par son compère le pope mort lui-même voilà quatre ans de cela, qui le guide interminablement vers le grand Toyone (seigneur, maître : Dieu) pour qu’il le juge. Ils laissent sur place les voleurs de chevaux, entr’autres âmes en peine cheminant comme eux.
« Et il s’aperçut que dans la plaine, il dépassait bien d’autres cavaliers. Tous allaient du même train que le premier, les chevaux volaient comme des oiseaux, les hommes étaient couverts de sueur et pourtant Makar les dépassait. À chaque pas, il en laissait un derrière lui. »
Makar comparaît devant Dieu, et met éloquemment le fardeau de sa misère dans la balance, en contrepoids de ses péchés.
Un conte humaniste.
\Mots-clés : #contemythe #misere
- le Lun 25 Avr - 12:46
- Rechercher dans: Écrivains d'Europe centrale et orientale
- Sujet: Vladimir Korolenko
- Réponses: 2
- Vues: 624
Lyonel Trouillot
Kannjawou
Le narrateur tient son journal, lit des romans (et veut en écrire) dans la rue de l’Enterrement, qui tient son nom du cimetière proche. Il raconte le quartier miséreux, et surtout le pire fléau, les forces d’Occupation des marines (1915-1934, puis l’actuelle, la « molle »). Il parle de ses proches, de Popol son jeune frère (ils sont orphelins depuis l’enfance), de Sophonie et Joëlle, les deux sœurs filles d’Anselme, paysan dépossédé de ses terres devenu tireur de cartes − « les deux femmes que j’aime » sans se déclarer ; la première est serveuse dans un bar dansant :
« Le “Kannjawou”. C’est un beau nom qui veut dire une grosse fête. »
Regard acerbe sur les expatriés qui y forment un clan, dont « la petite brune », « oie et autruche ».
Il rapporte aussi les conversations de man Jeanne qui évoque le passé, Wodné le militant qui se prépare sempiternellement à ce que les conditions soient réunies, le petit professeur qui promeut la lecture chez les jeunes laissés à eux-mêmes, Halefort le voleur de cercueils.
Un beau matériau, de l’amertume, de la rancœur, des bons sentiments, le ton est peut-être un peu maladroit malgré d'attachants personnages.
« Des promesses de kannjawou, en veux-tu, en voilà. Car chacun a droit à sa fête. Il suffit de prendre à la vie seulement la part qui te revient. Et d’inviter l’autre à la fête. Il suffirait. »
\Mots-clés : #contemporain #misere #viequotidienne
- le Dim 27 Mar - 12:25
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Lyonel Trouillot
- Réponses: 6
- Vues: 775
Akiyuki Nosaka
Les Pornographes
Dans l’Osaka des années soixante, Subuyan se débrouille avec Banteki et bientôt d’autres comparses dans les commerce et industrie pornographiques. C’est un panorama apparemment exhaustif de ce milieu interlope, qui les mène jusqu’à la réalisation de films et au proxénétisme, avec notamment Cancrelat, qui mérite bien son surnom, et Lagratte, écrivain érotique inspiré par sa mère devenue frigide en se tenant immobile pendant qu’on la besognait à côté de son petit enfant… Combines et professionnalisme se mêlent comiquement dans l’activité débordante de ces acolytes hauts en couleur, rendus au quotidien dans leur misère débrouillarde, subsistant aux dépens de vicieux notables, sans autre perspective que d’aller en prison.
Le récit suit un rythme très vif (dans tous les sens du terme), les picaresques péripéties s’enchaînent sans pause. C’est leste, truculent et même cru, mais c’est aussi la découverte d'une population dans le besoin, sa gouaille rendue avec humour – avec des flashs d’images terribles, comme celle où Subuyan perdit sa mère dans un bombardement de Kôbe, cuite à l’étouffée (le souvenir de la guerre reste omniprésent)…
Outre les fantasmes particuliers à l’imaginaire japonais (notamment les lycéennes en uniforme), on découvre de curieuses caractéristiques de la société nipponne, comme le recours d’entreprises à des exhibitions pornographiques sous-traitées (bien que la pornographie et la prostitution soient illégales et poursuivies par la police).
« En somme, jugeait-elle, faites miroiter un tant soit peu les plaisirs de la vie aux filles d’aujourd’hui et vous verrez, ce ne sont pas les scrupules qui les étouffent. »
Il y a de grandes scènes à la fois cocasses et sordides, comme la comparaison de leur première expérience onaniste, la rencontre scabreuse d’homosexuels et de lycéennes « au bar gay Cocteau », ou encore le cours de pelotage dans le métro…
« − Oui, oh, j’ai un rancard pour faire guide de presse.
− Guide de presse ?!
− Ouais, aux heures où y a presse dans le train, aux heures de pointe, quoi. J’ai un gars qui rêve de se faire prendre en sandwich entre deux minettes. »
Les pornographes sont épris de réalisme, et l’auteur aussi, même s’ils se réclament de l’humanisme !
« T’en as dont le truc est en berne, tout ratatiné, que moi, grâce à mes photos spéciales et mes bouquins, je les aide à redresser la tête encore une fois. Voilà, je rends service, par le fait. Je les compte plus, ceux qui sont venus me remercier jusqu’à maintenant, et ceux qui n’attendaient que ça, tiens, les larmes aux yeux, de se confier à moi. Crois-moi, c’est un métier qui t’assure une place au paradis, ça. »
En parallèle, Subuyan s’éprend de sa belle-fille Keiko (l’inceste revient souvent), est en proie à des problèmes d’érection…
Banteki le photographe se révèle un cinéaste doué, dont le travail s’apparente bientôt plus à l’érotisme suggestif qu’à la pornographie.
Yasuko, qui joue les pucelles pour clients amateurs de virginité, éduquée depuis toute jeune par sa mère maquerelle, envisage de poursuivre en formant sa propre fille.
« Soit talent maternel de pédagogue, soit privilège inné du beau sexe, moins de six mois suffirent à Yasuko pour maîtriser l’art de feindre tant la pure ingénue que la saute-au-paf allumée. »
« D’après elle, on devrait finir par obtenir la femme accomplie avec la petite-fille, ma fille à moi, donc. Ma mère aura été l’exploratrice, moi la pionnière, si vous voulez, et ce ne serait qu’à la génération suivante, la troisième donc, qu’on pourrait vraiment récolter les fruits. »
L’aboutissement de leur questionnement du sexe sera l’organisation de partouzes…
Premier roman, qui d’ailleurs le rendit célèbre, Les Pornographes est évidemment nourri de l’expérience de Nosaka. Sa mère mourut peu après sa naissance, et sa mère adoptive fut tuée dans un bombardement alors qu’il avait quinze ans. Il survécut de larcins et magouilles diverses jusqu’à être envoyé en maison de correction.
Une sorte de Steinbeck érotomane, de Cossery sans inhibitions ni limites !
\Mots-clés : #erotisme #misere #sexualité
- le Mar 21 Déc - 11:23
- Rechercher dans: Écrivains d'Asie
- Sujet: Akiyuki Nosaka
- Réponses: 28
- Vues: 1903
Bernard Malamud
Le Tonneau magique
Treize nouvelles sur les déboires de petits juifs, généralement à New York (ou en Italie), souvent réfugiés polonais après la Seconde Guerre mondiale, et qui cherchent un peu de bonheur.
Les Sept Premières Années : Sobel est amoureux de la fille du cordonnier Feld pour qui il travaille, mais ce dernier rêve d’un beau-fils plus prospère.
Les Pleureurs : Kessler, un ancien mireur d’œufs, est expulsé par son "marchand de sommeil" ; il pleure sur son existence (il a abandonné femme et enfants), et son propriétaire se joint à lui.
La Fille de mes rêves : auto-autodafé de manuscrits…
L’Ange Levine : Manischevitz, un infortuné tailleur, hésite à croire en un ange gardien, juif noir de Harlem.
Attention à la clé : un pauvre étudiant aves femme et enfant cherche un logement à Rome.
Prenez pitié : Rosen, un ancien représentant malade, s’efforce de donner de l’aide à une jeune veuve dans le besoin avec deux enfants, jusqu’à sacrifier sa vie.
La Prison : piégé, un ancien délinquant tente de prévenir une délinquante en herbe.
La Dame du lac : Levin, un ancien chef de rayon juif américain, profite d’un petit héritage pour visiter l’Italie, où il rencontre Isabella del Dongo sur son île du lac de Streza – croit-il −, et ment pour rehausser sa condition.
Lectures d’été : George a abandonné l’école, et reprend les livres pour se conformer à ce qu’il prétend faire.
La Facture : Willy Schlegel, concierge, achète à crédit dans la petite boutique d’en face, et ne peut pas rembourser.
Le Dernier Mohican : Arthur Fidelman, un étudiant du Bronx, arrive à Rome pour écrire une étude critique sur Giotto, et d’emblée Shimon Susskind, un réfugié, juif comme lui, le sollicite en quémandant son vieux costume. Le premier chapitre que Fidelman a écrit lui est dérobé, et il suspecte Susskind, qu’il cherche longuement, ne parvenant plus à poursuivre son ouvrage.
Le Prêt : Kobotsky réapparaît chez Lieb le boulanger. Amis lorsqu’ils étaient jeunes immigrants, une question d’argent les sépare jusque dans leurs misères.
Le Tonneau magique : Léo Finkle, un étudiant rabbinique de l’Université de Yeshivah de New York, passe par un marieur pour rencontrer une future épouse.
« Il lui fit remarquer en passant que la fonction du marieur était antique et honorable, hautement approuvée par la communauté juive, car elle rendait le nécessaire pratique sans entraver la joie. »
\Mots-clés : #communautejuive #misere #nouvelle #viequotidienne
- le Mer 15 Déc - 12:31
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Bernard Malamud
- Réponses: 46
- Vues: 3344
Antonio Lobo Antunes
Mémoire d’éléphant
La voix intérieure d’un psychiatre interroge :
« Quand me suis-je gouré ? »
Surtout, il se rappelle. Vétéran de la guerre d’Angola, issu de la catholique bourgeoisie lisboète, amer de la dictature comme toujours actuelle de Salazar, récemment séparé de sa femme et de ses deux filles, écrivain contrarié, il partage plusieurs traits biographiques avec Antunes.
Occasionnellement narrateur, il observe les autres et aboutit à un navrant constat clinique de l’état de ses patients et de la société.
« Aux Urgences, les internés en pyjama semblaient flotter dans la clarté des fenêtres comme des voyageurs sous-marins entre deux eaux, aux gestes ralentis par le poids de tonnes de médicaments. […]
Ici, pensa le médecin, vient se déverser l’ultime misère, la solitude absolue, ce que nous ne pouvons plus supporter de nous-mêmes, nos sentiments les plus cachés et les plus honteux, ce que nous appelons folie et qui en fin de compte est notre folie et dont nous nous protégeons en l’étiquetant, en la compressant entre des grilles, en la bourrant de comprimés et de gouttes pour qu’elle continue à exister, en lui accordant une permission de sortie à la fin de la semaine et en la conduisant vers une "normalité" qui probablement consiste seulement à empailler les gens vivants. »
Premier roman aux mêmes thématiques que Le Cul de Judas, son second roman, que j’ai malheureusement lu avant celui-ci.
C’est déjà son style baroque qui enfile les métaphores dans de longues phrases (il évoque judicieusement Fellini dans le texte, et j’ai pensé à Gadda), ainsi que de nombreuses références historiques, picturales et littéraires, mais aussi musicales et cinématographiques.
« Dans la nuit de Lisbonne on a l’impression d’habiter un roman d’Eugène Sue avec un passage sur le Tage, où la rue Barão-de-Sabrosa est le petit ruban décoloré qui marque la page lue, malgré les toits où fleurissent des plantations d’antennes de télévision semblables à des arbustes de Miró. »
Le rendu du flux de conscience dans ce roman contenu en une journée m’a ramentu l’Ulysse de Joyce.
Sa sombre détresse dans un quotidien de laideur, son angoisse de la décrépitude, sa solitude désespérée prennent toute leur démesure célinienne au chapitre 6, à partir de la grotesque et grinçante scène de son sordide dépucelage par une prostituée ; j’ai aussi pensé à Lowry lorsque, désolé par la perte de sa femme, son accablement l’enfonce dans une errance hallucinée.
« Au sommet d’une espèce de parc Édouard-VII en réduction bordé de palmiers hémophiles dont les branches grinçaient des protestations de tiroirs récalcitrants, d’hôtels sortis de films de Visconti, habités par des personnages de Hitchcock et par des gardiens de parking manchots, aux yeux affamés cachés sous les visières de leurs casquettes comme des oiseaux avides pris dans le filet plissé des sourcils, l’édifice du Casino ressemblait à un grand transatlantique moche, décoré de guirlandes de lumières, parmi des villas et des arbres, battu par les vagues de musique du Wonder Bar, par les cris de mouettes enrouées des croupiers et par l’énorme silence de la nuit maritime autour de laquelle montait une dense odeur d’eau de Cologne et de menstrues de caniche. »
Un livre marquant sur la folie d'une société traumatisée...
\Mots-clés : #guerre #misere #pathologie #regimeautoritaire #social #solitude
- le Mer 8 Déc - 12:14
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Antonio Lobo Antunes
- Réponses: 41
- Vues: 6281
Mario Vargas Llosa
Conversation à La Catedral
Titre original: Conversación en la Catedral, 1969, 610 pages environ.
Lu dans la seconde traduction, d'Albert Bensoussan et Anne-Marie Casès, Gallimard collection Du monde entier, 2015.
Au début un journaliste rentre chez lui, voit sa femme éplorée, on a subtilisé de force leur chien; le chroniqueur, Santiago Zavala, se rend à la fourrière canine afin de le récupérer (amener les chiens divagants à la fourrière rapporte quelques soles, et, quand ils ne divaguent pas...).
Là, après quelques saynètes et propos crus, Zavala tombe sur Ambrosio, ex-chauffeur de son père, et, sur proposition du premier et indication du dernier, ils vont se jeter quelques bières dans un boui-boui nommé La Catedral.
Les 600 pages sont la teneur de cette conversation, par séquences voire chapitres entiers très embrouillée, mâtinée de flashes-back, de réminiscences, d'évocations, de soliloques, de dialogues entremêlés, de bâtons rompus, bien que plus l'on avance, plus le propos soit formellement clarifié.
J'avais lâché cet embrouillamini indigeste et long il y a une quinzaine d'années, dans l'ancienne traduction.
Aujourd'hui c'est passé crème, le style narratif (parlé mais pas nécessairement ordonné) nécessite un peu d'accoutumance et le nombre des caractères ou personnages fait qu'on peut conseiller de le lire avec une relative célérité, du moins une linéarité.
In fine j'ai beaucoup apprécié cet apparent magma d'écriture faussement désinvolte, comme des micros qui captent toutes les bribes de conversations éparses, fissent-elles sens ou non, doublés de micros plus sophistiqués qui saisissent ce qui traverse les esprits, ce qui passe par les têtes:
N'est-ce pas plus proche de ce qui se passe dans la vie ?
Rendu on ne peut plus original donc, qui "classe" l'ouvrage dans un courant littéraire exploratoire. Techniquement, le rendu de ces interférences permanentes, de ces coqs-à-l'âne, couplé à la narration de style parlé permet beaucoup de choses: La légèreté sur un sujet et une époque qui réunissent pourtant tous les ingrédients pour que ce soit bien pesant, l'attention pseudo-détournée du lecteur, qui du coup en redemande à la lecture d'une saynète, sans trop savoir à quel moment du bouquin il va trouver la suite (ou ce qui précédait, via les flashes-back en nombre !).
Le Pérou, époque dictature d'Odría, il y avait tout pour faire du livre un mélo, ce qu'il n'est pas. Vargas Llosa réalise un petit coup de maître en réussissant une fresque où rien ne semble manquer excepté la vie rurale. Mais nous avons des destins, certains humbles, d'autres de premier plan, la violence, la corruption, la répression, les "arrangements", les oligarques, les révoltés, l'intérieur des familles, les maîtres et les servants, la prostitution - de luxe ou de caniveau.
Et même une certaine chronologie de ces temps particulièrement troublés. Les mondes des casseurs, des petites frappes, des indics, du journalisme, de la nuit sont particulièrement gratinés, le tout servi dans un bouillonnement où mijotent les entrelacs des histoires.
Certains personnages évoqués sont réels, Odría, Bustamante par ex. (mais la parole ne leur ait jamais laissée directement), la toponymie aussi, et les évènements narrés coïncident avec exactitude à l'histoire péruvienne de ces années-là.
Le personnage de Santiago Zavala a du Mario Vargas Llosa en lui, on dira qu'il colle avec sa bio (quant au personnage d'Amalia, il est remarquablement troussé, à mon humble avis).
Ce curieux kaléidoscope est sans aucun doute un vrai grand livre, à placer -à mon humble avis, toujours- parmi les ouvrages incontournables de la littérature latino-américaine de la seconde moitié du XXème siècle.
Un exemple de superposition de plusieurs situations, plusieurs dialogues (deux, en l'occurence); on note le simple "dit" pour informer le lecteur de l'auteur de la prise de parole.
Jamais ce "dit", comme un invariable, n'est remplacé par un des équivalents habituels lorsqu'on écrit des dialogues, du type annonça, interféra, trancha, cria, coupa, affirma, etc.
Chapitre VII, Partie 1 a écrit:
- Fondamentalement, deux choses, dit maître Ferro. Primo, préserver l'unité de l'équipe qui a pris le pouvoir. Deuxio, poursuivre le nettoyage d'une main de fer. Universités, syndicats, administration.
Ensuite élections, et au travail pour le pays.
- Ce que j'aurais aimé être dans la vie, petit ? dit Ambrosio. Riche, pour sûr.
- Alors tu pars pour Lima demain, dit Trifulcio. Et pour faire quoi ?
- Et vous c'est être heureux, petit ? dit Ambrosio. Évidemment que moi aussi, sauf que riche et heureux, c'est la même chose.
- C'est une question d'emprunts et de crédits, dit Don Fermín. Les États-Unis sont disposés à aider un gouvernement d'ordre, c'est pour cela qu'ils ont soutenu la révolution. Maintenant ils veulent des élections et il faut leur faire plaisir.
- Pour chercher du travail là-bas, dit Ambrosio. Dans la capitale on gagne plus.
- Les gringos sont formalistes, il faut les comprendre, dit Emilio Arévalo. Ils sont ravis d'avoir le général et demandent seulement qu'on observe les formes démocratiques. Qu'Odría soit élu, ils nous ouvriront les bras et nous donneront tous les crédits nécessaires.
- Et tu fais chauffeur depuis longtemps ? dit Trifulcio.
- Mais avant tout il faut impulser le Front patriotique national, ou Mouvement restaurateur, ou comme on voudra l'appeler, dit maître Ferro. Pour se faire, le programme est fondamental et c'est pourquoi j'insiste tant.
- Deux ans comme professionnel, dit Ambrosio. J'ai commencé comme assistant, en conduisant de temps en temps. Après j'ai été camionneur et jusqu'à maintenant chauffeur de bus, par ici, dans les districts.
- Un programme nationaliste et patriotique, qui regroupe toutes les forces vivves, dit Emilio Arévalo. Industrie, commerce, employés, agriculteurs. S'inspirant d'idées simples mais efficaces.
- Alors comme ça t'es un gars sérieux, un travailleur, dit Trifulcio. Elle avait raison Tomasa de pas vouloir qu'on te voie avec moi. Tu crois que tu vas trouver du travail à Lima ?
- Il nous faut quelque chose qui rappelle l'excellente formule du maréchal Benavides, dit maître Ferro. Ordre, Paix et Travail. J'ai pensé à Santé, Éducation, Travail. Qu'en pensez-vous ?
- Vous vous rappelez Túmula la laitière, la fille qu'elle avait ? dit Ambrosio. Elle s'est mariée avec le fils du Vautour. Vous vous rappelez le Vautour ? C'est moi qui avait aidé son fils à enlever la petite.
- Naturellement, la candidature du général doit être lancée en grandes pompes, dit Emilio Arévalo. Tous les secteurs doivent s'y rallier de façon spontanée.
- Le Vautour, le prêteur sur gages, celui qu'a été maire ? dit Trifulcio. Je me le rappelle, oui.
- Ils s'y rallieront, don Emilio, dit le colonel Espina. Le général est de jour en jour plus populaire. Il n'a fallu que quelques mois aux gens pour constater la tranquillité qu'il y a maintenant et le chaos qu'était le pays avec les apristes et les communistes lâchés dans l'arène.
- Le fils du vautour est au gouvernement, il est devenu important, dit Ambrosio. Peut-être bien qu'il m'aidera à trouver du travail à Lima.
\Mots-clés : #corruption #criminalite #famille #insurrection #medias #misere #politique #prostitution #regimeautoritaire #relationdecouple #temoignage #violence #xxesiecle
- le Lun 1 Nov - 10:28
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Mario Vargas Llosa
- Réponses: 36
- Vues: 3814
Page 1 sur 2 • 1, 2 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages