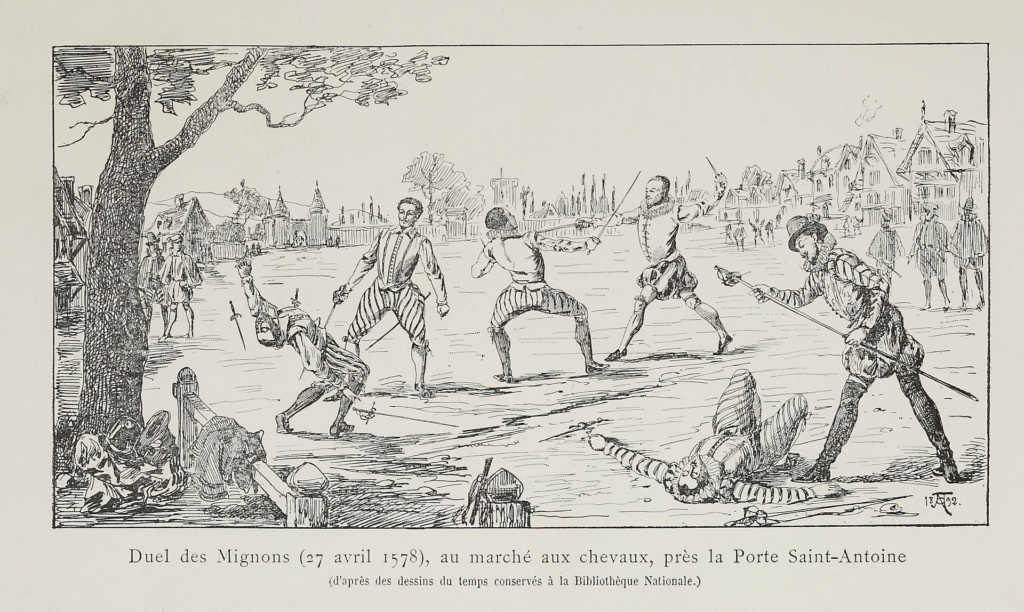La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 12:41
325 résultats trouvés pour historique
Roger Vercel
Capitaine Conan
L’armistice de la Première Guerre mondiale est signé, mais la guerre continue pour certaines troupes en Bulgarie.
Le lieutenant Norbert (narrateur et personnage inspiré de Vercel lui-même) est nommé avocat de préventionnaires, puis commissaire-rapporteur près le Conseil de guerre. Il entre en conflit avec le lieutenant Conan, commandant un valeureux corps franc, qui protège ses hommes qui ont brigandé.
« Rester couché huit jours dans la neige, dans la pénombre grasse de toiles huilées, c’est un hivernage qui étreint durement l’esprit. On a guetté la montée du froid dans ses membres comme l’invasion d’une maladie, on a trop écouté le silence, ce grand silence mat de la neige, ce silence clos, étouffé, si différent des autres silences campagnards, profonds, béants, qu’on sent faits pour amplifier, de toute la résonance de leur vide, les bruits et les voix qui y tombent. Pour avoir trop longtemps regardé un pauvre vieil arbre tors, disputant une à une ses dernières feuilles au vent, on a soudain pensé que les camarades tués étaient morts, qu’on était, soi, devenu homme sans avoir eu de jeunesse, que pour la cinquième fois, on ne serait point à la maison, au coin du feu, à Noël… »
« — C’est le bon gars, mais tu peux le laisser coucher dans l’église sans danger pour le Saint-Esprit !… Il m’a pourtant ramené un Bul, une fois, avec trois paires de chaussettes qu’il était parti laver au torrent de la cote 978… Il ramassait son linge, quand un Bul s’amène, un qui en avait marre, un égaré volontaire… « Tiens, que se dit Rouzic, v’là un Grec en balade. » Il lui fait un sourire, l’autre lui tend son flingue. Rouzic qui est poli, l’examine, fait jouer la batterie : « Bono, bono fusillof grécose »… Pour ne pas être en reste, il passe son lebel au Bulgare qui fait une bille, tu te rends compte !… Comme il n’avait plus rien à faire là, mon Rouzic flanque son linge dans le seau de toile, reprend sa pétoire, et au revoir !… Mais l’autre le suit, déboucle ses cartouchières en grimpant la côte, et veut à toute force coller son équipement à mon Rouzic avec le flingue, la baïonnette, tout le bazar ! Dame, il s’est fait rappeler aux convenances : « T’en as vu souvent des larbins faits comme moi ? que Rouzic lui a demandé. Si on ne vous apprend pas à porter votre barda, dans l’armée grecque, c’est la fin de tout ! » Pas vrai, Rouzic, que tu lui as appris les belles manières à ton Grec du torrent ?
L’ordonnance qui vient de rentrer répond placidement :
— J’pouvais-t-i’savoir, tout comme, que c’était pas un Grec ? »
« — Oui… Jusqu’à la prochaine. Je suis bien tranquille, on remettra ça !…
Et comme je me récriais :
— Tu cries, comme les gens à la porte des cimetières, le jour de l’enterrement, que tu n’oublieras jamais. Tu feras comme eux, t’oublieras !… T’as déjà commencé à oublier… Je me le suis souvent dit : pour en avoir marre, mais là marre pour de bon, pour tout le temps, ben mon vieux, il n’y a que les morts !… »
On parle de démobilisation, et c’est là qu’on peut mesurer la différence entre soldats et guerriers, entre l’armée et les corps francs – et la question de l’après-guerre :
« — Qu’est-ce qu’on va en faire, dis donc, des types qui ne sont bons qu’à se battre, et qui s’en sont aperçus ? »
De Scève, un officier de carrière, fera le nécessaire pour qu’un jeune déserteur à l’ennemi, un pauvre lâche, soit condamné à mort.
Puis Conan, nommé capitaine, est mis en cause à son tour ; Norbert quitte la « Justice militaire », impuissant à le défendre malgré ses états de service.
« Il y a longtemps que j’ai compris qu’ils avaient honte de nous, qu’ils ne savaient plus où nous cacher ! Moi et mes gars, on l’a faite la guerre, on l’a gagnée ! C’est nous ! Moi et ma poignée de types, on a fait trembler des armées, t’entends, des armées qui nous voyaient partout, qui ne pensaient plus qu’à nous, qui n’avaient peur que de nous dès que s’allumait la première fusée !… Tuer un type, tout le monde pouvait le faire, mais, en le tuant, loger la peur dans le crâne de dix mille autres, ça c’était notre boulot ! Pour ça, fallait y aller au couteau, comprends-tu ? C’est le couteau qui a gagné la guerre, pas le canon ! Un poilu qui tiendrait contre un train blindé lâchera à la seule idée que des types s’amènent avec un lingue… On est peut-être trois mille, pas plus, à s’en être servi, sur tous les fronts. C’est ces trois mille-là les vainqueurs, les vrais ! Les autres n’avaient qu’à ramasser, derrière !… Et maintenant, ces salauds qui nous les ont distribués, larges comme ça, nos couteaux de nettoyeurs, nous crient : "Cachez ça ! Ce n’est pas une arme française, la belle épée nickelée de nos pères !… Et puis, cachez vos mains avec, vos sales mains qui ont barboté dans le sang, alors que nous, on avait des gants pour pointer nos télémètres !… Et pendant que vous y êtes, cachez-vous aussi, avec vos gueules et vos souvenirs d’assassins ! On ne peut pas vous montrer, voyons ! »
En soutien aux Roumains sur le Dniester, De Scève, Norbert, Conan et leurs hommes repoussent les Rouges.
« Un cri, une clameur jaillit de là-bas… La clameur d’assaut, le hurlement que l’homme tient en réserve dans le tréfonds de son ventre et qu’il reconnaît, sans l’avoir jamais ni entendu, ni poussé… Le cri de guerre rouge m’a dressé sur les mains : une balle me rabat. Elle s’est piquée à deux doigts de mes yeux, elle m’a lancé de la boue sur la joue, des gouttelettes de boue qui me démangent comme de l’urticaire, et qu’il faut, avant tout, que j’essuie…
Et, sur le fleuve, la rumeur monte, ardente, touffue ! J’entends des cris se tordre dans des gueules noires, d’autres qui se cassent par le bout, d’autres qui se prolongent, horizontaux, sans fléchir, puis se tranchent net, comme une gorge… La pluie a cessé, et l’air froid du matin détaille affreusement ce sabbat. Pas une huée ne se perd, chacune s’enfonce dans l’oreille, avec son sens précis d’assassinat, le couteau, l’élan bas de la baïonnette, le coup de crosse, pas celui du théâtre où l’on empoigne à deux mains le fusil par le canon, pour le brandir au-dessus de sa tête, mais le vrai, l’arme saisie à la poignée et à la grenadière, levée à la hauteur de l’oreille, et le coup qui part oblique, en vache, défonce, fait sauter les dents sous la plaque de couche !… »
« Et ça se passera exactement sept mois et douze jours après l’armistice !… Ils me font doucement rigoler ceux qui ont tant gémi sur le sort du dernier tué de la guerre, celui de la minute d’avant le « cessez-le-feu ! » Comme s’il pouvait y avoir jamais un dernier tué !… »
Condamnés et préventionnaires seront réhabilités.
Ce témoignage fort romancé vaut aussi par sa langue, notamment son rendu de la gouaille populaire. L’article Wikipédia, très détaillé mais incomplet et présentant des inexactitudes, manque notamment à donner le sens de falot, qui était le conseil de guerre dans l’argot militaire.
Conan était Breton, mercier dans le civil…
\Mots-clés : #historique #premiereguerre #solidarite #violence
- le Jeu 25 Avr - 12:20
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Roger Vercel
- Réponses: 2
- Vues: 33
Mathias Enard
Déserter
Deux récits racontés alternativement, sans jamais vraiment se rejoindre :
D’une part, un homme déserte le camp des vainqueurs lors d’une guerre civile (en Yougoslavie ?), et regagne la masure écartée de son père ; il est reconnu comme ancien voisin par une jeune femme, qui fuit elle aussi, et sera foudroyée avec son âne.
« Il observe la catastrophe, elle sent peut-être ses yeux sur son corps, il se rappelle si bien la violence qu’il a fait subir qu’aucune surprise ne déforme son visage, aucune pitié, aucune compassion, il voit la jambe brisée et noire, il voit le bois enfoncé dans la chair, il voit l’immense ecchymose sur les côtes, la chemise déchirée, la peau blanche zébrée de peine [… »
D'autre part, Irina, historienne des mathématiques, évoque (notamment la veille d’un colloque commémoratif à Berlin le 10 septembre 2001) la vie de ses parents, Paul Heudeber et Maja Scharnhorst, respectivement mathématicien communiste célèbre en Allemagne de l’Est, ancien résistant antifasciste qui a été déporté à Buchenwald (« le camp sur l’Ettersberg », là où se promenaient Goethe et Schiller) et elle femme politique de l’Ouest, militante des droits des femmes, également ancienne résistante ; pas mariés, ils vécurent généralement éloignés l’un de l’autre, l’un en RDA, l’autre en RFA, séparés par le Mur.
« Pour lui les mathématiques étaient un sens, au même titre que la vue ou l’ouïe, et donc une façon de percevoir la nature. »
« Après 1991, il ne cachait plus son désespoir politique. La fin de la RDA, mais aussi l’explosion yougoslave le rendaient fou de douleur. L’humanité me semble, en gagnant le capitalisme, avoir perdu l’humanité. Partout dans le monde, disait-il. Guerre, violence et injustice. »
Le déserteur secourt la femme et l’emmène dans la montagne, vers la frontière au nord, dans la forteresse en ruine de la Roche Noire ; on apprend qu’elle a été victime de sévices de la part des troupes auxquelles le déserteur appartenait. Lui, tortionnaire croyant, est las de la guerre.
Paul a été rendu célèbre par Les Conjectures de Buchenwald :
« Robert Kant soutenait que l’originalité du texte de Paul, outre son côté indiscutablement littéraire, ses considérations sur la Révolution, ses passages obscurs, sa poésie si sombre, provient de sa radicalité scientifique : de ce croisement, au fond du XXe siècle, du désespoir historique avec l’espérance mathématique. »
À Weimar, Irina consulte le dossier établi par la Stasi sur sa mère, tandis que la Russie bombarde l’Ukraine.
« En 1942 le directeur des Musées de Weimar, en accord avec le maire, décide d’organiser la protection des collections prestigieuses des différents lieux de souvenir de la ville, en cas de bombardement aérien. Musée d’archéologie, Musée des Beaux-Arts, Maisons de Goethe et de Schiller. Il a l’idée de commander des caisses en bois au camp de concentration de Buchenwald, là-haut dans la forêt, qui possède un atelier de menuiserie et toute une hêtraie à disposition. Quarante grandes malles de bois pour emballer des meubles et des livres de la Maison de Schiller, de la Maison de Goethe et des collections du Musée d’histoire ancienne.
Le directeur souhaite aussi passer commande à Buchenwald des copies des meubles de la chambre du dernier étage de la Maison de Schiller : le lit de mort de Schiller, le bureau sur lequel il écrivait, l’épinette sur laquelle il jouait des danses de Haydn, ainsi qu’un fauteuil par étage. Tous ces meubles furent chargés dans un camion et confiés aux SS pour qu’ils en établissent des copies. Le bureau de Schiller et les danses de Haydn furent donc enfermés à Buchenwald et des détenus se mirent au travail pour les copier. Il fallut trouver des prisonniers non seulement ébénistes, mais aussi un facteur de piano pour l’épinette – il y avait le monde entier à Buchenwald, et les copies furent parfaites. »
Un intellectuel utopiste, un jeune rural qui fuit la guerre, avec peut-être pour point commun d’avoir été trompés dans leurs engagements…
Érudition certes (en Histoire, voire en mathématiques : Nasiruddin Tusi, etc.), mais bien amenée, et servie par un style exigeant (avec un peu trop de pathos à mes yeux). Des réflexions aussi, parfois surprenantes, comme en politique.
\Mots-clés : #guerre #historique #politique #science #violence #xxesiecle
- le Mar 23 Avr - 12:13
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Mathias Enard
- Réponses: 103
- Vues: 7967
Patrick Leigh Fermor
Un temps pour se taire
Témoignage des expériences monacales de l’auteur, d’abord à l’abbaye bénédictine de Saint-Wandrille, plus brièvement Solesmes et la Grande Trappe cistercienne, et enfin les monastères rupestres de Cappadoce.
Leigh Fermor offre des rappels historiques, analyse la vie monastique contemplative, sans oublier le rôle de « gardiens de la littérature, des classiques, de l’érudition et des humanités », et le plain-chant grégorien. Il retrace aussi la psychologie à l’œuvre tant dans son expérience personnelle que chez les moines, et évoque Huysmans.
« Le chant alterné, issu des stalles, continuait d’ériger son invisible architecture musicale : un échafaudage qui projetait des colonnes de plain-chant, complétées par une antienne du chœur qui les coiffait comme un toit. »
« On tend en effet à voir la vie monastique comme un phénomène ayant toujours existé, puis à l’écarter de l’esprit sans l’analyser ni le commenter davantage ; c’est seulement en vivant quelque temps dans un monastère qu’on peut commencer à saisir les différences vertigineuses qui le séparent de nos vies ordinaires. Les deux modes de vie ne partagent pas un seul attribut ; non seulement les pensées, les ambitions, les bruits, la lumière, le temps et l’humeur entourant les occupants du cloître sont-ils tout à fait différents de ceux que nous connaissons, mais d’une manière étrange, ils semblent en être l’exact contraire. La période de récession des critères normaux et celle où le nouvel univers devient réalité est longue et d’abord intensément douloureuse. »
« Si mes premiers jours à l’abbaye avaient été une période de dépression, le processus de désaccoutumance, après mon départ, fut dix fois pire. L’abbaye avait d’abord été un cimetière ; le monde extérieur sembla ensuite, par contraste, un enfer de bruit et de vulgarité entièrement peuplé de goujats, de catins et de forbans. »
« Mais la défection, après la fin du long noviciat et la prise des vœux définitifs, est très exceptionnelle. Les monastères français sont un désert pour la chronique scandaleuse hebdomadaire qu’alimentent si libéralement les membres des clergés non soumis au célibat des divers autres pays. »
\Mots-clés : #historique #musique #religion #spiritualité #temoignage #traditions
- le Mar 16 Avr - 12:10
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Patrick Leigh Fermor
- Réponses: 6
- Vues: 69
Ken Liu
L'Homme qui mit fin à l'histoire : un documentaire
« Evan Wei, un jeune spécialiste sino-américain du Japon de l’époque de Heian, et Akemi Kirino, une physicienne expérimentale nippo-américaine », mettent au point une exploration du passé en s’y rendant par un voyage dans le temps, mais avec la condition intrinsèque au processus de la destruction des preuves ramenées dudit passé.
« Un des paradoxes cruciaux de l’archéologie, c’est que, pour fouiller un site afin de l’étudier, il faut le détruire. Au sein de la profession, on débat à chaque site pour savoir s’il vaut mieux le fouiller ou le préserver in situ jusqu’à la mise au point de nouvelles techniques moins invasives. Mais sans des fouilles destructrices, comment mettra-t-on au point ces nouvelles techniques ?
Evan aurait sans doute dû lui aussi attendre qu’on invente un moyen d’enregistrer le passé sans l’effacer par la même occasion. Seulement, il aurait peut-être été trop tard pour les familles des victimes qui allaient bénéficier le plus de ces souvenirs. Il se débattait sans cesse entre les revendications antagonistes du passé et du présent. »
Le second propos est l’exposé des atrocités commises par les Japonais dans l’Unité 731 lors de la Seconde Guerre sino-japonaise (vivisections sans anesthésie, etc.).
« Ce même jour en 1931, près de Shenyang, ici en Mandchourie, éclatait la Seconde Guerre sino-japonaise. Pour les Chinois, il s’agissait du début de la Seconde Guerre mondiale, plus d’une décennie avant l’implication des États-Unis.
Nous sommes à la périphérie de Harbin, dans le district de Pingfang. Même si ce nom n’évoque rien à la plupart des Occidentaux, certains n’hésitent pas à surnommer ce lieu l’« Auschwitz d’Asie ». L’Unité 731 de l’Armée impériale japonaise y a mené durant la guerre d’atroces expériences sur des milliers de Chinois et Alliés captifs pour permettre au Japon de créer des armes biologiques et de conduire des recherches sur les limites de l’endurance humaine.
Dans ces locaux, des médecins militaires japonais ont tué des milliers de Chinois et d’Alliés par le biais d’expériences médicales, essais d’armements, vivisections, amputations et autres tortures systématiques. À la fin de la guerre, l’armée nippone qui battait en retraite a supprimé les derniers prisonniers et brûlé le complexe, ne laissant derrière elle que la carcasse du bâtiment administratif et les fosses utilisées pour élever des rats porteurs de maladies. Il n’y a eu aucun survivant.
Les historiens estiment qu’entre deux et cinq cent mille Chinois, presque tous des civils, ont été tués par les armes bactériologiques et chimiques mises au point ici et dans des laboratoires annexes : anthrax, choléra, peste bubonique. À l’issue de la guerre, le général MacArthur, commandant en chef des forces Alliées, a préservé les membres de l’Unité 731 de toute poursuite judiciaire pour crimes de guerre afin de récupérer les résultats de leurs expériences et de soustraire lesdites données à l’Union Soviétique. »
« Le 15 août 1945, nous avons appris que l’Empereur avait capitulé devant l’Amérique. Comme bien d’autres Japonais en Chine alors, mon unité a estimé qu’il serait plus facile de se rendre aux nationalistes chinois. On l’a incorporée dans une unité de l’armée nationaliste sous les ordres de Chiang Kaïchek, et j’ai continué de travailler en tant que médecin militaire pour aider les nationalistes contre les communistes dans la guerre civile. »
Est présentée ensuite l’attitude vis-à-vis de ces faits (de part et d’autre) : silence, oubli élusif, négationnisme, déni de responsabilité historique, opportunisme politique, etc. La question de leur validité en tant que documents historiques est aussi posée, ainsi que le problème du contrôle, de la maîtrise du passé.
« Aux premiers temps de la République populaire, de 1945 à 1956, l’approche idéologique des communistes consistait à tenir l’invasion pour une étape historique parmi d’autres de l’avancée irrésistible de l’humanité vers le socialisme. Tout en condamnant le militarisme japonais et en célébrant la résistance, ils essayaient de pardonner individuellement les Japonais si ces derniers montraient des signes de contrition – une attitude surprenante par son caractère confucéen et chrétien de la part d’un régime athée. Malgré l’atmosphère de zèle révolutionnaire, les prisonniers nippons étaient, pour la plupart, traités avec humanité. On leur donnait des cours de marxisme et on leur disait d’avouer leurs crimes par écrit (du fait de ces cours, le public japonais a pu croire que tout homme qui confessait des crimes horribles commis pendant la Guerre avait subi un lavage de cerveau de la part des communistes). Une fois qu’on les estimait repentis grâce à cette « rééducation », on les rendait au Japon. »
« Voisins sur le plan géographique, les deux pays l’ont été aussi dans leur réponse à la barbarie de la Seconde Guerre mondiale : l’oubli, au nom d’idéaux universels tels que « la paix » et « le socialisme », l’appariement des souvenirs de la Guerre au patriotisme, la déréalisation des victimes comme des bourreaux opérée pour les ramener pareillement à des symboles afin de servir l’État. Sous cet angle, la mémoire abstraite, partielle, fragmentaire en Chine et le silence au Japon ne sont plus que les deux faces de la même pièce. »
Cette novella très dense constitue un bel exemple de réflexion amenée par le biais de la science-fiction. Un assemblage de témoignages, interviews et autres déclarations parcourt les questions éthiques, juridiques, philosophiques portant sur un évènement historique difficile à assumer. Les dimensions personnelle et collective sont discutées.
« Tenter de rajouter l’empathie et l’émotion aux recherches historiques lui a valu l’opprobre de l’élite universitaire. Or, mêler à l’histoire la subjectivité du récit personnel renforce la vérité au lieu d’en détourner. Accepter notre fragilité et notre subjectivité n’est pas renoncer à notre responsabilité morale de dire la vérité, même, et surtout, si « la vérité », loin d’être unique, devient pluralité d’expériences partagées qui, ensemble, composent notre humanité. »
\Mots-clés : #campsconcentration #deuxiemeguerre #devoirdememoire #historique #sciencefiction #xxesiecle
- le Mar 13 Fév - 11:27
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Ken Liu
- Réponses: 2
- Vues: 182
Nathan Wachtel
Paradis du Nouveau Monde
Essais répartis entre Fables d’Occident (deux chapitres) et Messianismes indiens (trois chapitres).
I : Le Paradis terrestre est situé en Amérique méridionale par l’érudit vieux-chrétien espagnol Antonio de León Pinelo dans son encyclopédique El Paraíso en el Nuevo Mundo, rédigé entre 1640 et 1650, et le jésuite portugais Simão de Vasconcelos dans ses Noticias Curiosas e Necessarias das Cousas do Brasil, parues en 1663.
II : La « théorie de l’Indien juif », soit celle des Dix Tribus perdues d’Israël exilées en Amérique, est développée dans les synthèses de deux Espagnols, le dominicain Gregorio García dans L’origine des Indiens du Nouveau Monde, publié en 1607, et Diego Andrés Rocha dans Tratado Unico y Singular del Origen de los Indios, publié en 1681, et réfutée par le Hollandais d’origine portugaise Menasseh ben Israël dans Espérance d’Israël, publié en 1650.
« N’oublions pas cependant que des auteurs tels que Gregorio García, Diego Andrés Rocha ou Menasseh ben Israël développaient une argumentation extrêmement rigoureuse, que leurs démonstrations s’enchaînaient de manière très rationnelle ; et si elles ne peuvent plus convaincre, c’est parce qu’elles sont faussées au départ par leurs prémisses bibliques. »
III : La « Terre sans Mal » des Tupi-Guarani est le premier aspect du point de vue des Amérindiens. L’ethnologue autodidacte Curt Unkel Nimuendajú estime au début du XXe que « le moteur des migrations tupis-guaranis n’a pas été leur force d’expansion guerrière, et que leur motivation était d’un autre ordre, probablement religieux », outre la pression des colons, les guerres entre tribus indiennes, les conflits internes à certains villages, les épidémies et la politique gouvernementale de sédentarisation et de « réduction » des Indiens. Ces derniers vont vers l’est, en direction du soleil et de la mer à la recherche d’une sorte de paradis, dans un mouvement messianique dirigé par les « hommes-dieux » (Alfred Métraux) qui inclut bientôt la révolte contre la domination coloniale tout en intégrant des éléments de la catéchèse chrétienne.
IV : Le retour de l’Inca, « "messianisme" ou "millénarisme" » « obstinément réinventé » dans les Andes.
« …] la représentation indigène de la fin d’un monde est régie tant par les catégories de l’organisation dualiste que par la conception cyclique du temps. »
« L’on estime que, pendant le premier demi-siècle de la domination coloniale, la chute démographique dans le monde andin atteint en moyenne quelque 80 % de la population : d’où l’ampleur de la désintégration sociale, et du traumatisme. »
Les huacas (divinités) reviennent, possèdent des fidèles dans la « maladie de la danse », reprennent et retournent des éléments de l’institution coloniale contre elle dans un « mouvement de revitalisation religieuse ».
« Soit le renversement cataclysmique de l’ordre du monde, dès lors remis à l’endroit. »
« Ce n’est donc pas nécessairement par rejet du christianisme que les Indiens rebelles exterminent les Espagnols et pourchassent les prêtres. Bien au contraire ! On peut soutenir en effet, sans paradoxe, que si les rebelles massacrent les oppresseurs espagnols, c’est parce que ces derniers, cupides et corrompus, sont de mauvais chrétiens, instruments du diable, et qu’eux-mêmes, Indiens, incarnent les véritables et authentiques chrétiens. »
V : La Danse des Esprits dans le prophétisme nord-amérindien, issu des « catastrophe démographique » due aux épidémies (disparition de plus de 80% de la population la aussi), guerres, spoliations notamment territoriales et déportations forcées de la colonisation anglo-américaine (ainsi que de la disparition du gibier).
« Pendant quelque trois cents ans, les Indiens d’Amérique du Nord ont ainsi éprouvé des traumatismes de tous ordres, indéfiniment répétés, accumulés, toujours recommencés : ils ont vécu de multiples et tragiques fins du monde, en abyme. »
La région des Grands Lacs est le siège d’une « revitalisation religieuse et guerrière » chez les rescapés regroupés dans une pan-indianité intertribale, d’abord « nativiste » et tournée contre les influences européennes.
Lorsque les Indiens ont tous été « transformés en clients, puis en assistés » dans des « réserves », les visions du Paiute Wodziwob annoncent « le retour des morts » au cours de Ghost Dances (d’origine ancestrale). Puis Wovoka, un autre Paiute, donne une inflexion pacifiste à son message de « Messie » : la transe traditionnelle doit dorénavant coexister avec les usages importés (travail salarié, école, église, etc.).
« Il s’agit en fait de combiner et concilier la fidèle perpétuation des rituels anciens (danses, prières, chants, transes) avec l’inévitable intégration dans le monde moderne : soit un processus double, où se consolide et s’affirme une identité de plus en plus manifeste, par-delà les particularités tribales : l’identité indienne. »
Les Sioux font ensuite face à l’extermination des bisons et à une très importante réduction de leurs réserves ; les traités avec cette « nation » sont régulièrement violés. Puis vient le massacre de Wounded Knee, basé sur un malentendu à propos de la Ghost Dance (qui perdurera). Wachtel relate le meurtre de Sitting Bull, le rôle ambivalent de Buffalo Bill et de son Wild West Show – le contexte de la fin d’un monde.
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #contemythe #essai #historique #identite #minoriteethnique #religion #segregation #spiritualité #traditions
- le Dim 11 Fév - 11:29
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Nathan Wachtel
- Réponses: 2
- Vues: 416
Joseph Roth
Hôtel Savoy
Gabriel Dan, soldat austro-hongrois dans la Première Guerre mondiale et prisonnier en Sibérie, revient de trois ans de captivité à Łódź, où il loge à l'avant-dernier étage de l’hôtel Savoy, tenu par le mystérieux Kalegouropoulos. Pour continuer sa fuite vers l’Ouest, il espère une aide de son riche oncle Phébus Böhlaug.
« — Et tu n’y étais pas mal, n’est-ce pas ? Tous les gens disent qu’on est bien en captivité. »
« Je l’essaye dans la chambre d’Alexandre, devant la grande glace murale – il me va. Je me rends compte, mais oui, je me rends bien compte de la nécessité d’un costume bleu, « comme neuf », de la nécessité de cravates mouchetées de brun, d’un gilet marron, et, l’après-midi, je repars avec un carton à la main. Je reviendrai. Je me berce encore du léger espoir d’obtenir de l’argent pour le voyage.
— Maintenant, vois-tu, je l’ai équipé, dit Phébus à Régine. »
« J’avais été longtemps seul parmi des milliers. Maintenant, il y a des milliers de choses que je peux partager : la vue d’un pignon aux lignes courbes, un nid d’hirondelles dans les W.-C. de l’Hôtel Savoy, le regard irritant et les yeux couleur de bière du vieux garçon d’ascenseur, l’amertume qui règne au septième étage, l’étrangeté inquiétante d’un nom grec, d’une notion grammaticale brusquement rendue vivante, le triste rappel d’un aoriste plein de traîtrises, le souvenir de l’étroitesse de la maison paternelle, les ridicules de ce lourdaud de Phébus Böhlaug et Alex sauvé par le train des équipages. Les choses vivantes en devenaient plus vivantes, plus haïssables celles que tous condamnaient, plus proche le ciel et le monde asservi. »
« — Non, dis-je, je ne sais pas ce que je suis. Autrefois, je voulais devenir écrivain, mais je suis parti pour la guerre, et je crois qu’il ne sert à rien d’écrire. Je suis un homme solitaire et je ne peux pas écrire pour tous. »
Puis Gabriel, le narrateur, rencontre ses voisins dans le microcosme de l’hôtel, la danseuse Stasie, le clown Vladimir Santschin (qui meurt vite), Hirsch Fisch le vendeur de billets de loterie, Abel Glanz, l’étrange souffleur qui survit de change de devises, Taddeus Montag, le caricaturiste, et les autres pauvres de la ville (sale et d’apparence assez sinistre), comme les Juifs qui y errent. Alex, le fils de Phébus, épris de Stasie, lui propose de payer son voyage pour Paris en échange de sa chambre, mais il reste après avoir tergiversé. Les ouvriers de l’industriel Neuner sont en grève, on craint la révolution. Gabriel héberge Zwonimir Pansin, son frère d’armes, trublion, et même agitateur.
« L’auteur de l’article expliquait que tout le mal venait des prisonniers qui rentraient, car ils introduisaient « le bacille de la révolution » dans un pays sain. L’auteur était un pauvre type, il lançait de l’encre contre des avalanches, il construisait des digues de papier contre des raz de marée. »
Arrive l’Américain Bloomfield (Blumenfeld) (puis son coiffeur, Christophe Colomb), attendu par tous comme une manne financière, et Gabriel devient un de ses secrétaires, jusqu’à l’insurrection et l’incendie de l’hôtel Savoy.
« Douloureux est le sort des hommes, et leur souffrance élève devant eux un grand, un gigantesque mur. Pris dans la toile gris poussière de leurs soucis, ils se débattent comme des mouches prisonnières. Celui-ci manque de pain et celui-là le mange avec amertume. Celui-ci veut être rassasié et celui-là être libre. Là, un autre agite ses bras et croit que ce sont des ailes, croit qu’il va s’élever l’instant ou le mois, ou l’année d’après, au-dessus des bas-fonds de ce monde.
Douloureux était le sort des hommes. Leur destin, ils le préparaient eux-mêmes et croyaient qu’il venait de Dieu. Ils étaient prisonniers des traditions, leur cœur était retenu par des milliers de fils et leurs mains tissaient elles-mêmes ces fils. Sur toutes les voies de leur vie se dressaient les tables de la loi de leur Dieu, de leur police, de leurs rois, de leur classe. Ici, il était défendu d’aller plus loin et là de s’attarder. Et, après s’être ainsi débattus durant quelques décennies, après avoir erré, être restés désemparés, ils mouraient dans leur lit et léguaient leur misère à leurs descendants. »
À la fois désolé et teinté d’humour, ce roman rend subtilement le délitement de l’empire austro-hongrois et de la Mitteleuropa.
Et il s’ajoute en bonne place sur l’étagère des hôtels légendaires en littérature, comme le Lutetia de Pierre Assouline, qu’il m’a ramentu.
\Mots-clés : #exil #historique #lieu #premiereguerre #xxesiecle
- le Mar 26 Déc - 10:50
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: Joseph Roth
- Réponses: 31
- Vues: 4011
W.G. Sebald
Amère patrie − À propos de la littérature autrichienne
Ces essais constituent une sorte de suite, ou plutôt un pendant, à La Description du malheur, d’ailleurs aussi sous-titré À propos de la littérature autrichienne. Cette fois, il s’agit dans cette « tradition d’écriture » de ce qui tourne autour du concept de Heimat, la « (petite) patrie », « qui s’était imposée dans l’Autriche des années 1930 ».
« Ce qu’on essayait d’accomplir à l’époque, c’était de gommer la moindre différence, d’ériger l’étroitesse de vue en programme et la délation en morale publique. »
Il s’agit des auteurs du XIXe (et début XXe), et sont notamment évoqués les Juifs, l’exil, les migrations, la disparition culturelle, la perte et le passé.
Intéressante découverte de Peter Altenberg, le poète bohème et flâneur viennois (rapproché de Baudelaire).
Comme pour le précédent essai, une connaissance approfondie de l’histoire et de la littérature autrichiennes serait fortement souhaitable. De même, je n’ai pas été en mesure d’apprécier vraiment la validité de la « dimension messianique » juive attribuée au Château de Kafka.
Concernant Joseph Roth, sa conscience de la destruction à venir d’un monde où les Juifs avaient leur place est significative de l’élaboration fasciste qu’il dénonce dès 1927.
« Dans le domaine de l’esthétique, il en va toujours en dernier ressort de problèmes éthiques. »
Suit un article (fort) critique sur Hermann Broch.
« Le kitsch est le pendant concret de la désensibilisation esthétique ; ce qui se manifeste en lui est le résultat d’une erreur de programmation de l’utopie, une erreur de programmation qui mène à une nouvelle ère où les substituts et les succédanés prennent la place de ce qui a été un jour le réel, y compris dans le domaine de la nature et de l’évolution naturelle. »
Je ne connaissais pas Jean Améry :
« …] le jour de l’Anschluss ne sonnait pas seulement le glas de sa patrie, de son enfance et de sa jeunesse, mais aussi, de jure, celui de sa personne [… »
« Améry endossa ce qu’on a un jour appelé le vice du peuple juif, l’être ailleurs [en français dans le texte], et devint un “apatride de métier”. »
L’essai s’achève en évoquant Peter Handle :
« Si l’idée de Heimat s’est développée au XIXe siècle à l’épreuve de plus en plus inévitable de l’étranger, l’idéologisation de la Heimat, inspirée de la même façon par l’angoisse de la perte, conduit au XXe siècle à vouloir l’expansion la plus grande possible de cette Heimat, si nécessaire par la violence et aux dépens des autres patries. »
Et si je suis loin d’avoir tout saisi, certains passages trouvent une résonance…
« À partir des mythes indiens, Lévi-Strauss a montré que leurs inventeurs ne craignaient rien tant que l’infection de la nature par l’homme. La compréhension du monde qui en résulte a pour précepte central que rien n’est plus important que d’effacer les traces de notre présence. C’est une leçon de modestie diamétralement opposée à celle que notre culture s’est proposé d’appliquer. »
\Mots-clés : #biographie #communautejuive #ecriture #essai #exil #historique #nostalgie
- le Ven 22 Déc - 11:06
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: W.G. Sebald
- Réponses: 74
- Vues: 8389
David Grann
La Cité perdue de Z – Une expédition légendaire au cœur de l’Amazonie
Le colonel Percy Harrison Fawcett est disparu en 1925 lors d’une expédition amazonienne, parti à la recherche d’une cité perdue. Il avait déjà, en 1906-1907, établi une cartographie de la frontière entre le Brésil et la Bolivie pour la Société royale de géographie. Intrépide et apparemment invincible, il multiplie les explorations du proverbial « enfer vert » – finalement l’image ne me paraît pas totalement erronée, surtout vécue dans les conditions de l’époque. Quoique empêtré dans ses convictions victoriennes élitistes et racistes, il ne se borne pas à suivre les principaux cours d’eau mais s’enfonce à pied en forêt, et approche ainsi des tribus indiennes inconnues, dont il reconnaît la culture et le savoir-faire (en bref des civilisés) dans une approche qui annonce l’anthropologie moderne.
Mais c’est le mythique El Dorado des conquistadors qui obsède surtout Fawcett, qu’il appelle la cité perdue de Z.
En 1911, Hiram Bingham découvre les ruines incas de Machu Picchu. En 1913/1914, l’ex-président Théodore Roosevelt et Cândido Rondon, orphelin d’origine indienne devenu le colonel brésilien qui fondera le Service de protection des Indiens, explorent la rivière du Doute.
Pour son ultime expédition, Fawcett a été approché par le colonel T. E. Lawrence, mais préfère emmener son fils Jack et l’ami de ce dernier, Raleigh ; il manque de fonds, est devenu adepte du spiritisme et craint d’être devancé, cependant ils parviennent à partir dans le Mato Grosso. Fawcett emporte une idole de pierre, cadeau de Henry Rider Haggard (auteur de Les Mines du roi Salomon et She)…
David Grann, journaliste néophyte en la matière, raconte comment il suit ses traces en 2004 pour enquêter sur le terrain (comme tant d’autres, dont des dizaines ne revinrent jamais) ; il expose comme les dernières recherches archéologiques rendent compte d’une société qui a su se développer dans ce milieu avant d’être éradiquée par les maladies importées.
Brian, le fils cadet de Fawcett, présente les carnets de route et journaux intimes de son père dans Le continent perdu. Sir Arthur Conan Doyle, ami de Fawcett, fait de son histoire le cadre de son roman Le Monde perdu. J’ai eu une pensée pour Les Maufrais (père et fils). Autant de livres qui alimentèrent mon imaginaire depuis l’adolescence...
\Mots-clés : #amérindiens #aventure #biographie #contemythe #historique #lieu #nature #portrait #voyage
- le Mar 5 Déc - 11:36
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: David Grann
- Réponses: 15
- Vues: 1733
Laurent Binet
Perspective(s)
« Or, et c’est là tout ce que vous devez savoir : l’histoire se déroule à Florence, au temps de la onzième et dernière guerre d’Italie. »
(Préface)
Et c’est une époque et une contrée où s’affrontent l’Espagne et le pape épris de morale inquisitoriale, antiprotestante et opposée à la France, d’autres régions de ce qui sera l’Italie, dont le duché de Ferrare, les républicains et les artisans en quête de reconnaissance ; dans l’esprit du censeur Savonarole, les nus sont dorénavant mal acceptés dans les arts plastiques et graphiques, où le baroque oublie la perspective.
Le peintre Pontormo est tué devant les fresques de San Lorenzo auxquelles il travaille depuis onze ans, et on découvre chez lui un tableau de Vénus et Cupidon tiré d’un dessin de Michel-Ange (qui, fort âgé, travaille à Saint-Pierre de Rome), dont la tête féminine a été remplacée par celle de Maria de Médicis, fille du duc de Florence (et nièce de Catherine de Médicis, reine de France). De plus, la tête de Noé a été retouchée dans la scène du Déluge de Pontormo.
Polar historique épistolaire, ce roman est assez rocambolesque et irrévérencieux ; je me demande quelle part de vérité historique peut être reconnue aux portraits à charge de Vasari et Cellini, par exemple.
\Mots-clés : #correspondances #historique #peinture #polar
- le Jeu 23 Nov - 16:06
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Laurent Binet
- Réponses: 22
- Vues: 1215
Juan Gabriel Vásquez
Les Dénonciateurs
Gabriel Santoro, journaliste, a publié il y a trois ans, en 1988, Une vie en exil, biographie de Sara Guterman, une vieille amie juive de la famille qui s’était réfugiée en Colombie en fuyant le nazisme dans les années 1930. Mais ce livre a suscité une vive critique de son père, professeur de rhétorique lui aussi nommé Gabriel Santoro, et ils ne se sont plus fréquentés jusqu’à ce qu’il fasse appel à son fils à l’occasion d’une opération cardiaque. Alors commence sa « seconde vie » : il devient l’amant d’Angelica, une femme plus jeune, mais meurt dans un accident de voiture six mois plus tard, et son fils écrit le livre que nous lisons. Sara raconte à Gabriel ce que son père ne lui a jamais dit, le suicide de Konrad, père d’Enrique/ Heinrich, son ami, qui s’était rebellé contre la langue maternelle, l’allemand, et tout ce qu’elle représentait sous le national-socialisme. Et que Gabriel père a dénoncé Konrad à l’époque.
« Enrique, pour la première fois, a confirmé ce qu’a toujours su ton père : chacun est ce qu’il dit, chacun est comme il le dit. »
Le contexte historique est celui des listes noires de délation et des camps de concentration des Allemands supposés nazis lorsque le président Santos a rompu les relations avec l’Axe fin 1941.
« La sensation qu’il y a un ordre dans le monde. Ou du moins qu’on peut y mettre de l’ordre. Tu prends le chaos d’un hôtel, par exemple, et tu le mets sur une liste. Peu importe si c’est une liste de choses à faire, de clients, d’employés. Elle contient tout ce qui doit être, et si une chose n’y est pas c’est qu’elle ne devait pas y être. Et on respire, on est sûr d’avoir tout fait comme il faut. Un contrôle. C’est ce que tu as avec une liste : un contrôle absolu. La liste commande. Une liste est un univers. Ce qui n’est pas dans la liste n’existe pour personne. »
« Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qu’on appelait les listes noires du Département d’État des États-Unis avaient pour objectif de bloquer les fonds de l’Axe en Amérique latine. Mais partout, et pas seulement en Colombie, le système a connu des abus, et plus d’une fois des justes ont payé pour des pécheurs. »
Angelica dénonce son amant mort dans une interview, qui voulait rencontrer Enrique pour se faire pardonner de lui et l’aurait abandonnée. Et le fils poursuit son enquête…
Ce roman un peu embrouillé m’a ramentu ceux de Javier Cercas, et notamment L’imposteur que j’ai récemment lu, l’oubli ou pas de la trahison (quitte à trahir en la révélant ?), avec ce même lourd passé qui plombe le présent, qu’on le mette en lumière ou pas.
\Mots-clés : #antisémitisme #culpabilité #deuxiemeguerre #devoirdememoire #exil #historique #relationenfantparent #trahison #xxesiecle
- le Jeu 2 Nov - 11:26
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Juan Gabriel Vásquez
- Réponses: 26
- Vues: 2426
Henri Barbusse
Le Feu – Journal d’une escouade
Témoignage sur l’existence des poilus pendant la Première Guerre mondiale, basé sur le carnet de guerre tenu vingt-deux mois de 1914 à 1915 par Henri Barbusse sur le front. L’auteur est le narrateur de ce récit paru en 1916, et il rapporte les propos de quelques compagnons d’escouade, dont certains suivis jusqu’à leur mort.
« Ils sont des hommes, des bonshommes quelconques arrachés brusquement à la vie. Comme des hommes quelconques pris dans la masse, ils sont ignorants, peu emballés, à vue bornée, pleins d’un gros bon sens, qui, parfois, déraille ; enclins à se laisser conduire et à faire ce qu’on leur dit de faire, résistants à la peine, capables de souffrir longtemps.
Ce sont de simples hommes qu’on a simplifiés encore, et dont, par la force des choses, les seuls instincts primordiaux s’accentuent : instinct de la conservation, égoïsme, espoir tenace de survivre toujours, joie de manger, de boire et de dormir. Par intermittences, des cris d’humanité, des frissons profonds, sortent du noir et du silence de leurs grandes âmes humaines. »
Barbusse reproduit le parler de ses camarades venus de diverses régions de France, et ce recueil d’argot populaire n’est pas le moindre intérêt du livre.
« – C’est aux oreilles. Une marmite — et un macavoué, mon ieux — qui a pété comme qui dirait là. Ma tête a passé, j’peux dire, entre les éclats, mais tout juste, rasibus, et les esgourdes ont pris.
– Si tu voyais ça, dit Fouillade, c’est dégueulasse, ces deux oreilles qui pend. On avait nos deux paquets de pansement et les brancos nous en ont encore balancé z’un. Ça fait trois pansements qu’il a enroulés autour de la bouillotte. »
C’est « la bonne blessure » (en fait elle ne sera pas suffisante) :
« – On va m’attacher une étiquette rouge à la capote, y a pas d’erreur, et m’ mener à l’arrière. J’ s’rai conduit, à c’ coup, par un type bien poli qui m’ dira : « C’est par ici, pis tourne par là. . . Na !. . . mon pauv’ ieux. » Pis l’ambulance, pis l’train sanitaire avec des chatteries des dames de la Croix-Rouge tout le long du chemin comme elles ont fait à Crapelet Jules, pis l’hôpitau de l’intérieur. Des lits avec des draps blancs, un poêle qui ronfle au milieu des hommes, des gens qui sont faits pour s’occuper de nous et qu’on regarde y faire, des savates réglementaires, mon ieux, et une table de nuit : du meuble ! Et dans les grands hôpitals, c’est là qu’on est bien logé comme nourriture ! J’y prendrai des bons repas, j’y prendrai des bains ; j’y prendrai tout c’que j’trouverai. Et des douceurs sans qu’on soit obligé pour en profiter, de s’battre avec les autres et de s’démerder jusqu’au sang. J’aurai sur le drap mes deux mains qui n’ficheront rien, comme des choses de luxe — comme des joujoux, quoi ! — et, d’ssous l’drap, les pattes chauffées à blanc du haut en bas et les arpions élargis en bouquets de violettes... »
Une semaine de répit à l’arrière :
« Après plusieurs haltes où on se laisse tomber sur son sac, au pied des faisceaux — qu’on forme, au coup de sifflet, avec une hâte fiévreuse et une lenteur désespérante à cause de l’aveuglement, dans l’atmosphère d’encre — l’aube s’indique, se délaie, s’empare de l’espace. Les murs de l’ombre, confusément, croulent. Une fois de plus nous subissons le grandiose spectacle de l’ouverture du jour sur la horde éternellement errante que nous sommes.
On sort enfin de cette nuit de marche, à travers, semble-t-il, des cycles concentriques, d’ombre moins intense, puis de pénombre, puis de lueur morne. Les jambes ont une raideur ligneuse, les dos sont engourdis, les épaules meurtries. Les figures demeurent grises et noires : on dirait qu’on s’arrache mal de la nuit ; on n’arrive plus jamais maintenant à s’en défaire tout à fait. »
Il y a un côté didactique dans le roman qui s’organise par thèmes (« embarquement », « permission », etc.), aidé en cela par le Cocon, un familier des chiffres. Ainsi l’amer dépit vis-à-vis de ceux de l’arrière.
« – Dis donc, petit, viens un peu ici, dit Cocon, en prenant le bambin entre ses genoux. Écoute bien. Ton papa i’ dit, n’est-ce pas : « Pourvu que la guerre continue ! » hé ?
– Pour sûr, dit l’enfant en hochant la tête, parce qu’on devient riche. Il a dit qu’à la fin d’mai on aura gagné cinquante mille francs.
– Cinquante mille francs ! C’est pas vrai !
– Si, si ! trépigne l’enfant. Il a dit ça avec maman. Papa voudrait qu’ça soit toujours comme ça. Maman, des fois, elle ne sait pas, parce que mon frère Adolphe est au front. Mais on va le faire mettre à l’arrière et, comme ça, la guerre pourra continuer. »
Barbusse dépeint avec vigueur scènes et figures, et pas que les tranchées, les combats et les cadavres :
« Dans un coin de cette sale petite maison encombrée de vieilleries, de débris poussiéreux de l’autre saison, emplie par la cendre de tant de soleils éteints, il y a, à côté des meubles et des ustensiles, quelque chose qui remue : un vieux bonhomme, muni d’un long cou pelé, raboteux et rose qui fait penser au cou d’une volaille déplumée par la maladie. Il a également un profil de poule : pas de menton et un long nez ; une plaque grise de barbe feutre sa joue rentrée, et on voit monter et descendre de grosses paupières rondes et cornées, comme des couvercles sur la verroterie dépolie de ses yeux. »
Puanteur, crasse, pluie, froid, atrocités, souffrances sont décrits "de l’intérieur", et avec puissance. Je ne m’étends pas sur les nombreuses scènes d’horreur naturalistes (qui ramentoivent parfois Curzio Malaparte)…
« Un nuage de pestilence commence à se balancer sur les restes de ces créatures avec lesquelles on a si étroitement vécu, si longtemps souffert. »
Les avis sur la guerre sont imprégnés de l’antimilitarisme pacifiste de Barbusse, sans plus occulter l’égoïsme que la solidarité qui règnent dans les rangs.
« Mais les conversations sur ce sujet se terminent toujours par un haussement d’épaules : on n’avertit jamais le soldat de ce qu’on va faire de lui ; on lui met sur les yeux un bandeau qu’on n’enlève qu’au dernier moment. Alors :
– On voira bien.
– Y a qu’à attendre ! »
L’attention est surtout portée au peuple, la chair à canon.
« Chacun sait qu’il va apporter sa tête, sa poitrine, son ventre, son corps tout entier, tout nu, aux fusils braqués d’avance, aux obus, aux grenades accumulées et prêtes, et surtout à la méthodique et presque infaillible mitrailleuse — à tout ce qui attend et se tait effroyablement là-bas — avant de trouver les autres soldats qu’il faudra tuer. Ils ne sont pas insouciants de leur vie comme des bandits, aveuglés de colère comme des sauvages. Malgré la propagande dont on les travaille, ils ne sont pas excités. Ils sont au-dessus de tout emportement instinctif. Ils ne sont pas ivres, ni matériellement, ni moralement. C’est en pleine conscience, comme en pleine force et en pleine santé, qu’ils se massent là, pour se jeter une fois de plus dans cette espèce de rôle de fou imposé à tout homme par la folie du genre humain. On voit ce qu’il y a de songe et de peur, et d’adieu dans leur silence, leur immobilité, dans le masque de calme qui leur étreint surhumainement le visage. Ce ne sont pas le genre de héros qu’on croit, mais leur sacrifice a plus de valeur que ceux qui ne les ont pas vus ne seront jamais capables de le comprendre. »
Un aperçu quand même du massacre, lissé déjà par le temps passé :
« En bas, parmi la multitude des immobiles, voici, reconnaissables à leur usure et leur effacement, des zouaves, des tirailleurs et des légionnaires de l’attaque de mai. L’extrême bord de nos lignes se trouvait alors au bois de Berthonval, à cinq ou six kilomètres d’ici. Dans cet assaut, qui a été un des plus formidables de la guerre et de toutes les guerres, ils étaient parvenus d’un seul élan, en courant, jusqu’ici. Ils formaient alors un point trop avancé sur l’onde d’attaque et ils ont été pris de flanc par les mitrailleuses qui se trouvaient à droite et à gauche des lignes dépassées. Il y a des mois que la mort leur a crevé les yeux et dévoré les joues — mais même dans leurs restes disséminés, dispersés par les intempéries et déjà presque en cendres, on reconnait les ravages des mitrailleuses qui les ont détruits, leur trouant le dos et les reins, les hachant en deux par le milieu. À côté de têtes noires et cireuses de momies égyptiennes, grumeleuses de larves et de débris d’insectes, où des blancheurs de dents pointent dans des creux ; à côté de pauvres moignons assombris qui pullulent là, comme un champ de racines dénudées, on découvre des crânes nettoyés, jaunes, coiffés de chéchias de drap rouge dont la housse grise s’effrite comme du papyrus. Des fémurs sortent d’amas de loques agglutinées par de la boue rougeâtre, ou bien, d’un trou d’étoffes effilochées et enduites d’une sorte de goudron, émerge un fragment de colonne vertébrale. Des côtes parsèment le sol comme de vieilles cages cassées, et, auprès, surnagent des cuirs mâchurés, des quarts et des gamelles transpercés et aplatis. Autour d’un sac haché, posé sur des ossements et sur une touffe de morceaux de drap et d’équipements, des points blancs sont régulièrement semés : en se baissant, on voit que ce sont les phalanges de ce qui, là, fut un cadavre. »
Cette fresque sans concession aide à saisir ce que fut cette boucherie de la Grande Guerre, et à mon sens ce récit participe pleinement au devoir de mémoire nécessaire pour ne pas oublier la Der des Ders…
\Mots-clés : #autobiographie #devoirdememoire #guerre #historique #mort #premiereguerre #violence #xxesiecle
- le Mar 31 Oct - 11:21
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Henri Barbusse
- Réponses: 7
- Vues: 436
Javier Cercas
L'imposteur
Cercas détaille comme, troublé par l'histoire d’Enric Marco, « le grand imposteur et le grand maudit » qui s'est fait passer pour un survivant des camps de concentration et est devenu une célébrité espagnole de la mémoire historique des horreurs nazies, il s’est finalement résolu à écrire ce roman non fictionnel. « Comprendre, est-ce justifier ? » N’est-il pas lui-même un imposteur ?
« La pensée et l’art, me disais-je, essaient d’explorer ce que nous sommes, ils révèlent notre infinie variété, ambiguë et contradictoire, ils cartographient ainsi notre nature : Shakespeare et Dostoïevski, me disais-je, éclairent les labyrinthes de la morale jusque dans leurs derniers recoins, ils démontrent que l’amour est capable de conduire à l’assassinat ou au suicide et ils réussissent à nous faire ressentir de la compassion pour les psychopathes et les scélérats ; c’est leur devoir, me disais-je, parce que le devoir de l’art (ou de la pensée) consiste à nous montrer la complexité de l’existence, afin de nous rendre plus complexes, à analyser les ressorts du mal pour pouvoir s’en éloigner, et même du bien, pour pouvoir peut-être l’apprendre. »
« Un génie ou presque. Car il est bien sûr difficile de se départir de l’idée que certaines faiblesses collectives ont rendu possible le triomphe de la bouffonnerie de Marco. Celui-ci, tout d’abord, a été le produit de deux prestiges parallèles et indépassables : le prestige de la victime et le prestige du témoin ; personne n’ose mettre en doute l’autorité de la victime, personne n’ose mettre en doute l’autorité du témoin : le retrait pusillanime devant cette double subornation – la première d’ordre moral, la seconde d’ordre intellectuel – a fait le lit de l’escroquerie de Marco. »
« Depuis un certain temps, la psychologie insiste sur le fait qu’on peut à peine vivre sans mentir, que l’homme est un animal qui ment : la vie en société exige cette dose de mensonge qu’on appelle éducation (et que seuls les hypocrites confondent avec l’hypocrisie) ; Marco a amplifié et a perverti monstrueusement cette nécessité humaine. En ce sens, il ressemble à Don Quichotte ou à Emma Bovary, deux autres grands menteurs qui, comme Marco, ne se sont pas résignés à la grisaille de leur vie réelle et qui se sont inventés et qui ont vécu une vie héroïque fictive ; en ce sens, il y a quelque chose dans le destin de Marco, comme dans celui de Don Quichotte et d’Emma Bovary, qui nous concerne profondément tous : nous jouons tous un rôle ; nous sommes tous qui nous ne sommes pas ; d’une certaine façon, nous sommes tous Enric Marco. »
Simultanément s’entrelace l’histoire de Marco depuis l’enfance, retiré nourrisson à sa mère enfermée à l’asile psychiatrique ; il aurait été maltraité par sa marâtre et ignoré par son père ouvrier libertaire, puis ballotté d’un foyer à l’autre, marqué par les évènements de la tentative d’indépendance catalane d’octobre 1934, juste avant que le putsch et la guerre civile éclatent. Cercas a longuement interviewé Marco, un vieillard fort dynamique, bavard et imbu de lui-même, criant à l’injustice parce qu’il aurait combattu pour une juste cause.
D’après Tzvetan Todorov :
« [Les victimes] n’ont pas à essayer de comprendre leurs bourreaux, disait Todorov, parce que la compréhension implique une identification avec eux, si partielle et provisoire qu’elle soit, et cela peut entraîner l’anéantissement de soi-même. Mais nous, les autres, nous ne pouvons pas faire l’économie de l’effort consistant à comprendre le mal, surtout le mal extrême, parce que, et c’était la conclusion de Todorov, “comprendre le mal ne signifie pas le justifier mais se doter des moyens pour empêcher son retour”. »
Militant anarcho-syndicaliste, Marco aurait combattu dans les rangs de la République, et Cercas analyse le « processus d’invention rétrospective de sa biographie glorieuse » chez ce dernier.
« Et je me suis dit, encore une fois, que tout grand mensonge se fabrique avec de petites vérités, en est pétri. Mais j’ai aussi pensé que, malgré la vérité documentée et imprévue qui venait de surgir, la plus grande partie de l’aventure guerrière de Marco était un mensonge, une invention de plus de son égocentrisme et de son insatiable désir de notoriété. »
Cercas ne ménage pas les redites, procédé (didactique ?) un peu lassant.
« Parce que le passé ne passe jamais, il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit ; le passé n’est qu’une dimension du présent. »
« Mais nous savons déjà qu’on n’arrive pas à dépasser le passé ou qu’il est très difficile de le faire, que le passé ne passe jamais, qu’il n’est même pas le passé – c’est Faulkner qui l’a dit –, qu’il n’est qu’une dimension du présent. »
« La raison essentielle a été sa découverte du pouvoir du passé : il a découvert que le passé ne passe jamais ou que, du moins, son passé à lui et celui de son pays n’étaient pas passés, et il a découvert que celui qui a la maîtrise du passé a celle du présent et celle de l’avenir ; ainsi, en plus de changer de nouveau et radicalement tout ce qu’il avait changé pendant sa première grande réinvention (son métier, sa ville, sa femme, sa famille, jusqu’à son nom), il a également décidé de changer son passé. »
Cercas évoque De sang-froid de Truman Capote et L’Adversaire d’Emmanuel Carrère, deux « chefs-d’œuvre » du « roman sans fiction » dont il juge le premier auteur atteint de « turpitude » pour avoir laissé espérer tout en souhaitant leur exécution les deux meurtriers condamnés à mort, et doute du procédé du second, présent à la première personne dans son récit peut-être pour se donner une légitimité morale fallacieuse.
Intéressantes questions du kitch du narcissique, et du mensonge (peut-il être légitime ? un roman est-il mensonge ?)
« Il y a deux mille quatre cents ans, Gorgias, cité par Plutarque, l’a dit de façon indépassable : “La poésie [c’est-à-dire, la fiction] est une tromperie où celui qui trompe est plus honnête que celui qui ne trompe pas et où celui qui se laisse tromper est plus sage que celui qui ne se laisse pas tromper.” »
En fait de déportation, Marco a été travailleur volontaire en Allemagne fin 1941, et emprisonné au bout de trois mois comme « volontaire communiste ». Revenu en Espagne, il a effectivement connu « les prisons franquistes, non comme prisonnier politique mais comme détenu de droit commun. » Il abandonne ses premiers femme et enfants, change de nom pour refaire sa vie (grand lecteur autodidacte, il suit des cours universitaires d’histoire) – et devenir le secrétaire général de la CNT, le syndicat anarchiste, puis président de l’Amicale de Mauthausen, l’association des anciens déportés espagnols. Il a toujours été un séducteur, un amuseur, un bouffon qui veut plus que tout qu’on l’aime et qu’on l’admire.
« …] de même, certaines qualités personnelles l’ont beaucoup aidé : ses dons exceptionnels d’orateur, son activisme frénétique, ses talents extraordinaires de comédien et son manque de convictions politiques sérieuses – en réalité, l’objectif principal de Marco était de faire la une et satisfaire ainsi sa médiapathie, son besoin d’être aimé et admiré et son désir d’être en toute occasion la vedette – de sorte qu’un jour il pouvait dire une chose et le lendemain son contraire, et surtout il pouvait dire aux uns et aux autres ce qu’ils voulaient entendre. »
« Le résultat du mélange d’une vérité et d’un mensonge est toujours un mensonge, sauf dans les romans où c’est une vérité. »
« Marco a fait un roman de sa vie. C’est pourquoi il nous paraît horrible : parce qu’il n’a pas accepté d’être ce qu’il était et qu’il a eu l’audace et l’insolence de s’inventer à coups de mensonges ; parce que les mensonges ne conviennent pas du tout à la vie, même s’ils conviennent très bien aux romans. Dans tous les romans, bien entendu, sauf dans un roman sans fiction ou dans un récit réel. Dans tous les livres, sauf dans celui-ci. »
Après la Transition de la dictature franquiste à la démocratie, la génération qui n’avait pas connu la guerre civile a plébiscité le concept de “mémoire historique”, qui devait reconnaître le statut des victimes.
« La démocratie espagnole s’est construite sur un grand mensonge, ou plutôt sur une longue série de petits mensonges individuels, parce que, et Marco le savait mieux que quiconque, dans la transition de la dictature à la démocratie, énormément de gens se sont construit un passé fictif, mentant sur le passé véritable ou le maquillant ou l’embellissant [… »
Cercas raconte ensuite comment l’historien Benito Bermejo a découvert l’imposture de Marco, alors devenu un héros national, et s’est résolu à la rendre publique (c’est loin d’être la seule du même genre). Marco tente depuis de se justifier par son réel travail de défense de la cause mémorielle. Cercas décrit ses rapports avec Marco partagé entre le désir d’être le personnage de son livre, et le dépit de ne pas pouvoir contrôler ce dernier.
« — S’il te plaît, laisse-moi quelque chose. »
Opiniâtre quant à la recherche de la vérité, outre ses pensées Cercas détaille son ressenti, qui va du dégoût initial à une certaine sympathie ; "donquichottesque", il pense même un temps à sauver Marco non pas en le réhabilitant, mais en le plaçant devant la vérité…
Manifestement basée sur une abondante documentation, cette étude approfondie, fouillée dans toutes ses ramifications tant historiques que psychologiques ou morales, évoque aussi le rôle de la fiction comme expression de la vérité.
\Mots-clés : #biographie #campsconcentration #devoirdememoire #ecriture #guerredespagne #historique #politique #psychologique #xxesiecle
- le Mar 17 Oct - 12:34
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Javier Cercas
- Réponses: 96
- Vues: 12466
Cecil Scott Forester
Aspirant de marine
Premier volume du cycle Horatio Hornblower selon la chronologie du héros, et non la date de publication.
Horatio, âgé de dix-sept ans, embarque un temps sur le Justinian (juste le temps de montrer son courage de timide qui est bon en mathématiques et a le mal de mer), puis sur l’Indefatigable, une frégate qui donne la chasse aux navires français dans le golfe de Gascogne. L’action se situe peu après la Révolution française : l’Angleterre est en guerre avec la France. Assez vite aussi, il quitte la frégate pour prendre le commandement de l’équipage de prise de la Marie-Galante, brick français qui coule peu après. Ayant quitté le bord sur le canot, ils sont pris par le Pique, un corsaire français, auquel Horatio met le feu comme apparaît l’Indefatigable, qu’il regagne. Il participe activement à la prise du Papillon, corvette mouillée dans l’estuaire de la Gironde. Ils passent à l’abordage d’un autre navire français, tandis qu’Horatio sert un pierrier sur la hune du mat d’artimon, qui est fauché par des boulets. À bord de la Sophia, au départ de Plymouth, il est interprète dans le convoi d’une armée française royaliste partant en expédition en Bretagne, dont la tentative échoue. Dans une escarmouche avec des galères espagnoles (l’Espagne s’est ralliée aux Républicains français), Horatio en capture une en l’assaillant avec le canot qu’il commande. Puis il parvient à échouer un brûlot espagnol qui menaçait la rade de Gibraltar. Ensuite, il ramène d’Oran surprise par la peste une cargaison d’orge et de cheptel sur le brick-transport la Caroline, afin de ravitailler la flotte rationnée à cause du blocus européen – non sans capturer un lougre, garde-côte espagnol. Il ramène à Gibraltar le Rêve, un sloop capturé, dont il doit assurer le commandement pour le ramener en Angleterre – avec la duchesse de Wharfedale ; celle-ci est en fait une actrice, mais lui est fait prisonnier des Espagnols – et promu lieutenant pendant sa captivité (il a dix-huit ans) ; plus fort, il sauve des marins espagnols, ce qui lui vaudra sa libération. Ces dernières péripéties constituent le point d’orgue de ce palpitant roman d’aventures.
Succession rapide d’épisodes d’action, qui n’empêche pas un aperçu de la vie sur les bâtiments de ligne au XVIIIe siècle (avec le vocabulaire de la marine à voile). Le personnage d’Horatio est attachant, jeune homme s’efforçant sans cesse de se maîtriser et d’apprendre en respectant ses propres valeurs de courage et de rigueur.
« Il était de ce type d’homme qui eût continué à observer et à s’instruire sur son lit de mort. »
\Mots-clés : #aventure #guerre #historique #merlacriviere
- le Mar 3 Oct - 12:28
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Cecil Scott Forester
- Réponses: 5
- Vues: 323
Tzvetan Todorov
La conquête de l'Amérique - La question de l'autre
Exergue :
« Le capitaine Alonso Lopez de Avila s'était emparé pendant la guerre d'une jeune Indienne, une femme belle et gracieuse. Elle avait promis à son mari craignant qu'on ne le tuât à la guerre de n'appartenir à aucun autre que lui, et ainsi nulle persuasion ne put l'empêcher de quitter la vie plutôt que de se laisser flétrir par un autre homme ; c'est pourquoi on la livra aux chiens.
Diego de Landa, Relation des choses de Yucatan, 32
Je dédie ce livre à la mémoire
d'une femme maya
dévorée par les chiens. »
I Découvrir :
« Je veux parler de la découverte que le je fait de l'autre. »
Et tout particulièrement de la (non-)rencontre de Colon et des Indiens. Le premier est essentiellement finaliste, et découvre surtout ce qu’il s’attendait à découvrir.
« Les arbres sont les vraies sirènes de Colon. Devant eux, il oublie ses interprétations et sa recherche du profit, pour réitérer inlassablement ce qui ne sert à rien, ne conduit à rien, et qui donc ne peut être que répété : la beauté. « Il s'arrêtait plus qu'il ne voulait par le désir qu'il avait de voir et la délectation qu'il goûtait à regarder la beauté et la fraîcheur de ces terres n'importe où il entrait » (27.11.1492). Peut-être retrouve-t-il par là un mobile qui a animé tous les grands voyageurs, que ce soit à leur insu ou non.
L'observation attentive de la nature conduit donc dans trois directions différentes : à l'interprétation purement pragmatique et efficace, lorsqu'il s'agit d'affaires de navigation ; à l'interprétation finaliste, où les signes confirment les croyances et espoirs qu'on a, pour toute autre matière ; enfin à ce refus de l'interprétation qu'est l'admiration intransitive, la soumission absolue à la beauté, où l'on aime un arbre parce qu'il est beau, parce qu'il est, non parce qu'on pourrait s'en servir comme mât d'un bateau ou parce que sa présence promet des richesses. »
« L'attitude de Colon à l'égard des Indiens repose sur la perception qu'il en a. On pourrait en distinguer deux composantes, qu'on retrouvera au siècle suivant et, pratiquement, jusqu'à nos jours chez tout colonisateur dans son rapport au colonisé ; ces deux attitudes, on les avait déjà observées en germe dans le rapport de Colon à la langue de l'autre. Ou bien il pense les Indiens (sans pour autant se servir de ces termes) comme des êtres humains à part entière, ayant les mêmes droits que lui ; mais alors il les voit non seulement égaux mais aussi identiques, et ce comportement aboutit à l'assimilationnisme, à la projection de ses propres valeurs sur les autres. Ou bien il part de la différence ; mais celle-ci est immédiatement traduite en termes de supériorité et d'infériorité (dans son cas, évidemment, ce sont les Indiens qui sont inférieurs) : on refuse l'existence d'une substance humaine réellement autre, qui puisse ne pas être un simple état imparfait de soi. Ces deux figures élémentaires de l'expérience de l'altérité reposent toutes deux sur l'égocentrisme, sur l'identification de ses valeurs propres avec les valeurs en général, de son je avec l'univers ; sur la conviction que le monde est un. »
« C'est ainsi que par des glissements progressifs, Colon passera de l'assimilationnisme, qui impliquait une égalité de principe, à l'idéologie esclavagiste, et donc à l'affirmation de l'infériorité des Indiens. »
(Et Colon organisa effectivement une traite des Indiens, d’abord vus comme « bons sauvages », avec l’Espagne.)
« L'année 1492 symbolise déjà, dans l'histoire d'Espagne, ce double mouvement : en cette même année le pays répudie son Autre intérieur en remportant la victoire sur les Maures dans l'ultime bataille de Grenade et en forçant les juifs à quitter son territoire ; et il découvre l'Autre extérieur, toute cette Amérique qui deviendra latine. »
II Conquérir :
C’est celle du Mexique par Cortés, malgré un rapport numérique très déséquilibré des troupes. Todorov rappelle que les Aztèques étaient eux-mêmes de cruels conquérants, installés depuis relativement peu de temps.
Les Aztèques interprétaient les signes (prophéties des prêtres-devins) d’un monde surdéterminé dans une société fortement hiérarchisée, régie par l’ordre, avec « prééminence du social sur l'individuel ».
« Pris ensemble, ces récits, issus de populations fort éloignées les unes des autres, frappent par leur uniformité : l'arrivée des Espagnols est toujours précédée de présages, leur victoire est toujours annoncée comme certaine. »
« La première réaction, spontanée, à l'égard de l'étranger est de l'imaginer inférieur, puisque différent de nous : ce n'est même pas un homme, ou s'il l'est, c'est un barbare inférieur ; s'il ne parle pas notre langue, c'est qu'il n'en parle aucune, il ne sait pas parler, comme le pensait encore Colon. »
« Le chef de l'État lui-même est appelé tlatoani, ce qui veut dire, littéralement, « celui qui possède la parole » (un peu à la manière de notre « dictateur »), et la périphrase qui désigne le sage est « le possesseur de l'encre rouge et de l'encre noire », c'est-à-dire celui qui sait peindre et interpréter les manuscrits pictographiques. »
Les tergiversations de Moctezuma reflètent son désarroi devant une situation inédite, inattendue dans une société régie par le passé au sein d’un « temps cyclique, répétitif ».
Cortès, en vrai Machiavel, sait s’adapter et improviser, et manipule les Aztèques selon leurs croyances (mythe de Quetzalcoalt, etc.)
« …] l'intransigeance a toujours vaincu la tolérance. »
III Aimer :
« Si le mot génocide s'est jamais appliqué avec précision à un cas, c'est bien à celui-là. C'est un record, me semble-t-il, non seulement en termes relatifs (une destruction de l'ordre de 90 % et plus), mais aussi absolus, puisqu'on parle d'une diminution de la population estimée à 70 millions d'êtres humains. »
Pour s’enrichir rapidement, les conquistadors se laissent aller à toutes les cruautés ; ils massacrent sans compter, là où les Aztèques sacrifiaient.
« Le massacre, en revanche, révèle la faiblesse de ce même tissu social, la désuétude des principes moraux qui assuraient la cohésion du groupe ; du coup, il est accompli de préférence au loin, là où la loi a du mal à se faire respecter : pour les Espagnols, en Amérique, ou à la rigueur en Italie. Le massacre est donc intimement lié aux guerres coloniales, menées loin de la métropole. Plus les massacrés sont lointains et étrangers, mieux cela vaut : on les extermine sans remords, en les assimilant plus ou moins aux bêtes. L'identité individuelle du massacré est, par définition, non pertinente (sinon ce serait un meurtre) : on n'a ni le temps ni la curiosité de savoir qui on tue à ce moment. »
Des justifications de la guerre et de l’esclavage sont progressivement élaborées, les premières confinant au ridicule (comme le Requerimiento), jusqu’à la conférence de Valladolid, qui oppose la conception hiérarchique de Sepulveda et la conception égalitariste de Las Casas (Aristote versus le Christ). Mais le principe d’égalité chez Las Casas nie la différence :
« Le postulat d'égalité entraîne l'affirmation d'identité, et la seconde grande figure de l'altérité, même si elle est incontestablement plus aimable, nous conduit vers une connaissance de l'autre encore moindre que la première. »
Et le but reste la conversion à la « vraie foi » – et la soumission à la couronne espagnole : attitude colonialiste.
IV Connaître :
Cabeza de Vaca (ses « relations » forment un témoignage extraordinaire) constitue un bel exemple d’identification (relative). Le dominicain Diego Duran, farouche adversaire du syncrétisme religieux, étudie la religion aztèque, et forme involontairement un métissage culturel. Le franciscain Bernardino de Sahagun, enseignant et écrivain, outre son travail de prosélyte, a « le désir de connaître et de préserver la culture nahuatl ».
Épilogue :
Pour Todorov, « la connaissance de soi passe par celle de l'autre » (ethnologie) ; égalité et respect des différences doivent s’équilibrer.
« Le langage n'existe que par l'autre, non pas seulement parce qu'on s'adresse toujours à quelqu'un, mais aussi dans la mesure où il permet d'évoquer le tiers absent ; à la différence des animaux, les hommes connaissent la citation. »
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #esclavage #essai #genocide #historique #religion #spiritualité #traditions #violence #voyage
- le Ven 29 Sep - 11:25
- Rechercher dans: Sciences humaines
- Sujet: Tzvetan Todorov
- Réponses: 2
- Vues: 311
W.G. Sebald
De la destruction comme élément de l'histoire naturelle
Sebald constate que la destruction des villes allemandes par les raids aériens à la fin de la Seconde Guerre mondiale n’a pas été mémorisée en Allemagne, leur reconstruction ayant occulté le souvenir du passé historique avec le présent miracle économique.
« L’aptitude des hommes à oublier ce qu’ils ne veulent pas savoir, à détourner le regard de ce qu’ils ont devant eux, a rarement été mise à l’épreuve comme dans l’Allemagne de cette époque. On se décide, dans un premier temps sous l’emprise de la panique à l’état pur, à continuer comme si rien ne s’était passé. […]
Par ailleurs, le moyen le plus naturel et le plus sûr de “raison garder”, comme l’on dit, était encore de passer outre aux catastrophes survenues et de renouer avec la routine quotidienne, que ce soit en confectionnant un gâteau au four ou en continuant d’observer les rituels. »
À preuve le peu de témoignages recueillis, et le silence presque complet de la littérature allemande d’après-guerre à ce propos, à part notamment L’effondrement d’Hans Erich Nossack et Le Silence de l’ange d’Heinrich Böll, publié quarante ans plus tard ; Sebald cite aussi Automne allemand de Stig Dagerman, voir https://deschosesalire.forumactif.com/t300-stig-dagerman).
Il évoque « les errances de millions de sans-abri », en « profonde léthargie » et comme insensibles dans les ruines, et considère que cet anéantissement a été aussi illégal et immoral qu’illogique et militairement vain.
Le rapprochement avec la réaction japonaise à une situation en partie similaire n’est qu’à peine esquissé.
L’essai comporte trois parties (la troisième répondant aux attaques suscitées par les premières), et est suivi de L’écrivain Alfred Andersch, article très critique sur cet auteur de l’après-guerre.
Ces questions sont taraudantes, tant de la destruction de cités de l'Axe que du rebond des vaincus de la Seconde Guerre mondiale, et cet ouvrage permet au moins de les exposer, voire de leur apporter des éléments de réponse.
\Mots-clés : #deuxiemeguerre #essai #historique #xxesiecle
- le Mer 27 Sep - 12:16
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: W.G. Sebald
- Réponses: 74
- Vues: 8389
João Guimarães Rosa
Diadorim
Le titre original est Grande Sertão : veredas. Le sertão désigne les vastes régions semi-arides de l’intérieur du Brésil, où une population clairsemée vit surtout de l’élevage ; les chapadas, plateaux désertiques, sont parsemées de veredas, verdoyantes dépressions où l’eau se concentre, et donc la vie.
Riobaldo, surnommé Tatarana, ancien jagunço devenu fazendeiro (propriétaire d’une fazenda, ou vaste ferme), évoque devant le narrateur sa vie passée dans le sertão (les jagunços sont les hommes de main des fazendeiros, vivant en bandes armées et se livrant au brigandage, aussi considérés comme des preux).
« Vous le savez : le sertão c’est là où est le plus fort, à force d’astuces, fait la loi. Dieu lui-même, quand il s’amènera, qu’il s’amène armé. Et une balle est un tout petit bout de métal. »
« J’ai ramé une vie libre. Le sertão : ces vides qu’il est. »
« Le sertão est bon. Tout ici se perd ; tout ici se retrouve… disait le sieur Ornelas. Le sertão c’est la confusion dans un grand calme démesuré. »
Le sertão est hostile, mais a ses beautés, et les descriptions qui en sont données constituent un intérêt supplémentaire. À ce propos, l’emblématique buruti, c’est le palmier-bâche qui vit les pieds dans l’eau, le bem-te-vi, c’est le quiquivi, oiseau également fréquent en Guyane.
Riobaldo, comme beaucoup, ne connaît pas son père (en fait, à la mort de sa mère, il est recueilli par son parrain, qui serait son géniteur).
« L’homme voyage, il fait halte, repart : il change d’endroit, de femme – ce qui perdure c’est un enfant. »
Riobaldo parle de ses pensées qui l’obsèdent à propos du démon (qui a d’innombrables noms, dont « celui-qui-n’existe-pas ») : peut-on faire pacte avec lui ? Il parle aussi de Diadorim, son ami et amour, et des femmes qu’il aime. Il digresse, reprend le fil de son monologue : il évoque leur lieutenant, Medeiro Vaz, qui brûla sa fazenda, éparpilla les pierres de la tombe de sa mère pour aller mener une guerre de justice dans les hautes-terres, et leurs ennemis, les deux Judas félons (Hermὀgenes, protégé des enfers, et Ricardo) qui ont tué Joca Ramiro (père de Diadorim), et les soldats qui les combattent, et Zé Bebelo, stratège enjoué qui rêve de batailles et d’être député, puis remplace Medeiro Vaz à sa mort (et de qui Riobaldo fut percepteur, avant d’être dans le camp adverse, ce qui le tourmente). Car ce dernier narre dorénavant son existence depuis son enfance : comment il rencontra Reinaldo et fut séduit (ses amours sont plus généralement féminines, notamment la belle Otacilia, ou encore Norinha), Reinaldo qui lui confie s’appeler Diadorim.
À propos de la sensualité féminine, un passage qui rappelle Jorge Amado dans ses bonnes pages :
« L’une d’elles – Maria-des-Lumières – était brune : haute d’un huitième de cannelier. La chevelure énorme, noire, épaisse comme la fourrure d’un animal – elle lui cachait presque toute la figure, à cette petite mauresque. Mais la bouche était le bouton éclos, et elle s’offrait rouge charnue. Elle souriait les lèvres retroussées et avait le menton fin et délicat. Et les yeux eau-et-miel, avec des langueurs vertes, à me faire croire que j’étais à Goïas… Elle avait beaucoup de savoir-faire. Elle s’occupa aussitôt de moi. Ce n’était pas qu’une petite péronnelle.
L’autre, Hortense, une très gentille oiselle de taille moyenne, c’était Gelée-Blanche ce surnom parce qu’elle avait le corps si blanc ravissant, que c’était comme étreindre la froide blancheur de l’aube… Elle était elle-même jusqu’au parfum de ses aisselles. Et la ligne des reins, courbes ondulantes d’un ruisseau de montagne, confondait. De sorte que sa longueur exacte, vous n’arriviez jamais à la mesurer. Entre elles deux à la fois, je découvris que mon corps aussi avait ses tendretés et ses duretés. J’étais là, pour ce que je sais, comme le crocodile. »
Ce qui vaut surtout, c’est le monologue noté par son auditeur :
« Nous vivons en répétant, et bon, en une minime minute le répété dérape, et nous voilà déjà projetés sur une autre branche. »
Son récit décousu se commente lui-même, et sans doute l’auteur s’exprime-t-il lui-même par moments :
« Je sais que je raconte mal, je survole. Sans rectifier. Mais ce n’est pas pour donner le change, n’allez pas croire. […] Raconter à la suite, en enfilade, ce n’est vraiment que pour les choses de peu d’importance. De chaque vécu que j’ai réellement passé, de joie forte ou de peine, je vois aujourd’hui que j’étais chaque fois comme s’il s’agissait de personnes différentes. Se succédant incontrôlées. Tel je pense, tel je raconte. […] Et ce que je raconte n’est pas une vie d’homme du sertão, aurait-il été jagunço, mais la matière qui déborde. »
Riobaldo n’a jamais connu la peur, mais…
« Je sentis un goût de fiel sur le bout de ma langue. La peur. La peur qui vous coince. Qui me rattrapa au tournant. Un bananier prend le vent par tous les bords. L’homme ? C’est une chose qui tremble. Mon cheval me menait sans échéance. Les mulets et les ânes de la caravane, Dieu sait si je les enviais… Il y a plusieurs inventions de peur, je sais, et vous le savez. La pire de toutes est celle-ci : qui d’abord vous étourdit, et ensuite vous vide. Une peur qui commence d’emblée par une grande fatigue. Là où naissent nos énergies, je sentis qu’une de mes sueurs se glaçait. La peur de ce qui peut toujours arriver et qui n’est pas encore là. Vous me comprenez : le dos du monde. […] Je n’y arrivais pas, je ne pensais pas distinctement. La peur ne permettait pas. J’avais la cervelle embrumée, la tête me tournait. Je bus jusqu’à la lie le passage de la peur : je traversais un grand vide. »
« La peur manifeste provoque la colère qui châtie ; c’est bien tout ce à quoi elle sert. »
Le ton est celui du langage populaire, volontiers proverbial, traversé de fulgurances condensées voire lapidaires, très inventives et souvent poétiques, à l’encontre d’une rédaction rationnelle et claire. Allers-retours dans le temps de la remémoration (étonnamment riche, précise et détaillée), à l’instar des chevauchées et contre-marches de la troupe.
« Veuillez m’excuser, je sais que je parle trop, des à-côtés. Je dérape. C’est le fait de la vieillesse. Mais aussi, qu’est-ce qui vaut et qu’est-ce qui ne vaut pas ? Tout. Voyez plutôt : savez-vous pourquoi le remords ne me lâche pas ? Je crois que ce qui ne le permet pas c’est la bonne mémoire que j’ai. »
« Ah, mais je parle faux. Vous le sentez ? Si je démens ? Je démens. Raconter est très, très laborieux. Non à cause des années, passées depuis beau temps. Mais à cause de l’habileté qu’ont certaines choses passées – à faire le balancier, à ne pas rester en place. Ce que j’ai dit était-il exact ? Ça l’était. Mais ce qui était exact a-t-il été dit ? Aujourd’hui je crois que non. Ce sont tant d’heures passées avec les gens, tant de choses arrivées en tant de temps, tout se découpant par le menu. »
« Non, nenni. Je n’avais aucun regret. Ce que j’aurais voulu, c’était redevenir enfant, mais là, dans l’instant, si j’avais pu. J’en avais déjà plus qu’assez de leurs égarements à tous. C’est qu’à cette époque je trouvais déjà que la vie des gens va à vau-l’eau, comme un récit sans queue ni tête, par manque de joie et de jugement. La vie devrait être comme dans une salle de théâtre, et que chacun joue son rôle avec un bel entrain du début à la fin, qu’il s’en acquitte. C’était ce que je trouve, c’est ce que je trouvais. »
« Nous sommes des hommes d’armes, pour le risque de chaque jour et toutes les menues choses de l’air. »
« Mais les chemins sont ce qui gît partout sur la terre, et toujours les uns contre les autres ; il me revient que les formes les plus fausses du démon se reproduisent. Plus vous allez m’entendre, plus vous allez me comprendre. »
« On ne se met pas en colère contre le boa. Le boa étranglavale, mais il n’a pas de venin. Et il accomplissait son destin, tout réduire à un contenu. »
« La vie en invente ! On commence les choses, à l’obscur de savoir pourquoi, et dès lors le pouvoir de les continuer, on le perd – parce que la vie est le boulot de tous, triturée, assaisonnée par tous. »
« Tout cela pour vous, mon cher monsieur, ne tient pas debout, n’éclaire rien. Je suis là, à tout répéter par le menu, à vivre ce qui me manquait. Des choses minuscules, je sais. La lune est morte ? Mais je suis fait de ce que j’ai éprouvé et reperdu. De l’oublié. Je vais errant. Et se succédèrent nombre de petits faits. »
« Je sais : qui aime est toujours très esclave, mais ne se soumet jamais vraiment. »
« Qui le sait vraiment ce qu’est une personne ? Compte tenu avant tout : qu’un jugement est toujours défectueux, parce que ce qu’on juge c’est le passé. Eh, bé. Mais pour l’écriture de la vie, juger on ne peut s’en dispenser ; il le faut ? C’est ce que font seuls certains poissons, qui nagent en remontant le courant, depuis l’embouchure vers les sources. La loi est la loi ? Mensonge ! Qui juge, est déjà mort. Vivre est très dangereux, vraiment. »
La dernière phrase revient comme un leitmotiv dans le récit de Riobaldo :
« Vivre est très dangereux, je vous l’ai déjà dit. »
Apprécié en tant que bon tireur, Riobaldo parcourt donc le sertão qu’il aime, malgré les vicissitudes de cette existence itinérante, chevauchant de peines en batailles. Il médite sans cesse, sur la vie, l’amour, et par un curieux défi, dans sa haine d’Hermὀgenes qui aurait signé un pacte avec « l’Autre », décide d’en faire un lui aussi, bien qu’il ne croie ni à cette puissance maléfique, ni même à l’âme. Le démon ne se présente pas à la « croisée des chemins de Veredas-Mortes ».
« Alors, je ne sais ou non si j’ai vendu ? Je vous le dis : ma peur c’est ça. Tous la vendent, non ? Je vous le dis : de diable il n’y en a pas, le diable n’existe pas, et l’âme je la lui ai vendue… Ma peur, c’est ça. À qui l’ai-je vendue ? C’est ça, monsieur, ma peur : l’âme, on la vend, c’est tout, sans qu’il y ait acheteur… »
Cependant Riobaldo change. Lui, pour qui il n’était pas question de commander, devient le chef, Crotale-Blanc. Il reprend avec succès la traversée du Plan de Suçuarão, où avait échoué Medeiro Vaz, pour prendre à revers la fazenda d’Hermὀgenes.
Il y a encore les « pacants », rustres paysans croupissant dans la misère, victimes d’épidémies et des fazendeiros obnubilés par le profit, ou Siruiz, le jagunço poète, dont Riobaldo donne le nom à son cheval, ou encore le compère Quelémém, de bon conseil, évidemment Diadorim qu'il aime, et nombre d'autres personnages.
Ce livre-monde aux différentes strates-facettes (allégorie de la condition humaine, roman d’amour, épopée donquichottesque, geste initiatique – alchimique et/ou mythologique –, combat occulte du bien et du mal, cheminement du souvenir, témoignage ethnographique, récit de campagnes guerrières, etc.) est incessamment parcouru d’un souffle génial qui ramentoit Faust, mais aussi Ulysse (les deux).
Il est encore dans la ligne du fameux Hautes Terres (Os Sertões) d’Euclides da Cunha, par la démesure de la contrée comme de ceux qui y errent. L’esprit épique m’a aussi ramentu Borges et son exaltation des brigands de la pampa.
Sans chapitres, ce récit est un fleuve formidable dont le cours parfois s’accélère dans les péripéties de l’action, parfois s’alentit dans les interrogations du conteur : flot de parole, fil de pensée, flux de conscience. Et il vaut beaucoup pour la narration de Riobaldo ou, autrement dit, pour le style (c’est la façon de dire) rosien.
Le texte m’a paru excellemment rendu par la traductrice (autant qu’on puisse en juger sans avoir recours à l’original) ; cependant, il semble être difficilement réductible à une traduction, compte tenu de la langue créée par Rosa, inspirée du parler local et fort inventive.
\Mots-clés : #amour #aventure #contemythe #criminalite #ecriture #guerre #historique #initiatique #lieu #mort #nature #philosophique #portrait #ruralité #spiritualité #voyage
- le Ven 22 Sep - 13:06
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: João Guimarães Rosa
- Réponses: 26
- Vues: 1529
Jorge Semprun
Le Mort qu’il faut
À Buchenwald, en décembre 1944, Semprun est déporté depuis un an comme résistant ; il a vingt ans. Il fréquente notamment le sociologue Maurice Halbwachs et le sinologue Henri Maspero, qui vont y mourir l’année suivante, et un jeune Français lui aussi « Musulman », c'est-à-dire « les invalides et les exclus, marginalisés par le despotisme productiviste du système de travail forcé ».
« Prendre sur soi pour sortir de soi, somme toute. »
« Malgré tous les subterfuges, les ruses et les détours, il y avait toujours trop peu de pain pour que j’en garde en mémoire. C’était fini, pas moyen de me souvenir. Il n’y avait jamais assez de pain pour que j’en « fasse de la mémoire », aurait-on dit en espagnol, hacer memoria. La faim revenait aussitôt, insidieuse, envahissante, comme une sourde pulsion nauséeuse.
On ne pouvait faire de la mémoire qu’avec des souvenirs. Avec de l’irréel, en somme, de l’imaginaire. »
Comme il appartient à l’Arbeitsstatistik du « camp de rééducation » (« C’est la marotte des dictatures, la rééducation ! ») devenu « un camp punitif, d’extermination par le travail forcé », Semprun est un temps « animateur culturel », et peut lire Absalon ! Absalon ! (Faulkner) pendant ses nuits de comptabilisation des mouvements des travailleurs. Ainsi que disent les rescapés des premières années du camp, Buchenwald est devenu un « sana » (la fin de la guerre approche, les Américains tiennent Bastogne)… Dans les latrines collectives, leur seul asile, Semprun discute de Dieu et du Mal avec « Lenoir », un Juif autrichien, et Otto, « un "triangle violet", un Bibelforscher, un témoin de Jéhovah ».
« Quoi qu’il en soit, Otto, jadis, dans l’arrière-salle de l’Arbeit, venait de m’exposer une notion cruciale de Schelling, selon laquelle nulle part l’ordre et la forme ne représentent quelque chose d’originaire : c’est une irrégularité initiale qui constitue le fond cosmologique et existentiel. »
« Les kapos rouges de Buchenwald évitaient le bâtiment des latrines du Petit Camp : cour des miracles, piscine de Bethsaïda, souk d’échanges de toute sorte. Ils détestaient la vapeur pestilentielle de « bain populaire », de « buanderie militaire », l’amas des corps décharnés, couverts d’ulcères, de hardes informes, les yeux exorbités dans les visages gris, ravinés par une souffrance abominable.
— Un jour, me disait Kaminsky, effaré d’apprendre que j’y descendais parfois, le dimanche, en allant voir Halbwachs au block 56, ou en revenant d’un entretien avec lui, un jour, ils se jetteront sur toi, en s’y mettant nombreux, pour te voler tes chaussures et ton caban de Prominent ! Qu’y cherches-tu, bon sang ?
Il n’y avait pas moyen de le lui faire entendre.
J’y cherchais justement ce qui l’effrayait, lui, ce qu’il craignait : le désordre vital, ubuesque, bouleversant et chaleureux, de la mort qui nous était échue en partage, dont le cheminement visible rendait ces épaves fraternelles. C’est nous-mêmes qui mourions d’épuisement et de chiasse dans cette pestilence. C’est là que l’on pouvait faire l’expérience de la mort d’autrui comme horizon personnel : être-avec-pour-la-mort, Mitsein zum Tode.
On peut comprendre, cependant, pourquoi les kapos rouges évitaient cette baraque.
C’était le seul endroit de Buchenwald qui échappât à leur pouvoir, que leur stratégie de résistance ne parviendrait jamais à investir. Le spectacle qui s’y donnait, en somme, était celui de leur échec toujours possible. Le spectacle de leur défaite toujours menaçante. Ils savaient bien que leur pouvoir restait fragile, par essence, exposé qu’il était aux caprices et aux volte-face imprévisibles de la politique globale de répression de Berlin.
Et les Musulmans étaient l’incarnation, pitoyable et pathétique, sans doute, mais insupportable, de cette défaite toujours à craindre. Ils montraient de façon éclatante que la victoire des SS n’était pas impossible. Les SS ne prétendaient-ils pas que nous n’étions que de la merde, des moins-que-rien, des sous-hommes ? La vue des Musulmans ne pouvait que les conforter dans cette idée.
Précisément pour cette raison, il était, en revanche, difficile de comprendre pourquoi les SS, eux aussi, évitaient les latrines du Petit Camp, au point d’en avoir fait, involontairement sans doute, un lieu d’asile et de liberté. Pourquoi les SS fuyaient-ils le spectacle qui aurait dû les réjouir et les réconforter, le spectacle de la déchéance de leurs ennemis ?
Aux latrines du Petit Camp de Buchenwald, ils auraient pu jouir du spectacle des sous-hommes dont ils avaient postulé l’existence pour justifier leur arrogance raciale et idéologique. Mais non, ils s’abstenaient d’y venir : paradoxalement, ce lieu de leur victoire possible était un lieu maudit. Comme si les SS – dans ce cas, ç’aurait été un ultime signal, une ultime lueur de leur humanité (indiscutable : une année à Buchenwald m’avait appris concrètement ce que Kant enseigne, que le Mal n’est pas l’inhumain, mais, bien au contraire, une expression radicale de l’humaine liberté) – comme si les SS avaient fermé les yeux devant le spectacle de leur propre victoire, devant l’image insoutenable du monde qu’ils prétendaient établir grâce au Reich millénaire. »
Des vers de Rimbaud, Valéry, Machado, Lorca et d’autres poètes, des passages de L’espoir de Malraux reviennent à Semprun.
Apparemment bien organisé, l’appareil de renseignement des communistes allemands au sein du camp (en la personne de « Kaminsky ») apprend qu’il est recherché par la Gestapo, et a trouvé un moribond qui correspond à son profil, dont il pourra endosser l’identité – l’homme en question est « le jeune Musulman français ». À ses cotés sur un châlit du Revier, l’infirmerie, il suit son agonie, médite la finitude humaine.
« Non, pas moi, François, je ne vais pas mourir. Pas cette nuit, en tout cas, je te le promets. Je vais survivre à cette nuit, je vais essayer de survivre à beaucoup d’autres nuits, pour me souvenir.
Sans doute, et je te demande pardon d’avance, il m’arrivera d’oublier. Je ne pourrai pas vivre tout le temps dans cette mémoire, François : tu sais bien que c’est une mémoire mortifère. Mais je reviendrai à ce souvenir, comme on revient à la vie. Paradoxalement, du moins à première vue, à courte vue, je reviendrai à ce souvenir, délibérément, aux moments où il me faudra reprendre pied, remettre en question le monde, et moi-même dans le monde, repartir, relancer l’envie de vivre épuisée par l’opaque insignifiance de la vie. Je reviendrai à ce souvenir de la maison des morts, du mouroir de Buchenwald, pour retrouver le goût de la vie. »
La mémoire, les douloureuses modalités du souvenir sont centrales dans cet ouvrage, avec la puissance de la littérature ; Semprun évoque aussi la vie quotidienne du camp : la promiscuité, les castes, la lutte pour la survie, la solidarité et ses limites – et les musiques, des chanteuses allemandes diffusées au jazz clandestin, en passant par les souvenirs de flamenco et la fanfare qui accompagne le départ au travail (voir https://expo-musique-camps-nazis.memorialdelashoah.org/). Impressionnant témoignage, qui complète Le Grand Voyage et L'Écriture ou la Vie. Étonnamment (pour moi), Semprun remet en question le travail des historiens sur la période : d’après lui, ils auront les coudées franches lorsque les derniers témoins se tairont à jamais…
\Mots-clés : #autobiographie #campsconcentration #deuxiemeguerre #historique #politique #temoignage #xxesiecle
- le Sam 9 Sep - 18:34
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jorge Semprun
- Réponses: 30
- Vues: 2676
Pierre de l'Estoile
Journal du règne de Henri III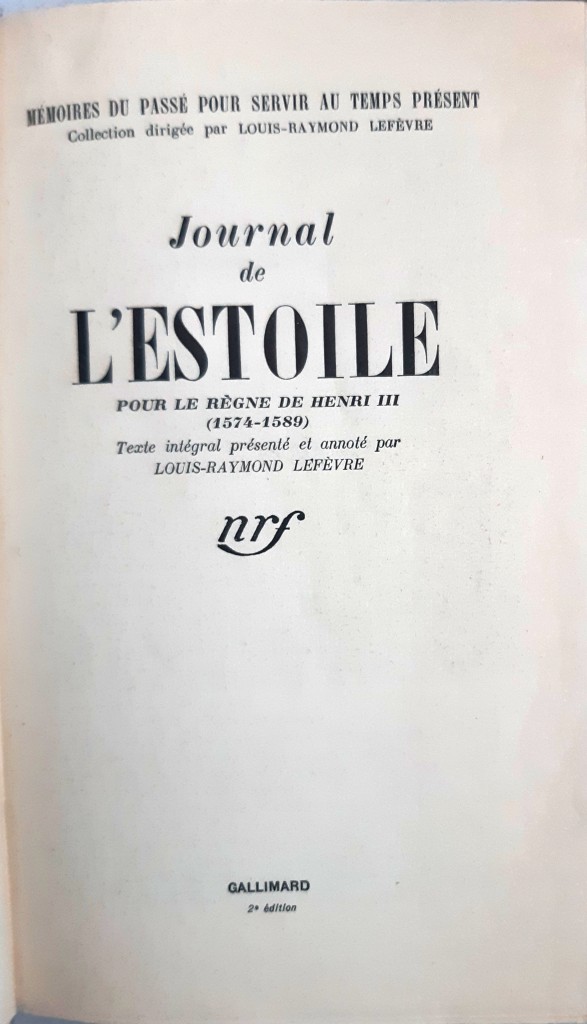
« En ce registre que j’appelle le magasin de mes curiosités, on m’y verra, comme dit le sieur de Montaigne, en ses « Essais », parlant de soi, tout nu, et tel que je suis, mon naturel au jour, mon âme libre et toute mienne, accoutumée à se conduire à sa mode, non toutefois méchante ni maligne, mais trop portée à une vaine curiosité et liberté (dont je suis marri). »
Pour ne pas vous imposer un pensum trop long, je sépare en deux parties :
Partie I : le contexte
Pierre de l’Estoile débute son journal en 1574, à la mort du roi Charles IX et à l’avènement de son frère, Henri III, alors roi de Pologne. C’est un moment où le pouvoir royal est très affaibli après le bref règne de François II, puis celui de Charles IX dont la mémoire est entachée par le massacre de la saint Barthélemy survenu deux ans plus tôt.
Le pays est toujours déchiré par les querelles religieuses opposant catholiques et protestants. A l’extérieur, les nations allemandes, l’Angleterre, l’Espagne, soufflent sur les braises prêtes à se rallumer à tout instant. En réalité, trop souvent, le prétexte religieux sert de justificatif à l’ambition personnelle des princes : Condé, Guise, Mayenne, Montmorency … Les grands du royaume montent des expéditions composées en partie de mercenaires, peu ou mal payés, gens souvent sans foi ni loi :
« Au commencement d’avril, les huguenots firent contenance d’assiéger la ville de Nevers et la branquetèrent de trente mille francs, comme ils avaient auparavant branqueté ceux de la Limagne, d’Auvergne, de cent cinquante mille livres, et ceux de Berry de quarante mille livres. D’autre côté, les gens de pied et de cheval partisans du roi, épandus par tous les endroits du royaume, vivant sans conduite ou discipline militaire à discrétion, sous ombre qu’ils n’étaient pas payés, pillaient, brigandaient, ravageaient, saccageaient, tuaient, brûlaient, violaient et rançonnaient villages et leurs villageois, bourgs et bourgeois. Par ainsi le pauvre était pillé et ruiné, et le peuple mangé de tous les deux partis ; car si en l’un il y avait bien des larrons, il n’y avait pas faute de brigands en l’autre. »
Avril 1576
Ces razzias incessantes sont source de misère. Il suffit alors d’une mauvaise récolte pour déclencher la disette :
« En ce mois d’août, quasi par toute la France, les pauvres gens des champs, mourant de faim, allaient par troupes, couper sur les terre les épis de blé à demi mûrs et les manger à l’instant pour assouvir leur faim effrénée ; et ce, en dépit des laboureurs, et autres auxquels les blés pouvaient appartenir, si d’aventure ils ne se trouvaient les plus forts, même les menaçaient ces pauvres gens de les manger eux-mêmes s’ils ne leur permettaient de manger les épis de leur blé. »
Août 1586
« Le vendredi 22 juillet, aux halles de Paris, le peuple se mutina contre les boulangers, vendant leur pain trop chèrement à son gré, ravit leur dit pain à force ouverte, et furent tués deux bourgeois passant par là, qui ne pouvaient mais de la querelle, au contraire tâchaient de l’apaiser. Grand fut ce séditieux tumulte, jusqu’à forcer les maisons de quelques bourgeois, esquelles le peuple avait opinion que lesdits boulangers avaient retiré et caché leur pain. Toutes les hottes et charrettes desdits boulangers, qui se trouvèrent au marché, furent brûlées. »
Juillet 1587
Quant au roi, très décrié, il œuvre sincèrement à l’unité du pays, à limiter les désordres et à réformer les institutions. Par ailleurs, il cherche à redonner du prestige à la fonction royale. Moins porté que ses prédécesseurs sur les valeurs chevaleresques traditionnelles, joutes et pratique intensive de la chasse, il est plutôt attiré par la danse, la musique, le théâtre, le raffinement des costumes, les fêtes. Ces goûts qu’il cultive jusqu’à la préciosité sont mal perçus par la population qui souffre de la dureté des temps :
« Cependant le roi faisait tournois, joutes et ballets et force mascarades, où il se trouvait ordinairement habillé en femme, ouvrait son pourpoint et découvrait sa gorge, y portant un collier de perles et trois collets de toile, deux à fraise et un renversé, ainsi que lors portaient les dames de la cour ; et était bruit que, sans le décès de messire Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, son beau-père, peu auparavant advenu, il eût dépendu au carnaval, en jeux et mascarades, cent ou deux cent mille francs, tant était le luxe enraciné au cœur de ce prince. »
24 février 1577
« En ce temps, le roi commença de porter un bilboquet à la main, même allant par les rues, et s’en jouait comme font les petits enfants. Et à son imitation, les ducs d’Epernon et de Joyeuse et plusieurs autres courtisans s’en accommodaient, qui étaient en ce suivis des gentilshommes, pages, laquais et jeunes gens de toutes sortes. Tant ont de poids et de conséquence (principalement en matière de folies) les actions et déportements des rois, princes et grands seigneurs ».
Août 1585
Le roi s’entoure de « mignons », ils forment une sorte de garde rapprochée et sont totalement fidèles au souverain. Les mignons sont hais du peuple pour leur mode de vie efféminé, leur luxe, leur morgue.
« Le dimanche 20 octobre, le roi arriva à Olainville en poste avec la troupe de ses jeunes mignons, fraisés et frisés avec les crêtes levées, les ratepennades en leurs têtes, un maintien fardé avec l’ostentation de même, peignés, diaprés et pulvérisés de poudres violettes et senteurs odorifantes, qui aromatisaient les rues, places et maisons où ils fréquentaient. »
Octobre 1577
« Ces beaux mignons portaient leurs cheveux onguets, frisés et refrisés par artifices, remontant par-dessus leurs petits bonnets de velours, comme font les putains du bordeau, et leur fraise de chemises de toile d’atour empesées et longues de demi-pied, de façon qu’à voir leur tête dessus leur fraise, il semblait que ce fût le chef de saint Jean dans un plat ; le reste de leurs habillements fait de même ; leurs exercices étaient de jouer, blasphémer, sauter, danser, volter, quereller et paillarder, et suivre le roi partout et en toutes compagnies, ne faire, ne dire rien que pour lui plaire ; peu soucieux en effet de Dieu et de la vertu, se contentant d’être en bonne grâce de leur maître qu’ils craignaient et honoraient plus que Dieu »
Juillet 1576
Pour ces mignons, le roi dépense des fortunes. En 1581, les noces du duc de Joyeuse prennent un caractère pharaonique et font gronder le peuple.
« Les habillements du roi et du marié étaient semblables, tant couverts de broderie, perles et pierreries, qu’il était impossible de les estimer, car tel accoutrement y avait qui coûtait dix mille écus de façon ; et toutefois aux dix-sept festins qui de rang de jour à autre par l’ordonnance du roi depuis les noces, furent faits par les princes et seigneurs, parents de la mariée et autres des plus grands et apparents de la cour, tous les seigneurs et les dames changèrent d’accoutrement, dont la plupart étaient de toile et drap d’or et d’argent, enrichis de passements, guimpures, recanures et broderies d’or et d’argent, et de pierre et perles en grand nombre et de grand prix. La dépense y fut faite si grande, y compris les mascarades, combats à pied et à cheval, joutes, tournois, musiques, danses d’hommes et femmes, et chevaux, présents et livrées, que le bruit était que le roi n’en serait point quitte pour douze mille écus. ¬[…] Et était tout le monde ébahi d’un si grand luxe, et tant énorme et superflue dépense qui se faisait par le roi et par les autres de sa cour de son ordonnance et exprès commandement en un temps mêmement qui n’était des meilleurs du monde, ains fâcheux et dur pour le peuple, mangé et rongé jusqu’aux os en la campagne par les gens de guerre, et aux villes par nouveaux offices, impôts et subsides. »
Septembre 1581
Parfois ces mignons s’entretuent pour des questions de préséance, de femmes, d’honneur, de rivalité entre clans….
« Le dimanche 27 avril, pour démêler une querelle née pour fort légère occasion, le jour précédent, en la cour du Louvre, entre le seigneur de Caylus, l’un des grands mignons du roi, et le jeune Entragues, qu’on appelait Entraguet, favori de la maison de Guise, ledit Caylus avec Maugiron et Livarot, et d’Entragues avec Ribérac et le jeune Schomberg, se trouvèrent, dès cinq heures du matin, au Marché-aux-chevaux (anciennement les Tournelles, près la Bastille Saint-Antoine), et là combattirent si furieusement que le beau Maugiron et le jeune Shomberg demeurèrent morts sur la place ; Ribérac, des coups qu’il y reçut, mourut le lendemain à midi ; Livarot, d’un grand coup qu’il eut sur la tête, fut six semaines malade et enfin réchappa ; Entraguet s’en alla sain et sauf avec un petit coup qui n’était qu’une égratignure au bras ; Caylus, auteur et agresseur de la noise, de dix-neuf coups qu’il y reçut, languit trente-trois jours et mourut le jeudi vingt-neuvième mai, en l’hôtel de Boisy où il fut porté du champ du combat comme lieu plus ami et plus voisin. »
Avril 1578
L’époque est violente : guet-apens, pistolades, arquebusades, coups de poitrinal, d’épée ou de dague sont légion :
« Le vendredi 29 mai, à six heures du soir, un gentilhomme de Berry, nommé Beaupré (qui se disait avoir été outragé par le seigneur d’Aramont, son voisin, allant à la chasse) accompagné de cinq autres, tous bien montés sur coursiers et chevaux d’Espagne, vint charger ledit seigneur d’Aramont, étant en un carrosse, près la porte Buci à Paris, avec le seigneur de Bouchemont et les dames maréchale de Retz et de la Bourdaisière, à grands coups de pistolets, et fut ledit seigneur d’Aramont blessé d’un coup de pistolet au bras droit, dont les balles lui froissèrent les os depuis le coude jusques à l’épaule […]. Le seigneur de Bouchemont, qui n’était point de la querelle, faisant contenance de vouloir sortir du carrosse, fut atteint de trois coups de pistolet en la tête et au corps, et mourut sur-le-champ. Le trompette du seigneur d’Aumont, le suivant à cheval, donna un coup d’épée au travers du corps d’un des assaillants, qui avait arrêté et blessé le cocher, lequel fuyant avec les autres, à quatre lieues de Paris, ne pouvant plus se soutenir, fut achevé par Beaupré et défiguré par le visage à coups de dague, afin qu’il ne fût reconnu ; et le lendemain fut son corps rapporté à Paris. »
Mai 1579
Il ne se passe pas de semaine sans exécutions dans la bonne ville de Paris, pour différents motifs :
" Le 11e jour de juillet, à Paris, devant l’hôtel de Bourbon, furent pendus un nommé Larondelle et un autre sien complice et compagnon, chacun d’eux âgé de soixante ans et plus, atteints et convaincus d’avoir l’un gravé les sceaux de la chancellerie du roi, et l’autre scellé plusieurs lettres d’importance, avec lesdits faux et contrefaits sceaux, desquels ils usaient avec telle dextérité que même le chancelier et les secrétaires d’Etat et autres, desquels ils contrefaisaient les seings et les sceaux, y étaient abusés, de mode que voyant lesdits sceaux et seings contrefaits, ils osaient assurer que c’étaient leurs seings et sceaux propres. »
Juillet 1584
« Le 15 juillet, Jeanne le Juge, fille d’un apothicaire épicier, demeurant en la rue Saint-Martin, prés Saint-Jacques de l’Hôpital , âgée de seize à dix-sept ans, par sentence du lieutenant-criminel, confirmée par arrêt de la cour, fut pendue et étranglée en Grève à Paris, et son corps ars sous la potence, pour avoir à son mari (avec lequel elle avait été mariée environ un an auparavant et ne l’aimait ni ne s’accordait aucunement avec lui), baillé de l’arsenic sublimé en un potage, dont il était mort trois ou quatre jours après.
Ce même jour, à Paris, devant l’hôtel de Bourbon, par sentence du prévôt de l’Hôtel, confirmée par arrêt du grand conseil, fut brûlé vif un quidam, suivant la cour, qui avait violé et gâté trois petites filles, dont la plus âgée n’avait pas atteint l’âge de dix ans. »
Juillet 1585
Autre condamnation d’un apprenti sorcier en explosifs qui invente une vraie machine infernale… :
« Le samedi 26 septembre, fut rompu et mis sur la roue, à Paris, un Normand nommé Chantepie, qui avait envoyé au seigneur de Meilhaud d’Alègre, par un laquais, une boîte artificieusement par lui composée, dans laquelle étaient arrangés trente-six canons de pistolets, chargés chacun de deux balles, et y était un ressort accommodé de façon qu’ouvrant la boîte, ce ressort lâchant faisait feu, lequel prenant à l’amorce à ce préparée, faisait à l’instant jouer les trente-six canons et jeter soixante-douze balles, dont à peine se pouvaient sauver ceux qui se trouvaient à l’environ. »
Septembre 1587
De son côté, le roi continue de s’amuser et, par repentance, se complait dans des manifestations ostentatoires de dévotion :
« Le jeudi saint 7 avril, sur les neuf heures du soir, la procession des Pénitents, où le roi était avec tous ses mignons, alla toute la nuit par les rues et aux églises, en grande magnificence de luminaire et musique excellente faux-bourdonnée. Et y en eut quelques-uns, même des mignons à ce qu’on disait, qui se fouettèrent en cette procession, auxquels on voyait le pauvre dos tout rouge des coups qu’ils se donnaient. »
Avril 1583
« Aux jours gras, le roi fait mascarades, ballets et festins aux dames, selon sa mode accoutumée, et se donne du plaisir et du bon temps tout son saoul ; et persévérant en ses dévotions (que beaucoup appelaient hypocrisie), le premier jour de carême se renferme aux Capucins, faisant ou feignant y faire pénitence avec ses mignons. »
Février 1587
Le roi fait venir des Feuillants de Toulouse, réputés pour leur sainteté. Certains ne tardent pas à se laisser corrompre :
« Quelques-uns des Feuillants se firent suivre et admirer en leurs prédications, entre autres un frère Bernard, gascon, âgé de vingt-un à vingt-deux ans, vivant (selon le bruit commun) fort saintement et austèrement, et disant bien jusques à miracle. Ce qui fut tant agréable aux dames de Paris, que l’allant voir souvent, elles lui changèrent son austérité en mignardise, lui envoyant si souvent de leurs confitures qu’elles lui firent enfin venir, comme l’on disait, l’appétit de la chair. »
Juillet 1587
Quant aux princes de l’église, il y aurait parfois à redire… Portrait d’Aimeric de Rochechouart, évêque de Sisteron :
« Remarquable fidèle de Bacchus et compagnon de Vénus, première gloire et première louange du troupeau d’Epicure, redoutable avant tout par la pointe de sa langue cynique, ardent à blesser Jupiter de sa bouche parjure, quant au reste pieux évêque, qui, large aux indigents, effaça ses lourdes fautes par ses aumônes et racheta ses débauches par autant de dons, toujours réjoui de nouveaux adultères, jamais il ne refusa ses propres ressources aux vierges consacrées de l’amour incestueux desquels il brûla. Sa mort fut semblable à sa vie ; la vie et la mort marchèrent du même pas. En effet, une proche le visitant alors qu’il était mourant, cette femme digne des plus grands amants lui dit : « Me voici, évêque, je me présente avec obligeance à celui qui me demande. Dis-moi donc si quelque chose de moi peut t’être de quelque douceur ? ». Et lui, mourant, répondit ainsi, sans tristesse : « Donne-moi ton con. Rien ne me plaît de toi que lui. Ce qui est cher aux vivants doit être cher aux mourants. » Dernières paroles, dignes d’un tel pontife. »
Décembre 1580
Sinon, à la cour, se sont les habituelles querelles ridicules de préséance (elles seront toujours de mise à l’époque de Saint-Simon) :
« Le 3 mai, au Louvre, au dîner du roi, y eut prise entre le comte de Saint-Paul, second fils de la maison de Longueville, et le duc de Nemours, sur ce que chacun d’eux prétendait être préférable à l’autre pour bailler la serviette au roi quand il lavait ; et montait leur débat en hautesse de paroles et grand querelle, quand le roi craignant pis, les accorda sur le champ, leur défendant très expressément de passer outre, et commandant que dès lors en avant un des gentilshommes servants lui baillât la serviette et non autre. »
Mai 1587
Les jeux d’esprit : une anecdote que le réalisateur Patrice Leconte a transposée au 18e siècle dans son film « Ridicule » :
« Le vendredi 25 de ce mois, advint au dîner du roi que monsieur Du Perron, grand discoureur et philosophe, et que le roi oioit volontiers, comme faisant cas de son esprit et de sa mémoire, fit un brave discours contre les athéistes et comme il y avait un Dieu, et le prouva par des raisons si claires, évidentes et à propos, qu’il semblait bien n’y avoir lieu aucun d’y contredire ; à quoi le roi montra qu’il avait pris plaisir et l’en loua. Mais Du Perron s’oubliant, comme font ceux de son humeur que le plus souvent la présomption et vaine gloire transportent et éblouissent, va dire au roi : « Sire, j’ai prouvé aujourd’hui, par raisons très bonnes et évidentes, qu’il y avait un Dieu ; demain, Sire, s’il plaît à Votre Majesté me donner encore audience, je vous montrerai et prouverai par raisons aussi bonnes et évidentes qu’il n’y a point du tout de Dieu. » Sur quoi le roi entrant en colère, chassa ledit Du Perron, et l’appela méchant, lui défendant de se plus trouver devant lui, ni comparoir en sa présence. »
Novembre 1583
Le roi ne manque pas d’esprit à certaines occasions :
« Le 14 juillet, le roi et la reine sa femme arrivèrent à Paris revenant du pays de Normandie, d’où ils rapportèrent grande quantité de guenons, perroquets et petits chiens achetés à Dieppe. Entre ces perroquets, la plupart, sifflés par les huguenots, jargonnaient mille fadaises et drôleries contre la messe, le Pape et cérémonies de l’Eglise romaine ; dont quelques-uns s’offensant, le dire au roi, qui fit réponse qu’il ne se mêlait point de la conscience des perroquets. »
Juillet 1576
\Mots-clés : #historique #violence
- le Lun 28 Aoû - 17:24
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Pierre de l'Estoile
- Réponses: 2
- Vues: 359
Jonathan Coe
Le Cœur de l'Angleterre
Troisième et dernier tome de la trilogie Les Enfants de Longbridge (paru bien après Bienvenue au club et Le Cercle fermé), sur la famille Trotter dans la seconde moitié du XXe, et ici au début du XXIe.
2010, le racisme est patent sous le couvert de la société multiculturelle épanouie. Août 2011 : émeutes et pillages de jeunes (la fracture est aussi générationnelle).
« On apercevait bien quelques émeutiers blancs et quelques policiers noirs, mais le face-à-face donnait l’impression écrasante d’un conflit racial. »
Le gouvernement considère qu’il s’agit de « débordements criminels, pas politiques ».
« Mais regardez plutôt comment ça a commencé. La police a abattu un Noir et refusé de communiquer avec sa famille sur les circonstances de sa mort. Une foule s’est rassemblée devant le commissariat pour protester et les choses ont tourné à l’aigre. Ce qui est en cause c’est le problème racial et les relations de pouvoir au sein de la communauté. Les gens se sentent victimes. On ne les écoute pas. »
Comme de coutume dans cette trilogie, Coe nous entraîne dans les arcanes de la politique (notamment grâce à Doug, journaliste positionné à gauche, qui semble porter l’opinion de Coe) ; mais on aborde aussi, avec le personnage de Sophie, le milieu universitaire, « cette manie de se polariser sur un sujet jusqu’à l’obsession en ignorant superbement le reste du monde », et celui de l’édition avec Philip et Benjamin.
Après la crise de 2008, David Cameron mène une politique d’austérité, et initie le référendum qui conduira au Brexit ; il recourt au nationalisme, mais la peur de l’immigration est prépondérante ; la désindustrialisation est passée par là. Et arrive Boris Johnson…
« Pourquoi est-ce que les journalistes aiment tant les questions hypothétiques ? Et qu’est-ce qui se passe si vous perdez ? Et qu’est-ce qui se passe si on quitte l’UE ? Qu’est-ce qui se passe si Donald Trump est élu président ? Vous vivez dans un monde imaginaire, vous autres. »
« Les gens vont voter comme ils votent toujours, c’est-à-dire avec leurs tripes. Cette campagne va se gagner avec des slogans, des accroches, à l’instinct et à l’émotion. Sans parler des préjugés [… »
Entretemps, Benjamin connaît un certain succès avec la publication du roman extrait de son énorme manuscrit, roman qui reprend son histoire avec Cicely (qui est partie seule en Australie soigner sa sclérose en plaques).
Côté social, le politiquement correct est présenté comme la cible de conservateurs âgés que rebutent la société multiculturelle ; en contrepoint est présenté le cas de Sophie, suspendue (et jetée en pâture aux réseaux sociaux) car (injustement) accusée de discrimination genrée par Coriandre, l’hargneuse fille de Doug.
Les retrouvailles de Benjamin et Charlie Chappell, clown pour goûters d’enfants en conflit avec son rival Duncan Field, sont l’occasion pour Coe de réitérer sa conception du destin :
« Benjamin comprenait qu’il voyait la vie comme une succession d’aléas qu’on ne pouvait ni prévenir ni maîtriser, si bien qu’il ne restait plus qu’à les accepter et tâcher d’en tirer parti autant que faire se pouvait. C’était une saine conception des choses mais qu’il n’avait jamais réussi à faire tout à fait sienne, pour sa part. »
C’est surtout la nostalgie et la désillusion qui percent dans cet après-Brexit, marqué par un exil en Europe pour quelques Trotter cherchant à échapper au passé.
\Mots-clés : #contemporain #famille #historique #nostalgie #politique #relationenfantparent #romanchoral #social #xxesiecle
- le Ven 25 Aoû - 17:27
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Jonathan Coe
- Réponses: 57
- Vues: 3185
Jonathan Coe
Le Cercle fermé
(En complément au commentaire approfondi de Pinky.)
1999 (livre paru en 2004), Claire revient d’Italie en Angleterre après cinq ans d’absence, et se confie par écrit à sa sœur Miriam, disparue (c’est la suite de Bienvenue au club, où les mêmes personnages vivaient dans les années soixante-dix). Le portable est devenu inévitable :
« …] quantité de gens qui ne travaillent plus, qui ne fabriquent rien, ne vendent rien. Comme si c’était démodé. Les gens se contentent de se voir et de parler. Et quand ils ne se voient pas pour parler directement, ils sont généralement occupés à parler au téléphone. Et de quoi ils parlent ? Ils prennent rendez-vous pour se voir. Mais je me pose la question : quand enfin ils se voient, de quoi ils parlent ? »
Nous savons depuis que lorsque les gens se voient, ils parlent à d’autres, sur leur portable.
Intéressante mise en parallèle des vies de couple de Benjamin et Doug, qui parviennent à se ménager une vie privée digne d’un célibataire – non sans une autre présence féminine, à laquelle ils ne savent guère faire face, incapables de prendre une décision.
« C’est là un défaut pathologique du sexe masculin. Nous n’avons aucune loyauté, aucun sens du foyer, aucun instinct qui nous pousserait à protéger le nid : tous ces réflexes naturels et sains qui sont inhérents aux femmes. On est des ratés. Un homme, c’est une femme ratée. C’est aussi simple que ça. »
Les profonds changements dans la communication sont particulièrement approfondis :
« Donc, d’après vous, si je comprends bien, disait Paul, le discours politique est devenu un genre de champ de bataille où politiciens et journalistes s’affrontent jour après jour sur le sens des mots.
— Oui, parce que les politiciens font tellement attention à ce qu’ils disent, les déclarations politiques sont devenues tellement neutres que c’est aux journalistes qu’il incombe de créer du sens à partir des mots qu’on leur donne. Ce qui compte aujourd’hui, ce n’est plus ce que vous dites, vous autres, c’est la manière dont c’est interprété. »
« C’est très moderne, l’ironie, assura-t-elle. Très in. Vous voyez, vous n’avez plus besoin d’expliciter ce que vous voulez dire. En fait, vous n’avez même pas besoin de penser ce que vous dites. C’est toute la beauté de la chose. »
« Il y a quelques mois, par exemple, ils ont pris des photos d’un top model particulièrement rachitique pour un article de mode du supplément dominical, mais elle avait l’air tellement squelettique et mal en point qu’ils ont renoncé à les utiliser. Et puis la semaine dernière ils ont fini par les déterrer pour illustrer un article sur l’anorexie psychosomatique. Visiblement, ça ne leur posait aucun problème. »
« Oh, de nos jours, tout dépend de la manière dont c’est présenté par les médias, pas vrai ? À croire que tout dépend de ça. »
Le Cercle fermé est créé au sein de la Commission travailliste réfléchissant au financement privé du secteur public (on est sous Tony Blair) ; l’extrême droite commence à monter.
Benjamin est un personnage central ; écrivain et musicien (assez raté), il reflète peut-être un aspect (ironique) du projet romanesque de Coe.
« Ce serait satisfaisant, d’une certaine façon ; il y aurait là un peu de la symétrie qu’il passait tant de temps à traquer en vain dans la vie, le sentiment d’un cercle qui se referme... »
« Je suis un homme, blanc, d’âge moyen, de classe moyenne, un pur produit des écoles privées et de Cambridge. Le monde n’en a pas marre des gens comme moi ? Est-ce que je n’appartiens pas à un groupe qui a fait son temps ? Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux fermer notre gueule et laisser la place aux autres ? Est-ce que je me fais des illusions en croyant que ce que j’écris est important ? Est-ce que je me contente de remuer les cendres de ma petite vie et d’en gonfler artificiellement la portée en plaquant dessus des bouts de politique ? »
Puis c’est le 11 septembre 2001, et l’approche de la « guerre à l’Irak ».
« La guerre n’avait pas encore commencé, mais tout le monde en parlait comme si elle était inévitable, et on était forcément pour ou contre. À vrai dire, presque tout le monde était contre, semblait-il, à part les Américains, Tony Blair, la plupart de ses ministres, la plupart de ses députés et les conservateurs. Sinon, tout le monde trouvait que c’était une très mauvaise idée, et on ne comprenait pas pourquoi on en parlait soudain comme si c’était inévitable. »
Le compte à rebours des chapitres souligne le suspense des drames personnels de la petite communauté quadragénaire immergée dans cette fresque historique.
\Mots-clés : #actualité #famille #historique #medias #politique #psychologique #relationdecouple #romanchoral #social #xxesiecle
- le Lun 21 Aoû - 13:08
- Rechercher dans: Écrivains européens de langues anglaise et gaéliques
- Sujet: Jonathan Coe
- Réponses: 57
- Vues: 3185
Page 1 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages