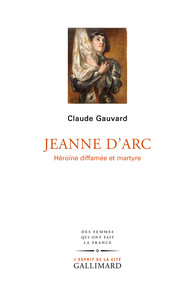La date/heure actuelle est Sam 27 Juil - 16:23
331 résultats trouvés pour historique
Hubert Haddad
La Cène
Marquès, reporter alcoolique et athée, accompagne une équipe de rugbymen brésiliens, étudiants catholiques de bonne famille, comme leur Fokker s’écrase à quatre mille mètres sur les Andes, entre Lima et Buenos Aires, où Marquès espérait retrouver Isabel.
« Chrétiens aux larges épaules, construits à l’échelle de Dieu, ils représentaient l’élite catholique du jeune Brésil formée dans un respect martial du credo. »
Les survivants souffrent du froid, de la faim ; ils piétinent vainement une grande croix de signalisation. Lui plaide pour descendre dans la vallée, tandis que les autres prient, attendant le salut du ciel. Il se confronte aussi à eux qui, par opposition au suicide, se refusent à euthanasier le pilote agonisant, incarcéré dans son cockpit.
« La plupart portaient des sortes de casques transparents bricolés à l’aide des plaques de mica qui protègent les hublots des radiations. Ils se découvrirent pour boire l’eau bouillante de la cuvette et leurs visages éclairés par les flammes semblaient figés sous les fards. Chacun s’était enduit la peau avec les cosmétiques et autres produits trouvés dans les sacs de voyage. »
Au bout d’une semaine, l’équipe décide de manger les morts, à grand renfort d’autojustifications. Marquès s’abstient, se sustentant d’excréments.
« Jésus a rompu le pain et tendu le calice aux apôtres. Il leur a dit de sa bouche mortelle : « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance. » Voilà ce qu’a dit notre Seigneur à la veille du supplice. Écoutez sa parole : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. » Le Christ est mort pour que nous vivions ! Les apôtres ont bu et ont mangé à la très sainte table pour accéder à la vie éternelle…
Ne pas manger serait un suicide et le suicide est le péché des péchés ! »
« Une cordée retourna en chasse : on remonta d’un précipice le corps pétrifié du séminariste. Sur la dépouille dénudée, le rasoir frôla les chairs meurtries. L’ongle d’acier découvrit les arêtes brisées des os. De la poitrine, jaillirent les organes sirupeux et luisants comme des crânes de nouveau-nés. Les athlètes s’accroupirent et Rodriguez distribua les parts. Ils se passèrent le foie dégelé à l’eau tiède, fruit précieux qui jutait dans les mains. Chacun y mordit à son tour comme l’aigle de la légende. Sébastien tombé de la croix, le séminariste gisait en chien de fusil sur la neige, les os en flèches, clavicules et condyles tranchant les lambeaux de chair. Son visage remodelé au gouffre souriait, extatique et sans âge. »
Après sept semaines, deux hommes se lancent dans la descente, et douze autres rescapés seront ainsi sauvés.
L’Église cautionne la « communion des vivants et des morts » qui permit de survivre à ceux qui sont alors considérés comme des héros.
L’histoire est bien sûr tirée du drame de la cordillère des Andes du 13 octobre 1972, dont on a beaucoup parlé à l’époque (quarante-cinq personnes à bord, trente-trois survivants le premier jour et seize à la fin).
Dans sa postface, La Cène ou le dernier festin des cannibales, Haddad interroge sur les limites de l’humanité.
« En exhumant le seul vrai héros de l’aventure, vite oublié par les survivants mais dont les premiers témoignages tiennent compte, sous la figure à demi fictive d’un reporter, lequel refusa jusqu’au bout de manger la chair humaine, j’ai tenté d’élever le fait divers à la parabole : cette poignée d’hommes en détresse caricature le destin d’une certaine forme cannibale et suicidaire des civilisations livrées au capitalisme sauvage, à l’ostracisme calculé des plus faibles, à la mise en coupe des ressources vitales, et pour finir à l’usage hypnotique des médias. »
Malhabilement emphatique par moments, et trop évidemment à charge sur le fond, malgré de superbes (et parfois horribles) descriptions.
\Mots-clés : #historique #mort #religion
- le Mer 8 Mar - 12:28
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Hubert Haddad
- Réponses: 22
- Vues: 1439
Panait Istrati
Les Chardons du Baragan
Incipit :
« Quand arrive septembre les vastes plaines incultes de la Valachie danubienne se mettent à vivre, pendant un mois, leur existence millénaire. »
C’est le baragan, plaine continentale roumaine, « ogre amoureux d’immensité inhabitable » et « assoiffé de solitude », désert où ne poussait que les chardons, qui secs étaient emmenés par le Crivatz (vent froid), comme les virevoltants ou tumbleweeds des westerns.
À neuf ans, le narrateur y part avec son père, dans l’objectif de vendre le poisson qui abonde chez eux, et manque ailleurs.
« Bon pays, mauvaise organisation :
Sacré nom d’un règlement !
C’était cela : un pays riche, mal organisé et mal gouverné ; ma mère le savait comme tout paysan roumain. »
Mais l’expédition est un échec, la mère décède, et à quatorze ans Mataké se sépare de son père pour partir à l’aventure derrière les « petites meules de broussaille » avec son ami Brèche-Dent : il réalise le rêve de tous les enfants, s’évader « à la découverte du monde », « quitter la maison et s’en aller par le monde ».
Ils sont recueillis comme argats [« Valets de ferme »] dans une famille paysanne miséreuse (peut-être les cojans, terme récurrent mais non explicité, comme trop d’autres).
« Sous un ciel si terreux qu’on eût dit la fin du monde, on voyait les chars avancer comme des tortues, sur des champs, sur des routes, sur une terre que Dieu maudissait de toute sa haine. Chars informes ; bêtes rabougries ; hommes méconnaissables ; fourrage boueux ; et aucune pitié nulle part, ni au ciel ni sur la terre ! Nous avions pourtant besoin de pitié divine autant que de pitié humaine, car les chars s’embourbaient ou se renversaient ; car les bêtes tombaient à genoux et nous demandaient grâce ; car les hommes battaient les bêtes et se battaient entre eux ; car les ciocani [« Tiges de maïs, dont les feuilles servent de fourrage et le déchet de combustible »] pourrissaient dans les mares et il fallait en transporter les gerbes à dos d’homme, à dos de femme, à dos d’enfant, et ces hommes, ces femmes, ces enfants n’étaient plus que des tas de hardes imbibées de boue, de grosses mottes de terre pantelante sous l’action de cœurs inutiles.
Tels étaient les paysans roumains, à l’automne de 1906. »
Mataké est tombé amoureux de Toudoritza, ma belle demoiselle éconduite par son amoureux à cause du boyard. Grand nettoyage (deux fois par an, pour Pâques et Noël) :
« Nous vidâmes deux pièces, en entassant les meubles dans une troisième. Au milieu de la tinda, trois brouettes de glaise jaune comme le safran et une brouette de crottin de cheval furent versées avec de l’eau chaude par-dessus, et je fus chargé de piétiner le lut sur le sol des chambres dont Toudoritza badigeonnait les murs en chantant à tue-tête. Elle s’était affublée de vieux vêtements de sa mère ; complètement enfouie, chevelure et visage, sous une grande basma qui ne laissait voir que ses beaux yeux, et armée d’une brosse à long manche, elle couvrait murs et plafond de cette couche de chaux bleuâtre qui fait la joie et la santé du paysan roumain et que connaissent seuls les villages balkaniques. Le badigeonnage fini, ce fut le tour du sol. Le temps de fumer une pipe, il se fit aussi lisse qu’une table, sous les mains adroites de Toudoritza qui le nivelait en marchant à reculons.
Une semaine durant, nous vécûmes une vie de rescapés, couchant un soir ici, le lendemain là, comme ça se trouvait, et mangeant sur le pouce, dans une atmosphère de salle de bain turc dont la vapeur, sentant la chaux et la bouse, nous piquait le nez. »
Mais une mauvaise récolte suscite une famine qui désespère les paysans.
« Soudain, une nouvelle tomba dans le village, comme l’éclair d’une explosion. En Moldavie, les paysans avaient brûlé le konak du grand fermier juif Ficher ! C’est M. Cristea qui nous lut cette nouvelle, dans un journal. Et ce journal concluait : « Cela apprendra aux Juifs à exploiter les paysans jusqu’au sang. À bas, à bas les Juifs ! »
Les cojans qui écoutaient se regardèrent les uns les autres :
– Quels Juifs ? Dans notre département il n’y en a pas ! Et même ailleurs, ils n’ont pas le droit d’être propriétaires ruraux. Or, les fautifs, ce sont les propriétaires, non les fermiers.
À ces paroles, toutes les faces se tournèrent du côté du konak. »
Et les villageois révoltés brûlent le konak. (Un konak est un palais, une grande résidence en Turquie ottomane ; il doit en être de même ici, à propos de la demeure du boyard.) La bourgade est bombardée par l’armée, c’est un massacre.
Outre le témoignage sur une Roumanie rurale misérable et l’insurrection de 1907, ainsi que ses charmes de conte, ce roman offre un éclairage original sur le goût du départ et l’émigration.
\Mots-clés : #historique #lieu #misere #ruralité #temoignage
- le Ven 17 Fév - 12:24
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Panait Istrati
- Réponses: 20
- Vues: 1462
Jules Romains
Les Hommes de bonne volonté« Les Hommes de bonne volonté », c’est 27 livres, 779 chapitres, des milliers de pages mettant en scène des dizaines de personnages pendant une génération, précisément du 6 octobre 1908 au 6 octobre 1923.
Par cette vaste fresque romanesque qui se place dans la continuité des entreprises de Balzac et de Zola, Jules Romains a tenté de dresser un panorama de la France de la Belle Epoque à l’entre-deux-guerres. Son entreprise est toutefois différente de celle de ses illustres prédécesseurs par un plan d’ensemble rigoureusement construit avec interaction entre eux des personnages dans les différents ouvrages.
A la différence de Proust, il ne faut pas chercher chez Romains une analyse psychologique poussée des personnages qui illustrent plutôt des types sociaux. Plus que la psychologie, c’est l’histoire qui intéresse l’auteur. De même, l’individu n’est plus au centre de la narration qui est constituée d’un conglomérat de différents points de vue en un temps donné, ceci afin de rendre compte au mieux de la diversité du monde réel. Tout ceci se résume dans une théorie à caractère spiritualiste, l’unanimisme, la croyance en une entité supérieure collective dans laquelle viendrait se fondre les différentes individualités. Ainsi, les hommes de bonne volonté pourraient infléchir le cours de l’Histoire.
Ces conceptions ont aujourd’hui un peu vieilli. N’empêche, « Les Hommes de bonne volonté » constitue un passionnant tableau de la société pendant le premier quart du XXe siècle.
Il s’agit pour moi d’une relecture.
Les Hommes de bonne volonté
1 - Le 6 octobre

Ce premier volume se passe à Paris dans la seule journée du 6 octobre 1908. Du matin au soir, nous faisons connaissance avec quelques personnages qui vont occuper le devant de la scène : les Saint-Papoul, noblesse traditionnelle dans leur hôtel particulier du faubourg Saint-Germain, le député Gruau prévoyant d’interpeller la Chambre sur les concussions des pétroliers, ignorant que sa compagne spécule sur le sucre. Nous croisons l’instituteur Clanricart, soucieux des risques de guerre, l’inquiétant relieur Quinette chez qui vient se refugier un homme maculé de sang. Dans un très beau chapitre, nous suivons le petit Léon Bastide courant avec son cerceau dans les rues de Montmartre.
Le véritable héros du livre c’est Paris. Il y a un vrai amour de la capitale que Jules Romains décrit avec lyrisme.
Quelques extraits pour mieux en rendre compte :
« Les gens s’en vont, marchent droit devant eux avec une assurance merveilleuse. Ils ne semblent pas douter un instant de ce qu’ils ont à faire. L’autobus qui passe est plein de visages non pas joyeux, sans doute, ni même paisibles, mais, comment dire ? justifiés. Oui, qui ont une justification toute prête. Pourquoi êtes-vous ici, à cette heure-ci ? Ils sauront répondre. »
« L’enduit de la muraille est très ancien. Il a pris la couleur qui est celle des vieilles maisons de la Butte, et que les yeux d’un enfant de Montmartre ne peuvent regarder sans être assaillis de toutes les poésies qui ont formé son cœur. Un couleur qui contient un peu de soleil champêtre, un peu d’humidité provinciale, d’ombre de basilique, de vent qui a traversé la grande plaine du Nord, de fumées de Paris, de reflets de jardin, d’émanation de gazon, de lilas et de rosiers."
« Puis la trêve de l’Exposition Universelle, avec des bruits de danses, et des coudoiements de nations, curieuses les unes des autres, mais sans amitié, comme des estivants qui se rencontrent sur une plage. L’aurore du siècle, trop attendue, fatiguée d’avance, trop brillante, traversée de lueurs fausses, et que les formidables stries de la guerre, dans les premières heures d’après, étaient venues charger. »
« Alors, les lycéens, dans les salles d’étude, mordillant leur porte-plume ou fourrageant leurs cheveux, suivaient les derniers reflets du jour chassés par la lumière du gaz sur la courbure miroitante des grandes cartes de géographie. Ils voyaient la France toute entière ; Paris posé comme une grosse goutte visqueuse sur la quarante-huitième parallèle, et le faisant fléchir sous son poids : ils voyaient Paris bizarrement accroché à son fleuve, arrêté par une boucle, coincé comme une perle sur un fil tordu. On avait envie de détordre le fil, de faire glisser Paris en amont jusqu’au confluent de la Marne, ou en aval, aussi loin que possible vers la mer. »
« Il y avait la ligne de la richesse qui courait comme une frontière mouvante et douteuse, souvent avancée ou reculée, sans cesse longée ou traversée par un va-et-vient de neutres et de transfuges, entre les deux moitiés de Paris dont chacune s’oriente vers son pôle propre ; le pôle de la richesse qui depuis un siècle remonte lentement de la Madeleine vers l’Etoile ; le pôle de la pauvreté, dont les pâles effluves, les aurores vertes et glacées oscillaient alors de la rue Rébaval à la rue Julien-Lacroix. Il y avait la ligne des affaires qui ressemblait à une poche contournée, à un estomac de ruminant accroché à l’enceinte du Nord-Est, et pendant jusqu’au contact du fleuve. C’est dans cette poche que les forces de trafic et de la spéculation venaient se tasser, se chauffer, fermenter l’une contre l’autre. Il y avait la ligne de l’amour charnel, qui ne séparait pas, comme la ligne de la richesse, deux moitiés de Paris de signe contraire ; qui ne dessinait pas, non plus, comme la ligne des affaires, les contours et les renflements d’un sac. Elle formait plutôt une sorte de traînée ; elle marquait le chemin phosphorescent de l’amour charnel à travers Paris, avec des ramifications, ça et là, des aigrettes ou de larges épanchements stagnants. Elle ressemblait à une voie lactée.
Il y avait la ligne du travail la ligne de la pensée, la ligne du plaisir… »
\Mots-clés : #historique #lieu #social
- le Jeu 29 Déc - 18:13
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Jules Romains
- Réponses: 2
- Vues: 177
James Fenimore Cooper
Le Dernier des Mohicans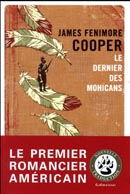
Dans son Introduction de la nouvelle édition du Dernier des Mohicans, Cooper énonce aussi laconiquement que légitimement ce que nous avons perdu avec la disparition des cultures amérindiennes d’Amérique du Nord :
« Peu de caractères d’hommes présentent plus de diversité, ou, si nous osons nous exprimer ainsi, de plus grandes antithèses que ceux des premiers habitants du nord de l’Amérique. »
Dans sa Préface de la première édition, il présente son roman historique comme un « récit », une « relation ».
En juillet 1757, dans l'actuel État de New York à la frontière des États-Unis et du Canada, le marquis de Montcalm et son armée s’approchent du fort William Henry, tenu par le colonel britannique Munro sur le lac Horican (George de nos jours). Cora et Alice, ses filles, partent pour le rejoindre du fort Edward tenu par le Général Webb, accompagnées par le major Duncan Heyward, le guide huron Magua (Renard Subtil), et La Gamme, maître en psalmodie. Ils rencontrent Œil-de-Faucon (« le chasseur », Bumppo ou la Longue Carabine à cause de son « tueur de daims » ; c’est Leatherstocking ou Bas-de-Cuir, au centre du cycle des cinq romans de Cooper auquel appartient celui-ci), coureur des bois (chasseur) et « batteur d’estrade » (éclaireur) des Anglais, Chingachgook ou Grand Serpent, sagamore (sachem) des Mohicans et son fils Uncas, ou Cerf Agile (c’est « le dernier des Mohicans »). Ils campent sur une petite île avec deux cavernes dans les chutes du Glen sur l’Hudson, et y sont assaillis par les Hurons. Après des affrontements épiques, à court de poudre, Œil-de-Faucon et les deux Indiens s’enfuient à la nage pour chercher du secours, tandis que les autres sont capturés. Ayant été humilié par Munro, Magua propose à Cora de l’épouser. Au moment où les captifs vont être exécutés, Œil-de-Faucon et les deux Mohicans les délivrent. Après d’autres péripéties, ils rejoignent le fort William Henry assiégé par les Français en nombre nettement supérieur. Sur ordre de Webb, commandant de la région qui n’enverra pas ses renforts, la garnison se rend et quitte le fort. Des Hurons, alliés de Montcalm, massacrent l’arrière-garde ; de nouveau, Alice, Cora et David sont enlevés par Magua, et Œil-de-Faucon, Chingachgook et Uncas se lancent à leurs trousses avec Munro et Heyward, d’abord en canoë sur le lac Horican puis sur terre, où les trois premiers font de nouveau preuve de leurs talents de pisteurs, qui lisent les traces comme les Blancs un livre. En approchant du Canada, ils retrouvent David, laissé en semi-liberté car pris pour un fou. Alice a été placée dans une tribu de Hurons et Cora chez les Delawares, traditionnels ennemis, mais alliés enrôlés dans la lutte contre les Anglais. Duncan se rend chez lez Hurons (déguisé), où Uncas est amené prisonnier. Œil-de-Faucon (travesti en ours) délivre Alice avec son aide, puis Uncas. Magua, orateur adroit et politique astucieux, intrigue toujours, chez les Hurons, puis chez les Delawares, où il ne parvient cependant qu’à arracher Cora au grand conseil présidé par le patriarche, Tamenund. Uncas, dont l’ascendance est reconnue, entraîne les Delawares contre les Hurons : avec la plupart de ces derniers, Cora, Uncas puis Magua trouvent la mort.
La distinction raciale est souvent évoquée, que ce soit la pureté d’un sang « sans mélange » qu’Œil-de-Faucon revendique fréquemment, ou la couleur de la peau (le teint tanné de ce dernier se distinguerait de celui des Indiens) : si on montre de la sympathie pour les Peaux-Rouges, c’est "malgré" leur couleur, au moins autant que leur aspect farouche ou leurs mœurs de sauvages, non-civilisés.
« Il y a de la raison dans un Indien, quoique la nature lui ait donné une peau rouge, dit le Blanc en secouant la tête en homme qui sentait la justesse de cette observation. »
Si la rigueur historique manque, cette fiction vaut pour l’attention portée aux peuples amérindiens en voie de disparition, « ces peuples à la fois si impétueux et si impassibles », et bien sûr pour l’action aux multiples rebondissements de ces aventures dans la nature "sauvage", si captivantes, du moins pour les jeunes lecteurs. Mais c’est mal écrit-traduit, d’un romantisme ronflant, et rempli d’invraisemblances. Style :
« Cependant l’air d’assurance et d’intrépidité du major, aidé peut-être par la nature du danger, leur donna du courage, et les mit en état, du moins à ce qu’elles crurent, de supporter les épreuves inattendues auxquelles il était possible qu’elles fussent bientôt soumises. »
\Mots-clés : #amérindiens #aventure #historique #nature
- le Sam 3 Déc - 11:03
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: James Fenimore Cooper
- Réponses: 2
- Vues: 241
W.G. Sebald
Austerlitz
Sebald rencontre à Anvers Austerlitz, architecte qui l’entretient de la démesure atteinte au XIXe dans la surenchère entre fortification et poliorcétique (art de mener un siège), la forteresse devenant de plus en plus rapidement obsolète face aux progrès de l’artillerie.
« …] nos meilleurs projets, au cours de leur réalisation, n’ont de cesse qu’ils ne se muent en leur exact contraire. »
« …] étudiant, l’architecture de l’ère capitaliste, et en particulier l’impératif d’ordonnance et la tendance au monumental à l’œuvre dans les cours de justice et les établissements pénitentiaires, les bourses et les gares, mais aussi les cités ouvrières construites sur plan orthogonal. »
Ils se revoient plusieurs fois, par hasard ; ici, à propos du palais de justice de Bruxelles :
« La construction de cette singulière monstruosité architecturale, à laquelle il songeait à cette époque consacrer une étude, avait été entreprise vers les années quatre-vingt du siècle dernier, dans la précipitation, sous la pression de la bourgeoisie bruxelloise, me raconta Austerlitz, avant que les plans grandioses présentés par un certain Joseph Poelaert aient été élaborés en détail, et la conséquence en était, dit Austerlitz, que dans ce bâtiment d’une capacité de plus de sept cent mille mètres cubes il existait des corridors et des escaliers qui ne menaient nulle part, des pièces et des halls sans porte où jamais personne n’avait pénétré et dont le vide conservait emmuré le secret ultime de tout pouvoir sanctionné. »
Ils se rencontrent encore deux décennies plus tard à Londres, et Sebald s’aperçoit qu’il ressemble à Wittgenstein, avec « son sac à dos ne le quittait jamais ».
« …] voilà qui était contraire à toute vraisemblance statistique mais d’une logique interne étonnante, pour ne pas dire inéluctable. »
Austerlitz lui raconte son histoire : dès le début de la Seconde Guerre mondiale et ses quatre ans et demi, il a été élevé par d’austères parents nourriciers, et son enfance fut froide, sinon lugubre.
« J’ai grandi, dit-il, à Bala, petite bourgade du pays de Galles, dans la maison d’un prédicateur calviniste, un ancien missionnaire nommé Emyr Elias et marié à une femme timorée issue d’une famille anglaise. »
« Durant toutes les années que j’ai passées au presbytère de Bala, le sentiment ne m’a de fait jamais quitté que restait dérobé à ma vue quelque chose de très proche et de très évident. Parfois, c’était comme si j’essayais à partir d’un rêve de saisir la réalité ; puis j’avais l’impression que marchait à mes côtés un frère jumeau invisible, le contraire d’une ombre en quelque sorte. »
Ce n’est qu’au lycée, une fois sa mère adoptive morte et Elias devenu fou de chagrin dans sa sombre croyance qui ne le soutient plus, qu’on lui apprend que son vrai nom est Austerlitz. André Hilary, son professeur d’histoire, féru de l’époque napoléonienne, lui apprend l’histoire de la bataille.
Il s’initie à la photographie (comme Sebald, dont les photos illustrent le texte) ; il protège son factotum en pension, le petit Gerald Fitzpatrick, début d’une amitié ; il se trouve invité par la mère de ce dernier à Barmouth, où Alphonso, le grand-oncle naturaliste, leur fait notamment découvrir les mites et papillons.
Les souvenirs d’Austerlitz sont riches d’énumérations minutieuses (insectes, mais aussi plantes, minéraux, maladies, etc.), et tout ce qui est rapporté l’est dans un style élaboré, précis, à la fois fluide et pesant, car sans pause (la traduction semble excellente).
« Admirées surtout par Gerald, les diverses stries lumineuses qu’ils semblaient laisser derrière eux, traits, boucles et spirales, n’avaient en réalité aucune existence, avait expliqué Alphonso, elles n’étaient que traces fantômes dues à la paresse de notre œil, qui croit encore voir un reflet rémanent à l’endroit d’où l’insecte, pris une fraction de seconde sous l’éclat de la lampe, a déjà disparu. C’était à ces genres de phénomènes factices, à ces irruptions de l’irréel dans le monde réel, à certains effets de lumière dans un paysage étalé devant nous, au miroitement dans l’œil d’une personne aimée, que s’embrasaient nos sentiments les plus profonds, ou du moins ce que nous tenions pour tels. »
Suivent des considérations sur le temps (ce récit lui-même est quasiment un flux ininterrompu).
« Si Newton a pensé, dit Austerlitz en montrant par la fenêtre, brillant dans le reste de jour, le méandre qui enserre l’île des Chiens, si Newton a réellement pensé que le temps s’écoule comme le courant de la Tamise, où est alors son origine et dans quelle mer finit-il par se jeter ? Tout cours d’eau, nous le savons, est nécessairement bordé des deux côtés. Mais quelles seraient, à ce compte, les rives du temps ? Quelles seraient ses propriétés spécifiques correspondant approximativement à celles de l’eau, laquelle est liquide, assez lourde et transparente ? En quoi des choses plongées dans le temps se distinguent-elles de celles qui n’ont jamais été en contact avec lui ? Que signifie que nous représentions les heures diurnes et les heures nocturnes sur un même cercle ? Pourquoi, en un lieu, le temps reste-t-il éternellement immobile tandis qu’en un autre il se précipite en une fuite éperdue ? Ne pourrait-on point dire que le temps lui-même, au fil des siècles, au fil des millénaires, n’a pas été synchrone ? Finalement, il n’y a pas si longtemps que cela qu’il se trouve en expansion et se répand en tous sens. Et jusqu’aujourd’hui, la vie des hommes, dans maintes contrées de la terre, n’est-elle pas moins régie par le temps que par les conditions atmosphériques, autrement dit par une grandeur inquantifiable qui ignore la régularité linéaire, n’avance pas de manière constante mais au rythme de remous et de tourbillons, est déterminée par les engorgements et les dégorgements, revient sous une forme sans cesse autre et évolue vers qui sait où ? L’être-hors-du-temps qui naguère encore était le mode d’existence dans les contrées reculées et oubliées de notre propre pays, comme sur les continents non encore explorés d’outre-mer, se retrouvait aussi, dit Austerlitz, dans les métropoles régies par le temps, Londres par exemple. Les morts n’étaient-ils pas hors du temps ? Les mourants ? Les malades alités chez eux ou dans les hôpitaux ? Et non seulement eux, car il suffisait d’avoir son content de malheur personnel pour déjà être coupé de tout passé et de tout avenir. »
Austerlitz poursuit ses études à Oxford puis Paris, tandis que Gerald, passionné par les pigeons, devient aviateur et astronome.
Lors d’excursions nocturnes Austerlitz explore le milieu urbain, et on se sait parfois plus s’il s’agit de Sebald ou de lui, sorte d’alter ego. Lorsque l’auteur mentionne ses propres allées et venues en marge des confidences d’Austerlitz, l’inquiétante étrangeté et son angoisse semblent déteindre des zones lugubres traversées.
Après une évocation des morts à propos des cimetières reconquis par la ville en extension, Austerlitz rapporte sa révélation sur ses origines dans la salle d’attente abandonnée de Liverpool Street Station. Ces architectures absurdes, à la Piranèse, reviennent plusieurs fois, comme une pénétration onirique de la réalité.
« Il faut bien dire que les pas décisifs de notre vie, nous les accomplissons presque tous sous la pression d’une confuse nécessité interne. »
Il poursuit ses investigations aux Archives de Prague, et retrouve Věra, sa bonne d’enfant, avec les souvenirs de sa petite enfance, il poursuit ses remémorations dans une profusion de détails. Sa mère, Agáta, était actrice, et « chanteuse d’opéra et d’opérette », juive dans l’avant-guerre…
« Ta mère Agáta, ainsi commença-t-elle, je crois, dit Austerlitz, en dépit de sa manière taciturne et quelque peu mélancolique, était une femme qui avait tout à fait confiance en la vie et se montrait parfois insoucieuse. […]
Néanmoins, dit Věra, poursuivit Austerlitz, Maximilian ne croyait en aucune façon que le peuple allemand avait été mené à sa perte ; bien plus, selon lui, partant des aspirations individuelles et de l’état d’esprit régnant dans les familles, il s’était lui-même radicalement refondé en se coulant dans ce moule pervers ; et il avait ensuite engendré ces dignitaires nazis que Maximilian tenait tous pour des bons à rien et des têtes brûlées, pour servir de porte-parole symboliques aux instincts profonds qui l’agitait. […]
Maximilian lui avait expliqué, dit Věra, que dans cette foule qui ne faisait plus qu’un seul être agité d’étranges convulsions et soubresauts, il s’était senti comme un corps étranger qui allait incessamment être broyé et expulsé. »
Quels bels emboîtements en cascade pour un cataclysme en marche avec tout un peuple ! Litanie scandée par l’indication des deux narrateurs, et passage superbe à propos de l’écho dans « le matériau de ces innombrables corps immobiles » du message « messianique » nazi.
Sur les traces de sa mère déportée, Austerlitz visite Terezín avec son bazar, sa forteresse et son musée du ghetto.
« Il ne me semble pas que nous connaissions les règles qui président au retour du passé, mais j’ai de plus en plus l’impression que le temps n’existe absolument pas, qu’au contraire il n’y a que des espaces imbriqués les uns dans les autres selon les lois d’une stéréométrie supérieure, que les vivants et les morts au gré de leur humeur peuvent passer de l’un à l’autre, et plus j’y réfléchis, plus il me semble que nous qui sommes encore en vie, nous sommes aux yeux des morts des êtres irréels, qui parfois seulement deviennent visibles, sous un éclairage particulier et à la faveur de conditions atmosphériques bien précises. »
Dans la foulée, il relate son séjour à Marienbad avec Marie de Verneuil (une Française dont il est proche), dans un étrange ressenti de désarroi et de discordance dû à sa résistance au retour de sa mémoire. Il reconnaît sourdement la gare Wilson d’où il partit pour Londres, envoyé par ses parents avec son petit sac à dos. La pérégrination dans l’espace et le temps continue avec Nuremberg, puis le camp de Theresienstadt. Dans ce dernier, les Allemands ont reconstitué une fallacieuse vitrine bienséante du ghetto afin de leurrer une commission d’inspection, aussi sinistre que cynique mascarade filmée « soit à des fins de propagande, soit pour légitimer à leurs yeux toute cette entreprise » : Le Führer offre une ville aux Juifs.
Ensuite Austerlitz cherche trace de son père, Maximilian, disparu à Paris.
« Ce genre d’intuitions me viennent immanquablement en des lieux qui appartiennent davantage au passé qu’au présent. Par exemple, lors de mes pérégrinations en ville, je jette quelque part un coup d’œil dans l’une de ces cours intérieures où rien n’a changé depuis des décennies, et je sens, physiquement presque, le cours du temps se ralentir dès qu’il entre dans le champ de gravitation des choses oubliées. Tous les moments de notre vie me semblent alors réunis en un seul espace, comme si les événements à venir existaient déjà et attendaient seulement que nous nous y retrouvions enfin, de même que, une fois que nous répondons à une invitation, nous nous retrouvons à l’heure dite dans la maison où nous devions nous rendre. Et ne serait-il pas pensable, poursuivit Austerlitz, que nous ayons aussi des rendez-vous dans le passé, dans ce qui a été et qui est déjà en grande part effacé, et que nous allions retrouver des lieux et des personnes qui, au-delà du temps d’une certaine manière, gardent un lien avec nous ? »
Pertes de connaissance ; lectures à la Bibliothèque nationale (l’ancienne puis la nouvelle).
« …] et j’en suis arrivé à la conclusion que dans chacun des projets élaborés et développés par nous, la taille et le degré de complexité des systèmes d’information et de contrôle qu’on y adjoint sont les facteurs décisifs, et qu’en conséquence la perfection exhaustive et absolue du concept peut tout à fait aller, et même, pour finir, va nécessairement de pair avec un dysfonctionnement chronique et une fragilité inhérente. »
Enfin, la gare d’Austerlitz…
Je suis heureux d’avoir reporté jusqu'ici la lecture de cet admirable roman (quoique l’on ait peu l’impression qu’il s’agisse d’un roman), m’y préparant avec la lecture d’autres œuvres de Sebald. Le parti pris des descriptions, digressions, énumérations, signale suffisamment que l’essentiel dans ce livre n’est pas l’histoire d’Austerlitz, ni l’Histoire, mais plutôt les impressions et coïncidences spatiotemporelles de l'existence.
\Mots-clés : #devoirdememoire #historique #identite
- le Lun 28 Nov - 12:10
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: W.G. Sebald
- Réponses: 74
- Vues: 9042
Georges Duby
Le Dimanche de Bouvines (27 juillet 1214)
Un livre d’histoire (« grand public ») qui… fit date !
« Les événements sont comme l'écume de l'histoire, des bulles, grosses ou menues, qui crèvent en surface, et dont l'éclatement suscite des remous qui plus ou moins loin se propagent. Celui-ci a laissé des traces très durables : elles ne sont pas aujourd'hui tout à fait effacées. Ces traces seules lui confèrent existence. En dehors d'elles, l'événement n'est rien. Donc c'est d'elles, essentiellement, que ce livre entend parler. »
« C'est la raison qui me conduit à regarder cette bataille et la mémoire qu'elle a laissée en anthropologue, autrement dit à tenter de les bien voir, toutes deux, comme enveloppées dans un ensemble culturel différent de celui qui gouverne aujourd'hui notre rapport au monde. »
Duby nous dit que vers l’an mil, la guerre ne fut plus considérée comme bonne par l’Église, et que la paix lui fut préférée, avec un rôle d’échange dorénavant dévolu au négoce ; c’est ainsi qu’elle en vint « à tolérer le lucre, à l'absoudre ». Ensuite l’Église travaille à instaurer la paix (armée) de Dieu, que le roi (consacré) va diriger personnellement. Le dimanche est chômé à la guerre, qui est toujours affaire de la chevalerie, comme la prière celle du clergé, et le labeur celle des roturiers, selon les trois ordres hiérarchisés de la société. L’essor de la monnaie va permettre celui des mercenaires, et aussi des tournois, joute équestre, jeu d'argent, « combats de plaisance » où la jeunesse exalte prouesse et largesse.
Et justement la bataille de Bouvines ressort à ce type d’exploit (quasiment "sportif", avec ses champions, son rituel, etc.). J’ai naturellement pensé au Désastre de Pavie de Giono – d’autant que Duby le cite comme source d’inspiration de son livre, de ton plus libre qu’un texte érudit !
Le code d’honneur reste prégnant, et tuer n’est pas le but.
« Parce que la guerre est une chasse, menée par des gens expérimentés, maîtres d'eux-mêmes, solidement protégés, qui ne rêvent pas d'exterminer leur ennemi, s'il est bon chrétien, mais de le saisir. Pour le rançonner. Encore une fois : pour gagner. »
« Quand, au début de l'engagement, Eustache de Malenghin se met à crier : « À mort les Français », tous ceux qui l'entendent sont écœurés, révoltés d'une telle inconvenance. Aussitôt les chevaliers de Picardie empoignent l'impertinent, ils le saignent. C'est le seul chevalier dont il est dit qu'il trouva la mort sur le champ de Bouvines. Avec Etienne de Longchamp, atteint lui, accidentellement, d'un couteau, par l'œillère du heaume. Tous les autres cadavres, ce fut le bas peuple qui les fournit. »
La conséquence légendaire de cette bataille est la naissance d’une nation, dans la lignée de Charlemagne et opposée à l’Allemagne, « mythe de la nation et de la royauté réunies ».
Déconstruit finement toute la complexité des ressorts de l’événement (y compris économiques). Captivant !
\Mots-clés : #contemythe #guerre #historique #moyenage #politique #religion #social #traditions
- le Mar 15 Nov - 11:36
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Georges Duby
- Réponses: 3
- Vues: 554
Paolo Rumiz
Appia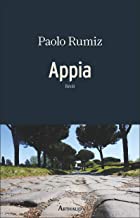
ArenSor nous a déjà présenté ce récit dans un commentaire approfondi, s’y reporter pour une description générale de l’ouvrage. Heureusement, il y a tant dans ce livre si dense que je vais pouvoir y glisser mon petit grain de sel…
C’est donc la redécouverte, presque une découverte, de la Via Appia, « la reine de toutes les routes », « la première route d’Europe », en grande partie oubliée, voire disparue. Périple à quatre randonneurs, pas pèlerins mais routards, « entre la rage et l’émerveillement », de l’antique en mafias en passant par les cuisines régionales (et sans éviter l’incontournable Padre Pio), de Rome la Dominante à Capoue puis Brindisi, du Nord au Sud et l’Est.
D’entrée le ton est vif, stigmatisant l’incurie, la « dilapidation » et bien d’autres maux actuels comme la paysannerie bradée – de ruines en ruines, plus ou moins récentes – et prônant les « paroles "narrabondes" » :
« …] le nomade préfère les paroles prononcées, capables de voler, plutôt que les paroles écrites, condamnées à « rester ». Il sait que la lecture silencieuse détache du monde et porte à la solitude. Les caractères de l’écriture phonétique ont été inventés pour être écoutés et partagés, et aujourd’hui le livre, pour ne pas mourir, a un besoin urgent de redevenir au plus vite le lieu de la voix. Chant, métrique, allure. Tendez l’oreille : dans l’antre des trésors, la Parole résonne que c’en est une merveille. »
Quelques autres extraits au fil de la lecture :
« Suivre notre route de bout en bout équivaut à se réapproprier le pays. »
« Rome, c’était avant toute autre chose le génie civil, la logistique, l’architecture. Routes, ponts, aqueducs, relais de poste. »
« "Vous êtes d’où ?" nous demande le jeune berger qui les suit, avachi dans sa voiture, la casquette à l’envers, visière sur la nuque, le bras gauche pendant le long de la portière. Il n’a jamais vu personne passer à pied sur ce chemin. Les Italiens ne marchent pas dans le ventre du pays.
[…]
Il rit, il se démanche le bras pour nous saluer et passe son chemin, klaxonnant derrière son troupeau lancé à l’assaut de l’abreuvoir, dans un sillage de crottes. Le berger en voiture et les bourgeois à pied : la situation est d’un comique évident. »
« Nous cherchions à faire renaître une route de l’Antiquité, au lieu de quoi nous assistons, lézarde après lézarde, éboulement après éboulement, à la mort en direct d’une route de l’ère moderne. »
« Les Pouilles étaient bien vertes, alors. Aujourd’hui est venu le temps du bitume et des désherbants. »
« Je me rends compte qu’il faudrait un minimum d’efforts pour maintenir cette route en état. »
« Rome était un empire fondé sur les choses. "Res" : entends la force lapidaire de ce mot qui ne laisse aucune place à de verbeuses échappatoires. »
« La lenteur complique les choses, répète toujours Riccardo, et moi, je veux une vie compliquée. »
J’ai pu mesurer combien peu je connais l’Italie (histoire, géographie, cuisine) – mais après tout, les Italiens eux-mêmes…
Une idée de randonnée pour Avadoro ?!
\Mots-clés : #Antiquité #historique #temoignage #voyage
- le Dim 30 Oct - 11:11
- Rechercher dans: Nature et voyages
- Sujet: Paolo Rumiz
- Réponses: 22
- Vues: 4190
Claudio Magris
Une autre mer
Enrico est un jeune étudiant en philologie de Gorizia en Autriche-Hongrie qui s’embarque à Trieste pour l’Argentine fin 1909, renonçant au bonheur avec son frère Nino et son ami Carlo, avec qui il pratiquait les philosophes grecs (notamment Platon), Schopenhauer, Ibsen, Tolstoï, Bouddha, Beethoven.
« Ce mélange de peuples et son agonie sont une grande leçon de civilisation et de mort ; une grande leçon de linguistique générale aussi, car la mort est spécialiste en matière de plus-que-parfait et de futur antérieur. »
« Sur ce bateau qui à présent file à travers l’Atlantique, Enrico est-il en train de courir pour courir ou bien pour arriver, pour avoir déjà couru et vécu ? À vrai dire, il reste immobile ; déjà les quelques pas qu’il fait entre sa cabine, le pont et la salle à manger lui semblent inconvenants dans la grande immobilité de la mer, égale et toujours à sa place autour du bateau qui prétend la labourer, alors que l’eau se retire un instant et se referme aussitôt. La terre supporte, maternelle, le soc de charrue qui la fend, mais la mer est un grand rire inaccessible ; rien n’y laisse de trace, les bras qui y nagent ne l’étreignent pas, ils l’éloignent et la perdent, elle ne se donne pas. »
Enrico devient éleveur en Patagonie, toujours en selle ; il est patient, détaché, libre, éprouvant dans l’instant la vie à laquelle il ne demande rien, refusant tout engagement professionnel, politique, sentimental ou familial.
« Une fois il se trouve face à un puma, son cheval s’emballe, il le fouette rageusement et même le mord, l’animal le désarçonne et le piétine ; pendant des mois il pisse du sang, jusqu’à ce que des Indiens lui fassent boire certaines décoctions d’écorces et que ça lui passe. »
« Il y a toujours du vent mais au bout d’un certain temps on apprend à distinguer ses tonalités diverses selon les heures et les saisons, un sifflement qui s’effiloche ou un coup sec comme une toux. Parfois il semble que le vent a des couleurs, il y a le vent jaune d’or entre les haies, le vent noir sur le plateau nu. »
« Enrico tire, le canard sauvage s’abat sur le sol, en un instant le vol héraldique est un déchet jeté par la fenêtre. La loi de la pesanteur est décidément un facteur de gaucherie dans la nature ; il n’y a que les mots qui en soient préservés, entre autres ceux imprimés dans les classiques grecs et latins de la collection Teubner de Leipzig. »
Venu de la mansarde de Nino dans Gorizia à une cabane de l’altiplano, fuyant le vacarme des villes (et la guerre), il correspond avec Carlo (qui est le philosophe Carlo Michelstaedter), jusqu’à ce que celui-ci se suicide après avoir rédigé La persuasion et la rhétorique. Cet essai théorise la persuasion comme « plénitude de l’être en accord avec la vie et l’instant », la rhétorique en tant que « tout ce qui nous fait désirer d’être ailleurs, plus tard, plus fort, tandis qu’irrévocablement s’écoule et s’enfuit notre vie véritable » (Gallimard). Enrico est l’incarnation du « persuadé ».
« Carlo est la conscience sensible du siècle et la mort n’a aucun pouvoir sur la conjugaison du verbe être, seulement sur l’avoir. Enrico a ses troupeaux, son cheval, quelques livres. »
« Carlo parlait de toi, il regardait ta vie comme la seule chose qui mérite de l’estime… ce que Carlo nous a donné tu le fais et le démontres dans chacun des actes de ta vie actuelle et tu ne le sais même pas… »
« Dans ces pages ultimes Carlo le représente comme l’homme libre à qui les choses disent « tu es » et qui jouit uniquement parce que sans rien demander ni craindre, ni la vie ni la mort, il est pleinement vivant toujours et à chaque instant, même au dernier. »
« Les hommes ne sont pas tristes parce qu’ils meurent, a dit Carlo, ils meurent parce qu’ils sont tristes. »
« Dans ces pages il y a la parole définitive, le diagnostic de la maladie qui ronge la civilisation. La persuasion, dit Carlo, c’est la possession au présent de sa propre vie et de sa propre personne, la capacité de vivre pleinement l’instant, sans le sacrifier à quelque chose qui est à venir ou dont on espère la venue prochaine, détruisant ainsi sa vie dans l’attente qu’elle passe le plus vite possible. Mais la civilisation est l’histoire des hommes incapables de vivre dans la persuasion, qui édifient l’énorme muraille de la rhétorique, l’organisation sociale du savoir et de l’agir, pour se cacher à eux-mêmes la vue et la conscience de leur propre vacuité. »
Enrico revient à Gorizia après la Grande Guerre ; l’empire austro-hongrois a éclaté. Il vit à Punta Salvore en Istrie, alors italienne, se marie, est quitté, demeure avec une autre femme. L’Istrie passe du régime fasciste au communisme (puis au titisme) en devenant part de la Yougoslavie après la Seconde Guerre mondiale. Il contemple toujours la mer, songeant à Carlo, de plus en plus hors du temps, à l’écart de la vie ; il montre peu à peu des signes de mesquinerie égoïste, puis meurt.
« Mais il ne peut en être autrement, les mots ne peuvent faire écho qu’à d’autres mots, pas à la vie. »
« …] le plaisir c’est de ne pas dépendre des choses qui ne sont pas absolument nécessaires, et même celles qui le sont doivent être accueillies avec indifférence. »
« Ce sont les esclaves qui ont toujours le mot droit à la bouche, ceux qui sont libres ont des devoirs. »
Magris a mis beaucoup de choses dans ce beau livre, qui m’a ramentu… Yourcenar !
\Mots-clés : #biographie #historique #philosophique #portrait #xxesiecle
- le Ven 7 Oct - 12:33
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Claudio Magris
- Réponses: 17
- Vues: 2394
Gabriel de La Landelle
Aventures et embuscades, Histoire d'une colonisation au Brésil
Première partie, En Portugal : Lisbonne, mi-XVIIIe : le roi Jean V meurt, son fils lui succède sous le nom de Joseph Ier, et l’ambitieux Sébastien Carvalho, comte d’Oeyras, et plus tard marquis de Pombal, opposé aux fidalgues (fidalgos, la noblesse portugaise), devient son premier ministre. Il est sur le point de faire arrêter le comte Pedro da Carvoa, conseiller de Jean V et disgracié, lorsque survient le grand tremblement de terre de Lisbonne ; le comte émigre au Brésil avec ses serviteurs, dont le fidèle José Péreira, forgeron, et son jeune fils, Joam.
Deuxième partie, Au Brésil : dans l’aldée de Crên-Bakuam, chef des Botocudos, sa femme Fleur-de-Liane vient d’être tuée par les Machaculis, qui ont aussi enlevé sa fille Zima. L’image donnée des Indiens est fort datée, malgré certaines observations apparemment correctes.
« Botoque ou batoque, signifie littéralement bonde de tonneau. De là le nom donné par les Portugais aux Aymorés, Tapuyas ou Botocudos, qui s’incrustent dans la lèvre inférieure et dans les lobes des oreilles, un disque de bois de barrigudo. »
« Les philosophes d’une certaine école, poétisant à plaisir le sauvage, oubliant ses instincts féroces, ses goûts dépravés, ses mœurs sanguinaires, ses préjugés stupides, ont essayé de placer l’homme de la nature au-dessus de l’homme civilisé, au-dessus du chrétien. »
« Parmi les Indiens du Brésil, le droit du chef est de marcher le premier sur le chemin de la guerre, − coutume barbare mais héroïque. »
(Certains regrettent parfois que nos propres généraux ne soient pas placés en première ligne, comme ce fut d'ailleurs le cas en des temps reculés de notre histoire.)
La petite expédition de dom Pedro s’enfonce dans l’intérieur des terres, loin de la colonie : organisation paramilitaire, ardeur à l’ouvrage et conscience religieuse, paternalisme (notamment avec les esclaves africains) …
« Il s’avançait non en conquérant, mais en fondateur ; il voulait créer au milieu du désert, dans des contrées inhospitalières, où il ne pouvait rencontrer que des peuplades hostiles aguerries, belliqueuses, féroces. »
Ils rencontrent les Machaculis, et l’ambitieux (lui aussi) Apocahi, leur maraca, une sorte de (faux) oracle qui s’intéresse à leurs armes à feu tandis qu’ils s’établissent dans la région, fondant la Fazenda d’Enchofre, c’est-à-dire habitation du soufre (qui entre dans la fabrication de la poudre).
Achim a lié amitié avec Préto, un jeune esclave − toutes proportions gardées :
« La soumission du jeune esclave et la douceur de Joam avaient fait naître entre eux une amitié qui ne détruisait pas cependant la distance rendue nécessaire par leurs positions respectives. C’était une de ces liaisons devenues si communes dans nos colonies, où chaque jeune fille créole est élevée avec une petite mulâtresse ou capresse, sa compagne, dont elle fait d’ordinaire son intime confidente, parfois sa victime.
Préto avait été constamment attaché au service de Joam depuis le départ de San-Salvador, il ne le quittait guère qu’aux heures d’étude. »
Préto ravit Zima aux Machaculis qui la retenaient captive. Amoureux d’elle, Achim sera capturé par les mêmes sauvages.
« Au milieu des territoires sans bornes qu’arrosent les Tucantins et l’Araguay, Joam subit le joug d’une peuplade barbare, naguère fraternellement accueillie par ses compatriotes, et qui se complaît maintenant à exercer sur lui une farouche vengeance. »
Puis « l’enfant de lait » deviendra « Jaguar bondissant » chez les Botocudos. Tout finira bien.
« Les monts Piauhis et les savanes sont défrichés et peuplés par une race d’un sang mêlé, il est vrai, mais qui sera un jour, n’en doutez pas, la véritable nation brésilienne, − fille de l’Afrique et du Nouveau Monde régénérée par le sang européen et par la foi catholique. »
\Mots-clés : #amérindiens #aventure #historique
- le Sam 24 Sep - 13:11
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Gabriel de La Landelle
- Réponses: 2
- Vues: 306
Nancy Huston
Instruments des ténèbres
Le titre est inspiré de Macbeth, cité en exergue, avec une allusion à la musique dans le terme « instruments ».
Alternance entre Le carnet scordatura (discordance en italien, jeu "désaccordé", dissonance volontaire en musique, « une manière d'accorder les instruments à cordes qui s'écarte de l'accord usuel », Wikipédia) et la Sonate de la Résurrection (d’après l'œuvre d'Heinrich Biber, compositeur baroque de Bohème) ; de fortes correspondances tissent des liens significatifs entre ces deux séries (le work in progress – plutôt coulisses, laboratoire, scriptorium, chambre d’écho − et son résultat).
Dans la première, journal intime tenu sur un an par la narratrice-auteure, Nadia (qui change son prénom en Nada, I étant "je" ; elle nomme son jumeau mort à la naissance Nothin’), États-unienne de quarante-neuf ans, commente son travail, sa documentation historique. Elle expose froidement son mépris pour ce qui est nature et vie, et choisit le diable contre Dieu : elle a pour muse son daimôn (génie, esprit, voix, inspiration) : « l’Autre », avec lequel elle converse parfois comme avec un psychothérapeute, et qui lui dicterait son œuvre. Elle discute avec Stella, violoncelliste et meilleure amie de sa mère Élise, sombrée dans la divagation mentale, et évoque son père Ronald, ivrogne qui engrossait sa femme régulièrement pour l’empêcher de jouer du violon.
« C’est une de mes "images au formol", comme je les appelle : des souvenirs qui ne changent pas, ne bougent ni ne s’évanouissent, mais restent là, alignés sur une étagère dans ma tête, muets et horribles tels les organes humains et animaux du siècle dernier qu’on voit exhibés dans des bocaux au Muséum d’histoire naturelle à Paris. »
Dans la seconde série, c'est-à-dire la fiction de Nadia, c’est le miséreux et superstitieux (et croyant) Berry sous l’Ancien régime : Barbe (née coiffée) et Barnabé sont des jumeaux séparés dès leur naissance, qui fut fatale à leur mère. Elle passe d’une famille d’accueil à l’autre, lui est élevé à Orsan, « prieuré où les femmes commandent et où les hommes obéissent », où il chante et a des visions de sa mère en attendant de devenir moine. Les jumeaux se sont retrouvés et s’aiment ; elle devient servante à l’auberge de Torchay, chez Hélène Denis (une guérisseuse, aussi grosse que Stella). Voix off :
« Je veux l’écrire ici et en avoir le cœur net : j’ai peur que Stella ne meure si je tue Hélène dans ma Sonate de la Résurrection. Ça a l’air insensé, mais c’est vrai. Et je n’oserais l’avouer à aucun être vivant. »
Là Barbe s’éveille.
« Les frontières de son univers reculent chaque jour un peu plus. »
Mais son amie Jeanne est foudroyée, elle est prise pour une sorcière et doit fuir. Elle est recueillie par Marguerite Guersant qui en fera sa servante, trop rebutante pour que son mari, Donat (« c’était un enfant donné, abandonné dès sa naissance »), ne l’engrosse comme les précédentes, par dépit qu’elle n’enfante pas ; mais il abuse quand même Barbe, qui devenue prégnante devra de nouveau s’enfuir, tentera d’avorter et donnera jour à un enfant mort-né (parallèlement, Nadia évoque son avortement, exécuté avec l’aide de sa mère : correspondance de Tom Pouce dans la scordatura et du Petit Poucet dans la Sonate ; alternent désir d’enfant et détestation de la maternité non voulue).
Le thème récurrent est l’injustice du sort (des femmes), sans Jugement, Dieu, « le Témoin », n’existant pas.
« Que, justement en raison du fait que la vie réelle existe, et qu’elle n’a pas de sens, il est indispensable que l’Art, qui tourne autour des inexistants, en ait. »
« Mais depuis que le monde est monde, la plus grande partie des passions humaines a tourné autour de choses inexistantes : Jéhovah, Belzébuth, Shiva, Isis, Damballah, la Vierge Marie, Hercule, Gatsby le Magnifique, Mme Bovary, la Fée bleue, mon frère jumeau, mon ange de fils, Sabina ma plus chère amie, Andrew le fils de Stella et Jack son mari… Ces êtres vivent et vibrent en nous, agissent sur nous, influencent nos gestes, nos pensées, nos états d’âme… Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents… »
L’indifférence pour se protéger du mal, de la violence dans le monde, « la lame froide, l’écart entre moi et le monde » chez Nadia évolue au fil du livre vers une acceptation de ce qui est.
« Je crois aux personnages de mon roman de la même façon que les paysans superstitieux croient aux fantômes, ou les mères en leurs enfants : non parce qu’ils espèrent en tirer quelque chose, mais parce qu’ils sont là : de façon aussi irréfutable que miraculeuse. Le désespoir est exactement aussi débile que l’espoir, ne voyez-vous pas ? La vérité n’est ni la lumière permanente éblouissante, ni la nuit noire éternelle ; mais des éclats d’amour, de beauté et de rire, sur fond d’ombres angoissantes ; mais le scintillement bref des instruments au milieu des ténèbres (oui, car la musique ne se perçoit que grâce au silence, le rythme grâce à l’étendue plane) [… »
Plutôt déconcertante de prime abord, Nancy Huston aime choquer, mais sa provocation n’est pas gratuite : les descriptions obsessionnelles d’accouchements gores mettent en relief le drame inhérent à la destinée féminine. Son écriture névrotique est assez bien décrite par un amant de Nadia :
« …] il ne raffole pas non plus de mes romans, il les trouve trop morbides, trop violents, "philopsychotiques" »
Le découpage en séquences assez courtes aide beaucoup à la lecture.
Ses échappées métaphysiques sont fort originales (même si elle m’a parfois ramentu Olga Tokarscuz).
« − Pourquoi le mot seconde, comme mesure de temps ? demandai-je à Sol.
− Hein ?
− On est dans les secondes, les secondes qui passent, tic tac, tic tac. Mais les premières ? Où sont-elles passées, tu peux me le dire ? On n’arrête pas de courir après les premières, toujours en retard, juste une seconde trop tard. »
\Mots-clés : #conditionfeminine #fratrie #historique #misere #mort #musique
- le Lun 12 Sep - 13:10
- Rechercher dans: Écrivains du Canada
- Sujet: Nancy Huston
- Réponses: 21
- Vues: 2226
Jean-Louis Brunaux
Les Gaulois, Vérités et légendes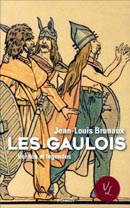
Où on apprend enfin ce qu’il en est exactement de la parenté entre ascendants des indépendantistes bretons et des gilets jaunes :
« Contrairement à ce que dit la rumeur actuelle, les Gaulois ne sont donc nullement une partie des Celtes. C’est tout le contraire : ces derniers ont formé le noyau primitif de la Gaule et se sont trouvés englobés dans l’ensemble plus vaste des Gaulois. »
« Il est donc temps de revenir à la réalité historique, décrite par les plus anciens auteurs grecs : les Celtes sont le plus ancien ensemble humain identifié en Gaule, correspondant à une partie de ses habitants. »
Par une relecture des textes anciens grecs et romains, et par l’apport des recherches archéologiques récentes, Brunaux corrige l’image fantasmagorique des Gaulois et de leur civilisation même si on peut regretter qu’apparemment nous n’en apprendrons jamais beaucoup sur cette culture sans écriture.
« Les druides qui régnaient non seulement sur le monde spirituel mais aussi dans la sphère sociale et politique, en même temps qu’ils avaient interdit l’usage de l’écriture, réprouvaient les figurations artistiques réalistes. À défaut de représentation plastique des humains et des dieux, le corps vivant des premiers devenait une véritable œuvre d’art. »
« Pour eux la vie humaine n’était qu’un stade transitoire dans le cycle permanent qu’accomplissaient les âmes. Le passage sur terre n’était pas particulièrement valorisé, ni plus ni moins que le séjour dans le monde souterrain. Seul comptait le paradis réservé aux guerriers morts sur le champ d’honneur, qui les faisait échapper au cycle des réincarnations. »
« Chaque fois, ils améliorèrent, brisèrent même leurs modèles pour les plier aux usages très spécifiques qu’ils voulaient en faire. Il faut plutôt reconnaître en eux un esprit inventif qui fut l’apanage de fort peu de peuples dans l’Antiquité. Leur imagination et l’intuition de ce qu’ils pourraient tirer des matériaux, des végétaux et des animaux devaient tout à la relation intime, voire charnelle, qu’ils entretenaient avec la nature. Le monde terrestre où ils vivaient ne leur était pas une contrainte à laquelle ils adaptaient leur existence. Ils vivaient en symbiose avec lui, en en tirant le meilleur et en n’hésitant pas à le transformer, à le maîtriser, à en faire leur égal. Aucune crainte religieuse ne semble leur avoir interdit quelque expérience. Certainement faut-il y reconnaître l’influence profonde des druides qui, philosophes et théologiens, avaient soumis le monde tout entier à leurs idées. »
Reste leur art :
« On n’a pas affaire, comme le croient encore quelques historiens d’art contemporains, à une simple réutilisation par les Gaulois de motifs grecs (la palmette, la lyre, la pelte, l’esse, etc.), mais plutôt à leur dissolution dans un mouvement linéaire, sans début ni fin. Ces motifs, que les analystes peinent à isoler pour mesurer la part de l’influence grecque, n’ont aucun sens en eux-mêmes. Ce qui compte est le mouvement perpétuel qu’ils créent, une métaphore des cycles qui régissent l’univers. L’image produite porte un message – et en ce sens elle se montre aussi œuvre d’art – précis et chaque fois nouveau, comme en témoignent quelques éléments à demi figuratifs (tête humaine, yeux, bourgeons, corps serpentin, feuille, etc.) qui sollicitent un commentaire à jamais perdu pour nous. »
« La contrainte de la non-imitation de la nature aurait pu être fatale à cette expression ; elle a été, au contraire, sa plus grande chance. Les monnaies gauloises en livrent l’illustration la plus éclatante. Elles sont inspirées de monnaies grecques, particulièrement du statère en or de Philippe II de Macédoine qui, au début du IIIe siècle, fonctionna comme un dollar de l’Antiquité. Pour que les monnaies gauloises possèdent une quelconque valeur auprès de leurs utilisateurs, il fallait qu’elles reprennent les codes de leur modèle, à savoir, sur l’avers, le profil d’Apollon et, sur le revers, la représentation du char de Philippe II. Ces deux images contrevenaient évidemment à l’interdit pesant sur les représentations divine et humaine. Aussi, dès leurs premières copies, les artistes gaulois n’ont cessé de prendre des distances avec leur modèle avec une imagination qui ne s’est rencontrée qu’à l’époque contemporaine. C’est pourquoi les surréalistes ont tant apprécié ces productions. De multiples expériences ont, en effet, été menées par les artistes gaulois. Certains n’ont gardé que quelques détails de la figure originale : la chevelure, l’œil et la bouche. D’autres ont littéralement peuplé le profil d’Apollon des objets les plus incongrus : tête d’oiseau rapace, arrière-train de cheval, guirlande de perles, tête coupée, etc. Souvent, le graveur a procédé à un démembrement de l’image originale qui confine à une véritable décomposition, une réduction aux éléments constitutifs les plus simples : tubes, sphères qui font immanquablement penser aux œuvres de Fernand Léger. Les artistes d’Armorique, quant à eux, se sont plu à créer des êtres imaginaires, hybrides, entraînés dans des courses endiablées. Pour donner le sentiment de vitesse, les jambes du cheval se démultiplient, comme l’ont proposé longtemps plus tard les futuristes italiens. De même, le portrait semble se déplier, présentant côte à côte la face et le profil, comme sur les portraits de Dora Maar par Picasso. »
\Mots-clés : #historique
- le Jeu 25 Aoû - 12:21
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Jean-Louis Brunaux
- Réponses: 11
- Vues: 663
Régine Pernoud
Pour en finir avec le Moyen Âge
Ouvrage de vulgarisation assez succinct, qui eut au moins le mérite de faire le point sur notre perception de cette période d’"obscurité" à l’époque (livre paru en 1977) ; on peut craindre que ce louable effort de passerelle entre les récentes études et nous, le public, ne soit daté − mais les poncifs ont la vie dure.
« Moyen Âge signifie toujours : époque d’ignorance, d’abrutissement, de sous-développement généralisé, même si ce fut la seule époque de sous-développement pendant laquelle on ait bâti des cathédrales ! Cela parce que les recherches d’érudition faites depuis cent cinquante ans et davantage n’ont pas encore, dans l’ensemble, atteint le grand public. »
Régine Pernoud souligne la « loi d’imitation » de l’antique à la Renaissance, et les « procédés académiques » qui s’en suivirent, c'est-à-dire une inspiration tirée du modèle gréco-romain, qui escamote toute la culture du millénaire médiéval. Apparemment ce livre ne fait pas consensus, et il est vrai que, dans sa défense du Moyen Âge et de l’enseignement de son histoire à l’école, l’autrice avance des idées aussi polémiques que personnelles.
« Les générations à venir (le mouvement est déjà amorcé) ne seront sans doute pas peu scandalisées de constater que la nôtre avait amené l’art dans le giron de la spéculation, manifestant jusqu’en ce domaine la confiance naïve dans les chiffres qui semble caractériser notre XXe siècle ; sa gloire n’en sera pas rehaussée.
Et l’on peut se demander si ces jeunes qui voyaient dans l’œuvre d’art un moment d’extase, un happening, qu’on provoque et qu’on détruit au besoin une fois passé l’émoi, n’étaient pas, somme toute, plus proches des conceptions pré-classiques − à cela près toutefois qu’ils confondaient le présent avec l’instant. »
Pour en revenir à la société féodale, elle était basée sur les engagements personnels (vassalité et fidélité) et les traditions communautaires au travers de la coutume ; essentiellement rurale (avec les centres des châteaux et monastères), on était passé de l’esclave du droit romain au serf, attaché à la terre comme son seigneur qui le protège et ne peut l’exiler, et homme à part entière (avant qu’on ne revienne à l’esclavage avec les colonisations du XVIe).
Régine Pernoud expose comme la femme (ainsi que l’enfant) a perdu de ses libertés avec le revirement de l’époque classique.
« La réaction n’est venue qu’en notre temps. Elle est d’ailleurs, disons-le, fort décevante : tout se passe comme si la femme, éperdue de satisfaction à l’idée d’avoir pénétré le monde masculin, demeurait incapable de l’effort d’imagination supplémentaire qu’il lui faudrait pour apporter à ce monde sa marque propre, celle qui précisément fait défaut à notre société. Il lui suffit d’imiter l’homme, d’être jugée capable d’exercer les mêmes métiers, d’adopter les comportements et jusqu’aux habitudes vestimentaires de son partenaire, sans même se poser la question de ce qui est en soi contestable et devrait être contesté. À se demander si elle n’est pas mue par une admiration inconsciente, et qu’on peut trouver excessive, d’un monde masculin qu’elle croit nécessaire et suffisant de copier avec autant d’exactitude que possible, fût-ce en perdant elle-même son identité, en niant d’avance son originalité. »
« On touche ici du doigt ce qui fait la différence d’une époque à l’autre, c’est-à-dire les différences de critères, d’échelle de valeur. Et il est élémentaire en histoire de commencer par en tenir compte, voire de les respecter, faute de quoi l’historien se transforme en juge. »
« Loin de nous l’idée d’un éternel recommencement, et même de comparaisons forcément factices, subjectives et arbitraires entre telle époque et telle autre ; plus loin encore l’idée que l’Histoire puisse apporter une solution aux problèmes du jour : si l’on peut tirer une conclusion de l’étude de l’Histoire, c’est au contraire que la solution de la veille n’est jamais celle du jour. […]
Mais ne se trouve-t-on pas beaucoup plus à l’aise pour formuler semblables jugements lorsqu’on bénéficie du recul du temps ?… L’Histoire ne fournit pas de solution, mais elle permet − et permet seule − de poser correctement les problèmes. »
Pas la synthèse qu’on pourrait attendre, même partisan voire pamphlétaire (glorification de la culture médiévale, de la place que la femme y tint), cet ouvrage mérite notre lecture "facile", à défaut ou dans l’attente d’approfondir le sujet avec d’autres, plus approfondis.
\Mots-clés : #historique #moyenage
- le Sam 13 Aoû - 16:50
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Régine Pernoud
- Réponses: 5
- Vues: 739
Alain Corbin
Le Village des « cannibales »
Dans la foulée de Le Royaume de ce monde d’Alejo Carpentier, un autre massacre : étude d’un cas exemplaire de mouvement de foule (apparemment irrationnel), de complotisme (manipulation d’une croyance transformée en complot fantasmatique) et de rumeur publique, soit « les mécanismes de psychologie collective » qui y mènent − de quoi éclairer notre actualité (quoique les faits remontent à 1870, le livre à 1986). En fait, la genèse des évènements est, de façon caractéristique, bien plus complexe : Corbin démonte « le travail qui s’opère sur la représentation du passé et l’imaginaire social que celles-ci induisent ». Il y a la vieille haine populaire des riches, des nobles et curés (paradoxalement instrumentalisée par la bourgeoisie rurale contre ces adversaires de caste − "récupération" par « captation »), un profond sentiment démocratique, un grand appétit de liberté, la rébellion contre l’impôt, la nostalgie de l’Empire à côté de la crainte du retour de l’Ancien Régime (qui a même abouti à une antithétique « détestation du républicain » dans le bonapartisme local), et bien sûr l’« angoisse collective », avec évidemment l’exécration du « Prussien », ennemi ou traître "de l’intérieur", fantasmé en cette époque de guerre où partent les fils.
(Je soulignerais les contradictions dans le fait que la bourgeoisie est foncièrement le milieu des nantis, que des sentiments légitimes occasionnent un carnage a priori incompréhensible, et que la simplicité des représentations politiques entraîne l’horreur).
Le supplice d’Alain de Monéys a lieu dans un foirail, à l’écart de toute autorité, sans notables ni forces de l’ordre présentes ; c’est le lieu justement de la consolidation d’une identité paysanne.
« Délivrée de la tutelle de l’autorité dont elle constate l’effacement, la foule libère sa parole : "Il n’y a plus de loi, crient les meurtriers assemblés autour du bûcher, on peut maintenant tuer un noble comme une mouche ou comme un poulet." »
Curieusement (ou pas), Corbin ne donne pas d’explication définitive à cet ultime massacre de la fureur paysanne française, sinon celle d’une résurgence de la cruauté d’un passé barbare, à l’écart du changement des mentalités sur la souffrance et la mort (progrès de l’analgésie, mise à l’écart des abattoirs hors des villes, fin des supplices en place publique, refus généralisé de la vue du sang)…
On est vraisemblablement là aux sources de ma défiance (voire aversion) personnelle pour les rassemblements de masse et mouvements de foule, les défilés, marches de protestation-revendication et autres descentes dans la rue, le militantisme et en général la "politique" …
D’autre part, comme l’auteur, il faudrait savoir éviter les généralisations (je parle pro domo).
\Mots-clés : #historique
- le Mer 27 Juil - 16:57
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Alain Corbin
- Réponses: 9
- Vues: 731
Alejo Carpentier
Le Royaume de ce monde
Bref roman très dense, chronique menée tambour battant de la sanglante révolte des esclaves de Saint-Domingue, suivie de l'exil des colons à Santiago de Cuba. Suivant Ti Noël, victime de l’époque, Carpentier nous relate le quotidien des plantations, la mutinerie des Noirs menés par le Mandingue Mackandal, manchot rebelle qui marronne et qui, devenu puissance vaudou, empoisonne bétail et gens ; à ces croyances africaines (inspirant le « réalisme magique » de l’auteur) s’opposent celles des propriétaires, chrétiens qui refusent les idées nouvelles d’égalité humaine. Puis c’est Pauline Bonaparte, épouse du général Leclerc, beau-frère de Napoléon, ensuite le règne du roi Henri Christophe dans son palais de Sans-Souci, dans sa forteresse au mortier lié de sang de taureaux sacrifiés, indépendance haïtienne aussi dure pour les petits que la servitude précédente, avant que les mulâtres ne prennent le pouvoir et que la servitude ne se renouvelle. Une page d’histoire, brillamment étudiée et rendue : l’influence de la révolution française dans la région (que Carpentier reprendra dans Le Siècle des lumières) − un éblouissant raccourci du cours de la misère humaine dans les Caraïbes. Avec un vocabulaire fort riche, et des scènes anthologiques (comme l’épidémie, l’ambiance de fin du monde chez les colons, la mort d’Henri Christophe).
« Les pluies obéissaient aux conjurations des sages et lors des fêtes de la circoncision, quand les adolescentes dansaient, les cuisses laquées de sang, on frappait des pierres sonores qui faisaient une musique comme de grandes cascades assagies. »
« Mais avec l'âge M. Lenormand de Mézy était devenu maniaque et buvait. Une érotomanie perpétuelle lui faisait guetter à toute heure les jeunes esclaves, dont l'odeur l'excitait. »
« Soudain, Pauline se mit à marcher par la maison de façon étrange, évitant de mettre les pieds sur l'intersection des dalles qui, c'était notoire, ne formaient des carrés que sur l'instigation impie des francs-maçons désireux de voir les hommes fouler la croix à toute heure du jour. »
« Il fallait épuiser le vin, exténuer la chair, être de retour du plaisir avant qu'une catastrophe eût enlevé toute possibilité de jouissance. »
« Çà et là se dressaient des pans de murs, telles de grosses lettres brisées. »
« Il comprenait à présent que l'homme ne sait jamais pour qui il souffre ou espère. Il souffre, et il espère et il travaille pour des gens qu'il ne connaîtra jamais, qui à leur tour souffriront, espéreront, travailleront pour d'autres qui ne seront pas heureux non plus, car l'homme poursuit toujours un bonheur situé au-delà de ce qui lui est donné en partage. Mais la grandeur de l'homme consiste précisément à vouloir améliorer le monde, à s'imposer des tâches. Dans le royaume des cieux il n'y a pas de grandeur à conquérir, car tout y est hiérarchie établie, existence sans terme, impossibilité de sacrifice, repos, délices. Voilà pourquoi, écrasé par la douleur et les tâches, beau dans sa misère, capable d'amour au milieu des malheurs, l'homme ne peut trouver sa grandeur, sa plus haute mesure que dans le Royaume de ce Monde. »
Avec une pensée pour la terrible histoire d’Haïti, sempiternellement recommencée…
\Mots-clés : #ancienregime #colonisation #esclavage #historique #insurrection #misere #regimeautoritaire
- le Mar 26 Juil - 13:31
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Alejo Carpentier
- Réponses: 16
- Vues: 1827
Vassili Grossman
Carnets de guerre : de Moscou à Berlin, 1941-1945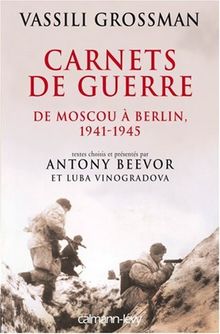
Le livre est composé d’extraits des carnets remplis par Vassili Grossman pendant le conflit entre l’URSS et l’Allemagne nazie, enrichis de lettres et d’articles, l’ensemble étant mis en contexte par l’historien Antony Beevor.
Dès les débuts de l’invasion en juin 1941, Vassili Grossman se porte volontaire pour aller au combat. Il est refusé en raison de son piètre état physique. En revanche, il est accepté comme correspondant de guerre de « Krasnoïa Zvezda », « L’Etoile rouge », journal officiel de l’Armée rouge.
La débâcle de 1941
Il part pour le front en début août à Goumel et Briansk. Il assiste, catastrophé, à l’effondrement de l’armée soviétique et échappe de peu à deux encerclements, surpris par la vitesse à laquelle les panzers foncent sur Moscou. Le récit de l’évacuation en urgence de la ville d’Orel est à proprement parler surréaliste :
« Toute la nuit la ville est en effervescence, des voitures, des charrettes filent à toute allure sans s’arrêter. Au matin, la ville est toute entière envahie d’effroi, d’agonie, comme une éruption de typhus. ».
« Je pensais savoir ce qu’est une retraite, mais une chose pareille, non seulement je ne l’avais jamais vue, mais je n’en avais pas même l’idée. L’Exode ! La Bible ! »
Lors du repli sur Moscou, Grossman fait une halte émouvante à Iasnaïa Poliana, le domaine de Tolstoï
« La tombe de Tolstoï. Au dessus d’elle les avions de chasse hurlent, les explosions sifflent. En cet automne majestueux et calme. Comme c’est dur. J’ai rarement ressenti une douleur pareille. »
Quelques jours plus tard, le général Guderian y installera son QG pour diriger la prise de Moscou.
Finalement, c’est le facteur climatique qui va sauver la capitale. Dès le début d’octobre, la succession de quelques jours de gel et de dégel entraîne le phénomène de la « rapoutitsa », saison des boues, qui enlise littéralement les véhicules blindés allemands.
« Une pareille gadoue, personne n’en a vu, c’est sûr : la pluie, la neige, une soupe, liquide, un marécage sans fond, une pâte noire, touillée par des milliers et des milliers de bottes, de roues, de chenilles. »
Stalingrad
Grossman est envoyé à Stalingrad en août 1942. Il va couvrir une grande partie de la fameuse bataille. Expérience majeure en ce qui le concerne et pour tous ceux qui l’ont vécu. Ses récits sont passionnants. Le correspondant interroge aussi bien les officiers supérieurs que les simples soldats, s’intéresse aux pilotes de chasse, aux snippers, aux tankistes….
Grossman fournit probablement le témoignage le plus véridique et le plus poignant du terrible affrontement sur les rives de la Volga. Ses reportages sont attendus avec impatience par tous les militaires, ce qui le protège d’un Staline qui ne l’aime pas. Il se plaint néanmoins des modifications que l’on fait dans ses articles :
« Mais si tu voyais comment on coupe et comment on défigure [mes textes], comment on va même jusqu’à ajouter des phrases entières à mes pauvres articles, tu serais à coup sûr navrée plutôt que réjouie de ce que mes articles, finalement voient le jour. »
Toutefois, au printemps 43, au moment de la contre-attaque, Grossman est écarté de Stalingrad et envoyé dans le sud en Kalmoukie. Il vit très mal cet éloignement d’une ville où il laissait une partie de son âme :
« Au soir du Nouvel An nous quittons Stalingrad, nous appartenons désormais au front sud. Quelle tristesse ! D’où me vient ce sentiment de séparation ? Pas une fois je ne l’avais éprouvé à la guerre. »
Lors du séjour en Kalmoukie, Grossman s’intéresse à la façon dont a été vécue l’occupation allemande pour ce peuple qui vient d’être libéré. Il y a des informations intéressantes sur la façon dont les occupants avaient modifié les programmes scolaires.
La reconquête, la découverte de l’extermination des juifs
Grossman va suivre les armées dans leur reconquête du territoire envahi, puis de la Pologne et enfin de l’Allemagne jusqu’à la chute de Berlin.
Il découvre, avec épouvante, l’ampleur des massacres juifs : ceux de Babi Yar à Kiev et ceux de Bertidchev qui le marquent personnellement puisque sa mère fait partie des victimes. Grossman s’en doutait mais il a confirmation sur place.
« Et il n’y a plus personne à Kazary pour se plaindre, personne pour raconter, personne pour pleurer. Le silence et le calme règnent sur les corps des morts enterrés sous des tertres calcinés, effondrés et envahis d’herbes folles. Ce silence est plus terrible que les larmes et les malédictions. Et il m’est venu à l’esprit que, de même que se tait Kazary, les Juifs se taisent dans toute l’Ukraine. »
Plus tard, c’est la découverte des camps de Maïdanek et de Treblinka. Là encore, son témoignage est capital.
« La terre rejette des fragments d’os, des dents, des objets, des papiers, elle refuse de garder le secret. Et des objets s’échappent de la terre, de ses blessures mal refermées. »
Impossible de tout dire, mais il y a également des pages étonnantes sur la bataille de Berlin.
Grossman n’hésite pas à parler, malgré de grands risques, de sujets qui « fâchent » : le comportement de soudard d’une partie de l’armée qui est saoule nuit et jour, tue les civils, pille sans vergogne, viole les femmes… Les témoignages sont accablants, en particulier des Russes qui avaient été emmenés en otage et qui sont considérés comme des traites.
Mots-clés : #deuxiemeguerre #historique
- le Jeu 14 Juil - 14:04
- Rechercher dans: Écrivains Russes
- Sujet: Vassili Grossman
- Réponses: 21
- Vues: 3512
Claude Gauvard
Jeanne d'Arc
Héroïne diffamée et martyre
Un bon livre d’histoire qui ne raconte pas comme si on pouvait tout savoir du passé mais qui confronte les sources et n’hésite pas à évoquer les zones d’ombre. Le personnage choisi, bel emblème de l’histoire de France, invoqué par tous les courants politiques mais en ce moment par les plus traditionalistes pour ne pas dire plus, n’est en aucun cas l’occasion d’une nostalgie de l’histoire d’antan, celle qui était indispensable pour un être un bon Français. Ce n’est pas non plus une nouvelle bondieuserie.
Claude Gauvard, spécialiste de la justice médiévale et de ses archives, cite la source qui l’a incitée à entreprendre ce nouvel ouvrage consacré à Jeanne d’Arc.
« Il [ce livre] ne reprend pas non plus les avatars historiographiques de son personnage. Le retour aux sources sur lequel il s’appuie ne prétend pas dire qui elle fut réellement, mais comment ses contemporains ont pu la juger. Un document de 1461, conservé aux Archives Nationales dans la série des registres criminels du parlement de Paris, m’y a incitée. Il état jusqu’alors inconnu des historiens. Au moment où François Villon chantait pour la postérité « Jeanne la bonne Lorraine », un noble nivernais, Jean II des Ulmes, né à peu près en même temps que la Pucelle, la traitait de « putain, ribaude », l’injure préférée des Anglais et des Bourguignons qu’on voyait ainsi resurgir, intacte, trente ans après sa mort. Dans la bouche de certains, peut-être n’avait-elle jamais disparu quand ils parlaient d’elle. »
Le livre, assez court 180 pages, passe au crible les éléments qui questionne cette fama, la renommée qui caractérise chacun au Moyen Age.
Le supplice : pourquoi brûler Jeanne d’Arc ? Il s’agissait, pour les Anglais, de faire disparaître le corps de cette femme qui avait permis à Charles VII de reprendre des villes et de se dresser contre la nouvelle double monarchie d’Henri VI, associant depuis 1431, la France et l’Angleterre.
Le procès associe politiques et religieux et nous plonge dans les relations compliquées qui lient les intérêts politiques des Anglais, les convictions bourguignonnes de l’Université, les rouages du procès religieux : hérétique, sorcière ….
Le roi et le royaume évoque le rôle de Jeanne qui a vécu sur la frontière lorraine du royaume dans son odyssée pour faire sacrer Charles VII et ce que l’on sait de la confiance que les politiques lui ont accordée.
Prophétesse ou sorcière nous permet de saisir les croyances aux prophéties des hommes de cette fin du Moyen Age alors que la chasse aux sorcières n’a pas vraiment commencé.
L’opinion revient sur la réhabilitation nécessaire à Charles VII pour asseoir son pouvoir qui ne pouvait lui venir d’une « putain, ribaude » tandis que les Anglais qui avaient perdu la partie continuaient à y voir les actions maléfiques d’une « sorcière ».
Claude Gauvard conclut ainsi son livre
« Au terme de ce livre, je reste convaincue qu’il est difficile d’écrire sur Jeanne d’Arc. Je me suis modestement contentée de décrire ce que les louanges ou les accusations dont elle fut l’objet révèlent des croyances et des peurs de la société de son temps. Les stéréotypes réducteurs dans lesquels on l’enferma, en particulier les chefs d’accusation de son procès en hérésie et sorcellerie ou les injures comprises de tous et véhiculées facilement partout répondaient aux attentes et aux pratiques de ses contemporains. Au sommet du pouvoir, à la cour du roi, elle suscita des jugements divers, et dans l’opinion, crainte, amour et haine à la fois, tout en étant sans doute ignorée du plus grand nombre. Il en ressort une image finalement contrastée et ambigüe dans le devenir d’un royaume où se mêlaient étroitement le religieux, le magique et le politique.
Il fallut donc attendre longtemps, à la fin du XIXe siècle, pour que la nation s’empare de Jeanne d’Arc et croie qu’elle avait fait la France. »
\Mots-clés : #biographie #historique
- le Dim 29 Mai - 10:29
- Rechercher dans: Histoire et témoignages
- Sujet: Claude Gauvard
- Réponses: 3
- Vues: 405
Kurt Vonnegut, jr
Nuit Mère
(Déjà lu dans la traduction de 1976 avant celle-ci, de 2016. J’ai comparé certains passages des deux traductions, et celui que je cite juste après l’ouverture du fil est globalement identique dans les deux versions, comme Nadine les a montrées. J’avais oublié de répondre à Bédoulène : c’est le moment où la belle-sœur du narrateur préfère, avant de partir dans la débâcle devant l’armée russe, supprimer son vieux chien gâté.)
Nadine, il me semble que le titre porte une majuscule, et même deux, comme celui en anglais, et puisqu’il est inspiré du Faust de Goethe, tel que cité dans la « Note de l’éditeur ». Le même « éditeur » déclare :
« Et, sur ces propos relatifs au mensonge, je risquerai d’avancer l’opinion que les mensonges prononcés au nom de l’effet artistique (au théâtre, par exemple, et dans les confessions de Campbell, peut-être) sont parfois, dans un sens plus profond, les formes de vérités les plus envoûtantes. »
Dans son introduction, Vonnegut rappelle son expérience vécue de la guerre en Allemagne, et donne une morale de l’histoire qu’il raconte :
« …] nous sommes ce que nous feignons d’être, aussi devons-nous prendre garde à ce que nous feignons d’être. »
Il précise de plus :
« Si j’étais né en Allemagne, je suppose que je serais moi-même devenu nazi, bousculant les juifs et les gitans et les Polonais, laissant des paires de bottes dépasser des congères, me réchauffant grâce à mes entrailles secrètement vertueuses. Ainsi va la vie. »
Les confessions de Howard W. Campbell Jr. est un document rédigé par celui-ci en manière de témoignage sur le Seconde Guerre mondiale tandis qu’il est emprisonné à Jérusalem en attendant son jugement.
« J’étais un radio-propagandiste nazi, un odieux et habile antisémite. »
« Sous quel motif voulaient-ils me juger ? Complicité pour le meurtre de six millions de juifs. »
États-unien élevé en Allemagne et y vivant à la déclaration de guerre, ses « émissions transmettaient d’Allemagne des informations codées » à l’intention des services de renseignement américains, et c’était donc un agent états-unien – mais c’est impossible à prouver.
Ce livre, qui ne se rattache effectivement pas au genre SF, mais plutôt espionnage, est très dense (on pourrait en citer d’innombrables extraits). Sur un ton ironique, paraissant proche du cynisme, l’humour macabre n’émousse pas les pointes groupées contre la culture occidentale, frappant à répétition là où ça fait mal. Les nombreux personnages évoqués sont autant de facettes de l’ignominie humaine.
« −Vous êtes le premier homme dont j’ai connaissance, me disait Mengel ce matin, qui ait mauvaise conscience de ce qu’il a fait pendant la guerre. Tous les autres, quel que soit leur camp, quoi qu’ils aient fait, sont persuadés qu’un homme bon n’aurait jamais pu agir autrement. »
Le thème central est donc celui des conséquences effectives de sa "couverture" de zélateur nazi ; ainsi s’exprime son beau-père, qui l’a soupçonné :
« − Parce que vous n’auriez jamais pu servir l’ennemi mieux que vous nous avez servis, nous. J’ai pris conscience que presque toutes les idées qui sont aujourd’hui les miennes, qui m’ôtent tout scrupule vis-à-vis de tout ce que j’ai pu ressentir ou faire dans ma vie de nazi, me viennent non pas de Hitler, non pas de Goebbels, non pas de Himmler… mais de vous. (Il me prit la main.) Vous seul m’avez empêché de conclure que l’Allemagne était devenue folle. »
La femme de son ami Heinz (qu’il va trahir) :
« Les gens qu’elle estimait réussir dans ce meilleur des mondes, après tout, se voyaient récompenser pour leur savoir-faire en matière d’esclavage, de destruction et de mort. Je ne considère pas ceux qui travaillent dans ces domaines comme des gens qui réussissent. »
Campbell est écrivain à l’origine, et voici un de ses poèmes :
« Un énorme rouleau compresseur approcha,
Le soleil s’en trouva éclipsé.
Il passa sur les gens couchés là ;
Personne ne voulait y échapper.
Ma bien-aimée et moi contemplions sidérés
Le mystère de ce destin de sang.
“Couchez-vous, criait l’humanité,
Cette machine est l’Histoire de notre temps !”
Ma bien-aimée et moi nous enfuîmes,
Bien loin des rouleaux compresseurs,
Nous partîmes vivre sur les cimes,
À l’écart de ces temps de noirceur.
Devions-nous rester en bas pour mourir ?
Mais non, la vie nous retenait !
Nous sommes descendus voir ce qu’était devenue l’Histoire ;
Et bon sang, comme les cadavres empestaient. »
Il a donc vécu le grand amour avec sa femme Helga, Une nation à deux, titre d’une de ses pièces, sans se préoccuper des horreurs de la guerre, de la folie schizophrène de l’époque.
« J’avais espéré, comme radiodiffuseur, me limiter au burlesque, mais nous vivons dans un monde où le burlesque est un art difficile, avec tant d’êtres humains si réticents à rire, si incapables de penser, si avides de croyance et de rogne et de haine. Tant de gens voulaient me croire ! »
« Je doute qu’il ait jamais existé une société sans sa part de jeunes gens fort avides de faire l’expérience de l’homicide, pourvu que les sanctions impliquées ne fussent pas trop graves. »
« Je n’ai jamais assisté à une démonstration aussi sublime de l’esprit totalitaire, un esprit que l’on pourrait assimiler à un mécanisme d’engrenage dont les dents ont été limées au hasard. Une machine à penser équipée d’une dentition si chaotique, alimentée par une libido moyenne voire inférieure, tourne avec l’inanité saccadée, bruyante et tape-à-l’œil d’un coucou de l’enfer. […]
Les dents manquantes, bien sûr, sont des vérités simples, évidentes, des vérités accessibles et compréhensibles même pour un enfant de dix ans, dans la majorité des cas. Le limage volontaire de certaines dents de l’engrenage, la mise à l’écart volontaire de certaines données évidentes… […]
Voilà comment Rudolph Hoess, commandant d’Auschwitz, avait pu faire alterner dans les haut-parleurs du camp de la grande musique et des appels aux porteurs de cadavres…
Voilà comment l’Allemagne nazie avait pu ne percevoir aucune différence notable entre civilisation et hydrophobie… »
« “Les bonnes raisons de se battre ne manquent pas, dis-je, mais rien ne justifie jamais la haine sans réserve, l’idée que Dieu Tout-Puissant partage cette haine. Où est le mal ? C’est cette part importante en tout homme qui voudrait haïr sans limites, qui voudrait haïr avec Dieu à ses côtés. C’est cette part en tout homme qui trouve un tel charme à toutes sortes de laideurs.
“C’est cette part en tout imbécile, dis-je, qui punit et diabolise et fait la guerre de bon cœur. »
Un chef-d’œuvre qui allie improbablement humour franc et réflexion sur le pourquoi du nazisme et de la guerre.
\Mots-clés : #antisémitisme #deuxiemeguerre #espionnage #historique #regimeautoritaire #xxesiecle
- le Ven 27 Mai - 12:17
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Kurt Vonnegut, jr
- Réponses: 106
- Vues: 6668
Howard Fast
La Dernière Frontière
1878, les guerres indiennes sont déjà du passé, ainsi que les grands troupeaux de bisons. Les diverses tribus indiennes, vaincues par l’armée états-unienne, sont regroupées dans une zone aride de ce qui deviendra l'Oklahoma. L’agent John Miles, un quaker, dirige l’agence civile de Darlington en Territoire indien, épaulé par la garnison de Fort Reno. Affamée, la tribu (ou village) cheyenne des deux vieux chefs Dull Knife et Little Wolf, environ 300 personnes dont 85 à 90 guerriers (les redoutés Dog Soldiers), décide de retourner sur son ancien territoire, les Black Hills, à 1600 km au Nord, en traversant l’immense Prairie.
« Les plaines qu’ils voulaient traverser n’étaient plus les plaines de leurs pères et de leurs aïeux. Elles étaient coupées de clôtures, ponctuées de fermes. Il y avait des routes, des lignes télégraphiques et, surtout, trois voies ferrées d’est en ouest enserraient d’une triple ceinture de fer le pays tout entier. »
Le capitaine Murray, homme irascible mais prudent (et personnage inventé par Fast), part à leur poursuite avec deux compagnies de cavalerie.
« Mais ce peuple qui tenait tête à des événements plus forts que lui, qui se battait inlassablement, même contre tout espoir, le stupéfiait. Murray n’arrivait pas à croire que ces Indiens avaient un idéal de liberté et d’indépendance semblable à celui des Blancs. Il attribuait leur résistance à un entêtement primitif, à une volonté de suicide racial, et il se jugeait un peu responsable de leur attitude. »
Les Cheyennes affrontent et bernent la cavalerie de Murray, un détachement d’infanterie montée (sur des mules), l’impulsive milice de Dodge City. Sur leur route, aussi des cow-boys, des chasseurs de bisons (seulement pour la peau).
« Pendant des kilomètres et des kilomètres, sur les plaines flottait l’odeur de charnier que dégageait la viande pourrie ; les coyotes eux-mêmes, gorgés de nourriture, dédaignaient cette proie. L’Amérique n’avait jamais été le théâtre d’un tel massacre ; et il n’est pas sûr que dans toute l’histoire de l’humanité on eût jamais vu pourrir ainsi sous le soleil brûlant tant de milliers de tonnes de viande. Les bisons étaient extraordinairement nombreux, mais à force de massacres on finit par en venir à bout. Lorsque les chemins de fer commencèrent à sillonner le continent, les trains attendaient parfois un jour entier qu’un troupeau eût traversé les voies. Cinq ans plus tard, les bisons étaient rares. Dix ans après, ils avaient pratiquement disparu, il n’en restait que le souvenir : un million de squelettes blanchis. »
Les Indiens des Plaines dépendaient de la chasse au bison.
« Certains sont morts de faim, d’autres de malaria, d’autres encore sont partis chasser le bison là où il n’y a plus de bisons. Mais que pouvais-je faire ? Les Indiens chrétiens, ceux qui n’étaient même qu’à demi civilisés, j’ai dû les favoriser… »
Ils sont donc traqués par des centaines d’hommes, mais passent entre les mailles du filet des télégraphistes « aux fronts surmontés de visières vertes » et des lignes de chemin de fer qui transportent les troupes militaires.
Fast rapporte les réactions et atermoiements de l’état-major et de Washington ; les journalistes de tous les États-Unis en font une affaire retentissante, et sans lendemain. Globalement, les Indiens sont considérés comme des sauvages à exterminer, à la fois insondables et dangereux. Mais ils sont aussi dignes et déterminés.
« Le Kansas recouvra son sang-froid et découvrit qu’il n’existait pas un cas, pas un seul et unique cas, d’un citoyen assassiné ou molesté par les Cheyennes, pas une seule maison incendiée : des chevaux avaient été enlevés, du bétail abattu, rien de plus. »
La tribu se sépare en deux : une moitié qui sera épuisée par le froid, la faim, le manque d’eau, et finalement massacrée ; l’autre qui parviendra aux Black Hills.
Dans ce « requiem d’une race condamnée », expression sans outrance puisque d’une part les Cheyennes chantent leur chant de mort quand ils comprennent qu’ils vont périr, et que d’autre part leur peuple est indubitablement condamné, tout dialogue est impossible et c’est l’incompréhension réciproque qui prévaut.
« − Ils sont déjà morts, traduisit le Sioux. Ils vont chez eux, chez eux, chez eux, s’en vont… Sont morts, s’en vont. »
M’a gêné le côté exploit surhumain, peut-être un peu d’exagération dans ce qui paraît constituer un exposé assez factuel d’une épopée sans issue.
Je pense que Bix connaissait ce livre, en tout cas il l’aurait passionné.
« Le mot freedom – liberté –, savez-vous d’où il vient ? Du vieux saxon, free (libre), et doom (mort). Alors, songeons à ce qu’il a signifié : le droit pour tout homme de choisir la mort plutôt que la servitude. Ainsi aucun homme ne pouvait être réduit en esclavage, puisque le pouvoir de mourir demeurait entre les mains de chacun. Même si on lui confisquait tout le reste, il restait maître de son destin. »
\Mots-clés : #amérindiens #colonisation #discrimination #historique #minoriteethnique
- le Lun 16 Mai - 12:31
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Howard Fast
- Réponses: 18
- Vues: 1964
Ariana Neumann
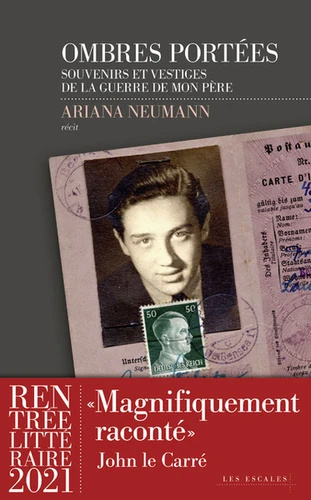
Ombres portées Souvenirs et vestiges es la guerre de mon père
L’auteure, comme il est dit plus haut, est née à Caracas. Son père ne lui a jamais parlé de son passé, comme beaucoup de survivants, elle savait à peine qu’elle était juive et qu’il était né ailleurs. Mais il a pris soin de lui laisser à sa mort une boîte pleine d’archives, pour qu’il ne lui reste plus qu’à prendre son bâton de marche, et retrouve toute une famille éparpillée aux 4 coins du monde, toute une histoire familiale tragique ancrée dans l’Histoire à travers ces destins de juifs tchèques face au nazisme.
C’est toujours la même histoire et jamais la même, c’est toujours saisissant, surprenant, invraisemblable et bouleversant. C’est toujours des secrets bien gardés mais qui se transmettent d’une génération à l’autre. Il y a toujours à apprendre.
Ca me fait toujours penser à Marie, évidemment.
\Mots-clés : #famille #historique #regimeautoritaire
- le Lun 18 Avr - 19:51
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Ariana Neumann
- Réponses: 4
- Vues: 585
W.G. Sebald
Les Anneaux de Saturne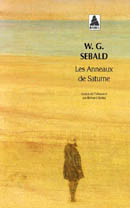
Sebald regroupe ses notes du temps où il fut hospitalisé pour être opéré, puis pendant ses pérégrinations dans le Suffolk, face à « l’océan allemand » (la mer du Nord) ; l’ouvrage est sous-titré en allemand : Eine englische Wallfahrt, le pèlerinage anglais. Après Michael Parkinson, fasciné par Ramuz, il évoque Janine Dakyns, spécialiste de Flaubert. Voici le début d’une belle description du bureau de cette dernière :
« Il m’est souvent arrivé de m’entretenir avec Janine de la conception flaubertienne du monde ; cela se passait en fin de journée, dans sa chambre où les notes, lettres et écrits de toute sorte s’entassaient en si grand nombre que l’on était pour ainsi dire immergé dans un flot de papier. Sur le bureau, point d’ancrage et foyer initial de cette merveilleuse multiplication du papier, il s’était formé au fil du temps un véritable paysage de papier, un paysage de montagnes et de vallées qui s’effritait progressivement sur les bords, à la manière d’un glacier ayant atteint la mer, donnant lieu sur le plancher, tout autour, à des entassements toujours nouveaux qui se déplaçaient eux-mêmes, imperceptiblement, vers le milieu de la pièce. »
Ensuite il parle de Thomas Browne et de La Leçon d’anatomie du Dr Nicolaas Tulp, de Rembrandt, dont il donne une brillante analyse (partiale et discutable). Il raconte son périple à pied dans le nord-est de l’Angleterre, une étrange société de pêcheurs « dos tourné à la terre, avec rien que le vide devant soi », les mœurs du hareng – et il vaut sans doute mieux présenter la table (Actes Sud la servait encore en ce temps-là) pour donner un aperçu des flâneries tant géographiques qu’intellectuelles d’un Sebald éclectique et curieux de tout :
Chapitre I
À l’hôpital – In memoriam – Errances du crâne de Thomas Browne – Leçon d’anatomie – Lévitation – Quinconce – Créatures fabuleuses – Incinération
Chapitre II
L’autorail diesel – Le palais de Morton Peto – En visite à Somerleyton – Les villes allemandes en flammes – Le déclin de Lowestoft – Station balnéaire d’autrefois – Frederick Farrar et la petite cour de Jacques II
Chapitre III
Pêcheurs sur la grève – Contribution à l’histoire naturelle du hareng – George Wyndham Le Strange – Un grand troupeau de porcs – La reduplication de l’homme – Orbis Tertius
Chapitre IV
La bataille navale de Sole Bay – Irruption de la nuit – Rue de la Gare à La Haye – Mauritshuis – Scheveningen – Tombeau de saint Sebald – Aéroport de Schiphol – Invisibilité de l’homme – Sailor’s Reading Room – Images de la Première Guerre mondiale – Le camp de Jasenovac
Chapitre V
Conrad et Casement – Le petit Teodor – Exil à Vologda – Novofastov – Mort et funérailles d’Apollo Korzeniowski – La mer et l’amour – Retour hivernal – Le cœur des ténèbres – Panorama de Waterloo – Casement, l’économie esclavagiste et la question irlandaise – Procès pour haute trahison et exécution
Chapitre VI
Le pont sur la Blyth – Le cortège impérial chinois – Soulèvement des Taiping et ouverture de l’empire du Milieu – Destruction du jardin Yuanmingyuan – Fin de l’empereur Xianfeng – L’impératrice Cixi – Secrets du pouvoir – La ville engloutie – Le pauvre Algernon
Chapitre VII
La lande de Dunwich – Marsh Acres, Middleton – Enfance berlinoise – Exil anglais – Rêves, affinités électives, correspondances – Deux histoires singulières – À travers la forêt de pluie
Chapitre VIII
Conversation sur le sucre – Boulge Park – Les FitzGerald – Chambre d’enfant à Bredfield – Les passe-temps littéraires d’Edward FitzGerald – A Magic shadow show – Perte d’un ami – Dernier voyage, paysage d’été, larmes de bonheur – Une partie de domino – Souvenirs irlandais – Sur l’histoire de la guerre civile – Incendies, appauvrissement et chute – Catherine de Sienne – Culte des faisans et esprit d’entreprise – À travers le désert – Armes secrètes – Dans un autre pays
Chapitre IX
Le temple de Jérusalem – Charlotte Ives et le vicomte de Chateaubriand – Mémoires d’outre-tombe – Au cimetière de Ditchingham – Ditchingham Park – L’ouragan du 16 octobre 1987
Chapitre X
Le Musæum clausum de Thomas Browne – L’oiseau à soie Bombyx mori – Origine et développement de la sériciculture – Les soyeux de Norwich – Maladies psychiques des tisserands – Échantillons de tissu : nature et art – La sériciculture en Allemagne – La mise à mort – Soieries de deuil
Méditations diverses,
« Qu’est-ce donc que ce théâtre dans lequel nous sommes tout à la fois dramaturge, acteur, machiniste, décorateur et public ? Faut-il, pour franchir les parvis du rêve, une somme plus ou moins grande d’entendement que celle dont on disposait au moment de se mettre au lit ? »
… souvent historiques et/ou littéraires, mais aussi géographiques, comme la description frappante du marécage hivernal de Vologda où le jeune Konrad est exilé avec ses parents, la désillusion et prise de conscience du même dans les ténèbres du Congo, une vue baudelairienne de la Belgique, le rapport du consul britannique Casement sur les méfaits du colonialisme en Afrique ; guerres de colonisation également en Chine, dont voici l’impératrice douairière Cixi :
« Les silhouettes minuscules des jardiniers dans les champs de lys au loin, ou celles des courtisans patinant en hiver sur le miroir de glace bleutée, loin de lui rappeler le mouvement naturel de l’homme, la faisaient plutôt penser à des mouches dans un bocal de verre, déjà subjuguées par l’arbitraire de la mort. Le fait est que des voyageurs, s’étant déplacés en Chine entre 1876 et 1879, rapportent que durant la sécheresse qui régna plusieurs années de suite, des provinces entières leur avaient fait l’effet de prisons ceintes de parois de verre. Entre sept et vingt millions de personnes – il n’existe aucun décompte précis à ce sujet – seraient mortes de faim et d’épuisement, principalement dans les provinces du Shaanxi, du Shanxi et du Shandong. Entre autres témoins, le pasteur baptiste Timothy Richards nous rapporte que la catastrophe s’accomplit progressivement, au fil des semaines, sous la forme d’un ralentissement de plus en plus prononcé de tout mouvement. Isolément, en groupes ou en cortèges clairsemés, les gens avançaient en vacillant dans la campagne, et il n’était pas rare que le plus faible souffle d’air les renversât et les laissât couchés à jamais au bord du chemin. Il semblait parfois qu’un demi-siècle se fût écoulé alors qu’on avait tout juste eu le temps de lever la main ou de baisser les paupières ou de respirer profondément. Et la dissolution du temps entraînait celle de tous les liens. Parce qu’ils n’en pouvaient plus de voir souffrir et mourir leurs propres enfants, nombre de parents les échangeaient contre ceux de leurs voisins. »
Il est difficile de limiter les extraits à citer, Sebald approfondissant ses réflexions digressives, et décidément rien ne vaut la lecture intégrale du livre.
Il décrit Dunwich comme un port jadis illustre qui sombre peu à peu dans la mer. Il montre cette partie de l’Angleterre, tout particulièrement les anciennes zones industrielles, comme une contrée ruinée, has been, dont les changements sont dus à l’épuisement des ressources naturelles, et abandonnée dans une sorte de décrépitude généralisée.
« Notre propagation sur terre passe par la carbonisation des espèces végétales supérieures et, d’une manière plus générale, par l’incessante combustion de toutes substances combustibles. De la première lampe-tempête jusqu’aux réverbères du XVIIIe siècle, et de la lueur des réverbères jusqu’au blême éclat des lampadaires qui éclairent les autoroutes belges, tout est combustion, et la combustion est le principe intime de tout objet fabriqué par nous. La confection d’un hameçon, la fabrication d’une tasse de porcelaine et la production d’une émission de télévision reposent au bout du compte sur le même processus de combustion. Les machines conçues par nous ont, comme nos corps et comme notre nostalgie, un cœur qui se consume lentement. Toute la civilisation humaine n’a jamais été rien d’autre qu’un phénomène d’ignition plus intense d’une heure à l’autre et dont personne ne sait jusqu’où il peut croître ni à partir de quand il commencera à décliner. »
À ce propos, l’abandon de l’énergie éolienne (moulins, voiles) au profit de la vapeur (charbon) me laisse pensif.
Mais voici la seule allusion au titre :
« – Ce soir-là, à Southwold, comme j’étais assis à ma place surplombant l’océan allemand, j’eus soudain l’impression de sentir très nettement la lente immersion du monde basculant dans les ténèbres. En Amérique, nous dit Thomas Browne dans son traité sur l’enfouissement des urnes, les chasseurs se lèvent à l’heure où les Persans s’enfoncent dans le plus profond sommeil. L’ombre de la nuit se déplace telle une traîne hâlée par-dessus terre, et comme presque tout, après le coucher du soleil, s’étend cercle après cercle – ainsi poursuit-il – on pourrait, en suivant toujours le soleil couchant, voir continuellement la sphère habitée par nous pleine de corps allongés, comme coupés et moissonnés par la faux de Saturne – un cimetière interminablement long pour une humanité atteinte du haut mal. »
L’évocation de la vie de l’excentrique Edward FitzGerald me fait considérer ce livre aussi comme un recueil de biographies, certes romancées.
« Je ne me suis endormi que vers le matin, le cri d’un merle résonnant à mon oreille, pour me réveiller peu après, tiré d’un rêve dans lequel FitzGerald, mon compagnon de la veille, m’était apparu en bras de chemise et jabot de soie noire, coiffé de son haut-de-forme, assis dans son jardin, à une petite table bleue en tôle. Tout autour de lui fleurissaient des mauves plus hautes que la taille d’un homme, dans une dépression sablonneuse, sous un sureau buissonnant, des poules grattaient le sol et dans l’ombre était couché le chien noir Bletsoe. Pour ma part, j’étais assis, sans me voir moi-même, donc comme un fantôme dans mon propre rêve, en face de FitzGerald, jouant avec lui une partie de dominos. Au-delà du jardin de fleurs, s’étendait jusqu’au bout du monde, où se dressaient les minarets de Khoranan, un parc uniformément vert et totalement vide. »
Voilà une transition typique, ici vers l’Irlande, dans une riche propriété en pleine déchéance.
« Peut-être était-ce pour cette raison que ce qu’elles avaient cousu un jour, elles le décousaient en règle générale le lendemain ou le surlendemain. Peut-être aussi rêvaient-elles de quelque chose de si extraordinairement beau que les ouvrages réalisés les décevaient immanquablement, en vins-je à penser le jour où, à l’occasion de l’une de mes visites à leur atelier, elles me montrèrent quelques pièces qui n’avaient pas été décousues ; car l’une d’entre elles, au moins, à savoir une robe de mariée suspendue à un mannequin de tailleur sans tête, faite de centaines de morceaux de soie assemblés et brodée ou, plutôt, brochée comme d’une toile d’araignée de fils de soie, était une véritable œuvre d’art, si haute en couleur qu’elle en devenait presque vivante, un ouvrage d’une splendeur et d’une perfection telles que j’eus à l’époque, en le découvrant, autant de mal à en croire mes yeux que j’en ai aujourd’hui à en croire ma mémoire. »
Après une évocation de Chateaubriand, via les arbres (dont la disparition des ormes), Sebald en arrive à témoigner des ravages de la tempête de 1987.
Dans le dernier comme le premier chapitre, il revient sur Thomas Browne et son « musée brownien », sorte de cabinet des merveilles bibliophile.
« Dans un recueil d’écrits variés posthumes de Thomas Browne où il est question du jardin potager et d’agrément, du champ d’urnes aux environs de Brampton, de l’aménagement de collines et de montagnes artificielles, des plantes citées par les prophètes et les évangélistes, de l’île d’Islande, du vieux saxon, des réponses de l’oracle de Delphes, des poissons consommés par notre Seigneur, des habitudes des insectes, de la fauconnerie, d’un cas de boulimie sénile et de bien d’autres choses, il se trouve aussi, sous le titre de Musæum clausum or Bibliotheca Abscondita un catalogue de livres remarquables, tableaux, antiquités et autres objets singuliers dont l’un ou l’autre a dû effectivement figurer dans une collection de curiosités constituée par Browne en personne, tandis que la plupart ont manifestement fait partie d’un trésor purement imaginaire n’existant qu’au fond de sa tête et uniquement accessible sous forme de lettres sur le papier. »
La démarche éclectique de Browne (et de Borges, fréquemment convoqué) est fortement rapprochable de celle de Sebald, qui passe à la sériciculture, venue de Chine en Europe et qui, selon lui, introduit une forme de dégénérescence de la population asservie par l’industrie textile débutante (soit une nouvelle variante sur la notion de décadence qui parcourt tout le livre comme un fil directeur).
L’écriture est belle ; j’ai pensé aux textes de Magris et d’autres écrivains voyageurs. Et j’ai beaucoup plus apprécié ces flâneries (une sorte de "rurex", comme il y a l’urbex, dans la lignée des promenades rudérales des Romantiques) que Les émigrants, ma seule autre lecture de Sebald à ce jour ; je comprends maintenant l’admiration que plusieurs Chosiens portent à son œuvre.
\Mots-clés : #autofiction #biographie #essai #historique #nostalgie #voyage
- le Dim 10 Avr - 12:18
- Rechercher dans: Écrivains européens de langue allemande
- Sujet: W.G. Sebald
- Réponses: 74
- Vues: 9042
Page 3 sur 17 •  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages