La date/heure actuelle est Sam 27 Juil - 9:58
181 résultats trouvés pour humour
Marcel Rouff
La Vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet
Dans le Bugey, le médecin Rabaz, le notaire Beaubois, le marchand de bestiaux Magot, les trois convives des mardis soir de l’ancien magistrat Dodin-Bouffant, sont en plein désarroi.
« Eugénie Chatagne, la cuisinière du « Maître », était morte ! En plein épanouissement de son génie, elle venait de disparaître, l’artiste incomparable, la dispensatrice bénie de tous les trésors culinaires dont depuis dix ans, à la table du maître célèbre dans toute la France, ils étaient les bénéficiaires attendris ! Exceptionnellement douée pour les grandes œuvres de la gastronomie, sous la haute direction du roi des gourmets, du dieu des chères parfaites, elle leur avait à profusion dispensé les sensations les plus rares, les émotions les plus complètes, elle les avait ravis sur les plus hauts sommets des allégresses sans nuage. Eugénie Chatagne, interprète inspirée des intentions supérieures que la nature a encloses dans toute matière alimentaire, avait, à force de raffinements, de talent, de recherches, de sûreté de goût, d’infaillibilité dans l’exécution, arraché la cuisine à la matérialité pour la dresser, souveraine et absolue, dans les régions transcendantes des plus hautes conceptions humaines. »
Dodin rend hommage à sa cuisinière et « collaboratrice ».
« J’affirme que si une inconcevable aberration ne déniait pas au goût la faculté d’engendrer un art alors qu’on accorde sans contestation cette faculté à la vue et à l’ouïe, Eugénie Chatagne aurait sa place assurée entre nos grands peintres et nos grands musiciens. »
Il lui cherche une remplaçante, tiraillé entre son absolu de la chère et les appels de sa chair (Eugénie était sa maîtresse, et il cherche aussi à la remplacer au lit). Tous les poncifs traditionnels défilent, depuis la primauté de la cuisine française jusqu’à la gauloise gaillardise, mais la femme cuisinière est vantée.
« Et ce soir-là, toutes les cuisinières de la ville, qui en compte de fameuses, abordèrent leurs fourneaux avec une gravité songeuse. Quelques-unes virent se lever, dans les braises ardentes, l’aube des réhabilitations. »
Le bibliothécaire Trifouille, créateur de bouchées, « les deux tranches d’une chair de homard à la fois séparées et réunies par une farce où se distinguait nettement la douceur de la viande nouvelle d’un très jeune porc de lait, rehaussée d’échalote et de salaison, corsée d’une pointe de morille, amalgamée avec de la pâte à brioche, bénie indiscutablement d’une légère aspersion de bourgogne », mérite de devenir le quatrième commensal.
Invité par le prince héritier d’Eurasie à un banquet munificent, Dodin est déçu :
« L’œuvre qu’il nous a servie est touffue, abondante, riche, mais sans lumière et sans clarté. Point d’air, point de logique, point de ligne. De la coutume, mais pas de règles. Un défilé, mais pas d’ordonnance. Quelles fautes dans la succession des goûts et des touchers ! »
Il l’invite en retour à un menu bien plus simple, d’apparence sommaire, de « quatre petits plats » :
« Les friandises avant le potage,
Le potage Adèle Pidou,
Les fritures de Brillat-Savarin,
Le pot-au-feu Dodin-Bouffant paré de ses légumes,
La purée Soubise,
Les desserts,
Vins blancs des coteaux de Dézaley et de Château-Grillé,
Vins rouges de Châteauneuf-du-Pape, de Ségur et de Chambolle. »
Le summum de la gastronomie, la perfection sans aucune faute sont atteints par la cuisson « en son point » de chaque ingrédient, sans le masque de sauces frelatées, avec une savante adéquation des crus : voilà l'excellence dans « l’art du goût ».
C’est qu’Adèle Pidou officie maintenant avec lui ; il va jusqu’à l’épouser pour la soustraire au prince qui voulait la lui prendre.
Il a une aventure sensuelle avec la jeune Mme Pauline d’Aizery, à laquelle il parvient à résister.
Il est victime de crises de goutte, et sa femme de colique néphrétique ; ils se résignent à suivre une cure à Baden-Baden, occasion d’un désastre culinaire et d’une réfutation de la métaphysique allemande : c’est un aperçu de la barbarie.
« Plus de doute : la cuisine d’un peuple est le seul témoin exact de sa civilisation. »
C’est le beau film de Trần Anh Hùng, La Passion de Dodin Bouffant, qui m’a fait découvrir le livre comme l’auteur.
\Mots-clés : #humour
- le Mer 10 Juil - 12:17
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Marcel Rouff
- Réponses: 7
- Vues: 71
Enrique Vila-Matas
Abrégé d’histoire de la littérature portative
Présentée comme un essai, c’est l’étude de la société secrète des shandys (nom suggéré par le Tristram Shandy de Laurence Sterne), qui s’est notamment inspirée de la boîte-en-valise de Marcel Duchamp pour théoriser leur mouvement littéraire aux temps de dada (cf. Histoire portative de la littérature abrégée de Tristan Tzara, où elle est un considérée comme « un art de vivre ») et du surréalisme.
(Pour mémoire, la boîte-en-valise est un concept de musée portatif des œuvres miniaturisées de l’auteur, une sorte de cabinet des curiosités portable.)
De nombreux artistes, surtout écrivains, sont rattachés à cette société, un condensé de références (comme ce livre lui-même), dont Marcel Duchamp et Walter Benjamin :
« Ils savaient l’un et l’autre que miniaturiser, c’est rendre portatif et que c’était là le meilleur moyen de possession des choses pour un vagabond ou un exilé. »
« C’est comme si, pour Duchamp, le monde était une miniaturisation du monde que le lecteur habite. »
« L’instinct de collection qui caractérisait les shandys leur fut bien utile. Apprendre était pour eux une manière de collectionner, comme dans le cas des citations et des extraits de leurs lecture quotidiennes qu’ils accumulaient sur les carnets de notes qu’ils transportaient partout et qu’ils avaient coutume de lire au cours de leurs réunions de conjurés dans les cafés. Penser était aussi une manière de collectionner, ou du moins l’avait-ce été dans les premiers temps de leur existence. Ils notaient consciencieusement les idées les plus extravagantes, ils développaient de véritables mini-essais dans des lettres à leurs amis ; ils récrivaient des plans pour des projets futurs ; ils transcrivaient leurs rêves ; ils tenaient des listes numérotées de tous les livres portatifs qu’ils avaient lus. »
Les shandys partagent « esprit d'innovation, sexualité extrême, absence totale de grand dessein, nomadisme infatigable, coexistence tendue avec la figure du double, sympathie à l'égard de la négritude, tendance à cultiver l'art de l'insolence. »
La part est belle de la fiction dans cette exégèse biographique et bibliographique décidément aussi fabuleuse que farfelue. Apparaissent des femmes fatales dans ce groupe de célibataires, dont Berta Bocado, une sorte de Rrose Salévy ; on y découvre le principe de « la possibilité de réaliser le suicide dans l’espace même de l’écriture » ; l’Afrique noire est une des constantes du mouvement, notamment à travers l’évocation de Raymond Roussel et de l’Anthologie nègre de Cendrars, mais aussi la danse, la paresse, la création littéraire, et le scandale insolent :
« Un scandale considérable, le triomphe de l’insolence considérée comme un des beaux-arts. »
À Paris, puis Vienne, puis Prague, puis Trieste, les odradeks (kafkaïens), puis golems (meyrinkiens) et bucarestis assaillent ses membres. À bord du Bahnhof Zoo, un sous-marin immobilisé, la « pauvre et pitoyable Mort » leur rend visite.
« Les Shandys composent à eux tous le visage d’un shandy imaginaire ; portrait portatif sur les traits duquel on peut lire les faits qui ont figuré sa tragique existence : la carte de sa vie imaginaire. »
Un des premiers romans d’Enrique Vila-Matas et caractéristique de son œuvre, cette excellente élucubration bouffonne fait ressurgir l’esprit du milieu littéraire des années vingt, qu’il est utile de connaître pour en apprécier les rappels (ou au moins une partie : je ne connaissais pas Aleister Crowley, George Antheil ou Andreï Biély). Au-delà, elle renvoie à tout un imaginaire qui se retrouve souvent sous-jacent dans les belles-lettres (double de l’auteur, minimalisme, mises en abyme, collections, listes, etc.). Tout cela traité avec esprit, humour, inventivité, et de belles fulgurances poétiques.
Voir aussi le point de vue fort juste de Shanidar ICI, et pour creuser le sujet, LÀ.
\Mots-clés : #absurde #biographie #creationartistique #historique #humour #reve #universdulivre #voyage #xxesiecle
- le Mer 19 Juin - 5:41
- Rechercher dans: Écrivains de la péninsule Ibérique
- Sujet: Enrique Vila-Matas
- Réponses: 67
- Vues: 7625
Naguib Mahfouz
Dérives sur le Nil
Anis Zaki, petit fonctionnaire au ministère de la Santé, est le « maître à bord » d’une péniche sur le Nil où une assemblée réduite d’habitués vient partager le narguilé de haschisch (l’omniprésente chicha égyptienne, d’ailleurs pas forcément garnie de « kif », comme improprement désigné dans cette traduction) : un fonctionnaire aisé, marié et croyant, un avocat, un critique d’art issu d’Al-Azhar, un héritier débauché, un célèbre acteur et séducteur, le mutique Anis, « moitié fou, moitié mort », et quelques femmes, dont Sana, jeune conquête de l’acteur. Am Abdu, un vieux colosse imam et proxénète, s’occupe des lieux. Anis est presque toujours dans un rêve hallucinatoire décousu, nourri de références littéraires (Al-Ma'arri, Omar Al-Khayyam, etc.) et historiques.
« Bien que le directeur général possède les pleins pouvoirs prévus par la loi des finances et de l'administration, sa compétence ne s'étend pas aux entrées et aux sorties ; en outre, il y a des milliers d'étoiles filantes qui fusent au-dessus des planètes, avant de se consumer et de se disperser dans l'atmosphère, sans passer par les archives ni être enregistrées dans le classeur des entrées et des sorties ! Quant à la souffrance, seul le cœur la connaît. »
Une journaliste, Samara Bahgat, est introduite dans leur cercle. Elle médite une pièce de théâtre abordant « l'utilisation du sérieux face à l'absurde » avec triomphe en amour de l’héroïne (elle), dont les commensaux seraient les autres personnages, partagés entre l’accoutumance, le libertinage et la fuite du réel ; Anis prend connaissance de ses notes, qui constituent une sorte de mise en abyme du roman, cette manière de comédie.
Les dialogues des amis sont typiques de la conversation égyptienne, riche en humour et en critique.
« "Nous travaillons pour gagner notre vie la première moitié de la journée ; ensuite, nous nous réunissons sur cette péniche pour qu'elle nous emmène dans l'au-delà !"
Elle demanda, avec un intérêt non dissimulé :
"Vous vous désintéressez vraiment de ce qui se passe autour de vous ?
— Nous l'utilisons parfois comme matière à plaisanterie !" »
« Il n'y a aucun rapport entre les choses… »
« "Soit ! la vérité, c'est que je crois au sérieux !" Les questions fusèrent : Quel sérieux ? Le sérieux au profit de quoi ? Est-il possible de croire à l'absurde avec sérieux ? Et si le sérieux implique que la vie ait un sens, quel est-il ? »
« Celui-là, c'est une autre histoire, il est musulman ! il prie et il jeûne ; c'est un mari exemplaire qui reste aussi indifférent aux femmes de la péniche que les Égyptiens aux événements. Peut-être bien que son premier souci est de marier sa fille ! »
« "C'est aussi le secret de la réussite des comédies qui nous montrent dans notre vérité…
— Pourquoi ne reconnais-tu pas cela dans tes articles ?
— Parce que je suis un hypocrite… Je visai par là les comédies étrangères… Les comédies locales finissent généralement par la métamorphose subite de l'acteur comique en un prédicateur imbécile… C'est pour cela que le troisième acte est d'ordinaire le plus mauvais puisqu'il est écrit en réalité pour la censure…"
Khalid se tourna vers Samara et déclara :
"Si tu pensais un jour écrire une pièce sur des gens comme nous, je te conseille, en collègue, de choisir la comédie, je veux dire la farce, ou l'irrationnel, les deux revenant au même…"
— Une idée qui mérite d'être étudiée ! s'écria-t-elle, en ignorant les regards d'Anis.
— Évite les héros engagés qui ne sourient pas, ne parlent que d'idéal, exhortent les gens à faire ceci ou cela, aiment sincèrement, se sacrifient, ânonnent des slogans, et ruinent le spectacle en fin de compte tant ils sont antipathiques…
— Je suivrai ton conseil et écrirai pour les autres, ceux qui ruinent le spectacle tant ils sont sympathiques !
— Mais ceux-là aussi ont un problème artistique ; ils vivent sans foi ; ils passent leur temps dans l'absurdité pour oublier qu'ils seront bientôt changés en cendres, os, limaille, azote, nitrogène et eau… En même temps, ils se tourmentent à l'idée que la vie quotidienne leur impose les variations d'un sérieux acéré, insensé, et que les fous autour d'eux les menacent de destruction à chaque instant. De telles personnes ne travaillent ni n'évoluent… »
L’action se passe essentiellement sur la péniche, à part une excursion nocturne à Saqqara, au cours de laquelle un piéton est tué par leur voiture : le drame se déclenche...
Ce roman m’a fait songer plus à Cossery qu’aux autres que j’ai lu de Mahfouz.
\Mots-clés : #addiction #amitié #humour
- le Dim 19 Mai - 7:35
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Naguib Mahfouz
- Réponses: 3
- Vues: 413
James Patrick Donleavy
L’Homme de gingembre
Deux jeunes États-Uniens fauchés en Irlande après-guerre, Sebastian Balfe Dangerfield et Kenneth O’Keefe, le second parti tenter sa chance en France, le premier reste soutenir (à peine) sa famille (Marion, Anglaise, et leur fille, Felicity) et ses études de droit au Trinity College de Dublin.
« Mais quand on est fauché, le problème est de manger. Quand on a de l’argent, c’est de baiser. Quand on a les deux, c’est la santé ; on a peur d’attraper une hernie ou n’importe quoi. Si tout va impeccablement bien, on a peur de la mort. Regarde-moi ces gueules, ils sont tous coincés par le premier problème de la série, et ça leur durera toute la vie. »
Ne faisant pas grand-chose et rêvant de fortune, Sebastian est facilement attiré par les femmes des environs, tandis que la sienne s’épuise et se révolte contre leur indigence due à son oisiveté, à ses mensonges et son baratin.
« Dignité dans les dettes, devise personnelle. »
Aventure avec « Chris aux longs doigts », du stout, une bagarre ; Marion s’enfuit de leur taudis, Dangerfield parvient à s’incruster dans son nouveau logement. Ils prennent une locataire, Miss Frost, avec qui il couchera lorsque Marion sera de nouveau partie. Skully, l’ancien propriétaire à qui il doit de l’argent, le harcèle.
Un protestant chez les catholiques :
« Je suis entré dans une pharmacie pour acheter des préservatifs, à mon arrivée en Irlande. J’en voudrais une douzaine, ai-je dit. Comment osez-vous demander une chose pareille, m’a répondu le pharmacien en se cachant derrière son comptoir jusqu’à ce que j’aie disparu. Je l’ai naturellement pris pour un fou. Je suis allé plus loin dans la rue. Un large sourire, bonjour et que désirez-vous, j’ai découvert mes dents l’espace d’un instant. J’ai constaté que les siennes étaient légèrement noires. J’ai formulé gracieusement ma demande, en spécifiant, modèle américain si possible. J’ai vu ses traits s’effondrer, la mâchoire s’allonger, les mains se tortiller et un flacon se briser par terre. La femme qui attendait derrière moi, offusquée, a quitté la boutique. Le pharmacien m’a dit d’une voix rauque qu’il ne tenait pas d’articles de ce genre. Et que je veuille bien me retirer car les prêtres le priveraient de son commerce. J’ai pensé que ce monsieur devait avoir quelque chose contre le modèle américain, que je préfère. Je suis entré dans une troisième pharmacie où j’ai acheté une savonnette Imperial Leather, pour faire bien. Après quoi j’ai demandé, discrètement, une demi-douzaine de modèles américains. J’ai entendu le troisième pharmacien balbutier une prière, Sainte Mère de Jésus, protégez-nous des licencieux. Puis il a fait un signe de croix et ouvert grand sa porte en me priant de sortir. Sorti je suis, convaincu que l’Irlande est un pays singulier. »
Érotisme et humour :
« Dangerfield soufflait car elle n’avait rien d’un poids plume. Mais c’était une bonne fille pleine de vigueur, et le travail ne lui faisait pas peur. Toute prête à mettre la main à la pâte. Voilà ce qui cloche dans le monde ; trop peu de gens mettent la main à la pâte, ils laissent les autres travailler à leur place. On voudrait leur faire passer le goût de la paresse quand on les voit se promener bêtement dans la campagne, le dimanche. C’est pénible de les voir chercher ce qu’ils peuvent bien faire de leur jour de congé. Il est temps que je fasse rouler Mary sur le dos, parce que j’ai des morceaux de charbon qui s’enfoncent à travers le matelas dans ma colonne vertébrale. Youp-là. Comme une tortue qu’on retourne. Valsez. Je me demande si cet effort n’est pas un peu trop pour moi. Le cirque, je lui enlève son chandail. Ouah, quelle gaillarde, toute haletante. Ma pensée n’est jamais si pénétrante que dans les moments où je m’ébats avec un corps de femme, pénétrante jusqu’à la garde. »
« C’est presque trop beau à imaginer. Un ventre de bonheur. Toi, en tout cas, Mary, prends de moi ce que tu veux, afin de ne pas avoir à chercher ailleurs. Une orgie sexuelle s’il le faut, tout ce que je peux t’offrir, parce que je m’en sors. Laisse-moi les toucher. Avec ma langue toute neuve. Je vais être une réalité. »
« Parlons de mon rognon. C’est très gentil à toi, Mac. Aurais-tu la bonté d’attendre le moment où tu m’entendras descendre les marches, pour le lâcher dans la poêle et, juste avant qu’il ne la touche, le retourner pour enfin le déposer dans mon assiette ? »
« Vais m’avancer un peu pour jeter un coup d’œil dans l’ouverture du manteau. Bien ce que je pensais, sans bretelles. Vous avez un joli bijou, Dorothy, sur votre pâle décolleté hivernal. Mains sans poils. Les miennes sont froides et jointes. N’ai pas souvent été amateur de cheveux blonds, préférant les bruns, les profonds, l’Ouest. Mais vous êtes riche et c’est ce qui me plaît avant tout. Pourtant, les lis et les roses poussent dans la misère. Suis une fleur délicate. »
Kenneth revient de France au bout de six mois, toujours aussi fauché et puceau (à part une expérience homosexuelle), puis repart en Amérique ; Sebastian fréquente aussi d’autres connaissances du même acabit, comme Tony Malarkey et Percy Clocklan, qui se serait suicidé.
« Pourtant, je ne suis pas à plaindre. Je ne me plains pas. Simplement, je n’aurais rien contre un changement complet. »
« Danger » part à Londres, où il retrouve son ami MacDoon, qui le déguise en kangourou.
Son père décédé, Sebastian escompte hériter d'une fortune tant attendue :
« … une somme placée en dépôt de façon à assurer un revenu qui n’excédera pas six mille dollars par an, lequel revenu vous sera versé dès que vous atteindrez l’âge de quarante-sept ans, ce qui signifiera… »
Mary l’a rejoint, il l’a jetée et elle va faire du cinéma.
« Des vieilles, là-bas, avec des diamants sur le buste à défaut d’autre chose. Je suis saisi parfois de l’envie de m’en faire une. L’âge ne me gêne pas. Bûches dans le feu. Je ne crois pas à Noël. C’est une escroquerie. Je sais que c’est une escroquerie. Personne ne fait attention à moi. On va y remédier.
Sebastian prenant son souffle avant de rugir.
— Noël est une escroquerie.
Le cri semant ses échos. Sourires épanouissant les visages de MacDoon et de Clocklan, car ils savaient que s’annonçait la nuit de la franchise. Derrière la porte de la bibliothèque, Mary se préparait au pire.
— Noël est une escroquerie. Cette pièce est pleine de filous et de voleurs. Jésus était un Celte et Judas un Britannique. »
On ne peut que penser à Henry Miller et à l’Ulysse de James Joyce à la lecture de ce roman, au style particulier, souvent elliptique, par brefs segments de phrases, dont les verbes d’action sont souvent éludés, et qui rend un flux de conscience composé de bribes sans cohérence forcément évidente.
\Mots-clés : #amitié #erotisme #humour #jeunesse
- le Ven 17 Mai - 8:27
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: James Patrick Donleavy
- Réponses: 2
- Vues: 147
Romain Gary
La Danse de Gengis Cohn
Incipit :
« Je suis chez moi, ici. Je fais partie de ces lieux et de l'air qu'on y respire d'une manière que seuls peuvent comprendre ceux qui y sont nés ou qui ont été complètement assimilés. Une certaine absence, qui a de la gueule, sans me vanter. À force de se faire sentir, elle devient une véritable présence. Il y eut, certes, usure, habitude, accoutumance, une légère évaporation et la fumée ne marque jamais le ciel d'une manière indélébile. L'azur, un instant enjuivé, se passe un peu de vent sur la figure et aussitôt, il n'y paraît plus. »
Vingt-deux ans plus tard, Moïché dit Gengis Cohn reste le dibbuk (démon qui hante l'individu auquel il est attaché) de Schatz (trésor !), le SS qui commanda son exécution en 1944, devenu Commissaire principal. Schatz enquête sur une série de meurtres (« vingt-deux meurtres en huit jours ») ; les victimes sont toutes des hommes, retrouvés poignardés dans le dos avec une expression de ravissement sur le visage, et déculottés…
« Dix-neuf ans de démocratie, c'est lourd à porter, lorsqu'on a un passé. Le nouveau chancelier Kiesinger avait appartenu un instant au parti nazi de 1932 à 1945, dans un moment d'idéalisme et de fougue juvéniles. »
Cohn, un comique juif, apparaît fréquemment à Schatz, qui est le seul à le voir, et sombre dans la paranoïa ; de temps à autre, ils se lient dans une certaine complicité, ont même parfois tendance à se confondre.
« Je crains qu'à force de nous griser de culture, nos plus grands crimes s'estompent complètement. Tout sera enveloppé d'une telle beauté que les massacres et les famines ne seront plus que des effets littéraires ou picturaux heureux sous la plume d'un Tolstoï ou le pinceau d'un Picasso. »
L’Allemagne est visée en tant que peuple où aurait lieu un regain nazi.
« Ce n'est pas pour rien que les nouveaux nazis accusent leurs compatriotes de s'être enjuivés. On se demande même s'ils parviendront jamais à retrouver leur pureté raciale, et on comprend alors pourquoi tant d'entre eux rêvent d'autodestruction. Je sais, par exemple, que mon ami Schatz a une telle envie de se débarrasser de moi qu'il a même fait une tentative de suicide. Il veut ma perte. Je crains toujours qu'il ne se pende, ou qu'il n'ouvre le gaz, dans une crise d'antisémitisme. »
« Alors, voilà : les Allemands avaient Schiller, Goethe, Hölderlin, les Simbas du Congo ne les avaient pas. La différence entre les Allemands héritiers d'une immense culture et les Simbas incultes, c'est que les Simbas mangeaient leurs victimes, tandis que les Allemands les transformaient en savon. Ce besoin de propreté, c'est la culture. »
« Si, pour redevenir elle-même, l'Allemagne doit renoncer à l'antisémitisme, elle le fera : c'est une nation très décidée et qui ne recule devant aucun sacrifice. »
Le richissime baron von Pritwitz est venu se plaindre au Commissaire de la disparition de son épouse Lily avec Florian, son garde-chasse, sympathique personne cependant froide en cette époque de chaleur, et pour tout dire mortifère ; Lily, la belle aristocrate, quant à elle, est éprise de culture.
« Nymphomane, c'est vite dit. Je trouve que Schatz ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il est permis d'avoir de l'idéal, des aspirations et de se donner beaucoup de mal pour essayer de les réaliser. On peut attendre le messie, chercher le sauveur, l'homme providentiel, le surhomme, sans se faire traiter de tous les noms. Ou alors, il n'y a qu'à dire que l'humanité est une frigide et une détraquée, condamnée à l'échec. Car enfin, il n'y a pas que l'Allemagne qui rêve, désire, attend, essaie, échoue, recommence, essaie toujours et n'aboutit jamais. On peut avoir le goût de l'absolu, de la possession totale – de la solution finale, si vous voulez – sans jamais y parvenir, mais sans se décourager. L'espoir, c'est ça qui compte. Il faut persévérer, essayer encore. Un jour, on y parviendra. Ce sera la fin du rêve, de la nostalgie, de l'utopie. »
« – Vous nous avez déjà fait assez de mal, avec votre propagande, depuis un quart de siècle. Je veux bien passer l'éponge, mais à condition que vous cessiez de nous enquiquiner ! Compris ? Nous en avons assez d'être obligés de vivre avec des fantômes ! Vous voulez que je vous dise, Cohn ? Vous êtes démodé. Vous faites vieux jeu. L'humanité vous a assez vu. Elle veut du neuf. Vos étoiles jaunes, vos fours, vos chambres à gaz, on ne veut plus en entendre parler. On veut autre chose. Du neuf. On veut aller de l'avant ! Auschwitz, Treblinka, Belsen, ça commence à faire pompier ! Ça fait le Juif de papa ! Les jeunes, ça ne leur dit plus rien du tout. Les jeunes, ils sont venus au monde avec la bombe atomique, ils ont des soleils dans les yeux ! Pour eux, vos camps d'extermination, ça fait pedzouille ! Ils en ont assez de bricolages ! Ils en ont soupé de nos bricoles juives, de nos petits pipis ! Cessez donc de vous accrocher à votre magot, à votre petit capital de souffrance, d'essayer de vous rendre plus intéressant que les autres. Les privilégiés, les peuples élus, il n'y en aura bientôt plus. Ils sont deux milliards, mon ami. Alors, qui cherchez-vous à impressionner, avec vos six millions ? »
« Ah non ! Le Vietnam, ce n'est pas ici, c'est en Amérique ! Qu'est-ce que ça veut dire, Cohn ? De quoi vous mêlez-vous ? Il n'y a pas de Juifs au Vietnam ! Ça ne vous regarde pas ! »
« Tous ces livres, tous ces documents, tous ces souvenirs de rescapés et, par-dessus le marché, son Juif personnel qui ne le quitte pas d'une semelle, malgré les psychiatres et l'alcool, il estime que cela a assez duré. Peut-être n'aurait-il pas dû crier Feuer ! il y a vingt-deux ans. Mais il était jeune, il avait un idéal, il croyait à ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il ne le ferait plus. Si jamais on lui donne une deuxième chance, lorsque le N.P.D. arrivera au pouvoir, et si Herr Thielen lui donne l'ordre, à lui, Schatz, de crier Feuer ! eh bien, lui, Schatz... Au fait, que ferait-il ? Il me cherche du regard, mais je me garde bien de le conseiller : après, on dira que c'est encore nous autres, Juifs, qui avons sapé le sens de la discipline et la fibre morale du peuple allemand. »
« Schatz se voit entouré de toutes parts d'une telle rancœur qu'un soupçon encore plus affreux lui traverse l'esprit : ne serait-il pas tombé, lui, l'ex-SS Schatz, dans le subconscient d'un auteur juif et ne l'a-t-on pas condamné à demeurer éternellement en ce lieu terrible ? N'est-il plus, lui, Schatz, qu'un dibbuk de nazi, à tout jamais emprisonné dans l'âme juive, à commencer par celle de cet écrivain impitoyable ? Impitoyable, car il ne paraît avoir qu'une idée en tête : empoisonner par sa littérature maudite le psychisme des générations futures. Un véritable crime contre l'espèce, une atrocité spirituelle plus criminelle que toutes celles, purement physiques, d'Auschwitz. »
« Je me souviens soudain que de la souffrance du Christ, des milliers de salopards ont tiré de très belles œuvres. Ils s'en sont régalés. Même en descendant plus bas, je me rappelle que des cadavres de Guernica, Picasso a tiré Guernica et Tolstoï a bénéficié de la guerre et de la paix pour son Guerre et Paix. J'ai toujours pensé que si on parle toujours d'Auschwitz, c'est uniquement parce que ça n'a pas encore été effacé par une belle œuvre littéraire. »
« Je vois soudain en plein milieu de la forêt de Geist une main sortant d'une bouche d'égout du ghetto de Varsovie, une main nue, laissée sans armes par l'humanité entière. La main se ferme lentement et le poing juif reste ainsi levé au-dessus de l'égout. »
La seconde partie est titrée Dans la forêt de Geist (Geist signifie en allemand esprit, génie, "idée de base") ; c’est là que sont perpétrés les meurtres ; le roman perd son peu de rationalité. Cohn et Schatz y rencontrent Florian, la mort, et Lily, la madone des fresques, la princesse de légende de la Renaissance, la nymphomane frigide que tous les hommes sont impuissants à contenter (tout au long du récit, la Joconde symbolise un aspect obscène, racoleur, de la culture). Des réflexions psychanalytiques sur le subconscient sont avancées ; des « considérations talmudiques » sont émises sur la nature de Dieu, avec même une nouvelle Crucifixion.
« Nous sommes un peuple de rêveurs, ce qui fait que nous n'avons jamais cessé d'attendre la création du monde. »
Menacé d’exorcisme, de fraternité œcuménique, Cohn songe à Tahiti, ce paradis terrestre…
L’humour noir (yiddish) fuse comme au vaudeville dans cette farce macabre aux sous-entendus salaces, aux accents parfois céliniens dans leur délire. J’ai souvent ri à cette lecture loufoque, même si le ton est hargneux, et franchement irrévérencieux.
Ce roman allégorique, apparemment issu d’une visite sur les lieux de la Shoah en 1966, constitue le deuxième volume de la trilogie Frère Océan (le premier, Pour Sganarelle, est une sorte d’essai littéraire défendant le roman picaresque) ; Frère Océan, c’est semble-t-il l’océan originel, mais aussi le subconscient collectif de la culture.
\Mots-clés : #antisémitisme #campsconcentration #communautejuive #culpabilité #deuxiemeguerre #fantastique #genocide #humour #satirique #xxesiecle
- le Mer 8 Mai - 12:41
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Romain Gary
- Réponses: 118
- Vues: 11058
Philip Roth
Pastorale américaine
Le romancier Nathan Zuckerman, la soixantaine, est contacté par l’idole de son enfance à Newark, Seymour Levov, « le Suédois », une star sportive, un Juif comme lui et son aîné de quelques années. Seymour est l’image-même de la réussite états-unienne, familiale, sociale, professionnelle. À ce propos, il a repris l’entreprise de son père, et dit avoir dû délocaliser son usine à regret, après les émeutes raciales de Newark de 1967, à cause de la situation sociale (violence et insécurité), pour former une main-d’œuvre compétente à l’étranger (ce qui constitue la succession inverse des faits telle qu’elle est souvent présentée). Seymour est vu comme un brave, gentil conformiste, dans le prolongement de sa jeunesse de « héros de lycée », « notre Kennedy ». Mais Nathan doit revoir son jugement :
« Le fait est que comprendre les autres n’est pas la règle, dans la vie. L’histoire de la vie, c’est de se tromper sur leur compte, encore et encore, encore et toujours, avec acharnement et, après y avoir bien réfléchi, se tromper à nouveau. C’est même comme ça qu’on sait qu’on est vivant : on se trompe. »
Jerry, le frère de Seymour, apprend à Nathan que ce dernier vient de mourir d’un cancer, et surtout qu’il était dévasté par l’attentat à la bombe perpétré par sa fille de seize ans en 1968 contre la guerre au Vietnam.
« Or survient la fille perdue, la fille en cavale, cette Américaine de la quatrième génération censée reproduire en plus parfait encore l’image de son père, lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite… survient la fille en colère, la malgracieuse, qui crache sur son monde et se fiche éperdument de prendre sa place dans la lignée Levov en pleine ascension sociale, sa fille, enfin, qui le débusque comme un fugitif, qui le pousse la première dans la transhumance d’une tout autre Amérique ; sa fille et ces années soixante qui font voler en éclats le type d’utopie qui lui est cher, à lui. Voilà la mort rouge qui contamine le château du Suédois, et personne n’en réchappe. Voilà sa fille qui l’exile de sa pastorale américaine tant désirée pour le précipiter dans un univers hostile qui en est le parfait contraire, dans la fureur, la violence, le désespoir d’un chaos infernal qui n’appartient qu’à l’Amérique. […]
Qui est fait pour la tragédie et la souffrance absurde ? Personne. La tragédie de l’homme qui n’était pas fait pour la tragédie, c’est la tragédie de tout homme. »
Meredith, dite Merry Levov, fait l’objet d’une « étiologie » (notamment psychiatrique) de son bégaiement de jeune adolescente révoltée qui se tourne vers l’extrémisme. Alors qu'elle est en cavale après l’attentat qu’elle a perpétré, Rita Cohen, qui s’avère être une terroriste communiste, prend contact avec Seymour.
Roth rend le calvaire de Seymour, lui si raisonnable, responsable.
« Telle est la vie extérieure, qu’il mène autant que faire se peut sans changement apparent. Mais elle se double d’une vie intérieure, d’une vie intérieure morbide, hantée par des obsessions tyranniques, des pulsions refoulées, des espoirs superstitieux, des imaginations effroyables, des conversations fantasmées, des questions insolubles. De nuit en nuit, insomnies, autopunition. Solitude colossale. […]
Et au quotidien rien à faire, sinon assumer cette imposture, continuer de vivre sous son identité, avec l’ignominie de se faire passer pour l’homme idéal. »
« S’il avait pu de nouveau fonctionner comme tout un chacun, redevenir tel qu’en lui-même, au lieu d’être ce charlatan à la sincérité schizophrène, lisse dehors, tourmenté dedans, stable aux yeux d’autrui, et pourtant le dos au mur en son for intérieur, puisque son personnage social détendu, souriant et factice servait de linceul au Suédois enterré vivant. S’il avait pu, si peu que ce fût, recouvrer son existence cohérente, indivise, qui lui avait donné son assurance physique, sa liberté d’allure avant d’engendrer une meurtrière présumée. »
Il décrit aussi la dépression de sa femme Dawn, une Irlandaise, ex-Miss New Jersey, musicienne, éleveuse de bétail, qui en est venue à le rendre responsable du drame ; il expose le métier de la ganterie transmis par son père à Seymour, ainsi que les valeurs de travail et d’excellence.
Puis Seymour retrouve Merry, devenue une adepte jaïn (« l’ahimsa, le respect systématique de la vie »), clandestine vivant dans des conditions sordides ; la terroriste a perdu son bégaiement, peut-être en se voilant pour ne pas tuer de petites vies. Fabricant des bombes, elle est la responsable directe de quatre morts (et a été victime de deux viols).
C’est tout le rêve américain fracassé qui est brossé, aboutissant dans la violence à une sorte de nihilisme dans un terrible conflit de génération.
« Trois générations. Toutes en ascension sociale. Le travail, l’épargne, la réussite. Trois générations en extase devant l’Amérique. Trois générations pour se fondre dans un peuple. Et maintenant, avec la quatrième, anéantissement des espoirs. Vandalisation totale de leur monde. »
« Il avait fait du mieux qu’un parent pouvait faire — il avait écouté tant et plus, alors même qu’il se retenait de toutes ses forces pour ne pas se lever de table et s’en aller en attendant qu’elle ait craché son venin. »
« Toujours dans la peau d’un personnage. Ce qui avait commencé de manière assez anodine du temps qu’elle jouait les Audrey Hepburn avait donc conduit en dix ans à ce mythe exotique de l’abnégation ? D’abord la niaise abnégation au nom du Peuple, maintenant la niaise abnégation de l’âme parachevée. Phase suivante, le crucifix de grand-mère Dwyer ? Est-ce qu’on allait revenir à l’abnégation suprême de l’éternelle chandelle et du Sacré-Cœur ? On était toujours dans l’irréalité grandiose, dans l’abstraction la plus lointaine — on ne s’occupait jamais de sa petite personne, alors là, jamais de la vie. Quelle imposture, quelle horreur inhumaine, cette abnégation ! »
« Tuer Conlon [le médecin victime collatérale de sa première bombe] n’avait fait que confirmer son ardeur de révolutionnaire idéaliste, qui n’hésitait pas à adopter les moyens, même impitoyables, de détruire un système injuste. »
Nombre de personnalités politiques états-uniennes sont évoquées, mais aussi Frantz Fanon, comme "influenceurs" de Merry. Jerry rabroue son frère à cause de son attitude envers le « monstre ». Puis Dawn décide de se refaire chirurgicalement une beauté, et de quitter la résidence rurale traditionnelle qui plaisait tant à Seymour (pleine de souvenirs) pour une maison lumineuse conçue par un architecte wasp (avec lequel elle trompe son mari – mais ce dernier a aussi fauté, avec Jessie, l’orthophoniste de Merry, qui accueillit celle-ci après son départ…). Cette confrontation avec ces amis, les Bill et Jessie Orcutt, les Barry et Marcia Umanoff, d’une certaine aristocratie ou élite intellectuelle établies, révèle (outre un fabuleux jeu de masques) un autre aspect social des États-Unis de la seconde moitié du XXe (et qui éclaire toujours la société contemporaine).
Des phrases comme celle-ci, en début de paragraphe, font d’avance sourire si on connaît un peu Roth :
« Au dîner la conversation roula sur le Watergate et sur Gorge profonde. »
Lou, le bavard père de Seymour, vieux has been, a des propos, certes décousus, mais pas forcément incohérents (il soutient aussi le fait que les délocalisations ont commencé avant les problèmes raciaux).
« C’est pas les syndicats à eux tout seuls qui nous ont cassés, cela dit. Les syndicats ont rien compris, mais certains industriels non plus. “Je veux pas payer ces fils de putes cinq cents de plus”, et le gars qui dit ça roule en Cadillac et passe l’hiver en Floride. Non, y a beaucoup d’industriels qui ont pas su réagir. Mais les syndicats n’ont jamais compris la concurrence d’outre-mer et, à mon avis, ils ont bel et bien accéléré la ruine de l’industrie du gant par leur intransigeance : on ne pouvait plus faire de bénéfices. »
Bill Orcutt :
« La permissivité. La perversion drapée dans les voiles de l’idéologie. La contestation perpétuelle. »
Roth évite de donner directement son avis en forçant le trait avec humour, en rapportant des points de vue erronés, des pensées attribuées à un personnage par le biais d’un autre (notamment son alter ego Zuckerman). Difficile de donner un résumé de ce livre sans être partial ; dans ce roman fouillé, qui compte près de 600 pages, Roth lance son lecteur sur de nombreuses pistes, le mène si bien qu’il le déroute souvent. Demeure cependant le constat d’un échec social, sociétal, voire civilisationnel d’une culture en pointe du monde occidental.
Au vu de son commentaire, ce n'est pas Topocl qui me contredira comme je recommande la lecture de ce livre.
\Mots-clés : #culpabilité #historique #humour #mondedutravail #politique #portrait #psychologique #relationenfantparent #satirique #social #solitude #terrorisme #xxesiecle
- le Sam 27 Avr - 13:38
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Philip Roth
- Réponses: 114
- Vues: 12705
Serge Rezvani
Les Années-lumière
Autobiographie de Rezvani : petite enfance de Cyrus-Boris ballottée en exil avec une mère russe atteinte d’un cancer, (puis) un père persan, magicien et infidèle. Fantaisiste, baroque et surréaliste (on peut en rapprocher par moments L'Écume des jours de Boris Vian), le récit se commente lui-même, y mêle Lula, le grand amour de sa vie au présent, dans une jubilation créative.
Mis en pension « dans la masure du bout du monde » en Suisse :
« À la fonte des neiges, nous essayons de reprendre le chemin de l’école, mais la boue a tout envahi. On enfonce jusqu’aux genoux, parfois même jusqu’au ventre. C’est décourageant. Le sous-sol travaille. Des effondrements creusent des cratères au pied même des maisons, minant les fondations. Ça glougloute de tous les côtés. D’un instant à l’autre, la rue change sous nos yeux. Il n’y a plus de sécurité à se déplacer. Traverser la cour devient une aventure.
Le village est bâti sur une poche de vide et on entend sous terre un grondement continuel de cataracte. Même les vieillards hochent la tête inquiets. La montagne frémit, des arbres entiers, tout droits avancent sur les pentes. On les voit subitement faire quelques mètres et s’arrêter. Ça glisse de tous les côtés. Des rochers énormes dérapent en silence, déplaçant les sentiers et les clôtures. Et toujours ce bruit souterrain assourdissant. Les anciens parlent d’une grotte gigantesque dont l’accès aurait été perdu depuis bien longtemps.
L’instituteur ne tient plus en place, cette histoire de grotte le fait rêver. Il n’en dort plus, il n’en mange plus. Il n’arrête pas de tourner autour des masures. Il racole les vieux pour avoir des détails. Il ne parle plus que de ça. Il est insatiable. Il fait des dessins, des plans, mais la montagne bouge tellement qu’il ne peut pas prendre de repères. Ça le désespère.
Un jour il s’en va par les sentiers, et s’enfonce dans le chaos. Nous le regardons longtemps monter comme une mouche sur le flanc de cette nature changeante. Il zigzague entre les arbres. De temps en temps il se retourne vers le village, agite son chapeau tyrolien et reprend l’ascension. On le voit de plus en plus minuscule, ridicule, rouler, se relever, courir jusqu’à une pierre, s’agripper, sauter et s’étaler. Les arbres glissent autour de lui, les rochers par quartiers entiers se décollent et rebondissent dans les précipices.
Il me semble que l’instituteur ne revint jamais. »
Son père vient le prendre pour vivre avec lui et sa compagne Pipa dans un petit appartement parisien, « le taudis aux pendolents » [pendeloques de cristaux] ; c’est un prestidigitateur qui fait de la voyance pour dames et beaucoup de pitreries.
« Ce fut pire qu’un accouchement, qu’une deuxième naissance, il fallait que je réapprenne à être, que je reprenne pied dans ce nouveau monde, il fallait essayer de croire à toute cette douceur. Je pleurais d’avance. C’était sûr que j’allais tout perdre. On m’emmènerait encore, on m’abandonnerait comme Lydia m’avait abandonné, on m’abandonnerait. Je bégayais : "Gaaar… dez… moi… aaah ! Gaaar… dez… moi… aaaah ! Gaaaar… deez… moi !" »
Assez vite, le couple le met en pension chez un pope.
« Ma langue vient frapper avec un bruit infernal sur les galandales de l’entre-dents. Mes molaires, je les compte une à une avec la pointe gustative du muscle glambuleur. Je m’embrouille dans les mauvais chiffres, les incisives, les canines, les prémolaires. Le muscle glambuleur cogne entre les crocs. Quatre-vingt-deux canines, ce qui fait cent. Le muscle trémulseur cherche la petite carie sur la quatre mille huit centième dent de la galandale inférieure. Les prismes musicaux trémolotent sur la gustative quatre. Les papilles musicalisées viennent se ranger bien sagement à la suite des amygdales. Pas de problème. J’enlève deux amygdales, il en reste huit plus une molaire, ça donne une ralingue sur sept qui ne fonctionne pas. Je reprends toutes mes amygdales et je les pose une à une sur la ralingue vingt-deux. Délicatement je fais descendre la ralingue quatre. Schplokssss ! Un grand coup de cuisse sur la touffe puante et les petites violettes commencent à pousser. Hi hi hi ! La ralingue descend, descend… grummm ! Je mâche les amygdales. Soixante et quelque chose amygdales ça fait une fameuse omelette, ça bave tellement partout qu’il en ressort par la ralingue huit. Je fais venir une autre ralingue, j’hésite une seconde entre la neuf et la douze. Je la pousse avec le muscle gustatif renversé, appuyé du glambuleur, saliveur, mâchouilleur, le plus dégueulasse de tous les muscles, celui qui se gonfle derrière mes oreilles. »
On est dans l’avant-guerre de la Seconde, vient l’exode, mais Rezvani revient toujours au rire, au délire. Les souvenirs sont développés à outrance par amplification.
Retour en famille à Paris occupé :
« Mon père ne refusait son assistance à personne. Pendant toute la guerre ce fut un carrousel incroyable. Chez mes parents c’était le no man’s land, une espèce de Suisse, minuscule en plein Paris. Mon père restait assis dans son vieux fauteuil à faire sauter sa bille, pfffuit, pffffuit, pffffuitt ! il laissait venir. Si c’était un résistant, il lui disait de faire gaffe, de raser les murs. Le résistant partait content et payait pour ce simple conseil. Si c’était un Juif il l’engageait à réaliser tout ce qu’il pouvait sur l’heure et à se cavaler le plus vite possible. Si c’était un collaborateur (et combien sont venus et revenus vomir chez le mage leur mauvaise conscience), il le pressait de retourner sa veste. Quand c’était von Fridoleïn il se faisait tout petit, petit, pas fou et il se frottait les mains, il aurait crié « Heil Hitler ! », n’importe quoi et surtout il le priait de bien essuyer ses bottes sur le paillasson, parce que sous le paillasson il y avait des actes de baptême qu’il avait mis à vieillir pour des Juifs. Des actes de baptême bien catholiques pour Juifs bien Juifs. Pas mal de curés sont venus aussi se renseigner dans le grand livre pour savoir de quel côté il valait mieux pencher. Il faut dire qu’avec Pie XII ils ne savaient plus très bien. Ceux-là payaient en actes de baptême vierges. »
Il s’efforce de dessiner une sirène, qui peu à peu devient Pipa, et est de nouveau envoyé en pension, celle de l’amiral Chalapine.
« Nous pénétrons dans la chapelle. L’odeur immonde d’encens me prend à la gorge, de nouveau cette envie de vomir, des relents d’oreillons. Pouah ! Le tabernacle, hostie et compagnie, toute la quincaillerie de maniaque, ciboire russe, cuillère russe à long manche d’argent pour racler, ostensoir russe, tout ce qu’il y a de plus russe, encensoir monté sur chaînette amovible, dérailleur pour la longueur, comme ça on ne heurte pas le calice à la bénédiction finale. Il me fait la démonstration, il cavale avec son encensoir. Toc ! il passe en première longueur, pfffuit, pffffuit ! il s’imite, se singe. L’encensoir voltige. Toc ! deuxième longueur. Il fait le tour de la chapelle, frôle toutes les aspérités, fait des moulinets furieux et toc ! passe en troisième longueur. Il est lancé sur la grande vitesse, le moindre faux pas et c’est la catastrophe, il n’a pas le droit de s’arrêter, il jubile de jeter son yoyo comme ça, de le faire virevolter, pfffuit, pffffuit ! bzim ! au ras des icônes. Il s’épate lui-même. Il faut reconnaître que comme numéro de jongleur, on ne fait pas mieux. Ses cheveux longs volent, sa barbe s’enroule autour de son cou comme une étole, ses voiles palpitent en cadence, sa robe se soulève, je vois son pantalon percé aux genoux, les rotules à l’air à force de macération. Il me fait pitié. « Amine ! » Il tombe à genoux, rétrograde son extensoir à encens, bzik ! bzik ! maintenant il travaille sur la toute petite vitesse, minuscules cercles, toilette de mouche, chuchus, chichis, pchik, pchik, tournicottis sur place, menu, menu, menu, minus, mimi, zizis mesquins, et tout à coup clac ! sans crier gare il repasse direct en troisième. Toujours à genoux, il promène son encensoir à ras de terre, l’envoie, cloc ! le ramène, cloc ! à l’horizontale. Ah ! c’est un as, un vrai diabolique champion, au millimètre près, poil du cul et zéphir aux couilles. Il joue dans les rayons de soleil. Toc ! il assomme une mouche au vol et toc ! vise le Christ en croix, pfffuit à un millipoil de millipoil et toc ! la Vierge. Bzim ! re-le Christ, pfffuit re-la Vierge, bzim ! Il me regarde en biais, il quête les compliments, le vieux cabot. Ça, il a pris des risques, il faut reconnaître qu’il a de quoi jubiler de sa dextérité, l’immonde baladin hilare avec son infernale trogne. »
La guerre devient plus présente.
« Maintenant, nuit et jour, c’est un flot ininterrompu de forteresses volantes. Elles foncent dans les splendeurs naturelles de l’air vers l’Allemagne, déverser leurs cargaisons, faire leur macabre travail. Des aviateurs recroquevillés dans leurs carlingues vont répandre, oh ! sans haine, les hideux, le feu, la mort et la poix des interminables agonies. Parfois un avion déchiqueté passe au ras des arbres, on voit très distinctement des hommes accrochés à l’épave. Ils ne peuvent pas se résoudre à sauter. Des automitrailleuses sillonnent les routes, partent à travers champs, à la poursuite des aviateurs suspendus à leurs parachutes. Ils ont beau agiter les bras, les mitrailleuses se déchaînent, les hachent menu. Ils peuvent toujours demander grâce les pauvres petits pantins qui ne veulent pas mourir, ils peuvent toujours hurler, supplier sous leurs corolles blanches… tac tac tac ! les uns après les autres ils sont démantelés par la grenaille. On voit peu à peu des morceaux se détacher, tomber sur les pavillons, dans les petits jardins paisibles. Les gens ne savent que faire de tous ces bouts de viande qui dégringolent du ciel. On arrache une main encore tiède de la gueule du chien. On fait des enterrements microscopiques, un doigt ici, un pied là, le voisin une oreille. Parfois on trouve un stylo made in U. S. A. ou bien une montre, en acompte sur l’avenir. Les femmes, pour le bel été, taillent des robes dans les parachutes, d’autres préfèrent cacher les parachutistes eux-mêmes. »
« C’est le fameux bombardement de Bétigny-les-Rateaux qui commence. Par vagues serrés, les forteresses volantes inaugurent le grand lâcher final. Des trains de bombes, torpilles, fusées, rockets, shrapnells, éclats gros comme des navires pleuvent sur les labours. Toute l’astucieuse machinerie à mixer les morts se met en branle. Je m’aplatis entre les choux, je rampe, mon carton à dessin à la remorque. Cloc ! le voilà percé d’un éclat. Toute mon œuvre à ce jour poinçonnée au même moment, curiosité pour la postérité… ha, ha, ha, ha ! ça y est, je me marre. Mes mâchoires claquent. Je meurs de peur et je ris à ne plus pouvoir avancer. J’en pisse de rire. La ferraille pleut autour de moi, grésille dans la rosée limpide. Je quatrepatte, je plaventre, je surledos, avance, nage, pissote, foirotte, tortille, claquedent et galipette dans la boue. Je suis infusoire, flagellé vert, amibe, hydre d’eau douce, H2O, bicarbonate de soude, fumée d’azote. Je coud’enterre, nombril en S, danse du ventre, roulement à billes, serpente, tortillou, nage papillon, vert de peur, de terre, de n’importe quoi dans la gadoue. Et les usines entières se déversent sans relâche. Toutes les merdeuses zones industrielles de Brooklyn à Sing-Sing, les quartiers honteux, échelles de fer, gratte-ciel en morceaux, ponts suspendus sont balancés par-dessus bord sur Bétigny-les-Rateaux. À coups de pied, on nous les expédie du ciel. L’Hudson en tronçons, acier liquide, boulons et contre-écrous se fichent en terre. Tout le trop-plein. Ford, General Motors, se débarrassent des invendus. Voitures entières s’enfoncent dans la glèbe, explosent en plein Millet. Bourrées de nitroglycé, juste ce qu’il faut pour être aussi meurtrières que possible, les Cadillac, pare-brise, en miettes, portières, roues de secours, V8, triples carburateurs à masturbation sphérique, culbuteurs, soupapes et vilebrequins dégringolent avec tous les chevaux de l’Apocalypse dans un rythme, une pulsation syncopée digne du pire Harlem. Disques explosifs, stylos piégés, chewing-gum à retardement spécialement étudiés pour décervelage éclair, machines à laver, machines infernales déguisées en bloc opératoire, frigos incendiaires, vieilles fabriques de chaussures, gares de triage abandonnées avec wagonnets, rails et aérodynamiques locomotives, autoroutes démodées sans parler de tous les cimetières de ferrailles pourries, marteaux-pilons rouillés, fils de fer phosphorescents et volcans liquides, zizis sournois, chichis usinés spécialement pour blessures incurables, déluge barbare exporté en plein angélus. Enfer du ciel ! »
Puis c’est la Libération : il joue un peu au résistant, est arrêté comme collabo ou milicien par la police française (tout le monde n’est d’accord que sur une seule chose, l’exécration des Juifs) : c’est dans le registre grotesque.
Il dessine à Montparnasse, est sujet à des nausées quand il ne rêve pas de sexe : son délire libidinal (et maritime), cauchemar d’enivré, m’a ramentu Henry Miller.
Puis ce sera Lula avec le second volume de ces mémoires contorsionnées.
\Mots-clés : #autobiographie #deuxiemeguerre #enfance #exil #humour #jeunesse #relationenfantparent #sexualité #xxesiecle
- le Jeu 18 Avr - 12:23
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Serge Rezvani
- Réponses: 13
- Vues: 1626
Éric Chevillard
Démolir Nisard
Jean-Marie-Napoléon-Désiré Nisard (1806 - 1888), écrivain et critique littéraire, qu’évoque son contemporain Pierre Larousse dans son Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (la notice dans Wikipédia semble mâtinée de Chevillard…), est l’objet de la haine exterminatrice du narrateur. Nisard paraît avoir été un raisonneur moral, « étroit » et réactionnaire, un arriviste qui réussit sous divers gouvernements, et un piètre plumitif qui entra même à l’Académie française.
« Instruit par l’expérience et las de revenir sans cesse en arrière pour corriger ses erreurs, retirer ses paroles et renier ses malencontreuses initiatives, il se fût abstenu d’agir, de bouger, de parler, il se fût finalement abstenu de vivre, accédant de son vivant aux vœux de la postérité, m’épargnant aujourd’hui la corvée de l’anéantir moi-même, ce qui lui eût valu de ma part une pensée reconnaissante et fugace donnée – à défaut d’en appréhender l’objet aboli – au vent, aux feuilles, à la dépaysante beauté du monde sans Nisard. »
Outre les diatribes les plus rageuses contre cette infection qui pullule encore, l’ouvrage relate la recherche du premier opus de l’auteur (présenté comme grivois, et que Nisard aurait voulu faire disparaître), Le Convoi de la laitière, où icelle meurt d’amour.
« Nisard fait durer l’agonie au-delà de la résistance de la laitière – crémière bientôt à force de tourner de l’œil. Il se régale de ces fromages comme la hyène du festin à venir. […] Enfin, le camembert est dans la boîte ! »
En eût-on douté, la preuve est faite que l’on peut écrire en français (et avec esprit) après Boileau…
\Mots-clés : #humour #universdulivre
- le Jeu 7 Mar - 11:25
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Éric Chevillard
- Réponses: 117
- Vues: 8222
Jorn Riel
Un curé d'enfer et autres racontars
Où on retrouve la même équipe dispersée au Groenland, pour de nouvelles aventures, certes loufoques, mais qui évoquent aussi un monde à la fois dur et attirant.
« Le vertigo polaire pousse lentement, et se construit selon le même schéma dans tous les cas connus. Les problèmes enflent et grossissent et étouffent à la fin leur victime au point qu’elle craque dans la grande crise libératrice du vertigo. Le vertigo en lui-même comporte un nombre abondant de variantes. Certains sont frappés d’une sorte de maladie du sommeil, où l’assoupissement permanent tient lieu de mécanisme protecteur contre les problèmes insolubles. Ceci est une forme assez bénigne que l’on peut observer chez des nourrissons qui ne sont pas à l’aise dans la vie. D’autres deviennent fous au sens le plus littéral du mot. Courent comme des insensés, hurlent comme des renards à la lune, cassent n’importe quoi, tirent sur tout ce qui bouge ; dans le même temps – ceci est commun pour tous – ils jurent, pleurent, rient et chantent des chansons cochonnes. Cette variante-là n’est pas préoccupante, il suffit de la laisser s’épuiser. La crise passe au bout de quelques jours, et celui qui en est la proie tombe dans un état d’épuisement d’où il se réveille avec une légère amnésie, clair et purifié.
Il y a aussi le cas bien connu des marcheurs solitaires. Des candidats au vertigo qui se mettent à marcher vers le sud à la chasse au bonheur, ou des gens qui s’installent dans une yole et commencent à ramer vers l’Islande. Ceux-là sont pénibles parce qu’il faut les suivre et les surveiller. À cette liste on peut ajouter une irrépressible envie de bisous-de-nègre, des exterminations intempestives de lièvres à trois pattes ainsi que de tenaces fantasmes féminins. »
« Parce que ni l’esprit missionnaire ni la Mission intérieure n’étaient plus ce qu’ils avaient été avant l’avènement de ce siècle. Des vents adoucissants avaient, avec le nouveau siècle, soufflé sur le mouvement de réveil religieux, et ce qui auparavant avait été si empreint d’un zèle répressif de toute joie était en train de se doter d’un visage plus positif et tolérant. Pour la direction supérieure, des fanatiques comme Pollesøn étaient donc devenus de vraies patates brûlantes. D’un côté, on ne pouvait pas sous-estimer ses mérites au Groenland, d’un autre côté, il ne fallait en aucun cas compromettre l’image en cours d’édification. »
\Mots-clés : #aventure #humour #nouvelle
- le Dim 21 Jan - 11:10
- Rechercher dans: Écrivains de Scandinavie
- Sujet: Jorn Riel
- Réponses: 51
- Vues: 7143
Amos Tutuola
L'ivrogne dans la brousse
Le malafoutier (récolteur de vin de palme, qui incise le haut du palmier pour recueillir la sève) de Père-Des-Dieux-Qui-Peut-Tout-Faire-En-Ce-Monde, le narrateur, est mort dans une chute, et son employeur part à sa recherche, car il a besoin de ses services. Il voyage dans la brousse, de villes en villages, et nous raconte les péripéties de ses pérégrinations. Dans ce conte, il capture la Mort au filet, trouve femme en la sauvant du « gentleman complet » (un crâne qui emprunte des membres pour aller au marché dans un beau corps), etc., dans un monde rempli d’esprits et de métamorphoses, chez les « êtres étranges ».
« Ces êtres mystérieux ne font rien comme les autres, par exemple, comme nous l’avons vu, si quelqu’un d’entre eux veut grimper à un arbre, il commence d’abord par grimper à l’échelle avant de la poser contre cet arbre ; mieux, il y a un terrain plat à côté de leur ville, mais ils ont construit leurs maisons sur les pentes d’une colline abrupte, alors toutes les maisons penchent de côté comme si elles allaient tomber, et leurs enfants dégringolent tout le temps des maisons, mais les parents ne s’en soucient pas autrement ; aucun d’entre eux ne se lave jamais, mais ils lavent leurs animaux domestiques ; eux-mêmes, ils s’habillent de feuilles, mais ils ont des vêtements somptueux pour leurs animaux domestiques, et ils leur coupent les ongles, mais leurs ongles à eux, ils les coupent une fois tous les cent ans, et même nous en voyons beaucoup qui couchent sur le toit de leurs maisons, et ils disent qu’ils ne peuvent utiliser les maisons qu’ils ont construites de leurs mains autrement qu’en dormant dessus. »
L’humour est omniprésent (lui et sa femme font « personnellement connaissance de Rire »), et le héros féticheur père des dieux est souvent dans de mauvaises postures pleines d’autodérision. Ce comique bon-enfant contribue à l’aspect à la fois onirique et familier du récit (la traduction de Raymond Queneau y est peut-être aussi pour quelque chose).
« Ainsi nous pouvons aller à travers cette forêt aussi loin que nous le pouvons. »
« Après ça, je me mets à lui ouvrir l’estomac avec mon couteau, puis nous sortons de son estomac avec nos bagages, etc. Et voilà comment nous avons été délivrés de l’Affamé, mais je ne pourrais le décrire complètement ici, parce qu’il était quatre heures du matin et, à cette heure-là, on n’y voit pas très clair. Bref, nous le quittons sains et saufs et nous en remercions Dieu. »
C’est aussi une sorte de chronique traditionnelle du passé (légendaire),
« Il y avait toutes sortes de créatures étonnantes dans le vieux temps. »
… une épopée qui rappellerait l’Odyssée et les travaux d’Hercule, mais aussi Rabelais (notamment le Quart Livre), tout un imaginaire collectif (peut-être à rattacher à l’analogisme selon Descola, et/ou à notre Moyen Âge), sans que je connaisse la part d’inspiration de notre culture dans ce livre.
« Tout nous avait bien plu dans cette Île-Spectre et nous nous y trouvions très bien, mais il nous restait encore bien des travaux à accomplir. »
L’aspect enseignement allégorique de la fable n’est pas absent (les amis qui se détournent quand il n’a plus rien à offrir), ni celui du mythe initiatique et sacrificiel (cf. l’histoire des « Rouges »). Sans vouloir évoquer des allusions ésotériques, il est certain que nombre de références yoruba doivent nous échapper (qu’en est-il ainsi de « marcher à reculons », qui est récurrent ?).
« Trois êtres bienveillants nous délivrent de nos ennuis. Ce sont : tambour, chant et danse »
J’ai eu le grand plaisir de retrouver la verve populaire truculente caractéristique de l’Afrique centrale et occidentale, trop absente de ses romans.
« D’abord, avant d’entrer dans l’arbre blanc, nous « vendons notre mort » à quelqu’un qui se trouvait à la porte, pour le prix de 7 925 francs, et nous « louons notre peur » à quelqu’un qui se trouvait aussi à la porte avec un intérêt de 3 500 F par mois, comme ça nous n’avions plus à nous soucier de la mort et nous n’avions plus désormais peur de rien. »
On retrouve les éléments typiques de ces sociétés : palabres, gris-gris, famine. Autre particularité distinctive, la familiarité avec la mort, qui n’est pas une fin :
« Alors il nous demande si, en arrivant là, nous étions encore vivants ou morts. Nous lui répondons que nous étions toujours vivants et que nous n’étions pas des morts. »
« Moi-même, je savais bien que les morts ne peuvent vivre avec les vivants, j’avais observé leurs façons et elles ne correspondaient pas du tout aux nôtres. »
Cela m’a ramentu Juan Rulfo, et il me semble qu’il y a une vision proche du réalisme magique chez Tutuola.
Les tribulations du couple en route vers « la mystérieuse Ville-des-Morts » où se trouve le malafoutier donnent lieu à des séjours prolongés dans certains lieux, et encore plus de rencontres étonnantes, comme « le Valet-Invisible ou Donnant-Donnant », « chef de tous les êtres de la Brousse ».
La légèreté de ton est marquante, comme avec ce fardeau qui se révèlera être ce qu’il paraît :
« En le mettant sur ma tête, je trouve que c’était exactement comme le cadavre d’un homme, il était très lourd, mais je pouvais le porter facilement. »
Voilà qui donne grande envie d’en connaître plus sur cette culture que je n’ai pu qu’effleurer.
« Et ainsi toutes nos épreuves, tous nos ennuis et de nombreuses années de voyage n’avaient rapporté qu’un œuf, c’est-à-dire aboutissaient à un œuf. »
\Mots-clés : #aventure #contemythe #fantastique #humour #mort #voyage
- le Lun 22 Mai - 12:19
- Rechercher dans: Écrivains d'Afrique et de l'Océan Indien
- Sujet: Amos Tutuola
- Réponses: 9
- Vues: 500
Luis Sepulveda
Le neveu d'Amérique
Recueil de quelques notes de Luis Sepúlveda, avec en entrée la formation par le grand-père à Santiago :
« Le gag consistant à me remplir de limonade pour ensuite me faire pisser à la porte des églises, nous l’avions maintes fois répété depuis que j’avais commencé à marcher et le vieux avait fait de moi son compagnon d’aventures, le petit complice de ses mauvais coups d’anarchiste à la retraite. »
Voilà qui suggère quelques activités récréatives pour égayer les proches retrouvailles avec mes petits-fils.
Suit une évocation de son « voyage à nulle part », de l’activisme communiste à la prison avec tortures, évocation sinistre rendue bouffonne par un humour détaché, quasiment gracieux.
« Un voyage d’aller », c’est d’abord l’errance dans la peur, c'est-à-dire l’Amérique du Sud des années soixante-dix, et deux péripéties romanesques en Équateur, soient autant de récits qui valent par l’art du conteur que par les personnages rencontrés.
« Un voyage de retour », c’est Chiloé, « l’antichambre de la Patagonie », où Luis rentre au pays, enfin autorisé à le faire par les autorités chiliennes. Il devait voyager avec Bruce Chatwin (mort entretemps, voir son fil), sur les traces de Butch Cassidy et Sundance Kid. Vin et agneau toujours au menu, mais surtout des histoires incroyables, comme les concours de mensonges et son ami Carlos l’aviateur.
L’adelantado Arias Pardo Maldonado aurait exploré la Patagonie :
« “Les habitants de Trapananda sont grands, monstrueux et velus. Leurs pieds sont aussi longs et démesurés que leur démarche est lente et maladroite, ce qui fait d’eux une cible facile pour les arquebusiers.
“Les gens de Trapananda ont les oreilles si grandes qu’ils n’ont pas besoin pour dormir de couvertures ou de vêtements protecteurs, car ils se couvrent le corps avec leurs oreilles.
“Les gens de Trapananda dégagent une telle puanteur et pestilence qu’ils ne se supportent pas entre eux, de sorte qu’ils ne s’approchent, ne s’accouplent ni n’ont de descendance.” »
« Avec lui naît la littérature fantastique du continent américain, notre imagination débridée, et cela suffit pour lui accorder une légitimité historique. »
« L’arrivée », c’est Martos en Andalousie, pays d’origine de son grand-père, où il retrouve le frère cadet de ce dernier.
« on est d’où on se sent le mieux »
Ces notes sont vraisemblablement extraites d’un carnet offert par Chatwin :
« Je me rappelle cela tandis que j’attends, assis sur une barrique de vin, face à la mer, au bout du monde, et je prends des notes sur un carnet aux pages quadrillées que Bruce m’a offert précisément pour ce voyage. Il ne s’agit pas d’un carnet ordinaire. C’est une pièce de musée, un de ces authentiques carnets de moleskine si appréciés par des écrivains comme Céline ou Hemingway, et à présent introuvables dans les papeteries. »
Luis Sepúlveda a le don de ne faire qu’effleurer, notamment la terreur dictatoriale, et à cet aspect élusif, elliptique, tient beaucoup de son pouvoir de faire rêver.
\Mots-clés : #amitié #autobiographie #exil #humour #regimeautoritaire #voyage
- le Sam 20 Mai - 13:02
- Rechercher dans: Écrivains d'Amérique Centrale, du Sud et des Caraïbes
- Sujet: Luis Sepulveda
- Réponses: 23
- Vues: 2820
Romain Gary
Le Grand Vestiaire
Le narrateur, Luc Martin, quatorze ans au sortir de la Deuxième Guerre et à la mort de son père, devient pupille de la nation. Mais très vite il est recueilli par le vieux Vanderputte, un des nombreux escrocs dans le chaos de la Libération, et volontiers métaphysicien...
« Il rejeta sa casquette en arrière, remua rapidement sa moustache, et braqua sur moi son ongle sale, tout en regardant soigneusement de côté.
– Apprenez cela, jeune homme, dès aujourd'hui : dans la vie, il s'agit de ne pas être là au bon moment, voilà tout. Il faut se faufiler adroitement entre les années, le ventre rentré et sans faire de silhouette, pour ne pas se faire pincer. Voilà ce que c'est, la vie. Pour cela, naturellement, il faut être seul. Ab-so-lu-ment ! La vie, c'est comme l'assassinat, il ne faut pas avoir de complice. Ne jamais se laisser surprendre en flagrant délit de vie. Vous ne le croirez peut-être pas, jeune homme, mais il y a des millions de gens qui y arrivent. Ils passent inaperçus, mais à un point... ini-ma-gi-nable ! C'est simple : à eux, la destinée ne s'applique pas. Ils passent au travers. La condition humaine – vous connaissez cette expression ? – eh bien, elle coule sur eux, comme une eau un peu tiède. Elle ne les mouille même pas. Ils meurent de vieillesse, de décrépitude générale, dans leur sommeil, triomphalement. Ils ont roulé tout le monde. Ils ne se sont pas fait repérer. Pro-di-gieux ! C'est du grand art. Ne pas se faire repérer, jeune homme, apprenez cela dès ce soir. Rentrer la tête dans les épaules, écouter s'il pleut, avant de mettre le nez dehors. Se retourner trois fois, écouter si l'on ne marche pas derrière vous, se faire petit, petit, mais petit ! Être, dans le plein sens du terme, homme et poussière. Jeune homme, je suis persuadé qu'en faisant vraiment très attention, la mort elle-même ne vous remarque pas. Elle passe à côté. Elle vous loupe. C'est dur à repérer, un homme, lorsque ça se planque bien. On peut vivre très vieux et jouir de tout, naturellement, en cachette. La vie, jeune homme, apprenez-le dès maintenant, c'est uniquement une question de camouflage. Réalisez bien ceci et tous les espoirs vous sont permis. Pour commencer, tenez, un beau vieillard, c'est toujours quelqu'un qui a su éviter la jeunesse. C'est très dangereux ça, la jeunesse. Horriblement dangereux. Il est très difficile de l'éviter, mais on y arrive. Moi, par exemple, tel que vous me voyez, j'y suis arrivé. Avez-vous jamais réfléchi, jeune homme, au trésor de prudence et de circonspection qu'il faut dépenser pour durer, mettons, cinquante ans ? Moi, j'en ai soixante... Co-los-sal ! »
Venu du maquis du Véziers à Paris avec Roxane la chienne de son père instituteur tué dans la Résistance (et son « petit volume relié des Pensées de Pascal » qui lui reste hermétique), Luc le rat des champs se sent perdu parmi les rats des villes.
« Mon père aimait à me plonger ainsi dans une atmosphère de mystère et de conte de fées ; je me demande, aujourd'hui, si ce n'était pas pour brouiller les pistes, pour atténuer les contours des choses et adoucir les lumières trop crues, m'habituant ainsi à ne pas m'arrêter à la réalité et à chercher au-delà d'elle un mystère à la fois plus significatif et plus général. »
Intéressante vision du cinéma et de son influence :
« La beauté des femmes, la force des hommes, la violence de l'action [… »
« Je cherchais alors à bâtir toute ma personnalité autour d'une cigarette bien serrée entre les lèvres, ce qui me permettait de fermer à demi un œil et d'avancer un peu la lèvre inférieure dans une moue qui était censée donner à mon visage une expression extrêmement virile, derrière laquelle pouvait se cacher et passer inaperçue la petite bête inquiète et traquée que j'étais. »
Avec Léonce (et comme beaucoup de gosses), ils rêvent d’être adultes, d’aller en Amérique, de devenir gangsters et riches. Il est amoureux de Josette, la sœur de Léonce, mais fort embarrassé.
« – Quelquefois, ça se guérit, me consolait-elle. Il y a des médecins qui font ça, en Amérique. On te colle la glande d'un singe et du coup, tu deviens sentimental. »
Vanderputte, un destin misérable :
« Je posais pour un fabricant de cartes postales. Sujets de famille, uniquement. J'ai jamais voulu me faire photographier pour des cochonneries. On pouvait me mettre dans toutes les mains. »
« Cet amour instinctif qu'il avait pour les objets déchus, cette espèce de sollicitude fraternelle dont il les entourait, avaient je ne sais quoi de poignant et c'est lorsque je le vis pour la première fois s'arrêter dans la rue, ramasser un peigne édenté et le glisser dans sa poche, que je me rendis compte à quel point ce vieil homme était seul. Les antiquités, les beaux objets de valeur finement travaillés ne l'intéressaient pas : il ne s'attachait qu'aux épaves. Elles s'accumulaient dans sa chambre et la transformaient en une immense boîte à ordures, une sorte de maison de retraite pour vieilles fioles et vieux clous. »
Avec son ami l’Alsacien Kuhl (son antithèse, épris d’ordre et de propreté ; employé à la préfecture de police, il reçoit mensuellement une enveloppe de Vanderputte), les deux cultivent un humanisme sentimental, convaincus de la décadence civilisationnelle.
Galerie de portraits hauts en couleur, tel Sacha Darlington « grand acteur du muet » et travesti vivant reclus dans un bordel, ou M. Jourdain :
« Le fripier, un M. Jourdain, était un bonhomme âgé ; il portait sa belle tête de penseur barbu, une calotte de velours noir extrêmement sale ; il était l'éditeur, le rédacteur en chef et l'unique collaborateur d'une publication anarchiste violemment anticléricale, Le Jugement dernier, qu'il distribuait gratuitement tous les dimanches à la sortie des églises et qu'il envoyait régulièrement, depuis trente-cinq ans, au curé de Notre-Dame, avec lequel il était devenu ami. Il nous accueillit avec une mine sombre, se plaignit du manque de charbon – on était en juin – et à la question de Vanderputte, qui s'enquérait de l'état de ses organes, il se plaignit amèrement de la vessie, de la prostate et de l'Assemblée nationale, dont il décrivit le mauvais fonctionnement et le rôle néfaste en des termes profondément sentis. »
Vanderputte tombe fréquemment amoureux d’un vêtement miteux, tel celui d’un Gestard-Feluche, fonctionnaire médaillé, qui ira augmenter le grand vestiaire de sa chambre.
Dans une France en pleine pagaille (et dans la crainte du communisme, de la bombe atomique), Léonce et Luc passent du trafic de « médicaments patentés » au vol de voitures, et envisagent un gros coup.
Josette meurt de la tuberculose, et Luc s’interroge toujours sur la société.
« Où étaient-ils donc, ces fameux hommes, dont mon père m'avait parlé, dont tout le monde parlait tant ? Parfois, je quittais mon fauteuil, je m'approchais de la fenêtre et je les regardais. Ils marchaient sur les trottoirs, achetaient des journaux, prenaient l'autobus, petites solitudes ambulantes qui se saluent et s'évitent, petites îles désertes qui ne croient pas aux continents, mon père m'avait menti, les hommes n'existaient pas et ce que je voyais ainsi dans la rue, c'était seulement leur vestiaire, des dépouilles, des défroques – le monde était un immense Gestard-Feluche aux manches vides, d'où aucune main fraternelle ne se tendait vers moi. La rue était pleine de vestons et de pantalons, de chapeaux et de souliers, un immense vestiaire abandonné qui essaye de tromper le monde, de se parer d'un nom, d'une adresse, d'une idée. J'avais beau appuyer mon front brûlant contre la vitre, chercher ceux pour qui mon père était mort, je ne voyais que le vestiaire dérisoire et les milles visages qui imitaient, en la calomniant, la figure humaine. Le sang de mon père se réveillait en moi et battait à mes tempes, il me poussait à chercher un sens à mon aventure et personne n'était là pour me dire que l'on ne peut demander à la vie son sens, mais seulement lui en prêter un, que le vide autour de nous n'est que refus de combler et que toute la grandeur de notre aventure est dans cette vie qui vient vers nous les mains vides, mais qui peut nous quitter enrichie et transfigurée. J'étais un raton, un pauvre raton tapi dans le trou d'une époque rétrécie aux limites des sens et personne n'était là pour lever le couvercle et me libérer, en me disant simplement ceci : que la seule tragédie de l'homme n'est pas qu'il souffre et meurt, mais qu'il se donne sa propre souffrance et sa propre mort pour limites... »
Les « ratons » (vaut tantôt pour petits rats, tantôt pour Nord-Africains) entrent dans le monde des « dudules » (vaut apparemment plus pour adultes, individus, que pour idiots) : le « gang des adolescents » devient célèbre pour ses braquages de transports de fonds. Léonce est tué ; Luc se retrouve dans la peau de Vanderputte, qu‘il craint de devenir cinquante ans plus tard. Ce dernier est poursuivi : entré dans la Résistance et arrêté par les Allemands, il avait très vite collaboré et dénoncé, principalement des juifs. Luc s’enfuit avec lui, pris par la pitié, mais…
\Mots-clés : #corruption #criminalite #deuxiemeguerre #enfance #humour #initiatique #jeunesse #portrait #vieillesse #xxesiecle
- le Ven 10 Mar - 11:56
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Romain Gary
- Réponses: 118
- Vues: 11058
Vladimir Nabokov
Brisure à senestre
Adam Krug est au chevet de sa femme Olga, morte à l’hôpital ; il rentre chez lui où l’attend David, leur fils de huit ans, après un épisode kafkaïen de contrôles d’identité sur un pont.
« Krug marchait vite, son laissez-passer à la main. Qu’arriverait-il si je le jetais dans le Kur ? Je serais condamné au va-et-vient sur un pont qui aurait cessé d’assurer sa fonction puisque les berges seraient inaccessibles... ce ne serait plus un pont mais un sablier, retourné d’un côté puis de l’autre, et moi je serais le sable fin et fluide à l’intérieur. Ou ce brin d’herbe que l’on cueille avec dessus une fourmi qui grimpe. Elle arrive en haut. On retourne le brin. Le haut devient le bas et la pauvre bête recommence son exploit... » (II)
Il est un professeur d’université renommé (également à l’étranger), philosophe, et camarade de classe du dictateur qui a pris le pouvoir, Paduk, surnommé « Crapaud », qui le dégoûtait déjà et dont il refuse de soutenir le régime. Celui-ci rappelle l’absurde et grotesque totalitarisme soviétique (et le nazisme), ignorance et idiotie basées sur une théorie pseudoscientifique (ici « l’ekwilisme »), haine de l’individu et instauration de l’uniformisation (« le parti de l’Homme ordinaire ») dans une mise en scène allégorique, parodique (un « dialecte » particulier remémore la novlangue).
L’auteur transparaît souvent (est-ce Krug ?), comme dans ces saillies :
« Tout le monde peut créer le futur, mais il faut un sage pour créer le passé. » (II)
« Quand les jeunes veulent s’accrocher à la tradition, ils le font avec la même passion que des hommes plus mûrs qui s’efforcent de l’enterrer. » (IV)
« Il nous est assurément possible de repérer des événements du passé susceptibles d’être mis en parallèle avec ce qui se produit actuellement : une idée boule de neige que roulent et roulent des mains rougies d’écoliers et qui grossit, grossit, jusqu’à devenir bonhomme de neige, le chapeau cabossé de guingois, le manche à balai négligemment glissé sous l’aisselle... et soudain les yeux de cette caricature d’homme se mettent à cligner, la neige se fait chair, le manche à balai se change en arme, un tyran se dresse qui fait rouler au sol la tête des enfants. » (IV)
« Il est vrai que l’esprit simple éprouve une fascination devant des moyens mécaniques destinés à imiter la nature. » (V)
Superbe scène chapitre VI de « reconstruction » du passé récent :
« En théorie, il n’existe aucune preuve définitive que se réveiller le matin (se retrouver le matin en selle, avec en main les rênes de sa propre personnalité) ne soit pas – au sens propre – un événement sans précédent, une naissance véritablement originelle. […]
On pourrait appliquer le même raisonnement à sa propre existence telle qu’on la perçoit au réveil de façon rétrospective. Cette impression même relève d’une illusion assez élémentaire, comparable à ces impressions d’éloignement, de profondeur, qu’un pinceau trace sur une surface plane. Mais un pinceau ne suffit pas à recréer ce sentiment d’une réalité dense enracinée dans un passé plausible, le sentiment d’une continuité logique, la certitude de reprendre le cours de son existence à l’endroit même où elle s’était interrompue. La complexité de cette opération n’est rien de moins que merveilleuse si l’on considère le nombre de détails à prendre en compte et à disposer de telle sorte qu’ils suggèrent l’intervention de la mémoire. » (VI)
Les arrestations arbitraires de ses relations se succèdent ; sourd aux avertissements de ses amis et refusant l’exil, Krug rencontre le tyran, qui lui propose d’être le nouveau président de l’université, à sa botte. Il sera arrêté, et son fils, moyen de pression, sera livré par erreur à des brutes. On lui propose d’abord de massacrer les « négligents » responsables, puis de gracier ses amis emprisonnés, mais Krug, qui n’a pas pris à temps le chemin de l’exil, devient fou par grâce de l’auteur… Sinistre farce, « tragédie des cabinets » (en français dans le texte), la comédie s’achève comme les personnages retombent en enfance dans leur école.
Bonheur de lecture avec ces images picturales comme « la joue fardée d’un fromage » (III) ; c’est bourré d’indices facétieux (dont des références à Joyce, Kafka, Baudelaire, Shakespeare, Mallarmé, etc.), de rêves rien moins que psychanalytiques, de renvois au jeu d’échecs, de spécimens entomologiques… La jeune Mariette semble préfigurer Lolita.
« Du furoncle de son visage aux oignons de ses pieds Paduk était uniformément vêtu de gris, les mains derrière le dos et ce dos tourné face au lecteur. » (XI)
« Est-ce que tout le monde éprouve cela ? Un visage, une expression, un paysage, une bulle d’air venue du passé qui flotte et s’élève, comme si elle avait été libérée par l’enfant du geôlier en chef, elle qui était enfermée dans une cellule du cerveau, tandis que l’esprit s’absorbe dans d’autres tâches ? Un phénomène comparable peut ainsi se produire au seuil du sommeil, ce moment où ce que l’on pense n’est pas du tout ce que l’on croit penser. Ou encore deux trains parallèles, l’un et l’autre emportant leurs pensées voyageuses, puis l’un dépassant l’autre. » (XV)
« Un nouveau et amusant décret exigeait de quiconque voulait voyager à bord d’un autobus non seulement de présenter son passeport, mais encore de donner au receveur une photographie numérotée et signée. La vérification de la signature, du numéro, de la ressemblance n’était pas une mince affaire. Un additif au décret précisait qu’au cas où le voyageur n’aurait pas l’appoint (17 cents par kilomètre et demi) le trop-perçu lui serait remboursé dans un lointain bureau de poste, à condition qu’il y fasse la queue dans un délai de trente-six heures après avoir quitté l’autobus. Il en résultait donc des retards supplémentaires dans la mesure où le receveur d’autobus, harassé, devait éventuellement établir et tamponner les papiers nécessaires. Enfin, le conducteur n’avait le droit de s’arrêter que si trois voyageurs au moins voulaient descendre, ce qui, en plus du retard, provoquait beaucoup de confusion. Malgré toutes ces mesures, les bus étaient affreusement bondés ces temps-ci. » (XV)
« La perspective de s’évader de Padukgrad et de gagner un pays étranger lui paraissait une sorte de retour au passé, ce passé où sa patrie avait été elle aussi un pays libre. À supposer que l’espace et le temps ne fissent qu’un, l’évasion et le retour devenaient interchangeables. » (XV)
Nabokov dénonce la liberté opprimée, et une société où le collectif prend le pas sur l’individu.
« Une personne qui n’a jamais appartenu à une loge maçonnique ou à une fraternité, à un club, à un syndicat ou chose d’analogue est anormale et dangereuse. Bien entendu, certaines de ces associations étaient mauvaises et sont, en conséquence, interdites aujourd’hui. Mais pour un homme il est cependant préférable d’avoir été membre d’une organisation aux orientations politiques erronées plutôt que de n’avoir appartenu à aucune. » (XIII)
« Prises individuellement, les vies sont fragiles, mais nous garantissons l’immortalité de l’État. Les citoyens meurent pour que vive la cité. » (XVIII)
En fait, je crois que surtout que Nabokov s'amuse beaucoup !
Il y a bien d'autres dimensions dans ce roman (incursion de l'auteur dans l'œuvre, place de son expérience personnelle dans celle-ci, etc.) ; sa lecture ramentoit également toute une part importante de la littérature d'Europe centrale et de l'Est (on pense à Boulgakov, etc.). Nabokov jette aussi quelques lueurs originales dans les profondeurs.
« Je pouvais également apercevoir une flaque particulière – celle que Krug avait en quelque sorte aperçue à travers les strates de sa propre vie –, une flaque oblongue qui prenait toujours la même forme après une averse par suite d’une dépression spatulée dans le sol. Il se produit peut-être quelque chose de semblable dans le cas de l’empreinte que nous laissons dans la texture intime de l’espace. » (XVIII)
\Mots-clés : #humour #regimeautoritaire
- le Jeu 12 Jan - 13:23
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Vladimir Nabokov
- Réponses: 46
- Vues: 5055
Roland Topor

Mémoires d'un vieux con
Je suis attirée -révulsée par les dessins de Topor depuis longtemps, il est fascinant.
Je le sens sombre et pourtant solaire. C'est compliqué pour quelqu'un comme moi qui suis très premier degré dans mes constructions mentales.
Rencontré notamment dans la très belle édition des oeuvres de Marcel Aymé.
Bref : un jour je vais chez mon libraire, et comme on s'achette une robe je veux m'acheter un livre. Cette librairie est petite, rien ne me tente. Je suis trop dans la pulsion d'achat. D'ailleurs je n'arrive pas à lire depuis des semaines, trop fatiguée, trop occupée.
Je tombe sur ce livre fin. Allez je prends.
Lu en 15 fois avant de dormir, au compte goutte, 10 mn avant de ronquer comme une bienheureuse : j'ai adoré.
Ce qui est génial c'est que j'ai plongé dedans "franco", en me demandant même, au bout de deux soirs de lecture brève mais gourmande si c etait vrai ou pas : delicieuse naiveté qui prouve comme il sait manier les codes du genre biographique. C'est assez évident que c'est un faux, même sans connaitre l'auteur, et à la fois c'est si foutraquement tripé qu'on a envie d'y croire.
J'ai beaucoup ri. Ce qui n'est pas fréquent pour moi. J'ai le second degré lent. Délicieux.La tournure des phrases est plus vraie que nature. Il épouse les temps de la biographie avec un appétit de surenchère joyeuse et c'est libérateur d'inhibition. Cela fait un sort à la notion de bonne foi.
\Mots-clés : #autobiographie #humour
- le Ven 11 Nov - 12:24
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Roland Topor
- Réponses: 6
- Vues: 903
Umberto Eco
Construire l’ennemi et autres textes occasionnels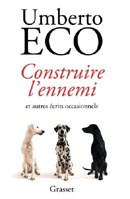
Dans Construire l’ennemi, Eco documente la stigmatisation de l’étranger, du laid, du juif, de l’hérétique, de la femme (notamment sorcière), du lépreux à travers les temps, en produisant nombre d’extraits édifiants (sans omettre les auteurs religieux).
« Il semble qu’il soit impossible de se passer de l’ennemi. La figure de l’ennemi ne peut être abolie par les procès de civilisation. Le besoin est inné même chez l’homme doux et ami de la paix. Simplement, dans ces cas, on déplace l’image de l’ennemi, d’un objet humain à une force naturelle ou sociale qui, peu ou prou, nous menace et doit être combattue, que ce soit l’exploitation du capitalisme, la faim dans le monde ou la pollution environnementale. Mais, même si ce sont là des cas « vertueux », Brecht nous rappelle que la haine de l’injustice déforme elle aussi le visage. »
« Essayer de comprendre l’autre, signifie détruire son cliché, sans nier ou effacer son altérité. »
Mention particulière à La paix indésirable ? Rapport sur l’utilité des guerres, effarante justification états-unienne (et orwellienne) de la nécessité de l’ennemi, notamment pour des raisons économiques (anonyme, préfacé par J. K. Galbraith).
Absolu et relatif nous entraîne dans un débat philosophique qui revient rapidement au problème de notre conception de la vérité (atteignable ou pas).
La flamme est belle est une réflexion sur le feu, qui n’oublie pas Bachelard, entr’autres.
« Les amis pleins de sollicitude brûlent, pour des raisons de moralité et de santé mentale, la bibliothèque romanesque de Don Quichotte. On brûle la bibliothèque d’Auto da fé d’Elias Canetti, en un bûcher qui rappelle le sacrifice d’Empédocle (« quand les flammes l’atteignent enfin, il rit à pleine voix comme il n’avait jamais ri de sa vie »). »
Délices fermentées est consacré à Piero Camporesi, auteur de L’Officine des sens et « gourmet de listes ».
« Hugo, hélas ! » La poétique de l’excès :
« Le goût de l’excès le conduit à décrire en procédant par énumérations interminables [… »
« La beauté n’a qu’un type, la laideur en a mille. »
Cela m’a ramentu cette phrase (souvenir scolaire – on a beau dire du mal de l’école…) :
« Si le poète doit choisir dans les choses (et il le doit), ce n’est pas le beau, mais le caractéristique. »
Astronomies imaginaires (mais pas astrologie, croyance ou tromperie).
Je suis Edmond Dantès ! sur le roman-feuilleton, et « l’agnition ou reconnaissance » (d’un lien de parenté entre personnages) ; le texte commence ainsi :
« Certains infortunés se sont initiés à la lecture en lisant, par exemple, du Robbe-Grillet. Illisible si l’on n’a pas compris les structures ancestrales de la narration, qu’il détourne. Pour savourer les inventions et déformations lexicales de Gadda, il faut connaître les règles de la langue italienne et s’être familiarisé au bon toscan avec Pinocchio. »
Il ne manquait plus qu’Ulysse. Époustouflant patchwork de critiques du livre de Joyce, où la bêtise le dispute à l’antisémitisme.
Pourquoi l’île n’est jamais trouvée. Incipit :
« Les pays de l’Utopie se trouvent (à de rares exceptions près, comme le royaume du Prêtre Jean) sur une île. »
Texte passionnant sur l’histoire de la (non-)découverte d’îles plus ou moins fabuleuses.
« C’est parce que, jusqu’au XVIIIe siècle, date à laquelle on a pu déterminer les longitudes, on pouvait découvrir une île par hasard et, à l’instar d’Ulysse, on pouvait même s’en échapper mais il était impossible de la retrouver. »
C’est l’argument de L’Île du jour d’avant, mais on découvre aussi l’« Ile Perdue, Insula Perdita », île des Bienheureux de saint Brendan, et même un décryptage de La Ballade de la mer salée d’Hugo Pratt.
Réflexions sur WikiLeaks
« Sur le plan des contenus, WikiLeaks s’est révélé être un scandale apparent, alors que sur le plan de la forme, il a été et sera quelque chose de plus, il a inauguré une nouvelle époque historique.
Un scandale est apparent quand il rend publique une chose que tout le monde savait en privé, et dont on parlait à mi-voix par pure hypocrisie (cf. les ragots sur un adultère). »
« Et cela ne fait que confirmer une autre chose que l’on sait pertinemment : chaque dossier élaboré pour un service secret (de quelque nation que ce soit) est constitué exclusivement de matériel qui est déjà dans le domaine public. Par exemple : dans une librairie consacrée à l’ésotérisme, on s’aperçoit que chaque nouvel ouvrage redit (sur le Graal, le mystère de Rennes-le-Château, les Templiers ou les Rose-Croix) exactement ce qui figurait dans les livres précédents. Et ce n’est pas que l’auteur de textes occultistes s’interdise de faire des recherches inédites (ou ignore comment chercher des informations sur l’inexistant), mais parce que les occultistes ne croient qu’à ce qu’ils savent déjà, et qui reconfirme ce qu’ils avaient déjà appris. C’est d’ailleurs là le mécanisme du succès de Dan Brown.
Idem pour les dossiers secrets. L’informateur est paresseux tout comme est paresseux, ou d’esprit limité, le chef des services secrets, qui ne croit que ce qu’il reconnaît.
Par conséquent, puisque, dans tous les pays, les services secrets ne servent pas à prévoir des cas comme l’attaque des Twins Towers et qu’ils n’archivent que ce qui est déjà connu de tous, il vaudrait mieux les éliminer. Mais, par les temps qui courent, supprimer encore des emplois serait vraiment insensé.
Si les États continuent à confier leurs communications et leurs archives confidentielles à Internet ou d’autres formes de mémoire électronique, aucun gouvernement au monde ne pourra plus nourrir des zones de secret, et pas seulement les États-Unis, mais même pas la République de Saint-Marin ou la principauté de Monaco (peut-être que seule Andorre sera épargnée). »
« Et même si la grande masse des citoyens n’est pas en mesure d’examiner et d’évaluer la quantité de matériel que le hacker capture et diffuse, la presse joue désormais un nouveau rôle (elle a déjà commencé à l’interpréter) : au lieu de relayer les nouvelles vraiment importantes – jadis, c’étaient les gouvernements qui décidaient des nouvelles vraiment importantes, en déclarant une guerre, en dévaluant une monnaie, en signant une alliance –, aujourd’hui c’est elle qui décide en toute autonomie des nouvelles qui doivent devenir importantes et de celles qui peuvent être passées sous silence, allant jusqu’à pactiser (cela est arrivé) avec le pouvoir politique pour savoir quels « secrets » dévoilés il convenait de révéler et ceux qu’il fallait taire.
Puisque tous les rapports secrets qui alimentent haines et amitiés d’un gouvernement proviennent d’articles publiés ou de confidences de journalistes à un attaché d’ambassade, la presse prend une autre fonction : jadis, elle épiait le monde des ambassades étrangères pour en connaître les trames occultes, désormais ce sont les ambassades qui épient la presse pour y apprendre des manifestations connues de tous. »
Tout le bref texte devrait être cité !
Et c’est toujours aussi délectable de se régaler de l’esprit d’Umberto Eco…
\Mots-clés : #complotisme #contemporain #discrimination #ecriture #espionnage #essai #guerre #humour #medias #philosophique #politique #social #universdulivre #xxesiecle
- le Lun 24 Oct - 13:57
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Umberto Eco
- Réponses: 69
- Vues: 9341
Kurt Vonnegut, jr
Le Petit Déjeuner des Champions
Je lis cette traduction par Gwilym Tonnerre pour Gallmeister en 2014 après (il y a longtemps) celle de Guy Durand en 1974 pour le Seuil sous le titre Le Breakfast du Champion (je n'ai pas remarqué de grandes différences en comparant succinctement les deux traductions).
D’entrée, le livre (première publication en 1973) déplore que les Terriens aient détruit, épuisé leur planète… Un demi-siècle de lente prise de conscience d’une évidence… Mais ce n’est pas le seul travers (plus particulièrement des États-Unis) à y être ridiculisé, il y a aussi la fascination pour l’argent et le sexe, sans oublier le racisme et la guerre, la publicité et la religion ; le propos de Kurt Vonnegut est de mettre en évidence ce dysfonctionnement civilisationnel.
Kilgore Trout, auteur de science-fiction pratiquement inconnu, car publié dans des parutions pornographiques (comme il n’est pas rétribué pour ses œuvres, il travaille aussi dans les fenêtres et volets anti-tempêtes en aluminium), est invité par erreur à prendre la parole lors du festival d’inauguration du Centre artistique Mildred Barry à Midland City. C’est un pessimiste qui imagine sans cesse des histoires comme autant d’expériences de pensée, et se prend pour « les yeux et les oreilles et la conscience du Créateur de l’univers » ; pour lui les miroirs sont des « vides ».
« Ils roulèrent en silence pendant un moment, puis le conducteur fit une autre observation pertinente. Il dit qu’il avait conscience que son camion transformait l’atmosphère en gaz toxique, et qu’on transformait la planète en bitume pour que son camion puisse circuler n’importe où.
– Donc je suis en train de me suicider, dit-il.
– N’y pensez pas, dit Trout.
– Mon frère, c’est encore pire, continua le conducteur. Il travaille dans une usine qui fabrique des produits chimiques pour détruire les arbres et les plantes au Vietnam.
Le Vietnam était un pays dans lequel l’Amérique essayait d’empêcher la population d’être communiste en lui larguant diverses choses de ses avions. Les produits chimiques auxquels le conducteur faisait allusion servaient à détruire tout le feuillage, afin qu’il soit plus difficile pour les communistes de se cacher des avions.
– N’y pensez pas, dit Trout.
– À long terme, lui aussi est en train de se suicider, dit le conducteur. À croire que, ces jours-ci, les seuls emplois qu’un Américain puisse trouver reviennent à se suicider d’une manière ou d’une autre.
– Pertinent, dit Trout.
– J’ai du mal à savoir si vous êtes sérieux ou pas, dit le conducteur.
– Je ne le saurai moi-même que quand je découvrirai si la vie est sérieuse ou pas, dit Trout. Elle est dangereuse, soit, et elle peut faire beaucoup de mal. Ça ne signifie pas forcément qu’elle soit sérieuse, en plus de ça. »
C'est ainsi qu'est annoncé le thème principal du livre (assez dickien) :
« Le postulat du récit était le suivant : la vie était une expérience du Créateur de l’univers, qui souhaitait tester un nouveau type de créature qu’il envisageait d’introduire dans l’univers. Cette créature était dotée de la capacité à prendre des décisions elle-même. Toutes les autres étaient des robots entièrement programmés. »
Dwayne Hoover, riche concessionnaire Pontiac est cette « seule créature de l’univers douée du libre arbitre » ; « au bord de la folie », il est victime d’une « mauvaise chimie » selon l’auteur, qui intervient librement :
« Cette folie naissante, évidemment, était surtout une affaire de chimie. Le corps de Dwayne fabriquait des substances chimiques qui lui perturbaient l’esprit. Mais Dwayne, comme tout apprenti désaxé, avait également besoin d’une dose de mauvaises idées pour donner forme et sens à sa démence. »
Il y a d’autres personnages, comme Wayne Hoobler, une sorte de double inversé de Dwayne Hoover, un récidiviste noir qui sort de prison et cherche à s’intégrer à la société.
La rencontre longuement annoncée des trois personnages principaux (Trout, Hoover et Vonnegut) a lieu dans un bar à cocktails, et le récit contre-culture prend une dimension métaphysique, tout en atteignant un summum de loufoquerie : en lisant Trout, Dwaine se convainc d’être le cobaye solipsiste de l’expérience divine, uniquement entouré de machines.
Ce roman constitue aussi un fort beau spécimen de livre où l’auteur intervient en personne, ici en tant que Créateur de son univers ; plus que clin d’œil ou caméo, différent de l’autofiction, c’est la fabrique de l’ouvrage elle-même.
« Mon avis était que Beatrice Keedsler [une romancière] s’était alliée à d’autres conteurs ringards pour faire croire aux gens qu’il existait dans la vie des personnages principaux, des personnages secondaires, des détails significatifs, des détails insignifiants, qu’il y avait des leçons à en tirer, des épreuves à surmonter, et un début, un milieu et une fin.
À l’approche de mon cinquantième anniversaire, j’avais été de plus en plus furieux et perplexe face aux décisions idiotes que prenaient mes concitoyens. Et puis j’avais soudain fini par les prendre en pitié, car j’avais compris avec quelle innocence et quel naturel ils se conduisaient de manière si abominable, avec des conséquences si abominables : ils faisaient de leur mieux pour vivre comme les personnages qu’on rencontrait dans les histoires. Voilà pourquoi les Américains se tiraient si souvent dessus : c’était un procédé littéraire pratique pour terminer une nouvelle ou un livre.
Pourquoi tant d’Américains étaient-ils traités par leur gouvernement comme si leur vie était aussi jetable qu’un mouchoir en papier ? Car c’était ainsi que les auteurs avaient coutume de traiter les petits rôles dans les récits qu’ils inventaient.
Et ainsi de suite.
Quand je compris ce qui faisait de l’Amérique une nation si dangereuse et malheureuse d’individus qui n’avaient plus aucun rapport avec la réalité, je pris la décision de tourner le dos aux histoires. J’écrirais sur la vie. Chaque personnage aurait strictement la même importance que n’importe quel autre. Tous les faits pèseraient aussi le même poids. Rien ne serait laissé de côté. Aux autres d’apporter de l’ordre au chaos. Moi, j’apporterais du chaos à l’ordre, comme je crois y être parvenu.
Si tous les écrivains faisaient de même, alors peut-être les citoyens en dehors des cercles littéraires comprendraient-ils que l’ordre n’existe pas dans le monde qui nous entoure, qu’il nous faut au contraire nous adapter aux conditions du chaos.
C’est difficile de s’adapter au chaos, mais c’est possible. J’en suis la preuve vivante : c’est possible. »
\Mots-clés : #humour #social
- le Ven 14 Oct - 14:15
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Kurt Vonnegut, jr
- Réponses: 106
- Vues: 6665
Carlo Emilio Gadda
Des accouplements bien réglés
Parmi ces quatorze récits, Saint Georges chez les Brocchi est une novella qui tympanise sarcastiquement la bonne société milanaise, pudibonde et mécène de tradition ; la famille comprend notamment la comtesse, qui malgré l’égide des saints pour lesquels elle brode des nappes d’autel craint fort la dégradation morale en ce XXe (on est au printemps 1929), mauvaises fréquentations et lectures pour son fils Luigi (Gigi, dix-neuf ans, tracassé par son éveil sexuel), Jole l’avenante femme de chambre du comte, l’oncle Agamènnone qui compose une Éthique comme Cicéron pour édifier la jeunesse virile.
« Les bulbes oculaires du professeur, gonflés de dédain, vrombirent comme frondes pour projeter au loin ce grondeur projectile. Ses bras, forts et courts, mirent en mouvement des mains voletantes, grassouillettes : un frémissement de grives.
La Marietta, qui passait chargée d’un grand plateau, lui jeta un regard de commisération, et de travers – elle en avait assez de tout ce cirque : quand elles coïncident avec des propositions exagérément nobles et virilement martelées, même des yeux de bossue et des dents de cheval peuvent atteindre à une ironie de style. »
L'Incendie de la via Keplero décrit ses ravages dans un immeuble populaire, le sort de ses occupants et leur secours.
« Des cheminées et des usines du voisinage les sirènes hurlèrent vers le ciel torréfié : et la trame cryptosymbolique des voix électriques perfectionna les appels désespérés de l’angoisse. »
« Et le regard aussi, du reste, voilé, mélancolique, perdu dans le céleste abîme de la flemme, la partie supérieure de ses bulbes oculaires dissimulée par des paupières tombantes, en une espèce de sommeil-du-front, le regard aussi prenait quelque chose du Sacré-Cœur, comme ça, un peu à la Kepler, quand ce n’était que l’opération de la Sacrée Bonbonne. »
Bien nourri contient une remarquable description d’une demeure, qui commence ainsi :
« À l’Allòro, par le raccourci, on y arrive le souffle coupé : c’est la vieille villa sur la colline, une ferme à vrai dire, gardée du dehors par le donjon du Torracchio, du sommet du coteau, et l’escouade de ses noirs cyprès : qui figurent, dans le ciel, comme des lames effilées. »
« Dans la cour, un énorme jeune homme s’avançait pesamment : projetant à chaque pas tout son corps d’un côté, chargeant la jambe et le pied tour à tour avancés dans la marche : en une ondulation compressive, d’un pavé à l’autre, qui, à chaque nouveau mouvement du pied, semblait devoir écraser la tête d’un nouveau serpent. Il tenait une cigarette entre ses doigts, avec la gravité d’un chef de chantier. Enfin Lisa vint à sa rencontre en sautillant, laissant sautiller, sur ses épaules, le flot de ses beaux cheveux qu’un ruban retenait à mi-vague : et avec plus d’un trille, l’ayant pris par la main, elle l’introduisit chez Mme Gemma. Comme le remorqueur introduit le navire dans le port. »
Socer Generque, comme d’autres textes, évoque la guerre et le fascisme.
« Un mois plus tard en effet, avenue des Chemises-Noires, deux vagissements vinrent au monde, l’un après l’autre, deux petits monstres sans chemise, mais dotés chacun d’un petit engin : à la grande joie du Premier Maréchal d’Italie, qui subodora aussitôt en eux deux futurs chômeurs qu’on pourrait envoyer crever, pour le plus grand bien de l’Italie, l’un en Russie, l’autre en Libye. »
Accouplements bien réglés : un autre novella, qui traite de la transmission du capital, la « privée, très privée, propre et personnelle propriété », avec un réjouissant pataquès juridique.
« Tout comme la goutte d’eau se gonfle en s’irisant, et petit à petit se sphéricise, sous l’augmentation constante de son propre poids, au bord extrême de la gouttière : jusqu’à l’instant où, tac, elle s’en décolle tout soudain : et dans le court moment de sa chute, acquiert son identité particulière et prend le nom de goutte d’eau, Berkeley lui-même ne l’appellerait pas autrement ; elle appartient pendant deux secondes, le temps d’atterrir sur le cou de qui, au passage, en frissonne, à une vaste certitude : la certitude du « réel » historique orchestré par Dieu, historicisé par Hegel, exalté par Carlyle. Elle, la goutte, à peine captée par la dialectique de l’histoire ou la vertèbre cervicale du passant, s’évapore aussitôt : comme la Substance du marquis de Château Flambé dans le creuset dialectique de l’an 1792. »
« La concomitance d’un certain nombre de faits amène à maturation, par une opération combinatoire, d’autres faits dont la somme constitue, à nos yeux, l’après-coup logique des premiers, et nous donnons à cette somme le nom de destin, de fatum : l’interprétant comme un énoncé contraignant ou normatif éructé de bouche de prophète. »
Ce recueil me paraît constituer une entrée privilégiée dans le monde des proliférantes ramifications gaddéennes, divagations langagières que de plus longs textes rendent plus ardue ; pour vraiment y pénétrer, il me semble qu’il faudrait maîtriser l’italien de manière approfondie, ainsi que ses dialectes, et les domaines abordés (comme l’antiquité romaine, nombre d'auteurs, etc.) …
\Mots-clés : #humour #nouvelle
- le Mar 11 Oct - 14:38
- Rechercher dans: Écrivains Italiens et Grecs
- Sujet: Carlo Emilio Gadda
- Réponses: 34
- Vues: 3192
Mark Twain
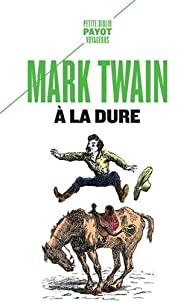
A la dure
J'aurais mis le temps pour revenir partager quelques mots sur ce livre, et si je vais faire court ce sera néanmoins de bon coeur.
Pour faire injsutement synthétique qu'ai je trouvé dans ce livre :
- une lecture divertissante, pleine d'humour
- un mélange de récit de voyage et d'aventure
- un stupéfiant panorama d'images des mythes américains
De la ruée vers l'or à Hawaii, San Francisco, de galeries de personnages en péripéties improbables, c'est baignés de bonne humeur que l'on voyage au fil de ce journal. Et les images fortes que l'on parcourt sont d'étonnants échos à nos visions de films si ce n'est d'actualités et d'étrangetés d'outre atlantique.
Le ton y est pour beaucoup mais la matière vaut le détour. Super lecture avec des moments incroyables !
Mots-clés : #aventure #humour #lieu #voyage #xixesiecle
- le Dim 9 Oct - 13:04
- Rechercher dans: Écrivains des États-Unis d'Amérique
- Sujet: Mark Twain
- Réponses: 34
- Vues: 3281
Éric Chevillard
Prosper à l'œuvre
Retour de Prosper Brouillon dans ce petit livre désopilant, où notre auteur s’essaie au polar. Les poncifs rappellent de façon hallucinante la façon dont ce thème est invariablement décliné en série sur notre télé nationale. C’est hilarant, comme les acceptions de l’adjectif "goguenard", rattaché à Van Gogh, puis Gauguin par notre romancier à succès.
Nos médiatiques producteurs nationaux de page-turners sont une fois encore écornés de tout cœur ; en fait c’est tout le business de l’édition nationale qui est férocement satirisé.
« Il enchaînera directement avec le festival Pleines Pages de Tarloire-sur-Vilaine, où il a accepté de prononcer une conférence (« Mots et mottes »), puis avec Les Encrières de Clonche qui attirent dans un décor riant malgré la pluie un public chaque année plus âgé. De là, il est attendu aux Journées de L’Ivre Livre d’Anchoix pour une lecture publique des Gondoliers (accompagnée à la scie musicale par Jean-Estève Ducoin). »
« Oui, car force est de reconnaître que les Lettres à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke, datent un peu. Datent même de 1929 ! Certaines de ses recommandations ne sont plus aussi pertinentes aujourd’hui.
Le marché n’est plus du tout le même. »
« La littérature pour Prosper Brouillon n’est pas un simple divertissement.
Elle n’est pas une de ces vaines passions impérieuses et vitales.
Il se fait d’elle une plus haute opinion.
Il y a de fortes sommes en jeu. »
« Le commandant arrache une tenture, frappe du poing contre le mur.
Ça sonne creux.
Nous sommes bien chez Prosper Brouillon. »
Chevillard crache dans la soupe (au moins dans celle de ses confrères) – et c’est un régal…
\Mots-clés : #humour #universdulivre
- le Lun 19 Sep - 12:21
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Éric Chevillard
- Réponses: 117
- Vues: 8222
Georges Perec
Les Revenentes
Prière d'insérer :
« − Vous avez lu quelque part que la lettre la plus fréquemment utilisée de la langue française était la voyelle "e". Cela, bien sûr, vous a semblé injuste, et même intolérable, et vous avez décidé d’agir. – Vous avez donc pris un dictionnaire de la langue française et vous avez recueilli tous les mots "sans e". Vous vous en êtes servi pour raconter une histoire que vous avez appelée, évidemment, La Disparition. – Néanmoins, vous n’étiez pas entièrement satisfait. Il vous semblait que vous n’aviez fait que la moitié du chemin. Vous avez donc récidivé, en prenant, cette fois-ci, les mots ne comportant que la voyelle "e", c’est-à-dire les mots "sans a", "sans i", – "sans o" et "sans u" ("y" est une semi-voyelle et mérite un traitement particulier). Vous vous en êtes servi pour raconter une histoire qu’à juste titre vous avez intitulée “Les Revenentes”. – Vous serez peut-être surpris de constater que vos deux ouvrages se ressemblent par de nombreux traits bien qu’ils n’aient aucun mot en commun. »
L’intrigue est confuse, entre la convoitise des gemmes de Thérèse Merelbeke et le libertinage au sein de l'évêché d'Exeter, notamment à cause de la difficulté à lire cette histoire (gêne beaucoup plus grande, dans mon souvenir, que pour La Disparition).
Perec prend rapidement des libertés avec l’orthographe, qui use de l’homophonie jusqu’au calembour :
« Mets le chef reste ferme et prétend qe Thérèse est décédée ! »
Le « i » est rendu par deux « e » :
« Entre Frence et Engleterre, le jet fend l’éther. Thérèse prend le thé et feyette négleegemment l’Express »
Les jeux de mots deviennent abracadabrants :
« T’es percé, mec, j’vé te descendre qe c’en est pédestre ! »
Le franglais est appelé à la rescousse :
« J’erre vènement de mess en self et d’estemeenet en denceengs. »
Puis le récit vire à la débauche licencieuse comme au burlesque :
« Estelle relève l’embètente leeqette de l’Evêqe, besse le sleep (c’est éveedemment qelqe sleep « Emeenence », « the best ») et de ses feengers experts encercle le membre frêle de l’Evêqe. »
La contrainte que s’est imposé Perec donne quand même de savoureuses phrases.
« Teek tek, teek tek, le temps se trène. »
Une référence de circonstance à La Lettre volée de Poe :
« − Certes, mets je le décèle ézément : Te rémembères les « Lettres Menqentes » : le meyer recette de céler est de sembler lesser en éveedence ! »
\Mots-clés : #erotisme #humour
- le Mar 6 Sep - 12:26
- Rechercher dans: Écrivains européens francophones
- Sujet: Georges Perec
- Réponses: 38
- Vues: 2223
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 


 Accueil
Accueil Nouveaux messages
Nouveaux messages
